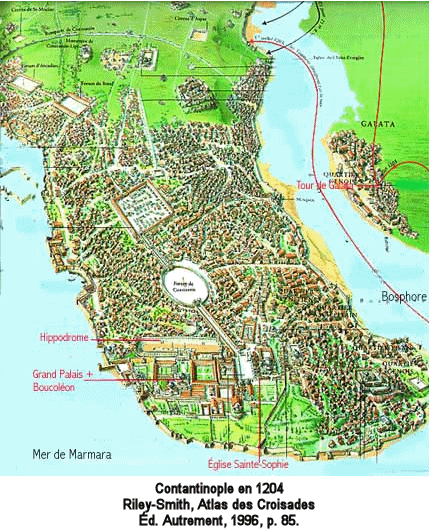HISTOIRE DES CROISADES
LIVRE SECOND
|
[1096] APRÈS le départ de Pierre l’ermite et la
déplorable catastrophe qui frappa son armée, après le massacre des légions
que Gottschalk avait traînées à sa suite, enfin après la déroute de cette
immense expédition de croisés qui étaient arrivés sur les frontières de la
Hongrie, Godefroi, duc de Lorraine, ayant convoqué tous ceux qui, devaient l’accompagner
et rassemblé, selon la coutume, tous les bagages, se mit en route dans le
courant de la même année[1], le 15 du mois d’août.
Les hommes nobles et illustres qui se réunirent dans son camp et dont la
mémoire mérite d’être conservée à jamais, étaient le seigneur Baudouin, frère
utérin du duc ; le seigneur Baudouin de Mons, comte du Hainaut ; le seigneur
Hugues, comte de Saint-Paul, et Engelram son fils, jeune homme de grande
espérance ; le seigneur Garnier, comte de Gray ; le seigneur Renaud, comte de
Toul, et Pierre son frère ; le seigneur Baudouin du Bourg, parent du duc ; le
seigneur Henri de Hache, et Godefroi son frère ; Dudon de Conti, Conon de
Montaigu, et beaucoup d’autres encore dont nous n’avons pu conserver ni les
noms, ni le nombre. Tous, marchant ensemble et suivis chacun de sa troupe,
arrivèrent le 20 septembre dans la province que l’on appelle Autriche, et au
lieu nommé Tollenbourg[2], ayant voyagé
sans le moindre accident et tous sains et saufs. Cette ville est située sur
la Leytha, au point où elle détermine les confins de l’Empire et du royaume
de Hongrie. La nouvelle des malheurs qu’avaient éprouvés les légions de
Gottschalk était parvenue aux Croisés, et ils délibérèrent, dans leur
sollicitude, sur les Moyens de poursuivre leur entreprise en toute sûreté.
Après avoir tenu un conseil, ils résolurent d’envoyer une députation au roi
de Hongrie, afin d’être parfaitement instruits des motifs qui avaient amené
la destruction des armées précédentes, d’écarter tout souvenir des anciennes
querelles, et de conclure avec le roi un traité de paix en vertu duquel il
fût permis à l’armée ne traverser librement Le seigneur Godefroi, duc de Lorraine, homme illustre et magnifique, et les autres princes, serviteurs de Dieu, qui sont avec lui tous dévoués à un service divin, nous ont envoyés auprès de Votre Éminence, désirent savoir par notre intermédiaire par quels motifs ce peuple de fidèles, dont les débris se sont fréquemment présentés à nous sur notre route, a trouvé auprès de vous, qui vous dites du nombre des fidèles, une si grande inhumanité qu’il eût mieux valu pour lui rencontrer des ennemis, quels qu’ils fussent. Que si ce peuple a commis des fautes telles qu’il ait mérité d’être puni des plus grands supplices, ceux qui m’envoient sont tout disposés à prendre en patience sa destruction. Quelle que soit la peine que l’on inflige, si elle est méritée, elle ne saurait exciter la colère et doit être supportée avec résignation. Que si, au contraire, et sans avoir aucun motif, vous avez calomnié et livré à la mort des innocents, ceux au nom de qui je parle ne sauraient souffrir en silence l’injure faite à ces serviteurs de Dieu, et ils sont tout prêts à venger le sang de leurs frères. Ils attendent donc votre réponse que nous sommes chargés de leur rapporter, et c’est d’après elle qu’ils régleront leurs pensées. Il dit, et le roi, entouré de la foule de ses satellites, lui répondit : Godefroi, homme de nos affections, à qui nous avons depuis longtemps accordé nos bonnes grâces à cause de tes mérites, nous voyons avec plaisir que tu sois venu vers nous, tant afin de resserrer avec toi les noeuds de notre ancienne amitié, que pour pouvoir protester de notre innocence auprès d’un juge aussi éclairé. Nous sommes en effet, comme tu le dis, du nombre des fidèles ; et plaise au ciel qu’il nous soit possible de justifier cette dénomination par nos œuvres ! Mais tous ceux qui vous ont précédés, tant ceux qui suivaient Pierre l’ermite, que ceux qui marchaient avec Gottschalk et ceux qui ont voulu s’emparer d’un de nos forts sur les frontières de notre royaume et y pénétrer de vive force, ne se sont montrés serviteurs du Christ ni de fait, ni de nom. Après que nous avons eu donné l’hospitalité à Pierre et à son armée, partageant avec eux les biens qui nous appartenaient, soit à titre gratuit, soit à des prix modérés, semblables au serpent dans le sein qui le réchauffe, ou à la souris renfermée dans la besace, ils ont bien mal reconnu les bons services de leurs hôtes. A l’extrémité des frontières de notre royaume, et lorsqu’ils eussent dû nous rendre des actions de grâces pour tant de bienfaits, ils ont forcé les portes d’une de nos villes, détruit presque entièrement le peuple qui l’habitait, et ils s’en sont allés, comme des voleurs de grand chemin, emportant avec eux d’immenses dépouilles et traînant à leur suite le gros et le menu bétail. Cependant, et comme si nous n’avions reçu aucune injure de ces premiers voyageurs, nous avons admis ensuite l’expédition de Gottschalk ; et ses légions sont entrées sans difficulté et sans trouble : au milieu même de ce royaume elles n’ont pas craint de se livrer au pillage, de porter partout le fer et le feu, de massacrer les habitants sur les plus frivoles motifs, et l’énormité de leurs péchés a enfin provoqué la colère du Seigneur. Nous aussi, ne pouvant tolérer les offenses commises envers nos sujets, nous avons mis la main à l’œuvre et avons cherché les moyens de prévenir des dangers si pressants. Avertis, par de tels exemples, de la nécessité d’e ne point nous exposer une troisième fois aux violences de ces détestables expéditions, nous avons jugé qu’il était plus prudent d’éloigner des frontières de notre royaume ces bandes impies d’hommes frappés sans doute de la colère de Dieu, plutôt que d’avoir à souffrir d’immenses dommages et d’éternelles insultes, ou de marcher contre eux en les traitant comme des ennemis. Qu’il nous suffise, homme prudent et sage, de t’avoir dit routes ces choses pour notre justification : nous n’avons rapporté que la pure vérité, comme il est vrai que le Seigneur est vivant. A ces mots, le roi ordonna que les députés fussent reçus avec bienveillance et traitas le plus honnêtement possible, jusqu’à ce qu’il eût tenu conseil avec les siens et nommé des députés qu’il enverrait aux princes, pour leur porter une réponse convenable. Il chargea donc, quelques-uns de ses domestiques de partir avec les députés du camp et de transmettre au duc et aux princes le message qu’il leur avait confié : Nous avons appris, et nous savions déjà depuis longtemps par la renommée, que tu es estimé, à juste titre, parmi les tiens, comme un prince grand, illustre et excellent, et que les hommes sages et prudents admirent en toi la bonne foi et la sincérité unies à la force et à la grandeur d’âme. Nous aussi, séduits par ta bonne réputation et par l’importance de ton entreprise, nous voulons, quoique tu sois absent, te bien traiter et t’honorer le plus promptement qu’il nous sera possible. Nous croyons que les hommes nobles qui sont avec toi, animés d’un zèle vraiment chrétien, n’ont due de pieuses intentions ; aussi nous ne voulons point tenir inutilement en réserve les bons offices par lesquels on peut s’acquérir des amis ; nous sommes tout prêts à montrer à tous l’amour que nous leur devons et à leur donner, par l’abondance de nos oeuvres, des gages de notre tendresse fraternelle. C’est pourquoi, puisque l’occasion se présente, nous désirons que tu veuilles bien te rendre en personne à notre château, nommé Ciperon[3], afin que nous puissions avoir avec toi une entrevue depuis longtemps désirée, et convenir de choses qui seront conformes à tes vœux. » Le duc, après avoir reçu ces’ dépêches et tenu conseil avec les chefs, se rendit le jour indiqué au lieu qui lui était désigné, accompagné de trois cents chevaliers choisis dans toute l’armée. Il traversa le pont et trouva le roi, qui le reçut avec beaucoup de bonté et lui rendit les plus grands honneurs. Ils vécurent ensemble dans une parfaite amitié, et convinrent enfin que l’armée donnerait des otages choisis parmi les nobles, que des deux parts on renoncerait à toute animosité, que la paix serait complètement rétablie, et que le duc entrerait librement dans le royaume a la tête de, ses légions, Le roi, pour avoir un gage plus assuré de la bonne conduite d’une si grande quantité d’hommes aunes, et pour prévenir, autant que possible, tout accident qui pourrait les porter à commettre :quelque désordre, par une confiance excessive en leurs forces et en leur nombre, demanda qu’on lui livrât comme otages Baudouin, frère du duc, avec sa femme, et sa famille. Le duc y consentit avec empressement ; son frère se rendit auprès du roi, conformément aux conventions, et l’armée entra en Hongrie. Le roi, de son côté, exécutant fidèlement ses promesses, ordonna par des édits qu’il fit publier dans tous les pays que l’armée devait traverser, que l’on eût à fournir aux légions toutes les choses nécessaires à leur subsistance, à des prix modérés et à de bonnes mesures, et il prescrivit de plus aux marchands de porter à la suite. des voyageurs toutes sortes de denrées. Le duc donna aussi des ordres particuliers et fit publier par des hérauts, dans tout le camp, la défense expresse de se livrer à aucun acte de pillage, de violence, ou d’insulte contre ceux qui s’approcheraient de l’armée, sous peine de mort et de confiscation des biens contre tout contrevenant ; en même temps il invitait tous les pèlerins à conclure leurs marchés de vente ou d’achat comme de bons frères qui sont unis par des liens de gloire et de charité. Il en résulta que la miséricorde divine marcha en tête de l’armée et que celle-ci traversa toute la Hongrie sans qu’il se fût élevé la moindre querelle entre les voyageurs et les indigènes. Le roi la suivait de prés avec toutes ses troupes, conduisant avec lui les otages, prêt à pourvoir à tout événement fâcheux et à apaiser par sa présence tout commencement de sédition. Lorsqu’on fut arrivé à Malaville[4], dont j’ai déjà parlé plusieurs fois, on s’arrêta sur les bords du fleuve Savoé[5], jusqu’à ce qu’on eût fait les dispositions nécessaires pour le passage de l’armée. On fit faire des radeaux, parce qu’on n’avait trouvé qu’un 1rés-petit nombre de bâtiments propres à transporter une aussi grande quantité de monde : d’abord on fit passer mille cavaliers bien cuirassés, qui allègent s’établir sur la rive opposée pour la garantir de toute embûche ennemie, afin que l’armée pût passer en sûreté et prendre tranquillement ses nouvelles positions. A peine était-elle arrivée sur l’autre bord, ayant en tête quelques uns de ses chefs, que le roi de Hongrie s’avança accompagné de tous les siens, et remit aussitôt entre les mains du duc le seigneur Baudouin, sa femme et tous les otages, ainsi qu’il avait été convenu dès le principe ; puis il offrit de riches présents au duc et à tous les autres princes, et se remit en route pour entrer dans le sein de ses États. Le duc, suivant ses légions, traversa tout de suite le fleuve avec les princes et tous ceux qui étaient restés auprès de lui ; on arriva à Belgrade, ville de Bulgarie, dont j’ai déjà fait mention, et l’on y dressa le camp. De là les bagages et les légions se mirent de nouveau en route, traversèrent la Bulgarie, vaste contrée, remplie de forêts qui s’étendent de toutes parts, et arrivèrent d’abord à Nissa et ensuite à Stralicie[6]. Il était facile de reconnaître quelles étaient alors la
misère des Grecs et la faiblesse de leur empire, d’après l’état de ces
contrées, où avaient été autrefois des provinces riches et fertiles, dans lesquelles
on trouvait toutes les douceurs et tous les agréments de Le duc ayant donc traversé avec toutes les légions la Dacie méditerranéenne, autrement dite Mœsie, passa ensuite les défilés vulgairement appelés de Saint-Basile, et descendant dans un pays plus uni, où il trouva des vivres en grande abondance, il arriva à Philippopolis, ville illustre et très peuplée. Il apprit alors que le seigneur Hugues-le-Grand, frère de Philippe, roi de France, ainsi que quelques autres nobles, étaient retenus captifs par l’empereur. Il expédia en toute hâte des dépêches et des messagers chargés d’inviter, et, au besoin, de sommer l’empereur de rendre la liberté à ces hommes qui accomplissaient leur voeu de pèlerinage, et qui avaient été jetés dans les fers sans avoir commis aucune faute. L’illustre Hugues-le-Grand, qui s’était mis en route l’un des premiers, avait traversé les Alpes, était descendu en Italie, et, se rendant de là dans la Pouille, il avait passé la mer avec une faible escorte, et débarqué à Durazzo, pour y attendre les princes qui venaient après lui, ne craignant nullement qu’il pût lui arriver le moindre événement fâcheux dans ce royaume des Grecs qu’on croyait attachés et fidèles à la communion chrétienne. Cependant le gouverneur du pays, après l’avoir fait arrêter et charger de fers, l’avait envoyé à l’empereur pour être livré au bon plaisir du souverain. Celui-ci le retenait en prison, comme s’il eût été un voleur ou un homicide, et en attendant, disait-il, l’arrivée des autres princes ; en sorte que, s’ils arrivaient en effet, il pût paraître lui avoir rendu la liberté pour l’amour d’eux, tandis que, dans le cas contraire, il lui était facile de le retenir toute sa vie dans les fers. L’empire des Grecs était gouverné à cette époque par un homme méchant et plein de fourberie, nommé Alexis, et surnommé Comnène. Cet homme avait vécu dans le palais impérial, comblé d’honneurs par Nicéphore ; surnommé Botoniate, qui portait alors le sceptre. Alexis était revêtu de la dignité de mégadomestique, qui correspond à ce que nous appelons la charge de grand-sénéchal, et en remplissait les fonctions. Son rang le plaçait immédiatement après l’empereur ; mais, se révoltant méchamment contre son maître et son bienfaiteur, il avait détrôné l’empereur, et usurpé sa place cinq ou six ans avant l’arrivée des peuples d’Occident[7], et il osait se maintenir sur le trône, après l’avoir occupé de vive force. Les envoyés du duc, s’étant donc présentés devant ce
souverain, lui demandèrent avec les plus vives instances, conformément à
leurs ordres, de mettre en liberté l’illustre Hugues, et ceux qui
raccompagnaient. L’empereur s’y refusa positivement, et les députés allèrent
rejoindre nos légions qui venaient de dépasser Andrinople ; et avaient dressé
leur camp dans un pays de pâturages. Sur le rapport que leur firent les députés,
que l’empereur n’avait voulu con= sentir, à aucun prix, aux demandes qui lui
étaient faites, le duc et les princes tinrent un conseil, à la suite duquel
tout le pays qu’on occupait fut livré à discrétion aux légions. L’armée y
demeura pendant huit jours, et cette contrée fut complètement ravagée. L’empereur,
dès qu’il en fut instruit, envoya des députés au duc pour lui demander de
faire cesser le pillage, et lui annoncer en même temps qu’on allait lui
remettre les prisonniers dont il avait sollicité A peine cependant s’étaient-ils félicités tour à tour par de tendres embrassements et dans des entretiens intimes, qu’on annonce des députés de l’empereur, qui viennent inviter le duc à se rendre auprès de lui avec quelques-uns des siens. Le duc tint aussitôt un conseil, et chercha à éluder cette proposition. L’empereur en conçut une grande colère, et fit interdire l’accès de tous les marchés aux légions qui venaient d’arriver. Les princes voyant que le peuple qu’ils conduisaient allait être réduit à manquer de tout, tinrent (le nouveau un conseil. Des bandes de gens armés se répandirent aussitôt dans les faubourgs et dans les campagnes, et ramenèrent de tous côtés des bestiaux et des vivres de toute espèce, en si grande abondance que les moindres individus de l’armée en avaient beaucoup plus qu’ils ne pouvaient en consommer. L’empereur, apprenant que le pays était livré au pillage et à l’incendie, et redoutant de plus grands malheurs, retira sa première défense, et les marchés furent r’ouverts. Comme les fêtes solennelles de Noël approchaient, les princes ordonnèrent, par un sentiment religieux, que l’armée eût à s’abstenir, pendant les quatre jours de fête, de tout pillage et de toute insulte envers qui que ce fût. Cette époque de solennité fut célébrée en effet dans le plus grand calme. L’empereur envoya alors un nouveau messager porteur de paroles pacifiques qui ne servaient qu’à cacher ses ruses. Il faisait proposer au duc de passer le pont qui est situé auprès du palais appelé Blachernes, afin que les légions allassent s’établir dans les nombreux palais qui sont bâtis sur le rivage du Bosphore. Il n’eut pas de peine à faire agréer sa proposition. Le camp était exposé à toutes les rigueurs de l’hiver ; des torrents de pluie l’inondaient à tel point que les pavillons en étaient à peine garantis par leurs auvents ; les vivres, lès bagages se corrompaient et pourrissaient dans l’humidité sans cesse entretenue par des pluies continuelles. Les hommes, les chevaux et tous les animaux n’auraient pu résister plus longtemps à la vivacité du froid et à l’abondance de la neige qui tombait presque sans relâche ; enfin, les maux qu’on avait à endurer surpassaient les forces de tous. L’empereur, tout en paraissant compatir à ces souffrances, avait cependant de bien autres projets ; il ne désirait voir accepter ses propositions qu’afin de resserrer nos légions sur un terrain plus étroit, pour leur enlever ainsi les moyens de se répandre au dehors, et pour pouvoir lui-même les contenir plus sûrement, et se conduire selon ses caprices. Mais, afin de faire mieux comprendre quelles pouvaient être ses intentions, il me paraît nécessaire de donner une description du site de Constantinople.
La mer du Pont, qui reçoit son nom de la contrée
adjacente, est située au nord de Constantinople, a une distance de trente
milles. De là une portion de cette mer descend vers le Tandis que nos légions demeuraient là, attendant l’arrivée
des autres princes, le duc recevait de fréquents messages, par lesquels l’empereur
l’invitait à venir le voir, Mais, se méfiant de son amitié et redoutant ces
entretiens, le duc cherchait toujours à les éluder. Il jugea cependant qu’il
serait tout à fait inconvenant et contraire à toutes les lois de l’honnêteté,
de ne pas lui envoyer du moins des hommes capables de le représenter, s’il n’y
allait lui-même en personne. Il fit donc porter ses excuses à l’empereur et
chargea de cette mission le seigneur Conon de Montaigu, Baudouin du Bourg et Henri
de Hache. L’empereur, ne sachant comment triompher de la résistance du duc,
imagina de nouveau d’interdire les marchés à notre armée. Mais cette mesure
ne put ébranler un homme si ferme. Alors, appesantissant sa main, l’empereur
envoya en secret des archers, qui s’embarquèrent, vinrent aborder du côté du
camp, et dès le matin, au premier crépuscule, lancèrent une grande quantité
de flèches sur ceux des nôtres qui étaient descendus au bord de la nier, ou
qui regardaient des fenêtres des palais qu’ils habitaient : ils tuèrent de
cette manière plusieurs de nos soldats. Dès que le duc en fut informé, il
convoqua sur-le-champ tous les princes, tint un conseil et ordonna à son frère
de se porter en avant avec une partie des troupes et d’aller s’emparer du
pont par où l’armée avait passé, afin qu’elle ne se trouvât pas resserrée et
exposée aux plus grands dangers dans les défilés qu’elle occupait. Baudouin
prend aussitôt cinq cents cavaliers bien cuirassés, court en toute hâte au
pontet s’en empare de vive force. Il était temps ; non seulement ceux qui s’étaient
approchés du camp sur les vaisseaux se montraient déjà en ennemis, mais toute
la ville elle-même se mettait en mouvement et prenait les armes. Les nôtres
voyant bien que ce n’était pas saris méchante intention qu’on leur avait
préparé de nombreux adversaires, et que tous les citoyens se réunissaient
pour les accabler, mirent le feu à tous les palais où ils avaient été logés et
l’incendie s’étendit, sur une longueur de six à sept milles, tant : aux bâtiments
des particuliers qu’à ceux qui appartenaient à l’empereur. Cependant les cors
et les clairons rappelèrent les soldats de tous les points qu’ils occupaient
; ils coururent aux armes en toute hâte, et le duc à mesure qu’ils arrivaient
les formait en bataillons et disposait tout pour le départ. Les bommes qui
avaient le plus d’expérience de l’art militaire craignaient que l’ennemi ne s’emparât
du pont ; et que l’armée ne fût facilement accablée dans l’étroit défile ; où
elle se trouvait engagée. C’est pourquoi on se hâta d’envoyer d’abord des
cavaliers, sans attendrie la réunion des corps d’infanterie. Baudouin, ainsi
que je l’ai dit, avait couru au pont pour s’en emparer de vive force, et
après en avoir chassé l’ennemi ; il s’était établi sui l’autre rive pour
protéger le passage. Le duc arriva en effet à la tête de ses légions,
emmenant aussi les bagages et les approvisionnements de toute espèce, et l’armée
passa sans aucune difficulté, et s’arrêta en dehors de la ville, dans une
plaine vaste et ouverte de toutes parts. Vers le soir on livra combat entre l’église
des saints martyrs Côme et Damien — aujourd’hui vulgairement appelée le
château de Boémond —, et le palais neuf de Blachernes, situé à un angle de la
ville, tout près du port ; les Grecs y perdirent beaucoup de monde, et ne
pouvant résister à l’attaque de notre armée, ils se retirèrent dans Le lendemain, à la pointe du jour, le duc ordonne et fait publier partout que l’armée ait à prendre les armes ; qu’une partie des troupes, marchant sous les chefs qui seront désignés, parcoure toute la,contrée, pour aller chercher des vivres, puisque l’empereur a interdit les marchés, qu’on cherche les moyens de s’en procurer, soit de vive force, soit à prix d’argent, qu’on ne laisse en arrière ni le gros et le menu bétail, ni les grains, ni enfin tous les approvisionnements de bouche que l’on pourra rassembler ; et il annonce que pendant ce temps il restera lui-même avec les autres chefs et une portion de l’armée, pour veiller à la sûreté du camp : car, ayant découvert la perfidie de l’empereur et des siens, on prenait toutes les précautions possibles pour se défendre de ses piéges. Ceux qui partirent pour aller fourrager formaient des troupes nombreuses de gens à pied et à cheval : pendant six jours de suite ils battirent tout le pays et se répandirent jusqu’à soixante milles à la ronde : le huitième jour ils rentrèrent au camp, rapportant d’immenses, provisions, plus qu’il ne serait possible de l’évaluer, à tel point qu’ils avaient grand’peine à se faire suivre de tous les bestiaux, des chariots et des bêtes de somme qu’ils tramaient après eux. Tandis que ces choses se passaient dans le camp, un messager arrive, se présente devant le duc de la part du seigneur Boémond, et lui remet une lettre ainsi conçue : Sachez, homme excellent, que vous avez affaire avec la plus mauvaise bête féroce et l’homme le plus scélérat qui existe ; son dessein est de tromper toujours, et de tourmenter de toutes les manières possibles, et jusqu’à la mort, toutes les nations latines. Une fois ou l’autre, vous reconnaîtrez par votre expérience que je parle de lui comme il le mérite. Je connais la malice des Grecs, et leur haine obstinée et implacable pour le nom latin. Ainsi donc, quittez cette ville s’il vous plaît, rendez-vous dans les environs d’Andrinople ou de Philippopolis, et donnez des ordres pour que les légions que le Seigneur vous a confiées puissent se réjouir dans un pays fertile où elles trouveront le repos et des vivres en abondance. Pour moi, avec l’aide de Dieu, je-me hâterai de vous rejoindre vers le commencement du printemps, pour vous offrir, avec des sentiments fraternels et comme à mon seigneur, mes conseils et mes secours contre le prince impie qui commandé aux Grecs. Après avoir lu et examiné avec attention le contenu de cette lettre, le duc tint un conseil des princes, et répondit ensuite de vive voix par l’intermédiaire du messager, et aussi par écrit : J’ai su, mon très cher frère, et depuis longtemps la renommée m’avait appris, que les Grecs astucieux ont toujours pris soin de poursuivre notre peuple d’une haine ardente et inexorable. S’il m’eût manqué quelque lumière à ce sujet, chaque jour m’apprendrait à le mieux reconnaître. Je ne doute point que les sentiments qui vous animent contre eux ne soient très fondés, et que vous ne les jugiez comme ils le méritent. Mais ayant toujours devant les yeux la crainte de Dieu, et considérant l’objet de mon expédition, je répugne à diriger contre un peuple chrétien les coups destinés aux infidèles. L’armée agréable à Dieu, qui est avec nous, attend avec la plus grande impatience votre arrivée, et se réjouit de la présence des autres princes qui se sont consacrés au Seigneur. L’empereur cependant, ainsi que tous ses domestiques et ses familiers, était fort inquiet, soit en voyant toute la contrée exposée au pillage, et en entendant les plaintes et les lamentations de tous ses sujets, soit en apprenant que le seigneur Boémond avait envoyé des messagers pour porter la nouvelle clé sa prochaine arrivée. Craignant, s’il ne parvenait à apaiser le duc avant la venue des autres princes, que tous ne se réunissent pour travailler de concert à sa ruine, l’empereur fit de nouveau solliciter le duc de se rendre auprès de lui ; il insista même beaucoup plus vivement qu’il ne l’avait fait encore ; il lui proposa de lui envoyer en otage son fils Porphyrogénète, et l’invita, aussitôt qu’il aurait reçu ce gage de sa foi, à s’avancer vers le palais, sans conserver la moindre crainte. Ces propositions ayant été agréées par les princes, et Conon de Montaigu et Baudouin du Bourg étant allés recevoir le fils de l’empereur de ses propres mains ; on le confia à’ la garde élu frère élu duc, et celui-ci, se faisant accompagner des autres princes, laissa à son frère le commandement de l’armée, et se rendit à Constantinople, ou il s’était fait désirer si longtemps. L’empereur le reçut avec les plus grands honneurs, en présence des hommes illustres de sa cour, empressés de voir celui dont ils avaient tant entendu parler, et qu’ils avaient appris aussi à connaître. Les princes qui’ l’avaient accompagné furent aussi honorés du salut impérial, ainsi que leur dignité leur en donnait le droit, et admis à recevoir le baiser de paix. L’empereur s’informa de leur santé avec le plus grand soin, interpellant chacun d’eux par son nom, afin de gagner leur bienveillance, et se montra extrêmement affable et bon envers tous. Enfin, se rapprochant du duc, il lui parla en ces termes : L’empereur a appris, duc très chéri, que tu es le plus puissant parmi les princes qui t’entourent ; il n’ignore point la pieuse entreprise que tu poursuis avec zèle, animé d’une fervente dévotion ; il sait, en outre, que la renommée célèbre de tous côtés la fermeté de ton courage et la sincérité de ta foi. Aussi, pour prix de tes hautes vertus, tu as conquis la bienveillance de beaucoup de personnes qui même ne t’avaient jamais vu. Nous également, voulant te montrer que nous avons pour toi des entrailles de père, et t’honorer d’une façon particulière, nous avons résolu de t’adopter aujourd’hui même comme notre fils, en présence des seigneurs de notre sacré palais, remettant ainsi notre Empire-en ton pouvoir, afin qu’il soit maintenu par toi dans toute son intégrité, en présence enfin de la multitude ici réunie, et de celle qui viendra encore s’y joindre. A ces mots, l’ayant fait revêtir des habits impériaux avec toutes les cérémonies qui étaient en usage à la cour pour célébrer la solennité de l’adoption, il le nomma son fils, selon la coutume du pays, et rétablit ainsi la paix et la bienveillance entre les deux nations. A la suite de cette cérémonie, l’empereur fit ouvrir ses
trésors tant au duc qu’à ses compagnons, et leur offrit, avec une grande libéralité,
de superbes présents en or, en pierres fines, en ouvrages de soie, en vases
précieux, objets magnifiques, et dont le prix ne pouvait être évalué, tant à
cause de l’élégance de la main-d’œuvre que de l’extrême beauté de Vers le milieu du mois de mars, le duc, ayant appris que les autres princes étaient arrivés dans les environs, et se disposaient à s’avancer avec leurs armées, fit tousses préparatifs pour traverser l’Hellespont, sur l’invitation de l’empereur, et du consentement de ses troupes et de tous les chefs ; il passa la mer, conduisit son armée en Bithynie, la première province que l’on rencontre dans l’Asie, et fit établir son camp auprès du bourg de Chalcédoine. C’est dans cette ville qu’au temps du pape Léon l’ancien et de l’empereur Marcien[9], se rassembla le quatrième concile général, qui fut composé de six cent trente-six Pères de l’Église, et qui s’unit contre les impiétés du moine Eutychès et de Dioscore, patriarche d’Alexandrie. Ce lieu, voisin de Constantinople, n’en est séparé que par le Bosphore ; on voit même la ville royale, et ceux qui y avaient affaire pouvaient facilement y aller et en revenir en trois ou quatre jours. L’empereur avait fortement insisté auprès du duc pour qu’il hâlât son départ et celui de son armée, mais sans lui parler avec franchise, et en usant toujours de ses ruses accoutumées : son intention Malt que les troupes du chic ne pussent pas se réunir à celles qui étaient sur le point d’arriver. Il usa du même artifice avec ceux qui vinrent successivement à Constantinople, et les força à partir toujours séparément, afin que cieux armées lie se trouvassent jamais ensemble devant la ville. Tandis que toutes ces choses se passaient à Constantinople
entre l’empereur et le duc de Lorraine, le seigneur Boémond, prince de
Tarente et fils de Robert Guiscard, qui, avant le commencement de l’hiver,
avait traversé L’empereur cependant, ayant appris que les légions de Boémond s’approchaient, ordonna secrètement aux chefs de ses armées, qu’il avait envoyées prendre leurs quartiers d’hiver dans les mêmes pays, de rassembler toutes les forces disponibles, et de suivre sans relâche la marche de Boémond jusqu’au fleuve Bardarius[12], en ayant soin de se tenir toujours de côté, afin de saisir toutes les occasions qui se présenteraient dans la nuit, vers le soir, à l’improviste, ou de toute autre manière, pour harceler constamment l’armée dans sa marche. Il avait en effet des raisons particulières de se méfier de Boémond ; ce seigneur, ainsi que son père, lui avait fait en diverses rencontres de vives insultes. Comme il était plein de ruses et habile à se montrer flatteur et à dissimuler ses projets, l’empereur envoya en même temps à l’illustre Boémond quelques nobles de sa domesticité, les chargeant de lui porter des paroles de paix, pour cacher ses artifices, et de tenter tous les moyens de le tromper. Voici ce que ces messagers avaient reçu ordre de lui dire, et ce qui était en même temps contenu dans les lettres qu’il lui adressait : Notre empereur, protégé de Dieu, a appris, et n’en doute nullement, que tu es un prince grand, puissant et accompli, fils d’un prince magnifique, très puissant et très habile. Aussi, et en raison de ton rare mérite, nous t’avons jusqu’à ce jour tendrement chéri et bien traité, quoique nous n’ayons jamais joui de ta présence. Maintenant que nous avons appris que tu entreprends un pèlerinage pour le service de Dieu, et pour accomplir une œuvre de piété, et que tu t’es adjoint d’autres princes également consacrés à Dieu, nous avons à cœur de t’aimer encore plus, et nous avons fortement résolu de t’honorer avec beaucoup plus de tendresse. C’est pourquoi, notre très cher, ordonne aux peuples qui marchent avec toi d’épargner tous nos sujets ; fais cesser la violence, les pillages, les incendies, et hâte-toi d’arriver le plus tôt possible en notre présence, afin que tu puisses jouir en toute sécurité des grands honneurs et des témoignages de bienveillance dont nous avons résolu de te combler. Nous avons prescrit à ceux qui te remettront les présentes, de faire donner à tes armées tout ce dont elles auront besoin pour de justes prix, et d’avoir soin qu’elles soient suivies, sans aucune interruption, de toutes sortes de denrées. Ces paroles qui semblaient n’exprimer que les meilleurs sentiments d’humanité, cachaient cependant un venin secret. Aussi Boémond, en homme adroit et pénétrant, ayant reconnu la méchanceté de l’empereur, dissimula avec, soin, et se tenant en même temps sur ses gardes, il lui fit rendre des actions de grâces pour la sollicitude qu’if daignait lui témoigner. Il arriva avec ses guides sur les bords du fleuve Bardarius. Déjà une portion de son armée l’avait traversé, et s’était reformée sur la rive opposée ; le reste se -disposait également à passer sur les bateaux, lorsque tout à coup les satellites de l’empereur, qui suivaient les traces des nôtres avec des forces considérables, croyant avoir trouvé une excellente occasion, se précipitent sur la portion de notre armée qui n’avait pas encore passé comme sur des ennemis et la pressent vivement. Tancrède, homme plein de bravoure et d’ardeur, ayant reconnu le mouvement, s’élance comme la foudre, traverse le fleuve à la nage, et rejoint la rive qu’il avait déjà abandonnée. Les cavaliers, au nombre de deux mille environ, le suivent de prés ; à peine arrivés sur l’autre bord, ils s’élancent sur les Grecs, enfoncent toutes leurs cohortes, les mettent en fuite, les poursuivent pendant quelque temps en leur tuant beaucoup de monde, et font aussi quelques prisonniers, qu’ils ramonent au camp et conduisent en présence de Boémond. Ce prince les interrogea avec soin, et leur demanda pour quel motif ils avaient attaqué l’armée chrétienne ? Ils répondirent qu’étant les hommes de l’empereur, et recevant de lui leur solde, ils étaient tenus de combattre conformément à ses ordres. Il devint dès lors évident aux yeux de tous que tout ce que l’empereur leur avait fait dire n’était que fraude et artifice : cependant, comme on devait traverser la capitale de l’empire, Boémond, contre l’avis de tous les autres, voulut que l’on dissimulât ses ressentiments, plutôt que de provoquer inutilement la colère de l’empereur. Après avoir traversé la Macédoine et toute l’Illyrie, l’armée hâtant sa marche en vertu des ordres de ses chefs, s’approcha auprès de la ville royale. Elle s’arrêta dans le voisinage, et le cinquième jour de fête, avant les solennités de Pâques, Boémond reçut une nouvelle députation de l’empereur, qui le faisait inviter à laisser ses troupes en arrière, et à se rendre à Constantinople avec quelques-uns des siens ; il hésita quelque temps, et redoutant de secrètes embûches, il chercha à retarder de jour en jour l’exécution des ordres qu’il recevait. Tandis qu’il était ainsi indécis et flottant dans ses résolutions diverses, l’illustre duc Godefroi, cédant aux instances et aux prières réitérées dé l’empereur, qui le suppliait d’aller à la rencontre de Boémond, et de le ramener saris crainte dans la ville, arrive au camp de celui-ci, accompagné d’un cortége magnifique de princes. Les tendres embrassements, les baisers de sincère amitié, témoignent la joie qu’ils éprouvent réciproquement à se rencontrer ; ils s’entretiennent ensemble avec gaieté, et s’accablent de questions les uns les autres ; enfin le duc, ainsi qu’il l’avait promis, invite Boémond à se rendre auprès de l’empereur qui l’attend ; Boémond se montre d’abord incertain et peu empressé à adopter l’avis qu’on lui présente, car il se méfiait des paroles de l’empereur ; cependant le duc parvient à le persuader, il marche devant lui, et tous ensemble entrent enfin à Constantinople. L’empereur reçoit Boémond en lui donnant le baiser de paix, il lui témoigne de la bienveillance, lui fait rendre les plus grands honneurs ; et à la suite de plusieurs conférences intimes, tenues entre l’empereur et les deux chefs, Boémond devient, comme on dit, l’homme de l’empereur ; il lui engage sa fidélité en lui donnant. la main, et lui prête serinent corps pour corps, ainsi clac le font les fidèles envers leurs seigneurs. Après cela, l’empereur fait prendre dans, ses appartement et offre à Boémond de riches présents en or, en vêtements, en vases et en pierres précieuses, objets d’un prix et d’une beauté incomparables. La paix ainsi rétablie, et tandis que Boémond demeurait encore dans le palais, Tancrède, homme recommandable en tout point, et neveu de Boémond par sa mère, évitant avec soin la présence de l’empereur, fit transporter toute son armée en Bithynie, et ayant traversé le Bosphore, établit son camp auprès du bourg de Chalcédoine, où les troupes du chic étaient déjà depuis longtemps, attendant l’arrivée des autres corps. L’empereur, lorsqu’il apprit ensuite que le seigneur Tancrède avait évité de le voir, en fut péniblement affecté. Mais en homme prudent, il dissimula sa colère, et faisant de nouveau distribuer d’immenses présents aux princes qui étaient demeurés auprès de lui, il les renvoya à leur camp au-delà du Bosphore arec les plus grands honneurs. Les deux armées s’étaient unies par les liens de la charité fraternelle, et vivaient ensemble, à la vue de Constantinople, attendant l’arrivée des autres princes, afin que toutes les légions ne formassent qu’un seul corps, pour marcher toutes ensemble au but de leur pèlerinage. La ville royale, et tous les faubourgs et les lieux environnants, leur fournissaient les vivres nécessaires, et les soldats vivaient dans une grande abondance. Pendant ce temps, l’illustre Robert, comte de Flandre, s’était embarqué au commencement de l’hiver à Bari, ville de Pouille, et était descendu à Durazzo avec tous ceux qui l’accompagnaient ; il s’était ensuite mis à l’abri des frimas en s’établissant dans un pays fertile, semé de bois et de pâturages, et offrant toutes les commodités que l’on pouvait désirer. Il reprit sa marche dès les premiers jours du printemps, et se hâta de rejoindre les princes qui l’avaient devancé. Avant d’arriver à Constantinople, il reçut, comme ceux qui s’étaient présentés avant lui, des messagers de l’empereur, qui vinrent l’inviter de la part de leur maître à laisser son armée en arrière, et à se rendre dans la ville royale avec une petite escorte. Instruit déjà de la conduite qu’avaient tenue ceux dont il suivait les traces, Robert arriva à Constantinople, et entra ait palais, accompagné d’un petit nombre des siens. L’empereur l’accueillit avec les mêmes honneurs, le traita avec bienveillance, reçut de lui le serment de fidélité, comme il l’avait reçu de Boémond, le combla dès lors de nouvelles faveurs, lui fit d’immenses présents et se montra également généreux envers ceux qui composaient sa suite. Robert demeura quelques jours dans la ville, tandis que son armée, campée dans les environs, jouissait d’un doux repos et d’une grande abondance ; lui-même voyait fréquemment l’empereur, et avait des conférences avec lui sur tous les objets dont il lui paraissait utile de l’entretenir ; enfin, il prit congé de l’empereur, et fit embarquer toutes ses troupes pour aller rejoindre ses compagnons de voyage. Ceux-ci l’accueillirent avec beaucoup de bonté et d’affection, et ses troupes se réunirent celles qui étaient déjà établies dans leur camp. Pendant quelques jours, les chefs se divertirent à se raconter les uns aux autres les divers événements de leurs voyages ; ils se rappelaient avec un certain plaisir toutes leurs fatigues, puis ils s’entretenaient en détail de l’avenir et du but de leur entreprise, et cherchaient ensemble les moyens lus plus convenables de parvenir le plus promptement possible à l’accomplissement de leurs desseins. Tandis qu’ils s’occupaient ainsi, se plaignant déjà du retard de ceux qui devaient encore arriver, et les accusant de perche inutilement un temps précieux, on vint annoncer un messager ; arrivant de la part du comte de Toulouse et de l’évêque du Puy, pour rendre compte que l’un et l’autre s’avançaient, et qu’ils seraient bientôt aux portes de Constantinople. Ces deux hommes puissants et illustres avaient toujours
marché ensemble dès le commencement de leur voyage en compagnons
inséparables. Ils avaient avec eux beaucoup d’hommes distingués par l’élégance
de leurs mœurs autant que par leur noblesse, savoir le seigneur Guillaume,
évêque d’Orange, Raimbault, comte de la même ville, Gaston de Béarn, Gérard
de Roussillon, Guillaume de Montpellier, Guillaume, comte du Forez, Raimond
Pelet, Centon de Béarn, Guillaume Amanjeu, et beaucoup d’autres encore dont
les noms, quoique nous ne les ayons pas conservés, ont été certainement
inscrits dans le livre de vie, car ils quittèrent leur patrie, leurs parents,
leurs amis et leurs vastes patrimoines, pour suivre le Christ et se livrer
volontairement à Les pèlerins donc étant entrés dans cette province trouvèrent sur leur route de grandes difficultés, principalement à cause de l’hiver qui s’approchait et de l’extrême inégalité du sol. Ils manquaient aussi de vivres de toute espèce, et pendant plusieurs jours ils furent en proie à une grande détresse. Les habitants abandonnaient les villes et tous les lieux fortifiés et se retiraient sur les montagnes ou dans des bois épais, emmenant avec eux leurs femmes, leurs enfants et toutes leurs provisions, fuyant comme des bêtes fauves, et redoutant la vue de nos voyageurs. En même temps cependant ils suivaient en haut et de loin les traces de l’armée et massacraient les vieillards affaiblis, les vieilles femmes qui ne s’avançaient que plus lentement, dès qu’ils pouvaient les rencontrer séparés des bandes armées. Le comte cependant, animé d’une juste sollicitude pour cette immense quantité de pèlerins, faisait marcher quelques-uns des chefs en avant des bataillons, et lui-même se tenait souvent sur les derrières avec la plus grande partie des cavaliers bien cuirassés, fermant la marche et se trouvant souvent le dernier. En outre l’atmosphère était chargée de brouillards et d’épaisses ténèbres, à tel point que ceux qui suivaient avaient peine à reconnaître les traces de ceux qui marchaient devant eux, et que ceux-ci à leur tour ne pouvaient distinguer aucun objet au-delà de la portée d’une pierre. Cette terre en effet est, comme je l’ai dit, couverte de petits ruisseaux, de fleuves et de marais, et à de certains jours il s’en élevait une si grande humidité, les nuages se chargeaient tellement de ces mauvaises exhalaisons qu’on en était presque suffoqué. Les Esclavons Dalmates, qui étaient là comme des indigènes, et connaissaient parfaitement toutes les localités, suivaient notre armée toujours de côté, à travers les précipices, des montagnes et les touffes les plus épaisses des forêts, et faisaient de fréquentes irruptions, dans lesquelles il leur était facile d’accabler les faibles et tous ceux qui étaient dépourvus d’armes. Le comte cependant et les principaux chefs les atteignaient souvent et au milieu de leurs incursions, les perçaient de leur lance, en tuaient beaucoup d’autres de leur glaive, et ils en auraient même atteint un bien plus grand nombre si ceux-ci ne s’étaient tenus constamment dans le voisinage des forêts pour y chercher un asile lorsqu’ils se sentaient trop vivement pressés. Un jour cependant, entre autres, quelques-uns de ces malfaiteurs ayant été faits prisonniers, le comte ordonna qu’on leur coupât les pieds et les mains, afin que leurs compagnons, effrayés de cet exemple, renonçassent à poursuivre l’armée. Pendant trois semaines consécutives elle suivit la même route, rencontrant partout les mêmes difficultés, et elle arriva enfin à un lieu, nommé Scodra[13], où elle trouva le roi des Esclavons. Le seigneur comte, qui était extrêmement bon, affable et compatissant, chercha à se lier d’amitié avec ce roi ; en lui faisant généreusement beaucoup de présents, dans l’espoir de gagner ainsi la bienveillance des indigènes et d’obtenir pour son peuple la permission de se pourvoir de toutes les choses dont il pourrait avoir besoin ; mais ce moyen même ne put lui servir à adoucir le caractère féroce de ces barbares, et dans la suite il’ les trouva bien plus cruels encore. Enfin, après avoir mis environ quarante jours à traverser la Dalmatie au milieu de toutes sortes de souffrances, il arriva à Durazzo avec toute son armée : L’empereur, qui avait eu quelque avis de l’arrivée du
comte, parce que c’était à la fois un homme sage et magnifique et qui avait à
sa suite une grande quantité de monde, s’était hâté d’envoyer une députation
composée d’hommes considérables qu’il avait chargés d’aller à sa rencontre
jusqu’à Durazzo, de le saluer affectueusement de la part de leur maître dès
qu’il y arriverait, et de le traiter avec beaucoup d’égards. Obéissant à ces
ordres, les députés se présentèrent devant le comte, s’entretinrent avec lui,
le comblèrent de caresses, et lui remirent les dépêches dont ils étaient
porteurs ; voici ce qu’elles contenaient : Depuis longtemps, comte très chéri, la
renommée de ta sagesse et le parfum de ta probité répandus de toutes parts
sont parvenus jusqu’à nous : l’excellence de tes mérites nous invite à te
chérir, et nous avons résolu d’aimer ta personne et de t’honorer avec une
affection particulière. Aussi nous attendons ton arrivée avec une grande impatience,
désirant conférer sur beaucoup de choses au sujet des affaires publiques,
avec toi comme aussi avec ta noblesse qui nous est infiniment chère. Nous te
recommandons avec instance de traverser toutes nos terres, sans trouble ni
scandale, de te hâter d’arriver auprès de nous, et de compter sur notre
bienveillance et sur les honneurs infinis que nous avons résolu de t’accorder.
Nous avons en outre donné ordre à ceux qui te remettront les présentes d’avoir
soin que ton peuple soit abondamment pourvu de toutes sortes de denrées et qu’il
puisse entretenir constamment des relations de commerce à de bonnes
conditions. Cette lettre réjouit infiniment le comte ainsi que
toute son armée ; elle se remit en route, traversa pendant plusieurs jours,
et non sans fatigue ; les montagnes et les forêts qui couvrent tout le pays
des Épirotes, et arriva enfin au pays nommé Pélagonie, où elle dressa son
camp et trouva une grande abondance de toutes choses. Là, le seigneur évêque
du Puy, homme vénérable, ayant fait placer ses tentes à quelque distance du
camp pour s’établir plus comma dément, fut saisi et fait prisonnier dans une
attaque imprévue des Bulgares. Mais, comme un si illustre pontife était
encore nécessaire au peuple de Dieu, la miséricorde olivine voulut qu’un
heureux hasard lui conservé Cédant aux instances unanimes des députés de l’empereur et des princes, le comte quitta son armée et laissa aux évêques et aux autres nobles qui demeuraient au camp le soin de veiller sur elle. Lui-même se rendit à Constantinople avec un petit nombre d’hommes ; il entra dans cette ville précédé des principaux officiers du palais, et alla se présenter devant l’empereur qui l’attendait depuis longtemps. Il fut reçu très honorablement et traité avec beaucoup de bonté et de douceur par l’empereur et par tous les hommes considérables et illustres qui l’entouraient. On chercha, avec les plus vives instances et par toutes sortes de cajoleries, à l’engager à prêter serment de fidélité à l’empereur, de la même manière que l’avaient fait les autres princes qui l’avaient précédé ; mais il s’y refusa avec la plus grande fermeté. Cependant l’empereur, indigné due le comte refus t de lui rendre hommage, ordonna en secret aux chefs des légions qui se trouvaient du même côté de marcher en toute hâte sur son armée, de chercher à la traverser par lotis les moyens possibles, et même de ne pas craindre de mettre à mort tous ceux qu’on pourrait frapper. Il s’était enhardi à donner de tels ordres, dans la confiance que tous les princes étaient engagés envers lui par le serment de fidélité qu’il en avait reçu, et que d’ailleurs il ne leur serait nullement facile de faire de nouveau passer leurs armées sur le rivage opposé. En effet tous les bâtiments qui se rendaient en Asie, soit pour porter des vivres aux armées, soit pour conduire des passagers, étaient tenus de quitter la terre aussitôt après le débarquement, afin qu’il n’y eût jamais beaucoup de bâtiments ensemble et que les princes ne pussent penser à retourner à Constantinople. Ainsi que je l’ai déjà dit, l’empereur était parvenu, à force de flatteries et d’insinuations adroites, à faire successivement partir chaque armée, pour que leurs forces ne pussent jamais être réunies auprès de la ville, car l’arrivée des nôtres avait excité ses méfiances, et il redoutait par dessus tout des rassemblements trop nombreux. Quant à ce qu’il avait fait pour combler les princes de ses largesses, ce n’était nullement par générosité ou par bienveillance, mais uniquement par peur et par une habileté pleine d’artifices. Nos princes cependant, marchant dans la simplicité de leur coeur et dans la sincérité de la bonne foi, avaient grand-peine à croire à la méchanceté des Grecs, aux fraudes et à la ruse persévérante de leur prince, surtout depuis qu’il les comblait de ses riches dons et affectait une extrême bienveillance pour eux tous. Cependant ceux qui avaient reçu les ordres de l’empereur, les centurions, les quinquagénaires[14], les préposés aux marches militaires, se mirent en devoir d’accomplir leur mission. Après avoir prévenu leurs troupes, au milieu de la nuit, ils s’avancèrent en silence et se précipitèrent sur l’armée du comte. Nos soldats se trouvant ainsi attaqués à l’improviste, au moment où ils n’avaient aucune crainte, un grand nombre d’entre eux furent misérablement tués ou prirent honteusement la fuite, avant que l’alarme fût devenue générale et qu’on eût couru aux armes. Enfin les vives instances des hommes les plus braves ranimèrent les nôtres, ils retrouvèrent leurs forces et leur courage, et firent à leur tour beaucoup de mal aux brigands armés, satellites de l’empereur. Quoiqu’ils eussent résisté avec assez de vigueur, eu égard au moment et au lieu même de l’attaque, frappés cependant de toutes les difficultés du voyage, découragés par les combats qu’ils avaient à livrer presque tous les jours et toujours à l’improviste, les nôtres cédaient à 1etlr abattement et semblaient déjà se repentir de leur entreprise ; chaque jour ils perdaient quelque chose du zèle fervent qui les avait d’abord animés ; excédés de plus en plus de fatigue, non seulement les gens du peuple, mais même quelques-uns des chefs se repentaient de leur voyage ; désespérant de pouvoir atteindre leur but et oubliant les voeux qui les engageaient, ils voulaient se préparer à retourner chez eux ; et si les évêques et le clergé n’eussent employé les avertissements et les exhortations pour leur rappeler leur voeu et ranimer en eux un zèle près de s’éteindre, ils étaient tous disposés à abandonner leurs bataillons et à tout tenter pour rentrer dans leur patrie, malgré les nouveaux dangers qui les attendaient. Lorsque ces nouvelles furent apportées au comte, frappé d’une vive douleur, il vit qu’on l’avait trahi : aussitôt choisissant quelques nobles parmi les fidèles qui l’entouraient, il les envoya présenter à l’empereur les preuves évidentes de son infâme perfidie, et déclara que, tandis qu’il l’attirait auprès de lui à force de lettres et de messages, l’empereur, contre toute bonne foi, avait armé ses troupes pour les faire marcher sur les Croisés. En même temps il se hâta de faire connaître aux princes, dont les instances et les prières l’avaient entraîné à quitter son armée, les malheurs qui venaient de lui arriver et la fraude manifeste de l’empereur, les appelant comme des fières i1 venir seconder ses projets de vengeance. En effet, si le comte avait eu autant de moyens de suivre ce dessein qu’il éprouvait de douleur de cette catastrophe, il est hors de doute que, dans l’état d’agitation où ces nouvelles l’avaient jeté, les menaces, la crainte, l’intervention de tous les princes, rien n’eut pu le détourner de poursuivre ses vengeances ; car il était, à ce qu’on dit, d’un courage bouillant, gardait à jamais le souvenir d’un affront et abondait fort dans son sens. L’empereur, voyant que les choses étaient allées beaucoup trop loin, et se repentant de ce qu’il avait fait, convoqua aussitôt les princes qui étaient encore avec leurs légions sur le rivage opposé de la ruer, le seigneur duc Boémond, et le comte de Flandre, pour leur demander leur intervention auprès dit comte et tâcher de se réconcilier avec lui. Les princes se rendirent à cet appel, quoiqu’ils fussent très mécontents de ce qui venait d’arriver. Ils jugèrent cependant que ce n’était pas le cas de rechercher une vengeance ; ils en parlèrent au comte en particulier, et tout en lui témoignant beaucoup d’intérêt, ils firent tous leurs efforts pour l’engager à dissimuler le ressentiment d’une injure qu’ils regardaient comme étant commune à tous ; ils lui représentèrent qu’en poursuivant ses vengeances il entreprendrait une oeuvre peut-être bien longue, et le supplièrent d’y renoncer, pour ne mettre aucun obstacle aux projets de ceux qui voulaient marcher dans les voies du Seigneur. Enfin, et à la suite de ces pieuses intercessions, le comte, en homme prudent, déposant les sentiments d’amertume qui remplissaient son anse, se rendit à l’avis des princes et se mit complètement à leur disposition. Ils allèrent alors trouver l’empereur et lui représentèrent, avec franchise et d’une commune voix, combien ils étaient offensés de tout ce qui venait d’arriver. L’empereur, bien convaincu de la solidité de leur union, et recevant les témoignages unanimes de leur indignation ; s’abaissa à faire des excuses en présence du comte et de toutes les personnes de la cour, tant de celles qui vivaient hors du palais que de ses propres domestiques ; il jura et protesta solennellement que tout ce qui venait de se passer lui était entièrement étranger, qu’il n’avait donnes aucun ordre semblable, et en même temps qu’il attestait ainsi son innocence, il. se déclara tout disposé à donner au comte toute satisfaction. Ainsi se manifestaient de jour en jour et de plus en plus
les artifices des Grecs et les fraudes de l’empereur ; il n’était aucun de
nos princes pour qui il ne fût aussi évident que la lumière du jour en plein Le comte se réconcilia donc avec l’empereur, conformément a l’avis des princes : il lui prêta aussi le serment de fidélité de la même manière et dans les mêmes termes que les autres l’avaient fait, et ainsi rentré en faveur, il reçut d’immenses présents, qu’il serait trop long s’énumérer, en témoignage de la libéralité de l’empereur. Les autres princes, comblés de nouvelles largesses, prirent enfin congé de l’empereur ; et après avoir recommandé au comte de ne pas s’arrêter trop longtemps, ils traversèrent l’Hellespont et se rendirent en Bithynie, auprès de leurs légions. Cependant l’armée du comte était arrivée à Constantinople ; il présida lui-même à toutes les dispositions de son départ, et elle alla se réunir aux autres armées. Le comte demeura quelques jours encore dans la ville, et en même temps qu’il faisait ses affaires particulières, il ne cessa de se conduire en homme sage, plein de zèle et de sollicitude pour les affaires publiques. Ainsi que les princes l’en avaient prié, il voyait fréquemment l’empereur et cherchait, comme l’avaient fait en particulier tous les autres chefs, à lui persuader de suivre en personne l’expédition et d’en accepter le suprême commandement. L’empereur répondit au comte, qui le sollicitait plus vivement, ainsi qu’il avait répondu à toutes les propositions semblables ; il s’excusa en disant qu’il était entouré d’ennemis féroces, les Bulgares, les Commans, les Pincenates, qui se présentaient incessamment sur les frontières de l’Empire, et épiaient sans relâche toutes les occasion& de faire de nouvelles invasions et de troubler la tranquillité de ses États ; que quoiqu’il ne désirât rien tant que de s’allier à tous ceux qui entreprenaient ce pèlerinage, et de pouvoir espérer ainsi une bonne part des récompenses qui les attendaient, il lui était cependant impossible d’abandonner son royaume et de fournir à ses ennemis l’occasion d’exercer leur méchanceté. Mais tout ce qu’il disait n’était que ruse et artifice ; et dans le fait, la véritable raison qu’il eût pu donner de ses refus, c’était que jaloux de l’expédition que les nôtres avaient entreprise, il cherchait toutes sortes de prétextes pour la contrarier, et pour s’opposer, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, au succès de leurs étrons. Tous ceux qui avaient déjà traversé la mer, savoir, le duc
Godefroi, Boémond, Robert comte de Flandre et l’évêque du Puy, se disposèrent
à se remettre en route, et ayant rassemblé tous les bagages, ils partirent
pour se rendre à pied à Nicée, et y attendre ceux qui demeuraient encore en
arrière. Comme ils s’avançaient vers Nicomédie, qui est la principale
métropole de la province de Bithynie, le vénérable prêtre Pierre l’ermite,
qui s’était mis à l’abri des rigueurs de l’hiver sur les frontières de ce
pays, vint à la rencontre des légions avec le petit nombre de pèlerins qui
avaient survécu aux désastres de cette expédition, et se réunit à elles,
après avoir présenté ses salutations aux princes. Ceux-ci le reçurent avec
bonté, lui demandèrent le récit de ses malheurs, et il leur raconta en détail
comment le peuple qui les avait devancés, sous sa conduite, s’était montré
dépourvu d’intelligence, incrédule et indomptable à la fois, déclarant que c’était
beaucoup plus par ses propres fautes que par le fait d’autrui qu’il avait
succombé sous le poids de ses calamités. Les princes, remplis de compassion
pour lui et pour ses compagnons d’infortune, les comblèrent les uns et les
autres des témoignages de leur générosité. L’armée qui s’était tort accrue
par la grâce de Dieu et par la réunion en un seul corps de toutes les
diverses expéditions, poursuivit sa marche et arriva à Nicée. On disposa le
camp en cercle, on marqua la place destinée aux princes qui n’étaient pas
encore arrivés, et le quinze du mois de tuai on commença à mettre le siège
devant Cependant l’illustre Robert, comte de Normandie, et tous
les autres nobles fameux qui l’avaient accompagne, savoir, Étienne, comte du
pays de Chartres et de Blois, et Eustache, frère du duc Godefroi, expédièrent
des messagers tant à l’empereur qu’à leurs frères, pour annoncer leur
prochaine arrivée. Ils avaient encore avec eux Étienne, comte d’Albemarle,
Alain Fergand et Conon, tous deux de Bretagne, hommes considérables, Rotrou
comte du Perche et Roger de Barneville. Tous ces hommes et beaucoup d’autres
encore, nobles et illustres, s’étaient rendus dans la Pouille, l’année précédente,
avant le commencement de l’hiver, avec le comte de Flandre et le seigneur Hugues-le-Grand
: lorsque ceux-ci s’étaient embarqués pour se rendre à Durazzo, les autres
redoutant la rigueur des frimas, avaient passé leur hiver dans de bons cantonnements,
dans la Pouille et sur les frontières de Un certain Grec, nommé Tanin, familier intime de l’empereur, homme méchant et perfide, qui avait les narines mutilées, en témoignage de sa perversité, était venu aussi se réunir au camp de notre armée. Nos chefs ayant demandé, pour plus de sûreté, un guide qui leur fit connaître les routes, cet homme avait été désigné par les ordres de l’empereur pour accompagner notre armée, et on l’avait choisi par ce qu’on disait qu’il avait une connaissance parfaite du pays ; mais en même temps parce que l’empereur se confiait entièrement en sa méchanceté et en son habile fourberie. Il s’associa donc à nos princes avec une petite escorte de gens à lui, afin qu’il y eût, comme on dit, dans l’armée une oie qui pût faire grand bruit au milieu des cygnes, et une méchante couleuvre parmi les anguilles. Tout ce qui se faisait au milieu de notre expédition, tout ce qui était dit par chacun, cet homme le travestissait par ses mauvaises interprétations, et avait soin d’en informer l’empereur ; il recevait aussi de fréquents messagers qui venaient lui apporter des instructions sur ses rapports et ses fraudes. Alors, pour la première fois, les divers corps qui avaient
suivi leurs chefs à travers des pays et en des temps différents, se virent
réunis et formèrent une seule armée du Dieu vivant, qui se trouva portée au
complet par l’arrivée successive des nombreuses divisions qui devaient |