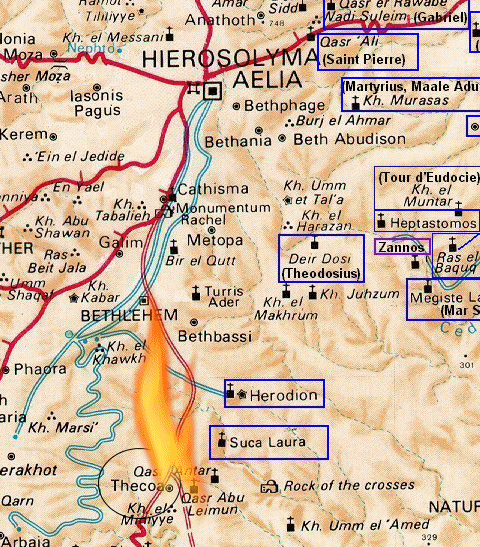HISTOIRE DES CROISADES
LIVRE PREMIER
|
ON lit dans les histoires anciennes, et les traditions des Orientaux rapportent également, qu’au temps où l’empereur Héraclius gouvernait l’Empire romain[1], la doctrine empestée de Mahomet, ce premier-né de Satan, qui s’était dit faussement prophète envoyé par le Seigneur, et avait séduit les contrées de l’Orient et principalement de l’Arabie, s’était déjà répandue de tous côtés : en même temps toutes les provinces de l’Empire étaient tombées dans un tel état de langueur et de faiblesse que les successeurs de Mahomet, renonçant aux exhortations et à la prédication, n’employaient plus que le fer et la violence pour imposer aux peuples leurs erreurs. L’empereur Héraclius, revenant victorieux de son expédition en Perse et rapportant en triomphe la croix du Seigneur, s’était arrêté en Syrie il avait ordonné à Modeste, homme vénérable qu’il venait de nommer évêque de Jérusalem, de faire relever les églises que le méchant satrape de Perse, Cosdroé[2], avait renversées, et s’était chargé de pourvoir à toutes les dépenses de leur restauration. Omar, fils de Catab, troisième successeur du séducteur Mahomet, héritier de ses erreurs et de son royaume, et suivi de troupes innombrables d’Arabes, avait déjà occupé de vive force la belle ville de Gaza en Palestine. De là, ayant franchi les frontières du pays de Damas, avec ses légions et la multitude de peuple qu’il traînait à sa suite, il avait mis le siège devant Damas, tandis que l’empereur attendait encore en Cilicie l’issue de cette entreprise. Lorsqu’on annonça à celui-ci que les Arabes, enflés d’orgueil et se confiant en leur nombre, ne craignaient pas même d’envahir les frontières de l’Empire et de s’emparer des villes qui lui appartenaient, l’empereur reconnaissant qu’il n’avait point assez de troupes pour s’opposer à de si nombreuses bandes et réprimer leur insolence ; prit le parti de se retirer en sûreté chez lui, pour rie pas se livrer aux chances incertaines de la guerre, avec des forces aussi disproportionnées. Celui qui était tenu de prêter son assistance aux citoyens affligés s’étant ainsi retiré, la violence des Arabes ne fit que s’accroître, et en peu de temps ils occupèrent tous les pays qui s’étendent depuis Laodicée de Syrie jusqu’en Égypte. J’ai exposé avec soin dans un autre écrit ce qu’avait été ce Mahomet, d’où il était, et comment il en était venu à ce degré de folie de se dire faussement prophète, et d’oser s’annoncer pour envoyé de Dieu ; j’ai dit quelles furent sa vie et ses paroles, combien de temps il avait régné et en duels lieux, et enfin quels avaient été ses successeurs ; j’ai raconté aussi comment ils avaient infecté le monde presque entier de sa doctrine, et quels étaient ceux qui l’avaient adoptée ; la suite du présent ouvrage servira à prouver encore mieux tout ce que j’ai rapporté ailleurs[3]. D’autres événements avaient concouru ait succès des entreprises de ces peuples. Peu d’années auparavant, le même Cosdroé, dont je viens de parler, était entré à main armée en Syrie, renversant les villes, portant le fer et le feu dans les campagnes, détruisant les églises et réduisant les peuples en captivité : les portes de la ville sainte avaient été brisées, trente-six mille citoyens y avaient péri sous le glaive de l’ennemi qui, en se retirant, avait transporté en Perse la croix du Seigneur et emmené l’évêque Zacharie, suivi des débris de toute la population, tant de la cité que de tout le pays environnant. Ce très puissant roi de l’erse épousa Marie fille de l’empereur Maurice — avec lequel le bienheureux pape Grégoire était tellement lié qu’il tint un de ses enfants sur les fonts de baptême — : en faveur de ce mariage, le roi reçut le sacrement de régénération et demeura ami intime des Romains, tant que vécut l’empereur son beau-père. Celui-ci ayant cité traîtreusement assassiné par le César Phocas, qui lui succéda dans l’Empire, le roi des Perses ayant en horreur la perfidie de ceux qui souffraient la domination d’un homme si criminel, encore couvert du sang de son maître, s’avouant ainsi en quelque sorte coupables avec lui d’une alliance secrète, et se sentant complices de son forfait, médita, à l’instigation de sa femme, de venger la mort de son beau-père ; il entra à main armée sur le territoire de l’Empire, et répandit partout ses fureurs : après avoir subjugué les autres contrées soumises à la domination romaine, il occupa enfin la Syrie, ainsi que nous l’avons dit plus haut, et détruisit la population soit par le fer, soit en emmenant de nombreux captifs en Perse. Les Arabes entrés en Syrie et la trouvant dépeuplée, saisirent cette facile occasion de s’en rendre maîtres. La ville chérie de Dieu, Jérusalem, fut en proie aux mêmes calamités[4] ; ils épargnèrent la faible population qui s’y trouvait encore, pour la rendre tributaire à des conditions très onéreuses, et lui permirent d’avoir son évêque, de rebâtir l’église qui avait été renversée, et de continuer à pratiquer librement la religion chrétienne.
La ville agréable et spécialement consacrée à Dieu se trouvant ainsi, en expiation de nos péchés, soumise à la domination des infidèles, subit pendant quatre cent quatre-vingt-dix ans le joug d’une injuste servitude, et fut travaillée de souffrances continuelles, cependant avec de grandes vicissitudes. Elle changea fréquemment de maîtres, par suite de l’extrême mobilité des événements ; suivant les dispositions de chacun d’eux, elle eut quelquefois des intervalles lucides, d’autres fois des jours chargés de nuages, et, comme un malade, elle était oppressée ou respirait plus librement, selon l’état du temps. Il était impossible qu’elle se releva jamais complètement, tant qu’elle avait à gémir sous la domination violente des princes infidèles et d’un peuple qui n’avait pas de Dieu.
Charles consolait fréquemment par ses largesses et par ses œuvres pieuses non seulement ceux des fidèles qui vivaient à Jérusalem sous la domination des infidèles, mais encore ceux qui, en Égypte et en Afrique, étaient soumis aux impies Sarrasins. On lit dans sa vie le passage suivant. Plein de zèle pour le soulagement des pauvres, il prenait soin de répandre ses libéralités, que les Grecs ont appelées έλεημοσύνη — aumônes —, non seulement dans sa patrie et dans son royaume, mais encore au-delà des mers, en Syrie, en Égypte, en Afrique, à Jérusalem, à Alexandrie, à Carthage ; partout où il parvenait à découvrir des Chrétiens vivant dans la pauvreté, il prenait compassion à de leurs maux, et leur envoyait souvent de l’argent. Il recherchait l’amitié des rois d’outre-mer, surtout dans l’intention que les Chrétiens soumis à leur domination pussent obtenir quelque soulagement et quelques secours[8]. Ceux qui désireront connaître avec plus de détail tout ce que la ville de Dieu et la contrée environnante eurent à souffrir durant cette période intermédiaire, et par suite des nombreuses vicissitudes de temps, d’événements et de dominations, n’ont qu’à lire l’histoire que nous avons écrite, après bien des soins et des fatigues, sur les faits et gestes des princes de d’Orient, depuis la venue du séducteur Mahomet jusqu’au temps actuel, l’an 1182 de l’incarnation de N. S. Cette histoire embrasse une période de 570 ans. Durant ce temps, les Égyptiens et les Perses soutinrent avec acharnement une longue querelle de rivalité et de puissance ; leurs haines mutuelles étaient entretenues et animées par l’attachement de chacun de ces peuples à des traditions contradictoires. Aujourd’hui encore, par suite de ces croyances diverses, chacun des deux traite l’autre de sacrilège ; ils n’ont aucune relation entre eux, et vont jusqu’à vouloir aussi être distingués par des noms divers. Ceux qui suivent la superstition des Orientaux s’appellent dans leur langue sunni ; ceux qui préfèrent les traditions des Égyptiens se nomment siha, et ceux-ci paraissent s’accorder mieux avec notre foi. Il serait hors de notre sujet d’exposer leurs différentes erreurs[9].
Avec le temps, le royaume d’Égypte s’étant fort accru, et ayant enfin occupé les provinces et toutes les contrées qui s’étendent jusqu’à Antioche, la ville sainte tomba aussi en son pouvoir, et lift soumise à la loi commune. Elle commença, sous ce nouveau gouvernement, à respirer un peu de ses longues angoisses, comme il arrive parfois aux captifs de trouver quelque adoucissement à leur sort. Mais enfin la méchanceté toujours croissante des hommes appela le règne du calife Hakem en Égypte[10]. Il se montra beaucoup plus pervers que tous ses prédécesseurs et ses successeurs, et, il est devenu un objet de scandale pour tous ceux qui ont pu lire l’histoire de ses folies. Son impiété et sa méchanceté l’ont tellement distingué entre tous les autres, que sa vie, également odieuse à Dieu et aux hommes, ne pourrait être racontée que dans un ouvrage tout particulier. Entre plusieurs ordres également funestes qu’il fit exécuter, il prescrivit de détruire de fond en comble l’église de la Résurrection du Seigneur, qui avait été construite par le vénérable Maxime, évêque de Jérusalem, d’après les ordres de l’empereur Constantin, et que le respectable Modeste avait fait réparer sous le règne de l’empereur Héraclius. Un de ses intendants, gouverneur de Ramla[11], et nommé Hyaroe, ayant reçu le rescrit par lequel cette destruction était ordonnée, exécuta les volontés royales, et fit raser l’église[12]. A la même époque, cette église était gouvernée par le vénérable Oreste, oncle maternel de ce méchant roi. On dit que ce prince se porta à cette mesure pour donner à ses peuples infidèles un gage de son infidélité ; on lui reprochait d’être chrétien, parce qu’il était né d’une mère chrétienne. Voulant repousser cette inculpation, il ne craignit pas de commettre ce sacrilège, et pensa que la calomnie n’aurait plus rien à dire contre lui, et que ses rivaux ne trouveraient plus aucun sujet de l’attaquer, aussitôt qu’il aurait, détruit cette source (le la religion chrétienne et ce berceau de la foi catholique. Dès lors la condition des fidèles de Jérusalem commença à
empirer beaucoup, tant à cause de la juste douleur que leur donnait la ruine
de la sainte église de la Résurrection, que par suite de toutes les vexations
et charges auxquelles ils furent chaque jour plus exposés. En outre des
énormes impôts et des tributs qu’on exigeait d’eux, fort au-delà des usages
et malgré les privilèges qui leur avaient été accordés par les prédécesseurs
élu roi, ce monarque leur interdit l’exercice des solennités que jusqu’à ce
jour ils avaient pratiquées sous d’autres princes assez librement, tantôt en
secret, tantôt tout à fait ouvertement. Plus un jour était célèbre, plus ils
étaient tenus étroitement enfermés dans leurs habitations ; ils n’osaient
paraître en public ; leurs maisons mornes ne leur offraient pas un refuge
tranquille : on leur jetait des pierres et toutes sortes d’ordures ; on
les attaquait avec violence, et ces persécutions étaient constamment plus
actives dans les jours des plus grandes solennités. Outre cela, sur la moindre
indiscrétion de parole, sur la plus légère suggestion d’un accusateur
quelconque, les fidèles étaient enlevés, traînés à la croix et au supplice,
sans que jamais on fît connaître aucun motif ; on confisquait leurs biens, on
les dépouillait de tout ce qu’ils possédaient. Les fils et les filles étaient
enlevés à la maison paternelle ; tantôt le fouet, tantôt les flatteries et
les promesses les entraînaient à l’apostasie, ou bien on les suspendait à Un citoyen de la classe des infidèles, animé d’une haine
insatiable contre les nôtres, homme perfide et méchant, cherchant un moyen de
jeter la mort dans leurs rangs, vint en secret déposer le cadavre d’un chien
à la porte d’un temple[13]. Les gardiens et
tous les habitants de la ville mettaient un grand prix à conserver cette
entrée pure de toute souillure. Le lendemain matin, ceux qui se rendaient à
ce temple pour la prière ayant rencontré ce cadavre immonde et puant,
devinrent presque fous, et remplirent toute la ville de leurs clameurs. Un
peuple immense accourt aussitôt, et de toutes parts on affirme que ce sont
les chrétiens qui ont commis ce crime. Qu’est-il besoin d’en dire davantage ?
On déclare qu’un tel forfait ne peut être expié que par la mort ; on ordonne
que tous les fidèles subiront le supplice. Ceux-ci, se confiant en leur
innocence, étaient tout préparés à périr pour le Christ. Tandis que les
soldats armés de leurs épées s’avançaient pour donner la mort aux chrétiens,
un jeune homme plein de courage dit à ses compagnons : Mes frères, il serait trop dangereux que l’Église toute
entière vînt à périr ; il est plus convenable qu’un seul meure pour le
peuple, et que la race soit sauvée. Promettez-moi d’accorder tous les ans des
addictions à ma mémoire, et de rendre éternellement à ma famille les honneurs
qui lui seront dus. Pour moi, avec l’aide de Dieu, je vais détourner le
carnage de vos têtes. Les fidèles accueillent ces paroles avec
reconnaissance, et lui promettent d’accomplir ce qu’il a demandé. En
conséquence, ils arrêtent que, pour conserver éternellement sa mémoire, les
gens de sa tribu porteront désormais dans la procession solennelle, et au
milieu des rameaux de palmier, l’olive qui est .le silane de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Aussitôt le jeune homme se présente devant les magistrats, et
se déclarant coupable, affirme en même temps l’innocence de tous les autres.
Les juges ayant entendu sa déposition, prononcent l’acquittement de tous les
fidèles, et envoient le jeune homme à Cependant la clémence divine, prenant en compassion les maux des affligés, leur envoya quelque consolation dans cet état, déplorable : le méchant prince Hakem sortit de ce monde. Les souffrances cessèrent en partie sous le règne de son fils Daller[15]. Il permit aux fidèles de rebâtir, l’église de la Résurrection, sur les instances que lui adressa l’empereur de Constantinople, Romain, surnommé l’Héliopolitain[16], avec lequel il s’était lié d’amitié, après avoir rétabli les articles d’un traité d’alliance que son père avait violé. La race des fidèles qui habitaient Jérusalem, ayant obtenu cette autorisation, mais reconnaissant en même temps que ses ressources trop modiques ne pouvaient lui permettre d’exécuter une telle entreprise, envoya des députés au successeur de l’empereur Romain dont je viens de parler, le seigneur Constantin i4lonomaque qui portait alors le sceptre[17]. Ceux-ci, lui adressant humblement la parole, et porteurs des prières de leurs frères, lui dirent que le peuple avait vécu dans la douleur et la désolation depuis la destruction de l’Église, et le supplièrent de leur tendre une main libérale, et de déployer sa munificence impériale pour aider à relever l’édifice renversé. Cette députation était conduite par Jean, surnommé Carianite, né à Constantinople, noble selon la chair, mais plus noble encore par les mœurs. Il avait renonce aux dignités du siècle pour suivre le Christ, et prenant l’habit religieux, il était allé vivre pauvre à Jérusalem pour l’amour du Seigneur. Envoyé à Constantinople, et déployant avec activité son zèle et sa sollicitude auprès de l’empereur, il accomplit fidèlement sa mission, et obtint de ce souverain agréable à Dieu qu’il donnât l’ordre de fournir de son propre trésor toutes les sommes nécessaires pour la reconstruction de l’église. Les vœux du peuple fidèle ainsi accomplis, Jean retourna avec joie à Jérusalem. Le récit qu’il fit de l’heureux résultat de son voyage ranima tout le clergé et le peuple, comme un convalescent se relève à la suite d’aine grave maladie. L’Église était, à cette époque, gouvernée par un homme vénérable, le patriarche Nicéphore. Le trésor impérial ayant fourni les sommes dont on avait besoin, ainsi que l’empereur, l’avait promis, on fit construire l’église de la Sainte-Résurrection, telle qu’on la volt maintenant à Jérusalem, fin io4s de l’incarnation, cinquante et uni ans avant la délivrance de la ville, et trente-sept ans après la destruction de l’ancienne église. Les fidèles trouvèrent dans cet événement une consolation à tous leurs maux et à tous les dangers qui menaçaient leur vie. Ils n’avaient pas cessé en effet d’être en butte à toutes sortes d’affronts ; on inventait sans cesse fie nouveaux tourments, on leur crachait au visage, on les battait, on les chargeait de fers, on les Jetait dans les cachots ; enfin le peuple de Dieu était affligé sans relâche de calamités de toute espèce. Les fidèles qui occupaient les villes de Bethléem et de Thécaé[18], étaient soumis aux mêmes tribulations. Toutes les fois qu’il arrivait un nouveau gouverneur, ou que le calife envoyait un autre intendant, on imaginait de nouvelles calomnies, de nouveaux moyens d’exaction. Lorsqu’on voulait faire subir quelque violence au patriarche ou au peuple, si, par hasard, ceux-ci mettaient le moindre délai à se soumettre, ils étaient aussitôt menacés de la destruction de l’église. Ces menaces se renouvelaient presque tous les ans, et les gouverneurs feignaient toujours d’avoir en main des ordres expédiés, disaient-ils, par le souverain lui-même, par lesquels il leur était enjoint de raser les églises si les chrétiens s’avisaient d’apposer quelque résistance ou Je moindre retard au paiement des tributs et de toutes les antres charges qu’on leur imposait. Tant que les Perses ou les Égyptiens eurent la prééminence dans d’Orient, les fidèles eurent cependant moins à souffrir que lorsque les Turcs, avant étendu leur empire, commencèrent à se rapprocher des frontières de ces peuples : enfin, lorsque les hures se furent emparés de la ville sainte, et pendant les trente-huit années qu’ils la conservèrent, le peuple de Dieu fut encore plus cruellement persécuté, et en vint à trouver léger le joug qu’il avait eu précédemment à supporter. Comme, dans le cours de cet ouvrage, j’aurai souvent à parler de ce qu’ont fait les Turcs contre les nôtres et des grands et magnifiques exploits que les nôtres ont faits contre eux, comme d’ailleurs ils ne persévèrent que trop audacieusement à nous attaquer, il ne sera pas hors de propos d’insérer ici quelques détails sur l’origine de ce peuple, et sur la marche des événements qui l’ont fait parvenir au degré de puissance qu’il occupe depuis longues années. La race des Turcs ou Turcomans — car ils ont la même origine — était, dans le principe, une nation septentrionale, tout à fait barbare et sans résidence fixe. Les Turcs vagabonds se transportaient çà et là, cherchant partout de bons pâturages, n’ayant nulle part ni ville, ni établissement, ni cité permanente. Lorsqu’ils voulaient partir, ceux de la même tribu s’avançaient ensemble, ayant à leur tête un des hommes les plus considérables de leur tribu, comme une sorte de prince : toutes les contestations qui s’élevaient dans la même tribu lui étaient soumises, l’une et l’autre des parties intéressées obéissaient à sa décision, et nulle d’elles n’aurait impunément tenté de s’y soustraire. Dans leurs émigrations, ils transportaient avec eux toutes leurs richesses, leurs haras, leur gros et leur menu bétail, leurs esclaves, hommes et femmes : c’était ce qui composait leur fortune. D’ailleurs, en aucun lieu ils ne s’adonnaient à l’agriculture ; ils ignoraient complètement les contrats de vente et d’achat, et ne se procuraient que par voie d’échange tout ce qui pouvait être nécessaire à leur subsistance. Lorsque de bons herbages leur inspiraient le désir de dresser leurs tentes en un lieu, et de s’y arrêter quelque temps sans être troublés, ils avaient coutume d’envoyer quelques-uns de ceux qu’ils jugeaient les plus sages dans leur tribu, au prince du pays où ils arrivaient ; ils concluaient des traités sous les conditions agréées réciproquement, s’engageaient à payer au prince certaines redevances stipulées, et alors ils demeuraient là selon les conventions, vivant au mi-lieu des pâturages et des forêts. Une multitude innombrable de ces Turcs, ayant marché en avant, et séparée du reste de la population, arriva sur les frontières de la Perse, et y trouva un pays qui lui convenait parfaitement. Ils payèrent au roi qui gouvernait alors le tribut dont ils étaient convenus dès leur arrivée, et y demeurèrent pendant quelques années, plus longtemps qu’ils n’avaient coutume de faire. Leur population s’accrut considérablement, et il n’y avait pas de raison pour qu’elle n’augmentât à l’infini. Le roi et les indigènes, ayant en quelque manière le pressentiment de l’avenir, commencèrent à redouter cet accroissement. On tint conseil, et on résolut de les expulser à main armée des frontières du royaume. Cependant on changea bientôt d’avis : on jugea qu’il serait plus prudent de les fatiguer par toutes sortes d’exigeantes, et d’ajouter de nouvelles charges irrégulières à celles qu’on leur imposait d’habitude, jusqu’à ce qu’ils prissent d’eux-mêmes le parti de se retirer. Pendant plusieurs années, ils supportèrent tous ces affronts et l’énorme fardeau des tributs qu’on leur arrachait ; mais enfin, ils arrêtèrent dans leurs conseils de ne plus s’y soumettre, et le roi de Perse en ayant été informé, leur envoya un héraut, avec l’ordre d’avoir à sortir de ses États dans le délai qui leur fut assigné. Ils traversèrent le fleuve Cobar[19], qui de ce côté fermait la limite de l’empire, et ce fut pour eux une occasion de voir plus facilement, et mieux qu’ils n’avaient pu jusqu’alors, l’immensité de leur population : comme ils avaient toujours vécu séparés les uns des autres, ils ne connaissaient ni leur nombre, ni leur puissance. Ils s’étonnèrent alors qu’un peuple aussi considérable eût pu supporter les mépris d’un prince quelconque, et se soumettre à tant de persécutions, à des tributs si onéreux. Ils reconnurent -avec certitude qu’ils n’étaient inférieurs en nombre ni en force au peuple de l’erse, ni à aucune autre nation ; qu’enfin il ne leur manquait, pour occuper à main armée les pays voisins, qu’un roi tel que les autres peuples en avaient. S’étant donc arrêtés d’un commun accord au projet de se donner un roi, ils firent une revue complète de leur immense population, et y reconnurent cent familles plus illustres que les autres. Ils ordonnèrent alors que chacune de ces familles apporterait une flèche, et on forma ainsi un faisceau de cent flèches. Le faisceau fut recouvert ; on fit venir un jeune enfant innocent, on lui prescrivit de passer la main sous le voile, et d’en retirer une seule flache, après avoir publiquement arrêté que celle que le sort amènerait désignerait la famille dans laquelle on prendrait le roi. L’enfant tira la flèche de la famille des Seljouk. Il fut alors convenu entre tous, conformément à la décision préliminaire, que le roi futur serait pris dans cette tribu. Puis on décida de la même manière que l'on élirait dans la même tribu les cent hommes qui seraient reconnus élevés au dessus des autres par leur âge, leurs mœurs et leurs vertus ; que chacun d’eux apporterait sa flèche, avec son nom inscrit au dessus : on forma un nouveau faisceau qui fut recouvert avec beaucoup de soin : l’enfant — le même ou peut-être un autre — reçut également l’ordre de retirer une flèche, et celle qu’il amena portait encore le nom de Seljouk[20]. Seljouk était un homme très considérable, noble et illustre dans sa tribu, d’un âge avancé, mais conservant encore toute sa vigueur ; il avait une grande expérience militaire, et, par son bel extérieur, possédait la majesté d’un grand prince. Les Turcs le mirent à leur tête d’un consentement unanime, l’élevèrent sur le trône royal, lui rendirent aussitôt tous les témoignages de respect qui sont dus aux rois, et chacun adoptant le traité d’union, vint s’engager de sa personne, et par serment, à obéir aux ordres du nouveau souverain. Celui-ci usant sans retard du pouvoir qui venait de lui être conféré, expédia de tous côtés des hérauts, et frit proclamer que l’on eût à repasser le fleuve ; qu’après l’avoir traversé, toutes les légions eussent à occuper à main armée le pays des Perses, qu’on avait abandonné peu auparavant, et à s’emparer en même temps de tous les royaumes environnants, de peur que le peuple ne fût forcé de nouveau à errer dans des régions éloignées, et à subir le joug insolent d’une autre nation. En peu d’années ils conquirent, non seulement le royaume des Perses, mais même tous les autres royaumes de l’Orient ; car ils domptèrent les Arabes et les autres nations en possession de l’empire. Ainsi un peuple vil et abject parvint rapidement au plus haut degré de puissance, et domina dans l’Orient. Ces événements arrivèrent environ trente ou quarante ans avant que nos princes d’Occident entreprissent le pèlerinage dont je vais écrire l’histoire. Et afin qu’il y eût au moins une différence de noms entre les hommes de cette race qui, s’étant donné un roi, avaient obtenu une gloire immense, et ceux qui, n’abandonnant pas leur ancienne manière de vivre, étaient restés dans leur grossièreté primitive, les premiers prirent le nom de Turcs, les autres conservèrent leur ancien nom de Turcomans. Les Turcs, après avoir subjugué tout l’Orient, firent une invasion dans le puissant royaume d’Égypte ; ils descendirent en Syrie, s’emparèrent de vive force de Jérusalem[21] et de quelques autres villes maritimes ; et, comme je l’ai déjà dit, les fidèles qu’ils y trouvèrent furent soumis à un joug beaucoup plus dur et subirent des vexations et des exactions bien plus cruelles que celles qu’ils avaient éprouvées jusque-là. Ce n’était pas seulement en Orient que les fidèles étaient ainsi opprimés par les impies ; en Occident et presque dans le monde entier, principalement parmi ceux qui s’appelaient fidèles, la foi avait failli et toute crainte de Dieu avait disparu. Il n’y avait plus de justice dans les affaires du monde, l’équité avait fait place à la violence qui seule régnait au milieu des peuples. La fraude, le dol, la fourberie s’étaient établis de toutes parts ; toute vertu s’était retirée et paraissait presque devenue inutile, tant la méchanceté avait pénétré partout ; il semblait que le monde tendît à son déclin et que la seconde arrivée du Fils de l’Homme dût être prochaine. La charité d’un grand nombre d’hommes s’était éteinte ; on ne trouvait plus de foi sur la terre ; la confusion des rangs confondait toutes choses ; on eût dit que le monde allait rentrer dans l’antique chaos. Les plus grands princes, qui étaient tenus de gouverner leurs sujets dans les voies de la paix, oubliant les termes de leur alliance, se querellant à l’envi sur les plus frivoles motifs, livraient des contrées entières à la flamme, exerçaient çà et là leurs rapines et sacrifiaient les biens des pauvres aux fureurs de leurs impies satellites. Au milieu de tant de périls nul n’avait ses richesses en sûreté ; aussitôt qu’un homme était présumé posséder quelque chose, c’était un prétexte suffisant pour le traîner dans les cachots, le charger de fers et lui faire subir dans sa personne les plus indignes tortures. Les biens des églises et des monastères n’étaient pas mieux à l’abri : les privilèges accordés par des princes pieux ne conféraient plus aucun avantage aux propriétés des saints ; elles n’étaient plus admises à revendiquer leurs premières immunités et leur dignité passée. Le sanctuaire même était brisé par la violence ; on enlevait de vive force tous les objets consacrés à l’usage dur ciel ; des mains sacrilèges ne distinguaient plus le sacré du profane, et, dans cette confusion, les voiles ide l’autel, les vêtements des prêtres, les vases du Seigneur étaient livrés en proie à tout venant. Ceux qui se réfugiaient au centre même de la maison de Dieu, dans le sanctuaire impénétrable, dans les porches des basiliques, en étaient arrachés avec violence pour être traînés à la mort et aux supplices ; les routes publiques étaient de tous côtés couvertes de brigands armés, qui tendaient des embûches aux voyageurs et n’épargnaient ni les pèlerins, ni les religieux. Dans les villes et dans tous les lieux fermés on, n’était pas plus à l’abri de l’insulte ; les rues, les places, infestées d’assassins, ne pouvaient plus être fréquentées par les honnêtes gens ; plus un homme était innocent, plus il se trouvait ex-posé à toutes sortes de trahisons. De tous côtés on se livrait impunément et sans aucune retenue à tous les dérèglements du libertinage, comme si c’eût été une chose tout à fait permise, Les liens du mariage n’étaient plus sacrés, même entre les parents et les alliés. La chasteté y vertu chérie des esprits célestes et de Dieu, avait été expulsée de partout comme stupide et sans valeur, L’économie et la sobriété ne pouvaient plus trouver place lorsque le luxe, l’ivrognerie, la passion insatiable du jeu occupaient toutes les avenues et pénétraient dans l’intérieur de toutes les maisons. Le clergé ne se distinguait pas du peuple par une vie plus régulière, selon les paroles du prophète : Le prêtre sera comme le peuple[22]. Les évêques étaient devenus négligents, vrais chiens muets qui ne savaient plus aboyer, faisant acception des personnes, arrosant leur tête de l’huile des pécheurs, et comme des mercenaires livrant aux loups dévorants les brebis qui leur étaient confiées, oubliant ces paroles du Seigneur, qui a dit : Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement[23]. Ils ne fuyaient point les œuvres hérétiques de la simonie, et se souillaient de toutes sortes d’ordures. Enfin ; et pour tout dire en un mot : La terre était corrompue devant Dieu et remplie d’iniquités[24]. Les prodiges menaçants que le Seigneur faisait apparaître dans le ciel et sur la terre ne pouvaient même arrêter ceux qui se précipitaient ainsi dans le niai. On voyait régner partout la peste et la famine ; on apercevait d’effrayants météores ; on éprouvait en tous lieux des tremblements de terre et tous les autres fléaux que le Seigneur énumère avec soin dans l’Évangile[25] ; s’obstinant dans leurs œuvres mortes, comme le pourceau dans sa fange[26], ils pourrissaient tels que les animaux dans leur fumier, et abusaient de l’extrême patience du Seigneur, semblables à ceux de qui il a été dit : Vous les avez frappés, et ils ne l’ont point senti ; vous les avez brisés de coups, et ils n’ont point voulu se soumettre au châtiment[27]. La colère du Seigneur ainsi provoquée ne se contenta pas
que les fidèles qui habitaient la Terre promise eussent à supporter le joug
d’une pénible servitude et des persécutions presque au dessus des forces
humaines ; elle fit plus, et suscita un puissant adversaire, fléau des
peuples, enclume qui pesa sur toute la terre, contre ceux qui semblaient
encore jouir de leur liberté et de qui l’on eût pu dire que tout prospérait
selon leurs vœux. Tandis que Romain, surnommé Diogène, régnait sur les Grecs
et gouvernait l’empire de Constantinople au sein d’une grande prospérité[28], le puissant
satrape des Perses et des Assyriens, nommé Belpheth[29], sortit des
frontières les plus reculées de l’Orient, traînant à sa suite une multitude
de nations, dépourvues de toute croyance, qu’il serait impossible d’énumérer,
et qui eussent pu suffire à couvrir la face de Les princes de l’Empire, ayant appris ces détails, se donnent aussitôt un autre souverain, jugeant que celui qui avait eu à supporter tant d’affronts en sa personne était devenu indigne de porter le sceptre et d’occuper le rang suprême : on lui arracha même les yeux, on le combla d’ignominies ; à peine lui permit-on de vivre désormais en simple particulier. Dés ce moment le prince ennemi, accomplissant sans obstacle ses desseins, occupe toutes les contrées qui s’étendent depuis Laodicée de Syrie jusqu’à l’Hellespont qui baigne les murs de Constantinople, dans un espace de trente journées de marche en longueur et de dix à quinze journées en largeur ; les cités tombent entre ses mains, et lés peuples qui les habitent sont captifs. Le Seigneur les livra entre les mains des nations, et ceux qui les haïssaient eurent l’empire sur eux[30]. Parmi elles, la plus noble, la plus élevée, celle qui commandait à de nombreuses provinces, la cité principale, premier siège du prince des apôtres, succombe enfin, la dernière de toutes, et devient esclave des infidèles, à la charge de payer un tribut. A la suite de cette invasion, la Cœlésyrie, les deux Cilicies, l’Isaurie, la Pamphylie, la Lycie, la Pisidie, la Lycaonie, la Cappadoce, la Galatie, les deux fonts, la Bithynie, une partie de l’Asie-Mineure, illustres provinces, riches en toutes sorties de biens, remplies de peuples fidèles, tombent en peu de temps au pouvoir du vainqueur ; les peuples sont déclarés captifs, les églises sont renversées, le culte chrétien est persécuté avec une fureur d’extermination. Sans doute si l’ennemi eût eu des vaisseaux à sa disposition, la ville royale elle-même n’eût point échappé’ à la conquête ; ses progrès avaient répandu une telle terreur parmi les Grecs qu’ils n’osaient se confier en leurs remparts ; la mer même qui les séparait leur semblait une défense insuffisante. Tant d’événements et tous les malheurs qui les suivirent, mirent le comble à la misère des fidèles qui habitaient Jérusalem et les environs, et les plongèrent dans l’abyme du désespoir. Tant que l’Empire avait prospéré, ainsi que je l’ai dit tout à l’heure, la maison impériale ne laissait pas de leur fournir de puissantes consolations, au milieu de leurs maux : la bonne situation de l’Empire encore intact de toutes parts, l’état prospère des villes voisines et principalement d’Antioche, ranimaient en eux l’espoir de recouvrer tôt ou tard leur liberté. Maintenant accablés du poids de leurs propres maux et de cens des autres ; abattus à l’excès par les bruits sinistres qui se répandaient de tous côtés, désirant la mort plus que la vie, ils se consumaient misérablement dans leur douleur, comptant désormais sur une éternelle servitude. Au milieu des dangers de toute espèce de cette époque de
calamités, -une multitude de Grecs et de Latins venaient par dévotion visiter
les saints lieux. Après avoir échappé à mille chances de la mort et traversé
des contrées ennemies, ceux qui se présentaient aux portes de la ville ne
pouvaient y pénétrer s’ils ne payaient aux préposés une pièce d’or, exigée à titre
de tribut. Mais ayant tout perdu en chemin, ne parvenant qu’avec beaucoup de
peine à se sauver de leur personne, et à atteindre le terme si désiré, ils ne
pouvaient avoir de quoi acquitter l’impôt. Il en résultait que des milliers
de pèlerins, rassemblés dans les environs de la ville, attendant la
permission d’entrer, réduits bientôt à une nudité absolue, succombaient de
faim et de misère. Les vivants et les morts étaient également un fardeau
intolérable pour les malheureux citoyens de Telle fut la cruelle servitude que le peuple consacré à Dieu eut à souffrir dans cet intervalle de quatre cent quatre-vingt-dix ans que j’ai indiqué plus haut. Il la supporta avec une pieuse patience, élevant vers le ciel ses gémissements et ses profonds soupirs, y joignant d’ardentes prières et criant au. Seigneur, pour le supplier de vouloir bien dans sa clémence épargner ceux qui seraient corrigés et éloigner d’eux le fléau de sacolère. Ils étaient parvenus au comble des maux, et comme l’abîme appelle l’abîme[31], cet abîme de misères appelait un abîme de miséricordes. Ils méritèrent enfin d’être exaucés par celui qui est le Dieu de toute consolation. Du haut de son trône de gloire, le Seigneur daignant jeter sur eux un regard de compassion, résolut de mettre un terme à tant de souffrances, et se disposa dans sa paternelle bonté à. leur envoyer les secours auxquels ils avaient aspiré. C’est pour en perpétuer le souvenir parmi les fidèles serviteurs du Christ que j’entreprends, dans cet ouvrage, de raconter le mode et tous les détails de cette puissante intervention, par laquelle Dieu voulut relever son peuple de ses longues douleurs.
Certes, vous êtes grand, Seigneur notre Dieu, et vos
miséricordes sont infinies ! Certes, bon Jésus, ceux qui espèrent en vous ne
tomberont point dans la confusion ! D’où vient à ce pauvre pèlerin, dénué, de
toute ressource et transporté bien loin des frontières de sa patrie, une
confiance si grande qu’il ose essayer une entreprise tellement au dessus de
ses forces, et espérer l’accomplissement de ses désirs ? si ce n’est
qu’il avait porté toute sa pensée vers vous, son protecteur, et qu’embrasé du
feu de la charité, compatissant aux maux de ses frères, aimant son prochain
comme lui-même, il lui suffisait d’accomplir
[1095] L’an mil quatre-vingt-quinzième de l’incarnation de Notre-Seigneur, à la quatrième indiction, sous le règne de Henri IV, roi des Teutons et empereur des Romains — c’était la quarante-troisième année de son règne, et la deuxième de son élévation à l’empire — ; l’illustre roi des Francs, Philippe, fils de Henri, régnant dans le même temps en France ; le seigneur pape Urbain, voyant que la méchanceté des hommes avait dépassé toute borne, que tout ordre était renversé, et que toutes choses ne tendaient plus qu’au mal, après avoir tenu à Plaisance un concile qu’il avait convoqué pour toute l’Italie — et qui, certes, était bien nécessaire pour réprimer les excès de tout genre —, quitta l’Italie pour faire le courroux de l’empereur, traversa les Alpes et entra dans le royaume des Francs. Il y reconnut, selon qu’il l’avait déjà entendu dire, que toutes les lois divines étaient foulées aux pieds, la doctrine de l’Évangile méconnue et méprisée, la foi, la charité et toutes les vertus éteintes dans les cœurs ; qu’en même temps, l’empire de la puissance ennemie et du prince des ténèbres s’étendait de toutes parts. Cherchant avec anxiété, ainsi qu’il y était obligé par son office, les moyens de s’opposer à tant de vices monstrueux, à cette énorme quantité de péchés qui pullulaient en tous sens, et envahissaient le monde entier, il résolut de convoquer un concile général qui dut se rassembler d’abord à Vézelay, ensuite au Puy. Niais par une nouvelle décision, le collage sacré des évêques et des abbés, venus de toutes les divisions des provinces Transalpines, se réunit, par la grâce de Dieu, à Clermont, ville d’Auvergne, dans le mois de novembre. Quelques-uns des princes qui régnaient dans ces diverses contrées y assistèrent aussi. Après avoir, de l’avis des prélats et des hommes craignant Dieu, arrêté les décisions qui paraissaient les plus propres à relever l’Église chancelante, et promulgué les canons qui furent jugés les plus utiles pour l’édification des mœurs, pour la réforme des énormes délits, et surtout pour le rétablissement de la paix ; qui semblait disparue de ce monde, comme le disait Pierre l’ermite, toujours zélé pour l’accomplissement de son œuvre, le seigneur Urbain adressa une exhortation au concile assemblé, et parla en ces termes : Vous savez, mes frères
bien-aimés, et il convient que votre charité n’oublie jamais, que le
Rédempteur du genre humain se revêtissant de chair pour le salut de tous, et
devenu homme parmi les hommes, a illustré par sa présence la terre de
promission, qu’il avait jadis promise aux patriarches ; il l’a rendue surtout
célèbre par les œuvres qu’il y accomplit, et par la fréquente manifestation
de ses miracles. L’ancien, comme le nouveau Testament, nous l’enseignent à
chaque page, à chaque syllabe. Il est certain qu’il a accordé à cette portion
infiniment petite du globe : un privilège tout particulier de prédilection,
puisqu’il daigne l’appeler son héritage, taudis que toute la terre et tout ce
qu’elle contient lui appartiennent. Ainsi a-t-il dit par la bouche d’Isaïe :
Israël est ma maison et mon héritage[34], et encore : la maison
d’Israël est la vigne du Seigneur des armées[35]. Et quoique dès le principe, il eût spécialement consacré
toute cette contrée, cependant il adopta plus particulièrement encore la
ville sainte, comme lui appartenant en propre, témoin le prophète qui dit : Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les
tentes de Jacob[36]. C’est d’elle qu’on dit des choses glorieuses, savoir,
qu’enseignant, souffrant, ressuscitant dans cette ville, le Sauveur y opéra
le salut au milieu de toute Il dit, et ordonne à tous les prélats des églises qui étaient présents de retourner dans leurs diocèses et d’appliquer toute leur sollicitude au soin d’exciter leurs peuplas par les plus vives instances à suivre les mêmes voies. Le synode dissous, tous prennent congé les uns des autres et retournent chez eux ; ils partent résolus, sur toute chose, à faire observer par tous les fidèles cette paix que tous les statuts du synode viennent de prescrire, et qu’on appelait dans le langage ordinaire treuga, la trêve de Dieu, afin que ceux qui voudront partir n’éprouvent aucun empêchement. Ainsi le Seigneur accorda l’efficacité de la parole à son fidèle serviteur, en récompense du mérite de sa foi, car il allait évangélisant partout avec beaucoup dé force ; et ses discours, empreints d’une puissance sublime, paraissaient, à ceux qui les entendaient, dignes de toute confiance. On jugeait qu’une telle chose ne pouvait venir que du Seigneur, et, quelque difficile et périlleuse que pût être cette entreprise, les grands et les petits s’y portaient avec une égale ardeur. Non seulement ceux qui écoutaient. Pierre, animés d’un zèle nouveau, préparaient leurs armes pour accomplir les desseins qu’il leur .inspirait, mais encore l’effet de ses discours se propageait au loin et les absents éprouvaient aussi un ardent désir de satisfaire aux mêmes vœux. De leur côté les évêques se montraient, conformément ait mandat qu’ils avaient reçu, fidèles coopérateurs des mêmes œuvres ; ils invitaient les peuples à suivre les voies qui leur étaient ouvertes, et parcouraient leurs diocèses, semant partout la parole de vie ; nulle part elle ne tombait sans produire de bons fruits, en sorte qu’on pouvait dire avec vérité que cette parole de Dieu s’accomplissait : Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée[51]. Le mari en effet se séparait de sa femme, la femme de son mari ; les pères quittaient leurs fils, les fils leurs pareras ; aucun lien d’amour n’était assez fort pour opposer un obstacle à ce zèle fervent ; du fond même des cloîtres, cachots où ils s’étaient enfermés volontairement pour l’amour du Seigneur, des moines sortaient en foule. Cependant le zèle de Dieu n’était pas pour tous l’unique motif d’une telle résolution, et la prudence, mère de toutes les vertus, n’était pas toujours consultée dans l’accomplissement de ces vœux. Quelques uns se réunissaient à ceux qui devaient partir pour ne pas quitter leurs amis ; d’autres pour éviter de paraître liches ou paresseux ; d’autres encore, uniquement par légèreté, ou bien aussi pour échapper à leurs créanciers lorsqu’ils se sentaient trop pressés dit poids de leurs énormes dettes. Dans tous les royaumes de l’Occident chacun semblait oublier son âge, son sexe, sa condition, son état ; nul ne se laissait détourner de son entreprise par aucune représentation ; tous indistinctement se donnaient la main, tous répétaient à l’unanimité, et de cœur et de bouche, le vœu du pèlerinage : on voyait s’accomplir à la lettre ce qui est écrit dans Tobie : Jérusalem, cité de Dieu, les nations viendront à toi des climats les plus reculés, et, t’apportait des présents, elles adoreront en toi le Seigneur, et considéreront ta terre comme une terre vraiment sainte, car elles invoqueront le grand nom au milieu de toi[52]. Beaucoup d’entre ceux qui avaient assisté au concile entreprirent avec joie de répandre la parole qu’ils avaient recueillie ; le premier d’entre eux fut le seigneur Adhémar, de bonne mémoire, évêque du Puy, homme d’une vie honorable, qui, plus tard, ayant exercé les fonctions de légat du siège apostolique, se montra, dans le cours de cette expédition, chef prudent et fidèle du peuple de Dieu. On remarquait encore le seigneur Guillaume, évêque d’Orange, homme religieux et craignant Dieu. Les princes des deux royaumes, qui ne s’étaient pas présentés au concile, animés de ln même ferveur, se disposaient aussi à se mettre en route et s’encourageaient les uns les autres par de fréquents messages ; ils assignaient entre eux des jours pour partir ensemble, après avoir rassemblé toutes les provisions nécessaires et convoqué tous leurs compagnons de voyage. Il semblait que toutes choses fussent préparées par l’intervention divine ; aussi pouvons-nous dire que le projet et la parole qui l’avaient fait naître étaient véritablement venus de Dieu. Les peuples accouraient en foule, dès qu’ils apprenaient que leur prince s’était consacré au même vœu, pour s’associer à sa marche ; Ils invoquaient son nom sur toute la route et lui juraient foi et obéissance. Et comme on répétait publiquement cette parole : Que la gale reste en arrière, il me serait honteux d’y être laissé, tous s’empressaient à l’envi de se pourvoir de ce qui était nécessaire, désirant se dépasser les uns les autres. Œuvre, véritablement venue de Dieu, car c’était le feu purifiant, devenu nécessaire pour expier les pêches trop nombreux déjà commis, l’occupation vraiment utile pour détourner les maux de l’avenir, alors qu’il n’y avait plus parmi les mortels ni respect de Dieu, ni crainte des hommes. On était convenu de toutes parts, et les ordres du seigneur pape avaient égaleraient prescrit, que tous ceux qui se lieraient par le vœu d’entreprendre ce voyage porteraient sur leurs vêtements, au dessous de l’épaule, le signe de salut, la croix vivifiante, en mémoire et en imitation de celui qui souffrit la Passion dans les lieux qu’ils allaient visiter, et qui, marchant au lieu de notre rédemption, avait porté sur ses épaules la marque de sa principauté[53]. C’est de lui aussi qu’on peut à juste titre entendre les paroles d’Isaïe : Le Seigneur élèvera son étendard parmi les nations, il réunira les fugitifs d’Israël[54]. Par là aussi se trouvait littéralement accompli ce précepte du Seigneur : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à soi-même, et qu’il se charge de sa croix et me suive[55]. Parmi ceux qui, dans l’un et l’autre royaume, s’étaient
munis du signe de la croix en gage de leur prochain pèlerinage, on remarquait
l’illustre seigneur Hugues-le-Grand, frère du seigneur Philippe, roi des
Francs ; le seigneur Robert, comte de Flandre ; un autre Robert, comte de
Normandie, fils du seigneur Guillaume, roi des Anglais ; le seigneur Étienne,
confite de Chartres et de Blois, père du seigneur comte Théobald ; le
seigneur Adhémar, évêque du Puy ; le seigneur Guillaume, évêque
d’Orange ; le seigneur Raimond, comte de Toulouse et de Saint-Gilles, suivi
d’un grand nombre d’hommes très nobles et très illustres ; le seigneur
Godefroi, duc de Lorraine, homme vaillant et très considérable, et ses
frères, le seigneur Baudouin et le seigneur Eustache ; un autre Baudouin,
surnommé du Bourg, parent des précéderas, et fils du seigneur Hugues, comte
de Réthel ; le seigneur Garnier, comte de Gray ; Baudouin, comte de Hainaut ;
Isoard, comte de Die ; Raimbault, comte d’Orange ; Guillaume, comte du Forez
; Étienne, comte d’Albemarle ; Rotrou, comte du Perche ; Hugues, comte de
Saint-Paul. Parmi les hommes nobles et illustres, qui cependant n’étaient pas
comtes et qui se présentèrent volontairement pour prendre part à cette
expédition agréable à Dieu, les plus considérables étaient Henri de Hache,
Raoul de Beaugency, Évrard de Puisaie, Centon de Béarn, Guillaume Amanjeu,
Gaston de Béarn, Guillaume de Montpellier, Gérard de Roussillon, Gérard de
Chérisi, Roger de Barnaville, Gui de Ponesse, Gui de Garlande, porte-mets du
roi des Francs, Thomas de Feii, Galen de Calmon, et enfin Pierre l’ermite,
suivi d’une multitude innombrable qu’il avait rassemblée, non sans de grandes
fatigues, dans le royaume des L’hiver et ses frimas étant passés, dès qu’on reconnut les premiers signes du retour du printemps et d’une température plus douce, tous préparent leurs chevaux, leurs armes, leurs bagages, et s’adressent réciproquement des messages pour s’inviter au départ. On convient avec soin à l’avarice du moment où il faudra que chacun parte, des points de réunion, et des routes par lesquelles il sera plus sûr et plus commode en même temps de s’avancer. Il eût été impossible en effet que ces milliers de voyageurs trouvassent en tout pays tout ce qui leur était nécessaire ; on arrangea donc avec soin que les princes les plus considérables conduiraient, chacun séparément, les légions qu’ils avaient à leur suite et prendraient des chemins divers. Aussi leurs armées ne se réunirent que lorsqu’elles furent dans les environs de Nicée. On verra plus tard que le général passa avec ses troupes par la Hongrie ; que le comte de Toulouse et l’évêque du Puy suivirent la route de la Dalmatie, les autres princes celle de la Pouille, et que tous arrivèrent à Constantinople par des chemins et en des temps divers. On préparait cependant tout ce qu’on jugeait devoir
suffire pour une si longue route ; tous cherchaient, autant que possible, à
proportionner leurs approvisionnements à la longueur du trajet, ignorant que
les voies de Dieu ne sont pas dans la main des hommes, car l’infirmité
mortelle ne sait pas même ce élue lui prépare le lendemain. Dans ce nombre
infini des provinces de l’Occident on ne voyait pas une seule maison en
repos. Partout, et quelles que fussent les affaires domestiques de chacun,
selon sa condition, ici le pire de famille, là le fils, ailleurs même tous
les habitants de la maison, se disposaient à entreprendre le voyage. De tous
côtés on s’envoyait fréquemment des lettres par lesquelles ceux qui devaient
partir ensemble s’invitaient mutuellement à se hâter, s’exhortaient à ne
mettre aucun retard, ou se reprochaient vivement le moindre délai. Ceux qui
étaient désignés comme chefs de bandes convoquaient tous les autres ; ils
s’arrachaient des bras de leurs amis au milieu des sanglots et des soupirs,
et se disant les uns aux autres un éternel adieu, ils se séparaient enfin
après de tendres embrassements. La mère quittait son fils, la fille son père,
la sœur son frère, la femme son mari, celle-ci portant son enfant dans ses
bras ou suspendu à son sein ; toutes les femmes les accompagnaient, versant
des larmes, poussant des cris de douleur et leur disant adieu ; lorsqu’elles
ne pouvaient suivre plus longtemps leur marche, leurs regards demeuraient encore
fixés sur eux. [1096] L’an 1096 de l’incarnation de N.-S., et le 8 du mois de mars, Gautier, surnommé Sans-Avoir, homme noble et plein de force sous les armes, s’étant mis le premier en marche, suivi d’une immense multitude de compagnies d’infanterie — il n’avait avec lui que très peu de cavaliers —, traversa le royaume des Teutons, et descendit en Hongrie. Le royaume de Hongrie est environna de vastes marais qui s’étendent de toutes parts, et de grands fleuves qui le rendent inaccessible, à moins qu’on n’obtienne l’entrée et la sortie de ce pays par certains passages qui sont eux-mêmes extrêmement resserrés. Il était alors gouverné par un homme très chrétien, le roi Coloman, qui, instruit de l’arrivée de Gautier, connaissant son dessein et approuvant sa pieuse entreprise, le reçut avec bonté, lui permit de conduire ses troupes à travers tout le royaume, et ne lui refusa point la faveur de traiter publiquement dans les marchas pour les besoins qu’il pourrait avoir. Gautier traversa donc le royaume en toute tranquillité, et il arriva sans accident, avec toute sa suite, jusqu’au fleuve Maroé[56], qui, comme on sait, sert de limite à ce royaume du côté de l’Orient. Ayant passé le fleuve, il se trouva avec ses légions sur les confins du peuple Bulgare, vers la ville qui est appelée Belgrade. Lorsqu’il traversa le fleuve, au lieu nommé Malaville[57], il ignorait que quelques-uns des gens de sa suite étaient demeurés en arrière pour acheter des vivres et d’autres provisions de voyage. Les Hongrois, les ayant arrêtés, les dépouillèrent complètement, leur enlevèrent tout ce qu’ils avaient, les accablèrent de coups, et les renvoyèrent ensuite à leurs frères. Toute l’armée, remplie d’un zèle charitable, prit compassion de leurs maux, et chacun témoigna une grande affliction des souffrances de ses compagnons. Cependant, croyant qu’il serait trop pénible et même à peu près impossible de repasser le fleuve, et qu’il y aurait des inconvénients graves à retarder à cette occasion la marche de l’armée, tous jugèrent qu’il serait plus convenable de dissimuler le ressentiment de cette injure, que d’aspirer témérairement à une vengeance qu’ils ne pourraient obtenir ; ils espérèrent en celui pour lequel ils avaient résolu de combattre, que cette offense gratuite envers les serviteurs du Christ ne demeurerait pas impunie, et qu’eux-mêmes en recevraient la récompense de celui qui a dit : Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ; c’est par votre patience que vous posséderez vos âmes[58]. Ils poursuivirent donc leur route, et arrivèrent à Belgrade, comme je l’ai dit. Gautier, ayant fait demander au duc des Bulgares qui commandait dans ce lieu la permission de faire des achats, et n’ayant pu l’obtenir, établit son camp devant la ville, et ne pouvant contenir son armée qui souffrait beaucoup du manque de vivres, il se trouva bientôt exposé aux plus graves dangers. Voyant que les Bulgares ne voulaient consentir à vendre aucune denrée, quelque prix qu’on leur en offrit, l’armée, sortit de son camp pour chercher à se procurer des aliments par un moyen quelconque, et échapper à la détresse qui l’accablait. Les soldats rencontrèrent les troupeaux des Bulgares, s’emparèrent de vive force du gros et du menu bétail, et le ramenèrent au camp. Aussitôt les Bulgares prennent les armes, et se mettent à la poursuite de ceux qui leur enlevaient leurs bestiaux, dans l’espoir de les reprendre. Se trouvant bientôt en nombre supérieur, et ayant atteint une troupe de cent quarante Croisés qui s’étaient séparés imprudemment du reste de leurs compagnons, et qui se réfugièrent dans un oratoire pour se soustraire à la fureur de leurs ennemis, ceux-ci mettent le feu à ce bâtiment, brûlent tous ceux qui s’y étaient renfermés, et mettent les autres en frite. Gautier, sachant bien qu’il traînait à sa suite des gens grossiers et dépourvus d’entendement, laissa en arrière ceux qui voulaient se conduire selon leurs caprices, et se montraient incorrigibles, poursuivit sa marche avec le reste de ses bataillons, traversa les vastes forêts de la Bulgarie, s’avançant avec beaucoup de prudence et de circonspection, et atteignit la belle ville de Stralicie, métropole de la Dacie méditerranée. Là, ayant porté plainte au gouverneur de la ville des outrages et des violences que le peuple de Dieu avait subis injustement de la part des Bulgares, il obtint une satisfaction complète. Le même chef, homme honnête et craignant Dieu, le reçut et le traita avec beaucoup d’humanité, lui permit de conclure des marchés selon les lois ordinaires, l’autorisa, ainsi que son peuple, à acheter tout ce qui serait nécessaire à de bonnes mesures et à des prix raisonnables ; et, pour mettre le comble à tant de bons procédés, il lui donna des guides qui furent chargés d’accompagner l’armée jusqu’à la ville royale. Gautier, y étant arrivé, et ayant été présenté à l’empereur, obtint de sa munificence la permission d’établir son armée dans des lieux voisins de la ville, jusqu’à l’arrivée de Pierre, sur les ordres duquel il déclara s’être mis en route ; et l’empereur, sur sa demande, lui accorda, pour lui et pour son armée, la permission de vendre et d’acheter. Cependant Pierre, peu de temps après, ayant traversé la
Lorraine, la Franconie ; la Bavière, cet le pays qui s’appelle Autriche, avec
une armée considérable composée d’une multitude de gens rassemblés par lui chez
tous les peuples, appartenant à des tribus et parlant des langues diverses,
et s’élevant peut-être à quarante mille individus, arriva aussi sur les
frontières de Tous ceux qui faisaient partie de l’expédition trouvèrent donc une grande abondance de vivres ; des marchés de toute espèce attestèrent la bonne union des deux peuples ; toute la nuit se passa dans la plus parfaite tranquillité, au milieu de ces témoignages réciproques de bienveillance. Le lendemain matin, les otages furent rendus, et l’armée se disposa à partir. Tandis qu’on faisait les derniers préparatifs, la plus grande partie de l’armée, et même presque toute l’armée étant déjà en marche, quelques brouillons dignes de la colère du ciel, se rappelant une querelle fort légère qu’ils avaient eue la veille avec un Bulgare, à l’occasion d’un marché, et se trouvant en arrière et à quelque distance du gros de l’armée, s’avisèrent de mettre le feu à sept moulins situés prés du pont et sur la rive du fleuve[60], et les bâtiments furent bientôt réduits en cendres. Ces fils de Bélial étaient Teutons, et au nombre d’environ cent hommes. Non contents de cet acte de frénésie, ils mirent en outre le feu à quelques autres bâtiments qu’ils trouvèrent en dehors des murs de la ville ; puis, après avoir consommé leur crime, et comme s’ils n’avaient pas même la conscience de leur scélératesse, ils se hâtèrent de rejoindre leurs innocents compagnons. Le duc cependant qui, la nuit précédente, les avait tous bien reçus et bien traités, voyant comme on répondait final t ses bons offices, et, par un jugement trop précipité, imputant à tous ce qui n’était que le crime de quelques-uns, considérant dès lors tous les gens de l’expédition comme des voleurs et des incendiaires, convoque tous les citoyens, et les invite à prendre les armes. Marchant lui-même à la tête de la multitude, il l’encourage par ses paroles et son exemple à poursuivre les légions, et à tirer d’elles la vengeance due aux sacrilèges. Tous sortent de la ville, et courent sur les traces de l’armée ; bientôt ils atteignent l’arrière-garde, et l’attaquent avec une horrible violence. D’abord ils rencontrent les malfaiteurs qui n’avaient pas encore rejoint le camp, et qui marchaient isolément, et leur font subir dans leur indignation la juste peine de leur crime. .bientôt, soit par hasard, soit avec intention, ils enveloppent le juste avec l’impie, et l’innocent succombe sous leurs coups comme le coupable. Ils enlèvent tous les chariots chargés de vivres et de toutes sortes d’instruments de ménage ; les vieillards, les malades, les ; femmes, les enfants et les jeunes filles qui ne peuvent suivre d’un pas égal la marche des troupes, sont arrêtés, chargés de fers, et emmenés en captivité ; enfin, las de carnage, rassasiés de sang, et chargés de riches dépouilles, les vainqueurs s’arrêtent, et rentrent dans leur ville. Pierre cependant, qui marchait en avant avec tous les bataillons et les hommes les plus considérables de l’expédition, ignorait complètement les malheurs qui s’étaient passés derrière lui et poursuivait sa route. Un homme, échappé du tumulte, presse un cheval vigoureux, arrive en toute hâte et lui rapporte le massacre de ses fières et la captivité de tous ceux qu’on a emmenés. Aussitôt, et sur l’avis unanime des hommes les plus sages, on reprend la route qu’on venait de suivre toute la journée ; les légions qui marchaient en avant sont rappelées ; tous apprennent avec douleur et en versant des torrents de larmes la mort de leurs frères, et se retrouvent le soir en face de la ville où la veille ils avaient dressé leurs tentes. Pierre et les hommes raisonnables qui étaient avec lui ne s’étaient arrêtés à cette résolution que dans des intentions pures et faciles à comprendre. Ils voulaient rechercher les, premières causes de cette catastrophe, prévenir toute occasion de nouveaux scandales et rétablir une paix solide entre les deux peuples, afin de reprendre leur marche avec plus de sûreté, après avoir pourvu au salut des consciences. Ils envoyèrent donc des hommes prudents et honnêtes au gouverneur et aux principaux habitants de la ville, les chargeant de prendre toutes les informations nécessaires, et de reconnaître quels motifs avaient pu amener une si brusque attaque et l’effusion de tant de sang innocent. Après avoir bien constaté les faits, les députés jugèrent qu’un mouvement légitime d’indignation avait suffisamment autorisé les citoyens à prendre les armes, qu’il ne serait ni convenable ni opportun de demander vengeance des maux soufferts ; et, tout bien considéré, ils se bornèrent à demander avec les plus vives instances que la paix fût rétablie, et que l’on rendît complètement le butin, les approvisionnements, les prisonniers, enfin tout ce qu’on avait enlevé. Tandis qu’ils travaillaient à ce traité et qu’ils étaient à peu prés parvenus à en arrêter les boises d’un commun accord, un nouveau tumulte s’élève dans le camp, à la suite de l’ardeur inconsidérée de quelques hommes téméraires qui cherchent à venger par la violence ; l’affront qu’ils ont reçu. Pierre s’efforçant de les arrêter dans leur folie, et surtout d’écarter toute occasion de massacre, leur envoie aussitôt des hommes prudents et qui exerçaient une grande autorité dans l’armée, avec mission d’employer tous leurs soins pour arrêter les soldats dans leur violente agression contre les citoyens. Voyant qu’on ne pouvait leur faire entendre les conseils de la sagesse, Pierre expédie aussitôt des hérauts qui ordonnent de sa part à toute l’armée, en lui rappelant son serment d’obéissance, de s’abstenir de prêter aucun secours à ceux qui, par un acte de témérité insensée, ont osé violer la paix entre les deux peuples. Toute l’armée se soumet à cette, proclamation et s’arrête, attendant l’issue de la querelle et le résultat des négociations. Les députés qui étaient auprès du gouverneur, voyant que le premier tumulte, loin de s’apaiser, s’accroissait à tout moment et rendait. impossible tout arrangement, rentrèrent au camp sans avoir terminé leur affaire, et s’occupèrent aussitôt avec Pierre, l’homme de Dieu, des moyens d’apaiser ces bandes de furieux ; mais tous leurs efforts furent également infructueux : il y avait environ un millier d’hommes qui persistaient dans leur acharnement. Il sortit de la ville un nombre de citoyens à peu près égal, et sous les murs même on se battit des deux parts avec une grande fureur. Ceux qui étaient demeurés dans la ville, voyant qu’il y avait au dehors suie sorte de schisme dans l’armée étrangère, espérèrent que le reste îles troupes ne prendrait aucune part au combat, puisque Pierre l’improuvait hautement et faisait tousses efforts pour l’arrêter, ouvrirent leurs portes, sortirent tous en même temps ; et tombant à la fois sur les nôtres, ils en tuèrent environ cinq cents sur le pont même, et précipitèrent les autres dans le fleuve, où ils se noyèrent presque tous, faute de connaître les localités et les gués. L’armée cependant ne put supporter plus longtemps le spectacle d’un tel massacre ; tous les soldats coururent aux armes ; on se battit avec acharnement des deux parts, et l’on tua beaucoup de monde : en sorte que cette seconde catastrophe fut encore plus déplorable que la première. Cependant ce peuple indocile, incapable de supporter le choc impétueux des Bulgares, ne tarda pas à prendre la fuite, et ceux qui combattaient le plus vaillamment, succombant bientôt à cet exemple, furent entraînés dans le tourbillon des fuyards. Toute l’armée se sauva à la débandade, tous les rangs furent rompus, nul ne songea plus à résister. Au milieu de tout ce désordre, Pierre perdit à peu près tout l’argent qu’il avait amassé, produit des largesses des princes fidèles, et qu’il destinait à secourir les pauvres et les indigents dans le cours de leur voyage. On enleva le chariot qui portait tout ce, qu’il possédait. Les Bulgares, poursuivant leurs succès avec ardeur, tuèrent environ dix mille Croisés, enlevèrent tous les chariots et toutes les provisions, et firent prisonniers une immense quantité de femmes et d’enfants. Ceux qui avaient échappé au massacre s’enfuirent dans l’épaisseur des forêts, et suivirent des sentiers détournés ; enfin le troisième jour, avertis par le son des clairons et des trompettes, ils se rassemblèrent autour de Pierre qui, de son côté, en avait rallié aussi un grand nombre, et tous se trouvèrent réunis sur une colline assez élevée. Au bout de quatre jours et après la réunion de tous ceux qui s’étaient dispersés ou sortaient des lieux qui leur avaient servi de refuge, l’armée se reforma au nombre d’environ trente mille personnes. Elle avait perdu par son imprudence à peu près deux mille chars ou chariots, et quoique toutes les difficultés fussent par là redoublées, elle n’aurait pu se résigner à l’ignominie de renoncer à ses premiers projets et l’on résolut de poursuivre le voyage. Tandis qu’on faisait les derniers préparatifs de départ et que l’on commençait à éprouver déjà tous les maux d’une nouvelle disette, voici qu’il arrive au camp un messager de l’empereur, qui porte des ordres souverains à Pierre et aux autres capitaines de l’armée ; il les rassemble et leur dit : Hommes nobles et illustres, la renommée a fait parvenir aux oreilles de l’empereur des rapports sinistres et des paroles mal sonnantes : on lui a dit que, dans le sein même de son Empire, vous aviez porté la violence parmi les habitants des contrées qui reconnaissent ses lois, et que vous aviez répandu partout le désordre et l’esprit de querelle. C’est pourquoi au nom de son autorité, et si vous désirez encore obtenir quelque grâce devant sa Majesté, nous vous enjoignons de ne plus vous arrêter au-delà de trois jours dans aucune clés villes que vous rencontrerez, de continuer votre route en tenant une meilleure conduite, et de diriger au plus tôt vôtre expédition vers Constantinople. Nous marcherons devant votre armée et lui ferons fournir à de justes prix tout ce qui sera nécessaire pour son entretien. Ces paroles relèvent le courage des soldats ; près de succomber sous l’excès de la misère et du dénuement : dès qu’ils apprennent les bons effets de la clémence de l’empereur et les ordres suprêmes qu’il a fait donner ; ils reprennent l’espérance et cherchent, suivant l’occasion, à protester de leur innocence, disant qu’ils ont supporté long ;-temps et patiemment les insultes et les procédés injustes des Bulgares ; ils suivent leur nouveau chef, s’abstiennent avec soin de tout désordre et arrivent d’une marche rapide à Constantinople. Ils y trouvèrent Gautier qui attendait leur arrivée à la tête de ses légions, et les deux armées, ainsi réunies, dressèrent leur camp aux lieux qui leur furent assignés. Pierre est aussitôt mandé par l’empereur ; il entre dans la ville, se présente devant sa Majesté et expose en homme rempli de courage et d’éloquence l’objet de son pèlerinage et les motifs d’une si grande entreprise : il dit que les plus grands princes des contrées occidentales, dignes serviteurs de Dieu, arriveront incessamment à sa suite. Tant de force d’esprit, tant d’éloquence de langage, subjuguent tous les auditeurs ; les princes du palais admirent le courage et la prudence de cet homme, et l’empereur lui-même en parle avec bienveillance. Il le comble de ses bontés, lui fait donner les plus riches présents et lui prescrit de retourner à son camp. L’armée se repose pendant quelques jours et se rétablit de ses fatigues, au milieu d’aine grande abondance de vivres ; et lorsque les vaisseaux que l’empereur a fait disposer sont prêts à la recevoir, elle s’embarque, traverse l’Hellespont, et aborde en Bithynie, première province du diocèse de l’Asie et limitrophe de la même mer : elle arrive ensuite en un lieu, situé sur les bords de la mer, nommé Civitot[61], et y établit son camp. Cette ville se trouvait aussi placée sur les frontières des ennemis. L’armée y passa environ deux mois de suite,, au milieu d’une grande abondance de toutes choses, ayant presque tous les jours des vivres frais, et se rétablissant de ses longues souffrances. Mais ce peuple misérable et dénué d’entendement, corrompu par l’opulence et l’oisiveté, poussé à l’insolence par le bien-être, commença bientôt à se former en bandes, en dépit des ordres de ses chefs, et ces bandes se mirent à parcourir le pays à plus de dix milles à la ronde, enlevant partout le gros et le menu bétail et le ramenant au camp. On avait reçu fréquemment des lettres, par lesquelles l’empereur ordonnait qu’on eût a attendre l’arrivée des princes qui devaient suivre les premières expéditions ; qu’on s’abstînt avec soin jusque-là de se répandre dans le pays et de provoquer les ennemis par aucun acte d’hostilité ; qu’enfin l’armée demeurât tranquillement dans les lieux qui lui étaient assignés et eût à se conduire avec prudence. Pierre cependant, plein de sollicitude pour le peuple confié a ses soins, était retourné à Constantinople, dans l’espoir d’obtenir des prix plus modérés et de meilleures conditions pour toutes les denrées qui étaient fournies aux soldats. Le peuple obstiné et mutile profita de son absence pour se livrer à de plus violons excès. Les complices d’une même faction se séparèrent du reste de l’armée et se réunirent au nombre d’environ sept mille hommes d’infanterie et trois cents cavaliers ; sourds aux prières et aux défenses de leurs compagnons, ils se formèrent en bataillons réguliers et partirent, dirigeant leur marche vers Nicée. Ils ramassèrent une grande quantité de bestiaux de toute espèce, dans les environs de cette ville, et rentrèrent ensuite, dans le camp, sains et saufs. Les Teutons et les hommes qui parlaient leur langue, voyant que les Latins avaient complètement réussi dans leur expédition, entraînés par l’amour du pillage, se réunirent de la même manière et formèrent le projet de tenter une semblable entreprise, afin de se faire un nom et d’accroître les ressources de leurs ménages. S’étant donc rassemblés au nombre d’environ trois mille hommes d’infanterie et deux cents cavaliers, tous de la même nation, ils prirent aussi la route de Nicée. Il y avait dans cette contrée une ville située au pied d’une montagne ; à quatre milles environ de Nicée : ils arrivent auprès de cette ville, l’attaquent de toutes parts avec une grande impétuosité et en rassemblant toutes leurs forces ; la plupart des habitants opposent une résistance opiniâtre, mais inutile ; les Teutons s’en rendent maîtres de vive force et massacrent presque toute la population ; puis s’étant emparés de tout ce qu’ils trouvent, séduits par la beauté et la richesse du pays, ils s’y établissent à demeure et dressent leur camp, résolus d’y demeurer jusqu’à l’arrivée des princes. Soliman[62], prince et gouverneur de ce pays, ayant appris depuis longtemps l’expédition des Chrétiens, avait recruté dans toutes les parties de l’Orient une quantité innombrable de vaillants guerriers, employant tour à tour la prière, l’argent et toutes sortes d’autres moyens pour accroître la force de ses armées, Il était revenu ensuite dans le, même pays, pour le mettre à l’abri des attaques de ses ennemis et y porter les secours nécessaires. Informé que les Teutons venaient de s’emparer d’une ville et comptaient s’y maintenir, Soliman arrive en toute hâte, attaque et force le camp des Teutons et fait passer au fil de l’épée tous ceux qui l’occupaient. Cependant le bruit de cette nouvelle se répand, et bientôt la renommée apprend aux Chrétiens que les cohortes Teutonnes, récemment sorties de leur camp, ont succombé presque entièrement sous les coups de l’ennemi. Tout le monde est consterné ; les gémissements et les larmes attestent la douleur générale, ainsi que la faiblesse d’esprit de ceux qui s’y livrent. Enfin, lorsque la triste vérité est plus complètement connue, il s’élève un tumulte extrême dans le camp et parmi cette foule de peuple ; tous demandent à grands cris qu’on ne se montre point insensible au malheur de leurs frères, qu’on prenne les armes, et que fantassins et cavaliers s’empressent à L’envi d’aller venger leur désastre. Les principaux chefs de l’armée et tous ceux qui avaient une plus grande expérience, jaloux de se conformer aux ordres de l’empereur, font tous leurs efforts pour apaiser ces cris et calmer l’ardeur imprudente d’un peuple furieux ; mais ce peuple se montre indomptable et se soulève bientôt contre eux ; s’appuyant sur l’autorité d’un certain Godefroi, surnommé Burel, qui était à la tête de la faction, il va jusqu’à insulter les principaux chefs, disant que c’est lâcheté et non prudence, de ne vouloir pas poursuivre avec le fer vengeur les assassins de leurs frères. L’avis des malintentionnés prévalut enfin ; tous courent aussitôt aux armes et laissent tous les hommes faibles avec les femmes, les enfants et ceux qui n’avaient pas d’armes ; ils se réunissent au nombre d’environ vingt-cinq mille hommes d’infanterie et cinq cents cavaliers bien cuirassés : puis d’étant formés en bataillons et en bon ordre d’armée, ils se dirigent à travers ‘la forêt vers le flanc de la montagne, sur le pays où se trouve Nicée. A peine avaient- ils fait une marche de trois milles, que Soliman, suivi d’une multitude innombrable, pénètre dans la même forêt, hâtant sa marche pour aller attaquer le camp des nôtres, au lieu où il avait été établi. Lorsqu’il entendit des cris extraordinaires et apprit que nos légions avaient quitté leur camp pour marcher sur lui, il quitta aussitôt les montagnes et les bois et se porta en rase campagne. Les nôtres y arrivèrent aussi, sans se douter de l’approche des ennemis ; mais dès qu’ils voient toute leur armée se développant dans la plaine, ils s’encouragent mutuellement, et se précipitant sur eux, les pressent vivement du fer meurtrier et leur redemandent le sang de leurs frères. Les ennemis, cependant, reçoivent cette première attaque, faite avec la plus grande impétuosité ; chacun d’eux reconnaissant bientôt qu’il y va de la vie, tous résistent avec fermeté, animés d’une juste indignation et se confiant en leur nombre. Des deux côtés les cohortes combattent avec la plus grande valeur, mais bientôt les nôtres sont accablés par la masse innombrable qui se précipite sur eux, et ne pouvant soutenir plus longtemps le combat, ils rompent leurs rangs et se mettent en fuite. Les Turcs cependant les poursuivent vivement l’épée dans les reins, et les ramènent ainsi jusques au camp, en faisant un massacre effroyable. On vit périr dans cette affaire plusieurs des principaux nobles, qui avaient suivi Pierre l’ermite, Gautier sans-avoir, Rainauld de Bresse, Foulcher d’Orléans et un grand nombre d’autres. Sur vingt-cinq mille fantassins et cinq cents cavaliers qui étaient sortis du camp, à peine un seul put-il échapper à la mort ou à la captivité. Maître de la victoire, et enorgueilli d’un si grand succès, Soliman entra de vive force dans le camp des Chrétiens : ceux qui y étaient demeurés sont massacrés, sans qu’aucun d’eux entreprenne même de résister ; les vieillards, les malades, les moines, tout le clergé, les femmes parvenues à l’âge mur, périssent sous le fer ennemi ; le vainqueur n’épargne que les enfants et les jeunes filles, dont l’âge et les traits inspirent la pitié, et qu’il réserve pour les réduire en servitude. Il y avait tout à côté du camp des Chrétiens, et sur les bords de la mer, une vieille forteresse, à demi-ruinée, sans habitants, et qui n’avait pas même de portes ; poussés par la nécessité, espérant y trouver quelques moyens de défense, des pèlerins s’y étaient transportés en toute hâte, et s’y trouvaient réunis au nombre de trois mille environ. Ils entassent aussitôt leurs boucliers, et une grande quantité d’énormes roches pour fermer l’entrée du fort, et font pour se défendre torts les préparatifs qu’exigeaient de si graves périls. Tandis que les Turcs les pressent vivement, et que de leur côté les assiégés l’ont tous leurs efforts pour les repousser, combattant avec la plus grande ardeur, dans l’espoir de sauver leur vie et leur liberté, un messager se rend en toute hâte auprès de Pierre, lui annonce la déroute de son armée, et lui dit enfin que les débris de ce peuple malheureux se sont enfermés dans une forteresse à demi-ruinée, où les ennemis les enveloppent et les assiégent, et qu’ils y manquent à la fois d’armés et de vivres. Pierre se présente chez l’empereur, et obtient, à force de supplications et de prières, qu’on fera partir le plus promptement possible des troupes, pour délivrer ces infortunés du péril qui les menace. Les ordres donnés sont aussitôt exécutés. Les Turcs, à cette nouvelle, se retirent soudain de devant la forteresse ; ils entraînent à leur suite tous leurs prisonniers, les tentes et les pavillons, les chevaux les mulets, les riches dépouilles de nos immenses bagages, et rentrent à Nicée. Ainsi périt un peuple obstiné et intraitable, qui ne sut point écouter les conseils de la prudence, et qui se livrant à son impétuosité naturelle, succomba sous le fer de l’ennemi, sans retirer aucun utile fruit de ses longues fatigues ; car il n’avait pas su se soumettre au joug salutaire de la discipline. Peu de temps après que Pierre fût arrivé en Bithynie, un
certain prêtre, nommé Gottschalk, Teuton d’origine, animé de la même ardeur,
et désirent suivre ses traces, doué du talent de la parole, parvint à
rassembler un grand nombre de Teutons, et à leur persuader d’entreprendre
aussi le pèlerinage. A la tête d’environ quinze mille hommes, il suivit la
même route, arriva sur les frontières de la Hongrie, et obtint sans
difficulté la permission de traverser ce royaume. En vertu des ordres du roi,
cette armée trouva partout toutes sortes de marchandises qu’elle achetait à
de bonnes conditions ; nais les soldats abusant de cette grande abondance
d’aliments, et se livrant à l’ivrognerie, ne tardèrent pas à se porter à
toutes sortes d’excès contre les indigènes ; ils pillaient de tous côtés ;
sur les marchés publiés, ils enlevaient de vive force les denrées qu’on y
apportait, et, oubliant toutes les lois de l’hospitalité, ils tuaient
fréquemment un grand nombre de gens du pays. Dés que le roi en fut instruit,
enflammé de colère, il fit sur-le-champ un appel à tout son royaume, et
ordonna au peuple et aux grands de s’armer pour tirer vengeance de tant
d’insultes. Dans un nombre infini de lieux, les soldats avaient commis, en
effet, toutes sortes d’excès honteux, dont le récit même souillerait ces
pages, et que le roi ne pouvait tolérer sans encourir la haine de ses sujets,
et le reproche de lâcheté. Toute la milice du royaume fut donc convoquée
comme pour marcher contre des ennemis dignes de la colère publique ; et les
Hongrois coururent aux armes d’un commun accord, pour venger dans le sang
toutes les indignités qu’ils avaient subies. Enfin, près du lieu dit Belgrade,
situé au centre même du royaume, ils trouvent cette .multitude d’insensés en
proie à la confusion : ceux-ci instruits de la prochaine arrivée du roi, et
de la fureur qui l’animait, livrés aux angoisses de leurs consciences
coupables, avaient pris les armes, et se disposaient a résister ouvertement,
et à repousser la force par Les députés s’avancèrent, portant artificieusement des
paroles de paix, et dirent aux troupes : Notre
roi a reçu de grandes plaintes de votre armée, et on lui a rapporté que vous
aviez commis les plus graves excès contre ses sujets, oubliant injustement la
bonté avec laquelle vos hôtes vous avaient accueillis. Cependant le roi a
reconnu, dans sa prudence, que vous n’étiez pas tous coupables des mêmes fautes
; il est certain qu’il y a parmi vous des hommes prudents et craignant Dieu,
auxquels des crimes aussi énormes ont déplu, et que c’est malgré leurs avis,
et en dépit de leurs remontrances qu’ont été faites toutes les choses qui ont
excité à juste titre l’indignation de notre roi. Craignant donc de faire
peser sur tous la peine des crimes commis par une portion des vôtres, et ne
voulant pas confondre le juste avec l’impie, le roi a résolu de mettre un
frein à sa colère, et d’épargner pour le moment ses frères dans la foi
chrétienne. Nous vous conseillons donc, afin que vous parveniez à apaiser
complètement sa colère, de livrer sans aucune condition, entre les mains du
seigneur-roi, vos personnes, vos armes, et tous les approvisionnements que
vous avez ici. Autrement, il n’est pas un seul de vous qui puisse échapper à
la mort, puisque vous trouvant au milieu de son royaume, et n’ayant que des
forces très inférieures, vous n’avez pas même le moyen de vous sauver par Vers le même temps, à très peu d’intervalle de cette catastrophe, des bandes innombrables venues de l’Occident, marchant à pied, sans chefs et sans guides, s’avançaient et se répandaient de tous côtés, sans la moindre prudence. Il y avait cependant dans le nombre de ces pèlerins quelques hommes nobles, tels que Thomas de Feii, Clairambault de Vandeuil, Guillaume Charpentier, le comte Hermann et quelques autres ; mais le peuple, impatient de toute discipline, ne leur obéissait point, et, négligeant les avis de tous les hommes prudents et sages, il marchait au hasard, se livrant hardiment à ses caprices et à toutes sortes d’actions illicites. Il en résulta qu’au lieu de suivre leur entreprise avec le sentiment de la crainte du Seigneur, et d’accomplir leur pèlerinage pour l’amour du Christ, en se souvenant des préceptes divins et en observant la discipline évangélique, ils s’abandonnèrent à l’esprit de vertige, et massacrèrent cruellement tout ce qu’ils rencontrèrent de Juifs dans les villes et, bourgs par où ils passèrent, les surprenant toujours à l’improviste, et dénués de tout moyen de défense. Ces désastres eurent lieu surtout dans les villes de Cologne et de Mayence ; là aussi le comte Emicon, homme puissant et noble, illustre dans ces contrées, se joignit à eux avec une grande suite ; mais oubliant la générosité qui lui eût convenu, loin de se montrer disposé à blâmer leur conduite ou à réprimer leurs excès, il prit part lui-même à tous ces désordres, et excita au crime ses compagnons de voyage. Après avoir traversé la Franconie et la Bavière, ils arrivèrent sur les frontières de la Hongrie, à un lieu nommé Mersbourg[63], et crurent qu’ils obtiendraient sans difficulté la permission d’entrer dans le pays ; mais ayant trouvé les passages fermés, ils s’arrêtèrent en deçà du pont. Mersbourg était une place forte, défendue par deux grands fleuves, le Danube et la Leytha, et entourée de marais profonds ; en sorte qu’il eût été très difficile, même à des forces plus considérables, de forcer le passage et de chasser ceux qui le défendaient. On disait que ceux qui s’avançaient étaient au nombre d’environ deux cent mille hommes d’infanterie et près de trois mille cavaliers. Lorsqu’ils voulurent passer, le roi de Hongrie leur fit refuser l’entrée de ses États, craignant qu’ils ne conservassent le ressentiment de la destruction des légions de Gottschalk, et qu’ils ne cherchassent à les venger. Ce désastre était encore récent ; on en avait fait un si horrible massacre que la nouvelle s’en était répandue partout, et tant de motifs étaient bien propres à inspirer de justes craintes au roi de Hongrie. Cependant les pèlerins obtinrent de ceux qui avaient été préposés par le roi à la garde de la ville, la permission d’envoyer des députés à ce souverain, pour lui demander humblement la paix, et l’autorisation de traverser son royaume ; et, en attendant l’issue de cette ambassade, ils se retirèrent en deçà des marais, et dressèrent leur camp au milieu de riches pâturages. Cependant, les envoyés au roi revinrent au bout de
quelques jours, sans avoir pu réussir dans leur négociation. Sur leur
rapport, les hommes les plus considérables de l’armée, voyant bien qu’il n’y
aurait aucun moyen de trouver grâce auprès du roi, proposèrent à leurs
compagnons de dévaster les terres appartenant à ce prince, situées en deçà
des deux fleuves et des marais, d’incendier les bourgs et de traiter le pays
en ennemi. Tandis qu’ils se livraient avec ardeur à ces excès, sept cents
hommes de la milice hongroise, ayant traversé en silence les fleuves, pour
aller entreprendre de protéger le pays qu’on dévastait, se présentèrent un
jour à l’improviste, en tête de l’armée des Croisés. Ne pouvant fuir devant
ceux-ci, et empêchés par les eaux de rentrer dans leur pays, ils furent
presque tous tués, et ceux qui se sauvèrent, en petit nombre, se cachèrent
dans les joncs, après avoir perdu leurs chevaux au milieu des marais.
Enorgueillis de cette victoire, les pèlerins formèrent le projet d’établir
des ponts sur les rivières, d’assiéger la forteresse et de s’ouvrir un
passage de vive force. Conformément à ce plan, les soldats, après avoir jeté
leurs ponts, s’avancent vers les murailles, sous la protection de leurs
boucliers, pour travailler à les renverser par le pied, tandis que d’autres
font leurs préparatifs pour entrer de vive force dans Tels étaient les grands mouvements qui agitaient alors tout l’Occident ; presque toutes les nations se précipitaient en masse vers la même entreprise, les ailes ayant leurs princes à leur tête, d’autres marchant isolément et dépourvues de chefs. La route la plus directe, qu’avaient découverte ceux qui passèrent les premiers par la Hongrie, fut bientôt complètement fermée, par suite de l’insolence des pèlerins, et des excès de tout genre auxquels ils se livrèrent si injustement envers les habitants de ces contrées. Aussi ceux qui vinrent après eux, avertis par ces exemples, mirent-ils tous leurs soins à se concilier la faveur et les bonnes grâces du souverain de ce royaume. |
 L’empereur
Héraclius, lorsqu’il s’arrêta dans cette ville,
ainsi que je l’ai rapporté, s’informa avec grand soin auprès de tous les
citoyens, et en particulier auprès d’un homme vénérable, Sophronius, alors
évêque — qui venait de succéder à Modeste de pieuse mémoire —, du lieu même
où avait été le temple du Seigneur, que le prince romain Titus avait détruit
en même temps que
L’empereur
Héraclius, lorsqu’il s’arrêta dans cette ville,
ainsi que je l’ai rapporté, s’informa avec grand soin auprès de tous les
citoyens, et en particulier auprès d’un homme vénérable, Sophronius, alors
évêque — qui venait de succéder à Modeste de pieuse mémoire —, du lieu même
où avait été le temple du Seigneur, que le prince romain Titus avait détruit
en même temps que  La nation du Seigneur recouvra cependant la tranquillité
du vivant de cet homme admirable et digne de louanges, Haroun, surnommé
Haschid, qui gouverna tout l’Orient
La nation du Seigneur recouvra cependant la tranquillité
du vivant de cet homme admirable et digne de louanges, Haroun, surnommé
Haschid, qui gouverna tout l’Orient
 Au temps donc où la ville agréable à Dieu était, comme je
l’ai dit, en proie à tant de souffrances, parmi ceux qui allaient accomplir
l’œuvre de la dévotion et : de la prière, en visitant les lieux saints, un
prêtre nommé Pierre, né dans le royaume des Francs et dans l’évêché d’Amiens,
ermite autant de fait que de nom, attiré par la même ardeur, arriva à
Jérusalem. C’était un homme de très petite stature et dont l’extérieur
m’offrait qu’un aspect misérable : mais une force supérieure régnait dans ce
corps chétif. Il avait l’esprit vif, l’œil pénétrant, le regard agréable, et
parlait avec facilité et abondance. Selon la loi commune imposée à tous les
chrétiens qui voulaient entrer, il acquitta à la porte de la ville le tribut
qu’on exigeait, et reçut l’hospitalité chez un fidèle qui était lui-même au
nombre des, confesseurs du Christ ; s’informant avec empressement de la
situation des chrétiens auprès de son hôte qui était aussi un homme actif et
zélé, il apprit de lui non seulement tout ce qui se rapportait aux malheurs
présents, mais encore tous les détails des persécutions que leurs ancêtres
avaient eu à supporter depuis longues années ; s’il manquait quelque chose à
ce récit, le témoignage de ses propres yeux ne tarda pas à l’instruire
complètement. Ayant fait quelque séjour dans la ville, et visitant toutes les
églises, Pierre y trouva l’entière confirmation de tout ce que ses frères lui
avaient raconté. Comme il apprit aussi que le patriarche de Jérusalem était
un homme religieux et plein de la crainte du Seigneur, il désira conférer
avec lui de l’état présent des affaires, et s’instruire plus en détail sur
quelques autres points : il alla donc le trouver, lui fut présenté par un
fidèle ami, et tous deux se réjouirent mutuellement de leurs conférences. Le
patriarche s’appelait Siméon : reconnaissant au langage de Pierre que c’était
un homme de prudence, rempli d’expérience dans les choses du monde, puissant
par les œuvres autant que par les paroles, il en vint bientôt à causer plus
familièrement avec lui, et lui exposa en détail tous les maux qui
affligeaient profondément le peuple de Dieu, habitant de
Au temps donc où la ville agréable à Dieu était, comme je
l’ai dit, en proie à tant de souffrances, parmi ceux qui allaient accomplir
l’œuvre de la dévotion et : de la prière, en visitant les lieux saints, un
prêtre nommé Pierre, né dans le royaume des Francs et dans l’évêché d’Amiens,
ermite autant de fait que de nom, attiré par la même ardeur, arriva à
Jérusalem. C’était un homme de très petite stature et dont l’extérieur
m’offrait qu’un aspect misérable : mais une force supérieure régnait dans ce
corps chétif. Il avait l’esprit vif, l’œil pénétrant, le regard agréable, et
parlait avec facilité et abondance. Selon la loi commune imposée à tous les
chrétiens qui voulaient entrer, il acquitta à la porte de la ville le tribut
qu’on exigeait, et reçut l’hospitalité chez un fidèle qui était lui-même au
nombre des, confesseurs du Christ ; s’informant avec empressement de la
situation des chrétiens auprès de son hôte qui était aussi un homme actif et
zélé, il apprit de lui non seulement tout ce qui se rapportait aux malheurs
présents, mais encore tous les détails des persécutions que leurs ancêtres
avaient eu à supporter depuis longues années ; s’il manquait quelque chose à
ce récit, le témoignage de ses propres yeux ne tarda pas à l’instruire
complètement. Ayant fait quelque séjour dans la ville, et visitant toutes les
églises, Pierre y trouva l’entière confirmation de tout ce que ses frères lui
avaient raconté. Comme il apprit aussi que le patriarche de Jérusalem était
un homme religieux et plein de la crainte du Seigneur, il désira conférer
avec lui de l’état présent des affaires, et s’instruire plus en détail sur
quelques autres points : il alla donc le trouver, lui fut présenté par un
fidèle ami, et tous deux se réjouirent mutuellement de leurs conférences. Le
patriarche s’appelait Siméon : reconnaissant au langage de Pierre que c’était
un homme de prudence, rempli d’expérience dans les choses du monde, puissant
par les œuvres autant que par les paroles, il en vint bientôt à causer plus
familièrement avec lui, et lui exposa en détail tous les maux qui
affligeaient profondément le peuple de Dieu, habitant de  Quelques années auparavant, le pape
Grégoire, prédécesseur
d’Urbain, avait, après de longues contestations, vivement poursuivi Henri,
roi des Teutons et empereur des Romains, au sujet de l’anneau et de la crosse
des évêques défunts. Par suite d’une ancienne habitude, invétérée surtout
dans l’Empire, un envoyait à l’empereur l’anneau et là crosse pastorale,
après la mort des prélats de chaque église. Aussitôt, et sans attendre
l’élection du clergé, l’empereur chargeait un homme quelconque, choisi par
ses familiers et ses chapelains, de remplir les fonctions de pasteur dans
l’Église vacante. Le pape jugeant qu’un tel procédé citait contraire à toute
honnêteté et foulait aux pieds les droits de l’Église, envoya trois
avertissements consécutifs à l’empereur, pour l’inviter e renoncer à cette
détestable prétention. Après l’avoir ainsi prévenu par de salutaires conseils
ne pouvant le persuader, il l’enchaîna du moins par les liens de l’anathème.
L’empereur, irrité de ce traitement, commença à persécuter l’Église romaine :
il suscita un adversaire au pape dans la personne de Guibert, archevêque de
Ravenne, homme lettré et extrêmement riche. Celui-ci se confiant aux forces
de l’empereur et à l’immensité de ses richesses, déposséda par la violence
l’homme vénérable qui occupait le siège apostolique, envahit le Saint-Siège
même, et dépourvu de toute droiture d’esprit, il en vint à ce point de délire
de se croire réellement élevé au rang qu’on lui attribuait par un impie
mensonge. Comme le monde, livré au mal, ainsi que je l’ai dit, suivait alors
des voies pleines de danger, et qui ne pouvaient porter aucun bon fruit, ce
schisme nouveau le poussa encore plus dans ses mauvais penchants ; il perdit
entièrement tout respect de Dieu et des hommes, ne recherchant que ce qui
était nuisible et rejetant tous les moyens de salut. On arrêtait les évêques
; les prélats des églises, quels qu’ils fussent, poursuivis comme s’ils
eussent été coupables d’homicide, étaient jetés dans des cachots et voyaient
tous leurs biens confisqués, dies qu’ils refusaient d’approuver l’empereur
dans sa perversité. Et ce n’était pas seulement des affronts passagers qu’ils
avaient à subir, on les chassait pour toujours de leurs églises, on leur
substituait des intrus. Le pape Grégoire, fuyant l’indignation de l’empereur,
s’était retiré dans la l’ouille. Il y avait été reçu honnêtement et traité
avec bonté par Robert Guiscard, due de ce pays, aux bons offices duquel il
devait déjà d’avoir échappé aux mains de l’empereur. Puis s’étant rendu à
Salerne, il y atteignit le Lerma de sa vie et v fut enseveli. Après Victor,
qui n’occupa le siége que deux mois, il eut pour successeur Urbain, qui, pour
échapper à la fureur de Henri, successeur de l’autre Henri, et persévérant
dans les mêmes voies, vécut aussi caché dans des lieux forts, au milieu de
ses fidèles, sans trouver nulle part un asile parfaitement sûr. Ce fût au
sein même de ces adversités qu’il reçut et traita avec bonté Pierre l’ermite,
lorsque celui-ci vint s’acquitter de sa mission : il lui promit au nom du
Verbe, dont il était l’appui, de se montrer, au temps nécessaire, coopérateur
fidèle de son dessein. Pierre, embrasé du zèle divin, parcourt toute
l’Italie, franchit les Alpes, visite successivement tous les princes de
l’Occident, se transporte en tous lieux, presse, gourmande, insiste avec
fermeté et parvient, avec le secours de la grâce, à persuader à quelques-uns
qu’il importe de se hâter pour subvenir aux pressants besoins de ceux de
leurs frères qui succombent à l’oppression, et de ne pas souffrir que les
lieux saints, que le Seigneur daigna illustrer de sa présence, demeurent plus
longtemps exposés aux profanations et aux impuretés des infidèles. Il juge
même qu’il ne suffit pas de porter ses avertissements chez les princes, et
qu’il convient de faire entendre les mêmes exhortations aux peuples et à tous
les hommes de condition inférieure. Pieux solliciteur, il parcourt tous les
pays, visite tous les royaumes, s’acquitte de sa mission auprès des pauvres
et des hommes les plus obscurs, et évangélise de toutes parts. Le Seigneur,
reconnaissant le mérite d’une foi si ardente, lui avait conféré tant de grâce
qu’il était rare qu’il échouât complètement, dans aucune de ses tentatives
auprès des peuples. Il fut clone extrêmement utile au pape, qui avait résolu
de le suivre sans délai par delà les monts. Remplissant les fonctions de
précurseur, il prépara les esprits de ses auditeurs à l’obéissance, afin que
celui qui entreprendrait de les persuader parvînt plus facilement à son but,
et déterminât plus promptement toutes les volontés.
Quelques années auparavant, le pape
Grégoire, prédécesseur
d’Urbain, avait, après de longues contestations, vivement poursuivi Henri,
roi des Teutons et empereur des Romains, au sujet de l’anneau et de la crosse
des évêques défunts. Par suite d’une ancienne habitude, invétérée surtout
dans l’Empire, un envoyait à l’empereur l’anneau et là crosse pastorale,
après la mort des prélats de chaque église. Aussitôt, et sans attendre
l’élection du clergé, l’empereur chargeait un homme quelconque, choisi par
ses familiers et ses chapelains, de remplir les fonctions de pasteur dans
l’Église vacante. Le pape jugeant qu’un tel procédé citait contraire à toute
honnêteté et foulait aux pieds les droits de l’Église, envoya trois
avertissements consécutifs à l’empereur, pour l’inviter e renoncer à cette
détestable prétention. Après l’avoir ainsi prévenu par de salutaires conseils
ne pouvant le persuader, il l’enchaîna du moins par les liens de l’anathème.
L’empereur, irrité de ce traitement, commença à persécuter l’Église romaine :
il suscita un adversaire au pape dans la personne de Guibert, archevêque de
Ravenne, homme lettré et extrêmement riche. Celui-ci se confiant aux forces
de l’empereur et à l’immensité de ses richesses, déposséda par la violence
l’homme vénérable qui occupait le siège apostolique, envahit le Saint-Siège
même, et dépourvu de toute droiture d’esprit, il en vint à ce point de délire
de se croire réellement élevé au rang qu’on lui attribuait par un impie
mensonge. Comme le monde, livré au mal, ainsi que je l’ai dit, suivait alors
des voies pleines de danger, et qui ne pouvaient porter aucun bon fruit, ce
schisme nouveau le poussa encore plus dans ses mauvais penchants ; il perdit
entièrement tout respect de Dieu et des hommes, ne recherchant que ce qui
était nuisible et rejetant tous les moyens de salut. On arrêtait les évêques
; les prélats des églises, quels qu’ils fussent, poursuivis comme s’ils
eussent été coupables d’homicide, étaient jetés dans des cachots et voyaient
tous leurs biens confisqués, dies qu’ils refusaient d’approuver l’empereur
dans sa perversité. Et ce n’était pas seulement des affronts passagers qu’ils
avaient à subir, on les chassait pour toujours de leurs églises, on leur
substituait des intrus. Le pape Grégoire, fuyant l’indignation de l’empereur,
s’était retiré dans la l’ouille. Il y avait été reçu honnêtement et traité
avec bonté par Robert Guiscard, due de ce pays, aux bons offices duquel il
devait déjà d’avoir échappé aux mains de l’empereur. Puis s’étant rendu à
Salerne, il y atteignit le Lerma de sa vie et v fut enseveli. Après Victor,
qui n’occupa le siége que deux mois, il eut pour successeur Urbain, qui, pour
échapper à la fureur de Henri, successeur de l’autre Henri, et persévérant
dans les mêmes voies, vécut aussi caché dans des lieux forts, au milieu de
ses fidèles, sans trouver nulle part un asile parfaitement sûr. Ce fût au
sein même de ces adversités qu’il reçut et traita avec bonté Pierre l’ermite,
lorsque celui-ci vint s’acquitter de sa mission : il lui promit au nom du
Verbe, dont il était l’appui, de se montrer, au temps nécessaire, coopérateur
fidèle de son dessein. Pierre, embrasé du zèle divin, parcourt toute
l’Italie, franchit les Alpes, visite successivement tous les princes de
l’Occident, se transporte en tous lieux, presse, gourmande, insiste avec
fermeté et parvient, avec le secours de la grâce, à persuader à quelques-uns
qu’il importe de se hâter pour subvenir aux pressants besoins de ceux de
leurs frères qui succombent à l’oppression, et de ne pas souffrir que les
lieux saints, que le Seigneur daigna illustrer de sa présence, demeurent plus
longtemps exposés aux profanations et aux impuretés des infidèles. Il juge
même qu’il ne suffit pas de porter ses avertissements chez les princes, et
qu’il convient de faire entendre les mêmes exhortations aux peuples et à tous
les hommes de condition inférieure. Pieux solliciteur, il parcourt tous les
pays, visite tous les royaumes, s’acquitte de sa mission auprès des pauvres
et des hommes les plus obscurs, et évangélise de toutes parts. Le Seigneur,
reconnaissant le mérite d’une foi si ardente, lui avait conféré tant de grâce
qu’il était rare qu’il échouât complètement, dans aucune de ses tentatives
auprès des peuples. Il fut clone extrêmement utile au pape, qui avait résolu
de le suivre sans délai par delà les monts. Remplissant les fonctions de
précurseur, il prépara les esprits de ses auditeurs à l’obéissance, afin que
celui qui entreprendrait de les persuader parvînt plus facilement à son but,
et déterminât plus promptement toutes les volontés. Francs et dans l’Empire. Dans les environs des
Alpes on remarquait le seigneur Boémond, prince de Tarente, fils du seigneur
Robert Guiscard, duc de Pouille, le seigneur Tancrède, neveu du précédent par
sa mère, et beaucoup d’autres encore dont nous n’avons pu conserver ni le
nombre, ni les noms. Tous, attendant le temps favorable avec les troupes
nombreuses qu’ils avaient sous leurs ordres, se disposaient à marcher comme
une milice chrétienne, et se dévouaient avec ardeur aux fatigues de ce long
pèlerinage pour l’amour du nom du Christ.
Francs et dans l’Empire. Dans les environs des
Alpes on remarquait le seigneur Boémond, prince de Tarente, fils du seigneur
Robert Guiscard, duc de Pouille, le seigneur Tancrède, neveu du précédent par
sa mère, et beaucoup d’autres encore dont nous n’avons pu conserver ni le
nombre, ni les noms. Tous, attendant le temps favorable avec les troupes
nombreuses qu’ils avaient sous leurs ordres, se disposaient à marcher comme
une milice chrétienne, et se dévouaient avec ardeur aux fatigues de ce long
pèlerinage pour l’amour du nom du Christ.