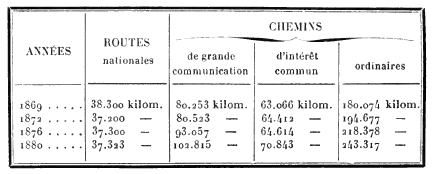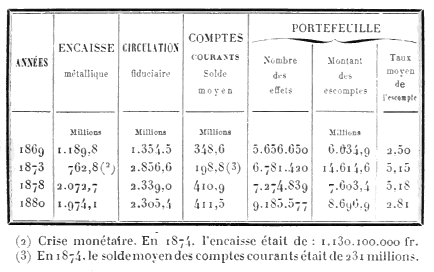HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE (1871-1900)
II. — LA PRÉSIDENCE DU MARÉCHAL MAC MAHON
L'ÉCHEC DE LA MONARCHIE
CHAPITRE X. — LE RELÈVEMENT. - L'AVÈNEMENT DE LA DÉMOCRATIE.
|
Optimisme du peuple français. — Impression produite sur lui par la guerre de 1870. — Le sol de la France. — Le patriotisme. — L'unité nationale. — Années prospères — La température. — La production. — Les récoltes. — L'industrie. — Le commerce. — Abondance. — Les salaires. — La fortune publique. — Rapide relèvement matériel. — La population. — Les classes de la société française. — La bourgeoisie. — Le peuple. — Les nouvelles couches. — Avènement de la Démocratie. I Par la suite logique des événements, l'Assemblée nationale est amenée à donner une constitution à la France. Il serait plus exact de dire que le pays se constitue lui-même. Aucune initiative, aucune direction ne vient du gouvernement. Un cabinet d'affaires, un cabinet neutre arrive au pouvoir. Quant au chef de l'État, ses fonctions sont provisoires et, par des actes décisifs, il s'est volontairement neutralisé. S'il y eut jamais une circonstance où l'inconscient opéra, c'est le jour où, parmi des incidents parlementaires assez minces, au milieu de débats en apparence fastidieux et incohérents, la République fut fondée. Fondée à une voix de majorité par une Assemblée hostile à cet avènement ! C'est donc bien la force des situations, ou pour mieux dire, la poussée nationale qui imposa le vote et fixa à la France ses ultérieurs destins. Les tendances, les aspirations mal définies du peuple français se figèrent soudain autour de ce bulletin unique qui, une fois dans l'urne, fut ferment de vie et principe d'action. Il serait difficile de préciser les raisons obscures du travail secret et intime qui, du fond de l'être, fit naître ainsi, pour des fonctions nouvelles, de nouveaux organes. Ces dispositions, ces aspirations, ces rêves, mal discernés alors, il n'est guère possible de les reconnaître aujourd'hui qu'à leurs effets. Il faudrait une description historique qui ne s'arrêtât pas à ce théâtre de Versailles où la représentation est en parade, mais qui parcourait tout le pays et qui pénétrât jusque dans la conscience de chaque citoyen pour retrouver les origines et les causes. De l'Océan aux Alpes, de la mer du Nord aux Pyrénées, un peuple vit, sent, pense, espère. Matériel énorme ; âme murmurante et confuse. Mille voix exposent ces intérêts et cette âme. Ce sont ces voix qu'il faudrait entendre et cette âme qu'il faudrait raconter. Immédiatement après la guerre, d'un bout à l'autre du territoire, la confiance s'est rétablie ; une vitalité s'est manifestée qui a étonné et averti le monde. La France est résolue à vivre : elle trouvera dans les ressources de son sol, de son génie, la loi de son relèvement et de son progrès. Vaincue, elle reste grande par sa richesse, par ses œuvres ; elle reste grande par la magnifique floraison d'hommes qui se pressent auprès d'elle et lui font un cortège de gloire ; elle reste grande par la crise morale qu'elle traverse ; elle reste grande, enfin, par la volonté où elle est, la première parmi les puissantes nations européennes, de constituer le gouvernement du peuple par lui-même, réalisant ainsi, au moment où elle souffre d'une si cruelle injustice, un effort nouveau vers l'avènement de plus de justice dans l'humanité. Trois ans se sont écoulés. La France est rentrée dans le courant de sa vie régulière. D'autres peuples peut-être se seraient laissé abattre par de tels revers. Se conformant au décret de la victoire, ils auraient accepté une vie diminuée, humiliée, traînant sous le poids du fardeau, une existence misérable. Il en fut autrement de la nation française. Ce peuple n'est pas mélancolique. Aussi peu enclin aux longues tristesses qu'aux longues réflexions, la vivacité de ses impressions sèche ses larmes, comme un rayon de soleil l'ondée rapide de son ciel changeant. Il se remit à vivre, sans faire tant de raisonnements sur les malheurs qui avaient failli tarir en lui les sources de la vie. Le Français, prompt à prendre un parti, est non moins prompt à prendre son parti ; en raison même de sa légèreté, il flotte. Sa vanité, qui le jette au péril, relève sa tête dans l'infortune. Sa mobilité ne l'attarde pas plus aux catastrophes qu'elle ne le fixe dans la prospérité. Ce trait du caractère national, qui met une force dans la souplesse, est exprimé en deux mots par La Fontaine : Je plie et ne romps pas. Le Français a d'autres qualités naturelles qui sont de précieuses conditions de survie : son goût du travail, son application à l'épargne. Ingénieux et habile de ses mains, il est laborieux, beaucoup plus que ne l'exigeraient, sur un sol si fertile et sous un ciel si indulgent, les nécessités et même les commodités de l'existence. La diversité des provinces, la variété des climats, la complexité des races font la multiplicité des travaux et des ressources qui assurent contre les ruines complètes. La prévoyance de la race y aide beaucoup. Il y a toujours, dans les greniers, une semence d'avance, au cas où la récolte manquerait. Chaque Français travaille pour l'avenir et accumule pour la postérité, retranchant méthodiquement sur son bien-être et sur son plaisir, ce qu'il faut pour le bien-être ou le plaisir des générations futures et des héritiers qu'il ne connaitra pas. Ainsi s'établit, entre les âges successifs, une solidarité continue qui donne une permanence robuste au corps de la nation. Le Français a des passions vives, non profondes ; il ne sait pas s'obstiner ; il ne sait pas délester ; la longue rancune et la haine tenace ne demeurent pas en lui. Sa violence est prompte ; elle tombe et se fond à la première larme ou au premier sourire. Le Français aime à aimer. Sa bonne foi est parfaite dans ces élans qui étonnent les races plus réservées : il les blesse parfois en leur tendant les bras. Cette sympathie un peu large, cet optimisme vivace, cette confiance invincible de la nation française en elle-même et dans la nature, apparaissent à toutes les époques de son histoire. Après la guerre de Cent Ans et la grande pitié qu'il y avait au royaume de France, on vit fleurir les temps du roi Louis XII et les heures inoubliables de la Renaissance française ; après les guerres de religion et les invasions espagnoles, ce fut le règne de Henri IV et le rêve de la poule au pot. Aux temps de la Révolution et aux années de l'empire, où le sang déborda de la France sur l'Europe, succédèrent l'idylle de la Restauration et l'ère bourgeoise de Louis-Philippe : les mêmes hommes de loups se font bergers et de soldats laboureurs. Le plus souvent, c'est un retour vers la vie des champs qui produit, en France, ces convalescences bienfaisantes. Le sentiment le plus puissant et le plus profond de la race, c'est l'attachement au sol. L'urbain, le voyageur, l'intellectuel ont toujours quelque lien avec la terre ; ils la quittent ou ils y reviennent. Ce sol de la France a un attrait sans pareil : les étrangers le proclament à l'envi ; mais ils ne peuvent, comme l'habitant de ces terres heureuses, pénétrer le charme que dégage la terre maternelle. Un gras verger normand qui ouvre sa neige féconde à la première brise du printemps ; une vigne qui embaume à l'heure où, dans les prés, la faux coupe les foins de la saint Jean ; les longues plaines fourmentières qui, quand vient l'août, emplissent d'or le rêve du laboureur ; les pacages abrités par le rempart des haies et où vague la tache blanche des bœufs morvandiots ; les rivières flexibles qui attardent, dans les plaines, les détours de leur lame d'argent les forêts où la variété du gibier disperse l'aboiement des chiens ; les routes dont le trait blanc perce l'horizon ; les fermes antiques couronnant les collines ; le clocher paternel montrant du doigt le ciel le vieux cimetière cachant dans l'herbe ses croix de bois ; la fumée des chaumières montant dans le soir paisible : ces spectacles habituels, cette activité mesurée, ces émotions journalières et par leur régularité même inaperçues, touchent n'iule et y laissent une empreinte que rien ne saurait effacer. La douceur de la nature fait la douceur de la vie et crée la sociabilité, qui est un des caractères de la race. Comment ne pas se répandre en libres propos épanouis, quand la clarté du jour réjouit le ciel et, en même temps, le cœur de l'homme ? Bon voisin, bon matin, dit le proverbe. La subsistance abonde et les hommes se réunissent pour la goûter en commun. Devant la cheminée qui flambe, la veillée prolonge et alterne les contes et les chansons ; la vendange joint les mains pour la bourrée ; la flamme du vin et de l'amour pénètre les cœurs par les bras enlacés ; sur la place du village, à l'heure où les chariots rentrent, pliant sous le poids des gerbes, les vieillards devisent et transmettent la parole des aïeux ; la nature dicte sa calme et sincère leçon. Les bourgades agglomèrent les populations plus denses et plus polies ; sur le pas des portes, de maison à maison, les devis s'échangent et s'animent. Les passions de la vie étroite s'excitent, il est vrai, et s'enveniment parfois ; mais, si vives qu'elles soient, elles restent à fleur de peau ; une crainte d'attenter à la paix courante ou de blesser la convenance les contient. Dans les grandes villes, les foules ont des mouvements où se révèle l'âme de l'humanité ; aux époques de trouble, elles ressentent des commotions profondes et se portent en masse sur des points par où le monde penche ; aux jours de fêtes, elles se livrent à des manifestations éclatantes et célèbrent, par la gloire des anniversaires, celle de la nation. La fraternité. Perclus dans les hameaux ou indistincts dans les foules, tous les Français ont un même besoin, un étroit besoin l'un de l'autre. Leur émotion est communicative ; les âmes se rapprochent et s'épanchent. C'est ici que l'homme est le moins un loup pour l'homme. De ce contact constant naît l'habitude du secours mutuel, du soulagement réciproque et cette autre sociabilité, plus exquise encore, que la France a nommée, la première : fraternité. Il n'est pas de mot plus beau, puisqu'il ajoute à l'idée de justice, base de la société, un sentiment. Elle remplit le cœur de ce peuple quand il est laissé à lui-même : il s'y abandonne même parfois jusqu'à en faire une sorte de sentimentalité cosmopolite ; au delà de la famille, de la nation, il voudrait, dans une expansion plus large, embrasser l'humanité. Quand la fraternité s'arrête aux frontières tracées par la nature et qui limitent une même race et un même langage, elle trouve son expression la plus claire et la plus durable dans le culte de la patrie. L'amour du sol, la stabilité du foyer, la continuité des efforts, la fraternité des citoyens ont, sans tant de leçons, développé dans chaque V Français, un patriotisme vif et actif. La patrie, ce n'est pas seulement un orgueil commun, une tradition et un idéal identiques : c'est une conception de l'intelligence, une adhésion de la volonté, un élan du cœur. La patrie est parce qu'on l'aime ; et on l'aime par une inclination de l'être, pareille à celle qui lie la mère aux enfants et les enfants à leur mère. La patrie est supérieure à tous les accidents de l'existence et de l'histoire ; une et indivisible, comme disait la Révolution française. Elle appartient à chacun et à tous : elle enveloppe les hommes comme l'air qu'ils respirent ; elle les saisit d'une prise telle que leur décision même ne suffit pas pour les délivrer de l'étreinte. Fille de la nature, œuvre des siècles, communion des limes, il faudrait des bouleversements dans l'ordre naturel, un effort inverse des siècles, l'insurrection des volontés, l'anéantissement d'une race pour la détruire. A plus forte raison, un sentiment si puissant et si simple échappe-t-il à l'oppression. Les peuples, les provinces, les familles, les citoyens se sont donnés, et se donnent chaque jour, par une effusion continuelle, à la patrie commune. Quelle violence ou quel artifice empêcheraient l'âme d'offrir son essence, la fleur de livrer son parfum ? L'amour ne connaît pas de frontières. M. de Bismarck, quand il cherchait à dégager, devant le Reichstag, les raisons pour lesquelles l'Alsace et la Lorraine resteraient attachées de cœur à la France, présentait une explication un peu lourde : C'est, disait-il, que ces provinces sont fières de penser que Paris, ce grand Paris, leur appartient... Il ne s'agit pas de Paris seulement : la France est toute à la France. Une et indivisible, reprenons le mot de la Révolution : cette formule reste la base de la constitution française. Rien ne peut en altérer l'autorité, ni porter atteinte à l'union spontanée de tous ceux qui, soit publiquement, soit au fond du cœur, perpétuent l'adhésion. Et c'est cette foi latente qui permit à la France de supporter la sentence prononcée à Francfort. Conquête, soit ; séparation, non. Par-dessus la frontière, les âmes volent. Le nom de la France plane partout où le sentiment français demeure. On se résigna donc à la paix, parce que, dans la conscience intime du pays, la liberté humaine étant invincible, rien n'était accompli[1]. Et la France se remit au travail. II Ce fut la nature d'abord, cette nature et ce sol de la France qui commencèrent l'ouvre de la réparation : Ainsi demeurera le tonneau inexpuisible. Il a source vive et veine perpétuelle[2]. Tous ceux qui ont vécu ces heures se souviennent de la surprise joyeuse qui se répandit partout quand, après ces terribles moments et les cieux implacables de l'hiver 1870-1871, le soleil soudain perça la nue et qu'une atmosphère bienfaisante baigna plus chaudement la terre. Ce ne fut pas une simple impression, une illusion, le reflet sur le corps de la joie intime née de la fin du cataclysme et de l'espérance renaissante. Le fait est lit : la France sentit comme une caresse, une indulgence des choses ; depuis longtemps elle n'avait vu et de longtemps elle ne devait revoir des années aussi belles. En 1870[3], la température moyenne avait été de 9°57 ; elle fut seulement de 9°31 pendant l'année 1871. Les mois de décembre et de janvier, les mois des combats et des désastres, où les mobiles eurent tant à souffrir, furent d'une rigueur exceptionnelle[4]. Or, en 1872, le vent tourne ; la température moyenne s'élève à 10°97 et, pendant plusieurs années, se fixe à ces moyennes favorables : 10°12 en 1873, 10°30 en 1874, 10°17 en 1875, 10°57 en 1876, 10°43 en 1877. Au printemps, le soleil rit travers les ondées bienfaisantes : en 1870, la moyenne de l'eau tombée à Paris avait été de 413 millimètres ; en 1871, de 521 millimètres ; elle est de 686 millimètres en 1872, de 598 en 1873, de 447 en 1874, de 497 en 1875, et elle monte encore à 654, à 638 en 1877 et en 1878. Les étés sont chauds et secs ; la moyenne du mois de juillet dépasse 19° en 1872, en 1874, en 1876, et les récoltes se font par une claire canicule. Les années 1872 et 1874 surtout donnèrent cette impression de reviviscence. La nourriture abonde. Les granges et les celliers suffisent à peine aux récoltes. Les années 1872 et 1874 atteignent, pour le rendement en froment, des chiffres qui n'avaient jamais été obtenus, même quand la France comptait deux fécondes provinces de plus ; et ces chiffres n'ont pas été, depuis lors, dépassés : près de 121 millions d'hectolitres de blé, avec un rendement moyen de 17 hectol. 33 à l'hectare, en 1872 ; au prix moyen de 22 fr. 90 l'hectolitre, c'est une somme de trois milliards pour cette seule récolte. L'année 1873 est médiocre et ne produit que 81.900.000 hectolitres, avec un rendement moyen de 12 hectol. 04 à l'hectare. Les blés d'Amérique comblent, pour la première fois, le déficit et empêchent un surenchérissement excessif du pain. Mais, en 1874, la récolte du froment atteint 133.130.000 hectolitres, avec un rendement de 19 hectol. 64 à l'hectare ; c'est, au prix moyen de 24 fr. 31 l'hectolitre, une somme de trois milliards deux cent cinquante millions de francs en une seule année. On a dit avec raison que le bénéfice brut de ces deux superbes récoltes (1872-1874) suffit pour couvrir le montant de l'indemnité de guerre. Les autres sources de richesse sont aussi abondantes. La puissante nourrice offre son lait à la fois par toutes ses mamelles. La récolte des pommes de terre, atteint, dans cette période triennale, des totaux qu'elle ne dépassera plus : 120 millions et demi d'hectolitres en 1873, 148 millions d'hectolitres en 1874 et plus de 124 millions d'hectolitres en 1875, avec un rendement de 102, 126 et io3 hectolitres à l'hectare, alors que la moyenne est de 90 environ. La vigne française, déjà frappée par le phylloxera, résiste cependant : on peut croire qu'elle se sauvera d'elle-même. Ces années furent, comme on le répéta Le rut longtemps dans les vignobles, le chant du cygne. 54.920.181 hectolitres en 1872 : 36 millions seulement, il est vrai, en 1873 : mais en 1874, près de 70 millions d'hectolitres, chiffre égal à celui de 1869, et, en 1875, plus de 78 millions d'hectolitres forment l'apogée de la courbe du vignoble français. La qualité soutient la quantité ; grands crus ou ginguelets, jamais le vin ne fut meilleur : il releva l'âme de la nation. De rares amateurs dégustent encore, aujourd'hui, une bouteille de Château-Lafite 1875 pour apprendre ce que furent les vieux vins français. Cette récolte qui se vendit, l'année suivante, au prix moyen de 25 francs l'hectolitre, produisit, une somme de près de deux milliards de francs. La culture de la betterave, cette vigne du Nord, Le sucre donne des résultats analogues. De 1867 à 1875, malgré les deux années de crise si grave pour l'industrie, la production en sucre raffiné est juste doublée — 198 millions de kilogrammes raffiné, campagne 1867-1868 ; 406 millions de kilogrammes, campagne 1875-1876 —. Les riches régions du Nord, encore sans rivales au dehors, assurent de ce chef à l'exportation française un de ses bénéfices les plus clairs. Les autres Aux champs, toutes les variétés de récoltes fourragères, industrielles, dont le dénombrement serait homérique ; aux herbages, aux pâturages, aux basses-cours, aux landes même, le bétail, les troupeaux, les moutons, les chevaux, la volaille, les animaux domestiques ; aux plaines et aux forêts, le gibier (jamais il ne se fit de plus beaux coups de fusil !) ; aux jardins, les légumes, les fruits, les fleurs, dont la vente et l'exportation prennent, dès lors, une importance européenne ; aux vergers, les cidres ; aux houblonnières, les bières, et comme un résultat dernier, extrait de l'excédent de cette richesse arrachée à la chaleur solaire, la production du calorique végétal suprême, l'alcool, s'élevant de Ir.34o.000 hectolitres en 1869 à 1.600.000 hectolitres (alcool pur) en 1870-1875 ; comment se faire une idée des ressources et du secours que la terre de France fournit alors à l'homme qui ne désespéra pas d'elle ? La richesse du sol s'accrut par les amendements, par les engrais, par le choix des semences améliorées par les nouvelles méthodes ; on se prépara aux procédés d'une culture plus intensive. La confiance qui présida à cette évolution fut telle, qu'on crut, un moment, que la terre suffirait pour guérir les blessures. Les baux furent renouvelés à des conditions si élevées que les gens avisés commencèrent à se demander s'il n'y avait pas un engouement du paysan pour la terre, à laquelle il tient d'une attache si âpre et si exclusive. L'industrie proprement dite n'est pas, en France comme dans d'autres pays, le thermomètre de la richesse publique. Le travail humain y est dispersé entre mille métiers divers. Comment évaluer le profit du charron, du forgeron, celui du sellier, du bourrelier, celui de l'agriculteur ou du jardinier, du carrier, du maçon, du scieur de long, du sabotier, du cordonnier, du tailleur, du petit bonnetier qui, tous répandus dans la campagne et dans les bourgs, font concurrence à la grande production et enrichissent, par une série d'efforts limités mais continus, une nation plutôt industrieuse qu'industrielle[5] ? Les statistiques constatent que la grande industrie tout au moins, eut sa part dans la prospérité générale. La guerre est, en elle-même, une cause d'activité et de production. On a nourri, vêtu, transporté, armé, dans des conditions exceptionnellement rapides et onéreuses, des centaines de mille hommes ; on a nourri, hébergé les armées ennemies ; les indemnités et les réquisitions ont vidé les magasins et les caisses : sur toute la face du pays. le travail a été suspendu pendant de longs mois ; il faut regagner les retards, relever les ruines, combler les vides. Des besoins nouveaux réclament de toutes parts : un pays à remettre à neuf, cités et maisons à rebâtir, forts à construire, arsenaux à munir ; canons, fusils et armes blanches à fondre ou à forger sur de nouveaux modèles. Ce sont les chemins de fer cédés à remplacer, les lignes insuffisantes à doubler, les canaux à creuser ou à raccorder ; les ponts à rétablir, les chemins abimés par les charrois à réparer. La ruine universelle cause un travail universel. Les échanges entre les nations sont, dès lors, tellement solidaires, que l'étranger avait souffert de l'absence de la France. Il attend avec impatience qu'elle reprenne sa place dans la famille commerciale. Les commandes affluent. Une activité qui ne doit pas s'arrêter de longtemps se manifeste aussitôt après la conclusion de la paix et la fin de la Commune. Malgré la perte de deux provinces qui comptaient parmi les plus laborieuses et les plus industrieuses, la France, sans affaiblissement notoire de ses facultés et de son ingéniosité technique, est prête à répondre aux demandes. La production des mines de combustibles minéraux, qui, en 1860, avait fourni une valeur de 96 millions de francs, et eu 1869 (Alsace et Lorraine comprises) une valeur de 156 millions, rend, en 1871, 164 millions ; en 1872, 212 millions ; en 1873, 290 millions ; en 1874, 279 millions ; en 1875, 270 millions. La production de la fonte, qui avait atteint, en 1869, une valeur de 126 millions, est, en 1872, de 147 millions ; en 1873, de 190 millions ; en 1874, de 168 millions ; en 1875, de 156 millions. Celle des fers et aciers, qui avait été, en 1869, de 245 millions, est, en 1872, de 314 millions ; en 1873, de 362 millions ; en 1874, de 320 millions ; en 1875, de 311 millions. L'outillage de la grande industrie représentait, en 1870, à la veille de la guerre, une puissance de 136.000 chevaux-vapeur ; elle passe, en 1872, à 336.000 ; en 1873, à 362.000 ; en 1874, à 382.000 ; en 1875, à 401.000 ; en 1876, à 427.000, ayant gagné près de 100.000 chevaux-vapeur en cette courte période. Cet accroissement, qui indique une activité persévérante et la confiance dans l'avenir, ne devait pas s'arrêter, puisque, à la fin du siècle, en 1900, on compte en France un total de 1.791.354 chevaux-vapeur, avec un gain de 1.475.000 en trente ans. Les chemins de fer réparent les dégâts et les pertes. En 1870, la France compte 18.000 kilomètres de voies ferrées ; dès 1875, l'augmentation est de 3.000 kilomètres, avec 21.770 kilomètres, et, en 1878, de 6.000, avec 24.456 kilomètres[6], avant même qu'on ait abordé le plan général de construction qui devait être proposé bientôt par M. de Freycinet et dont l'exécution produira 38.000 kilomètres, c'est-b-dire que le réseau français aura doublé en moins de trente ans[7]. Les chemins publics nationaux, départementaux et vicinaux sont remis en état ou multipliés de telle sorte que cet ornement singulier de la campagne française ne parait en rien touché par les événements, par la diminution des ressources ou par l'augmentation des impôts. Jamais les routes de France n'ont été plus nombreuses et plus belles. Les moindres villages poursuivent diligemment l'entreprise des chemins vicinaux, si heureusement commencée sous le second empire[8]. La navigation maritime ne connaît pas encore les heures de crise ; si le chiffre du tonnage des voiliers diminue comme partout, celui des bateaux à vapeur français passe de 151.000 tonneaux en 1870 à 185.000 en 1873, et à 277.000 tonneaux en 1880. Le mouvement des ports passe de 6.034.000 tonneaux en 1869 à 7.559.000 en 1873, à 8.943.000 en 1875 et à 13.322.000 en 1880. Ces chiffres indiquent, dans les ports comme à l'intérieur, une ferme confiance dans l'avenir. La production industrielle des tissus suit la progression suivante : Tissus de coton manufacturés ; en 1869, 124.331.000 kilogrammes ; en 1874, 133.527.000 kilogrammes ; en 1876, 157.859.000 kilogrammes. Laines en masse : importation pour la consommation, 108 millions de kilos en 1869 ; 102 millions en 1871 ; 107 millions en 1872 ; 120 millions en 1873 ; 117 millions en 1874 ; 127 millions en 1875 ; 151 millions en 1880. L'exportation des tissus de laine (une des branches les plus intéressantes de l'industrie française) passe de 262 millions et, 1869 à 317 millions en 1876. L'exportation des soieries progresse de 410 millions en 1869 à 478 en 1873 ; à 415 en 1874 ; elle fléchit à 376 en 1875 et à 296 millions en 1876. C'est la période si grave de la maladie qui atteint le ver à soie, de même que le phylloxera frappe la vigne. On sait avec quelle vaillance le pays, après tant de maux, supporte ce double désastre. La production n'est pas tout : les relations, les échanges, la consommation, les salaires, l'épargne, le paiement des charges publiques permettent d-apprécier sous toutes ses faces le relèvement matériel qui suivit si rapidement des événements si graves. En 1869, l'office des postes délivre 357 millions de lettres ; en 1872, malgré le renchérissement de 25 % qui frappe le timbre, elle en transporte 342 millions : en 1874, 350 millions, plus 16 millions de cartes postales ; en 1875, 367 millions, plus 20 millions de cartes postales ; en 1876, 381 millions, plus 27 millions de cartes postales ; en 1880, 530 millions, plus 30 millions de cartes postales. Les recettes des télégraphes sont de 11 millions en 1869, de 16 millions en 1873, de près de 20 millions en 1876 et de 25 millions en 1880. Le commerce spécial, importations et exportations réunies, était à 6.228 millions en 1869 ; on le retrouve à 7.520 millions à la fin de l'exercice 1876, en augmentation de 1.292 millions ; en 1880, il est à 8.601 millions. Les objets fabriqués à l'exportation suivent la progression suivante : en 1869, 1.639 millions ; en 1871, 1.544 ; en 1872, 1.905 ; en 1873, 1.984 ; en 1874, 1.909 ; en 1875, 1.950 ; en 1880, 1.839[9]. Voyons maintenant quelle répercussion cet accroissement du travail a sur le bien-être de la nation. Les salaires dans les départements français (Paris excepté) ont bénéficié d'une plus-value remarquable de 1853 à 1871, passant de 1 fr. 89 2 fr. 65 comme moyenne ordinaire et de 2 fr. 36 à 3 fr. 36 maximum, de 1 fr. 53 à 2 fr. 19 minimum. Le mouvement s'accentue même après la guerre, et les chiffres sont les suivants : en 1875 moyenne ordinaire, 2 fr. 86 ; salaire maximum, 3 fr. 64 ; salaire minimum 2 fr. 34. A Paris seulement, les salaires restent stationnaires autour du prix moyen de 4 fr. 98[10]. Consommation. La consommation du froment, qui était de hectol. 76 par tête d'habitant en 1831, avait monté à 3 hectol. 32 dès 1868 ; elle se maintient après la guerre avec un léger fléchissement pourtant au début ; la consommation du sucre, malgré les charges nouvelles, passe de 7 kilog. 3 par tête d'habitant, en 1869, à 8 kilog. 6 en 1880. La consommation du vin est très variable suivant la récolte ; elle était de 1 hectol. 75 en 1869 ; elle atteint 1 hectol. 84 en 1874 et jusqu'à 2 hectol. o4, chiffre culminant, en 1875. La consommation de la viande qui était de 17 kilog. par habitant en 1812, de 26 kilog. en 1862 et de 25 kilog. et demi en 1872, passe à 33 kilog. en 1882[11]. La consommation de l'alcool (et il faut y comprendre l'alcool employé pour le vinage des vins et pour l'industrie) est de 2 lit. 63 en 1869 ; elle regagne ce chiffre (malgré les droits nouveaux, il faut toujours faire cette remarque) dès 1873, monte à 2 lit. 82 en 1875, pour atteindre 3 lit. 64 en 1880. On voit avec quelle rapidité partout l'équilibre est rétabli. Cette vigueur de la nation apparaît plus nettement encore dans le mouvement de la fortune publique, dans l'exercice de la faculté française par excellence, l'épargne, dans la facilité avec laquelle furent supportées les nouvelles charges fiscales. Le mouvement de l'argent est la mesure des efforts particuliers et des efforts publics ; or, les bilans de la Banque de France sont les suivants :
Le cours de la rente 5 %, qui sert de témoin pour celui de toutes les autres valeurs dont il est à cette époque en quelque sorte le régulateur, inscrit les chiffres suivants :
Les caisses La renie a donc monté au plus haut de vingt-quatre points et au plus bas de trente-deux points en dix années. L'ensemble du marché financier marque un progrès analogue. Comme l'ont démontré les emprunts énormes qui recourent à lui et qui auraient pu l'accabler, le crédit de la France est intact. Malgré la facilité des placements, en raison des émissions fréquentes qui se produisent par petites coupures, les dépôts à la caisse d'épargne, un moment diminués par les nécessités de la guerre et par l'appel des grands emprunts, reprennent bientôt leur marche ascensionnelle. A la fin de l'année 1869, il était dû 711 millions aux déposants par les caisses d'épargne ordinaires ; à la fin de 1873, seulement 545 millions, mais, dès 1877, le chiffre de 862 millions est atteint pour s'élever, en 188o, à 1.280 millions. En 1869, le nombre des livrets est de 2.130.768 ; en 1880, il atteignait le chiffre de 3.841.104. La fortune personnelle des caisses d'épargne s'élève de 17 millions en 1869 à 30 millions en 1880. Les fonds de retraites des sociétés de secours mutuels, qui sont de 19 millions en 1871, passent à 32 millions en 1878 et à 38 millions en 1880. Les cotisations des membres participants s'élèvent de 5 millions 938 mille francs en 1871 à 7 millions 940 mille francs en 1878 et à 8 millions 728 mille francs en 1880. La fortune de ces sociétés est de 36.498.000 francs en 1871 ; elle est de 52.222.000 francs en 1878 et de 56.443.326 francs en 1880. Les effectifs des membres participants sont les suivants : en 1871 : 489.006 ; en 1880 : 640.613 plus 20.769 enfants. Les impôts sont perçus avec la plus grande aisance, alors que les budgets se sont accrus, en moins de dix ans, dans des proportions écrasantes :
Les annuités successorales, qui forment une évaluation très approximative de la fortune publique, se développent selon la progression suivante : en 1869, 4.567 millions ; en 1871, 5.729[13] ; en 1872, 5.078 ; en 1875, 5.320, et en 1880, 6.382. C'est sur ce point une augmentation manifeste de 1.300.000 en cinq ans, au profit d'une nation amputée de deux de ses plus belles provinces et accablée par les charges multiples et les ruines sans nombre que la crise de 1870-1871 avait accumulées ou précipitées. De ces données si variées, il résulte que, du moins au point de vue matériel, le pays, son sol, sa population, son labeur, avaient tenu bon et vaillamment supporté les conséquences de la défaite. III Ce peuple, qui se relève, sent une force nouvelle circuler dans ses veines. Tandis que sur le sol qu'il habite la prospérité renaît, le corps de la nation reprend couleur et vie. Les 36 millions d'êtres humains qui composent alors le peuple de France[14] sont disséminés sur un territoire vaste[15]. Les populations des régions différentes se connaissent peu. Elles n'ont guère de contact entre elles que dans les casernes pour le service militaire et, quelquefois, par le travail en commun dans les ateliers. La masse reste ensevelie au fond des bourgs, des villages, des hameaux. La désuétude des déplacements anciens et des tours de France — non remplacés encore par les voyages d'excursions et les trains de plaisir — cantonne la vie locale plus qu'elle ne l'a jamais été. Le Français de 1870 est tardigrade et casanier. Taine écrit, en 1879, dans sa brochure sur le Suffrage universel : Un villageois français vit dans un cercle de deux lieues de rayon ; son horizon ne s'étend pas au delà. La diversité mal fondue des provinces, avec la différence des traditions, des mœurs, des patois, des provinces, maintient les séparations. Le Midi, tout latin, fils de la vigne, abondant, éloquent, passionné de la politique et de la bascule des clientèles, étonne le Nord, plus lent, plus calme, phis judicieux, qui se plaint de l'exigence et de l'intempérance méridionales. Entre l'Est et l'Ouest, les divergences sont aussi marquées : l'Est, où un mélange appréciable de sang germanique et une habitude de vie plus plantureuse, donnent du ton et de l'assiette à la race, vit largement et indépendamment dans ses maisons clairsemées où le même toit, haut et large, abrite toute la maisonnée : c'est le pays de l'égalité, de la tranquille modération : tandis que l'Ouest, plus ardent, plus prompt, plus imaginatif, s'abandonnant à la fougue, à la négligence et à la rêverie celtiques, s'attarde dans la verdure des herbages et reste hiérarchisé sous le poids du passé et de la tradition. Il faudrait distinguer les traits selon les provinces, selon les familles, selon les professions, selon que le Français est peuple ou bourgeois, paysan ou citadin, ouvrier d'État, ouvrier d'atelier, lettré ou illettré, boutiquier ou petit patron, — pour préciser la multiplicité des répercussions qu'eut le choc de la guerre sur les molécules dispersées, dont l'ensemble compose la nation. Rappelons cependant que cette masse obscure, inconnue a elle-même, a peine connue de ceux qui la font mouvoir, c'est elle qui produit, c'est elle qui arrache au sol la richesse d'oh vient la délivrance. Seule elle vit familièrement avec cette nature qui. dans le désastre, demeure la ressource suprême ; par sa peine constante et son épargne continuelle, par son labeur anonyme et soutenu, elle est et se sent éminemment France. Or, elle commence il se demander si on l'a bien conduite et si l'on a employé sagement le fonds et l'apport que son travail fournit, sans relâche, à la masse commune. Peu à peu, les blessés, les prisonniers, les retardataires sont rentrés au village. On a compté les morts. Bien des familles sont en deuil ; les mères et les veuves font, parmi les foules, une tache noire : souvenir que le temps seul effacera. Et puis, il faut payer les impôts qui tombent comme grêle, s'en prennent à tous les actes de la vie et renouvellent la commémoration de la défaite, chaque année, à l'heure où le percepteur sonne. Ce peuple est résigné, certes ; il est passif ; il se soumet à la direction de ces gens graves et sors d'eux-mêmes, — légistes, notaires, médecins, fonctionnaires, bourgeois, en un mot, — qui, de toutes parts, entourent et encadrent son existence. Il se résignera encore, puisqu'il le faut. Cependant on dirait que cette fois il y a comme une hésitation. La physionomie, des choses est autre. Des blessures si cruelles, l'amputation de deux provinces, la terrible saignée de la Commune, ont modifié les dispositions réciproques[16]. A l'intérieur du corps social, des déplacements d'atomes se sont produits. Une poussée se fait d'en bas. Surprise, pour la partie supérieure de la nation, celle qui avait pris l'habitude du commandement : la bourgeoisie. Le règne de Louis-Philippe n'était pas si loin que la bourgeoisie eût oublié ces heures uniques. 1848 l'avait prise au dépourvu. L'avènement à la politique des masses populaires lui parut un inexplicable cataclysme. Sauvée, un peu malgré elle, en 1851, elle avait boudé Napoléon III, tout en acceptant les places et, les décorations de la main de l'empereur ; mal ralliée à l'empire, elle était à la fois avec M. Rouher et avec M. Thiers. Au moment où le ministère du 19 janvier ouvrait à ses ambitions et à son libéralisme une ère nouvelle, l'empire s'était effondré[17]. Mais voici Thiers. Les beaux jours sont revenus. La bourgeoisie française est honnête, probe, appliquée : cependant, née loris le prétoire, elle se sent toujours de la robe. Dans son travail, dans ses mœurs, Clans ses rapports avec l'ensemble de la nation, elle apporte la ponctualité et l'exigence juridiques. A cette époque, c'est-à-dire sers les années qui précédèrent et suivirent la guerre, les caractéristiques de la bourgeoisie ne se déterminent ni par la mils-sauce, ni par le bénéfice de certains privilèges sociaux, ni même par l'exercice de certaines professions, mais bien par l'obtention d'un diplôme, — le baccalauréat. Entre 1830 et 1860, ce mandarinat s'était constitué[18]. L'homme qui fait ses études est un personnage. Entre lui et les autres, la démarcation est aussi profonde que celle qui pouvait exister, par exemple, Rome, entre les chevaliers et la plèbe. Elle s'affirme dans l'aspect extérieur, costume, coiffure, coupe de la barbe : le chapeau haut de forme, l'habit noir ou la redingote, les favoris distinguent l'homme de loi ou le fonctionnaire et tranchent, au premier coup d'œil, avec la blouse bleue, le bourgeron, la casquette, la moustache de l'homme qui a fait son temps ou la figure glabre du paysan. Le Français qui n'est pas vêtu bourgeoisement sait d'avance qu'il est des endroits réservés où il ne peut habiter, ni même entrer. Le Recueil des Cinq Codes et le Manuel du Baccalauréat, tels sont les livres de la bourgeoisie : elle se conserve entre leurs pages, comme ou dit que les Anglais vivent entre la Bible et Shakespeare. Elle garde, de ses origines, un goût marqué pour les métiers de plume et les gloires de papier, une admiration sans borne pour la parole écrite et parlée, un respect pour les leçons du collège, une faveur pour les prix de concours et les notoriétés de l'école, un goût classique pour les opinions contrôlées, les gestes mesurés, les couleurs atténuées, les démonstrations proportionnées. A égale distance de l'intellectualité parisienne et de la matérialité des champs, la bourgeoisie, répandue à Paris et dans la province, fait le tampon : elle sépare et elle unit ; par elle, communiquent et se pénètrent les autres parties de la nation. A l'égard de Paris, la bourgeoisie est à la fois en méfiance et en admiration. A l'égard du peuple, elle est dans une ignorance et dans un mépris incroyables. Ce fils d'ouvrier et de paysan ne veut plus connaître la condition des ouvriers et des paysans. Ce contremaître est dur pour ses compagnons d'hier. Le chapeau n'a rien de commun avec le bonnet d'où il sort. La vanité propre à la race et à la classe s'exagèrent au moment précis où celle-ci quitte le sol et l'atelier pour s'enfermer dans une boutique ou dans une étude. Le nom de classe moyenne, dont la bourgeoisie s'honore, lui est, à ses propres veux, un certificat de bonnes mœurs, de prudence et de mesure. La règle de sa vie, c'est la respectabilité et la considération : s'il subsiste un soupçon de pharisaïsme dans cette nation si sincère, c'est Iii qu'il s'est réfugié. Qualités et défauts, la bourgeoisie se sent désignée pour les responsabilités d'État, pour les fonctions publiques. Et, en effet, maitresse de la parole, sauf aux époques où l'action s'impose, elle règne. Au lendemain de la guerre et de la Commune, les circonstances sont particulièrement propices à un retour des cendres de la bourgeoisie. Elle ne se sentait pas responsable des erreurs commises devant l'ennemi : elle avait fait son devoir : la plupart des officiers de mobiles sortaient de ses rangs. L'armée, rivale naturelle de la bourgeoisie, avait perdu son prestige. Paris, abîmé par un long siège et une affreuse révolution, Paris était démantelé et croulant ; les ouvriers des villes étaient refoulés ou comprimés, en tout cas dégoûtés pour longtemps, on pouvait le croire, de la politique et de ses illusions. Donc, sous le principat de M. Thiers, la bourgeoisie tendait la main, d'un geste habituel, pour saisir le timon. Or, elle rencontre certaines difficultés, certaines résistances. Sans qu'elle y ait pris garde, la réaction contre la monarchie impériale l'a dépassée. En de nombreuses circonscriptions, le suffrage a santé d'un bond pardessus l'époque philippiste et a reculé jusqu'il la Restauration. La noblesse, si oubliée depuis un siècle, est de nouveau tirée à la lumière ; des survivants d'un autre fige, comtes, marquis, ducs, ont reparu ; ces aristocrates qui s'étaient bien battus, font figure de parlementaires. Ils parlent le langage de la liberté. Le clergé avait, plus encore, profité des circonstances. Non seulement dans les départements de l'Ouest, mais un peu partout, un émoi sincère avait touché les âmes, jeté les foules croyantes aux pieds du Sauveur. Les évêques des diocèses envahis, les Pie, les Mathieu, les Dupont des Loges, les Freppel, les Dupanloup, ont évoqué les illustres souvenirs de l'épiscopat des Gaules. Des orateurs, prêtres ou même soldats, portent la parole sainte soit dans les églises, soit au milieu de la société laïque : les moines se jettent dans la mêlée : les cuirassiers se font prédicateurs. Si bien que la bourgeoisie, ébranlée dans sa négation voltairienne, en est tout au moins à l'hésitation et au scrupule. D'autre part, les masses populaires disposent désormais librement du suffrage universel. Jusqu'ici, on connaissait le mot : on allait apprendre à connaître la chose. Forgée par la révolution de 1848, l'arme puissante avait été maniée par l'empire qui s'en était servi surtout pour asséner les coups formidables des plébiscites. L'opposition bourgeoise avait essayé de soulever la massue d'Hercule. Maintenant, elle la voit aux mains des paysans et des ouvriers. Le bulletin devant assurer la victoire du nombre, c'est un régime nouveau qui riait. Parmi les bourgeois, les uns, effrayés du péril, se reportaient vivement en arrière. Les autres se demandaient s'il était sage, s'il était habile, s'il était juste de rompre avec le peuple. Scission. Ballottées entre ces deux courants, les classes moyennes hésitaient comme hésitaient les hommes qui gouvernaient en leur nom. A court d'idéal et de principes, déchirée par ces luttes et ces jalousies intestines, que le défaut national, la vanité, allume et excite sans cesse, rapetissée par cette nullité de la vie locale[19] à laquelle elle n'a pu s'arracher, la bourgeoisie subit, presque sens résistance, l'attraction, la fascination qu'exerce sur elle la masse compacte et noire qui monte, l'envahit, la désagrège et qu'elle ose à peine nommer : le peuple. Le peuple, c'est lui qu'il faut considérer maintenant. Ah ! ce n'est pas un peuple de demi-dieux !... Plutôt, selon le mot de la polémique courante, un peuple de ruraux ! Dénombrons : Il y a, en France, en 1871, 10 millions d'électeurs. Sur ce total, 5.383.000 s'adonnent à la vie agricole ; 3.102.000 à l'industrie, 410.000 au commerce et 338.000 à diverses entreprises (voiturage, chemins de fer, banques. assurances). Il reste, pour les professions dites libérales, 356.000 électeurs, et, comme rentiers, propriétaires, etc., 410.000 environ. Sur les 5.383.000 campagnards, 3.552.000 (c'est-à-dire la grande majorité) sont propriétaires. Ils se décomposent ainsi : 2.165.000 propriétaires cultivateurs (c'est-à-dire plus du cinquième des électeurs), 693.000 journaliers propriétaires de parcelles, 463.000 fermiers, 159.000 métayers, 72.000 propriétaires exploitant eux-mêmes leurs biens. Sur les 3.552.000 propriétaires, les trois quarts, c'est-à-dire 2.711.000, sont de petits propriétaires. Il faut citer encore, comme se rattachant étroitement à cette masse rurale, dépendant d'elle ou vivant d'elle, les 1.327.000 électeurs habitant la campagne, soit ouvriers ruraux (894.000), soit fermiers ou métayers non propriétaires (276.000 et 157.000). Ajoutons les petits industriels et commerçants qui vivent au village, les maraîchers, bûcherons, jardiniers, etc. Ajoutons les arpenteurs, vétérinaires, etc. ; ajoutons les employés et domestiques ruraux : c'est un nouveau total de 514.000 électeurs qui vit près de la masse agricole et se prête aux mouvements intimes qui l'agitent. 3.102.000 électeurs se consacrent à l'industrie, parmi lesquels 1.393.000 sont entrepreneurs ou patrons, fout travailler ou travaillent à leur compte, 65.000 employés à titres divers, 54.000 domestiques. 1.590.000 constituent la filasse ouvrière proprement dite, salariés à la journée ou à la tâche. Le commerce est représenté par les chiffres suivants : 410.000 électeurs, dont 322.000 patrons, 73.000 commis et 15.000 domestiques. Les professions libérales, même si ou y comprend les fonctionnaires et les rentiers, font un total de 660.000 électeurs — car il faut défalquer du chiffre les domestiques, 52.000, et les employés, 45.000. Ce sont ces 660.000 qui ont commandé jusqu'ici. Resteront-ils les maitres L'auteur du travail auquel nous empruntons ces chiffres. et qui fut publié en 1874, au moment où la question du suffrage universel était à l'étude, conclut en ces termes : Le centre de gravité du système économique de la France est placé très avant dans les couches profondes du corps social. C'est, en politique, l'équivalent de ce qui est, en physique, la condition nécessaire de la stabilité d'équilibre[20]. Donc c'est vers les parties inférieures que la recherche de l'équilibre et de la stabilité doit se porter. Ces masses populaires sont-elles organisées ? A peine dans les villes ; nullement dans les campagnes. Dans les villes, un rudiment d'organisation avait été tenté depuis 1818 et s'était perpétué vaguement sous l'empire, jusqu'à la Commune. Les écoles révolutionnaires avaient proposé aux masses flottantes les cadres rivaux de leurs systèmes chimériques. Le saint-simonisme, l'internationalisme, le blanquisme et le fouriérisme mourant, le marxisme naissant, tout s'était effondré en mai 1871. Ces tentatives avortées ont été jugées en ces termes par une amie sincère de la démocratie, George Sand : ... La Commune fonctionne de par la force brut a le, sans invoquer d'autre droit que celui du mépris et de la haine pour tout ce qui n'est pas elle. Elle proclame la science sociale positive dont elle se fit dépositaire unique, mais dont elle ne laisse pas échapper un mot dans ses délibérations et dans ses décrets... Quelle République est-ce fit ? Je n'y vois rien de vital, rien de rationnel, rien de constitué, rien de constituable. C'est une orgie de prétendus novateurs qui n'ont pas une idée, pas un principe, pas la moindre organisation sérieuse, pas la moindre solidarité avec la nation, pas la moindre ouverture vers l'avenir...[21] Cette faillite des premières écoles laisse donc le peuple des villes dans la nuit et le dégoût. Il sent bien que ce n'est pas lui qui a fait tout le mal : son nombre même et sa force ont horreur de pareilles horreurs. On a usurpé sa volonté, abusé de sa confiance. Des ambitieux ont grimpé sur ses épaules pour paraître grands. Il a été trompé : il le sera si souvent encore ! Quant au peuple des campagnes, dispersé et moléculaire, sans consistance et sans expérience, il est surtout effrayé par les menaces portées contre la propriété du sol — sa seule sauvegarde à lui. Il y aurait bien une organisation plus naturelle, suite des rapports qui devraient exister normalement entre le patron et l'ouvrier, entre le capital et le travail. Tous les travailleurs sont solidaires puisqu'ils sont liés à une même tâche. Mais le malentendu, né de l'improvisation de la grande industrie et de l'introduction brusque de la machine, s'est accru sous l'empire, qui avait intérêt à la lutte des classes, et s'est exaspéré sous la Commune. L'ignorance où la bourgeoisie se tient à l'égard du peuple est trop souvent dédain, profit excessif, morgue insupportable : par contre, l'envie, la rancune des pauvres, ne veut plus rien entendre d'une classe qu'elle considère désormais comme composée d'ennemis et d'exploiteurs. L'influence que le chef d'industrie, le chef d'atelier, le patron, le propriétaire, le fermier, pourrait, par ses conseils, son exemple, une amitié secourable, exercer sur ceux dont la main exécute ce que sa volonté a conçu, cette influence est annulée. On déteste un conseil sous lequel la méfiance croit deviner un calcul. La population rurale est donc abandonnée à son ignorance ou à son incohérente conception de la vie. Le morcellement héréditaire émiette les patrimoines, rompt le foyer. L'avarice légiste dévore les petites épargnes. L'absentéisme dépense à la ville les revenus de la culture et du travail. Ces hommes ne se connaissent plus que par les termes de fermages et de loyers, par les ruses réciproques pour esquiver les engagements ou aggraver le fardeau[22]. Quelques exceptions dans l'Ouest, où le seigneur continue à vivre au milieu des populations villageoises et reçoit d'elles, comme un dernier hommage, les mandats électifs, et dans l'Est, où commencent à s'essayer des systèmes de coopération et de prévoyance patronales et ouvrières. En somme, les populations provinciales sans guide, désemparées, excitées par les sous rances de la vie moderne qui devient plus exigeante, sans autre appui et sans autre recours que le travail, le contact avec la nature, le vague flux de pensée qui, par intervalle, de Paris pousse jusqu'à elles. Et cependant tous les partis et même ceux qui paraissent le plus éloignés de la conception démocratique, se tournent vers ces foules urbaines ou rurales, parce qu'ils savent que là est la puissance, le développement, l'avenir. Alors que les institutions anciennes se sont écroulées, alors que l'autorité des classes qui s'appelaient elles-mêmes dirigeantes est écartée, qui donc dirigera ce peuple-roi ? Considérez attentivement cette partie de la démocratie laborieuse, ces hommes à peine sortis du rang des ouvriers et des paysans : petits patrons, commerçants, boutiquiers, employés, herbagers, vignerons, maquignons, vétérinaires, instituteurs, cabaretiers. Ils étaient peuple hier, ils le sont encore par les mœurs, par leurs occupations ordinaires, par l'aspect ; ils ont le teint rude et les mains calleuses. Pourtant l'œil s'ouvre et le front s'élargit ; il y a une fierté sur ces traits à peine dégrossis. En passe de gagner la fortune, ils se plantent en face de la bourgeoisie arrivée et lui disent son fait avant de s'introduire dans ses rangs. Ceux-ci sont restés fidèles à la tradition voltairienne. Ils gardent la vieille méfiance nationale contre le gouvernement des curés. Il y a, dans leurs sentiments, de l'aigreur, de l'intolérance, un goût prononcé, — et qui tient peut-être aux origines serves, — pour le complot sournois, les machinations ourdies de longue main, les influences occultes. Mais il y a aussi de l'entrain, de l'allant, de l'élan. Cette néo-bourgeoisie est moins glaciale que son aînée ; elle a plus d'ardeur, plus d'énergie : elle a la volonté d'être, de savoir ; elle sait vouloir. Elle entre dans les comités électoraux qui s'organisent ; elle s'enrôle dans la franc-maçonnerie[23] qui pousse son recrutement prudent des villes aux bourgs et des bourgs aux campagnes elle suit avec une attention passionnée les marches et les contre-marches des campagnes électorales, si difficiles en province, où tout le monde se ronflait, se surveille, se pèse. Vivant près du peuple, elle a sur lui une influence immédiate : elle distribue les bulletins et mène les fidèles à l'urne. Elle fait en somme, dans la démocratie, office de levain. A ne voir que l'ensemble du corps électoral, ses occupations ordinaires, la conception qu'il a de la vie, sa dispersion sur le vaste sol qu'il occupe, on pourrait lui appliquer ces paroles d'Aristote, — car il n'y a rien de nouveau sous le soleil — : La classe la plus propre au système démocratique est celle des laboureurs ; aussi, la démocratie s'établit sans peine partout où la majorité vit de l'agriculture et de l'élève des troupeaux. Comme elle n'est pas fort riche, elle travaille sans cesse et ne peut s'assembler que rarement, et comme elle ne possède pas le nécessaire, elle s'applique aux travaux qui la nourrissent et n'envie pas d'autres biens que ceux-là. Travailler lui vaut mieux encore que gouverner et commander là où l'exercice du pouvoir ne procure pas de grands profits ; car les hommes, en général, préfèrent l'argent aux honneurs[24]. Mais si l'on envisage cette fraction particulière du peuple qui, se détachant de lui, se prépare à le diriger, c'est aux modernes qu'il faut demander sa définition : car elle est essentiellement du temps et du moment. N'a-t-on pas vu apparaître sur
toute la surface du pays, — et je tiens
infiniment à mettre en relief cette génération nouvelle de la démocratie,
— un nouveau personnel politique électoral, un
nouveau personnel du suffrage universel... Oui,
je pressens, je sens, j'annonce la venue dans la politique d'une couche
sociale nouvelle... On a senti que la
démocratie actuelle était sortie du sentimentalisme un peu vague qui avait
été le caractère dominant de nos devanciers... On a affaire maintenant à ce personnel nouveau, gens pratiques,
expérimentés, aptes aux affaires, prudents, sages en politique : toutes les
fois qu'ils émettront un vœu, prendront une décision, ces vœux ou ces
décisions auront un caractère particulier, un accent spécial, qui doivent
influer sur la direction générale des affaires de la France... Gambetta parlait ainsi à Grenoble le 26 septembre 1872. Le chef flattait de la Noix ceux qui se levaient à son appel : le jeune tribun, avec son sens politique affiné, avait deviné la fortune de cette partie de la nation qui se plaît à réclamer pour elle ce grand nom, nouveau en France : Démocratie. Est-ce donc l'avènement de ce régime prédit par Montalembert et par Tocqueville, combattu par Guizot, préparé par Louis Blanc ? L'élargissement de la sphère d'influence politique est tel, en effet, qu'elle englobe désormais tout l'ordre social. Les transformations qui s'accomplissent, non pas en France seulement, mais dans tous les pays civilisés, la richesse croissante, la fierté et l'indépendance qu'elle assure, le sentiment simple et net de l'égalité, la diffusion des lumières, la facilité des communications, toutes ces causes agissent dans le même sens : des masses de plus en plus nombreuses sont appelées au maniement conscient des affaires publiques. C'est donc, — dans les deux sens du mot, politique et social, — le progrès démocratique. Prenons garde cependant. Il s'agit d'une tendance, non de réalisations complètes ou lame prochaines. Ce travail se fait, comme la vie elle-même, au jour le jour. Les limites de l'évolution sociale et de l'évolution politique restent indéterminées. Les oncles se pénètrent. Le langage courant les confond. Les plus précis et les plus éclairés s'y perdent : Avènement de la démocratie, souveraineté du peuple, loi du nombre, volonté générale, suffrage universel, toutes ces expressions couvrent un état de choses qui reste inorganique et où il traire beaucoup de passé, s'il y germe beaucoup d'avenir. On en est encore, même en 1879, aux affirmations un peu floues, si j'ose dire, inscrites en 1848 dans la proclamation du gouvernement provisoire, qui introduisit le suffrage universel : Tout Français en âge viril est citoyen politique. — Tout électeur est souverain. — Le droit est égal et absolu pour tous. — Le règne du peuple s'appelle République. Prévost-Paradol, qui ne se piquait pas d'enthousiasme, avait donné, dans la France Nouvelle, en 1868, aux mêmes aspirations une même expression optimiste : La puissance publique, venant de tous, pouvant être incessamment reprise par tous, obtenue de tous par quelques-tins au moyen de la seule persuasion et concentrée ainsi pour un temps dans la main du plus capable et du meilleur... La démocratie repose sur cette idée que le plus grand nombre des citoyens fait un usage raisonnable de son vote et voit toujours avec discernement ce qui est conforme à la justice et à l'intérêt commun. Conceptions simples. Elles descendent, traditionnellement, de la vieille polémique du Contre-un engagée dès le XVIe siècle, reprise par les philosophes, précisée par Jean-Jacques et qui inspira les Assemblées de la Révolution française. La souveraineté du peuple : mais elle n'est réalisable que si une convention tacite la soumet elle-même à la loi des majorités. Le peuple n'est, en tant que souverain, que parce qu'il consent à n'être que la moitié plus un. Il ne s'agit donc pas d'un droit, mais bien d'un fait, une façon d'en finir, un pis aller et, comme on fa dit, le pouvoir du dernier mot[25]. La loi du nombre : elle est elle-même inapplicable s'il est question de régir une population nombreuse dispersée sur un vaste territoire. Le peuple ne peut se réunir effectivement et fréquemment pour délibérer dans ses comices. Il est donc obligé de confier ses pouvoirs à des délégués. Jean-Jacques, logique avec lui-même, s'était déclaré l'adversaire des grands États modernes : Grandeur des nations, étendue des États, première et principale source des malheurs du genre humain.... Il détestait non moins tout régime représentatif : La souveraineté ne peut être représentée, disait-il fortement[26]. Malgré les leçons du philosophe genevois, il ne peut être question d'appliquer à la démocratie française un autre système que le système représentatif. Nouvelle restriction au principe de la souveraineté. Autre fait qui entrave le droit : la centralisation. La centralisation, c'est-à-dire l'autorité traditionnelle dans un pays qui a une longue histoire, d'une capitale unique qui pense, agit, propage les idées, les mœurs, dicte les lois, les modes, en un mot gouverne, quel que soit le régime politique. Cette centralisation est un bienfait conquis par mille siècles de luttes ; il ne peut être question de la détruire[27]. Et cette puissance de fait se ramasse, si j'ose dire, en ces deux autres pouvoirs non moins actifs, non moins efficaces, non moins indestructibles : celui de l'administration, celui de l'opinion. L'administration existe depuis qu'il y a une France. Dans sa forme moderne, elle remonte, pour le moins au temps de Richelieu, de Colbert et de Louvois. C'est elle qui, du consentement unanime, préside au fonctionnement de la machine sociale. Elle en connaît tous les ressorts. Elle a le savoir-faire, le tour d'esprit et le tour de main, le prestige qui vient de la compétence et de l'autorité. Ou la raille de loin ; de près, on s'incline ; elle garde, dans ses cartons, le secret de l'État. Son froid visage ne s'émeut jamais. Elle représente, jusqu'à un certain point, cette intelligence sans la passion qui, selon la parole des anciens, est l'idéal du bon gouvernement. Du dernier des villages jusqu'au sommet de la hiérarchie sociale, elle se tient ; franc-maçonnerie, clergé laïque plus puissant et mieux averti qu'aucun antre groupement. La France a toujours subi cette domination ; ce n'est pas seulement qu'elle l'accepte, elle la préfère : c'est vers l'administration que monte sa plainte en cas de trouble, d'inquiétude ou de désordre. Ce que l'Angleterre demande à l'homme de loi, la France le demande au fonctionnaire. Dans la crise récente, l'administration — les employés aux manches de lustrine dont parlait M. Thiers — a par sa fermeté, sa stabilité, son labeur impassible et méthodique, contribué, plus que nulle autre partie du corps social, au salut du pays. On peut mettre la main sur le personnel de l'administration ; mais il ne saurait être question de se passer d'elle. Le mouvement vers la centralisation c'est toute l'histoire nationale : le contrarier, ce serait porter atteinte à l'essence de la vie publique. Un seul pouvoir plus fort : celui de l'opinion. Récemment apparu comme ces forces physiques, la vapeur, l'électricité, inconnues aux siècles antérieurs, il agit sur tout l'appareil social ; il ébranle les anciennes institutions, excite les aspirations modernes, brise les vieilles formules, balaye les préjugés, remet tout en question. Seul, il a une pénétration suffisante pour atteindre les masses profondes. Il les secoue d'une alerte, d'une émotion constantes, par la production intellectuelle, scientifique, artistique, par la publicité, l'action d'un organe de diffusion sans pareil : la presse. Le peuple ne serait vraiment libre que s'il pouvait dominer, en lui-même, cette perpétuelle suggestion. Récapitulons : La transformation sociale qui enlève leur dernière autorité aux classes dirigeantes, qui écarte la bourgeoisie ou plutôt qui la dilue par l'avènement des nouvelles couches sociales, institue un nouveau régime : la démocratie. Mais le mot n'est qu'un symbole, l'expression d'un idéal. En réalité, les dix millions de citoyens français qui ont droit de vote n'ont pas une action égale sur la marche des affaires publiques. Les bulletins additionnés n'expriment que rarement et très approximativement la volonté de tous ou même la volonté du plus grand nombre. Il subsiste, malgré tout, dans cette démocratie, une élite. Cette élite se compose : des anciennes influences, des nouvelles couches sociales, de la capitale, Paris, du personnel des administrations publiques, de tout ce qui écrit, publie, parle, enseigne, formant l'opinion. Elle agit continuellement sur les masses, selon le mot de Prévost-Paradol, par la persuasion. Et quand celles-ci votent et se constituent en majorités, elles subissent encore le pouvoir occulte de ces autorités diverses qui s'exerce sur elles. Il est donc naturel et nécessaire de rechercher, dans les sentiments de l'élite, les raisons d'agir de la nation au moment où vont se dégager les principes de la nouvelle constitution. |