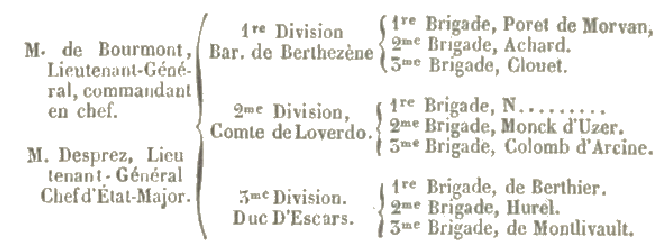HISTOIRE DE LA CONQUÊTE DE L'ALGÉRIE
TOME PREMIER
LIVRE PREMIER. — PRISE D'ALGER.
Considérations
générales. — Coup d'œil sur l'Afrique et l'Algérie. — Précis de son histoire
avant 1830. — Causes de la guerre. — Hussein Dey, sa cour, son gouvernement.
— Préparatifs de la France. — Le général en chef et l'amiral. — Embarquement
des troupes. — Départ de France. — Naufrage des bricks le Sylène et
l'Aventure. — Séjour à Palma. — Arrivée en Afrique. — Débarquement. —
Bataille de Staouëli. — Deuxième bataille gagnée par les Français. — Siège et
prise du fort l'Empereur. — Capitulation d'Alger. — Attaque par mer.
Depuis
les violentes secousses imprimées à la société européenne par la Révolution
Française, depuis la disparition du Géant qu'elle avait enfanté, nul
événement n'aura une plus large place dans les annales du monde que la prise
d'Alger. C'est d'elle que datera l'envahissement de l'Afrique par la
civilisation européenne, grande période de l'histoire, dont nous avons vu le
commencement, et dont nos petits-fils ne verront pas la fin ; la France était
destinée par la Providence à faire les premiers pas dans cette carrier, ou
d'autres nations la Suivront sans doute ; elle accomplit sa mission avec ce
dévouement aux nobles idées, avec cette abnégation de ses intérêts matériels,
qui la caractérise ; mais le temps des dédommagements arrivera ; la guerre
que nous soutenons en Afrique sera aussi grande par ses résultats, qu'elle
est héroïque dans ses épisodes. Nous avons conquis une foi inébranlable dans
notre œuvre, du premier jour, où en 1851, nous avons mis le pied sur ce
rivage régénéré par le pavillon français ; les mains laborieuses des
Européens féconderont ces vallées fertiles, mais incultes, où l'Arabe conduit
ses maigres troupeaux, chaque course de nos soldats trace sur cette terre
sauvage une route qui se couvrira plus tard de voyageurs paisibles ; chaque camp
devient le noyau d'une ville puissante dont nos généraux auront la gloire
d'avoir été les véritables fondateurs ; honneur donc à notre armée qui
poursuit sa tâche avec tant de courage et d'intelligence ; honneur à tous
ceux qui concourent à une œuvre plus utile à l'humanité, que tout ce que nous
avons fait depuis un siècle. Qu'est-il advenu de tous les gigantesques
triomphes de la Révolution et de l'Empire ? La tempête suscitée en France-a
balayé les libertés dont jouissaient alors plusieurs petits États, et si,
quand le sol s'est raffermi, on a trouvé quelques idées de plus semées sur la
surface de l'Europe, qui oserait affirmer qu'elles n'étaient pas la suite des
progrès que le temps amène toujours avec lui ? Cependant que de sang versé,
que de ressources prodiguées dans ces grandes guerres européennes, tandis que
dans nos modestes expéditions d'Afrique, avec des armées de 9.000 hommes,
nous gagnons des batailles destinées à renouveler la face d'un continent tout
entier ; le jour n'est pas éloigné, je l'espère, où les Etats européens
comprendront qu'une guerre entr'eux n'a, le plus souvent, d'autres résultats
que de ruiner pour longtemps les puissances belligérantes, et de laisser les
choses à peu près dans la position où elles étaient avant la lutte ; qu'il y
a un but plus noble et plus avantageux offert à leur activité et à leurs
communs efforts, celui de les consacrera étendre sur tout le globe les
bienfaits de leur civilisation et de leur industrie supérieures. Que tous les
hommes passionnés pour le bien de l'humanité se réunissent pour détruire,
avec l'aide du temps, les vieux ferments de jalousie et de rivalité qui
divisent encore les nations les plus avancées du monde ; que la grande voix
de la France retentisse dans toute l'Europe, pour proclamer cette vérité si
féconde, si nouvelle, et encore si mal comprise, que la prospérité d'un
peuple, quand il ne s'en sert pas pour opprimer ses voisins, bien loin de
leur nuire, est pour eux une chance de plus de bonheur et de richesses. Mais
autant une guerre est fâcheuse et généralement absurde entre deux peuples
également avancés, autant elle est avantageuse à l'humanité, lorsqu'elle met
la barbarie aux prises avec la civilisation, avec toutes les chances de
triomphe pour cette dernière ; le soldat vainqueur n'est alors que le
missionnaire armé d'un nouvel ordre d'idées et d'organisation. Malgré toute
l'éloquence de J.-J. Rousseau, l'expérience a prouvé que plus .un peuple se
civilise, plus il devient supérieur à ceux qui restent barbares, sous tous
les rapports physiques et moraux ; on a dit, et je le croirais volontiers,
que pour les naturels de l'Inde, le plus mauvais gouverneur anglais valait
mieux que le meilleur gouvernement indigène ; applaudissons donc aux
triomphes de l'Angleterre en Asie, mais que, de son côté, elle rende la même
justice à notre domination sur les Arabes, à mesure que les nations
s'éclaireront, la bienveillance, la justice, la vérité, prendront une plus
grande place dans leurs mutuels rapports. Les discussions de tribune qui
éclairent les questions et soumettent les gouvernements à l'opinion publique
de toute l'Europe, les relations de commerce qui tendent constamment à
l'agrandir et à l'affranchir de toute entrave, sont des juges constants de
paix et de concorde. Un autre plus puissant encore, peut-être, se trouve dans
ces congrès que les grands États, ont pris l'habitude de réunir à toute
occasion un peu importante ; quoique ces assemblées de plénipotentiaires
aient presque toujours été impopulaires, il serait peut-être à désirer,
qu'elles se réunissent à des époques fixes et déterminées ; elles
deviendraient, par sa seule force des choses, sans que les États despotiques
s'en doutassent, une véritable représentation constitutionnelle de l'Europe.
Alors elles ne s'occuperaient pas uniquement d'un incident passager, mais
elles imprimeraient à la politique du monde une marche générale, vers un but
d'utilité et d'avenir ; alors on laisserait les Anglais percer l'Isthme de
Suez, immense avantage et pour eux et pour tous les peuples. La Russie
pourrait poursuivre ses succès en Turquie ; une - autocratie européenne doit
toujours mieux valoir que le despotisme oriental ; on nous rendrait les
limites que le Rhin et la nature nous ont tracées au nord ; on nous
permettrait de poursuivre sans obstacle et sans jalousie la régénération de
ces plages africaines, si justement appelées jusqu'à ce jour du nom de
Barbarie. L'attrait
de ces grandes questions nous entraîne ; revenons à notre Afrique, où
l'avenir nous réserve de si grandes destinées, où quoiqu'on en dise, nous
avons déjà fait beaucoup ; je voudrais réunir, dans une esquisse rapide, les
événements qu'elle a vu surgir depuis 1830 ; bien des noms, qui me furent
chers et familiers dès ma première jeunesse, viendront se mêler à mes récits
; heureux je serai de voir des contemporains et des amis se couvrir d'une
gloire si méritée ; malheureux de ne pouvoir en prendre moi-même ma part ! La
vaste terre d'Afrique, jetée tout d'une pièce "au milieu des mers,
paraît être le dernier boulevard que la barbarie doit opposer à la
civilisation : aucun grand golfe ne pénètre profondément cette étendue
immesurée de sables, de plaines, de montagnes, habitée par de sauvages
populations chez lesquels un étranger est presque sûr-de trouver la mort ;
aucun fleuve gigantesque, semblable à celui des Amazones qui traverse de part
en part l'Amérique du Sud, ne peut porter un nouvel Orellana au centre de
pays inconnus, et tracer la route découverte à ceux qui voudraient imiter son
audacieux exemple ; aussi quand on jette les yeux sur une mappemonde,
l'Afrique tout entière apparaît-elle comme un vaste désert, à peine entamé
sur ses bords pour quelques contrées un peu plus connues, où les Européens
ont jeté des comptoirs plutôt que des Colonies ; le continent de Colomb fut
tout entier parcouru et conquis presque aussitôt que trouvé, et aujourd'hui
nous n'en savons guère plus que les anciens sur l'intérieur de l'Afrique.
Tout ce qui nous vient de ces régions inexplorées, les productions, les
fleuves, les vents même ont quelque chose d'extraordinaire et d'effrayant :
le siroco eh Algérie, les vents d'est au Sénégal, avec leurs influences
pernicieuses et leurs propriétés particulières que toute notre physique a peine
à expliquer, apportent -comme un parfum de mystère et de terreur des
solitudes brûlantes qu'ils ont traversées. L'Algérie,
située en regard de l'Europe, à l'extrémité nord de l'Afrique, en est la
partie qui, par son aspect t ses productions, a le moins de rapport avec le
continent auquel elle appartient ; l'air y est généralement sain et tempéré ;
les plantes et les arbres plutôt européens que tropicaux ; le blé, dont la
culture caractérise les zones moyennes, parait être là dans sa terre natale,
et c'est, sans contredit, sous une pareille latitude que sa production est la
plus abondante et la plus facile. Mais par la disposition du sol et la
configuration des côtes, l'Algérie est une terre toute Africaine ; aucun
accident un peu notable ne rompt la monotonie de sa rive inhospitalière, qui
court de l'est à l'ouest sur une étendue de 250 lieues, en ligne droite presque
continue. A peu près au milieu de cette ligne, une découpure demi-circulaire
dont le diamètre mesure environ cinq lieues, échancre la terre, en laissant
une côte presque plate à l'orient, formée à l'ouest par des collines aux
flancs abruptes et déchirés. C'est au bas de ces collines, baignant ses pieds
dans les flots, que s'appuie la ville d'Alger, tandis que ses maisons
échelonnées gravissent la hauteur, et que sa tête, couronnée par le Casbah,
repose sur un mamelon situé à mi, chemin de la pente totale, et élevé de
quelques deux cents mètres au-dessus du niveau des mers ; de l'extrémité d'un
cap, formé par quelques maisons de la ville, s'élance dans les ondes une
jetée partie naturelle, partie faite par la main des hommes, qui, se courbant
ensuite au sud, embrasse un port presque fermé. Son entrée, à l'abri des
coups de la haute-mer, semblerait devoir être très sûre, si par les vents du
nord-est, terribles dans ces parages, la vague violemment refoulée par le
fond de la baie, ne venait s'y briser avec fureur ; il était du reste rétréci
et peu profond lors de la conquête ; il était réservé à la France de
l'agrandir et de l'assurer. A
partir des bords de la mer, le sol est couvert de collines inégales, qui
augmentent graduellement d'élévation, à mesure qu'on s'avance dans
l'intérieur, jusqu'à 25 ou 30 lieues de distance, où se rencontrent les
croupes les plus élevées qui se prolongent de l'est à l'ouest, presque
constamment parallèles à la côte. Les anciens leur avaient donné le nom
d'Atlas, aujourd'hui entièrement oublié, dans toute la Régence. Le sol sur
lequel reposé tout ce système de hauteurs, s'élève en même temps que les hauteurs
elles-mêmes, et très souvent par des pentes excessivement brusques, de sorte
que le versant de l'Algérie, du côté de la Méditerranée, peut assez bien se
figurer par une suite de gradins superposés, sur lesquels on aurait seing des
inégalités de terrain sans ordre et irrégulières ; chaîne culminante de ces
gradins forme de grands plateaux ; s'inclinant au nord ou au sud par des
pentes très douces, et parsemés de quelques pics qui dominent toute la
région, mais qui n'atteignent presque jamais la limite des neiges
perpétuelles ; ils donnent naissance à une multitude de torrents et de
rivières dont les unes après un cours plus ou moins long, tombent au nord
dans la Méditerranée, tandis que les autres, se dirigeant au sud, se perdent
bientôt dans les sables du grand désert qui les engloutit comme une mer
véritable, ou dans un grand fleuve du nom d'Adjedi, qui prend sa source à
Ain-Madhi, coule à l'est et disparaît enfin elle-même dans un de ces lacs saumâtres
peu profonds, si communs dans l'Algérie. Quoique presque à sec durant l'été,
plusieurs de ces rivières sont assez poissonneuses ; les tortues d'eau douce
y abondent ; une bordure de lauriers roses en décore presque toujours les
rives ; elles sont animées par une foule d'oiseaux de marais, affectionnées
par les sangliers qui trouvent une abondante pâture dans les herbes
qu'alimente la fraîcheur des eaux. On se
tromperait fort du reste, si d'après quelques récits laissés par les anciens,
on se figurait les pays dont nous parlons, comme ravagés journellement par
des animaux féroces, ou infectés de reptiles énormes et venimeux ; partout où
l'homme a établi sa race avec quelque puissance, ses ennemis les plus
dangereux ont rapidement disparu ; les serpents dans l'Afrique du Nord ne
sont ni plus gros, ni plus communs que dans le midi de la France ; je n'y ai
jamais vu de scorpions quoique je pense qu'il doit s'y en trouver. Les seuls
animaux qui s'y montrent réellement dangereux sont la panthère et le lion,
encore n'attaquent-ils jamais l'homme à moins d'être positivement provoqués,
et l'espèce en diminue-t-elle si rapidement tous les jours, que bientôt
seront-ils aussi rares dans la Régence que l'ours l'est maintenant en France,
dont il peuplait jadis les forêts. Les chacals dent les bandes remplissent
les fouillis et les broussailles sont plutôt utiles que nuisibles ; leur
voracité leur fait dévorer tous les débris d'animaux qui pourraient corrompre
l'atmosphère. Les autres quadrupèdes de l'Algérie sont si faibles et si doux
qu'ils sont devenus des esclaves soumis à notre luxe ou à nos besoins ; si
nous n'y trouvons plus l'éléphant qu'Annibal menait à la conquête de
l'Italie, il est remplacé et probablement très avantageusement par le
chameau, introduit par les Arabes, lors de leur irruption en Afrique, et qui
est peut-être le seul présent réellement utile qu'ils aient fait à leur
malheureuse conquête. Il s'y est parfaitement acclimaté, et on le trouve en
égale abondance depuis les côtes de l’Océan, jusqu'à l’isthme de Suez. Nous
avons dit que le climat de l'Algérie, à l'exception des parties marécageuses,
qui par cela même, seraient dangereuses sous toutes les latitudes, était
généralement sain et tempéré. Dans l'intérieur des terres, la température est
modifiée par l'élévation du sol au-dessus du niveau de la mer ; sur les
côtes, par une brise du large qui s'élève-ordinairement vers les neuf à dix
heures du matin ; rarement au milieu de l'été, le thermomètre s'élève-t-il
au-dessus de 28 à 50 degrés centigrades, excepté quand souffle le siroco ou
le Vent du désert, et heureusement cette circonstance est-elle assez rare et
toujours de courte durée ; les rosées abondantes qui tombent toutes les
nuits, remplacent assez bien les pluies qui manquent pendant trois ou quatre
mois de l'année, et la végétation de l'Afrique, d'une nature il est vrai
moins sensible que la nôtre à la sécheresse, en traverse ordinairement
l'époque sans trop en souffrir ; même aux mois d'août et de septembre, alors
que les €Ôtes de Provence n'offrent plus qu'un tableau uniformément grisâtre,
les aloès et les cactus revêtent les collines d'Alger d'une verdure sombre et
tranchée, qui, vue en mer, d'une certaine distance, représentent assez bien
les teintes employées à l'Opéra de Paris pour rendre les arbres et les
prairies. Mais c'est surtout au mois de mai et de juin, que la nature est
dans toute sa pompe, et la température réellement délicieuse. Il est peu
d'ensembles pareils à celui dont jouit le spectateur, quand du haut de la
Casbah, par une belle matinée de printemps, et elles sont presque toutes
belles dans cet heureux climat, il embrasse d'un coup d'œil la mer bleuâtre
qui s'aplanit au nord, les blanches terrasses de la ville qui se déroulent à
ses pieds par étages superposés, les vertes collines de Mustapha et
d'Hussein-Dey dont les teintes s'adoucissent et se dégradent à mesure
qu'elles s'éloignent, pour se noyer enfin dans l'uniformité de la plaine.
D'un ciel d'un azur foncé, s'échappe par torrents une lumière étincelante,
qui revêt, d'un air de fête et de splendeur, tous les objets qu'elle éclaire.
Un horizon accidenté, découpé à larges festons, par les cimes neigeuses de
l'Atlas, réunit dans un cadre immense ce tableau magique, où l'œil et la
pensée trouvent constamment des impressions nouvelles ; une atmosphère tiède
et molle enveloppe les membres de l'homme, comme un léger bain de vapeur :
s'ils perdent quelque chose de leur énergie, tous les mouvements en
acquièrent plus de souplesse et de facilité : l'âme elle-même retrouve un
moment toute sa jeunesse. Les perceptions douces et rapides à la fois sont
semblables à celles qu'éprouve un convalescent, lorsque, à la suite d'une
légère maladie, il sort une première fois pour respirer le grand air et
essayer des forces longtemps oisives. Mais un
charme peut-être encore plus inconnu aux habitants des froides contrées du
Nord est celui qui, sous cette latitude, s'attache aux soirées qui terminent
les chaudes journées de l'été : l'occident, revêtu d'une pourpre embrasée, où
le soleil couchant a laissé une partie de ses feux, la lumière douce et
argentée de la lune qui se marie lentement aux dernières lueurs du jour, les
plaines du ciel qui se nuancent de mille teintes changeantes, et qui, se
reflétant dans la mer, s'y diversifient encore, la brise qui fraîchit et
verse dans la nature une vie et une force nouvelle, tout porte alors dans
l'âme une impression de joie ineffable, que ceux qui l'ont une fois éprouvée
regretteront toute leur vie ; alors exister, c'est jouir ; nul autre
spectacle, nulle excitation extérieure ne doit venir troubler le calme
délicieux qui règne dans l'âme ; à cette heure, elle se recueille et se
replie sur elle-même pour y renfermer les sensations de bonheur qui
l'inondent de toutes parts. Ces
jouissances si faciles et si douces sont la cause de cette paresse reprochée
si souvent aux voluptueux habitants du Midi. Quel trésor acquis par un
travail pénible vaudrait pour eux les biens que la nature leur prodigue avec
tant d'abondance, et auxquels leur organisation les rend si sensibles ? Dans
un air froid et humide l'existence n'est supportable qu'à force de soins et
d'artifices. Un travail opiniâtre y semble l'éternel héritage de l'homme.
L'activité du corps y est du reste nécessaire pour entretenir la circulation
et la chaleur du sang. Mais la preuve que cette activité n'est qu'un remède
et non le bien-être, c'est que la mélancolie et le dégoût de la vie sont des
maladies endémiques de ces climats. L'Anglais se tue souvent au milieu des
trésors accumulés par son travail, tandis que l'Espagnol attend
tranquillement et sans souffrances le terme de ses jours au sein d'une
pauvreté à laquelle les dédommagements d'une nature privilégiée ont su le
rendre presque insensible. Je laisserai au moraliste le soin de décider ce
qui vaut mieux pour le bonheur d'un peuple, ou des richesses qu'a su se créer
le laborieux Anglais, ou des biens que le Méridional doit à l'influence du
climat qu'il habite ; pour moi il me semble que la réunion des deux avantages
compléterait tout le bien-être réservé à l'homme ici-bas. En nous rapportant
aux premières époques historiques, nous trouvons que les peuples du Midi ont
été longtemps égaux, et même supérieurs à ceux du Nord dans les sciences, les
arts et l'industrie. D'homme à homme cette supériorité semble subsister
encore. Pourquoi donc les nations méridionales ne pourraient-elles pas
reconquérir au moins une entière égalité ? Qu'elles jouissent des bienfaits
de leurs délicieux climats, mais qu'elles ne s'endorment pas dans leur facile
bonheur. Tout ce qui tend à les perfectionner leur est donc utile, et dans ce
sens la guerre que nous soutenons contre les Arabes de l'Algérie, et qui ne
peut se terminer que parleur complète soumission, aura en définitive des
résultats plus avantageux encore pour les vaincus que pour nous. Chacun
sait que les contrées, aujourd'hui théâtres de nos succès, colonisées jadis
par les Phéniciens, parvinrent sous la domination de Carthage à un tel degré
de richesses et de pouvoir, qu'elles balancèrent quelque temps le destin de
Rome elle-même ; mais enfin, il leur fallut subir le sort qui attendait
presque tous les peuples, et réduites en provinces romaines, elles eurent
longtemps l'honneur de nourrir les maîtres du monde. Lorsque les barbares du
Nord se partagèrent les conquêtes de Rome, elles échurent aux Vandales, dont
la domination désastreuse fut heureusement de courte durée ; Bélisaire
vainquit et prit Gélimer ; le dernier de leurs rois, et rattacha l'Afrique- à
Constantinople qui représentait alors l'empire Romain. Elle respira quelque
temps sous les empereurs du Bas-Empire, jusqu’au moment où les Arabes,
conduits par les successeurs de Mahomet, y établirent définitivement leur
religion et leurs mœurs ; le chef de ces conquérants fanatiques poussa son
cheval dans les flots du grand Océan, sur les côtes du Maroc, en remerciant
Allah du bonheur de ses armes, qui n'avaient plus d'autre limite que celle du
monde. Différents souverains arabes se partageaient la domination de ces
beaux pays, lorsque Chair-Eddin, surnommé Barberousse, fils d'un potier de
l'Archipel, converti à l'Islamisme par le sabre des Turcs, d'abord amiral du
sultan de Constantinople, ensuite conquérant pour son propre compte, s'empara
d'Alger dont il fit périr l'ancien maître. Il s'y établit avec -ses Turcs, et
fonda le gouvernement qui a subsisté jusqu'à l'expédition française ;
méprisant les peuples conquis, il ne voulut pas même chercher chez eux des
instruments du pouvoir, et confia les charges de l’Etat à des aventuriers de
la Turquie d'Europe ou d'Asie qui affluaient en Afrique, attirés par
l'espérance des richesses et du pouvoir. Cet
exemple fut imité par ses successeurs cinq ou six mille Turcs suffirent pour
dominer des millions de naturels, comme si cette terre d'Afrique était
impuissante à produire ses maîtres. Cette soldatesque indisciplinée élisait
les souverains du pays et les siens, puis les assassinait quand elle en était
mécontente ; peu de Deys virent arriver naturellement le terme de leurs jours
: dans une de ces révolutions si fréquentes dans les États despotiques, le
même soleil vit élever sur ce trône sanglant, et massacrer tour-à-tour, trois
de ces princes éphémères, et cependant on ne cite pas un seul élu qui ait
décliné ce dangereux pouvoir, peut-être parce qu'il y aurait eu autant de
péril à le refuser qu'à l'accepter. Hussein, le dernier Dey, régnait
néanmoins depuis quinze ou seize ans lorsqu'il fut détrôné par nos armes ;
mais en 1850, il y avait dix ans qu'il n'avait osé sortir de sa forteresse,
la Casbah, et la dernière fois qu'il avait traversé les rues de la ville pour
se rendre à la Marine, deux coups de feu tirés sur lui l'avaient dégoûté pour
jamais de recommencer une nouvelle expérience. Différentes
fois cependant, les Européens avaient attaqué l'État d'Alger avec des
résultats plus ou moins avantageux ; Charles-Quint enleva Tunis à Barberousse
qui s'en était emparé, et vint ensuite descendre, en 1540, au fond de la rade
d'Alger, et ne dût sans doute qu'à une tempête effroyable, qui ruina sa
flotte et son armée, de ne pas détruire l'empire naissant du pirate. Quoi
qu'il en soit, son expédition manquée, l'orgueil du barbare et l'effroi qu'il
inspirait, ne purent que s'en augmenter encore ; plus tard, néanmoins, les
Espagnols attaquèrent et prirent Oran, et étendirent leur domination sur
plusieurs autres villes de la Régence. Mais la force expansive de l'Espagne
se portait alors principalement vers l'Amérique, où elle trouvait des ennemis
moins redoutables que les belliqueux et fanatiques successeurs des
conquérants arabes. Ses établissements en Afrique ne firent que languir sans
jamais acquérir une prospérité réelle. Les souverains Turcs de la Régence,
faisaient chaque jour de nouveaux efforts. Peu à peu les Espagnols perdirent
tout le terrain qu'ils avaient acquis sur cette côte ; enfin en 1740, le boulevard
de leur puissance, Oran dont ils avaient fait une place fortifiée à la
moderne, tomba sans retour entre les mains des Algériens. Louis
XIV fil aussi sentir le poids de sa puissance aux États barbaresques ;
justement irrité de l'atrocité d'un Dey qui avait fait charger un mortier
avec le corps d'un consul français, il ordonna, en 1685, à Duquesne, son
amiral, d'attaquer la ville d'Alger. Celui-ci trouva le moyen d'établir des mortiers
sur des navires flottants, bombarda la ville avec un tel succès, qu'effrayés
des flammes qui dévoraient leurs habitations, les Algériens implorèrent la
clémence du vainqueur ; l'amiral français ne se retira qu'accompagné de cinq
cents esclaves chrétiens, arrachés par lui au plus dur esclavage, Il s'en
suivit un traité glorieux pour la France, conclu en 1684 ; malheureusement il
fut presque aussitôt violé que juré par les Mahométans ; les guerres
continuelles que se faisaient les princes chrétiens ne permirent pas à la
France de venger ce manque de foi, et les courses des Algériens
recommencèrent jusques en 1816, où l'Angleterre pensa qu'il était de la
dignité de sa marine de châtier à son tour ces barbares, qu'on ne voulait pas
se donner la peine de détruire. Lord Exmouth, avec une escadre Anglaise,
soutenue de quelques bâtiments hollandais, vint s'embosser à l'entrée du
port, si près de la ville, que la proue de la Reine-Charlotte, le
vaisseau-amiral touchait, disait-on, les premières maisons d'Alger. Bientôt
les batteries musulmanes, prises de revers, furent entièrement démolies, les
vaisseaux de la Régence consumés, les habitations en ruine ; le souverain du
pays accepta encore une fois toutes les conditions qui lui furent imposées ;
les esclaves chrétiens furent délivrés, une paix conclue ; cette expédition
anglaise semble faire le pendant de celle de Duquesne, et par la manière
hardie et expéditive dont elle fut conduite, par le succès qu'elle obtint, et
par le peu de durée du traité qui en fut la suite. Indépendamment
des tentatives armées dont nous avons donné une idée, les Français avaient
acquis des Arabes en 1450, et par conséquent bien avant la conquête de
Barberousse, une certaine étendue de côtes, situées à l'est de Bone, du côté
de Tunis. Ce territoire cédé par les Mahométans, moyennant certaines
redevances, a porté depuis lors jusqu'à nos jours le nom de concessions
d'Afrique. Nos droits de propriété ont été formellement reconnus par les
empereurs de Constantinople, qui avaient conservé la suzeraineté des États
barbaresques ; les Deys eux-mêmes les avaient également sanctionnés par des
traités conclus en 1694, 1801 et 1817. La situation avantageuse de ces
possessions, leur fertilité, les facilités qu'elles offraient pour commercer
avec l'intérieur du pays, avaient procuré de grands avantages aux compagnies
auxquelles nos rois les avaient concédées avant 1789 ; la Restauration voulut
renouveler cet état de choses par le traité de 1817, mais la mauvaise volonté
du Dey qui survécut au traité, l'intention souvent manifestée par lui de
détruire nos établissements, empêchèrent les négociants de Marseille de
suivre des relations, qui exigent avant tout de la confiance et de l'avenir. A la
possession d'un territoire assez considérable se joignait pour nous le
privilége exclusif de la pêche du corail, sur une étendue d'environ 60 lieues
de côtes, droit également reconnu par nos traités avec la Porte et avec les
souverains du pays ; la somme à payer annuellement, consentie par nous pour
ce privilége, fixée à 17.000 fr. avant 1789, fut portée à 60.000, lorsque le
privilège exclusif nous fut rendu en 1817 ; mais deux ans s'étaient à peine
écoulés que le Dey, sans motif apparent, voulut porter notre redevance
annuelle à 200.000 fr. Pour ne pas priver ses sujets d'un commerce
avantageux, le gouvernement y consentit, et comme toujours, un acte de
faiblesse fit naître de nouvelles exigences. Le Dey ne respecta pas plus nos
droits nouvellement sanctionnés, qu'il n'avait fait des précédents. En 1826
il fit publier un manifeste qui permettait à toutes les nations la pêche du
corail sur les côtes de sa domination, et pour comble de mauvaise foi et
d'absurdité, il voulait continuer de recevoir le prix d'un privilége qu'il
venait de nous ravir. Tel était l'un des griefs .de la guerre que nous
entreprîmes contre Alger. Un
autre bien plus grave encore, qui détermina une rupture préparée depuis
longtemps, fut l'insulte faite à notre consul à Alger, M. Deval : Deux riches
juifs algériens, Bacri et Busnach, avaient fourni au Consulat et à l'Empire
divers approvisionnements, dont le prix liquidé plus tard par la restauration
avec sa bonne foi ordinaire, constituèrent, par une décision d'arbitres du 28
octobre 1819, le trésor débiteur à leur égard d'une somme de sept millions.
Cette liquidation fut plus tard approuvée par le Dey d'Alger et Charles X,
avec la condition de la part de ce dernier, que les Français créanciers des
juifs algériens pourraient présenter eux-mêmes leurs comptes, et qu'une somme
égale à leur montant serait tenue en réserve jusqu'à ce que les tribunaux français
eussent prononcé sur la validité de ces titres. Jamais convention plus juste
ne fut plus ponctuellement exécutée de la part de la France ; quatre millions
cinq cent mille francs furent payés à la Société Bacri et Busnach par l'État
; deux millions cinq cent mille francs, montant des réclamations des
créanciers français à l'égard des deux juifs d'Alger, furent versés à la caisse
des dépôts et consignations en attendant, qu'il fût décidé à qui cette somme
appartiendrait en dernier résultat. Mais
l'avarice du Dey, créancier lui-même des sieurs Bacri et Busnach, s'accommodait
mal des formes, des lenteurs ordinaires de la justice française. Il réclama
plusieurs fois avec hauteur la remise des 2.500.000 fr., prétendant que les
créanciers français pourraient tout aussi bien faire valoir leurs droits à
son tribunal, qu'auprès des juges de leur patrie ; enfin il adressa lui-même
une lettre conçue dans ce sens à M. de Damas, alors ministre des affaires
étrangères en France ; lettre dans laquelle il faisait avec son insolence
ordinaire, de la remise immédiate de la somme en litige entre ses mains, une
condition nécessaire au maintien de ses relations avec la France ; quelques
jours après, la veille des fêtes musulmanes, M. Dèval se rendit suivant l'usage
au palais du Dey, et celui-ci lui demanda s'il n'avait pas une lettre à lui
remettre de la part de son gouvernement ; M. Deval répondit négativement, et
là-dessus, le prince entra en fureur, voulut lui porter plusieurs coups d'un
chasse-mouche qu'il tenait à la main, en lui ordonnant de sortir sur-le-champ
de sa présence. En même temps il déclara publiquement qu'il ne voulait plus
qu'il y eût un seul canon français sur le territoire d'Alger, et qu'il ne
nous y reconnaissait plus que les droits généraux, dont jouissaient les
autres nations qui viendraient y trafiquer ; M. de Damas prescrivit à M.
Deval d'exiger une réparation éclatante, ou de quitter immédiatement la
capitale du Dey. La réparation fut refusée, le consul général quitta la
ville, et le Dey envoya aussitôt au Bey de Constantine l'ordre de détruire
les établissements français en Afrique. Cet ordre fut exécuté, et le fort la
Galle, le plus considérable de nos - entrepôts, ruiné de fond en comble,
ainsi que tous les comptoirs qui en dépendaient. Dès lors toute transaction
sembla impossible et la guerre exista de droit. Néanmoins
le gouvernement français ne pensait guère alors à un débarquement en Afrique.
Dans leurs relations avec Alger, les États européens cherchaient avant tout,
en sauvant tant bien que mal l'honneur de leur pavillon, à maintenir des
relations commerciales avantageuses à leurs sujets ; d'après ces principes,
Charles X envoya simplement une escadre croiser devant la capitale du Dey,
avec ordre de maintenir un blocus rigoureux ; on espérait ainsi l'amener à
quelque chose qui pût ressembler à une réparation ; mais Alger n'était pas le
seul port de la Régence, la côte d'Afrique est mauvaise. Ce blocus coûta
vingt millions, et dura trois ans sans causer à l'ennemi un dommage assez
réel pour l'engager à nous demander la paix. Il fallait en finir avec ces
demi-mesures, inutiles et ruineuses. Cependant avant de pousser les choses à
l'extrême, le roi et son conseil se déterminèrent à essayer encore une
tentative de conciliation ; dans le courant de juillet 1829, M. de la
Bretonnière fut envoyé à Alger avec ordre d'entamer une négociation, si le
Dey semblait disposé à entendre raison ; M. de la Bretonnière fut admis
auprès de celui-ci, essuya un refus formel, et au moment où le vaisseau que
montait l'ambassadeur français quittait le port d'Alger, chargé du pavillon
parlementaire, une décharge générale de toutes les batteries voisines vint
l'atteindre de 80 boulets ; le feu ne cessa que lorsque le bâtiment se trouva
tout-à-fait hors de portée. Quel
était donc le prince qui se montrait à notre égard si féroce, si contempteur
de la justice et de la foi jurée ? Hussein-Dey cependant, d'après ce que nous
en savons, n'était ni cruel, ni même injuste dans le sens que nous attachons
ordinairement à ce mot ; le fond de son caractère semble plutôt avoir été une
espèce de bonhomie mêlée de finesse et de fermeté ; né à Smyrne dans une
condition inférieure, d'abord simple garçon de café, comme beaucoup de Turcs,
il était venu chercher fortune à Alger, où il entra dans la classe des Ulémas
ou docteurs de la loi ; à ce titre, il devait être plus instruit que la
plupart de ses compatriotes. Bientôt son adresse le rendit le secrétaire
intime et le confident d'Aly-Soco, son prédécesseur. Il sut néanmoins se ménager
en même temps un parti dans la milice turque, contre laquelle Aly-Soco
nourrissait quelque projet, de sorte qu'à la mort de ce dernier, enlevé par
la peste, il fut élu Dey, sans opposition. Des largesses distribuées à la
milice turque, le maintinrent jusqu'en 1850 sur le trône où sa politique
l'avait élevé. Hussein entendait assez bien la position d'Alger à l'égard des
puissances européennes ; seulement les ménagements ordinaires, dont on usait
à l'égard de sa principauté presque barbare, lui avaient donné une idée trop
exagérée de sa force et de sa puissance. Il ne doutait pas que l'Afrique ne
devînt le tombeau de toute armée européenne qui oserait venir l'attaquer.
D'ailleurs, en qualité de bon Musulman, il méprisait souverainement les
chrétiens, et ne se croyait pas tenu à leur égard aux règles ordinaires de la
justice et du droit des gens ; telle est l'explication la plus naturelle de
l'anomalie qui semble exister entre son caractère connu et sa conduite à
notre égard. La
Régence était alors divisée en quatre beylicks ou gouvernements ; d'abord,
ceux d'Alger et d'Oran, le premier soumis immédiatement à l'autorité du Dey,
le second confié à un autre Hussein ; ensuite celui de Constantine où régnait
Achmet-Bey, et enfin le beylick de Tittery, le dernier et le moins important
de tous, situé au sud des environs d'Alger ; suivant le genre du gouvernement
invariablement adopté dans les États despotiques, les gouverneurs des trois
derniers beylicks réunissaient tous les pouvoirs chacun dans le ressort de
leur juridiction, et ne témoignaient de leur soumission à leur suzerain que
par un tribut variable, accompagné de beaucoup de présents, lorsqu'ils
voulaient se maintenir bien en cour car un souverain turc mesure toujours la
capacité de ses agents sur l'argent qu'il en reçoit. Le Bey d'Oran avait
trouvé le moyen de satisfaire aux exigences de son maître, sans trop
pressurer la province qu'il administrait depuis dix ans avec autant de
justice que d'intelligence. Hadj Achmet, Bey de Constantine, était le fils
d'un Turc et d'une Mauresque, c'est-à-dire en termes du pays un Colougli,
race ordinairement éloignée des emplois de la Régence Son père et son
grand-père avaient eux-mêmes gouverné longtemps la province de Constantine :
la famille entière fut exterminée par une de ces révolutions si communes chez
les Musulmans : Achmet, épargné à cause de sa jeunesse, rentra plus tard en
grâce auprès du Dey, protégé qu'il fut par l'homme qui en était, à la fois,
et ministre de la guerre et le général en chef. Les massacres, dont les siens
auraient été victimes dans son enfance, lui avaient donné un caractère
soupçonneux et inquiet ; mais il ne manquait ni dé capacité ni d'énergie. Indépendamment
des Beys gouverneurs de province, le Dey d'Alger avait auprès de lui
plusieurs officiers, qui formaient sa cour et remplissaient des fonctions
diverses ; le Hazenagi, c'est-à-dire la ministre des finances ou grand
trésorier, pouvait passer pour le premier Visir de ce petit Sultan. C'était
un nommé Braham, homme fin et rusé ; le poste de ministre de la guerre,
commandant de la force armée, où Bach-Aga, était occupé par un jeune homme
rempli de hauteur et de fierté du nom d'Ibrahim ; le Wekil-Ardji, ou
intendant général de la marine était violent et, brave comme un marin
d'Europe ; il semble que dans tous les pays, les diverses fonctions marquent
d'un caractère particulier ceux qui les occupent. Tels étaient les ennemis
que nous préparait notre rupture définitive avec la régence. On a
voulu voir dans la résolution de Charles X, le projet de donner du lustre à
ses armes, pour les préparer à une lutte plus importante qu'il plié-, voyait
en France ; je crois que cette considération fut très faible auprès de lui,
si même elle y fut de quelque chose ; une expédition qui avait quelque chose
des anciennes croisades devait plaire au caractère un peu chevaleresque et
surtout très religieux de Charles X. En envoyant une armée en Morée, il avait
déjà prouvé qu'il ne redoutait pas les guerres lointaines ; d'ailleurs une
descente en Afrique était résolue bien avant qu'il fût question du coup
d'Etat qui le précipita du trône ; sous le point de vue social et politique,
cette guerre n'avait rien de noble et d'avantageux. Elle vengeait une insulte
faite à la France ; elle lui donnait une colonie à trois jours de navigation
de ses côtes ; elle affranchissait pour toujours les États européens du
tribut honteux qu'ils payaient à une poignée de pirates[1]. Enfin on devait trouver dans
le trésor de la Casbah un dédommagement aux frais de l'expédition ; la
résolution une fois prise, les préparatifs furent poussés avec intelligence
et rapidité ; il en était temps, car il ne restait que deux ou trois mois jusqu'à
la saison favorable. Tout le monde était d'accord que la plus grande
difficulté de l'expédition consistait dans le débarquement ; la côte
d'Afrique, réellement mauvaise, passait pour l'être bien davantage encore.
Dans les conseils qui furent tenus à ce sujet aux Tuileries, la plupart des
amiraux déclinèrent le commandement de la flotte. L'amiral Duperré fut plus
hardi ; il se chargea de déposer l'armée sur les plages de la Régence, et son
heureuse audace lui fournit l'occasion d'attacher à son nom une renommée
impérissable. Afin de les aborder plus facilement, il ordonna la construction
à Toulon de cinquante bateaux plats d'un très faible tirant d'eau, capables
de porter chacun d'eux 120 hommes et une pièce de canon. Ces bateaux chargés
sur les "vaisseaux ne devaient être mis à la mer qu'au moment du
débarquement ; ordre fut donné pour qu'ils fussent prêts vers le 30 avril ;
hi flotte devait partir dans les premiers jours de mai. De toutes parts on
demandait des bâtiments du commerce pour transporter des troupes et des
vivres ; quelques régiments, désignés pour l'expédition, avaient profité des
premiers beaux jours pour s'acheminer vers le Midi de la France ; à Toulon et
à Marseille on fabriquait des biscuits, on rassemblait des approvisionnements
pour nourrir 30 à 55.000 hommes pendant quatre mois. La facilité avec
laquelle s'opérait ce grand mouvement peut donner une idée des ressources
qu'offre la France : aucun renchérissement sensible ne se fit sentir sur les
objets de consommation qui venaient s'offrir d'eux-mêmes aux agents du
gouvernement. La bourse, ce baromètre de l'opinion n'annonçait aucune
inquiétude dans les esprits ; seulement quelques navires du commerce des
Colonies manquèrent un moment de matelots. Déjà
depuis quelque temps, la nouvelle de l'expédition, comme un coup électrique,
avait parcouru tous les régiments de l'armée ; cette jeunesse bouillante,
ennuyée de l'oisiveté de la paix, salua de ses acclamations l'espoir de
montrer son courage sur un nouveau champ de bataille. Le ministre de la
guerre était assailli de demandes qu'il ne pouvait satisfaire ; chaque
officier et chaque soldat voulait faire la guerre d'Alger, et plusieurs sous-officiers
remirent les insignes de leurs grades, pour entrer comme simples soldats dans
les régiments désignés pour l'expédition. L'annonce d'une guerre sera
toujours saluée avec bonheur par une armée française, surtout lorsqu'elle
arrive après une paix de quinze ans. Les
projets de Charles X se répandirent bientôt dans toute l'Europe, et
réveillèrent divers sentiments chez les différents gouvernements.
L'Angleterre que nous trouvons trop souvent en opposition avec nous, lorsque
nous méditons quelque entreprise utile pour notre patrie, ne vit pas nos
préparatifs sans une jalousie mal dissimulée. Elle adressa plusieurs notes à
M. de Polignac, qui répondit d'abord avec toute la politesse et la réserve
d'un homme né à la cour, mais en laissant voir clairement, surtout dans les
dernières dépêches, que le parti de son maître était irrévocablement pris, et
qu'aucune menace ne pourrait le faire changer ; l'Angleterre, comme lors de
la guerre d'Espagne, se résigna et attendit les événements ; l'Allemagne,
moins envieuse de la prospérité maritime de la France, ne vit rien dans nos
projets qui dût l'inquiéter, et ne montra à notre égard qu'une bienveillante
neutralité ; les petits États des bords de la Méditerranée que la conquête
d'Alger devait délivrer d'un tribut, aussi pénible qu'humiliant, virent nos
préparatifs avec plaisir. Enfin la Russie, trop éloignée de la France -et de
l'Algérie, pour prendre ombrage de l'agrandissement de l'une, ou nourrir
quelque prétention sur l'autre, applaudit sincèrement à nos efforts. D'ailleurs,
cette dernière puissance qui voulait se ménager un allié puissant pour les
projets d'agrandissement qu'elle méditait dans l'Orient, était depuis
longtemps dans les meilleurs termes avec la cour des Tuileries. La
Turquie, dont le Dey reconnaissait la suzeraineté par quelques présents
envoyés de loin en loin, que des liens de religion et de parenté unissaient à
la race qui dominait Alger, ne pouvait voir qu'avec chagrin l'orage qui se
préparait à fondre sur la Régence ; elle essaya même de le détourner en
envoyant une commission à Hussein Dey pour l'engager à traiter avec la France
; mais elle connaissait trop son caractère pour espérer de grands résultats
de sa démarche ; cette tentative avortée, elle abandonna son vassal à sa
mauvaise fortune. Le
ministre de la guerre de Charles X, le général Bourmont, s'était réservé le
commandement de l'armée d'invasion ; c'était un homme capable, prudent, mais
dont la conduite politique dans nos discordes civiles, avait éprouvé des
vicissitudes qui lui avaient aliéné l'opinion publique. D'abord laissé dans
l'ombre par Louis XVIII qui avait trop d'intelligence pour se charger de son
impopularité, il avait été appelé au ministère de la guerre par Charles X au
moment où ce malheureux prince s'enfonçait tous les jours davantage dans la
voie qui devait le conduire à sa perte, semblait prendre à tâche de
s'entourer des hommes que la France réprouvait le plus. Il est
probable cependant que M. de Bourmont ne fut prévenu, ni du moment choisi
pour les Ordonnances de Juillet, ni de la manière dont on devait en
poursuivre l'exécution ; son intelligence eut bientôt découvert la folie
d'une semblable tentative, et peut-être même en eut-il arrêté l'exécution ;
mais on sait que la Restauration dans les derniers jours de son existence, en
était venue au point de cacher ses projets, même aux agents les plus
importants de leur exécution : Ainsi le maréchal Marmont, qui commandait les
troupes dans les Journées de Juillet, n'avait été prévenu des ordonnances
qu'en même temps que le public, par le Moniteur. Il est donc naturel de
croire que M. de Bourmont, qui avait quitté Charles X dans le courant
d'avril, qui faisait la guerre sur un tout autre théâtre, avait partagé son
ignorance. Dans son voyage de Paris à Toulon, il avait visité avec soin et
intelligence tout ce qui avait rapport à l'art militaire. Partout il avait
reçu les honneurs qui se rattachaient au rang qu'il occupait dans l'armée et
les sentiments qui devaient vivre dans le cœur des anciens soldats de
l'empire, ne s'étaient trahis par aucun manifeste. Arrivé à Marseille le 26
avril, il s'était hâté de prendre le commandement en chef de l'expédition ; à
la tête d'une armée brillante dont il était l'âme et la volonté, où tous les
corps rivalisaient d'ardeur et d'obéissance, prêt à venger le nom français
des insultes d'un barbare, qu'il devait se tenir assuré de vaincre avec les
moyens dont il disposait, il dut penser qu'enfin le prestige du pouvoir et de
la victoire allait effacer pour toujours les impressions défavorables qu'il
sentait s'attacher à son nom. L'avenir lui réservait un terrible mécompte. Le
commandant de la marine, l'amiral Duperré, avait quitté Paris pour le Midi
depuis le 28 mars et s'était arrêté deux jours à Marseille pour examiner les
bâtiments de commerce nolisés pour le compte de l'État. Il s'était
constamment occupé depuis son arrivée à Toulon des immenses préparatifs
nécessaires pour l'embarquement de près de 40.000 hommes. Pour donner plus
d'unité et d'ensemble à tous les ordres, il avait voulu remplir lui-même les fonctions
de préfet maritime jusqu'au moment du départ de l'expédition. Une activité
extraordinaire régnait à Toulon ; chaque jour on faisait des essais ; de
débarquement avec des bateaux plats ; des officiers d'artillerie et de marine
étudiaient l'effet des fusées à la Congrève qui donnèrent jusqu'à deux lieues
de portée. Chaque commandant de navire exerçait ses marins à des manœuvres
promptes et précises. Un air de fête et de bonheur caractérisait tousses
préparatifs éclairés du soleil du Midi. Après un hiver d'une rigueur
inaccoutumée, le printemps s'annonçait serein et précoce ; le ciel lui-même
prenait parti pour la France. L'amiral
Duperré recherchait surtout les hommes ayant quelques connaissances
personnelles des côtes qu'on allait attaquer ; on lui avait déjà indiqué le
capitaine Bavastro de Nice, qui, ayant fait longtemps une guerre maritime aux
Algériens, jusque sous les murs de leur capitale, connaissait parfaitement
les parages qui l'avoisinent. Il fut attaché à l'état-major de l'amiral et
embarqué comme tel sur le vaisseau la Provence qui devait porter son
pavillon. Il rendit quelques services à l'expédition et après la conquête fut
attaché au port d'Alger où il mourut. L'expédition
qui devait partir à la fois de Marseille et de Toulon se composait de l'armée
de bataille, de la réserve, d'un convoi formé de trois divisions, et enfin
d'une flottille portant les vivres nécessaires à toute l'armée pendant une dizaine
de jours. Les
navires du commerce français nolisés par l'État, comptant 170 voiles, étaient
déjà réunis dans cette première ville ; ils y furent bientôt rejoints par 200
autres bâtiments Sardes, Italiens, Napolitains. Vingt mille hommes
d'infanterie, la cavalerie étaient destinés à prendre place sur ces moyens de
transports, qui, avertis par une dépêche télégraphique du départ de Toulon de
la flotte militaire, devaient la rallier en mer, pour naviguer de conserve et
sous sa protection. Il y avait sur la partie étrangère de la flotte des
matelots de toutes les nations de l'Europe ; la guerre d'Afrique s'annonçait
comme une nouvelle croisade, ces grandes expéditions européennes, dont le
peuple français était le chef et le guide. Le
dauphin lui-même vint animer de sa présence les préparatifs de l'expédition.
Le lendemain de son arrivée à Toulon, il visita le port et la rade qui,
couverte de bâtiments pavoisés, éclairés par un brillant soleil, présentait
un coup d'œil magnifique ; trois salves d'artillerie parties des batteries de
la Provence, du Trident et de la Créole annoncèrent l'arrivée du prince. Une
immense multitude couvrait les bords de la rade, et, en admirant le
spectacle, en augmentait elle-même l'éclat. La plage du polygone était
choisie, pour y simuler une descente analogue à celle qui s'exécuta plus tard
sur les côtes d'Afrique. Cinq bateaux plats chargés de troupes et de pièces
d'artillerie s'appro, chèrent de la côte. Les troupes sautèrent à terre,
l'artillerie fut débarquée et commença sur-le-champ à faire feu ; les troupes
se dispersèrent en tirailleurs, vinrent se réformer derrière des
retranchements simulés tout en continuant un feu de mousqueterie vif et
soutenu. Cet appareil servit d’exercice aux troupes et de fêtes à cette
population méridionale, si amoureuse de mouvement et d'émotion. Le lendemain,
5 mai, les troupes de terre furent passées en revue solennelle sur les glacis
de la place ; plusieurs fois elles y manifestèrent l'ardeur avec laquelle
elles couraient à cette expédition aventureuse. Le 10
mai, M. de Bourmont adressa à tous les corps de l'armée une longue
proclamation, expression assez juste du caractère de son auteur, homme
d'ordre et d'intelligence, mais réservé et ambitieux ; les troupes du reste
n'avaient nul besoin x d'être encouragées, et le jour de l'embarquement était
attendu avec une vive impatience. Il commença le 12 mai. Dès le point du jour
un mouvement extraordinaire avait commencé dans les quartiers habités par les
troupes ; chacun des chefs, quelque subalterne qu'il fût, voulait faire
l'appel et l'inspection des soldats confiés à ses soins. Les détachements
d'un même régiment se réunissaient ensuite, et, le colonel en tête, se
dirigeaient tous ensemble au lieu de rembarquement ; les dépôts qui restaient
à terre conservaient quelques hommes, qui disaient adieu à leurs camarades.
Un grand fond de gaité, une explosion de plaisanteries plus ou moins
spirituelles, de temps en temps quelques serrements de main un peu plus
graves, quelques élans d'une sensibilité vive mais passagère, caractérisaient
ces adieux qui devaient être éternels pour plusieurs d'entre eux. Les troupes
arrivées vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville de Toulon trouvaient amarrés le long
du quai les bateaux qui devaient les prendre ; chaque corps avait son
embarcation désignée, de sorte qu'on n'eut à déplorer ni le plus léger
accident, ni même une apparence de désordre. Les soldats sautaient légèrement
sur les bateaux lesteurs qui sur-le-champ les transportèrent à bord des
bâtiments en rade. Le 2re léger, les 3e, 4e et 37e de ligne quittèrent la
terre ce jour-là même. Vers les 2 heures de l'après-midi, un vent du
nord-ouest assez violent arrêta l'opération qui fut reprise le 15. En même
temps, différents corps de cavalerie cantonnés, dans les villages qui bordent
la rade, s'embarquaient de leur côté. Les bâtiments de transport qui devaient
partir de Marseille recevaient aussi leurs charges. Enfin, le 18 mai, une
dépêche télégraphique de l'amiral Duperré annonça que toute l'armée avec son
matériel était à bord, que l'homme avait fini sa tâche, et que le reste
devait être l'ouvrage du vent et de la mer. Ce même jour on publia sur tous les
vaisseaux de la flotte l'ordre du jour suivant : « Officiers,
sous-officiers et marins, appelés avec vos frères d'armes de l'armée
expéditionnaire à prendre part aux chances d'une entreprise que l'honneur et
l'humanité commandent, vous devez aussi en partager la gloire ; c'est de nos
efforts communs, de notre parfaite union, que le Roi et la France attendent
la réparation de l'insulte faite au pavillon français ; recueillons les
souvenirs qu'en pareille circonstance nous ont légué nos pères ; imitons-les
et le succès est assuré : Partons, vive le Roi. » L’armée
expéditionnaire se composait de trois divisions, chaque division de trois
brigades, chaque brigade de deux régiments, excepté la 1re brigade de la 1re
division, qui en contenait trois, en tout 19 régiments. A ces troupes il
fallait joindre : 3 escadrons de cavalerie ; 8 compagnies du génie ; 18 batteries d'artillerie ; 6 compagnies du train d'artillerie ; 100 gendarmes, dont 50 à cheval ; 98 employés aux vivres ; 2 compagnies d'ouvriers d'administration et
d'ambulance. Voici
le tableau de la composition générale de l'armée :
Tout
était prêt pour le départ, et le calme retenait la flotte dans la rade ;
l'impatience des troupes s'accroissait de moment en moment ; du 20 au 25 mai
les jours se passèrent dans des alternatives de crainte et d'espérance ; le
24, le temps fut plus contraire encore, et un fort vent est-sud-est empêchait
tout-à-fait de songer à prendre la mer ; enfin le 25, vers les 2 heures du
soir, après une légère pluie, le vent sauta tout-à-coup à l'ouest et devint
favorable ; à un signal du vaisseau-amiral tous les marins sont à leurs
postes, les manœuvres commencent, les bâtiments se couvrent de leurs voiles,
et se préparent à prendre le large ; onze vaisseaux, dix-neuf frégates,
vingt-une corvettes, quinze bricks, deux bâtiments à vapeur, cinquante-quatre
bâtiments de transport, composant la première division de la flotte,
partirent dans cette soirée du 25. La deuxième division, qui comptait
quatre-vingt-dix1 navires de transport, sous l'escorte du bâtiment de guerre
la Comète, appareilla le 26 au matin. Enfin la troisième division, forte de
cent trente-six transports et deux bâtiments de guerre, le Daphné et la
Cigogne, fut retenue en rade par un retour du vent d'est, et ne put partir
que le 27 vers les trois heures, et déjà une frégate revenant d'Alger avait
annoncé, quelques instants auparavant, qu'elle avait rencontré l'escadre de
l'amiral Duperré, à vingt lieues de Toulon, faisant bonne route pour
l'Afrique. Ce
retard qu'accusait l'impatience des troupes fut, cependant, un accident
heureux pour l'expédition : pendant tout le mois de mai un temps affreux
avait régné sur les côtes d'Afrique et la flotte en eût certainement souffert
de graves avaries si elle se fût trouvée dans ces parages. Un début fâcheux
décourage toujours au commencement d'une campagne, et les bâtiments dispersés
par la tempête, forcés de se réfugier dans différents ports, n'auraient pu
être ralliés qu'avec beaucoup de peine ; l'escadre qui bloquait Alger fut elle-même
contrainte de prendre le large, et deux bricks, le Silène et l'Aventure,
capitaines Bruat et d'Assigny se jetèrent sur la côte, à onze lieues à l'est
d'Alger, auprès du cap Bingut ; cette nouvelle empoisonna la joie qu'avait
causée à la France l'heureux départ de la flotte. On était dans les plus
grandes inquiétudes sur les équipages des deux bricks, livrés à des peuplades
fanatiques, chez lesquelles nous allions porter la guerre ; une foule de
bruits remplaçaient les rapports officiels qui manquaient ; on annonçait la
perte de plusieurs autres bâtiments ; on disait que tous les équipages qui
les montaient avaient été massacrés ; enfin une lettre de l'amiral Duperré,
datée le 2 juin, des environs de Mayorque, vint dévoiler de tristes
événements, moins tristes cependant que l'incertitude où l'on était plongé ;
elle contenait un rapport de M. d'Assigny, écrit du bagne d'Alger, où cet
officier se trouvait prisonnier depuis le 21 mai : il commençait ainsi : « Monseigneur,
j'ai l'honneur de vous rendre compte de la perte des bricks l'Aventure et le
Sylène, événement funeste, dans lequel la fortune s'est plu à nous accabler
de toutes ses rigueurs ; naufrage de nuit par un temps affreux, Il sur une
terre ennemie, peuplée d'hommes féroces que craignent même les Turcs, qui ne
traversent qu'en tremblant leurs sauvages des meures. » Il annonçait
ensuite que l'Aventure navigant de conserve avec la Bellone, en avait été
séparée par un gros temps, au milieu de la nuit et de la brune ; que le
lendemain ayant aperçu le Sylène, brick de guerre français, elle s'en était
approché autant qu'elle pouvait le faire, et que les deux commandants s'étant
mutuellement fait part de leur point, avec le porte-voix, la malheureuse consonnance
de mots est et ouest leur avait fait penser qu'ils étaient d'accord : ils
étaient à l'est du méridien d'Alger, ils se crurent à l'ouest. Ils couraient
donc en toute sécurité pour rejoindre ce méridien qu'ils avaient dépassé
quand l'Aventure, qui marchait en tête, ressentit tout-à-coup une secousse
vers les 8 heures et demie du soir du 16 mai. Le navire venait de franchir
l'acore d'un banc de sable. La vague en déferlant l'abandonna tout-a-coup sur
la rive, et tous les efforts pour le remettre à flot furent inutiles ; le
Sylène, averti trop tard, avait éprouvé le même sort ; les officiers des deux
bricks, réunis sur cette plage inhospitalière, tinrent conseil. Il fut
question de se retrancher sur le rivage de la mer et d'attendre que d'autres
bâtiments de la croisière vinssent leur porter secours ; mais les poudres
étaient mouillées, il parut impossible de résister aux indigènes ; les deux
équipages se munirent de quelques vivres et marchèrent vers Alger, en suivant
la grève : ici, nous laisserons parler M. d'Assigny lui-même. « Il
était environ quatre heures du matin ; à peine avions-nous parcouru un quart
de lieue qu'une troupe de Bédouins armés vint fondre sur nous. Parmi les
hommes qui formaient l'équipage du Sylène, se trouvait un Maltais pris devant
Oran, par ce brick, dans un bateau de pêche. Cet homme sachant l'arabe, et
ayant longtemps navigué avec des hommes de la Régence, se dévoua pour ainsi
dire au salut de tous. Nous recommandant de ne point contredire ce qu'il
allait avancer, il protesta à ces barbares furieux que nous étions anglais.
Par trois fois on lui mit le poignard sur la gorge, pour tâcher de l'effrayer
et de juger, par son émotion, si ce qu'il avançait était vrai ; sa fermeté en
imposa aux Arabes, et, bien qu'ils ne fussent pas entièrement convaincus, elle
jeta un doute en leur esprit, qui contribua en partie à sauver les équipages.
» M.
d'Assigny raconte ensuite que sous prétexte de les faire arriver plus
promptement à Alger, les Arabes les conduisirent dans les montagnes, les
pillèrent, les dispersèrent ; puis il ajoute : « Ici
l'histoire de nos malheurs se complique, chaque village, chaque maison
présente des scènes différentes, mais comme je craindrais de vous fatiguer
par tant d'images douloureuses, je vais me borner à vous rendre compte de ce
qui se passa sous mes yeux. Arrivés chez un bédouin qui nous avait pris sous
sa protection, les femmes se refusèrent à nous recevoir ; nous fûmes rebutés
encore par elles dans une autre case, puis elles finirent par s'attendrir sur
notre sort, et la première maison dont nous avions d'abord été repoussés,
devint notre asile. On nous alluma du feu, on nous donna à manger, et deux
jours se passèrent-sans trouble. Le premier sujet d'inquiétude nous fut donné
par quelques marins qui s'échappèrent des maisons voisines et coururent la
campagne dans l'espoir de se sauver ; ils furent arrêtés peu après, mais les
Bédouins nous observèrent davantage, nous soupçonnant tous d'avoir les mêmes
intentions. Le 18, vers le soir, les frégates de la division et quelques
bricks s'étant approchés des navires échoués, envoyèrent des embarcations
pour les reconnaître. Ces dispositions de débarquement jetèrent la terreur de
toutes parts ; tous les Arabes s'armèrent et descendirent les montagnes en
hurlant ; les femmes mirent leurs enfants sur leur dos, prêtes à fuir ; nous
autres malheureux prisonniers, on nous enferma dans les cases les plus
fortes, nous menaçant de mort, au moindre mouvement que nous ferions pour
tâcher de nous sauver. Nous étions au moment d'être égorgés ; un coup de
canon que nous entendîmes nous parut à tous le signal du massacre, car de
quelque côté que tournât la fortune, les Bédouins, vainqueurs ou vaincus,
devaient nous immoler à leur fureur. Heureusement, la chance tourna plus
favorablement qu'on ne devait l'espérer ; la frégate rappela ses embarcations
et tout rentra pour nous dans l'ordre accoutumé. » Mais le reste des
prisonniers n'en fut pas quitte à si bon marché. Les Arabes exaspérés par les
démonstrations de la frégate française égorgèrent plusieurs des marins de M.
Bruat ; enfin arrivèrent des officiers du Dey chargés de réclamer les
prisonniers ; dès lors, ils furent mieux traités et on les achemina sur
Alger. « Pendant
la route, ajoute M. d'Assigny, un Turc qui parlait français, nous dit que
nous étions bien heureux d'avoir échappé au massacre, que déjà vingt têtes
avaient été portées à Alger, qu'on parlait d'un plus grand nombre encore. Ces
nouvelles nous navrèrent le cœur et furent, pendant toute cette triste
marche, le sujet de nos douloureux entretiens. Nous passâmes la nuit au cap
Matifoux ; le lendemain, environ à quatre heures du soir, nous entrâmes à
Alger, escortés de soldats turcs et suivis d'une populace nombreuse. On nous
conduisit devant le palais du Dey, où le spectacle affreux de nos malheurs
vint frapper nos yeux dans toute son horrible vérité ; les têtes de nos
camarades y étaient exposées aux yeux d'une populace effrénée ; plusieurs de
nous ne purent supporter ce spectacle de douleur et tombèrent évanouis ;
après dix minutes de pause, on nous conduisit au bagne, où nous trouvâmes
douze des nôtres, qui, réunis à 74 que j'accompagnais, sont jusqu'à présent
les seuls débris que j'aie pu réunir de cet affreux naufrage ; quelque
horribles qu'en soient les suites, nous devons encore bénir la providence de
nous avoir permis d'en recueillir autant de débris, car, jusqu'à présent, les
équipages dont les bâtiments périrent sur ces côtes ont presque tous été
entièrement massacrés ; un navire même de la Régence n'y éprouverait pas un
sort moins funeste. » Ces
détails répandirent une teinte de gravité et de tristesse dans l'armée, sans
rien diminuer de de son ardeur. Chacun mit un surcroît de vigilance, s'il
était possible dans l'accomplissement de ses devoirs, sentant que, du succès
de l'expédition, dépendait un nouveau résultat, la délivrance de Français et
de compagnons gémissant dans un dur esclavage. Nous
avons laissé l'amiral Duperré à vingt lieues de Toulon, navigant à pleines
voiles au sud-ouest ; si le temps se maintenait favorable, il devait
directement attaquer la côte d'Afrique, pour opérer sur-le-champ le
débarquement. Dans le cas contraire, la baie de Palma dans l'île de Mayorque
était désignée comme rendez-vous général de la flotte. La division marchait
ralliée et en bon ordre, quand dans la nuit du 27 mai, elle fut assaillie par
un violent coup de vent est-sud-est, à la hauteur des îles Baléares. Elle
chercha un abri sous le vent de ces îles, se rallia de nouveau et reprit la
route d'Alger ; le 29 mai elle était en vue de la terre ; le temps était
beau, quoiqu'un vent un peu fort soufflât de l'est. L'amiral manœuvra pendant
la nuit, pour se trouver le lendemain au lieu de débarquement derrière le cap
Caxine, à l'ouest d'Alger. Ces mesures étaient bien prises ; mais le temps
changea dans la nuit. Le matin, vers les quatre heures, la côte parut
enveloppée d'un épais brouillard, l'horizon était chargé, la force du vent
augmentait graduellement, Un débarquement semblait impossible ; l'amiral prit
sur-le-champ son parti. Il ordonna de gouverner sur Palma pour y réunir de
nouveau toutes les parties de la flotte, et attendre que le temps fût remis
au beau, d'une manière un peu stable : cette mesure était sage. La troisième
division partie le 27 de Toulon, saluée à la sortie de la rade par un violent
coup de vent du nord-est, en avait été dispersée ; rassemblée de nouveau à
Palma, elle y retrouva la première division. Enfin, dans l'espace de huit
jours l'amiral parvint à rallier dans la baie de Palma les bâtiments de la
réserve, les trois divisions du convoi, et surtout la plus grande partie de
la flottille qui portait les dix jours de vivres nécessaires au débarquement.
Il repartit le 10 juin pour Alger, par un vent favorable, et le 12, à la
pointe du jour, on n'était plus qu'à trois ou quatre lieues de la côte. La
flotte venait d'être ralliée par la Sylène, frégate attachée au blocus,
montée par officier qui en commandait l'escadre, M. de Rosamel. Mais la
fortune et la mer voulaient encore nous faire acheter nos succès ; la force
toujours croissante du vent et l'agitation des flots firent craindre que le
débarquement ne pût s'effectuer facilement, dans un mouillage très resserré,
sur une côte à peu près inconnue, en face d'un ennemi préparé à nous
recevoir. Déjà la flotte avait fait quelques avaries heureusement peu
considérables ; mais pour la tenir bien ralliée, il fallut reprendre le
large, et l'on s'éloigna encore une fois de ce rivage tant désiré ; vers la
soirée le vent tomba, la mer s'embellit, l'amiral s'estimait à 40 milles de
l'Afrique ; la flotte vira de bord et manœuvra pour se trouver le lendemain à
la pointe du jour à 12 milles de la côte. Enfin
le 13, le soleil en se levant découvrit à l'armée les montagnes de cette
terre, que nous ne devions plus perdre de vue. Bientôt tous les regards
dirigés vers la côte distinguèrent la ville, ses remparts et ses forts. M.
Duperré se mit en communication avec l'escadre du blocus et en prit avec lui
trois ou quatre bâtiments, pour l'aider dans le combat qu'il croyait
imminent. La flotte ainsi renforcée se forme rapidement en ordre de bataille
; la frégate la Sylène qu'avait quittée M. de Rosamel, pour prendre poste sur
le Trident, s'avance en tête, commandée par M. Massieu de Clerval ; elle
marche à petites voiles pour que les bâtiments qui la suivent puissent bien
conserver leurs postes ; la réserve, le convoi et la flottille naviguent dans
les eaux des bâtiments de guerre ; à six heures du matin, toute la
flotte défile devant les forts et les batteries de la ville, deux bâtiments
légers sont détachés pour aller rapidement reconnaître le lieu choisi depuis
longtemps pour le débarquement. C'était une petite presqu'île située à sept
lieues à l'ouest d'Alger, connue sous le nom de Sidy-Ferruch, ou de
Torre-Chica (petite tour)
; le reste de l'armée accompagne de loin les navires envoyés en éclaireurs.
Arrivé par le travers de la presqu'île, l'amiral s'étonne de n'y apercevoir
aucun être vivant ; cependant deux navires restent en face pour la canonner
directement en cas de besoin ; les autres bâtiments rasent l'extrémité des
rochers, gagnent la rade de l'ouest, à l'abri de la brise régnante. Chaque
commandant de navire avait un plan des lieux où était marqué le point qu'il
devait occuper lors du débarquement. Le Breslaw fut le premier à son poste ;
il jette l'ancre, serre ses voiles, s'embosse avec rapidité : il est prêt à
faire feu ; chaque navire exécute la même manœuvre, l'amiral ordonne de
mettre les bateaux plats à la mer pour enlever de vive force la batterie qui
défendait la presqu'île ; mais aucun défenseur ne se montre, le rivage était
abandonné, la tour qui donne son nom à la presqu'île s'élevait solitaire et
déserte ; quatre ou cinq masures, à moitié ruinées, s'appuyaient sur ses
murailles ; un peu plus loin on voyait un de ces petits monuments si communs
en Algérie, et que nous avons décorés du nom de marabouts. Dans l'éloignement,
sur les hauteurs, on découvrait quelques tentes d'Arabes éparses çà et là.
Des cavaliers, courant à bride abattue, traversait rapidement la plaine ;
quelques-uns mêmes s'avancèrent jusqu'auprès de la tour, paraissant n'avoir
d'autre but que de satisfaire leur curiosité. Tout-à-coup, un coup de canon,
parti des hauteurs voisines, vient déceler la présence de l'ennemi ;
plusieurs bombes et boulets tombent au milieu de nos vaisseaux, sans causer
de perte ; cependant un matelot à bord du Breslaw fut blessé d'un éclat de
bombe, ce fut le seul accident de la journée ; la position de l'ennemi était
trop éloignée et trop élevée, ses coups étaient trop peu dangereux pour que
l'amiral jugeât qu'il valût la peine d'y riposter sérieusement ; un seul
bateau à vapeur, rangeant le rivage le plus près possible, envoya quelques
boulets à terre et fit ainsi évacuer la batterie ennemie la plus rapprochée
et dégoûta les cavaliers arabes de leurs promenades. On s'occupa surtout des
préparatifs du débarquement qui fut remis au lendemain, à la pointe du jour.
A huit heures du soir les trois escadres, la première division du convoi, la
flottille portant les premiers vivres avaient jeté l'ancre. Les bâtiments de
la croisière, les bateaux à vapeur restèrent sous voiles, pour veiller à la
sûreté de tous et repousser les brûlots que l'ennemi pourrait lancer contre
la flotte. On put
juger dans cette première journée combien le point de débarquement était bien
choisi. Du fond d'une anse à grande courbure s'avance dans la mer la
presqu'île de Sidy Ferruch, d'une longueur de cent mètres, et dont l'isthme
n'en a guère qu'une soixantaine de large. La presqu'île forme deux baies,
l'une à droite, l'autre à gauche, de sorte qu'excepté par les vents de
nord-ouest, une des deux au moins offre un mouillage assez sûr. Le terrain en
avant ne présente que de faibles ondulations. Il n'est encombré que de
broussailles peu épaisses et peu élevées, incapables d'arrêter le
développement d'une armée, et pour comble de bonheur l'ennemi abandonnait les
défenses que la main de l'homme avait rassemblées sur ce point. Qu'on se
figure l'impatience de l'armée, fatiguée de vingt jours de navigation, qui
voyait enfin devant elle, à quelques brasses, cette plage que ses pensées et
ses désirs appelaient depuis si longtemps ; peu de soldats, sans doute,
fermèrent l'œil cette dernière nuit passée à bord ; on ne pensait plus aux
fatigues passées, encore moins à celles à venir ; la plus grande difficulté
pour les chefs n'était pas d'encourager leurs hommes, mais de les retenir ;
cependant le débarquement se fit avec ordre. A quatre heures du matin les
bateaux plats, remorqués par des embarcations, et portant chacun un officier
et cent vingt hommes, étaient rangés le long de la côte ; les bâtiments de
guerre qui n'avaient pas de troupes à débarquer avaient été se poster dans la
rade de l'est, aussi près que possible de terre, pour prendre d'écharpe les
batteries ennemies et les battre par-dessus la presqu'île ; deux bateaux à
vapeur à l'ancre dans la rade de l'ouest, à côté du point de débarquement le
couvraient directement de leurs feux ; à un signal, les marins sautent à
terre ; deux matelots courent à la tour, et arborent le pavillon français sur
cette terre d'Afrique, qu'il ne devait plus quitter. Les soldats suivent les
marins. En un instant, six mille hommes, huit pièces d'artillerie sont sur la
plage ; alors seulement les batteries ennemies situées sur les hauteurs
ouvrent un feu soutenu sur les Français ; les navires embossés leur répondent
vivement, mais sans grand effet de part et d'autre. On continue le
débarquement sans s'en inquiéter : le général en chef met le pied sur
l'Afrique à six heures et demie, et, jugeant tout de suite qu'il y avait
assez de troupes débarquées pour essayer un mouvement offensif, il fit cesser
une canonnade inutile, et se mettant à la tête des troupes qui venaient de se
former ; il s'avança le long de la mer pour tourner les positions ennemies :
le succès ne fut pas long à se décider. On repoussa quelques masses de
cavalerie arabe qui voulaient les défendre ; les canonniers turcs s'enfuirent
ou furent tués sur leurs pièces. Un voltigeur attaqua seul une batterie
occupée par plusieurs Arabes ; il allait succomber, quand il fut secouru ; il
fut mis à l'ordre du jour et nommé caporal sur le champ de bataille. Mais,
malgré la prise de leurs batteries, les Musulmans embusqués dans les
broussailles qui couronnaient les hauteurs, et qui devenaient plus hautes et
plus fourrées à mesure qu'on s'éloignait de la mer, n'en continuaient pas
moins un feu de mousqueterie très vif et assez meurtrier ; des cavaliers
arrivaient au galop jusqu'à quelques pas des rangs, faisaient feu sans
s'arrêter, et couraient recharger leurs fusils hors de portée. Cette
manœuvre, peu décisive dans une bataille, et qui fut leur constante tactique,
inquiétait les troupes et ne leur laissait pas un moment de repos ; on nuit
pourtant par les chasser des positions avantageuses qu'ils occupaient. Avant
midi toutes les hauteurs, rangées en amphithéâtre autour de la presqu'île,
étaient au pouvoir des Français. Nous occupions un demi-cercle de deux lieues
de rayon, dont le centre était marqué par le point de débarquement ; il put
alors se continuer sans danger et sans difficulté. Quelques instants après,
l'infanterie entière était débarquée avec des vivres et des
approvisionnements pour dix jours. Le quartier général fut établi dans cette
tour, qui, la première, eut l'honneur de porter le drapeau français. Cette
première affaire nous avait coûté trente-deux morts ou blessés. Un officier
était parmi ces derniers ; c'était assurément bien peu pour un pareil
résultat. La perte des Arabes ne put s'évaluer : on sait qu'ils ont
l'habitude d'enlever leurs morts du champ de bataille ; mais elle dut être
assez faible ; parce que se dispersant sur un grand espace, ils offraient
moins de priée à nos coups. On ne put non plus former que des conjectures
très incertaines sur le nombre des ennemis qui avaient pris part à l'action. Telle
fut cette journée du 14, qui décida du sort d'Alger ; il devint alors évident
que les cinq ou six mille Turcs qui dominaient la Régence, soutenus de la
Cavalerie indisciplinée des Arabes sur lesquels ils n'avaient qu'une autorité
précaire, ne sauraient tenir longtemps contre une armée de trente mille
hommes, parfaitement organisée, munie de tout le matériel utile à un siège
soutenue d'une flotte maîtresse da la mer, qui lui apportait les vivres et
les renforts nécessaires. La nuit suivante, la côte offrait un spectacle réellement
magique ; l'amphithéâtre des hauteurs entourant la presqu'île et la flotte,
étincelant des feux de nos bivouacs, ces lueurs se reflétant dans la mer,
éclairaient les bâtiments en rade, et, avertissant la flotte que l'armée
veillait pour le salut commun, semblaient un lien d'amitié et de fraternité
entre les soldats et les marins. C'est
encore une énigme aujourd'hui de savoir comment le Dey, qui ne manquait ni
d'intelligence ni de fermeté, ait pu laisser opérer avec si peu de résistance
un débarquement qui devait avoir pour lui des suites si funestes : on a dit
qu'il voulait profiter des dépouilles des Français, qu'il se croyait sûr de
vaincre et que c'était dans cette espérance qu'il les avait laissés descendre
à terre. L'offensive que prit son armée deux ou trois jours plus tard, et qui
amena la bataille de Staouëli, semblerait confirmer cette supposition ; s'il
en était ainsi, il connaissait bien peu l'ennemi auquel il avait à faire. Le
commandant en chef employa les jours suivants à se fortifier dans la position
qu'il venait de conquérir. Le général Valazé, commandant le génie, traça un
retranchement bastionné, qu'on garnit d'artillerie, qui couvrait la
presqu'île du côté de la terre, et en faisait une place d'armes capable de
résister à des ennemis plus habiles que les Arabes ; derrière ces remparts
improvisés, nos provisions et notre matériel se trouvaient en sûreté, et l'on
s'occupa de mettre un peu d'ordre dans tous les objets épars qui couvraient
le sol. La marine, de son côté, étudiait les côtes, l'ancrage, et trouvait
que la rade offrait un abri plus sûr qu'elle n'avait osé l'espérer. Cette
pointe de terre devenait comme par enchantement, un camp, un port, un
arsenal, on pouvait dire presque une ville. Il s'y formait des hôpitaux, des
cafés, des restaurateurs ; ici, un parc d'artillerie, là, des magasins ; plus
loin des boulangeries, des écuries, jusqu'à des ateliers de peinture ; car
des artistes s'étaient joints à l'armée pour que Paris pût jouir bientôt des
points de Tue du pays que tous allions conquérir ; et, le lendemain de leur
arrivée, ils s'étaient mis à l'ouvrage au bruit du canon, et presque sous les
balles ennemies. Il semblait que à France, avec ses arts, sa civilisation,
son activité fût débarquée tout entière en Afrique. Voici
comment un témoin oculaire rend compte de ces impressions pendant les
quelques jours de repos qui suivirent la bataille du 14 : « Les deux
premières divisions occupent maintenant une belle position, à une lieue en
avant de Torre-Chica. Un Ruisseau tombe dans la mer à notre droite, et nous
fournit de l'eau en abondance. Sur le premier plan, devant nous, les Bédouins
occupent les hauteurs et dans le lointain l'Atlas montre ses cimes découpées
que les brouillards nous cachent souvent : ce ruisseau a été l'occasion de
bien des combats de tirailleurs entre nos avant-postes et les cavaliers
arabes. On les voit s'approcher en désordre ; de longs manteaux blancs
tombent de leurs têtes et leur recouvrent tout le corps ; quelques chefs
Turcs se montrent parmi eux et semblent les exciter au combat ; on porte
devant eux des cymbales et des drapeaux, mais quand un obus bien pointé tombe
au milieu d'eux, c'est une scène vraiment comique que de voir leur désordre,
leur agitation, et la terreur que leur inspire le redoutable canon à deux
coups. « Au
moment où je vous écris, toute la ligne est sous les armes pour l'appel du
soir. La musique joue devant le front des régiments ; la brise emporte vers
le désert la Tyrolienne de Guillaume Tell et les belles marches de Moïse.
Notre imagination nous montre le Berbère étonné, s'arrêtant sur son cheval
pour écouter ces sons inaccoutumés : tout est calme sur les hauteurs ; devant
nous sont les collines où sifflaient les balles et où plusieurs de nos
compagnons ont laissé leur vie. Derrière, le soleil s'abaisse lentement dans
un horizon rougeâtre et semble se jouer dans les mâts de notre flotte
doucement balancée sur les flots : à travers les vapeurs du soir nous
distinguons les têtes blanches des tentes et les lignes des travailleurs de
la presqu'île. » Une journée de mauvais temps vint déranger encore nos
opérations ; le 16 juin, la mer devint monstrueuse, des navires perdirent
leur gouvernail, qu'on recueillit au milieu des ondes ; heureusement cette
tempête fut courte ; une fois passée, l'amiral sentit le danger de cette
foule de bâtiments entassés les uns sur les autres. Les navires déchargés et
les bâtiments-écuries débarrassés de leurs chevaux, firent voile pour Toulon
: ils devaient rapporter des provisions et de l'eau dont nos marins
commençaient à manquer : en attendant, le débarquement continuait toujours ;
le lendemain 17, il y eut encore un orage. Dans la soirée le temps se
remettait au beau ; l'été fut très lent cette année à s'établir dans ces
parages. Maitresse
d'une bonne base d'opération, l'armée avait devant elle les pentes occidentales
d'un système général de hauteurs dont les revers opposés soutiennent la ville
d'Alger. L'ensemble de ces coltines forme un quadrilatère irrégulier, dont
les diagonales d'une longueur de dix ou douze lieues courent sensiblement du
nord au sud de l'est à l'ouest, du cap Caxine à Bouffarlck, et de
l'embouchure de l'Atateh à celle du Massafran ; deux des côtés en sont
bornés par la mer ; les deux autres par une plaine marécageuse nommée la
Métidjah, presque au niveau de la mer, dont elle semble n'être que le
prolongement ; ainsi le Massif d'Alger, en arabe le Sahel, forme une espèce
d'île entièrement isolée du continent ; sa partie sud n'offre que des
accidents peu prononcés mêlés de plateaux et de vallées presque entièrement
planes. Il se relève au contraire brusquement à l'extrémité du nord pour
former le Boudjaréa, le point culminant de tout le système, et qui domine la
mer d'une hauteur de quatre à cinq cents mètres : les flânes en sont déchirés
par des ravins raides et profonds, garnis d'arbres et de buissons d'une
végétation Vigoureuse : l'armée française débarquant à l'ouest de Boudjaréa
devait donc le tourner pour atteindre Alger, en traversant le plateau qui lui
sert de base du côté du sud, et qui s'abaissait doucement à l'ouest. A cinq
lieues de la mer, la campagne se dépouille tout-à-coup et ne nourrit plus,
pendant une heure de marche, que des palmiers nains qui cachent une terre
fertile, probablement bien cultivée dans un temps plus heureux ; après cet
espace découvert, on arrive aux environs d'Alger, proprement dits, formés de
champs semés en céréales, de jardins ceints de murs, de maisons de campagne
dont l'éclatante blancheur tranche sur la sombre verdure du sol ; on peut
maintenant avoir une idée et du chemin qu'avait à parcourir l'armée
française, et des obstacles qu'elle devait rencontrer sur la route. Notre
avant-garde, couverte par des retranchements de campagne, souffrait peu de
ces petits engagements qui rappelaient que nous étions en pays ennemi ; la
grande armée musulmane s'était contentée de concentrer ses tentes en face des
Français, dans un lieu nommé Staouëli sans faire aucun mouvement depuis la
journée du 14. Cependant elle avait reçu des renforts ; les Beys de
Constantine, d'Oran et de Tittery étaient arrivés au camp et s'étaient mis
sous les ordres du Bach-Aga-d'Alger : Celui-ci commandait personnellement
cinq ou six mille Turcs : l'ensemble de ces forces pouvait monter de 40.000 à
50.000 hommes d'après les renseignements recueillis plus tard près des
consuls européens ; comprenant peu les raisons de prudence et de stratégie
qui renfermaient les Français dans leur camp, jusqu'à ce que le matériel de
siège et tous les moyens d'attaque leur fussent arrivés, ils établirent des
batteries entre leurs positions et les nôtres pour attaquer un ennemi qui
semblait les redouter ; le 19 à la pointe du jour, toute l'armée algérienne
s'ébranla, s'avançant d'après la tactique invariablement suivie par les
Arabes, sur un front très étendu pour envelopper l'armée française ;
l'attaque se fit sur tous les points à la fois ; mais ce fut, la milice
turque opposée aux brigades Clouet et Achard qui montra le plus de résolution
; leurs hommes à cheval fondirent sur les. lignes françaises, et plusieurs
pénétrèrent rapidement jusqu'au milieu de nos retranchements ; presque tous y
trouvèrent la mort ; l'un d'eux vint planter un drapeau algérien jusques sur
le revêtement d'une batterie, et fut tué d'un coup de sabre par l'officier
d'artillerie qui la commandait ; l'engagement fut vif mais très court ; les
Turcs, reçus à la baïonnette, furent repoussés ; le point où ils avaient
donné, devait évidemment décider de la journée ; aussi le général Clouet
reprit-il bientôt l'offensive ; les généraux Achard et de Morvan s'avancèrent
pour le soutenir. Le succès des Français n'avait pas été moindre sur le reste
de la ligne ; une partie des divisions Berthezène et Loverdo, qui se trouvait
en face des contingents d'Oran et de Constantine, avait laissé sans brûler
une amorce, l'ennemi s'avancer jusqu'au fond du ravin qui couvrait le front
des retranchements, puis l'avait brusquement chargé à la baïonnette ; les
Musulmans avaient évacué bien vite le terrain, en le laissant couvert de
cadavres ; voyant l'ardeur des troupes électrisées par ces premiers succès,
M. de Bourmont donna l'ordre de marcher en avant, à l'attaque des batteries
et du camp des Algériens ; toute l'année pouvait alors exécuter à la fois les
ordres du général en chef. Seulement trois régiments de la division d'Escars
formèrent la réserve générale de l'armée. La distance qui nous séparait du
camp ennemi fut franchie avec une rapidité extraordinaire ; l'artillerie
nouveau modèle, qu'on essayait la première fois sur un champ de bataille, fut
constamment la première en ligne, malgré la difficulté du terrain ; elle prit
dès lors sur les Arabes cet ascendant de terreur qu'elle n'a plus perdu
depuis. L'ennemi ne mit pas dans sa défense le courage qu'il avait montré
dans l'attaque ; les batteries construites en avant de ses positions furent
abandonnées après une canonnade qui n'arrêta pas un instant l'élan de nos
troupes ; le 20rae de ligne s'empara des huit pièces de bronze qui les
armaient ; dès lors, ce ne fut plus qu'une déroute ; en un instant nos
soldats enlevèrent le camp ennemi composé de 400 tentes toutes dressées.
Celles des Beys de Tittery et de Constantine étaient magnifiques. Nous y
trouvâmes des magasins de vivres et des approvisionnements de toute espèce en
armes, bagages, poudres et projectiles. Plusieurs troupeaux de moutons, des
chameaux firent partie du butin. L'étendard du chef de la cavalerie algérienne
fut pris et rapporté au quartier-général par un voltigeur français, qui
l'avait enlevé à l'officier turc qui le portait, après un combat corps à
corps ; la perte de la milice turque fut considérable, mais on ne put
l'apprécier d'une manière un peu fixe, qu'après la prise d'Alger, lorsque nos
ennemis devenus nos sujets nous racontèrent tous les épisodes de la guerre.
Quelques bâtiments de la flatte, à l'ancre dans la rade à l'est de la
presqu'île, avaient soutenu de leurs feux le commencement de l'action ; la
prompte retraite de l'ennemi les rendit bientôt inutiles. La
journée du 19 porta un coup mortel à la puissance du Dey ; le soir même
plusieurs Arabes vinrent faire leur soumission aux avant-postes français ;
chez les populations impressionnables, une seule bataille avait détruit le
pouvoir moral des Turcs, bien qu'une pareille opinion ne fut pas motivée par
leur perte matérielle. La nôtre se montait à cent et quelques hommes tués et
trois cents blessés, mais la plupart d'une manière peu dangereuse ; plusieurs
rejoignirent leurs drapeaux au bout de quelques jours. L'armée était pleine
de courage, d'espérance et de santé ; le temps s'était enfin remis au beau
fixe, la chaleur était moins vive et moins accablante qu'on ne l'avait
généralement pensé. Tous les objets nouveaux pour nos jeunes soldats leur
offraient un sujet intarissable de gaîté et de plaisanterie. Le camp français
occupait alors remplacement de celui de l'ennemi avant la bataille de
Staouëli. Au
milieu de ces travaux et de ces combats, les marins avaient aussi leur tâche.
Ils continuaient avec activité le débarquement des provisions et du matériel
; vingt jours de vivres pour tous les corps, un millier de chevaux, toute l’artillerie
de campagne nécessaire à l'armée était déjà établie dans la presqu'île ; le
reste du matériel devait arriver dans deux ou trois jours ; les matelots
débarqués à terre sous les ordres du capitaine de vaisseau Hugon, formèrent
la garnison - de notre forteresse improvisée ; ainsi toutes les troupes de
terre restaient disponibles pour marcher en avant et soutenir les nombreux
convois qui devaient établir une communication journalière, entre l'armée
conquérante et sa base d'opération ; des groupes d'Arabes, voltigeant sans
cesse sur les flancs de l'armée, paraissant et disparaissant avec la même
facilité, annonçaient que nous avions affaire à un ennemi redoutable dans une
guerre d'escarmouches, sinon dans une bataille rangée, et que de faibles
escortes pouvaient bien être enlevées et exterminées avant qu'on eût le temps
de les secourir. Pendant que nos troupes de terre gagnaient du terrain,
l'amiral Duperré, qui avait renvoyé en France une grande partie des bâtiments
de transport, dont les vaisseaux de guerre étaient débarrassés des soldats
qui les avaient encombrés, se trouvant plus libre dans ses mouvements, avait
établi un blocus rigoureux des ports d'Alger et des autres villes de la
Régence, et des bâtiments bons voiliers, constamment en croisière sur ces
côtes, l'instruisaient de tous les événements qui pouvaient y survenir. Après
le combat du 19, l'ennemi ne montra plus que quelques détachements épars :
beaucoup d'Arabes s'étaient éloignés ; ceux qui paraissaient encore
semblaient faire la guerre pour leur propre compte. Cependant- plusieurs de
ces combattants indisciplinés montrèrent une énergie ardente et désespérée.
On demandait à l'un de leurs blessés tombés entre nos mains, et qui
trouvaient chez nous les mêmes soins que nos soldats, ce qu'il ferait si on
lui rendait la liberté ? « J'irai vous combattre, » répondit-il sans
hésiter. On lui fit observer avec quels égards on le traitait, tandis que les
siens avaient égorgé tous les prisonniers français qu'ils avaient pu faire : « Que
n'en faites-vous autant, » dit-il, en découvrant sa poitrine. Ce qui
avait éloigné les Turcs du théâtre de la guerre, après la bataille de
Staouëli, était une vive fermentation qui régnait dans Alger et qui leur
faisait craindre une révolte de la part des Maures. Ceux-ci venaient
tout-à-coup de s'apercevoir qu'ils ne souffraient qu'avec répugnance le joug
de leurs maîtres ; si l'armée se fût immédiatement portée en avant, il est
très possible qu'elle eût enlevé la ville par un rapide coup de main ; mais
le général en chef ne voulut pas compromettre l'ascendant moral, que nous
venions de conquérir, par une tentative qui, après tout, pourrait avorter. En
cela il eut raison ; il importait peu d'entrer à Alger quelques jours plus
tard, et il eut été fâcheux que nos succès eussent été interrompus par
quelques revers ; ni les chevaux de l'artillerie de siège, ni ceux de
l'administration n'étaient arrivés. Les bâtiments qui les transportaient
avaient du partir le 15 juin de Palma ; des vents contraires les y avaient
retenus jusqu'au 18, et depuis lors les calmes qui avaient régné presque
constamment ne leur permettaient pas d'arriver en vue des côtes d'Afrique ;
M. de Bourmont les attendait pour continuer la guerre, et commencer les
travaux du siège du fort l’Empereur ; ce retard donna aux Turcs le temps de
respirer : comme avant la journée du 19, ils furent enhardis par cette
prudence inexplicable pour eux ; ils rallièrent un grand nombre d'Arabes, et
le 24, à la pointe ou jour, ils se présentèrent à nos avant-postes ; leur
ligne embrassait un front très étendu et un ordre de combat analogue à celui
qui déjà leur avait si mal réussi à la bataille de Staouëli. Les cavaliers
bédouins, au nombre de plus de douze mille, se précipitèrent sur nos troupes avec
des hurlements épouvantables, mais qui déjà ne les étonnaient plus. D'après
les ordres des chefs, l'armée française s'était formée en carrés, assez
éloignés pour pouvoir manœuvrer avec facilité, assez rapprochés pour se
prêter un mutuel secours et ne pas permettre aux ennemis 4'sp percer la
ligne. Ils vinrent se briser sur le front de nos baïonnettes, luttaient un
instant contre ces murailles de fer, puis remontaient au galop sur les
hauteurs ? en poussant des cris de désespoir. Toutes les dispositions étaient
prises pour que le premier choc une fois engagé, l'armée reprît l'offensive
et- gagnât tout de suite deux ou trois lieues de terrain. En effet, la
division Berthezène, une brigade de la division Loverdo, soutenues d'une
batterie de campagne, s'avancèrent en colonne, et traversèrent la plaine
découverte qui s'étendait en avant du camp ; les Musulmans reculaient
successivement et ne trouvèrent un point d'appui que derrière les jardins et
les maisons de campagne, qui forment les environs d'Alger ; même derrière ces
moyens de défense, les Turcs se montrèrent moins terribles que leur
réputation ne les avait dépeints : à peine quelques coups de fusil
partaient-ils d'un point occupé par eux, que nos jeunes conscrits s'y
précipitaient, la baïonnette au bout du fusil, et s'en emparaient
ordinairement de vive force, et sans s'arrêter. Nous
parvînmes ainsi jusqu'à un ravin plus découvert, qui nous séparait encore de
la crête extrême des hauteurs sur lesquelles les Turcs s'arrêtèrent enfin, à
une lieue d'Alger. A partir de ce point culminant, le terrain s'abaisse
rapidement pour se précipiter dans la mer ; l'artillerie française arrive
malgré tous les obstacles, se met en batterie sur les bords du ravin, et ses
projectiles, dirigés avec une grande justesse de tir, labourent la crête
opposée encore occupée par les Turcs ; l'épouvante les glace ; perdant tout à
fait la tête, ils font alors sauter un magasin à poudre établi sur les pentes
de la colline. Une violente détonation, d'immenses colonnes de fumée,
qu'éclairait le soleil d'Afrique, avertirent l'armée de l'acte de désespoir
auquel venait de se livrer l'ennemi ; aucun soldat français ne fut ni tué ni
blessé par cette explosion. Un fait
remarquable dans toute cette guerre, et qui contribua aux succès constants de
nos armes, était le manque total du côté des Turcs, de canons mobiles
analogues à notre artillerie de campagne ; à la bataille du 19, l'ennemi
avait fortifié sa position d'une batterie de gros canons immobiles, -et qui
furent enlevés dès le commencement de l'action ; après ce malheureux essai,
les Turcs ne nous opposèrent plus qu'un feu de mousqueterie qui, bien
qu'assez meurtrier, ne pouvait cependant arrêter longtemps des troupes munies
d'une artillerie admirable, dont les boulets renversaient les murailles, dont
les obus fouillaient les haies et les broussailles à l'abri desquelles
combattait l'ennemi. Aussi rien n'égalait l'effroi que leur inspirait nos
obusiers, dont ils n'avaient pas la moindre idée. Ce fut
dans cette dernière journée que le jeune Amédée de Bourmont, escaladant un
mur de clôture, reçut un coup de feu, qui quelques jours après devint mortel.
Déjà un de ses frères s'était distingué en entrant le premier dans une
batterie ennemie, lors de l'affaire du 19 juin. Ceux même qui trouvaient des
taches dans la vie antérieure du père ne purent que rendre justice au
sentiment d'honneur exalté, qui poussait constamment ces jeunes gens au plus
fort du danger ; M. de Bourmont rendit noblement compte, au président du
conseil, de la blessure de son fils, par ces quelques lignes empreintes d'une
véritable simplicité antique : « Le nombre des hommes mis hors de combat a
été peu considérable ; un seul officier a été blessé dangereusement ; c'est
le second des quatre fils qui m'ont suivi en Afrique. J'espère qu'il vivra
pour continuer de servir avec dévouement le roi et la patrie. » Cette douleur
paternelle, si contenue et si calme, quoique si bien sentie, désarma même les
journaux de l'opposition, qui ménageaient peu M. de Bourmont ; toute la
France s'associa au désespoir du père, qui venait empoisonner les triomphes
du général. Il est consolant de penser qu'au milieu des haines de parti les
plus violentes et quelquefois les plus justes, il est des sentiments qui
trouvent, dans tous les cœurs, du retentissement et un écho. Les
équipages de siège et les chevaux de l'administration, si impatiemment
attendus, étaient enfin arrivés dans la nuit du 24 juin. Ils furent débarqués
sans obstacles dès le lendemain ; bien en prit aux marins de ne pas perdre un
seul moment, car les orages et les coups de vent se succédaient avec une
continuité extraordinaire. La flotte eût pu en éprouver de graves accidents
sans la prudente habileté de son chef ; malgré toutes les précautions
possibles, le 26, le vent étant très fort et la mer monstrueuse, plusieurs vaisseaux
chassèrent sur leurs ancres, brisèrent leurs amarres et firent d'assez fortes
avaries ; l'amiral n'était pas sans inquiétude ; il craignait que la baie ne
devint tout à fait intenable, et que l'armée de terre ne se trouvât privée de
ressources et des vivres qu'elle tirait de France, si la lutte venait à se
prolonger. Mais
enfin, tous les puissants moyens de destruction que l'art moderne a inventés
pour la prise des places, reposaient alors sur la terre d'Afrique, à l'abri
des vents et des flots ; il ne restait plus qu'à les amener en face des murs
à battre, et les voies de communication manquaient entièrement sur cette côte
barbare ; le dévouement de l'armée y suppléa ; le général Valazé traça une
route à laquelle les soldats se mirent à travailler avec ardeur ; dans trois
jours elle fut terminée ; quoique imparfaite par la rapidité de l'exécution,
et d'un tirage difficile à cause des terrains légers et sablonneux qu'elle
traversait, elle suffisait à son but. Elle fut assurée au moyen de blockhaus
et de redoutes armées avec les canons enlevés à l'ennemi ; les pesantes
pièces de siège roulèrent sans obstacles jusqu'à l'extrémité de la ligne
occupée par les Français. Le jour fatal s'approchait pour Alger ; pendant
tous ces travaux, le général en chef, fidèle à son système de temporisation
et de prudence, n'avait fait aucun mouvement ; les Turcs, au contraire,
témoins de ces préparatifs qui annonçaient leur ruine, presque entièrement
abandonnés par les Arabes, qui battaient la campagne par groupes, sans se
réunir nulle part, tentèrent quelques nouveaux efforts pour sauver leur
patrie adoptive ; ils assaillissaient nos positions d'un feu de mousqueterie
assez vif, qui nous mit plus de six cents hommes hors de combat ;
heureusement ces blessures faites de très loin étaient généralement peu
dangereuses. Le 27
juin l'ennemi parvint aussi, à force de peine et de bras, à établir sur le
terrain qu'il occupait encore deux canons de vingt-quatre ; leurs boulets
arrivant jusqu'à nous, nous tuèrent quelques hommes et emportèrent un bras à
M. le commandant Chambaud, officier du génie très distingué. Une plus longue
inaction eût été fâcheuse ; le commandant de l'armée française prépara enfin
un plan d'attaque générale pour le 29 juin. Deux brigades de la division
Berthezène formaient la droite, deux brigades de la division d'Escars la
gauche, deux brigades de la division Loverdo, le centre de l'ordre du combat.
Ce dernier devait se maintenir un peu en arrière des ailes de l'armée ; trois
brigades, dont chacune appartenait à une division différente, étaient
échelonnées sur la route pour maintenir les communications avec la presqu'île
de Sidi-Ferruch. Les Arabes se montraient de temps en temps sur la droite de
cette longue ligne, sans rien entreprendre d'important pour la couper. Le
général d'Escars reçut l'ordre de commencer l'attaque avec ces deux brigades,
et de suivre à peu près la crête d'une suite de hauteurs qui se rattachait à
celle du fort l'Empereur. C'était la position la plus importante de la
journée, et celle où l'ennemi avait concentré la plus grande partie de ses
forces ; les généraux Hurel et Berthier qui commandaient chacun une des deux
brigades, mirent dans l'attaque autant de vigueur et d'impétuosité qu'ils
avaient montré de patience et de sang-froid dans la position défensive qu'ils
venaient de quitter ; culbutés vivement sur ce point, les Musulmans ne
tinrent plus nulle part ; alors, entièrement maîtresses du terrain, les deux
ailes de l'armée française marchèrent de manière à se rapprocher constamment
du centre, afin de concentrer ses forces en avant du château de l'Empereur,
qui allait devenir le tut et le point de mire de toutes nos opérations. Le
général Loverdo qui commandait le centre n'avait qu'à s'avancer en ligne
droite et parvint le premier à moins de quatre cents mètres de la forteresse
; il profita des accidents du terrain pour y loger deux bataillons, derrière
des crêtes qui les abritaient des feux ennemis ; le général d'Escars s'était
lui-même assez rapproché pour que ses troupes pussent facilement fournir des
travailleurs pour l'ouverture de la tranchée ; elle eut lieu dès la nuit
suivante, celle du 29 juin ; le général Valazé avait tracé les premiers
ouvrages à deux cent cinquante mètres des murs à battre. Malgré leurs
fatigues,, les soldats se mirent courageusement à l'œuvre ; dès le 1er
juillet, plusieurs batteries étaient commencées par l'artillerie : pendant la
nuit, temps ordinaire consacré à ces sortes de travaux, l'ennemi tirait peu
et les travailleurs étaient assez tranquilles ; mais dans le jour les Turcs
et les Arabes se glissaient derrière les haies, dans les plis d'un terrain
fortement accidenté, et recommençaient une fusillade meurtrière ; il fallut
établir plusieurs traverses qui mirent enfin nos soldats à l'abri ; l'ennemi,
s'il eût été plus expert dans l'art de la guerre, eût pu rassembler des
troupes, sous le canon de la place, pour exécuter de vigoureuses sorties, et
tomber en force sur les gardes de tranchée ; il n'en fit rien, et dès lors
ses tentatives étaient incapables d'interrompre sérieusement nos efforts. Les
batteries construites et perfectionnées, elles furent armées de vingt-six
bouches à feu, dix pièces de vingt-quatre, six pièces de seize, quatre
mortiers de dix pouces et six obusiers de huit pouces. Tout fut terminé dans
la nuit qui suivit le 3 juillet, et le 4 à 3 heures et demie du matin, une
fusée donna le signal de l'ouverture des feux : les vingt-six bouches enfin
tonnèrent toutes à la fois, et les échos portèrent jusqu'à la flotte qui
croisait devant Alger, l'annonce que l'armée de terre portait les derniers
coups à l'ennemi commun. Pendant
trois heures les Turcs ripostèrent très vivement : mais bientôt nos boulets
ruinèrent les embrasures de la place ; leur élargissement laissait voir les
canonniers turcs, d'abord bravement immobiles à leurs postes, mais
disparaissant successivement, emportés par nos feux supérieurs ; la placé
devenait intenable : toutes les pièces étaient démontées ; à huit heures le
feu du château était complètement éteint ; nos canons continuèrent à ruiner
les crêtes de ses épaisses murailles, nos bombes à en labourer la surface
intérieure., et l'ordre de battre définitivement en brèche fut enfin donné.
On commençait à l'exécuter, quand on vit la garnison sortir du château et
s'acheminer vers la ville, et quelques instants après, vers les dix heures du
matin, une explosion épouvantable vint signaler une nouvelle péripétie dans
ce drame sanglant, et en précipiter le dénouement ; le fort, dernière
espérance d'Alger, venait de sauter ; la terre trembla, de larges jets de
flamme s'élancèrent dans les airs à une hauteur prodigieuse ; d'épaisses
colonnes de fumée les suivirent immédiatement ; elles se déroulèrent et se
répandirent ensuite sur les murs du château, enveloppèrent la colline elle-même
dans une obscurité majestueuse ; des éclats de pierre, des débris de bois et
fer lancés au loin dans toutes les directions, retombaient comme une pluie
sur nos soldats ; heureusement peu en furent atteints d'une manière sérieuse
; une légère brise, déchirant par lambeaux ce rideau noirâtre, l'emporta
lentement vers le sud, et le château de l'Empereur reparut aux yeux des
Français, mais à moitié ruiné et dépouillé de presque toutes ses défenses. Le
général Hurel qui commandait la tranchée ne perdit pas un moment ; à ses
ordres, les soldats s'élancent au pas de course, arrivent au milieu de cette
scène de désolation, se logent dans les décombres encore tout fumants.
Différentes versions circulèrent sur la cause de cette catastrophe ; les uns
l'attribuèrent à un simple accident ; mais il paraît beaucoup plus probable que
le Dey d'Alger, voyant le château abandonné par ses défenseurs, qui se
plaignaient qu'on les sacrifiait inutilement, et perdant tout espoir de le
conserver, avait ordonné lui-même d'en faire sauter le magasin à poudre :
quoi qu'il en soit, un intervalle de repos et de calme suivit cette terrible
explosion. Le général en chef en profita pour se porter en personne dans le
fort qu'il venait de conquérir. Quelques heures après un parlementaire lui
fut annoncé ; c'était le secrétaire du Dey qui venait demander la paix au nom
de son maître, offrant d'indemniser la France de tous les frais de la guerre
; on lui répondit que le temps des transactions était passé, et qu'avant tout
il fallait que la Casbah, les forts et le port d'Alger fussent remis aux
troupes françaises. Ces conditions lui parurent bien dures et tout en se
plaignant de l'obstination d'Hussein, qui avait attiré tant de malheurs sur
sa patrie, il retourna vers la ville en disant que lorsque les Algériens
étaient en guerre avec la France, ils devaient conclure la paix avant de
faire leur prière du soir. L'armée française se trouvait alors directement en
face de la Casbah, dont les canons ouvrirent le feu contre elle ; ce fut le
dernier effort d'un ennemi aux abois. Peu d'instants après, deux Maures, des
plus riches et des plus importants d'Alger, furent envoyés par le Dey, pour
demander la suspension des hostilités, promettant que la Casbah allait cesser
immédiatement de tirer ; l'artillerie se tut en effet de part et d'autre. Les
deux Maures, rassurés par le premier succès de leur démarche, et encouragés
par les marques de bienveillance que leur témoignaient M. de Bourmont et son
état-major, ne dissimulèrent plus l'état de consternation et d'anarchie qui
régnait dans la ville. Tous les habitants, tant Maures que Turcs, n'avaient
plus - qu'un désir, celui de la paix. Ils firent même entendre qu'ils
l'achèteraient volontiers, au prix de la tête de leur souverain : pendant
cette conversation et le repos qui raccompagnait, le général Valazé fit
ouvrir quelques communications en avant du fort de l'Empereur, qui devaient
nous conduire jusqu'aux pieds des murs de la Casbah, dans le cas où elle
voudrait essayer encore une défense ; mais ces préparatifs de guerre - furent
inutiles ; à trois heures le secrétaire du Dey revint accompagné du consul et
du vice-consul d'Angleterre, qui devaient servir d'intermédiaire ; il demanda
que les conditions de la paix fussent mises par écrit, pour qu'il pût les
communiquer plus sûrement à son maître. Le lendemain matin, M. de Bourmont
lui remit la note suivante, qu'il emporta sur-le-champ à la Casbah. Convention entre le Général en
Chef de l'armée française et son Altesse le Dey d'Alger. « Le
fort de la Casbah, tous les autres forts qui dépendent d'Alger, et le port de
cette ville, seront remis aux troupes françaises, ce matin à dix heures
(heures françaises). Le général en chef de l'armée française s'engage, envers
S. A. le Dey d'Alger, à lui laisser la liberté et la possession de ce qui lui
appartient personnellement. Le Dey
sera libre de se retirer avec sa famille et ce qui lui appartient dans le
lieu qu'il fixera ; et tant qu'il restera à Alger, il y sera, lui et toute sa
famille, sous la protection du général en chef de l'armée française ; une
garde garantira la sûreté de sa personne et celle de sa famille, « Le
général en chef assure à tous les soldats de la milice les mêmes avantages et
la même protection. « L'exercice
de la religion mahométane restera libre ; la liberté des habitants de toutes
les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie
ne recevront aucune atteinte ; leurs femmes seront respectées, le général en
chef en prend l'engagement sur l'honneur. « L'échange
de cette convention sera fait avant dix heures, ce matin, et les troupes
françaises entreront aussitôt après dans la Casbah et successivement dans
tous les autres ports de la ville et de la marine. » Au camp
devant Alger, le 5 juillet 1850, SIGNÉ : COMTE DE
BOURMONT. — Ici
le Dey a appliqué son sceau. — Pour
copie conforme : Le
Lieutenant-Général, chef de l'État-Major, SIGNÉ : DESPREZ. Ce
n'est jamais sans regrets qu'on abandonne le pouvoir ; après avoir vainement
demandé un sursis dans l'occupation de sa ville, Hussein finit par s'exécuter
de bonne grâce : à onze heures l'entrée de la Casbah fut livrée aux troupes
françaises, qui occupèrent successivement tous les forts. A midi, le pavillon
de France flottait sur tous les murs de cette cité orgueilleuse, et vengeait
enfin les souffrances endurées par tant de chrétiens. Hussein
désormais simple particulier se retira dans une maison qu'il possédait dans
l'intérieur de la ville. La convention, du 5 juillet devint la base de tous
les rapports qui s'établirent entre les vainqueurs et les vaincus ; les
biens, les personnes des Musulmans furent rigoureusement respectés. Le
souverain, le premier moment d'étourdissement dissipé, protégé par l'épée qui
l'avait renversé du trône, parut heureux du dénouement d'une crise qui
pouvait se terminer d'une manière bien plus fâcheuse pour lui. Bien
que la flotte eût rempli la principale partie de sa mission, en débarquant
l'armée de terre, l'amiral Duperré désirait vivement opérer une diversion
puissante du côté de la mer, mais un calme prolongé l'empêchant de combattre,
il résolut de commencer par une opération dont l'avantage lui était démontré
depuis longtemps. Les bâtiments de transport avaient éprouvé, dans l'étroite
rade de Sidy-Ferruch, plusieurs coups de vent qui n'avaient pas laissé de
leur causer quelques avaries ; les y maintenir plus longtemps était
d'ailleurs inutile, puisque les derniers objets nécessaires à l'armée de
terre allaient être débarqués dans trois jours ; il les réunit donc autour du
pavillon amiral, en face d'Alger, dans la baie beaucoup plus spacieuse qui
baigne les murs de la ville. Seulement pour ne pas laisser sans communication
maritime cette presqu'île, base de nos opérations et centre de nos magasins,
l'amiral forma, sous les ordres du capitaine de vaisseau Ponié, une division
séparée, qu'il établit en croisière devant ce point si important pour nous ;
elle était formée de six navires armés en flûte, qui donnaient la main au
reste de la flotte établie plus à l'est. Ces changements se firent pendant le
calme du 1er juillet, au moyen de bateaux à vapeur, remorquant les bâtiments
à voiles ; d'autres plus légers, n'ayant qu'un faible tirant d'eau, étant par
suite moins en danger de s'échouer, furent laissés autour de la presqu'île
pour aider les transports arrivant de France, et décharger plus rapidement
les vivres et munitions de guerre qu'ils apportaient pour l'armée. Ces
mouvements et d'autres, d'une nature plus belliqueuse, occupèrent plusieurs
jours l'activité de la flotte. Le 5 juillet, dès le matin, elle se prépara
tout entière pour un combat général ; malgré le calme prolongé qui rendait
les moindres mouvements très difficiles, à deux heures après-midi, les
bâtiments de guerre étaient parvenus à se ranger en ordre de bataille ; la
Bellone, montée par M. Legallois, formait l'avant-garde ; puis venait le
pavillon amiral flottant sur la Provence. A deux heures et quart, le signal
fut donné à tous les commandants de laisser arriver, pour défiler devant les
batteries ennemies, en commençant par celles de la pointe Pescade ; un peu
avant d'arriver par leurs travers, l'amiral s'aperçut qu'elles étaient
abandonnées ; bientôt il vit descendre des hauteurs voisines un détachement
de nos troupes de terre qui vint les occuper ; la Bellone mit en mer un canot
chargé d'un drapeau français qui, sans plus tarder, fut arboré sur notre
nouvelle et facile conquête. Ces batteries, en parties désarmées, contenaient
cependant encore dix-huit pièces de canon et leurs approvisionnements. Les
Turcs effrayés par nos rapides succès, tremblant pour la sûreté de la ville
et des forts qui la défendent directement, y avaient concentré tous leurs
moyens de défense. Après
cet incident la flotte continua son mouvement, et quelques instants après la
Bellone se trouvait en face du fort dit des Anglais, à demi-portée de ses
pièces de dix-huit ; elles tonnèrent sur-le-champ contre l'ennemi ; le fort
riposta vivement ; la Bellone, continuant sa marche, canonna la ville et les
autres forts, à mesure qu'elle arrivait à portée. Elle était immédiatement
remplacée par le vaisseau-amiral, suivi lui-même des autres bâtiments, qui
tous exécutèrent une manœuvre analogue : bientôt tous les navires en ligne
combattirent en même temps ; c'était un beau spectacle que ces masses
flottantes mues avec ordre par une seule volonté, s'enveloppant à chaque
bordée d'un immense nuage de feu et de fumée, d'où s'échappaient, au milieu
d'un fracas épouvantable, des centaines de boulets qui semblaient devoir
écraser la ville, et enterrer tous les habitants sous les ruines de leurs
demeures ; cependant cette canonnade fut plus effrayante que dangereuse.
Quand notre flotte eut fini de défiler et que la foule eut été emportée par
la brise, la ville et ses fortifications reparurent sans grand dommage
apparent ; nos vaisseaux eux-mêmes n'avaient éprouvé qu'une perte très faible
et des avaries légères ; seulement un horrible accident, arrivé à bord de la
Provence, vint attrister nos marins ; une pièce de trente-six creva dans la
batterie, tua six hommes et en blessa quatorze, parmi lesquels se trouvait M.
Berard, lieutenant de vaisseau ; c'était la seconde fois depuis deux ans que
ce beau navire voyait se renouveler sur son bord cette sanglante catastrophe.
Le lendemain, quoique contrarié par des vents peu favorables, M. Duperré, ne
voulant pas laisser à l'ennemi le temps de respirer, se préparait à une
nouvelle attaque, quand l'explosion du fort l'Empereur vint reporter toute
son attention du côté de la terre. Nos marins dès qu'ils purent distinguer
quelque chose du milieu de l'horrible confusion qui s'en suivit, aperçurent
le fort en partie détruit, et notre infanterie arrivant au pas de course pour
en prendre possession : comme cependant la ville tirait encore, la flotte
allait recommencer la canonnade, quand un canot parlementaire sortit du port
d'Alger et aborda le vaisseau-amiral ; il avait à son bord l'amiral de la
flotte algérienne, qui venait, au nom du Dey, demander la suspension immédiate
des hostilités pour arriver plus tard à la conclusion de la paix ; on
apercevait en même temps le parlementaire envoyé à M. de Bourmont, se
dirigeant vers les ruines du fort l'Empereur. M. Duperré répondit que les
dispositions de la flotte étaient subordonnées à celles de l'armée de terre,
et que c'était donc auprès du général en chef que devait avoir lieu
l'ouverture des négociations : la soirée et la nuit se passèrent néanmoins
sans hostilités de part et d'autre. Le 5, à la pointe du jour, l'envoyé
revint renouveler ses sollicitations auprès de l'amiral ; celui-ci répondit
au Dey par une note très laconique dont il fit faire une copie pour l'envoyer
à M. de Bourmont ; elle portait en substance que tant que le pavillon de la
Régence flotterait sur les murs d'Alger, cette ville serait par lui
considérée et traitée comme ennemie ; peu après le pavillon algérien disparut
des murs de la Casbah et fut remplacé par le drapeau du vainqueur ; au même
moment nos colonnes d'infanterie descendaient les pentes qui dominent la
ville et en occupaient successivement tous les forts qui s'ombrageaient des
couleurs françaises ; le vaisseau la Provence les salua de 21 coups de canon
et vint immédiatement jeter l'ancre tout à fait sous les murs de la ville que
ses batteries ne menaçaient plus ; l'amiral Rosamel, avec sa division,
continua la croisière à l'entrée de la rade d'Alger ; le capitaine de
vaisseau Ponié resta avec la sienne en travers de celle de Sidi-Ferruch. Le plus
doux fruit de la victoire pour les Français fut la délivrance de leurs
compagnons ; les naufragés du Sylène et de l'Aventure, les premiers marins
qui sautèrent à terre coururent au bagne où ces malheureux prisonniers
étaient renfermés. Il les trouvèrent presque nus ayant beaucoup souffert des
insultes de la populace, mais néanmoins soutenus par leur courage et leurs
espérances ; ils savaient que leur patrie ne les abandonnerait pas ; on n'eut
à regretter aucun des naufragés qui étaient entrés dans cette prison
douloureuse, et l'on se flatta quelque temps que plusieurs de ceux qui
n'avaient pas été conduits à Alger pourraient être encore vivants, retenus
par les tribus de l'intérieur ; mais tous les doutes furent bientôt levés à
cet égard ; lo consul de Sardaigne, dont la bienveillance et la générosité
s'étaient signalées à l'égard de nos prisonniers, avait eu la triste
précaution de compter les têtes envoyées à Alger ; en y ajoutant le nombre de
ceux qui avaient survécu, il retrouva ainsi le total de l'équipage des deux
bricks, et l'on n'eut plus rien à espérer de nos infortunés compatriotes. Si maintenant nous jetons un coup d'œil sur l'ensemble des événements que nous venons de rapporter, nous verrons que nos succès furent l’effet, non d'une suite d'heureux hasards, mais bien des sages combinaisons d'une prudence consommée, servie par une bravoure toujours active et dévouée. En effet le mois de juin, ordinairement si beau et si calme dans cette latitude, y fut presque constamment orageux cette année ; le débarquement fut effectué avec une promptitude extraordinaire, dans un des rares intervalles à peu près calmes, qui séparèrent les tempêtes ; peu de jours après la flotte fut forcée d'abandonner le mouillage de Sidi-Ferruch, par la crainte d'être jetée à la côte, et lorsqu'il lui fallait du vent pour porter ses canons en face des batteries ennemies, un calme désespérant vint souvent paralyser ses efforts ; l'armée de terre, de son côté, après avoir enduré patiemment les ennuis d'une navigation plus longue qu'on ne devait le croire, jetée sur la côte avant qu'on pût la fournir de tout le matériel nécessaire, parvint à suppléer à ce qui lui manquait par son courage et sa patience ; on a - voulu reprocher à M. de Bourmont de l'hésitation et un excès de prudence ; c'est le propre du caractère français de vouloir tout emporter d'emblée, et cette malheureuse précipitation nous a fait perdre bien des batailles. Le général en chef suivit une autre marche ; sentant bien qu'en employant avec prudence ses forces et ses ressources, il dominerait à peu près la fortune, éclairé par la non réussite des expéditions essayées avant lui, se défiant d'une terre où tout était nouveau, les hommes, les animaux, le climat, il n'entreprit rien qu'il ne fût assuré du succès, et s'il ne gagna du terrain qu'avec précaution, jamais il ne fut forcé d'en abandonner un pouce, et en définitive, dans l’espace de vingt jours, il gagna trois batailles contre des forces supérieures, ruina un fort regardé comme formidable, et réduisit à se rendre à discrétion la capitale d'un empire presque aussi étendu que la France, défendue par un ennemi brave quoique indiscipliné : les rapports qu'il adressait au président du conseil des ministres sont écrits avec clarté, précision et dignité. Les quelques lignes qu'il y consacre à son fils tué au service de son pays sont empreintes d'autant de douleur que de fermeté : Malheureux que le souvenir d'une conduite antérieure, et le ministère sans intelligence et sans avenir auquel il s'était livré, n'ait pas permis à la France de lui savoir gré du véritable service qu'il lui rendit, par une guerre prudemment conduite et brillamment terminée. |