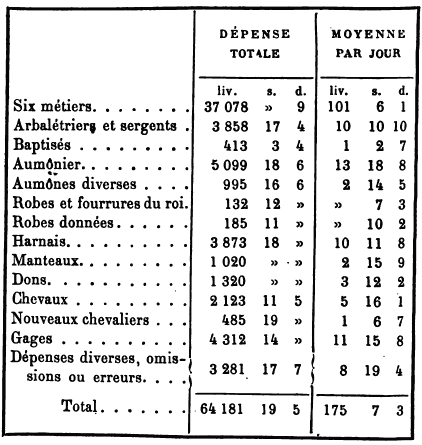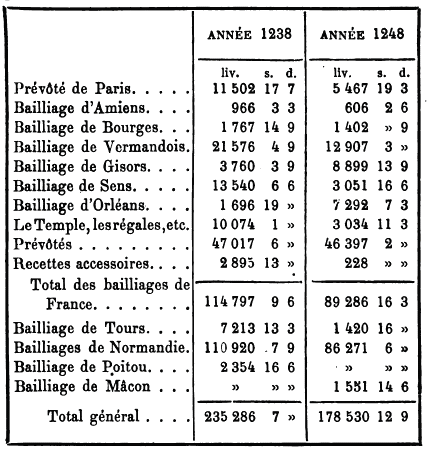SAINT LOUIS ET SON TEMPS
TOME SECOND
CHAPITRE XVI. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE. - FINANCES.
|
I. — Agents de l'administration. - Prévôts et bayles. - Baillis et sénéchaux. Le roi, en tant que seigneur dans son domaine, avait en main tous les pouvoirs. II était tout à la fois chef militaire (ce fut toujours l'apanage du souverain), législateur, ayant le droit de faire la loi, de lever l'impôt et de disposer de son domaine ; grand justicier, pouvant rendre personnellement la justice et alors ne relevant que de sa conscience, n'étant tenu d'aucune loi, puisque sa volonté était la loi. Ce pouvoir absolu chez lui n'était limité qu'au dehors, parce que là il rencontrait d'autres seigneurs ayant mêmes droits chez eux, droits qui pourtant se trouvaient de plus en plus réduits par les progrès de l'autorité royale ; et ces empiétements du suzerain sur les vassaux leur étaient d'autant plus à craindre qu'aucun droit écrit n'y faisait obstacle[1]. Ces pouvoirs, il ne les exerçait pas tous par lui-même ; il y employait les grands officiers et les barons dont il formait sa cour ; il les déléguait aussi des officiers inférieurs. Mais c'est ici que se manifestait surtout la différence du moyen âge avec les temps modernes. Aux temps modernes, le principe qui domine dans le gouvernement d'un peuple, c'est la division des pouvoirs. Au moyen âge, ils restaient réunis dans la même main. De même que le roi, ses délégués, aux divers degrés de la hiérarchie, en accomplissaient les fonctions dans des circonscriptions plus restreintes. C'est ainsi que le prévôt avait action tout à la fois pour la guerre, pour les finances et pour la justice : réunissant les hommes d'armes, affermant les produits du domaine, jugeant, faisant la police et tous les actes de l'administration ; et au-dessus du prévôt le sénéchal ou le bailli, dans les provinces où cet officier avait remplacé le sénéchal, cumulait aussi tous ces pouvoirs. Mais cela dit, il convient, pour répondre aux habitudes modernes et mettre plus d'ordre dans la discussion, d'examiner à part chacun de ces services. Disons d'abord quelle attention saint Louis apporta à la conduite de ses agents, et nous verrons ensuite dans quelle mesure il améliora chacune des branches de leur administration. Nous avons vu plus haut, en remontant à Philippe Auguste, quels étaient les grands officiers de la couronne : le bouteiller, le chambrier, le connétable et le chancelier. Leurs principales attributions les retenaient dans la maison du roi. L'administration du royaume appartenait surtout à ceux que Philippe Auguste avait établis pour suppléer le sénéchal et qui le remplacèrent : les baillis, créés au nombre de quatre, et dont le nombre s'accrut beaucoup sous saint Louis. Sans parler de Paris dont la prévôté valait bien un bailliage[2], Senlis, le Vermandois, Amiens, Arras, Saint-Omer, Gisors, Mantes, Rouen, le pays de Caux, Verneuil, Caen, Bayeux, le Cotentin, Sens, Mâcon, Étampes, Orléans, Tours, Bourges, l'Auvergne avaient chacun leur bailli[3]. La charge de bailli était comme un dédoublement, un diminutif, si l'on peut dire, de celle du sénéchal ; et le titre de sénéchal était resté à des officiers qui remplissaient les mêmes fonctions dans plusieurs grands fiefs[4]. Il resta avec les mêmes attributions que celles des nouveaux baillis dans les provinces acquises par la couronne au midi de la France. C'est ainsi que la réunion d'une partie du Languedoc, au traité de Paris (1229), fit créer les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne. Saint Louis y joignit celles de Périgord, de la Rochelle et du Quercy. Les bailliages et les sénéchaussées formaient donc le cadre de l'administration royale, et les prévôtés en étaient les subdivisions. Les bailliages comprenaient la France entière, et les grands fiefs eux-mêmes, tout indépendants qu'ils fussent réellement, étaient répartis entre les bailliages : la Bretagne ressortissait au bailliage de Tours ; la Bourgogne au bailliage de Mâcon ; la Guyenne et la Gascogne à la sénéchaussée de Périgord[5] ; quant aux pouvoirs attachés à ces charges, les énumérer comme nous l'avons fait tout à l'heure, c'est dire combien l'exercice des uns prêtait d'appui à l'abus qu'on pouvait faire des autres ; et pour le bailli ou sénéchal en particulier ces excès étaient, en raison de son autorité, plus grands encore que pour le prévôt[6]. Le bailli avait tout à la fois son action personnelle qui s'étendait à tous et la surveillance des prévôts ou des juges dans leurs fonctions spéciales. Aussi était-il souhaitable que, dans un champ si peu limité, le magistrat trouvât un frein en lui-même. Le jurisconsulte Beaumanoir, qui avait été bailli, ne lui demande pas moins de dix vertus : la sapience, l'amour de Dieu ; qu'il soit doux et débonnaire ; souffrant (endurant) et écoutant, laissant les parties s'expliquer à leur aise ; hardi et vigoureux, sans nulle paresse ; qu'il fasse largesse sagement et modérément, sans folle dépense ; qu'il obéisse au commandement de son seigneur, sans perdre son âme ; qu'il ait de la science pour distinguer le bien du mal, le droit du tort, les gens pacifiques des querelleurs, les loyaux des tricheurs ; l'esprit prompt et actif, et la loyauté qui est la fleur des vertus : car s'il a sagesse et loyauté, ajoute Beaumanoir, il a toutes les vertus en même temps[7]. Nous avons dit que le bailli jugeait lui-même ou présidait une cour composée des hommes de fief. Là où il jugeait, il lui était recommandé de s'entourer des plus sages conseillers ; là où il présidait seulement, il pouvait encore diriger les juges par son expérience. Quant aux assises, il devait les tenir régulièrement et ne pas les contremander lorsqu'elles étaient indiquées ; poursuivre d'office les méfaits et, s'il ne peut attendre les assises, réunir trois ou quatre jugeurs pour en faire justice. Quelquefois il pouvait se faire suppléer, mais il devait alors s'attacher à bien choisir ce suppléant ; publier sa nomination, soit aux assises, soit par lettres, afin que nul n'en ignore ; ne pas prendre des hommes qu'on ne pourrait punir en cas de mauvaise gestion, ni des gens qui ne seraient pas capables d'être baillis[8]. Mais à défaut des vertus qu'on lui demandait, on prenait des précautions contre les excès dont il pouvait se rendre coupable. Des mesures de ce genre étaient déjà usitées à l'égard des sénéchaux dans le Languedoc, où étaient restes les principes du droit romain. Plusieurs règles étaient empruntées de ce droit : temps limité pour la gestion ; défense de se marier dans la sénéchaussée et à la sortie de charge ; ordre de rester pendant un certain nombre de jours dans la province pour rendre compte. Ces règles se retrouvent dans l'ordonnance de Beaucaire, rendue par saint Louis au retour de la croisade. Elles ont été généralisées pour les baillis et les sénéchaux dans les ordonnances de 1254 et de 1256, résumées en une par Joinville dans le texte emprunté à la chronique française dont il fait usage (ch. CXL.)[9]. Comme première garantie, on demande au bailli le serment ; car on a foi en la puissance du serment. Il doit jurer de faire droit à chacun sans acception de personne, jurer de ne pas diminuer les droits du roi. Mais de plus on prévoit les écarts où la passion peut l'entraîner : 1° Mesures contre la corruption. — Ne recevoir aucun présent des justiciables, ni pour soi, ni pour les siens, à moins qu'il ne s'agisse de fruits, de pain, de vin jusqu'à la valeur de 10 s. (13 fr.) ; n'en pas faire non plus à ceux dont il peut être comptable, aux membres de la cour du roi ni à leurs enfants ou à leurs femmes ; à ceux qui examinaient ses comptes ou aux enquesteurs ; 2° Mesures contre les abus de pouvoir. — Défense de se marier ou de marier les siens dans la sénéchaussée ou bailliage ; défense de leur y procurer des bénéfices ; défense d'y prendre part aux adjudications, d'adjuger des prévôtés à des parents. Pas d'exaction, comme par exemple d'imposer des chevauchées pour les faire racheter à prix d'argent ; pas de concussion, comme de défendre l'exportation du blé ou du vin : il ne le devait pas faire sans l'avis des prud'hommes ; pas d'emprisonnement pour dettes, à moins qu'il ne s'agit de dettes envers le roi. Ne pas fatiguer les populations en transférant son siège de lieu en lieu ; n'enlever à personne, sans connaissance de cause, les biens dont on aurait la saisine. On prenait aussi des sûretés contre les excès de son entourage, car il en était responsable dans une certaine mesure. A ce degré inférieur, il y avait une classe de fonctionnaires, agents zélés de l'administration royale, qui trop souvent faisaient leurs propres affaires en faisant celles du roi : les sergents (servientes). On recommandait au bailli de n'avoir pas trop de sergents ; de les nommer publiquement, afin que personne ne pût commettre d'abus sous leur nom ; de ne nommer que des roturiers afin qu'ils fussent toujours punissables, et de surveiller même ce qui était commis aux soins des inférieurs, par exemple les prisons. Les sénéchaux étaient des nobles, les baillis des nobles ou des roturiers. On vient de voir que par l'ordonnance de 1256, il était défendu de donner les fonctions inférieures à des gentilshommes, afin qu'on pût toujours y être jugé par les baillis : ce fut une des choses qui contribuèrent le plus à créer la classe roturière des légistes et à leur ouvrir l'accès des bailliages. Pour être bailli, il fallait savoir le droit : or la meilleure préparation pour le savoir, c'était de l'avoir pratiqué en remplissant, au degré inférieur, les fonctions de prévôt. Les défenses faites aux baillis s'appliquaient en général aux prévôts, sauf la défense de mariage ou d'achat de biens dans la province, parce que les prévôts n'avaient pas une influence qui pût paraître redoutable à cet égard, et que, d'ailleurs, ils étaient toujours sous la main du bailli. Le bailli lui-même était sous la surveillance de la population entière du bailliage. A sa sortie de charge, il devait rester dans sa province pendant quarante jours, afin que chacun pût exercer contre lui ses revendications légitimes. L'utilité de cette mesure ressortira davantage quand nous aurons examiné plus en détail les pouvoirs des prévôts et des baillis, en prenant, l'une après l'autre, chacune des branches de l'administration. II. — Finances. - Revenus du domaine. Les revenus du roi se composaient de ce qu'il retirait comme seigneur de son domaine et comme roi du royaume. Les revenus qu'il retirait de son domaine comme seigneur étaient les plus considérables et constituaient à proprement parler ses recettes ordinaires. Nous en avons dit quelque chose en parlant de la condition des campagnes et des villes, et nous pouvons nous contenter de rappeler ici : le cens qui frappait toutes les terres[10] ; la taille, tout ce qui n'était point, terres ou personnes, couvert du privilège de la noblesse ; les aides payées par les nobles comme par les roturiers, droit généralement proportionnel au relief du tènement[11]. Le seigneur percevait encore d'autres droits, soit. sur ses vassaux nobles, soit sur les roturiers. Parmi les redevances féodales, citons le droit de rachat ou de mutation quand le fief passait en d'autres mains[12] ; le droit de garde sur les enfants mineurs ; le droit d'amortissement quand le fief était acquis par un roturier, qui ne pouvait plus remplir les devoirs de chevalier, ce qui diminuait (abrégeait) le fief et donnait lieu à une indemnité ou redevance pécuniaire ; les droits de quint et de requint, le quint, c'est-à-dire le cinquième du prix de la vente de la terre féodale, et le requint, le cinquième de la redevance, qui s'y ajoutait dans certains pays : le droit de quint n'était plus qu'un droit de douzième, si l'héritage était de vilenage[13]. Mais c'est surtout le roturier qui était frappé. L'impôt l'atteignait dans sa personne, dans son avoir, dans son travail, dans tous les actes de sa vie civile et même religieuse. Dans Ba personne, par le service militaire et par les corvées ; — dans son avoir, par les dons gratuits, les prêts forcés et le crédit, sorte d'achat avec payement à long terme ; par les droits de gîte, de visite et de prise — droit de séjourner gratis et de prendre en partant ce qu'on jugeait nécessaire pour la suite du voyage — et par mille exactions de noms divers. Il était frappé dans le produit de son travail agricole, industriel ou commercial par les droits prélevés sur la moisson, indépendamment de la dîme — champart, part des produits du champ — ; sur les céréales — minage ou tant par mesure de blé — ; sur le bétail, tant par tête de bœuf ou bien encore la plus belle des brebis après que l'éleveur en avait choisi une (moutonnage) ; sur les charrues, la vendange, la coupe des bois (gruerie)[14] ; par les droits sur les métiers, sur les transports des marchandises et sur les marchés (tonlieux, péages, foires) ; — dans les actes de sa vie civile et religieuse, par les taxes prélevées pour le baptême, le mariage, l'extrême-onction, la sépulture : taxes qui à l'origine, en ce qui touche les sacrements, étaient des offrandes volontaires, et qui parfois, comme les dîmes, étaient dévolues, par usurpation ou autrement, aux seigneurs. Le mariage et la mort donnaient lieu d'ailleurs à des droits particuliers sur le vassal comme sur le vilain. Pour ce qui est du mariage, l'héritière d'un fief, aussi bien que le serf, ne pouvait se marier sans l'autorisation du seigneur : autorisation dont le défaut pouvait entraîner la confiscation et l'amende. Dans le servage, la permission du seigneur était toujours requise et toujours donnée à prix d'argent : droit exprimé grossièrement quelquefois, il faut le dire, dans la langue grossière du temps, mais qui ne reçut de signification malhonnête que de l'imagination libertine des temps qui ont suivi. On peut en appeler à témoin l'Église dans son silence. L'Église, qui a défendu les droits sacrés du mariage contre l'impudicité des princes, ne serait pas restée muette devant le scandaleux abus de pouvoir des seigneurs dans l'acte le plus solennel de la vie du chrétien[15]. Quant à la mort, elle donnait ouverture au droit de rachat dont nous avons parlé à propos des fiefs, et à d'autres bien plus considérables à l'égard de la classe inférieure : droit de mainmorte, qui faisait passer au seigneur la succession entière du serf mort sans enfant mâle ; droits d'aubaine, de bâtardise, qui lui donnaient dans le même cas les mêmes droits sur l'héritage de l'étranger et du bâtard ; droits de mutation, appelés lods ou ventes s'il s'agissait de terres censives : ils étaient perçus en cas d'aliénation comme en cas de succession. Là ne se bornaient pas les droits du seigneur sur son domaine. Il ne se contentait pas de prendre sa part dans les profits de la culture et du commerce des autres ; il n'intervenait pas seulement dans la vente de leurs produits, il imposait l'achat des siens : je veux parler des monopoles et des banalités qui étaient une des plaies les plus douloureuses de ce régime. Le seigneur interdisait de vendre du vin pendant un certain temps à partir de la vendange (banvin), et de la sorte, il était seul à vendre celui qu'il avait récolté. Il enjoignait de porter le raisin à son pressoir, le blé à son moulin, le pain à son four à un prix qu'il avait fixé lui même. Il prélevait un droit jusque sur le blé qu'on ne lui donnait point à moudre, mais qui, étant produit dans les limites de sa seigneurie, était comme tributaire de son moulin. Une autre sorte de monopole pour lui, c'étaient les juifs, monopole de l'argent et de l'usure. Les juifs appartenaient aux grands fiefs où ils résidaient. Des traités, des contrats entre le roi et les seigneurs leur en garantissaient mutuellement la possession. On se promettait de ne pas se les prendre ou de se les rendre les uns aux autres[16]. Or comme le prêt à intérêt était défendu aux chrétiens, ce sont eux qui en avaient le monopole. Ils l'exerçaient, malgré les prohibitions répétées des 'ordonnances, au profit des seigneurs, et voici comment : de temps à autre le seigneur levait une taille sur ses juifs, ou bien encore réglait leurs comptes avec leurs débiteurs, en retenant pour lui-même une partie de ce qui leur était dû : heureux encore les juifs, lorsqu'on ne les chassait pas en confisquant leurs biens. Mais ceci était proprement l'affaire du roi[17]. Nous verrons au chapitre de la justice comment en usa saint Louis. Parmi les droits de la souveraineté qui s'étaient attachés à la terre et demeuraient, dans une certaine mesure, aux seigneurs (tous en effet ne les avaient pas retenus), étaient les droits généraux de l'administration publique : droit de voirie, droit de sceau, droit même sur les poids et mesures (une taxe était payée par ceux qui en usaient), droit de battre monnaie, droits de justice et de guerre : droits qui, indépendamment de ce qu'ils leur donnaient de puissance, pouvaient ajouter à leurs revenus : la monnaie par des profits souvent iniques sur le poids et le titre des espèces ; la justice par la confiscation et les amendes ; la guerre par le rachat des services qui leur étaient dus. Ces droits que le seigneur avait chez lui, appartenaient au roi dans son domaine et lui créaient des ressources d'autant plus considérables que le domaine royal s'était agrandi. Mais de plus les rois avaient gardé certaines attributions de la puissance royale telle qu'elle existait sous les Carlovingiens : et ces droits, qui avaient surtout tendance à s'accroître, devaient ajouter beaucoup aux revenus du Trésor. Le roi levait la taille même sur les terres seigneuriales, indépendamment de la taille des seigneurs[18]. Il retirait certains droits même de leurs transactions avec les villes et les villages de leur domaine. Les chartes de commune ou les immunités que les villes avaient obtenues d'eux, elles en demandaient la confirmation au roi comme souverain, et cette confirmation ne laissait pas que de lui assurer certains avantages. L'Église aussi lui en procurait d'autres du même genre. Les évêchés, les abbayes, quand elles relevaient des seigneurs, recherchaient volontiers la protection du roi ; or cette protection, en s'étendant, lui devenait une source de profits considérables : car le protecteur, on l'a vu, jouissait des revenus du siège quand il devenait vacant et tant qu'il était vacant (ce qu'on nommait la régale). Ajoutez ce que le roi pouvait réclamer à titre extraordinaire, soit de tous ses sujets, vassaux ou roturiers, comme aide[19], soit de l'Église elle-même. Car l'Église n'était pas aussi exempte d'impôts qu'on le suppose. Le clerc n'était affranchi de la taille que s'il vivait cléricalement, c'est-à-dire sans être marié ni faire le commerce ; et même alors ses biens personnels étaient soumis aux mêmes conditions que les autres. Quant aux terres ecclésiastiques, si elles étaient quittes de tout tribut, cette faveur avait bien sa compensation dans les dîmes payées au roi en forme d'aides par le -clergé, dîmes établies d'abord à propos de la croisade, concédées ensuite par le pape pour toute autre guerre où l'Église était censée avoir intérêt, et qui, de 1247 à 1274, se renouvelèrent jusqu'à vingt et une fois[20]. L'administration des revenus du roi était, nous l'avons dit, avec la justice et la guerre, la principale attribution des officiers mis à la tête des grandes divisions du royaume, baillis et sénéchaux, et de leurs délégués : les prévôts dans le Nord, les bayles dans le Midi[21]. Les prévôts et les bayles n'étaient au fond que des fermiers de revenus. Outre le cens et les rentes, outre les biens domaniaux, les uns donnés à ferme, les autres à rente perpétuelle et dits fieffés, quoique bien différents des fiefs, il y avait tout cet ensemble de droits éventuels, les amendes, les péages, les revenus des fours, des moulins, des pressoirs, des rivières, des prés et des étangs, les taxes sur les métiers, les marchés, etc., qui constituaient le domaine muable et faisaient l'objet d'une adjudication dans chaque district : c'est ce qu'on appelait prévôtés. L'adjudicataire, prévôt ou bayle, se remboursait des sommes qu'il s'engageait à payer, en levant lui-même l'impôt avec droit de contrainte : c'est ce qui faisait de sa charge une sorte d'office public, et c'est l'origine de sa juridiction. Tous les ans les prévôtés étaient mises aux enchères ; quelquefois le même homme en affermait plusieurs, et il tirait parti de son marché, soit en sous-louant, soit en faisant gérer par des commis ; d'autres fois, une même prévôté était adjugée à plusieurs, et c'était une autre source d'abus, chacun d'eux prétendant à l'exercice des droits qu'ils avaient acquis dans le même ressort[22]. Cela était fréquent dans les États d'Alfonse de Poitiers et se rencontrait aussi dans ceux de saint Louis qui tâcha d'ailleurs de remédier aux abus, mais ne supprima la vénalité qu'à Paris, où l'administration d'Étienne Boileau fit bénir cette réforme[23]. Les prévôts et les bayles payaient leur fermage au bailli ou sénéchal, de qui ils relevaient. Le bailli ou sénéchal percevait généralement un droit sur les revenus des prévôtés ; il avait le tiers des amendes et des services, mais il devait lever sans indemnité les tailles extraordinaires sur les juifs et sur les chrétiens[24]. Outre les fermages des prévôtés, le bailli ou sénéchal percevait les frais d'administration, et rendait les comptes à une commission qui siégeait au Temple à Paris[25]. Chaque dépense était généralement imputée sur un revenu particulier. Quand il y avait à faire une dépense extraordinaire en province, l'ordre en était expédié au bailli ou sénéchal qui la prenait sur ses recettes et la déduisait de son compte lorsqu'il venait le rendre à Paris. L'excédant des recettes était envoyé par les baillis ou sénéchaux au Trésor. On tenait tant au scrupuleux accomplissement de leur devoir en ce point qu'on leur enjoignait de l'envoyer en la monnaie qu'ils avaient reçue, même lorsqu'elle n'avait point cours à Paris. On se défiait des profits qu'ils auraient pu chercher sur le change[26]. II bis. — Comptabilité. La comptabilité royale, dont les documents sont nombreux sous Philippe le Bel, était déjà établie sur les mêmes bases au temps de saint Louis et de Philippe Auguste. Outre les traces qu'on en a pu recueillir, on en trouve une preuve indirecte dans les documents plus complets que nous offre l'administration d'Alfonse de Poitiers : car la comptabilité royale avait été établie dans le Poitou pendant la minorité d'Alfonse ; et ce prince ne fit que la suivre et l'étendre, en l'appliquant dans les autres parties de ses domaines[27]. Le document le plus étendu que l'on ait sur cette époque est un registre où sont inscrits les comptes rendus par le bailli de Poitou depuis la Toussaint 1243 jusqu'à la Toussaint 1248 : registre où l'on peut retrouver, comme nous le disions. tout à l'heure, les principes de la comptabilité royale, puisque le Poitou fut administré par le roi jusqu'en 1241, mais où l'on peut noter aussi les progrès de cette comptabilité sous l'administration propre d'Alfonse ; car c'est depuis 1245 que l'on trouve ces comptes disposés dans un ordre bien déterminé[28]. Ils renferment les deux parties de tout compte : Recettes, Dépenses, et dans chacune de ces deux parties ces, subdivisions régulières : I. RECETTES. — 1° les rachats (racheta), droits de mutation que payaient les feudataires ; 2° le domaine (domanium), comprenant les domaines proprement dits dont le seigneur était propriétaire, et les droits de seigneur et de suzerain, redevances qui portaient comme on l'a vu, sur les maisons, les fours, les moulins, les étaux, les biens ruraux, champs, prés, vignes, bois, rivières, étangs, etc., quelquefois même sur les personnes : car on payait pour être protégé ; 3° les exploits (expleta), ou produits de justice, notamment les amendes dont le détail était inscrit au dos des rouleaux de comptes : on en pourrait tirer une statistique intéressante des délits les plus communs dans ce temps-là ; et les délits de mœurs y tiendraient toujours le premier rang[29]. A ces trois classes de recettes ordinaires, il faut joindre certaines recettes extraordinaires ou éventuelles comme les confiscations sur les hérétiques, les impôts extraordinaires ou certains revenus domaniaux estimés trop considérables pour être affermés[30]. II. DÉPENSES. — Chaque bailli ou sénéchal prélevait, nous l'avons vu, sur ses recettes les sommes nécessaires à l'administration de la province. Elles sont rangées uniformément, dans le registre cité, sous ces rubriques : Liberationes ; — Feoda et eleemosinæ ; — Opera ; — Minuta expensa. Les liberationes, ou acquittements, comprenaient les gages des sergents, des gardes forestiers, des châtelains, des chapelains, etc. ; Les feoda, ou fiefs, les rentes ou pensions accordées à d'anciens serviteurs ; Les eleemosinæ, ou aumônes, les dons faits soit à des particuliers, soit à des établissements religieux. Sous le titre d'opera, ou travaux, étaient inscrites les dépenses d'entretien des châteaux ; celles des ponts et des routes, des marchés et des halles. Enfin, les minuta expensa, ou menues dépenses, étaient toutes les dépenses non classées : payement des messagers, transport des deniers, etc. L'année financière avait trois termes : Toussaint, Chandeleur et Ascension, ou plutôt les octaves de ces fêtes[31]. Les recettes et les dépenses se divisaient en trois parties correspondant aux trois périodes comprises entre ces termes ; mais comme l'Ascension était une fête mobile, pour rendre la répartition plus égale on adoptait, dans la pratique, en ce qui touche les dépenses, la Saint-Jean au lieu de l'Ascension[32]. III. — Budget de saint Louis. Tout seigneur, nous l'avons vu, tirait de son domaine un revenu qui devait suffire à ses dépenses et à la bonne gestion de sa seigneurie. Le royaume était la seigneurie du roi. Le domaine royal suffisait-il aux dépenses de la cour et de l'administration du pays ? De la réponse que l'on pourra donner à cette question dépendra l'idée que l'on se devra faire de l'administration des finances de saint Louis. Il est resté un assez grand nombre de fragments de comptes du temps de saint Louis. Les éditeurs des Historiens de France ont publié, dans le tome XXI de leur recueil, ce qu'ils en ont trouvé ; et M. N. de Wailly, l'un d'eux, a placé en tête du volume une savante notice où il a essayé de refaire, en quelque sorte, le budget d'une année de saint Louis[33]. Nous distinguerons avec lui les dépenses de l'hôtel du roi et celles des prévôtés et bailliages, et nous verrons ensuite par quelles recettes elles étaient balancées. Dans l'hôtel du roi, il y avait d'abord les six métiers ou ministères (ministeria, misteria) qui étaient la paneterie, l'échansonnerie, la cuisine, la fruiterie, l'écurie et la chambre. Ces six corps de services demandaient de l'argent tant pour le personnel que pour le matériel ; et certains indices ont permis de faire la part de chacune de ces deux choses, pour la paneterie et l'échansonnerie, par exemple[34]. La dépense totale des six métiers, tant pour le personnel que pour le matériel, du 10 février.1256 au 9 février 1257, est évaluée par M. de Wailly à 3995,1. 10 s. (100.902 fr. 60 c.) pour le personnel, et 33.082 l. 10 s. 9 d. (7.454.360 fr. 06 c.) pour le matériel[35]. Les arbalétriers et les sergents, les baptisés[36] et les nouveaux chevaliers, les aumônes et les dons, les harnais et les chevaux, les robes et les fourrures du roi, les robes données et les manteaux font un autre chapitre, dont les parties ont été aussi examinées distinctement et pour plusieurs déterminées d'une façon assez précise à l'aide de certains comptes partiels[37]. Aux dépenses un peu flottantes il faut joindre ce qu'on trouve fréquemment dans les comptes sous le titre de Pro vadiis et minutis, pour les gages et les menus frais. Le dernier compte de Jean de Lissi en fixerait la valeur à 10 l. 16 s. 4 d. (273 fr. 98 c.) par jour ; et sur cette somme on pourrait, d'après une ordonnance de 1261, évaluer à 5 l. 4 s. 4 d. (132 fr. 12 c.) les gages qui se payaient en dehors des six métiers[38]. En recueillant toutes les données des comptes et en les complétant par des évaluations proportionnelles, M. de Wailly[39] est arrivé à proposer le tableau suivant pour les diverses dépenses de l'hôtel, du 10 février 1256 (année bissextile) au 9 février 1257 :
Quant aux dépenses des bailliages et prévôtés, M. de Wailly a principalement opéré sur deux comptes partiels rendus au terme de l'Ascension, l'un en 1238, l'autre en 1248. Nous avons dit que les comptes se rendaient en trois termes : Chandeleur, Ascension, Toussaint ; mais que l'Ascension étant une fête mo bile, pour mettre plus d'uniformité dans les payements, on en reculait communément l'échéance à la Saint-Jean (24 juin). La remarque a son importance lorsque d'une période on veut conclure à l'année tout entière ; mais là n'était pas la plus grande cause d'incertitude : le difficile était surtout de démêler dans ces comptes les dépenses fixes et les dépenses variables, et par ces dernières il faut entendre les salaires payés pour des choses temporaires, les travaux de construction ou de réparation. C'est par l'application de ces règles de critique que M. de Wailly est arrivé à évaluer la dépense des baillis de France pour l'an 1238 à 21.601 l. 18 s. 4 d. (547.171 fr. 78 c.), soit par jour 59 l. 3 s. 8 d. (1.474 fr. 75 c.), et par un calcul proportionnel, la dépense totale tant des bailliages de France que des autre bailliages (Tours, Normandie, Poitou, Albigeois), à 80.909 l. 17 s. 1 d. (2.049.426 fr. 80 c.), soit par jour 221 l. 13 s. 5 d. (5.614 fr. 86 c.). La dépense de l'hôtel n'a été calculée que pour les années 1256 et 1257. Si l'on voulait approximativement avoir une idée de la dépense totale d'une année, on pourrait, tout en se rappelant que l'on joint deux éléments de date fort éloignée, additionner, par exemple, les dépenses des bailliages telles qu'on les a trouvées en 1238, avec les dépenses de l'hôtel comme on les a en 1257, et l'on aurait ainsi une dépense totale de 158.817 l. Il s. 8 d. (3.939.213 fr. 83 c.) par an, ou de 435 l. 2 s. 4 d. (11.021 fr. 40 c.) par jour. Par quelles recettes couvrait-on ces dépenses ? C'est aux deux comptes de 1238 et de 1248 que M. de Wailly a demandé la réponse à cette question. Ici encore mêmes difficultés, et pour les résoudre mêmes règles de critique. Il faut savoir distinguer les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires. Il faut faire attention à ne pas prendre pour une recette partielle, imputable à un seul terme, ce qui serait la recette pour l'année tout entière. Si des payements de ce genre figuraient fréquemment dans les comptes sans aucun signe qui les distinguât, le calcul fondé sur la proportion deviendrait impossible ; il serait exposé à trop d'erreurs. Mais il est à noter que même pour ces recettes, les baillis les attribuaient communément par tiers aux trois périodes de l'année. C'est une observation que M. de Wailly a appuyée d'un document publié par Brussel dans son Examen de l'usage général des fiefs. Les revenus des prévôtés y sont portés pour un tiers dans chacun des trois comptes partiels qui embrassent l'année. Sur ces bases M. de Wailly[40] a dressé le tableau suivant de la recette annuelle des bailliages et des prévôtés en 1238 et en 1248 :
Ces résultats, qui, malgré leur précision apparente, ne sont que des approximations et des probabilités, autorisent toutefois la conclusion que M. de Wailly en a tirée : c'est que les revenus de la monarchie, sous le règne de saint Louis, étaient plus que suffisants aux dépenses ordinaires, et que l'excédant offrait même de quoi satisfaire non-seulement aux constructions d'édifices religieux et aux dotations pieuses, si considérables sous le saint roi, mais même à la plupart des dépenses imprévues. Il en faut excepter sans doute, les dépenses de guerre qui ne sont, à aucune époque, entrées dans aucun budget normal, et surtout celles d'une guerre lointaine comme la croisade. Cela donnait lieu à des aides et à des impôts extraordinaires dont nous avons parlé plus haut. Une ordonnance de saint Louis réglait la forme de ces impôts dans les bonnes villes[41]. Les villes nommaient trente ou quarante bourgeois et ceux-ci douze répartiteurs, lesquels nommaient quatre prud'hommes qui devaient taxer les répartiteurs à leur tour, et recevoir la taille. Quand saint Louis levait des impôts sur ses villes, c'était, selon le texte de l'ordonnance, de leur volonté et grâce, c'est-à-dire qu'il leur fit voter des subsides, aimant mieux se les faire octroyer que de les imposer d'autorité selon le droit féodal[42]. Saint Louis leva donc des impôts extraordinaires et c'est à tort qu'on avait induit le contraire du texte de Joinville, lorsque, après avoir raconté la campagne du roi contre le comte de la Marche et le roi d'Angleterre en 1242, il ajoute : Mais, ni pour dons ni pour dépenses que l'on fit en cet host (expédition) ni autre deçà mer ni delà, le Roy ne requit ni ne prit onques aides des siens barons, ni à ses chevaliers, ni à ses hommes, ni à ses bonnes villes dont on se plaignist[43]. Joinville se borne à dire que jamais il n'exerça ce droit de manière à exciter des plaintes. Il constate la mesure avec laquelle saint Louis en usa et comment il la fit accepter. Du reste, pour ce qui est de la plus grosse dépense, la croisade, le roi put d'autant plus ménager ses bonnes villes que l'Église en supportait la principale charge. IV. — Monnaie. Une question qui se rattache intimement aux finances, c'est celle de la monnaie. La monnaie c'est la forme la plus générale de l'impôt et le moyen le plus commode des échanges. C'est une des matières les plus importantes dans les rapports du roi et des citoyens tout aussi bien que des citoyens entre eux. Le droit de battre monnaie était devenu un droit seigneurial, grave inconvénient à une époque où l'on se figurait que le droit de faire de la monnaie impliquait celui de lui donner sa valeur et par suite de l'altérer à volonté. Il est vrai qu'il y a un remède contre l'altération : le discrédit. Mais si l'altération se cache, bien des gens peuvent être lésés avant qu'on s'en aperçoive ; et si elle se déclare elle prétend s'imposer aussi, et il n'est pas toujours facile de résister à la force, surtout quand l'autorité souveraine a pour complice certains intérêts particuliers, comme il yen a toujours : c'est donc une grave perturbation jetée dans toutes les relations sociales. Saint Louis voulut restreindre autant que possible ce droit de battre monnaie, en limitant le champ où il pouvait se produire : ce fut l'objet de son ordonnance du carême 1262. Le droit seigneurial n'était évidemment valable que dans les limites de la seigneurie. Saint Louis consacra ce principe en ordonnant, comme l'avait fait son père Louis VIII en 1226, que la monnaie royale fût reçue dans tout le royaume, et la monnaie des seigneurs seulement sur leurs terres concurremment avec la monnaie du roi. Là où le seigneur n'avait pas le droit de battre monnaie — car là où il ne l'exerçait pas, il était censé ne plus l'avoir — la monnaie royale était seule admise. Ainsi la monnaie du roi avait sur toutes les autres un premier avantage, et un avantage considérable, celui d'une circulation universelle ; et le roi lui en assura un second en la faisant meilleure qu'aucune autre. Les types de la monnaie de saint Louis acquirent dès lors la réputation qu'ils méritaient. Par ce double avantage, il rendit la concurrence presque impossible et dégoûta plusieurs seigneurs d'un droit qui ne leur rapportait plus le même profit. Saint Louis, tout en souhaitant que les seigneurs qui le gardaient en usassent de la meilleure manière et fissent d'aussi bonne monnaie que lui-même, ne souffrait pas d'ailleurs qu'ils imitassent ses types[44] : cette ressemblance aurait pu favoriser leur circulation hors de la seigneurie dans le royaume, aux dépens de la sienne. Il ne le toléra pas même de la part de son frère Alphonse de Poitiers. Ce prince ayant fabriqué des deniers tournois semblables aux siens à Montreuil-Bonnin en Poitou, à Riom, à Toulouse et dans le marquisat de Provence, le roi lui députa le doyen d'Orléans pour le lui interdire. Alphonse envoya des excuses : il ne savait pas, disait-il, que sa monnaie fût frappée autrement qu'elle ne l'avait été dès les premiers temps de son règne. Mais saint Louis n'accueillit pas ces raisons, et Alphonse céda[45]. Toutefois on peut voir par les comptes de ce prince que, dès l'an 1264, les ateliers de Montreuil-Bonnin avaient repris leur fabrication : Alphonse ayant donné satisfaction à son frère en modifiant le type de ses tournois[46]. Le règlement de saint Louis sur les monnaies avait été fait de concert avec des bourgeois, et, circonstance digne d'être notée, leurs noms figurent à côté de celui du roi dans l'ordonnance. Le système monétaire, au treizième siècle, n'était pas aussi simple qu'il l'est aujourd'hui. Il faudrait une dissertation spéciale pour tirer au clair tout ce qui concerne le titre, la taille, le poids et le cours des monnaies de saint Louis. Cette dissertation a été faite, après Le Blanc, et d'une main assez sûre pour que nous puissions nous borner à en signaler les résultats. Le titre de la monnaie de saint Louis différait sensiblement du titre de notre monnaie actuelle. Il était de 990/1000 fin pour l'or, de 23/24 de fin pour l'argent, tandis que chez nous il est de 900/1000 de fin pour les deux matières : en d'autres termes, l'alliage était de 1/100 pour l'or, de 1/24 pour l'argent, tandis qu'il est de 1/10 pour notre monnaie tant d'or que d'argent[47]. Les monnaies fabriquées à ce titre étaient, pour les espèces en or, l'agnel d'or, et le denier d'or à l'écu. On taillait 59 agnels 1/6 dans un marc d'or[48], ce qui lui donnait un poids légal de 4 gr. 137, et en évaluant le kilogramme d'or pur à 3.444 fr. 44 c., une valeur de 14 fr. 10 c. (je néglige les fractions inférieures) ; le denier d'or à l'écu devait avoir même poids et même valeur. Pour l'argent, la pièce principale était le gros tournois d'argent, à la taille de 58 au marc, ce qui lui donnait le poids légal de 4 gr. 2198 et la valeur d'environ 90 c. (89 c. 8677). Indépendamment de la monnaie d'or et d'argent au titre que j'ai dit, il y avait la monnaie de billon, monnaie d'argent d'un alliage beaucoup plus considérable : tel était le petit tournois ou denier tournois qui valait 1/12 du gros tournois, à la taille de 220 au marc[49]. Le gros tournois valait 12 deniers ou un sou tournois : c'est sur cette base qu'il faut calculer la valeur de la livre (monnaie de compte) lorsque la somme est payée en argent ; l'agnel et le denier d'or à l'écu avaient cours pour 12 sous 6 deniers tournois : mais il faudrait bien se garder d'en déduire la valeur intrinsèque du sou et du denier en monnaie actuelle. L'or et l'argent en effet n'avaient pas au treizième siècle le même rapport de valeur qu'aujourd'hui. L'or en ce temps valait douze fois et 2/10 son poids en argent, tandis qu'aujourd'hui un kilogramme d'or est légalement admis pour quinze kil. et demi d'argent et en vaudra peut-être bientôt seize, la dépréciation de l'argent suivant une marche continue. C'est pourquoi on ne peut partir, soit de la valeur de l'agnel, soit de celle du gros tournois, pour apprécier la valeur intrinsèque d'une somme, qu'autant qu'il est dit expressément que la somme est en or ou en argent. Quand rien n'est dit (et c'est ce qui arrive le plus souvent), comme le payement a pu se faire soit en or, soit en argent ou par un mélange des deux monnaies, il faut prendre la moyenne des deux évaluations : et c'est ce qu'a fait M. de Wailly dans le tableau qu'il a proposé. Malgré les revendications légitimes que faisait saint Louis en faveur de sa monnaie, elle pouvait ne pas suffire à tous les besoins : et la commodité des relations commerciales demandait qu'on admit concurremment avec elle certaines monnaies généralement admises ailleurs : loevessins (monnaie de Laon), nantois à l'écu, angevins, mançois, estellins (sterlings d'Angleterre). Saint Louis le comprit et, par l'ordonnance de la Toussaint 1265, il régla le taux du change. D'après cette ordonnance, deux loevessins étaient reçus comme valant un denier parisis ; quinze nantois, douze deniers tournois ; quinze angevins, douze deniers tournois ; un mançois, deux angevins ; un estellin, quatre deniers tournois. Rappelons que la monnaie parisis est à la monnaie tournois dans le rapport de 5 à 4, c'est-à-dire que quatre deniers parisis valaient cinq deniers tournois. Beaucoup de rentes se payaient en nature ; beaucoup de charges s'acquittaient en services personnels. C'est ce qui explique la modicité des recettes que nous avons constatées, et comment pourtant, avec si peu de ressources, on pouvait suffire à l'administration du royaume. Les deux grands services auxquels il fallait surtout pourvoir : c'était la guerre et la justice. Nous en traiterons successivement dans les deux chapitres suivants. |