LE NOUVEAU TESTAMENT ET LES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES MODERNES
LIVRE SECOND — LES ÉVANGILES
CHAPITRE V. — LA PASSION AU POINT DE VUE ARCHÉOLOGIQUE.
|
La passion de Notre-Seigneur, son genre de mort et les instruments de son supplice ont été, dans ces dernières années surtout, le sujet de nombreuses études archéologiques dont les résultats, quoiqu’ils ne soient pas tous certains, intéressent particulièrement la légitime curiosité des fidèles[1]. Les souffrances de Notre-Seigneur commencèrent au Jardin des Oliviers[2].
La grotte de l’Agonie, où Notre-Seigneur eut la sueur de sang, est à quelques pas au nord du Jardin. On y pénètre par une sorte de couloir à ciel ouvert et assez profond. Elle est grande[6], et de forme irrégulière. Elle est soutenue par plusieurs piliers. Vers le milieu, une ouverture y laisse pénétrer le jour. La caverne est naturelle ; le roc, presque partout à nu, est peint seulement en quelques endroits. C’est de Gethsémani, où eut lieu la trahison de Judas, que le Sauveur fut conduit chez Anne[7] et chez Caïphe[8], dont la demeure, selon la croyance traditionnelle, était située au côté opposé, sur le mont Sion, au sud-ouest de Jérusalem, dans la ville haute. Sur l’emplacement de la maison d’Anne, beau-père de Caïphe, s’élève aujourd’hui l’église des religieuses arméniennes schismatiques (Deir Zeitoun). Elle se compose de deux oratoires séparés, mais communiquant ensemble : A gauche de l’église, on voit, soigneusement enfermés dans un enclos, les rejetons de l’olivier où l’on dit que Notre-Seigneur fut attaché la nuit de la trahison[9]. Ces rejetons ressemblent assez à ceux de Gethsémani. Pour aller de la maison d’Anne à celle de Caïphe, située au couchant, il faut sortir de la ville par la porte de Sion et faire un assez long détour, mais quand on y est arrivé, on s’aperçoit que de fait les deux maisons étaient autrefois voisines, séparées seulement par un jardin ou une cour dans laquelle on a construit, depuis, les murs de la Jérusalem actuelle. La maison de Caïphe est transformée en chapelle et appartient aussi aux Arméniens. L’autel est formé par une grosse pierre blanchâtre, dont une partie est visible des deux côtés et par derrière, et qu’on dit être la pierre du Saint-Sépulcre. A droite, dans le chœur, il y a un petit réduit où l’on dit que Notre-Seigneur fut emprisonné. On remarque au milieu du couvent une petite cour. C’est là, croit-on, que se trouvait saint Pierre, pendant qu’on jugeait son maître, et qu’il le renia trois fois[10]. De la maison de Caïphe, on conduisit le Sauveur à Pilate, au Prétoire. Ce mot de Prétoire désigna d’abord la tente du général en chef dans le camp romain. Il fut aussi donné plus tard à la résidence d’un gouverneur de province, comme était Pilate, le cinquième procurateur de Rome dans la Judée, qu’il administra de l’an 26 à l’an 36 de notre ère. Ce faible représentant de Rome, qui condamna le Sauveur à la mort, par lâcheté, en reconnaissant son innocence, résidait ordinairement à Césarée, sur la mer Méditerranée ; mais il s’était rendu à Jérusalem à l’occasion de la grande fête de Pâques, et il logeait au Prétoire, où il rendait aussi la justice, près du palais d’Hérode et de la tour Antonia, au nord-ouest du Temple. Le Prétoire[11], à ce qu’on croit, était situé en grande partie à l’endroit même où est aujourd’hui la cour actuelle de la caserne turque. On y voit encore de grosses pierres qu’on dit avoir appartenu à cet édifice. L’escalier qui conduisait de la cour supérieure, où était situé le Prétoire, à la cour inférieure, a été transporté à Rome, en 326, par l’impératrice Hélène, et il est vénéré près de saint Jean de Latran, sous le nom de Scala Santa. Il se compose de 28 marches de pierre, recouvertes de bois destiné à les protéger. On ne le monte qu’à genoux. Vers le milieu, il y a deux petits cercles, ouverts dans le bois protecteur, par lesquels on peut baiser la pierre même. Le premier supplice qu’eut à subir le Rédempteur des hommes, livré à Pilate, fut celui de la flagellation[12]. Le Talmud la décrit en ces termes : Les mains du condamné sont attachées à la colonne ; alors l’exécuteur public lui ôte son vêtement, soit qu’il le déchire, soit qu’il l’en dépouille, de manière à découvrir la poitrine. Une pierre est placée derrière le patient. Sur cette pierre, le licteur est debout, tenant un fouet ou des lanières de cuir, pliées de manière à former deux courroies qui s’élèvent et s’abaissent sur le condamné. Horace appelait avec raison ce supplice : horribile flagellum[13]. La colonne de la Flagellation est aujourd’hui conservée à Rome, dans l’église de Sainte-Praxède. Elle est de marbre noir avec des veines blanches, et à la forme d’une sorte de piédestal de 70 centimètres de hauteur et de 45 centimètres de diamètre à la base. Quand Pilate eut consenti au crucifiement de Jésus[14], les soldats romains, avant de le conduire au Calvaire, rassemblèrent dans le Prétoire toute la cohorte, qui se composait régulièrement de 625 hommes, et là, l’ayant dépouillé, ils le couvrirent d’un manteau de pourpre[15]. Ce manteau est appelé par les Évangélistes chlamyde[16], espèce de manteau de laine, ouvert et retroussé sur l’épaule gauche, où il s’attachait avec une agrafe, afin de laisser le bras droit libre. La chlamyde est ici le nom grec du paludamentum, vêtement militaire du soldat romain. Il était de forme ovale, se portait par-dessus la cuirasse et retombait en arrière, à peu près jusqu’à mi-jambe. Les tribuns le portaient de couleur blanche ; les généraux et les empereurs, de couleur pourpre. Après avoir revêtu le Sauveur de ce manteau dérisoire, les soldats, pour pousser jusqu’au bout leur cruelle moquerie, lui placèrent sur la tête une couronne d’épines[17] et dans la main droite un roseau en guise de sceptre[18]. La couronne était de joncs, entrelacés d’épines de zizyphus. La couronne proprement dite, donnée à saint Louis, roi de France, et longtemps conservée à la Sainte-Chapelle, qui fut construite pour la recevoir, est aujourd’hui à Notre-Dame de Paris. Pise possède, dans sa jolie église de la Spina, une branche de zizyphus, à laquelle elle doit son nom. La couronne de joncs de Paris, cette insigne relique, peut-être la plus remarquable de celles que possèdent les chrétiens, à cause de son intégrité relative,... se compose d’un anneau de petits joncs réunis en faisceaux. Le diamètre intérieur de l’anneau est de 210 millimètres, la section a 15 millimètres de diamètre. Les joncs sont reliés par quinze ou seize attaches de joncs semblables... Quelques-uns sont pliés et font voir que la plante est creuse ; leur surface, examinée à la loupe, est sillonnée de petites côtes... Le Jardin des Plantes de Paris cultive un jonc appelé janeus balticus, originaire des pays chauds et qui paraît exactement semblable à la relique de Notre-Dame. Quant aux épines, nul doute... que ce ne soit du rhamnus, nom générique de trois plantes qui se rapprochent tout à fait de l’épine de Pise. Ce rhamnus est le zizyphus spina Christi ou jujubier. Dans la couronne de Notre-Seigneur, ses branches, brisées ou courbées vers le milieu pour prendre la forme d’un bonnet, pileus, étaient fixées par chacune de leurs extrémités, soit en dedans, soit en dehors du cercle de joncs... Il fallait que le cercle fût plus grand que le tour de la tête, afin de pouvoir l’y faire entrer, malgré le rétrécissement causé par l’introduction des branches, et l’on trouve en effet que la couronne de Notre-Dame, placée seule sur la tête, tomberait sur les épaules. On n’avait même pas besoin de nouveaux liens pour les fixer au cercle de joncs ; et les rameaux passés alternativement dessus et dessous devaient suffire pour les maintenir. C’est cette opération que les [Évangélistes] ont pu appeler le tressage[19]. Les soldats sans doute évitèrent de toucher à ces horribles épines, dont chacune, plus tranchante que la griffe du lion, fait couler le sang en abondance[20]. La branche de zizyphus de Pise a 80 millimètres de hauteur. Elle portait autrefois six épines, dont trois seulement sont intactes. La principale a plus de 20 millimètres de longueur[21]. Celle de l’église de Saint-Sernin, à Toulouse, est de 41 millimètres. Les deux que possède le grand séminaire d’Autun ont, l’une 38 millimètres et l’autre, 34 millimètres, elles sont blanches dans leur plus grande partie et d’un brun noir à leur base. La cathédrale de Trèves a un rameau de zizyphus de 10 centimètres environ de longueur, avec une épine droite et plusieurs épines courtes. Nous le reproduisons ici d’après dom Calmet[22].
Après avoir été déchiré par la flagellation et le couronnement d’épines, le Sauveur fut chargé de sa croix pour être conduit au Calvaire. Le supplice le plus commun chez les Juifs était la lapidation. La loi mosaïque parle aussi du supplice du fouet, du supplice du glaive, mais celui de la croix était inusité. Si l’on attachait quelquefois les criminels à la croix ou plutôt à la potence, ce n’était qu’après leur mort, afin de les montrer en exemple, non pour les y faire périr. Puisque le Rédempteur voulait mourir pour nous, il pouvait être lapidé comme saint Étienne, jeté dans les flammes comme les compagnons de Daniel ou décapité comme saint Paul, mais il ne voulut point accomplir de la sort,- son sacrifice ; il choisit un genre de supplice usité chez les Romains, qui étaient alors maîtres de la Palestine, et le préféra à tous les autres, parce qu’il convenait mieux à ses desseins de miséricorde et d’amour[23]. Il avait annoncé lui-même qu’il porterait sa croix et qu’il mourrait sur la croix : c’est là qu’il devait expirer en Dieu. Noms nous représenterions difficilement le Sauveur lapidé, périssant par le feu ou par le glaive. La croix devait être pour lui une chaire sanglante, d’où il adresserait aux hommes ses dernières paroles. C’est le genre de mort dans lequel le supplicié conserve le mieux ses facultés ; là, Jésus pourrait rendre pour ainsi dire le dernier soupir à son gré, au moment qu’il aurait marqué, quand tout serait consommé ; non sous le coup du bourreau, mais comme maître de la vie et de la mort, en poussant un grand cri[24]. La croix devait, d’ailleurs, lui fournir l’emblème le plus simple et le plus naturel de notre religion : elle parle à nos yeux et à notre cœur plus que tout autre supplice ; elle pouvait aussi devenir facilement, comme elle l’est devenue en effet, le symbole, la marque même du Christianisme. Nous pouvons la porter sur nous, et nous pouvons avoir partout sous nos yeux l’image du Crucifié[25]. Le bois de la croix était donc l’instrument prédestiné par la Providence pour la rédemption du monde. Si le supplice de la croix était celui qui se prêtait le mieux aux vues du Sauveur pour ces raisons diverses, c’était également celui qui lui fournissait le moyen de satisfaire davantage son amour en souffrant pour nous, autant qu’il soit possible de souffrir. La croix est le genre de mort le plus long et le plus cruel. Elle ne fait pas de blessure mortelle ; on y meurt de faim et d’épuisement. Jésus n’y resta que trois heures, à cause de tous les tourments qu’il avait déjà endurés, mais on a vu des criminels y languir pendant trois jours. Aussi la croix était-elle réservée aux esclaves. Cicéron l’appelait : servitutis extremum summumque supplicium[26]. Jamais un homme libre, à plus forte raison un citoyen romain, n’était condamné à ce supplice ignominieux. Les tortures qu’on y endure en aggravent encore l’infamie. On se voit mourir comme à petit feu, et sans espoir, au milieu des plus cruelles angoisses physiques et morales, ce qui faisait qualifier ce supplice de : crudelissimum teterrimumque supplicium[27]. La douleur la plus vive du crucifié, ce qui constituait, selon l’expression de Tertullien, l’atrocité propre du supplice de la croix[28], c’était le percement des mains et des pieds, qui déchirait les membres les plus sensibles et mettait le condamné dans l’impossibilité de faire le moindre mouvement sans éprouver les douleurs les plus vives et les plus aiguës. Pour empêcher le crucifié d’avoir les mains complètement déchirées par le poids de son corps, on était obligé dé placer sur la croix une sorte de siège, appelé sedile[29] ou corne[30], afin qu’il pût s’y maintenir et ne point tomber à terre. Tant de tourments amenaient une soif brûlante ; de là était venu l’usage de donner au malheureux supplicié un breuvage propre à calmer un peu la soif ou à diminuer la sensibilité[31]. La croix du Sauveur devait avoir la forme[32] qu’on lui donne communément, c’est dire qu’elle se composait d’un montant, avec une traverse laissant dépasser la tête de la tige. D’après une tradition ancienne, la hauteur du montant était de 4 mètres 80, et la longueur de la traverse de 2 mètres 30 à 2 mètres 60. Pendant longtemps, on a émis les opinions les plus diverses sur la nature du bois ou des bois dont elle était formée. De l’examen scientifique de diverses reliques, il résulte que le bois de la croix provenait d’un conifère, et on ne peut douter que ce conifère ne soit du pin[33]. Notre-Seigneur dut porter lui-même l’instrument de son supplice[34], en traversant toute la ville de Jérusalem depuis le Prétoire, à l’est, jusqu’au Calvaire, hors des murs de la ville, à l’ouest, et par conséquent pendant un trajet de 5 à 600 mètres. On a calculé que la croix devait avoir un poids total d’environ 100 kilogrammes. Comme elle traînait à terre, il en résultait une diminution de poids qu’on peut évaluer de 25 à 30 kilogrammes. Jésus avait donc encore à porter de 70 à 75 kilogrammes. Épuisé par les tourments qu’il avait déjà endurés, ce fardeau dépassait ses forces ; on fut obligé de requérir un passant, Simon de Cyrène[35], pour aider le Sauveur des hommes. Nous ignorons si je Cyrénéen porta seul la croix ou bien s’il en porta seulement une partie, en même temps que Notre-Seigneur. La plupart des Pères ont pensé que Jésus avait été complètement déchargé de son fardeau. Le crucifiement eut lieu sur le Calvaire ou Golgotha[36]. Ce lieu sacré est actuellement enclavé dans l’église du Saint-Sépulcre, près de l’entrée, dans la partie sud-est de la Basilique. Il s’élève à la hauteur de 4 mètres 70 au-dessus du sol. Des travaux successifs en ont défiguré la forme. Les pèlerins peuvent seulement toucher le rocher en enfonçant la main dans une sorte de cône ouvert dans sa partie supérieure et placé sous l’autel du crucifiement. D’après les auteurs anciens, la croix était ordinairement dressée à l’avance et le condamné y était attaché d’abord avec des cordes, puis cloué. Plusieurs peintres, entre autres Rubens, ont représenté de cette manière le crucifiement de Notre-Seigneur. Plus communément, on suppose que la victime sainte fut attachée par terre à l’instrument de son supplice, lequel ne fut élevé qu’ensuite avec son divin fardeau. La place des clous était préparée à l’avance dans le bois avec une broche. On n’est pas d’accord sur le nombre des clous qu’on employait dans la crucifiement ; il n’était que de trois, selon les uns, un seul servant à clouer les deux pieds ; il était de quatre, plus vraisemblablement, selon les autres[37], un pour chaque main et un pour chaque pied. Toutes les peintures grecques représentent Jésus attaché à la croix avec quatre clous. En tout cas, que le nombre ait été de trois ou de quatre, ce qui est certain, c’est que le Sauveur avait été cloué â l’instrument de son supplice, comme le supposent expressément les paroles qu’il adressa à l’apôtre Saint-Thomas[38]. On conserve à Notre-Dame de Paris un clou de la passion qui a 90 millimètres de longueur ; il n’a pas de tête ; sa pointe méplate est intacte. Dans la basilique de Sainte-Croix-de-Jérusalem, à Rome, on voit un autre clou, qui a 12 centimètres de long et 8 millimètres ½ de grosseur à sa plus grande dimension ; sa têt est couverte d’une espèce de chapeau creux, au fond duquel il est rivé, comme dans d’autres clous antiques, tels qu’en possède, par exemple la Bibliothèque du Vatican[39]. La cathédrale de Trèves conserve un clou de forme semblable, qu’on dit avoir été donné par sainte Hélène à l’évêque de cette ville[40]. La pointe, qui manque, en fut détachée et cédée à l’église de Toul[41]. La célèbre couronne de fer qui servait au couronnement des empereurs et qui subsiste toujours à Monza, près de Milan, tire son nom d’un clou de la Croix, qui a été façonné en lame de fer et est attaché à la couronne principale en or pur, ornée de pierres précieuses[42]. Quand on conduisait un condamné au supplice, on attachait à son cou un écriteau faisant connaître la cause de sa condamnation, ou bien on le faisait porter devant lui ; quelquefois un crieur public proclamait le nom du coupable, son crime et son châtiment. L’écriteau mentionnant le nom et la qualité du Sauveur avait été préparé avant qu’il sortît du Prétoire, pour le précéder sur le chemin qui le menait au Calvaire[43].
La croix servait comme de tombeau au supplicié. Les Grecs et les Romains considéraient la privation de sépulture comme une aggravation de la peine ; le condamné était abandonné sur le gibet pour servir de pâture aux oiseaux de proie[49]. Mais du temps de l’empereur Auguste, on commença à permettre d’ensevelir les victimes de la justice[50] ; les Juifs demandèrent à Pilate l’autorisation de faire enlever le corps de Jésus et des deux larrons de la croix, afin qu’ils ne demeurassent pas exposés le jour de la fête de Pâques, et le procurateur y consentit[51]. Le brisement des os était le complément ou la fin du supplice de la croix. Ce supplice étant très lent, c’était peut-être un adoucissement introduit par la coutume pour abréger un peu l’effroyable longueur de l’agonie et accélérer la mort. Les deux larrons eurent ainsi les jambes rompues, mais le Sauveur, épuisé par tous les mauvais traitements qu’il avait endurés, avait déjà rendu le dernier soupir, et de même que pour l’Agneau pascal, qui était sa figure, aucun de ses os ne fut brisé[52]. Les soldats qui l’avaient crucifié se partagèrent ses dépouilles[53] et, comme sa tunique était sans couture, ils ne la divisèrent point, mais la tirèrent au sort[54]. La tradition rapporté qu’elle fut donnée en présent par l’impératrice Irène à Charlemagne et apportée de Constantinople en France. L’empereur la déposa à Argenteuil, où on la conserve encore, à l’exception des parties qui ont été enlevées à l’époque de la Révolution. La tunique était le principal vêtement de dessous ; par son usage, elle se rapprochait donc de la chemise ; par sa forme, elle ressemblait beaucoup à la blouse moderne. Elle descendait jusqu’aux chevilles, avec deux manches couvrant seulement la moitié des bras. Celle d’Argenteuil[55] a un mètre 45 de hauteur et un mètre 15 de largeur. Elle est tissée, en commençant par le haut, dans toute son étendue et sans couture. Le tissu est assez lâche et ressemble à du canevas fin, dont les fils, d’origine animale, seraient très tors. Elle a été faite à l’aiguille sur un métier fort simple, tel qu’une tablette recevant sur ses deux faces la chaîne et la trame[56]. L’Église de Trèves possède aussi une Sainte Tunique. Pour la conserver, on l’a depuis longtemps placée entre deux enveloppes. Celle de dessus est une étoffe de soie damassée, qui paraît provenir de l’Orient et remonter à une époque comprise entre le VIe et le IXe siècle. L’enveloppe de dessous est une sorte de gaze ou crêpe de Chine. Entre les enveloppes se trouvent des parties d’étoffe, adhérentes malgré des lacunes, et qui ont indubitablement formé à l’origine le vêtement entier. Elles constituent la véritable relique. La couleur en est grisâtre, le tissu très fin, la matière paraît être de toile ou de coton[57]. On ne saurait déterminer laquelle des deux tuniques, celle d’Argenteuil ou celle de Trèves, fut tirée au sort au Calvaire entre les soldats romains. L’une des deux reliques peut être la tunique de dessus, l’autre celle de dessous[58]. Pour ensevelir le Sauveur, on employa environ cent livres de myrrhe et d’aloès[59]. Ces parfums ont la vertu de garantir le corps de la putréfaction. Quatre ou cinq livres auraient pu suffire, afin d’embaumer le corps de Jésus, mais il fut plongé dans les parfums et non pas seulement enduit. Il fallut une grandi quantité de linges et de bandelettes pour maintenir cette quantité considérable d’aromates autour du corps sacré du Sauveur. Certaines momies égyptiennes sont enveloppées de deux à trois cents mètres de toile de lin. De même qu’on avait prodigué les parfums, on ne dut pas ménager le linge pour l’ensevelissement du divin Maître. Indépendamment de ces linges, dont parle saint Jean[60], Jésus avait été enveloppé d’un suaire par Joseph d’Arimathie[61], pour être porté du Calvaire au Saint-Sépulcre. On vénère un Saint Suaire à Turin en Piémont, celui qui enveloppait le corps, et un autre à Cadouin, dans la Dordogne, celui qui enveloppait la tête. Le Saint Suaire de Turin est une pièce d’étoffe de quatre mètres environ de longueur, en lin, un peu jauni par le temps et rayé comme du basin. De grandes taches, dont quelques-unes indiquent certainement la place de la tête[62], ne peuvent être attribuées qu’au sang divin dont ce saint suaire fut décoré. Le temps a fait dans le tissu des trous imperceptibles dont quelques-uns ont été réparés par les princesses [de Savoie][63]. Les statues des rois de Piémont, placées aux angles de la Chapelle, semblent monter la garde autour de la sainte Relique. La longueur du Saint Suaire [de Cadouin] est de 2 mètres 81 ; sa largeur de 1 mètre 13. La pièce d’étoffe est entière, ayant une lisière sur les deux côtés larges et une bordure coloriée sur les deux côtés longs... La couleur en est blanche, altérée par le temps ; mais la teinte qui en est résultée n’a aucun rapport avec la teinte écrue générale dans toutes les toiles qui ont servi à la sépulture dans l’ancienne Égypte[64]. Tous les monuments donnent unanimement à la relique de Cadouin le nom de Sudarium capitis Domini ou Suaire du chef du Seigneur[65]. Jésus fut enseveli dans le tombeau de Joseph d’Arimathie, où personne n’avait encore été déposé[66]. Ce tombeau était creusé dans le roc[67], selon une coutume commune dans le pays. On voit encore autour de Jérusalem et dans les environs une multitude de tombeaux de ce genre. Celui qui devait devenir si glorieux sous le nom de Saint-Sépulcre était composé, d’après la tradition, de deux chambres, dont la première formait le vestibule de la seconde. C’est dans cette dernière que fut placé le corps du divin crucifié. Il est impossible de se rendre exactement compte aujourd’hui, par l’inspection des lieux, de la disposition primitive. Sainte Hélène, en préparant le terrain pour isoler le tombeau du Sauveur, placé actuellement au milieu de la rotonde de l’Église du Saint-Sépulcre, modifia la forme du monument et le rendit quadrangulaire. La première chambre du tombeau, nommée chapelle de l’Ange, parce qu’on croit qu c’est là que l’ange annonça aux saintes femmes la résurrection du Sauveur[68], est une sorte de vestibule long de 3 mètres 45, sur 2 mètres 90 de large. On entre en se baissant, par une petite porte très basse, percée dans le mur ouest, dans la seconde chambre, appelée chapelle du Tombeau de Notre-Seigneur. Cette chapelle a 2 mètres 07 de long sur 1 mètre 93 de large. Des plaques de marbre blanc couvrent le roc naturel. Le tombeau proprement dit s’élève de 65 centimètres au-dessus du pavement ; il est long de 1 mètre 89 et large de 93 centimètres, creusé en forme d’auge et adhérent aux parois nord-ouest et est. On le fermait à l’aide d’une grande pierre, qu’on roulait devant la porte extérieure[69]. Une pierre de ce genre, qui ferme encore aujourd’hui le tombeau dit des Rois à l’ouest de Jérusalem, permet de se rendre parfaitement compte de ce que racontent les Évangiles. Cette pierre a la forme d’une meule[70]. On la fait mouvoir en la roulant. Si l’on veut fermer le tombeau, on la roule devant l’ouverture. Pour ouvrir le tombeau, on pousse la pierre dans une petite galerie, à ciel ouvert, creusée à gauche dans le roc vif et suffisamment longue pour dégager complètement l’accès du sépulcre. -Quand cette pierre roulante est placée devant la porte, il est facile d’y mettre des sceaux et l’on ne peut plus pénétrer dans l’intérieur du monument sans les rompre. Jésus voulut que son tombeau fût scellé[71] et gardé par des soldats[72] afin que le miracle de sa résurrection fût plus glorieux et plus manifeste. |
 Le Jardin des Oliviers ou Gethsémani est situé au nord-est
de Jérusalem, au bas du mont des Oliviers, à côté du torrent de Cédron, sur
sa rive orientale. Gethsémani signifie pressoir à huile. Le jardin est
aujourd’hui entouré d’un mur
Le Jardin des Oliviers ou Gethsémani est situé au nord-est
de Jérusalem, au bas du mont des Oliviers, à côté du torrent de Cédron, sur
sa rive orientale. Gethsémani signifie pressoir à huile. Le jardin est
aujourd’hui entouré d’un mur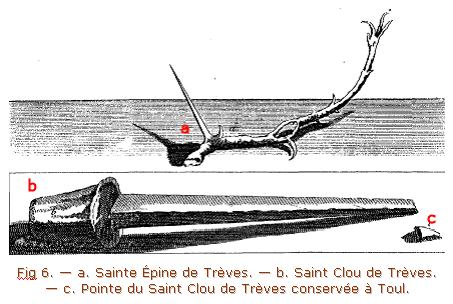
 Les trois premiers évangélistes n’ont pas rapporté mot à
mot l’inscription ; ils n’en ont donné que le sens
Les trois premiers évangélistes n’ont pas rapporté mot à
mot l’inscription ; ils n’en ont donné que le sens