LE NOUVEAU TESTAMENT ET LES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES MODERNES
LIVRE PREMIER — DE L'AUTHENTICITÉ DES ÉCRITS DU NOUVEAU TESTAMENT PROUVÉE PAR LEUR LANGAGE
CHAPITRE II. DE LA LANGUE PARLÉE PAR NOTRE-SEIGNEUR ET LES APÔTRES.
|
La question de savoir quelle a été la langue parlée par Notre-Seigneur pendant sa vie mortelle est intéressante en elle-même. Elle excite la légitime curiosité de tous les chrétiens instruits. Notre langage est comme une partie de notre personne et de notre vie, et l’idiome qui a été sanctifié en passant par les lèvres divines du Sauveur, celui qui a servi à prononcer le sermon sur la montagne, les paraboles évangéliques, les discours de la Cène et tous les enseignements que nous a apportés du ciel le Verbe incarné mérite bien d’être l’objet de nos recherches. Mais en nous livrant à cette investigation, nous ne satisferons pas seulement une pieuse curiosité ; nous pourrons atteindre le but plus important encore, que nous avons annoncé, celui d’apporter, parce moyen, de nouvelles preuves en faveur de l’authenticité des Évangiles et des écrits du Nouveau Testament en général. La langue qu’a parlée Notre-Seigneur est celle qu’ont parlée ses Apôtres et ses Évangélistes. Quoique des circonstances diverses aient engagé les écrivains du Nouveau Testament à écrire en grec, si le grec n’est pas leur langue maternelle, nous devrons retrouver dans les œuvres qu’ils nous ont laissées des traces de l’idiome qu’ils parlaient en Palestine, et nous pourrons ainsi constater, par cet examen intrinsèque, l’origine judaïque des Évangiles et des Épîtres. La détermination de la langue parlée par Jésus-Christ et par ses Apôtres a donné lieu à de nombreuses discussions[1]. Nous allons raconter d’abord l’histoire de cette controverse. ARTICLE Ier. — HISTORIQUE DE LA QUESTION. Le Nouveau Testament nous apprend qu’au temps de Notre-Seigneur on parlait en Palestine une langue appelée langue hébraïque[2]. Les recherches philologiques de notre siècle nous la font bien connaître et il est maintenant facile de s’en faire une juste idée. On pourrait être induit en erreur sur la nature de cette langue par le nom que lui ont donné les écrivains du Nouveau Testament : elle est appelée hébraïque parce qu’elle était parlée par les Hébreux[3] ; mais elle est différente de l’hébreu proprement dit, c’est-à-dire de celui dont se sont servis Moïse, David, les historiens et les prophètes de l’Ancien Testament. La famille des langues sémitiques comprend l’arabe, qui se parlait et se parle encore en Arabie, dans une partie de l’Asie et de l’Afrique ; l’éthiopien, qu’on parlait en Éthiopie ; l’assyrien, qu’on parlait en Assyrie et en Chaldée ; l’araméen, qu’on parlait dans le pays d’Aram ou Syrie et enfin l’hébreu, qu’on parlait en Palestine avant la captivité[4]. Après la captivité, l’hébreu proprement dit devint une langue morte ; il fut remplacé par l’araméen. L’araméen ou langue du pays d’Aram était usitée, non seulement dans la Syrie, mais aussi en Chaldée et dans l’ancienne Assyrie, où de nombreuses tribus araméennes avaient été déportées par les rois de Ninive et de Babylone. L’ancien hébreu avait les affinités les plus étroites avec l’araméen. Les habitants de Juda et de Jérusalem, transportés sur les bords de l’Euphrate, étant moins nombreux que les Araméens, durent y perdre l’habitude de parler leur propre langue, pour se faire entendre de leurs compagnons d’infortune et aussi des indigènes, à qui l’araméen était devenu familier[5]. C’est parce que les Juifs s’accoutumèrent à parler cette langue en Chaldée qu’elle reçut le nom de chaldaïque, quoique cette dénomination ne soit pas plus exacte que celle d’hébraïque. L’araméen se subdivisait en deux branches ou dialectes l’araméen occidental, qu’on a plus spécialement appelé syriaque, et l’araméen oriental, auquel on a donné le nom de chaldaïque ou syro-chaldaïque. Le premier se parlait en Syrie, le second en Babylonie : c’est donc l’araméen oriental que les Juifs apprirent dans ce dernier pays. Après la captivité, étant de retour dans leur ancienne patrie, ils continuèrent à en faire usage, et ils s’en servaient encore du temps de Notre-Seigneur, qui a par conséquent parlé ce dialecte, ainsi que ses Apôtres, comme nous allons le démontrer. On a émis, au sujet de la langue parlée par le Sauveur, des opinions singulières. On a supposé, par exemple, que Jésus avait parlé latin ou grec. Wernsdorf a écrit un traité : De Christo latine loquente[6]. Pour prouver que le Sauveur parlait latin, il s’appuie sur certaines expressions, d’origine romaine, qui se lisent dans les Évangiles. On rencontre, il est vrai, des mots latins dans les discours du Sauveur : modius (boisseau)[7], legio (légion), quadrans (la quatrième partie de la monnaie appelée as)[8] ; mais de l’emploi d’un terme militaire, d’un nom de mesure ou de monnaie[9], on ne peut conclure que celui qui s’en sert parle l’idiome même à laquelle ce mot est emprunté[10]. Dans toutes les langues, on emprunte des mots de ce genre ; le français n’en est pas moins différent de l’anglais, malgré les mots que nous avons pris à nos voisins, comme par exemple, les rails, les wagons et les tramways, etc., et nous ne parlons pas néanmoins anglais, même quand nous employons les termes que nous venons de citer. Quoique les Romains fussent assez nombreux en Judée au premier siècle de notre ère, quoique une partie des monnaies qui étaient en circulation dans le pays portassent une légende latine, la langue des vainqueurs n’y était nullement devenue vulgaire[11]. Au premier abord, le sentiment de ceux qui pensent que Notre-Seigneur a parlé grec pourrait paraître plus vraisemblable. Cette opinion a eu ses défenseurs ; elle en a même encore[12]. Isaac Vossius fut le premier qui imagina de soutenir que !e Sauveur des hommes avait parlé grec. La Judée seule, disait-il, ne pouvait avoir échappé au sort commun des provinces conquises par Alexandre le Grand et ses successeurs ; elle ne pouvait avoir conservé seule sa propre langue, au lieu d’adopter celle des conquérants ; d’où il concluait que le, grec était la seule langue parlée en Palestine depuis l’invasion macédonienne en Asie[13]. Les prémisses de Vossius étaient fausses : s’il est vrai que l’on parlait grec à la cour des généraux d’Alexandre, devenus rois d’Égypte et de Syrie, il est vrai aussi que le peuple continua à parler copte en Égypte et araméen en Syrie comme le prouve la littérature de ces deux pays. Dominique Diodati[14] fut néanmoins séduit par la théorie de Vossius et il la soutint à Naples en 1767. Jésus et les Apôtres, d’après lui, parlèrent le grec connu sous le nom de langue hellénistique. Le savant Bernard de Rossi publia, pour le réfuter, une monographie qui est demeurée célèbre : De la langue dit Christ et des Hébreux de la Palestine depuis le temps des Macchabées, publiée à Rome en 1772[15]. La langue hellénistique, dit-il, était peu connue en Palestine ; Jésus-Christ, comme tous ses compatriotes, parlait un dialecte sémitique mixte ; Rossi appelle ce dialecte syro-chaldaïque. A la suite de sa publication, il se produisit en Allemagne, où ses conclusions avaient été acceptées par Pfannkuche[16], une opinion intermédiaire. Le Dr Gottlob Paulus, professeur à Iéna[17], reconnut que la langue vulgaire des Juifs de Palestine, au commencement de notre ère, était en effet un dialecte araméen, mais, ajoutait-il, il faut aussi admettre que le grec était alors assez répandu dans le pays, et en particulier en Galilée et à Jérusalem, pour que !e Sauveur et ses disciples pussent en faire usage dans leurs discours publics, toutes les fois qu’ils le jugeaient à propos[18]. Paulus fut réfuté par un illustre savant français, Silvestre de Sacy, qui défendit le sentiment qu’avait déjà défendu de Rossi contre Diodati[19]. Sans nier absolument que Jésus et ses disciples aient pu parler quelquefois grec, il montre très bien qu’on n’a aucune preuve qu’ils l’aient fait, et il établit que la langue parlée à cette époque en Palestine était l’araméen. Aujourd’hui presque tous les savants et les critiques se rangent à l’avis de Bernard de Rossi et de Silvestre de Sacy[20]. Cependant les partisans de la langue grecque n’ont pas complètement désarmé. Un savant anglais, le Dr Roberts avait publié en 1862 un écrit dans lequel il soutenait l’opinion de Paulus[21]. Toutes les réfutations dont ce premier ouvrage avait été l’objet ne l’ont pas ébranlé, et il est rentré en lice en 1888 par la publication d’un nouveau volume où il maintient toujours son sentiment[22]. Quelques-unes de ses raisons peuvent paraître spécieuses, mais elles ne sont pas solides. C’est ce que nous allons démontrer. ARTICLE II. — LE GREC N’A PAS ÉTÉ LA LANGUE DE NOTRE-SEIGNEUR ET DES APÔTRES. Avant d’établir directement que l’araméen était la langue que parlaient Notre-Seigneur et les Apôtres, nous allons exposer et réfuter les arguments de Paulus, du Dr Roberts et de leurs partisans.
Personne ne conteste les faits qu’ils allèguent. Qu’il y eût des villes, Césarée, Sepphoris, Tibériade, Gadara, où l’élément gréco-macédonien fût considérable et où l’on parlât en conséquence grec, comme on parle aujourd’hui le français au Caire, à Jérusalem, à Constantinople ou à Athènes, nous n’y contredirons pas. Les étrangers apportaient et gardaient leur propre langue dans les lieux où ils étaient groupés ensemble. Qu’il y eût aussi des Israélites qui comprissent le grec, cela est également certain. Ceux qui habitaient l’Égypte et les autres pays où cette langue était usuelle devaient naturellement s’en servir. Comme un certain nombre de Juifs hellénistes séjournaient en Judée et en Galilée, il y en avait également toujours dans ces provinces qui parlaient le grec. Quelques-uns de ceux qui étaient nés en Palestine avaient pu également apprendre cette langue ; mais rien ne prouve que Jésus et ses disciples fussent de ce nombre. De ce que les monnaies d’Hérode portent des légendes grecques, il ne s’ensuit nullement que la connaissance de cette langue fût générale dans son royaume. Les monnaies anglaises portent encore aujourd’hui une légende latine, quoique le latin ne soit pas parlé dans la Grande-Bretagne. Nous n’avons aucune preuve que le Sauveur ait parlé grec au centurion[30]. Cet officier pouvait avoir appris assez d’araméen pour se faire entendre des gens du pays, ou bien il pouvait parler par interprète, de même que les Grecs qui désiraient s’entretenir avec Notre-Seigneur. Les drogmans ont toujours été connus en Orient[31]. Aucun des faits allégués n’établit donc la thèse soutenue par Paulus et M. Roberts. Mais ils apportent encore d’autres raisons. Quand le Sauveur, disent-ils, s’adressait aux foules, comme elles se composaient d’auditeurs de nationalités diverses, il devait se servir de la langue qui était comprise de tous et cette langue ne pouvait être que le grec. C’est ce dernier point qu’il faudrait démontrer. La plupart des Israélites, au contraire, ne savaient certainement pas le grec. Ce qui est raconté dans le livre des Actes du don des langues et de l’étonnement que manifestent, avec les habitants de Jérusalem, les Juifs de tous pays qui y sont rassemblés, quand ils voient que les Apôtres sont compris de tous leurs auditeurs[32], venus des diverses parties du monde, nous montre bien qu’il n’y avait pas une langue commune à l’aide de laquelle on pût se faire comprendre de tous en Palestine. Mais M. Roberts est si prévenu en faveur de son système qu’il va jusqu’à transformer en preuves de son opinion les arguments mêmes qui la détruisent. Si Notre-Seigneur, dit-il, parlait araméen quand il s’adressait à la multitude, pourquoi l’Évangile nous fait-il remarquer que, pour ressusciter la fille de Jaïre, il prononça quelques mots en cette langue[33] ? C’est évidemment parce qu’il n’avait pas coutume de s’en servir. — Les termes araméens conservés par le texte sacré démontrent, au contraire, que le langage de Notre-Seigneur n’était pas le grec. L’Évangéliste ne les a pas rapportés pour indiquer que Jésus se servit en cette circonstance d’un idiome dont il ne faisait pas ordinairement usage[34], — rien dans son récit n’autorise à tirer cette conclusion, — mais parce que la grandeur du miracle, produit par deux simples mots sortis de la bouche du maître : Thalitha coumi, avait tellement frappé les spectateurs que ces mots étaient restés gravés dans leur mémoire. Voilà pourquoi saint Marc, qui les avait appris de la bouche du prince des Apôtres, témoin de la scène, nous les a conservés. Un discours de saint Pierre fournit un autre argument aux partisans du grec. Saint Pierre, parlant aux Apôtres rassemblés au Cénacle, rappelle la fin tragique de Judas et l’usage qu’on fit de l’argent de sa trahison, avec lequel on acheta un champ pour servir de sépulture aux étrangers, puis il ajoute : Le fait est connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ est appelé dans leur langue Haceldama, c’est-à-dire le champ du sang[35]. Puisque le chef de l’Église explique en grec le sens du mot Haceldama, c’est, dit-on, parce qu’il parlait grec. On attribue ici à saint Pierre une interprétation qui est de saint Luc. Ce passage de l’auteur des Actes est en réalité tout à fait concluant contre la thèse de Paulus et de M. Roberts. Il atteste d’abord de la manière la plus formelle que la langue qu’on parlait à Jérusalem n’était pas le grec : Ce champ fut appelé, dans leur langue, Haceldama. L’interprétation du mot était indispensable pour les lecteurs grecs des Actes, parce que c’est la signification du mot Haceldama, « champ du sang, -, qui prouve la vérité de ce que dit saint Pierre. Mais si saint Luc avait besoin de donner à ses lecteurs l’explication d’Haceldama, il n’en était pas de même pour saint Pierre parlant aux Apôtres. Ceux-ci savaient aussi bien que lui l’araméen et comprenaient parfaitement le sens d’Haceldama. Saint Pierre, s’adressant en araméen à ses compatriotes, ne pouvait leur traduire en grec des mots araméens. Que si l’on voulait supposer, contre toute vraisemblance, qu’il parlait grec aux Galiléens rassemblés avec lui dans le Cénacle, il n’en resterait pas moins vrai que l’interprétation eût été inutile dans la bouche du prince des Apôtres, comme, le serait, dans la bouche d’un Breton, parlant en français à un auditoire exclusivement composé de ses compatriotes, l’explication d’un nom propre breton. La traduction du nom du champ acheté avec les trente deniers de Judas est donc dans cet endroit, comme dans les passages analogues des Évangiles, l’œuvre de l’écrivain sacré, non de l’orateur juif. L’auteur des Actes raconte encore[36] que saint Paul, s’adressant aux habitants de Jérusalem, leur paria en hébreu au milieu d’un grand silence. C’est là, observe le Dr Roberts, la preuve que saint Paul avait coutume de parler grec. Personne, assurément, ne contestera que saint Paul ne connut le grec. Mais il n’était pas juif palestinien, il était de Tarse en Cilicie, pays où le grec était une langue usuelle. On ne peut donc induire de là que les autres Apôtres et Jésus se servaient aussi du grec ; car Notre-Seigneur n’avait jamais habité de pays grec et ses disciples étaient nés et ils avaient toujours vécu en Palestine, avant leur dispersion dans le monde. Du reste l’épisode en question montre bien, contre les partisans de la langue hellénique, qu’on n’avait pas l’habitude de parler grec à Jérusalem, car, en cette circonstance, saint Paul ayant demandé au tribun Lysias de s’entretenir avec lui en particulier, Lysias lui dit : Savez-vous le grec ?[37] La connaissance de cette langue était donc une chose exceptionnelle. C’est, au surplus, un fait avéré qu’aucun Juif de Palestine, avant la ruine du second Temple, n’a écrit de livre en grec, à cause de l’ignorance générale du grec dans ce pays[38]. On allègue enfin en faveur de l’opinion de M. Roberts que la plupart des citations de l’Ancien Testament faites dans le Nouveau sont conformes à la version grecque des Septante et non au texte hébreu original ; mais l’explication de cette particularité est bien facile : les auteurs sacrés ont écrit en grec et pour les Grecs qui avaient entre les mains la version grecque des Septante, non le texte hébreu original ; ils ont donc cité l’Écriture d’après la traduction qui était connue de leurs lecteurs[39]. Aucune des raisons apportées en faveur de l’opinion que Notre-Seigneur et ses Apôtres auraient parlé la langue hellénistique en Palestine n’a donc de valeur démonstrative. Cela est si vrai que M. Roberts lui-même est obligé de convenir qu’on ne trouve dans le Nouveau Testament aucune preuve directe de sa thèse. Au contraire le sentiment opposé est établi par plusieurs faits certains et incontestables. ARTICLE III. — L’ARAMÉEN, LANGUE DE NOTRE-SEIGNEUR ET DES APÔTRES. On ne peut nier d’abord que la langue néo-hébraïque ou araméenne ne fût la langue du peuple sous les Asmonéens. Le second livre des Macchabées l’appelle expressément patria lingua[40], c’est-à-dire la langue du pays. Du temps de Notre-Seigneur, elle était encore la langue du pays, et c’est par conséquent la langue que parlaient Jésus-Christ et ses disciples. En voici les preuves : Les renseignements épars dans le Nouveau Testament et dans les monuments de la littérature juive composés vers le premier siècle de notre ère, attestent que les habitants de la Palestine parlaient à cette époque un dialecte araméen. Les Juifs nés en pays étranger et qui se trouvaient à Jérusalem soit en passant soit d’une manière stable, parlaient le grec ; de rares indigènes qui l’avaient appris au moyen de maîtres étaient en état de le comprendre, mais c’étaient là des exceptions : l’araméen était la langue courante et ordinaire. Les Évangiles nous en fournissent de nombreuses preuves, soit dans les noms propres qu’ils contiennent, soit dans quelques phrases qu’ils ont conservées, soit enfin dans leur rédaction même. Parmi les noms propres, examinons d’abord les noms de personnes. Cette preuve, assurément, n’est pas la plus forte, parce que les noms d’hommes ne sont pas toujours tirés de la langue en usage : il y a parmi nous des noms anglais, allemands, James, Édith, etc. Au premier siècle de notre ère, les noms de personnes étaient mêlés en Palestine, comme il arrive toujours dans les pays où sont mélangées des nations et des races diverses. Les noms hébreux, qui jouissaient d’une longue possession, y sont naturellement nombreux : Jésus, Marie, Joseph, Jean, Siméon (Simon), Jacques (Jacob), Anne, etc., sont tirés de l’ancien hébreu. Les noms grecs, provenant de la langue qu’on parlait dans la plus grande partie des pays de la dispersion, ne sont pas très rares : Philippe, Nicodème, Étienne (Stéphanos), Nicolas, Nicanor. La langue des vainqueurs, le latin, compte aussi quelques noms : Marc, Lucas, etc. Cependant l’idiome qui fournit le plus fort contingent, c’est l’araméen. Nous remarquons d’abord toute la série des noms qui commencent par Bar : Barabbas, Barthélemy, Barjésu, Barjona, Barnabé, Barsabas, Bartimée. Tous ces mots sont incontestablement araméens, car le substantif bar, fils, est caractéristique des langues araméennes ; l’hébreu dit ben au lieu de bar. Plusieurs autres noms d’hommes ou de femmes sont aussi certainement araméens : Thomas, jumeau[41], Caïphe, pierre ou dépression[42], Saphire, belle[43], Marthe, dame ou maîtresse[44], Tabitha, biche[45], Céphas, pierre, Boanergès, fils du tonnerre[46]. Ces deux derniers surnoms, donnés, le premier au prince des Apôtres, le second aux deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, méritent surtout attention. On sait dans quelles circonstances, et pour quelle raison, Jésus-Christ donna à Simon le surnom de Céphas ou Pierre, pour marquer la place que tiendrait cet Apôtre dans l’Église, dont il devait être le fondement[47]. Nous voyons par le récit sacré que le Maître ne donna pas au disciple son nom symbolique en grec : Petros, mais en araméen : Képha. Il ne lui dit pas : Tu seras appelé Petros, mais : tu seras appelé Céphas, ce qui, ajoute l’Évangéliste, signifie Pierre[48]. Jésus-Christ ne parlait donc pas grec, mais araméen. On peut tirer la même conclusion du surnom donné aux deux fils de Zébédée. Les surnoms sont significatifs dans toutes les langues et ils sont tirés de la langue usuelle. Or, la qualification de Boanergès ou fils du tonnerre, attribuée à Jacques et à Jean[49] ; est araméenne et non grecque. Le titre qui est donné à Jésus, celui de Messie (traduit en grec par Christos, d’où notre nom de Christ) est aussi un titre purement sémitique[50]. Les noms de lieux prouvent, comme les noms de personnes, que la langue araméenne était la langue en usage dans la Palestine. Naturellement les noms anciens sont restés les mêmes, mais les noms nouveaux qu’on a en occasion de donner à des endroits particuliers de Jérusalem, par exemple, sont tirés du dialecte syrien, comme Golgotha, Béthesda, Gabbatha, Haceldama. Dans tous ces noms, on voit du premier coup d’œil la terminaison caractéristique des mots araméens, a’. Golgotha ou le Calvaire[51], le crâne ou chauve, serait en hébreu Gulgôlet ; il n’est pas grec, non plus que tous les autres noms que nous venons de citer, mais néo-hébreu ou araméen, comme le disent expressément les Évangélistes. Béthesda[52] signifie maison de miséricorde ; Gabbatha, hauteur[53]. Haceldama, le champ du sang, est de tous les mots cités le plus important, parce que, comme nous savons que ce nom a été donné au champ acheté avec les trente deniers de Judas, il est, si l’on peut dire, daté et prouve que l’on parlait araméen en Palestine, à l’époque de la mort de Notre-Seigneur. Il se compose de deux mots hagal, champ, et demâ, sang[54]. La forme demâ’, est incontestablement araméenne. Outre les noms propres de personnes et de lieux, il y a de plus, dans le Nouveau Testament, un certain nombre de mots qui sont rapportés par occasion et qui nous fournissent une nouvelle preuve qu’on parlait en Palestine une langue sémitique au premier siècle de notre ère. Par exemple, les Apôtres donnent souvent à Jésus un titre qui nous a été conservé plusieurs fois dans sa forme originale, quoique d’autres fois il ait été traduit, celui de rabbi[55], qui est araméen et correspond à Maître[56]. Rabboni, s’écrie aussi Marie-Madeleine, quand elle reconnaît son Sauveur ressuscité[57], donnant de la sorte à Notre-Seigneur la qualification de maître par excellence[58]. Au jour de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la foule l’accueille avec des acclamations dont une locution araméenne, qui nous a été transmise, est le trait principal : Hosanna, sauvez, je vous prie[59]. Les écrivains du Nouveau Testament ont été obligés de se servir d’un certain nombre de mots qui étaient propres aux Juifs et n’avaient aucun équivalent en grec, comme le nom d’une liqueur fermentée enivrante, appelée sikéra par saint Luc[60], celui de la mesure appelée saton[61], celui de la fête de Pâques, ceux des sectes juives, la secte des Pharisiens et la secte des Sadducéens. La forme qu’ont donnée les Évangélistes à ces mots dans leurs transcriptions fournit une preuve certaine que les Juifs d’alors parlaient un dialecte araméen. La terminaison aios qui est donnée[62] au mot Pharisien et au mot Sadducéen, en grec, indique en effet une désinence araméenne, c’est-à-dire la désinence en a’, qui caractérise un grand nombre de mots syriaques : pherisà’, sedouqa, tandis que la désinence hébraïque est i, pherisà’, sediqi. Le nom de mesure, saton, qui a été aussi conservé par notre Vulgate, satum, et qui est employé pour désigner une mesure équivalent à treize litres environ[63], dans la parabole du levain[64], est passé dans le grec sous sa forme syro-chaldaïque sa’ta ; la forme hébraïque est se’âh. Il en est de même de la dénomination de la fête appelée pascha[65], d’où nous avons tiré Pâque. Cette solennité est nommée en hébreu Pesah, mot que la Vulgate a rendu souvent par Phase dans l’Ancien Testament[66] ; mais cette forme pesah devient pasha’ ou pascha[67], dans le dialecte chaldaïque, et c’est pour cela que le Nouveau Testament appelle toujours ainsi la solennité de l’immolation de l’Agneau pascal. La transcription Satanas[68], désignant le chef des démons, indique également la forme syriaque : sâtânâ, non la forme hébraïque : sâtân. Le titre du Messie, Messias[69], a pris aussi une terminaison araméenne dans saint Jean[70]. Les quatre Évangiles mettent fréquemment dans la bouche du Sauveur l’adverbe amen, en vérité, certainement[71], qui nous montre bien que Notre-Seigneur s’exprimait en sémitique et que c’était là une de ses expressions favorites. C’est pour ce motif que ses historiens ont dû nous la conserver, ne trouvant point d’ailleurs dans la langue grecque de mot qui rendît à leur gré les nuances de cette locution[72]. Le sermon sur la montagne contient, indépendamment d’amen, qu’on retrouve dans tous les discours de Notre-Seigneur, quelques autres mots sémitiques sortis de sa bouche sacrée : raca, gehenna, mammona. Nous y lisons d’abord : Quiconque dit à son frère : raca, sera exposé à être jugé par le conseil ; mais celui qui lui dira : môré, sera exposé à la géhenne de feu[73] ou l’enfer. Le mot raca[74], forme araméenne de l’hébreu rîq, signifie vide. Le Talmud l’emploie dans le sens de vide, stupide[75]. Moré est la traduction du sémitique nâbâl, qui signifie fou et impie[76]. Le mot gehenna, dans son sens primitif, est une abréviation de gé-ben-hinnom, la vallée du fils d’Hinnom, vallée située à l’ouest et au sud de Jérusalem, où l’on brûlait les cadavres des suppliciés, et où l’on avait aussi offert des enfants en sacrifice au dieu Moloch. Dans les Évangiles, Notre-Seigneur se sert de ce nom pour désigner l’enfer[77]. Quant à mammona[78], il n’existe pas en hébreu. En araméen, il signifie richesses, trésor[79]. Dans un autre discours de Notre-Seigneur, rapporté par saint Marc, Jésus s’exprime ainsi : Vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa mère : Le corban, c’est-à-dire le don qui est offert par moi vous servira, etc.[80] Corban a en effet en chaldaïque le sens de don, comme corbanas, que nous lisons en saint Matthieu[81], signifie le trésor sacré où sont reçus les dons offerts au Temple. Parmi les mots employés par Notre-Seigneur, nous trouvons aussi en saint Marc : abba, forme araméenne du mot hébreu ‘ab, qui veut dire Père[82]. Toutes ces expressions montrent bien que Jésus-Christ parlait un dialecte sémitique. Mais les Évangélistes ne nous ont pas conservé seulement des mots isolés du Sauveur, qu’ils ont enchâssés dans la traduction grecque de ses discours, parce qu’ils ne trouvaient pas de mots helléniques propres à en rendre exactement le sens ; ils nous ont conservé aussi des phrases courtes mais complètes, qui avaient été prononcées dans des circonstances solennelles ; et que pour ce motif ils ont tenu à nous faire connaître dans les termes mêmes dont s’était servi le Christ. C’est ainsi que saint Marc nous apprend que Jésus guérit un sourd-muet en lui touchant la langue et en disant : Ephphatha, c’est-à-dire ouvre-toi[83], et qu’il ressuscita la fille de Jaïre en la prenant par la main et lui disant en langue araméenne : Talitha coumi, c’est-à-dire, jeune fille, lève-toi[84]. Saint Marc nous a aussi transmis en araméen, de même que saint Matthieu, le passage des Psaumes[85] prononcé par Notre-Seigneur sur la croix : Elohi, Elohi, lema sabachtanei, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?[86] Ces paroles de Notre-Seigneur et l’ensemble des arguments que nous avons rapportés sont plus que suffisants pour démontrer que la langue parlée par Jésus et ses Apôtres était un dialecte araméen. Tous les autres monuments de cette époque, d’accord avec les Évangiles, établissent également que le chaldéen était la langue usuelle de la Palestine au premier siècle de notre ère. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, a inséré une phrase étrangère : Maran atha : Notre-Seigneur vient[87]. Elle est araméenne. Josèphe, qui était contemporain des Apôtres, appelle l’araméen la langue du pays[88]. Il nous apprend que, pendant la guerre contre les Romains, il parlait hébreu, c’est-à-dire araméen, à ses soldats. Pendant le siège de Jérusalem, il servait d’interprète entre les Juifs et les Romains[89]. Nous savons aussi par son témoignage que les Juifs, qui parlaient l’araméen oriental, pouvaient comprendre les Syriens qui parlaient l’araméen occidental, tant les différences entre les deux dialectes étaient peu sensibles. Quoique ce savant juif fût un des hommes les plus instruits de sa nation, il n’apprit pas sans peine le grec, qu’il ne sût même jamais bien prononcer, dit-il[90], et il écrivit d’abord son histoire de la Guerre des Juifs en langue hébraïque[91]. Il cite dans ses ouvrages quelques mots sémitiques et il les reproduit sous leur forme araméenne. C’est ainsi qu’il remarque que les Hébreux expriment le mot rouge par adôma[92] ; prêtre par chanaias[93] ; Pentecôte par asartha[94] ; boiteux par chageiras[95], etc.[96] Tous ces faits, qui établissent d’une façon si péremptoire que l’araméen était la langue parlée en Palestine et la seule qui fût généralement connue, sont confirmés aussi par les écrits talmudiques. Non seulement les Targums, la Ghemara du Talmud et les Midraschim[97], c’est-à-dire les commentaires des plus anciens des Juifs, sont composés en syro-chaldaïque, mais ils rapportent aussi des proverbes et des dictons populaires qui, tout en différant parla prononciation et par quelques autres particularités de la langue des rabbins et des docteurs, appartiennent cependant au même idiome. Ces citations populaires sont précédées des mots : comme le dit le peuple, ou autres semblables. Quand le célèbre rabbin Hillel donne une explication en langage populaire, cette explication est annoncée par les mots : Hillel explique dans le langage du commun peuple[98]. La Mischna dit qu’il y avait dans le temple de Jérusalem des vases avec des inscriptions araméennes[99]. D’après une tradition, le grand-prêtre Johanan entendit une voix céleste sortant du sanctuaire, qui lui dit en araméen : Les jeunes gens qui ont entrepris la guerre contre Antiochus sont victorieux[100]. Les prières les plus anciennes en usage parmi les Juifs, en dehors des textes scripturaires, sont en araméen[101]. Les lettres que Gamaliel l’ancien adressa aux habitants de la haute et de la basse Galilée pour la fixation de la nouvelle lune, sont aussi en cette langue[102]. Il est donc établi par tous les monuments littéraires du commencement de notre ère que la langue de la Palestine, au temps de Jésus-Christ et des Apôtres, était un dialecte sémitique. Ce fait est d’une grande importance pour la critique du Nouveau Testament. Il en découle des conséquences que nous devons maintenant exposer. Montrons d’abord pourquoi et comment les auteurs des Évangiles et des Épîtres ayant parlé dans leur enfance un idiome oriental, cet idiome a dû laisser son empreinte, même dans leurs écrits grecs, de sorte que les traces du dialecte sémitique soient visibles dans les couvres qu’ils nous ont laissées. |
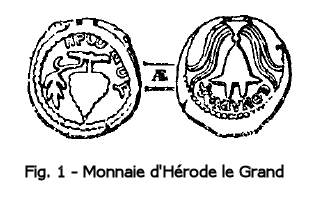 Le premier point qu’ils cherchent à démontrer, c’est que
le grec était connu en Palestine. La preuve en est qu’on se servait
couramment de cette langue dans plusieurs villes de Palestine, à Sepphoris, à
Césarée, à Tibériade
Le premier point qu’ils cherchent à démontrer, c’est que
le grec était connu en Palestine. La preuve en est qu’on se servait
couramment de cette langue dans plusieurs villes de Palestine, à Sepphoris, à
Césarée, à Tibériade