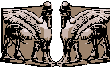ÉMIGRATION DES CANANÉENS
CHASSÉS DE PALESTINE EN AFRIQUE ET PARTICULIÈREMENT À LEPTIS OU EN TRIPOLITAINE.
|
Abrégé du
Mémoire lu à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans les séances
des 1er, 15 et Par le Père VERDIÈRE
de I. Une vue d’histoire générale dirige nos recherches sur ce sujet restreint et sur quelques études monographiques au sujet de Leptis. Septime Sévère, et Caracalla, originaires de cette ville, en ont gardé le caractère, les mœurs et le culte. D’autre part les Basssiens d’Émèse, Phéniciens (τό γένος Φοίνισσα, άπό Έμέσου έν Φοινίαη, Hérodien, V), s’allièrent à cette branche punique de leur dynastie, en la personne de Julie Domna, épouse et mère de ces princes, grand’tante maternelle d’Élagabal et d’Alexandre Sévère ; et cette union tendait aussi à réunir étroitement le génie des deux branches, d’une même race comme ces deux branches d’une même famille, fait qu’on remarque surtout dans l’alliance du dieu Élagale avec Céleste, déesse de Carthage. L’unité singulière de ces deux rameaux puniques et phéniciens parait dès les temps les plus reculés, surtout par l’exemple de l’entente séculaire, qui règne entre Tyr et Carthage, républiques que leur commerce, étendu à tout le monde antique, aurait dû mille fois diviser, tandis qu’elles ne semblent former que comme une seule maison commerçante, l’immense entrepôt principal de l’antiquité. La race de Canaan conserve quelque chose de ce rôle universel dans l’empire romain et dans l’Église, au commencement du IIIe siècle, de 198 à 235, époque où nous concentrons plus en particulier notre étude. C’est le temps de Tertullien, de l’école établie à Béryte par le Phénicien Papinien et Ulpien de Tyr, de la plus violente et la plus perfide des persécutions qui eût encore été dirigée contre la foi par cette race phénicienne, et de la transformation chrétienne du même peuple, au commencement de la grande Église d’Afrique, quand elle recevait les prémices de l’Esprit. Outre cet intérêt de monographie au point de vue de
l’histoire générale, Leptis ou, avec plus de latitude, II. Abordons la discussion
des textes sur son origine proprement cananéenne par les plus connus, le
texte qu’on attribue à Eusèbe et l’inscription rapportée par Procope.
Le premier (Chron.
gr., liv. I) prouverait directement la fondation de Tripoli par
les Cananéens fugitifs. Mais Scalinger l’a tiré du Syncelle, qui insère dans
la chronique d’Eusèbe des textes postérieurs à ce dernier historien. Il faut
donc établir l’émigration cananéenne indirectement, mais plus sûrement, par
l’inscription de Procope (Bell. Vandal., II, 10) ; témoignage recommandé sans
discussion par la commission de l’Académie, en Malgré les fautes de détail que l’on peut reprocher au récit de Procope, son témoignage même qui est oculaire, se recommande par la véracité et la science. L’inscription, en particulier, présenté d’abord des preuves intrinsèques. 1° à la vérité, on ne peut, avec M. Munk, tirer un argument de l’impossibilité où était Procope de connaître, d’après les livres saints, l’hébraïsme άπό ωροσώπου, qu’il reproduit. L’auteur byzantin paraît avoir été catholique, et les Septante même lui auraient d’ailleurs révélé cette forme hébraïque, au moins dans l’Ancien Testament. Il reste de cette preuve l’observation du style phénicien dans la langue. 2° Le style de l’architecture phénicienne est aussi observé dans les deux stèles, de tradition imposée. Enfin cette fuite, dont le terme est marqué aux dernières bornes du monde, répond au psaume Exsurgat Deus et dissipentur, répété sur le Jourdain dans la même langue : harmonie à indiquer en passant, plutôt que preuve rigoureuse. Passons à des preuves extrinsèques plus scientifiques, et à la réponse aux objections : 1° à la négation de Mannert sur tout le récit et sur l’émigration cananéenne. Nous lui opposons la gravité des témoins, tant celle de Procope que celle des auteurs qui l’appuient, mais principalement l’invraisemblance de sa propre thèse contre les migrations cananéennes en Afrique, qui sont au contraire très conformes à l’histoire de la colonisation phénicienne, et de l’élément agricole de la population libyphénicienne, nécessairement venu de la vallée du Jourdain. La voie de mer était naturelle, et semble rappelée par le mythe d’Antée ; mais l’émigration dont parle Procope aurait eu lieu, d’après lui, par l’Égypte. Cette difficulté est levée par la presque simultanéité de la domination des Hyksos[1]. Procope
s’accorde avec les anciens historiens, dans ses témoignages, quelquefois peu
vraisemblables de prime abord, mais autorisés ensuite par la science, et
féconds pour le progrès historique. Ainsi pour l’origine phénicienne des
Maures, on explique ce qui ne serait d’ailleurs qu’exagéré dans son exposé.
D’après Arnobe le jeune, c’est à l’intérieur et surtout du côté de Tripoli,
qu’on parlait le phénicien. Procope n’indique l’élément cananéen que comme
notable dans la population mauresque. Pomponius Méla donne une attestation
locale sur l’existence de cet élément jusqu’à Tanger. Les modernes adhérent d’ailleurs très généralement à l’authenticité de l’inscription, bien que la critique des moins récents ne soit pas autant à mettre en ligne de compte, comme quelquefois arriérée. On a commencé de nos jours à confirmer ce témoignage avec une méthode plus sûre et des preuves plus fortes. L’Académie appuie aussi les éloges donnés à Procope, dès l’antiquité. La grande raison donnée à l’émigration agricole du temps de Josué a été empruntée heureusement à Movers par M. Lenormant. Ajoutons que la tribu cananéenne des Λευαθαί ou Levvâtah, près de Tripoli, — Κιδάμη, — Cadmus, etc. sont là autant de souvenirs cananéens auprès de Leptis. On s’y glorifiait de ces origines ; Procope put être amené par la conversion des Mauri patati, sur la frontière, à rapprocher, comme eux, les souvenirs bibliques de ces traditions et d’autres qu’on verra. 2°
Gesenius rejette l’inscription par des motifs aussi mal fondés que ceux des
commentateurs de Mannert, quoiqu’ils aient tous raison de ne pas prendre
Tigisis pour Tanger. MM. Marcus et Duesberg ne tirent qu’un argument négatif
du silence des anciens auteurs chrétiens, en particulier de saint Augustin,
sur le monument épigraphique d’une ville qu’ils connaissaient. Les détails
topographiques mêmes, que donnent les commentateurs de Mannert, font
ressortir la singulière précision de ceux que fournit Procope. On élève une dernière difficulté sur son inscription à propos du mot Nave, qui, n’étant pas hébreu, ne serait pas phénicien. Mais il y a lieu d’y faire plusieurs réponses par l’autorité de différentes versions, par celle même de l’Ecclésiastique, écrit originairement en hébreu. Peut-être était-ce la forme cananéenne, recueillie par les Septante sur le lieu de l’ancien séjour des Sémites d’Égypte ou du passage des Cananéens. C’est encore la variante d’une chronique très ancienne (235, monument que nous produirons après l’inscription traduite par Moyse de Khoren). Enfin l’omission du nom généalogique par l’auteur arménien qu’on va examiner autoriserait au besoin à croire que le mot Nave n’appartenait pas non plus à Procope, mais aurait passé d’une glose dans son récit. III. L’inscription des colonnes, traduite en arménien et assez semblable a celle de Procope, n’existait-elle pas avant lui, et ne fournit-elle pas des documents nouveaux ? Moyse de Khoren, historien grave et abondamment renseigné, n’a pu d’ailleurs subir dans son texte d’interpolations de passages entiers. Movers croit supposé celui de l’inscription ; mais il ne le connaît qu’imparfaitement et ne l’a pas examiné. Il faut d’abord comparer les deux versions de Le Vaillant avec l’original, dans l’Histoire d’Arménie, et avec d’autres passages que renferme cette histoire sur les Cananéens. Ces textes expliquent l’addition du mot nos princes à l’inscription, et marquent les rapports des Arméniens avec les Cananéens d’Afrique : relations que l’on peut d’ailleurs induire d’un passage de Salluste (Bellum Jugurthin., c. 19-20), éclairé par la langue arménienne, ainsi pour le nom des Maures, tiré du nom Mèdes : En arménien Mède se dit Mar, et de Mar à Maure il n’y a pas loin (Le Vaillant de Fl.). Les traducteurs de Moyse de Khoren indiquent, malgré une défiance mal fondée, le lieu important du débarquement, Acras, nom qui se rapporte, ce semble, à celui des Acrikis ou Afrikis, Cananéens voisins de Tripoli. La traduction des Mekhitaristes marque expressément cette descente en Afrique et non pas simplement une navigation le long de ses côtes, avant d’arriver à Tharsis, pays qui, d’après plusieurs savants, désignerait alors Carthage. De là, et d’après les preuves déjà données[2], nous concluons à une première station. en Tripolitaine. Mais il faut établir au préalable l’identité clé Carthage avec Tharsis à cette époque. Les motifs que Quatremère apporte en faveur de Sofalah, sur la côte orientale d’Afrique, militent plutôt pour l’identité avec Carthage, qui exerçait le monopole du commerce et de l’Afrique et du monde ancien : solution plus satisfaisante pour expliquer la provenance de certaines denrées de Tharsis[3]. Carthage ne fleurit ainsi, à la vérité, que plus d’un siècle après Salomon, quand se continuaient encore les voyages de Tharsis, qui pouvaient alors se diriger surtout vers l’Espagne ; mais auparavant la ville punique put en être le but principal. Les célèbres voyages de trois années, dont on ne se rendrait pas compte autrement, en aucune supposition, s’étendaient sans doute, après avoir visité Carthage, aux pays qui produisaient les denrées dont cette cité faisait le trafic. Ce nomade Tharsis était relatif à l’étendue de la navigation commerciale, des Phéniciens et des connaissances géographiques que les Juifs avaient seulement par ce peuple. Il désigne, non primitivement une ville[4], mais une contrée éloignée, riche et, remarquent les érudits allemands, toujours située à l’occident, dernier caractère qui fit que ce nom s’appliqua définitivement à l’Espagne mais qui exclut l’interprétation de Sofalah. Quatremère joint d’ailleurs son autorité à celle des écrivains qui se déclarent pour l’identification, à un temps très antique, de Tharsis avec Tunis, c’est-à-dire avec Carthage ; car Cambé, à deux lieues de Tunis, était comme son port ; c’était la colonie de Sidon la plus ancienne, avec Hippone, sur toute la côte d’Afrique, et alors la plus florissante, bien avant de porter le nom de Carthage ou de la ville neuve des Tyriens. L’est de Tharsis désigne donc l’est de Carthage. Une conclusion plus générale sur l’ensemble du témoignage de Moyse de Khoren, c’est qu’il donne des indications importantes et ne manque point d’autorité. Nous ne tranchons pas cependant, sur les inscriptions mêmes, la question d’authenticité d’une manière absolue, ni par conséquent, à l’égard de l’inscription rapportée par Procope, la question de priorité. Du reste ce dernier texte a seul influé sur la chaîne de la tradition historique, l’arménien restant ignoré. IV. Document très antique d’une chronique pascale. Ce document, bien plus ancien même que la chronique d’Eusèbe, est cité en 235 par une chronique anonyme, jointe aux œuvres de saint Hippolyte, mais distincte de son canon pascal : il est attribué à Héron, martyr que le saint évêque de Porto avait converti, et il paraît authentique à la généralité des savants. Il désigne le peuple particulier des Afri comme frère des Phéniciens, montre, les Cananéens fugitifs dans les îles Baléares et attribue aux Jébuséens la fondation de Cadix : dernier point qui confirme avec précision la mention particulière de cette tribu par Procope. V. Traditions éparses. Des traditions de différentes sources achèvent notre démonstration. 1°
Les traditions chrétiennes, consignées clans les chronographes. Plus
précis que l’Écriture sainte et que les Pères qui’ désignent l’Afrique comme
la terre des fils de Canaan, ils font formellement de ses habitants les
frères des Phéniciens. 2° Les traditions juives. 3° Les traditions africaines. Les Berbères prétendaient descendre de Mâhzig, fils de Canaan ; mais ils parlaient une autre langue que les Phéniciens. Les Zeirites-Zénates se croyaient fils d’Amalec, allié de Canaan. Les Gergéséens convertis paraissent s’être fondus avec les Acrikis et avaient pour cité Gergis, sur la petite Syrte. Omettons les rapports de Tripoli avec Ammonium, grande oasis, toute cananéenne, intermédiaire entre ce pays et les Sémites d’Égypte. 4° Les traditions arabes sont surtout représentées par Ibn Kaldun et par Léon l’Africain, qui identifient les Berbères eux-mêmes avec les Cananéens. En terminant, nous nous rattachons aux principaux motifs tirés d’une colonisation tout agricole de l’Afrique, nécessairement, due aux réfugiés du bas Canaan. Les témoignages de grands auteurs, sacrés ou profanes, confirment ce caractère. |