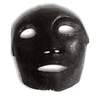L'HOMME AU MASQUE DE FER
CHAPITRE XIX[1].
|
Intervention des rois de France en Italie. — Politique d'Henri II, d'Henri IV et de Louis XIII. — Conduite judicieuse de Richelieu. — Traité de Cherasco. — Ambition menaçante de Louis XIV. — Situation de la cour de Savoie à la mort de Charles-Emmanuel. — Portrait de Charles IV, duc de Mantoue. — Le marquisat de Montferrat et Casal. — Le comte Matthioly. — Sa carrière politique, son caractère. — L'abbé d'Estrades et Giuliani. — Projet de cession de Casal à Louis XIV. — Entrevue à Venise de Charles IV et de l'abbé d'Estrades. — Voyage de Matthioly à Versailles. — Il communique le projet aux ennemis de la France. — Que faut-il penser de sa conduite ? C'est presque toujours mal à propos que les rois de France se sont engagés en Italie. Leurs établissements n'y ont jamais été durables, parce qu'ils étaient contraires aux véritables intérêts de la France et qu'ils violaient les lois naturelles de délimitation imposées aux deux contrées par leur configuration géographique. Charles VIII conquit le royaume de Naples, mais Louis XII fut contraint d'en sortir. Celui-ci prit le Milanais, mais François Ier fut obligé de l'évacuer ; et, en restituant le Piémont, dont s'était emparé son père, Henri II acheva ce mouvement rétrograde. Après s'être éloigné de la fausse voie où ses trois prédécesseurs avaient imprudemment entraîné la France, Henri Il a montré où se trouvaient les frontières à agrandir, les conquêtes nationales à faire, quelle était la vraie direction à donner aux armées. Il a pris Calais, indiquant ainsi le chemin des Pays-Bas, et en devenant le maître des Trois-Évêchés il a ouvert à ses successeurs la glorieuse route de l'Alsace et du Rhin. En même temps qu'il inaugurait si heureusement une lutte nouvelle, il établissait les bases d'une politique nouvelle aussi, entrevue par François Ier, mais dont les mérites appartiennent surtout à Henri II. Celui-ci comprit que le plus efficace moyen de combattre un empereur d'Allemagne, chef du parti catholique, était de s'allier avec les princes allemands et le parti réformé ; et s'il fut trop tôt, et par une mort violente, interrompu dans son œuvre, si la minorité ou la faiblesse de ses enfants en suspendirent longtemps l'exécution, elle fut reprise, et l'on sait avec quel succès, par Henri IV, Richelieu, Mazarin et Louis XIV. S'assurer la neutralité de l'Espagne, surveiller l'Italie, sans tenter de s'y établir, et porter toutes ses forces vers le Nord et vers l'Est, pour étendre de ce côté les frontières, trop rapprochées de la capitale, telle a été la glorieuse politique d'Henri IV, un moment suspendue après sa mort, mais dignement continuée par ses successeurs. Ce n'est pas à dire que ceux-ci soient restés indifférents aux affaires d'Italie. Lorsque, en 1627, les ducs de Savoie et de Guastalla, soutenus par la maison d'Autriche voulurent conserver à Charles de Gonzague la succession du duc de Mantoue, Louis XIII prit hautement sa défense et fit triompher les droits de cet héritier légitime. Rendu, par la victoire, maître du sort de la maison de Savoie, Richelieu ne se laissa pas éblouir par le succès. Ce politique incomparable comprit que déposséder une dynastie italienne et s'établir au delà des Alpes aurait nécessairement pour résultat de réunir les Italiens aux Espagnols ; de provoquer contre les Français, devenus promptement impopulaires par leur présence même, une coalition tôt ou tard victorieuse ; de créer enfin, en dehors de la naturelle sphère d'action de la France, une cause incessante d'inquiétudes, de jalousies, de luttes et d'alarmes. Aussi en 1651, et par le traité de Cherasco, l'habile ministre, sacrifiant une grande partie des fruits de sa victoire, restitua le Piémont et la Savoie, se contentant de garder Pignerol, afin d'avoir toujours ouverte une des portes de l'Italie. La surveiller sans l'alarmer, se faire le protecteur des droits des princes italiens, sans menacer leur indépendance, exiger d'eux, en retour, une confiance complète, déjouer les intrigues des Espagnols, et les laisser accumuler sur eux les haines et les ressentiments ; prendre, en un mot, une attitude passive, mais vigilante, ferme, mais non menaçante, telle fut la conduite judicieuse de Richelieu à l'égard de l'Italie. Louis XIV resta longtemps fidèle à cette politique. C'est vers le Nord et vers l'Est qu'il porte ses armes victorieuses, et par une suite d'entreprises supérieurement préparées et merveilleusement conduites, il étendit les frontières de la France là où elles devaient l'être, et, arbitre de l'Europe à Aix-la-Chapelle, et plus tard à Nimègue, il la remplit de crainte et d'admiration. Dans ces deux villes, sa seule volonté fut la seule base des négociations. Tandis que pour tous la paix d'Aix-la-Chapelle n'avait semblé devoir être qu'une trêve, celle de Nimègue réunissait toutes les conditions d'une paix définitive. Mais, bien avant même la signature de ce fameux traité, Louis XIV formait au delà des Alpes d'ambitieux projets, et la possession de Pignerol et des vallées voisines ne lui paraissait plus suffisante pour le rôle qu'il voulait jouer en Italie. L'influence de soft gouvernement y avait été cependant d'autant mieux acceptée qu'on l'avait dissimulée davantage, et qu'on avait évité avec plus de soin tout ce qui pouvait porter quelque ombrage. Mais lorsque la politique de Richelieu et de Mazarin, scrupuleusement continuée par de Lyonne, eut cessé de prévaloir ; lorsque l'envahissant et impétueux Louvois constitua une sorte de diplomatie militaire qu'il dirigeait au gré de ses desseins, les sentiments des Italiens, et en particulier des Piémontais, se modifièrent : la déférence affectueuse fit place à une appréhension inquiète, à des craintes contenues, et peu à peu à une haine qui éclatera contre la France au moment des coalitions et des revers. Charles-Emmanuel, duc de Savoie, venait de mourir, laissant pour successeur un enfant sous la tutelle d'une mère[2] glorieuse, passionnée, ardente, et que les petitesses de son esprit autant que les emportements de son caractère devaient conduire à des résistances exagérées, bientôt suivies de concessions humiliantes. Au lieu d'être pour Victor-Amédée un protecteur désintéressé, un conseiller sincère, Louis XIV songea dès lors à s'agrandir en Italie, en profitant de la faiblesse de ce gouvernement, de la vanité de la régente, de l'inexpérience de son fils, des passions soulevées dans cette cour autour d'une femme légère et capricieuse. Il aurait pu, par une conduite toute contraire, s'attacher à jamais le jeune duc, qui plus tard deviendra son adversaire, non le plus formidable, mais le plus incommode, et qui contribuera plus que tout autre, par la diversion opérée dans le Midi, à paralyser les forces de la France et à la mettre à deux doigts de sa perte. On a représenté avec raison Victor-Amédée comme un allié peu sûr et dissimulé, comme un ennemi perfide. Mais c'est d'abord la conduite de sa mère, puis celle de Louis XIV, qui ont de bonne heure disposé à la dissimulation ce prince, laissé à l'écart par une régente dure et ambitieuse, dont les amis étaient suspects et surveillés, et qui, réduit à l'isolement, mais non étranger aux intérêts de ses États, taciturne, mais réfléchi et observateur, patient plus que résigné, subissait avec une apparente indifférence une double et lourde tutelle, et n'attendait qu'une occasion pour s'en affranchir ou s'en venger. Dès ce moment donc, Louis XIV lui-même préparait les désastres qui marqueront la fin de son règne. Tandis que les décisions audacieusement arbitraires des chambres dites de réunion, en agrandissant la France par des conquêtes faites en pleine paix, irritaient profondément le Nord de l'Europe, il allait en agiter le Midi par des prétentions aussi excessives, longtemps dissimulées, puis hardiment découvertes, et qui ne tendaient à rien moins qu'à placer une partie de l'Italie sous sa domination exclusive. La complaisance, ou tout au moins la neutralité qu'assuraient à Louis XIV dans le Piémont la vanité et la faiblesse de la régente, étaient rendues non moins certaines à Mantoue par la frivole insouciance de Charles IV, son jeune duc. Ce prince, représentant dégénéré de cette maison de Gonzague qui a fourni tant de grands hommes et mêlé son sang aux plus illustres familles de l'Europe, se montrait indigne de son rang et de son nom parla conduite la plus follement dissipée. Insouciant et léger, il était tout à fait indifférent aux intérêts de son duché, en laissait l'administration à des favoris incapables, et lui-même, duc non résidant, passait au milieu des plaisirs de Venise la plus grande partie de son existence, et ne songeait à revenir à Mantoue que lorsque de pressants besoins d'argent l'y appelaient. Très-joueur et fort dépensier, il avait promptement épuisé dans les fêtes et les aventures les restes d'une fortune et d'une santé également chancelantes. Escomptant à l'avance les revenus de son duché, il venait d'obtenir de quelques juifs le payement anticipé des impôts de plusieurs années[3]. Cette somme fut bientôt gaspillée, et Charles IV, privé de ressources, mais non moins ardent au plaisir, ruiné, mais non moins empressé à assister à toutes les fêtes données hors de ses États, était réduit aux expédients, et en quelque sorte se trouvait à vendre. Il ne tarda pas à rencontrer un acheteur. Sous son autorité était placé le marquisat du Montferrat, cette riche, cette fertile contrée, si constamment enviée, et à maintes reprises disputée par les armes. Enlevé aux Romains par les Goths, puis à ceux-ci par les Lombards, ayant ensuite fait partie de l'empire d'Occident, devenu plus tard un fief héréditaire, plusieurs fois revendiqué par la maison de Savoie, conquis par Charles-Emmanuel, puis évacué, ce pays avait été enfin annexé au duché de Mantoue, dont le séparaient cependant de vastes États. Casal en était la capitale. Cette place forte, situé sur le Pô, à quinze lieues à l'est de Turin, était d'une importance de premier ordre, mais surtout pour le Piémont. De tout temps la cour de Turin avait convoité cette annexe naturelle, que les défaites de Louis XIV et la conduite de Victor-Amédée devaient un jour lui assurer. Que le duc de Mantoue possédât ce territoire limitrophe du Piémont, c'était sans doute une anomalie, mais fort peu dangereuse. Le roi de France, au contraire, déjà maitre de Pignerol, le devenant de Casal, tiendrait en réalité enfermée la cour de Turin entre deux places formidables, dont l'une, au sud-ouest, donnait accès au chemin des Alpes, et l'autre, au nord-est, occupait la route du Milanais. C'est pourtant le projet que forma Louis XIV. L'intrigue en fut mystérieusement commencée en 1676 ; mais longtemps auparavant il avait porté son attention sur cette ville importante. Le 17 septembre 1665, quelques jours après la mort de Charles III, avant-dernier duc de Mantoue, il s'était empressé d'envoyer auprès de la régente, mère de Charles IV, le sieur d'Aubeville, chargé de tenir la main à ce qu'on ne tolérât aucune innovation dans la garnison de Casal pendant la minorité du jeune duc[4]. Cette préoccupation, très-naturelle à cause du voisinage des Espagnols, semblait et était peut-être alors fort désintéressée ; mais en 1676 il ne s'agit plus de maintenir à Casal une garnison mantouane, mais d'y faire pénétrer les soldats de Louis XIV. Parmi les grands personnages de Mantoue était Ercole-Antonio Matthioly. Né à Bologne le 1er décembre 1640, il appartenait à une famille de robe ancienne et distinguée. Son aïeul, Costantino Matthioly, avait été élevé à la dignité de sénateur. Un de ses oncles, Hercule Matthioly, père jésuite, était un orateur très-célèbre[5]. Lui-même attira dé bonne heure l'attention, en obtenant à dix-neuf ans le lauréat en droit civil et canonique, et peu après le titre de professeur à l'université de Bologne. Il acheva ensuite de se faire connaître par plusieurs ouvrages estimés, et après s'être allié à une honorable famille sénatoriale de Bologne, il alla s'établir à Mantoue, où ses talents, sa dextérité et sa maturité précoce le firent apprécier du duc Charles III de Gonzague, dont il fut l'un des secrétaires d'État. Après la mort de ce prince, son fils, Charles IV de Gonzague, quand il fut parvenu à sa majorité,- accorda son amitié à Matthioly et le nomma sénateur surnuméraire de Mantoue, dignité à laquelle était attaché le titre de comte. Plein d'ambition, Matthioly espérait non-seulement reconquérir la charge de secrétaire d'État, main encore devenir le principal ministre de son jeune maître. Connaissant sa situation des plus précaires, il désirait ardemment lui rendre un de ces services signalés qui justifient les plus hautes récompenses : l'occasion s'en présenta dans les derniers mois de l'année 1677. Aussi ambitieux, aussi remuant que Matthioly, était l'abbé d'Estrades, alors ambassadeur de Louis XIV auprès de la république vénitienne. Appartenant à une famille de diplomates, et impatient de s'illustrer à son tour, il eut l'habileté d'entrer hardiment dans les vues de la cour de Versailles, et, sachant bien d'ailleurs qu'il serait approuvé, de nouer l'intrigue qui devait aboutir à la cession de Casal. au roi de France. Connaissant depuis longtemps la situation de la cour de Mantoue et les personnages qui y occupaient le premier rang, il jeta les yeux sur Matthioly, comme étant le plus propre par son caractère à embrasser le projet de session, et, par son influence sur son maitre, à le lui faire adopter. Mais avant de se mettre directement en relations avec Matthioly, il envoya à Vérone, où celui-ci se rendait assez souvent, un homme tout à fait sûr, Giuliani, que sa situation d'éditeur de journal obligeait d'aller de ville en ville pour recueillir des nouvelles, et dont, par conséquent, le séjour à Vérone ne pouvait pas inspirer de soupçons. Giuliani fit observer Matthioly, le surveilla lui-même, et pénétra ses sentiments de répulsion à l'endroit des Espagnols, dont il n'avait jamais obtenu que des espérances. Peu à peu la liaison fut plus étroite, et Giuliani put sans danger lui faire entrevoir les projets de l'abbé d'Estrades, les avantages pécuniaires que retirerait le duc de Mantoue de la cession de Casal à Louis XIV, et la sûreté autant que l'honneur d'une alliance avec un roi aussi puissant. Matthioly accueillit avec empressement cette proposition[6], et s'en fit l'interprète auprès du duc, qu'il n'eut pas de peine à convaincre. Les relations deviennent bientôt plus directes. Giuliani voit Charles IV à Mantoue, et l'on convient qu'une entrevue entre celui-ci et l'abbé d'Estrades aura, lieu à Venise d'autant plus secrètement qu'à cause du carnaval, tout le monde, même le doge, les plus vieux sénateurs, les cardinaux et le nonce ne vont qu'en masque[7]. Louis XIV et M. de Pomponne, son ministre, félicitent avec effusion l'abbé d'Estrades de l'heureux début de cette délicate négociation[8], et le roi ne dédaigne pas, le 12 janvier 1678, d'écrire lui-même au comte Matthioly et de lui adresser ses remercîments[9]. Matthiole et Charles IV se rendent en effet à Venise. Le premier discute avec l'abbé le prix de la cession, que l'on fixe à cent mille écus payables après l'échange des ratifications du traité, et en deux termes à trois mois de distance. Le 15 mars 1678[10], à minuit, au sortir d'un bal, l'ambassadeur de Louis XIV et le duc de Mantoue se rencontrent, comme par hasard, au milieu d'une place, et là, éloignés de toute oreille indiscrète, cachés aux regards par un masque semblable à ceux que tous les seigneurs portent alors à Venise, ils s'entretiennent une heure durant des conditions du traité, du payement du prix, de la manière dont Louis XIV défendra Charles IV contre les effets du ressentiment de la république de Venise et des Espagnols. Si méfiants que soient les princes italiens, quelque disposition qu'ait la république vénitienne à soupçonner une intrigue et à empêcher une intervention aussi dangereuse du roi de France dans le nord de l'Italie ; si nombreux, si exercés que soient les espions qui encombrent Venise, c'est dans cette ville même, et presque sous les yeux des représentants des diverses puissances, que sont ainsi, et avec un mystère impénétrable, établies les bases d'un traité des plus menaçants pour l'indépendance de la péninsule. Avec les mêmes précautions, et sans attirer davantage l'attention des autres princes, Charles IV revit plusieurs fois l'abbé d'Estrades. Il fut convenu entre eux que Matthioly se rendrait secrètement en France, et qu'il signerait à Versailles, au nom de son maître, le traité définitif qui permettrait à Louis XIV de pénétrer dans le nord de l'Italie. Ce voyage de Matthioly fut rétardé de quelques mois, d'abord par une assez longue maladie qui le retint à Mantoue, puis par le désir qu'avait Louis XIV de différer jusqu'au printemps suivant, c'est-à dire jusqu'au mois d'avril 1679, l'envoi de ses troupes à Casal[11]. A la fin d'octobre 1678, le comte Matthioly et Giuliani annoncent, pour détourner les soupçons, l'intention de visiter la Suisse, s'y rendent en effet, la traversent[12], et ils arrivent à Paris le 28 novembre. Mis de suite en rapport avec M. de Pomponne, ministre des relations extérieures, ils débattent et rédigent dans le plus grand secret le traité de cession, qui est signé le 8 décembre[13], et qui porte : 1° Que le duc de Mantoue recevra des troupes françaises à Casal ; 2° Qu'il sera nommé généralissime de l'armée française, si Louis XIV en envoie une en Italie ; 3° Et qu'après l'exécution du traité on remettra au prince une somme de cent mille écus[14]. Aussitôt après la signature de cet acte, Matthioly est reçu par Louis XIV en audience secrète et accueilli avec la plus flatteuse distinction. Le roi lui offre, en souvenir de son voyage, un diamant de prix, lui fait payer quatre cents doubles louis, et lui promet qu'après la ratification du traité il recevra en récompense une somme bien plus considérable, pour son fils une place dans les pages du roi, et pour son frère une riche abbaye[15]. Jamais intrigue n'a été mieux nouée et n'a réuni plus de chances de succès : dans le Piémont, une cour divisée, impuissante, et dévouée à la France presque jusqu'à la servilité ; dans le reste de l'Italie, comme dans le Piémont, des princes maintenus dans l'ignorance la plus complète ; à Mantoue, un duc tout disposé à vendre une partie de ses États ; enfin, chez les deux ambassadeurs chargés de négocier cette affaire, un égal intérêt à la voir réussir, puisqu'elle doit enrichir l'un et assurer à l'un et à l'autre la reconnaissance de leur maître et une haute situation. Deux mois après le voyage en France de Matthioly, les cours de Turin, de Madrid et de Vienne, le gouverneur espagnol du Milanais et les inquisiteurs d'État de la république vénitienne, c'est-à-dire tous ceux qui étaient les plus intéressés à s'opposer à l'exécution du projet, le connaissaient dans ses moindres détails, et n'ignoraient ni le prix de la cession, ni l'époque où elle devait être faite, ni le nom des négociateurs. En un mot, ils savaient tout, parce qu'ils avaient reçu à diverses époques[16] les confidences du principal, du mieux instruit des acteurs de cette intrigue, du comte Matthioly. Quel mobile l'a déterminé ? Faut-il voir dans cette trahison un acte inspiré par une basse cupidité ? Matthioly a-t-il été un fripon qui, après avoir reçu l'argent de Louis XIV, est allé se vendre tour à tour aux Autrichiens, aux Espagnols, aux Vénitiens et aux Piémontais ? Ou bien, ébranlé jusqu'au fond de l'âme et illuminé tout à coup par l'apparition soudaine de sa patrie en danger, a-t-il eu comme un remords au moment de la vendre, et recherché le seul moyen de la garantir contre les envahissements d'un roi ambitieux ? Est-ce un intrigant, un dénonciateur de bas étage, ou bien un homme combattu tour à tour par deux sentiments contraires, que son ambition avide a d'abord conduit à servir les projets criminels de son maître, puis que son patriotisme a soudainement déterminé à les faire avorter ? Voilà ce que nul ne pourra résoudre, parce que nul n'a reçu ses confidences. Il est à remarquer cependant que si la seule cupidité avait été le mobile de Matthioly, il aurait dû pencher pour l'exécution du traité de Casal, car elle lui offrait bien plus d'avantages matériels qu'il ne pouvait en espérer d'un revirement de conduite. Que, dans les dépêches échangées ensuite entre la cour de Versailles et les représentants français en Italie, Matthioly soit désigné du nom de fripon, on ne saurait s'étonner de cette colère, naturelle conséquence d'un amer désappointement. Mais il suffit qu'il y ait place pour un mobile plus noble, il suffit qu'une inspiration patriotique ait été possible, pour qu'on ne condamne pas sans réserve cet homme qui a peut-être cru sauver son pays. Sans doute il aurait fallu rejeter toutes les apparences de la fourberie, renvoyer à Louis XIV ses présents, dissuader d'abord Charles IV, et, s'il avait persisté à introduire les troupes françaises en Italie, alors, alors seulement révéler l'imminence du danger aux autres princes. Dans ce cas encore, objectera-t-on, il fallait le faire hautement, avec franchise, sans dissimulation, et en instruisant l'abbé d'Estrades de ce qui n'eût plus été une trahison, mais un acte de vrai patriote. Toutefois cette conduite était-elle possible à Matthioly entouré d'espions, surveillé et ayant à redouter une puissance aussi formidable que la France, un ressentiment aussi dangereux que celui de Louis XIV ? Faut-il entièrement le blâmer s'il n'a pas su se dépouiller de tout ce que son caractère renfermait de ruse et de duplicité, et si, avec les apparences déshonorantes de la trahison, il a cru accomplir un acte honorable ? Jusqu'ici on n'a vu en lui qu'un méprisable fripon, mais, si faible que soit la présomption contraire, ne la rejetons pas absolument. Cessons de nous placer uniquement au point de vue français, et, en considérant le péril auquel la cession de Casal exposait l'Italie, ne nous refusons pas à supposer qu'en l'empêchant, Matthioly a peut-être entrevu l'intérêt de son pays plus que le sien propre, et que, dans une âme naturellement cupide, a pu pénétrer un sentiment noble et désintéressé. |