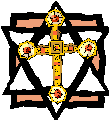LES APÔTRES
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
CHAPITRE XVII. — ÉTAT DU MONDE VERS LE MILIEU DU PREMIER SIÈCLE.
|
L'état politique du monde était des plus tristes. Toute
l'autorité était concentrée à Rome et dans les légions. Là se passaient les
scènes les plus honteuses et les plus dégradantes. L'aristocratie romaine,
qui avait conquis le monde, et qui, en somme, resta seule aux affaires sous
les Césars, se livrait à la saturnale de crimes la plus effrénée dont le
monde se souvienne. César et Auguste, en établissant le principat, avaient vu
avec une parfaite justesse les besoins de leur temps. Le monde était si bas,
sous le rapport politique, qu'aucun autre gouvernement n'était plus possible.
Depuis que Rome avait conquis des provinces sans nombre, l'ancienne
constitution, fondée sur le privilège des familles patriciennes, espèces de tories obstinés et malveillants, ne pouvait subsister[1]. Mais Auguste
avait manqué à tous les devoirs du vrai politique, en laissant l'avenir au
hasard. Sans hérédité régulière, sans règles fixes d'adoption, sans loi
d'élection, sans limites constitutionnelles, le césarisme était comme un
poids colossal sur le pont d'un navire sans lest. Les plus terribles
secousses étaient inévitables. Trois fois, en un siècle, sous Caligula, sous
Néron et sous Domitien, le plus grand pouvoir qui ait jamais existé tomba
entre les mains d'hommes exécrables ou extravagants. De là des horreurs qui
ont été à peine dépassées par les monstres des dynasties mongoles. Dans cette
série fatale de souverains, on en est réduit à excuser presque un Tibère, qui
ne fut complètement méchant que vers la fin de sa vie, un Claude, qui ne fut
que bizarre, gauche et mal entouré. Rome devint une école d'immoralité et de
cruauté. Il faut ajouter que le mal venait surtout de l'Orient, de ces
flatteurs de bas étage, de ces hommes infâmes que l'Égypte et Le véritable esprit romain, en effet, vivait encore. La noblesse humaine était loin d'être éteinte. Une grande tradition de fierté et de vertu se continuait dans quelques familles, qui arrivèrent au pouvoir avec Nerva. qui tirent la splendeur du siècle des Antonins et dont Tacite a été l'éloquent interprète. Un temps où se préparaient des esprits aussi profondément honnêtes que Quintilien, Pline le Jeune, Tacite, n'est pas un temps dont il faille désespérer. Le débordement de la surface n'atteignait pas le grand fond d'honnêteté et de sérieux qui était dans la bonne société romaine ; quelques familles offraient encore des modèles d'ordre, de dévouement au devoir, de concorde, de solide vertu. Il y avait dans les maisons nobles d'admirables épouses, d'admirables sœurs[4]. Fut-il jamais destinée plus touchante que celle de cette jeune et chaste Octavie, fille de Claude, femme de Néron, restée pure à travers toutes les infamies, tuée à vingt-deux ans, sans qu'elle eût jamais senti aucune joie ? Les femmes qualifiées dans les inscriptions de castissimæ, univiræ ne sont point rares[5]. Des épouses accompagnèrent leurs maris dans l'exil[6] ; d'autres partagèrent leur noble mort[7]. La vieille simplicité romaine n'était pas perdue ; l'éducation des enfants était grave et soignée. Les femmes les plus nobles travaillaient de leurs mains à des ouvrages de laine[8] ; les soucis de toilette étaient presque inconnus clans les bonnes familles[9]. Les excellents hommes d'Etat qui sortent pour ainsi dire
de terre sous Trajan ne s'improvisèrent pas. Us avaient servi sous les règnes
précédents ; seulement, ils avaient eu peu d'influence, rejetés qu'ils
étaient dans l'ombre par les affranchis et les favoris infimes de l'empereur.
Des hommes de première valeur occupèrent ainsi de grandes charges sous Néron.
Les cadres étaient bons ; le passage au pouvoir des mauvais empereurs, tout
désastreux qu'il était, ne suffisait pas pour changer la marche générale des
affaires et les principes de l'État. L'Empire, loin d'être en décadence,
était dans toute la force de la plus robuste jeunesse. La décadence viendra
pour lui, mais deux cents ans plus tard, et, chose étrange ! sous de bien
moins mauvais souverains. A n'envisager que la politique, la situation était
analogue à celle de La philosophie avait fait alliance avec les honnêtes familles romaines et résistait noblement. L'école stoïcienne produisait les grands caractères de Crémutius Cordus, de Thraséas, d'Arria, d'Helvidius Priscus, d'Annæus Cornutus, de Musonius Rufus, maîtres admirables d'aristocratique vertu. La roideur et les exagérations de cette école venaient de l'horrible cruauté du gouvernement des Césars. La pensée perpétuelle de l'homme de bien était de s'endurcir aux supplices et de se préparer à la mort[11]. Lucain, avec mauvais goût, Perse, avec un talent supérieur, exprimaient les plus hauts sentiments d'une grande âme. Sénèque le Philosophe, Pline l'Ancien, Papirius Pabianus, maintenaient une tradition élevée de science et de philosophie. Tout ne pliait pas ; il y avait des sages. Mais trop souvent ils n'avaient d'autre ressource que de mourir. Les portions ignobles de l'immunité prenaient par moments le dessus. L'esprit de vertige et de cruauté débordait alors, et taisait de Rome un véritable enfer[12]. Ce gouvernement, si épouvantablement inégal à Rome, était
beaucoup meilleur dans les provinces. On s'y apercevait assez peu des
secousses qui ébranlaient la capitale. Malgré ses défauts, l'administration
romaine valait mieux que les royautés et les républiques que la conquête
avait supprimées. Le temps des municipalités souveraines était passé depuis
des siècles. Ces petits États s'étaient détruits eux-mêmes par leur égoïsme,
leur esprit jaloux, leur ignorance ou leur peu de souci des libertés privées.
L'ancienne vie grecque, toute de luttes, tout extérieure, ne satisfaisait
plus personne. Elle avait été charmante à son jour ; mais ce brillant Olympe
d'une démocratie de demi-dieux, ayant perdu sa fraîcheur, était devenu
quelque chose de sec, de froid, d'insignifiant, de vain, de superficiel,
faute de bonté et de solide honnêteté. C'est ce qui fit la légitimité de la
domination macédonienne, puis de l'administration romaine. L'Empire ne
connaissait pas encore les excès de la centralisation. Jusqu'au temps de
Dioclétien, il laissa aux provinces et aux villes beaucoup de liberté. Des
royaumes presque indépendants subsistaient en Palestine, en Syrie, en Asie
Mineure, dans la petite Arménie, en Thrace, sous la protection de Rome. Ces royaumes
ne devinrent des dangers, à partir de Caligula, que parce qu'on négligea de
suivre à leur égard les règles de grande et profonde politique qu'Auguste
avait tracées[13].
Les villes libres, et elles étaient nombreuses, se gouvernaient selon leurs
lois ; elles avaient le pouvoir législatif et toutes les magistratures d'un
État autonome ; jusqu'au IIIe siècle, les décrets municipaux se rendent avec
la formule : Le sénat et le peuple[14]... Les théâtres
ne servaient pas seulement aux plaisirs de la scène ; ils étaient partout des
foyers d'opinion et de mouvement. La plupart des villes étaient, à des titres
divers, de petites républiques. L'esprit municipal y était très-fort[15] ; elles
n'avaient perdu que le droit de se déclarer la guerre, droit funeste qui
avait fait du monde un champ de carnage. Les
bienfaits du peuple romain envers le genre humain étaient le thème de
déclamations parfois adulatrices, mais auxquelles il serait injuste de dénier
toute sincérité[16].
Le culte de la paix romaine[17], l'idée d'une
grande démocratie, organisée sous la tutelle de Rome, était au fond de toutes
les pensées[18].
Un rhéteur grec déployait une vaste érudition pour prouver que la gloire de
Rome devait être recueillie par toutes les branches de la race hellénique
comme une sorte de patrimoine commun[19]. En ce qui
concerne En somme, malgré les exactions des gouverneurs et les
violences inséparables d'un gouvernement absolu, le monde, sous bien des
rapports, n'avait pas encore été aussi heureux. Une administration venant
d'un centre éloigné était un si grand avantage, que même les rapines exercées
par les préteurs des derniers temps de Dans ceux des pays conquis où les besoins politiques
n'existaient pas depuis des siècles, et où l'un n'était privé que du droit de
se déchirer par des guerres continuelles, l'Empire fut une ère de prospérité
et de bien-être comme on n'en avait jamais connu[22] ; il est même
permis d'ajouter sans paradoxe, de liberté. D'un coté, la liberté du commerce
et de l'industrie, dont les républiques grecques n'avaient pas l'idée, devint
possible. D'un autre côté, la liberté de penser ne fit que gagner au régime
nouveau. Cette liberté-là se trouve toujours mieux d'avoir affaire à un roi
ou à un prince qu'à des bourgeois jaloux et bornés. Les républiques anciennes
ne l'eurent pas. Les Grecs tirent sans cela de grandes choses, grâce à
l'incomparable puissance de leur génie ; mais, il ne faut pas l'oublier,
Athènes avait bel et bien l'inquisition[23]. L'inquisiteur,
c'était l'archonte-roi ; le saint office, c'était le portique Royal, où
ressortissaient les accusations d'impiété.
Les accusations de cette sorte étaient fort nombreuses ; c'est le genre de
causes qu'on trouve le plus fréquemment dans les orateurs attiques.
Non-seulement les délits philosophiques, tels que nier Dieu ou De larges idées de fraternité universelle, sorties pour la plupart du stoïcisme[28], une sorte de sentiment général de l'humanité, étaient le fruit du régime moins étroit et de l'éducation moins exclusive auxquels l'individu était soumis[29]. On rêvait une nouvelle ère et de nouveaux mondes[30]. La richesse publique était grande, et, malgré l'imperfection des doctrines économiques du temps, l'aisance fort répandue. Les mœurs n'étaient pas ce qu'on se figure souvent. A Rome, il est vrai, tous les vices s'affichaient avec un cynisme révoltant[31] ; les spectacles surtout avaient introduit une affreuse corruption. Certains pays, comme l'Égypte, étaient aussi descendus à la dernière bassesse. Mais il y avait dans la plupart des provinces une classe moyenne, où la bonté, la foi conjugale, les vertus domestiques, la probité, étaient suffisamment répandues[32]. Existe-t-il quelque part un idéal de la vie de famille, dans un monde d'honnêtes bourgeois de petites villes, plus charmant que celui que Plutarque nous a laissé ? Quelle bonhomie ! quelle douceur de mœurs ! quelle chaste et aimable simplicité[33] ! Chéronée n'était évidemment pas le seul endroit où la vie fût si pure et si innocente. Les habitudes, même en dehors de Rome, avaient bien encore quelque chose de cruel, soit comme reste des mœurs antiques, partout si sanguinaires, soit par l'influence spéciale de la dureté romaine. Mais on était en progrès sous ce rapport. Quel sentiment doux et pur, quelle impression de mélancolique tendresse n'avaient pas trouvé sous la plume de Virgile ou de Tibulle leur plus fine expression ? Le monde s'assouplissait, perdait sa rigueur antique, acquérait de la mollesse et de la sensibilité. Des maximes d'humanité se répandaient[34] ; l'égalité, l'idée abstraite des droits de l'homme, étaient hautement prêchées par le stoïcisme[35]. La femme, grâce au système dotal du droit romain, devenait de plus en plus maîtresse d'elle-même ; les préceptes sur la manière de traiter les esclaves s'élevaient[36] ; Sénèque mangeait avec les siens[37]. L'esclave n'est plus cet être nécessairement grotesque et méchant, que la comédie latine introduit pour provoquer les éclats de rire, et que Caton recommande de traiter comme une bêle de somme[38]. Maintenant les temps sont bien changés. L'esclave est moralement égal à son maître ; on admet qu'il est capable de vertu, de fidélité, de dévouement, et il en donne des preuves[39]. Les préjugés sur la noblesse de naissance s'effaçaient[40]. Plusieurs lois très-humaines et très-justes s'établissaient, même sous les plus mauvais empereurs[41]. Tibère était un financier habile ; il fonda sur des bases excellentes un établissement de crédit foncier[42]. Néron porta dans le système des impôts, jusque-là inique et barbare, des perfectionnements qui font honte même à notre temps[43]. Le progrès de la législation était considérable, bien que la peine de mort fût encore stupidement prodiguée. L'amour du pauvre, la sympathie pour tous, l'aumône, devenaient des vertus[44]. Le théâtre était un des scandales les plus insupportables aux honnêtes gens, et l'une des premières causes qui excitaient l'antipathie des juifs et des judaïsants de toute espèce contre la civilisation profane du temps. Ces cuves gigantesques leur semblaient le cloaque où bouillonnaient tous les vices. Pendant que les premiers rangs applaudissaient, souvent aux gradins les plus élevés se faisaient jour la répulsion et l'horreur. Les spectacles de gladiateurs ne s'établirent qu'avec peine dans les provinces. Les pays helléniques, du moins, les réprouvèrent, et s'en tinrent le plus souvent aux anciens exercices grecs[45]. Les jeux sanglants gardèrent toujours en Orient une marque d'origine romaine très-prononcée[46]. Les Athéniens, par émulation contre ceux de Corinthe[47], ayant un jour délibéré d'imiter ces jeux barbares, un philosophe se leva, dit-on, et fit une motion pour qu'on renversât préalablement l'autel de la Pitié[48]. L'horreur du théâtre, du stade, du gymnase, c'est-à-dire des lieux publics, de ce qui constituait essentiellement une ville grecque ou romaine, fut ainsi l'un des sentiments les plus profonds des chrétiens, et l'un de ceux qui eurent le plus de conséquence. La civilisation ancienne était une civilisation publique ; les choses s'y passaient en plein air, devant les citoyens assemblés ; c'était l'inverse de nos sociétés, où la vie est toute privée et close dans l'enceinte de la maison. Le théâtre avait hérité de l'agora et du forum, l'anathème jeté sur le théâtre rejaillit sur toute la société. Une rivalité profonde s'établit entre l'église, d'une part, les jeux publics de l'autre. L'esclave, chassé des jeux, se porta à l'église. Je ne me suis jamais assis dans ces mornes arènes, qui sont toujours le reste le mieux conservé d'une ville antique, sans y avoir vu en esprit la lutte des deux mondes : — ici l'honnête pauvre homme, déjà à demi chrétien, assis au dernier rang, se voilant la face et sortant indigné, — là un philosophe se levant tout à coup et reprochant à la foule sa bassesse[49]. Ces exemples étaient rares au premier siècle. Cependant la protestation commençait à se faire entendre[50]. Le théâtre devenait un lieu fort décrié[51]. La législation et les règles administratives de l'Empire étaient encore un véritable chaos. Le despotisme central, les franchises municipales et provinciales, le caprice des gouverneurs, les violences des communautés indépendantes se heurtaient de la manière la plus étrange. Mais la liberté religieuse gagnait à ces conflits. La belle administration unitaire qui s'établit à partir de Trajan sera bien plus fatale au culte naissant que l'état irrégulier, plein d'imprévu, sans police rigoureuse, du temps des Césars. Les institutions d'assistance publique, fondées sur ce
principe que l'État a des devoirs paternels envers ses membres, ne se
développèrent largement que depuis Nerva et Trajan[52]. On en trouve
cependant quelques traces au premier siècle[53]. Il y avait déjà
des secours pour les enfants[54], des
distributions d'aliments aux indigents, des taxes de boulangerie avec
indemnité pour les marchands, des précautions pour l'approvisionnement, des
primes et des assurances pour les armateurs, des bons de pain qui
permettaient d'acheter le blé à prix réduit[55]. Tous les
empereurs, sans exception, montrèrent la plus grande sollicitude pour ces
questions, inférieures si l'on veut, mais qui, à certaines époques, priment
toutes les autres. Dans la haute antiquité, on peut dire que le monde n'avait
pas besoin de charité. Le monde alors était jeune, vaillant ; l'hôpital était
inutile. La bonne et simple morale homérique, selon laquelle l'hôte, le
mendiant, viennent de la part de Jupiter[56], est la morale
de robustes et gais adolescents. L'état intellectuel des diverses parties de l'Empire était
peu satisfaisant. Sous ce rapport, il y avait une véritable décadence. La
haute culture de l'esprit n'est pas aussi indépendante des circonstances
politiques que l'est la moralité privée. Il s'en faut, d'ailleurs, que les
progrès de la haute culture de l'esprit et ceux de la moralité soient
parallèles. Marc-Aurèle fut certes un plus honnête homme que tous les anciens
philosophes grecs ; et pourtant ses notions positives sur les réalités de
l'univers sont inférieures à celles d'Aristote, d'Épicure ; car il croit par
moments aux dieux comme à des personnages finis et distincts, aux songes, aux
présages. Le monde, à l'époque romaine, accomplit un progrès de moralité et
subit une décadence scientifique. De Tibère à Nerva, cette décadence est tout
à fait sensible. Le génie grec, avec une originalité, une force, une richesse
qui n'ont jamais été égalées, avait créé depuis des siècles l'encyclopédie
rationnelle, la discipline normale de l'esprit. Ce mouvement merveilleux,
datant de Thaïes et des premières écoles d'Ionie (six
cents ans avant Jésus-Christ), était à peu près arrêté vers l'an 120
avant Jésus-Christ. Les derniers survivants de ces cinq siècles de génie,
Apollonius de Perge, Ératosthène, Aristarque, Héron, Archimède, Hipparque,
Chrysippe, Carnéade, Panétius, étaient morts sans avoir eu de successeurs. Je
ne vois que Posidonius et quelques astronomes qui continuent encore les
vieilles traditions d'Alexandrie, de Rhodes, de Pergame. L'Italie, en adoptant la science grecque, avait su, un
moment, l'animer d'un sentiment nouveau. Lucrèce avait fourni le modèle du
grand poème philosophique, à la fois hymne et blasphème, inspirant tour à
tour la sérénité et le désespoir, pénétré de ce sentiment profond de la
destinée humaine qui manqua toujours aux Grecs. Ceux-ci, en vrais enfants
qu'ils étaient, prenaient la vie d'une façon si gaie, que jamais ils ne
songèrent à maudire les dieux, à trouver la nature injuste et perfide envers
l'homme. De plus graves pensées se firent jour chez les philosophes latins.
Mais, pas mieux que L"Empire, jusqu'à Vespasien, n'avait rien qui put s'appeler instruction publique[65]. Ce qu'il eut plus tard en ce genre fut presque borné à de fades exercices de grammairiens ; la décadence générale en fut plutôt hâtée que ralentie. Les derniers temps du gouvernement républicain et le règne d'Auguste furent témoins d'un des plus beaux mouvements littéraires qu'il y ait jamais eu. Mais, après la mort du grand empereur, la décadence est rapide, ou, pour mieux dire, tout à fait subite. La société intelligente et cultivée des Cicéron, des Atticus, des César, des Mécène, des Agrippa, des Pollion, avait disparu comme un songe. Sans doute, il y avait encore des hommes éclairés, des hommes au courant de la science de leur temps, occupant de hautes positions sociales, tels que les Sénèque et la société littéraire dont ils étaient le centre, Lucilius, Gallion, Pline. Le corps du droit romain, qui est la philosophie même codifiée, la mise en pratique du rationalisme grec, continuait sa majestueuse croissance. Les grandes familles romaines avaient conservé un fond de religion élevée et une grande horreur de la superstition[66]. Les géographes Strabon et Pomponius Mela, le médecin et encyclopédiste Celse, le botaniste Dioscoride, le jurisconsulte Sempronius Proculus, étaient des têtes fort bien faites. Mais c'étaient là des exceptions. A part quelques milliers d'hommes éclairés, le monde était plongé dans une complète ignorance des lois de la nature[67]. La crédulité était une maladie générale[68]. La culture littéraire, se réduisait à une creuse rhétorique, qui n'apprenait rien. La direction essentiellement morale et pratique que la philosophie avait prise bannissait les grandes spéculations. Les connaissances humaines, si l'on excepte la géographie, ne faisaient aucun progrès. L'amateur instruit et lettré remplaçait le savant créateur. Le suprême défaut des Romains faisait sentir ici sa fatale influence. Ce peuple, si grand par l'empire, était secondaire par l'esprit. Les Romains les plus instruits, Lucrèce, Vitruve, Celse, Pline, Sénèque, étaient, pour les connaissances positives, les écoliers des Grecs. Trop souvent même, c'était la plus médiocre science grecque que l'on copiait médiocrement[69]. La ville de Rome n'eut jamais de grande école scientifique. Le charlatanisme y régnait presque sans contrôle. Enfin, la littérature latine, qui certainement eut des parties admirables, fleurit peu de temps et ne sortit pas du monde occidental[70]. De la mort d'Auguste à l'avènement de Trajan, il faut donc
placer une période d'abaissement momentané pour l'esprit humain. Le monde
antique était loin d'avoir dit son dernier mot ; mais la cruelle épreuve
qu'il traversait lui ôtait la voix et le cœur. Viennent des jours meilleurs,
et l'esprit, délivre du désolant régime des Césars, semblera revivre.
Epictète, Plutarque, Dion Chrysostome, Quintilien, Tacite, Pline le Jeune,
Juvénal, Rufus d'Ephèse, Arétée, Galien, Ptolémée, Hypsiclès, Théon, Lucien,
ramèneront les plus beaux jours de Le goût général était fort mauvais. Les grands écrivains grecs font défaut. Les écrivains latins que nous connaissons, à l'exception du satirique Perse, sont médiocres et sans génie. La déclamation gâtait tout. Le principe par lequel le public jugeait des œuvres de l'esprit était à peu près le même' que de notre temps. On ne cherchait que le trait brillant. La parole n'était plus ce vêtement simple de la pensée, tirant toute son élégance de sa parfaite proportion avec l'idée à exprimer. On cultivait la parole pour elle-même. Le but d'un auteur en écrivant était de montrer son talent. On mesurait l'excellence d'une récitation ou lecture publique, au nombre de mots applaudis dont elle était semée. Le grand principe qu'en fait d'art tout doit servir à l'ornement, mais que tout ce qui est mis exprès pour l'ornement est mauvais, ce principe, dis-je, était profondément oublié. Le temps était, si l'on veut, très-littéraire. On ne parlait que d'éloquence, de bon style, et au fond presque tout le monde écrivait mal ; il n'y avait pas un seul orateur ; car le bon orateur, le bon écrivain sont gens qui ne font métier ni de l'un ni de l'autre. Au théâtre, l'acteur principal absorbait l'attention ; on supprimait les pièces pour ne réciter que les morceaux d'éclat, les cantica. L'esprit de la littérature était un dilettantisme niais, qui gagnait jusqu'aux empereurs, une .sotte vanité qui portait chacun à prouver qu'il avait de l'esprit. De là une extrême fadeur, d'interminables Théséides, des drames faits pour être lus en coterie, toute une banalité poétique qu'on ne peut comparer qu'aux épopées et aux tragédies classiques d'il y a soixante ans. Le stoïcisme lui-même ne put échapper à ce défaut, ou du
moins ne sut pas, avant Épictète et Marc-Aurèle, trouver une belle forme pour
revêtir ses doctrines. Ce sont des monuments vraiment étranges que ces
tragédies de Sénèque, où les plus hauts sentiments sont exprimés sur le ton
d'un charlatanisme littéraire tout à fait fatigant, indices à la fois d'un
progrès moral et d'une décadence de goût irrémédiable. Il en faut dire autant
de Lucain. La tension d'âme, effet naturel de ce que la situation avait
d'éminemment tragique, donnait naissance à un genre enflé, où l'unique souci
était de briller par de belles sentences. Il arrivait quelque chose
d'analogue à ce qui se passa chez nous sous En tout cas, cette éducation, noble et distinguée à beaucoup d'égards, n'arrivait pas jusqu'au peuple. C'eût été là un médiocre inconvénient, si le peuple avait eu du moins un aliment religieux, quelque chose d'analogue à ce que reçoivent, à l'église, les portions les plus déshéritées de nos sociétés. Mais la religion dans toutes les parties de l'Empire était fort abaissée. Rome, avec une haute raison, avait laissé debout les anciens cultes, n'en retranchant que ce qui était inhumain[71] séditieux ou injurieux pour les autres[72]. Elle avait étendu sur tous une sorte de vernis officiel, qui les amenait à se ressembler et les fondait tant bien que mal ensemble. Malheureusement, ces vieux cultes, d'origine fort diverse, avaient un trait commun : c'était une égale impossibilité d'arriver à un enseignement théologique, à une morale appliquée, à une prédication édifiante, à un ministère pastoral vraiment fructueux pour le peuple. Le temple païen n'était nullement ce que furent à leur belle époque la synagogue et l'église, je veux dire maison commune, école, hôtellerie, hospice, abri où le pauvre va chercher un asile[73]. C'était une froide cella, où l'on n'entrait guère, où l'on n'apprenait rien. Le culte romain était peut-être le moins mauvais de ceux qu'on pratiquait encore. La pureté de cœur et de corps y était considérée comme faisant partie de la religion[74]. Par sa gravité, sa décence, son austérité, ce culte, à part quelques farces analogues à notre carnaval, était supérieur aux cérémonies bizarres et prêtant au ridicule que les personnes atteintes des manies orientales introduisaient secrètement. L'affectation que mettaient les patriciens romains à distinguer la religion, c'est-à-dire leur propre culte, de la superstition, c'est-à-dire des cultes étrangers[75], nous paraît cependant assez puérile. Tous les cultes païens étaient essentiellement superstitieux. Le paysan qui de nos jours met un sou dans le tronc d'une chapelle à miracles, qui invoque tel saint pour ses bœufs ou ses chevaux, qui boit de certaine eau dans certaines maladies, est en cela païen. Presque toutes nos superstitions sont les restes d'une religion antérieure au christianisme, que celui-ci n'a pu déraciner entièrement. Si l'on voulait retrouver de nos jours l'image du paganisme, c'est dans quelque village perdu, au fond des campagnes les plus arriérées, qu'il faudrait le chercher. N'ayant pour gardiens qu'une tradition populaire
vacillante et des sacristains intéressés, les cultes païens ne pouvaient
manquer de dégénérer en adulation[76]. Auguste,
quoique avec réserve, accepta d'être adoré de son vivant dans les provinces[77]. Tibère laissa
juger sous ses yeux cet ignoble concours des villes d'Asie, se disputant l'honneur
de lui élever un temple[78]. Les extravagantes
impiétés de Caligula ne produisirent aucune réaction ; hors du judaïsme, il
ne se trouva pas un seul prêtre pour résister à de telles folies. Sortis pour
la plupart d'un culte primitif des forces naturelles, dix fois transformés
par des mélanges de toute sorte et par l'imagination des peuples, les cultes
païens étaient limités par leur passé. On n'en pouvait tirer ce qui n'y fut
jamais, le déisme, l'édification. Les Pères de l'Église nous font sourire
quand ils relèvent les méfaits de Saturne comme père de famille, de Jupiter
comme mari. Mais, certes, il était bien plus ridicule encore d'ériger Jupiter
(c'est-à-dire l'atmosphère) en un dieu
moral, qui commande, défend, récompense, punit. Dans un monde qui aspirait à
posséder un catéchisme, que pouvait-on faire d'un culte comme celui de Vénus,
sorti d'une vieille nécessité sociale des premières navigations phéniciennes
dans De toutes parts, en effet, se manifestait avec énergie le
besoin d'une religion monothéiste, donnant pour base à la morale des
prescriptions divines. Il vient ainsi une époque où les religions
naturalistes, réduites à de purs enfantillages, à des simagrées de sorciers,
ne peuvent plus suffire aux sociétés, où l'humanité veut une religion morale,
philosophique. Le bouddhisme, le zoroastrisme, répondirent à ce besoin dans
l'Inde, dans Cette tentative ne se produisit pas encore au temps des Césars. Les premiers philosophes qui essayèrent une espèce d'alliance entre la philosophie et le paganisme, Euphrate de Tyr, Apollonius de Tyane et Plutarque, sont de la fin du siècle. Euphrate de Tyr nous est mal connu. La légende a tellement recouvert la trame de la biographie véritable d'Apollonius, qu'on ne sait s'il faut le compter parmi les sages, parmi les fondateurs religieux ou parmi les charlatans. Quant à Plutarque, c'est moins un penseur, un novateur, qu'un esprit modéré qui veut mettre tout le monde d'accord en rendant la philosophie timide et la religion à moitié raisonnable. Il n'y a rien chez lui de Porphyre ni de Julien. Les essais d'exégèse allégorique des stoïciens[80] sont bien faibles. Les mystères, comme ceux de Bacchus, où l'on enseignait l'immortalité de l'âme sous de gracieux symboles[81], étaient bornés à certains pays et n'avaient pas d'influence étendue. L'incrédulité à la religion officielle était générale dans la classe éclairée[82]. Les hommes politiques qui affectaient le plus de soutenir le culte de l'État s'en raillaient par de forts jolis mots[83]. On énonçait ouvertement le système immoral que les fables religieuses ne sont bonnes que pour le peuple, et doivent être maintenues pour lui[84]. Précaution fort inutile ; car la foi du peuple était elle-même profondément ébranlée[85]. A partir de l'avènement de Tibère, il est vrai, une réaction religieuse est sensible. Il semble que le monde s'effraye de l'incrédulité avouée des temps de César et d'Auguste ; on prélude à la malencontreuse tentative de Julien ; toutes les superstitions se voient réhabilitées par raison d'État[86]. Valère Maxime donne le premier exemple d'un écrivain de bas étage se faisant l'auxiliaire de théologiens aux abois, d'une plume vénale ou souillée mise au service de la religion. Mais ce sont les cultes étrangers qui profitent le plus de ce retour. La réaction sérieuse en faveur du culte gréco-romain ne se produira qu'au IIe siècle. Maintenant, les classes que possède l'inquiétude religieuse se tournent vers les cultes venus de l'Orient[87]. Isis et Sérapis trouvent plus de faveur que jamais[88]. Les imposteurs de toute espèce, thaumaturges, magiciens, profitent de ce besoin, et, comme il arrive d'ordinaire aux époques et dans les pays où la religion d'État est faible, pullulent de tous côtés[89] ; qu'on se rappelle les types réels ou fictifs d'Apollonius de Tyane, d'Alexandre d'Abonotique, de Pérégrinus, de Simon de Gitton[90]. Ces erreurs mêmes et ces chimères étaient comme une prière de la terre en travail, comme les essais infructueux d'un monde cherchant sa règle et aboutissant parfois dans ses efforts convulsifs à de monstrueuses créations destinées à l'oubli. En somme, le milieu du premier siècle est une des époques les plus mauvaises de l'histoire ancienne. La société grecque et romaine s'y montre en décadence sur ce qui précède et fort arriérée à l'égard de ce qui suit. Mais la grandeur de la crise décelait bien quelque formation étrange et secrète. La vie semblait avoir perdu ses mobiles ; les suicides se multipliaient[91]. Jamais siècle n'avait offert une telle lutte entre le bien et le mal. Le mal, c'était un despotisme redoutable, mettant le monde entre les mains d'hommes atroces et de fous ; c'était la corruption de mœurs, qui résultait de l'introduction à Rome des vices de l'Orient ; c'était l'absence d'une bonne religion et d'une sérieuse instruction publique. Le bien, c'était, d'une part, la philosophie, combattant à poitrine découverte contre les tyrans, défiant les monstres, trois ou quatre fois proscrite en un demi-siècle (sous Néron, sous Vespasien, sous Domitien)[92] ; c'étaient, d'une autre part, les efforts de la vertu populaire, ces légitimes aspirations à un meilleur état religieux, cette tendance vers les confréries, vers les cultes monothéistes, cette réhabilitation du pauvre, qui se produisaient principalement sous le couvert du judaïsme et du christianisme. Ces deux grandes protestations étaient loin d'être d'accord ; le parti philosophique et le parti chrétien ne se connaissaient pas, et ils avaient si peu conscience de la communauté de leurs efforts, que le parti philosophique, étant arrivé au pouvoir par l'avènement de Nerva, fut loin d'être favorable au christianisme. A vrai dire, le dessein des chrétiens était bien plus radical. Les stoïciens, maîtres de l'Empire, le réformèrent et présidèrent aux cent plus belles années de l'histoire de l'humanité. Les chrétiens, maîtres de l'Empire à partir de Constantin, achevèrent de le ruiner. L'héroïsme des uns ne doit pas faire oublier celui des autres. Le christianisme, si injuste pour les vertus païennes, prit à tâche de déprécier ceux qui avaient combattu les mêmes ennemis que lui. Il y eut dans la résistance de la philosophie, au premier siècle, autant de grandeur que dans celle du christianisme ; mais que la récompense de part et d'autre a été inégale ! Le martyr qui renversa du pied les idoles a sa légende ; pourquoi Annæus Cornutus, qui déclara devant Néron que les livres de celui-ci ne vaudraient jamais ceux de Chrysippe[93] ; pourquoi Helvidius Priscus, qui dit en face à Vespasien : Il est en toi de tuer ; en moi de mourir[94] ; pourquoi Démétrius le Cynique, qui répondit à Néron irrité : Vous me menacez de la mort ; mais la nature vous en menace[95], n'ont-ils pas leur image parmi les héros populaires que tous aiment et saluent ? L'humanité dispose-t-elle de tant de forces contre le vice et la bassesse, qu'il soit permis à chaque école de vertu de repousser l'aide des autres et de soutenir qu'elle seule a le droit d'être courageuse, fière, résignée ? |