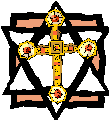LES APÔTRES
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
CHAPITRE XVI. MARCHE GÉNÉRALE DES MISSIONS CHRÉTIENNES.
|
Nous avons vu Barnabé partir d'Antioche pour remettre aux fidèles de Jérusalem la collecte de leurs frères de Syrie. Nous l'avons vu assister à quelques-unes des émotions que la persécution d'Hérode Agrippa Ier causa à l'Église de Jérusalem[1]. Revenons avec lui à Antioche, où toute l'activité créatrice de la secte semble en ce moment concentrée. Barnabé y ramena avec lui un zélé collaborateur. C'était son cousin Jean-Marc, le disciple intime de Pierre[2], le fils de cette Marie chez laquelle le premier des apôtres aimait à demeurer. Sans doute, en prenant avec lui ce nouveau coopérateur, il pensait déjà à la grande entreprise à laquelle il devait l'associer. Peut-être môme entrevoyait-il les divisions que cette entreprise susciterait, et était-il bien aise d'y mêler un homme qu'on savait être le bras droit de Pierre, c'est-à-dire de celui des apôtres qui avait dans les affaires générales le plus d'autorité. Cette entreprise n'était pas moins qu'une série de grandes missions qui devaient partir d'Antioche, ayant pour programme avoué la conversion du monde entier. Comme toutes les grandes résolutions qui se prenaient dans l'Eglise, celle-ci fut attribuée aune inspiration du Saint-Esprit. On crut à une vocation spéciale, à un choix surnaturel, qu'on supposa avoir été communiqué à l'Église d'Antioche pendant qu'elle jeûnait et priait. Peut-être l'un des prophètes de l'Église, Ménahem ou Lucius, dans un de ses accès' de glossolalie, prononça-t-il des paroles d'où l'on conclut que Paul et Barnabé étaient prédestinés à cette mission[3]. Quant à Paul, il était convaincu que Dieu l'avait choisi dès le ventre de sa mère pour l'uvre à laquelle il allait désormais se dévouer tout entier[4]. Les deux apôtres s'adjoignirent, à titre de subordonné, pour les seconder dans les soucis matériels de leur entreprise, ce Jean-Marc que Barnabé avait fait venir avec lui de Jérusalem[5]. Quand les préparatifs furent terminés, il y eut des jeûnes, des prières ; on imposa, dit-on, les mains aux deux apôtres en signe d'une mission conférée par l'Église elle-même[6] ; on les livra à la grâce de Dieu, et ils partirent[7]. De quel côté vont-ils se diriger ? Quel monde vont-ils évangéliser ? C'est ce qu'il importe maintenant de rechercher. Toutes les grandes missions chrétiennes primitives se
dirigèrent vers l'ouest, ou, en d'autres termes, se donnèrent pour théâtre et
pour cadre l'empire romain. Si l'on excepte quelques petites portions du
territoire, vassal des Arsacides, compris entre l'Euphrate et le Tigre,
l'empire des Parthes ne reçut pas de missions chrétiennes, au premier siècle[8]. Le Tigre fut, du
côté de l'orient, une borne que le christianisme ne dépassa que sous les
Sassanides. Deux grandes causes, De tous les pays étrangers à Il en fut de même de l'Egypte. L'Egypte ne joue presque aucun rôle dans l'histoire apostolique ; les missionnaires chrétiens semblent systématiquement y tourner le dos. Ce pays, qui, à partir du IIIe siècle, devint le théâtre d'événements si importants dans l'histoire de la religion, fut d'abord fort en retard avec le christianisme. Apollos est le seul docteur chrétien sorti de l'école d'x41exandrie ; encore avait-il appris le christianisme dans ses voyages[11]. Il faut chercher la cause de ce phénomène remarquable dans le peu de rapports qui existait entre les Juifs d'Egypte et ceux de Palestine, et surtout dans ce fait que l'Egypte juive avait en quelque sorte son développement religieux à part. L'Egypte avait Philon et les thérapeutes ; c'était là son christianisme[12], lequel la dispensait et la détournait d'accorder à l'autre une oreille attentive. Quant à l'Egypte païenne, elle possédait des institutions religieuses bien plus résistantes que celles du paganisme gréco-romain[13] ; la religion égyptienne était encore dans toute sa force ; c'était presque le moment où se bâtissaient ces temples énormes d'Esneh, d'Ombos, où l'espérance d'avoir dans le petit Césarion un dernier roi Ptolémée, un Messie national, faisait sortir de terre ces sanctuaires de Dendérah, d'Hermonthis, comparables aux plus beaux ouvrages pharaoniques. Le christianisme s'assit partout sur les ruines du sentiment national et des cultes locaux. La dégradation des âmes en Egypte y rendait rares, d'ailleurs, les aspirations qui ouvrirent partout au christianisme de si faciles accès. Un rapide éclair partant de Syrie, illuminant presque
simultanément les trois grandes péninsules d'Asie Mineure, de Grèce,
d'Italie, et bientôt suivi d'un second reflet qui embrassa presque toutes les
côtes de Depuis cent cinquante ans, en effet, le judaïsme, jusque-là borné à l'Orient et à l'Egypte, avait pris son vol vers l'Occident. Cyrène, Chypre, l'Asie Mineure, certaines villes de Macédoine et de Grèce, l'Italie, avaient des juiveries importantes[14]. Les juifs donnaient le premier exemple de ce genre de patriotisme que les Parsis, les Arméniens et, jusqu'à un certain point, les Grecs modernes devaient montrer plus tard ; patriotisme extrêmement énergique, quoique non attaché à un sol déterminé ; patriotisme de marchands répandus partout, se reconnaissant partout pour frères ; patriotisme aboutissant à former non de grands États compactes, mais de petites communautés autonomes au sein des autres États. Fortement associés entre eux, ces juifs de la dispersion constituaient dans les villes des congrégations presque indépendantes, ayant leurs magistrats, leurs conseils. Dans certaines villes, ils avaient un ethnarque ou alabarque, investi de droits presque souverains. Ils habitaient des quartiers à part, soustraits à la juridiction ordinaire, fort méprisés du reste du monde, mais où régnait le bonheur. On y était plutôt pauvre que riche. Le temps des grandes fortunes juives n'était pas encore venu ; elles commencèrent en Espagne, sous les Wisigoths[15]. L'accaparement de la finance par les juifs fut l'effet de l'incapacité administrative des barbares, de la haine que conçut l'Eglise pour la science de l'argent et de ses idées superficielles sur le prêt à intérêt. Sous l'empire romain, rien de semblable. Or, quand le juif n'est pas riche, il est pauvre ; l'aisance bourgeoise n'est pas son fait. En tout cas, il sait très-bien supporter la pauvreté. Ce qu'il sait mieux encore, c'est allier la préoccupation religieuse la plus exaltée à la plus rare habileté commerciale. Les excentricités théologiques n'excluent nullement le bon sens en affaires. En Angleterre, en Amérique, en Russie, les sectaires les plus bizarres (irvingiens, saints des derniers jours, raskolniks) sont de très-bons marchands. Le propre de la vie juive pieusement pratiquée a toujours été de produire beaucoup de gaieté et de cordialité. On s'aimait dans ce petit monde ; on y aimait un passé et le même passé ; les cérémonies religieuses embrassaient fort doucement la vie. C'était quelque chose d'analogue à ces communautés distinctes qui existent encore dans chaque grande ville turque ; par exemple, aux communautés grecque, arménienne, juive, de Smyrne, étroites camaraderies où tout le monde se connaît, vit ensemble, intrigue ensemble. Dans ces petites républiques les questions religieuses dominent toujours les questions politiques, ou plutôt suppléent au manque de celles-ci. Une hérésie y est une affaire d'État ; un schisme y a toujours pour origine une question de personnes. Les Romains, sauf de rares exceptions, ne pénétraient jamais dans ces quartiers réserves. Les synagogues promulguaient des décrets, décernaient des honneurs, faisaient acte de vraies municipalités. L'influence de ces corporations était très-grande. A Alexandrie, elle était de premier ordre, et dominait toute l'histoire intérieure de la cité[16]. A Rome, les juifs étaient nombreux[17] et formaient un appui qu'on ne dédaignait pas. Cicéron présente comme un acte de courage d'avoir osé leur résister[18]. César les favorisa et les trouva fidèles[19]. Tibère fut amené, afin de les contenir, aux mesures les plus sévères[20]. Caligula, dont le règne fut pour eux néfaste en Orient, leur rendit leur liberté d'association à Rome[21]. Claude, qui les favorisait en Judée, se vit obligé de les chasser de la ville[22]. On les rencontrait partout[23], et on osait dire d'eux comme des Grecs, que, vaincus, ils avaient imposé des lois à leurs dominateurs[24]. Les dispositions des populations indigènes envers ces étrangers étaient fort diverses. D'une part, le sentiment de répulsion et d'antipathie que les juifs, par leur esprit d'isolement jaloux, leur caractère rancunier, leurs habitudes insociables, ont produit autour d'eux partout où ils ont été nombreux et organisés, se manifestait avec force[25] Quand ils étaient libres, ils étaient en réalité privilégiés ; car ils jouissaient des avantages de la société, sans en supporter les charges[26]. Des charlatans exploitaient le mouvement de curiosité que causait leur culte, et, sous prétexte d'en exposer les secrets, se livraient à toutes sortes de friponneries[27]. Des pamphlets violents et à demi burlesques, comme celui d'Apion, pamphlets où les écrivains profanes ont trop souvent puisé leurs renseignements[28], circulaient, servant d'aliment aux colères du public païen. Les juifs semblent avoir été en général taquins, portés à se plaindre. On voyait en eux une société secrète, malveillante pour le reste des hommes, dont les membres se poussaient à tout prix, au détriment des autres[29]. Leurs usages bizarres, leur aversion pour certains aliments, leur saleté, leur manque de distinction, la mauvaise odeur qu'ils exhalaient[30]. leurs scrupules religieux, leurs minuties dans l'observance du sabbat, étaient trouvés ridicules[31]. Mis au ban de la société, les juifs, par une conséquence naturelle, n'avaient aucun souci de paraître gentilshommes. On les rencontrait partout en voyage avec des habits luisants de saleté, un air gauche, une mine fatiguée, un teint pâle, de gros yeux malades[32], une expression béate, faisant bande à part avec leurs femmes, leurs enfants, leurs paquets de couvertures, le panier qui constituait tout leur mobilier[33]. Dans les villes, ils exerçaient les trafics les plus chétifs, mendiants[34], chiffonniers, brocanteurs, vendeurs d'allumettes[35]. On dépréciait injustement leur loi et leur histoire. Tantôt on les trouvait superstitieux[36], cruels[37] ; tantôt, athées, contempteurs des dieux[38]. Leur aversion pour les images paraissait de la pure impiété. La circoncision surtout fournissait le thème d'interminables railleries[39]. Mais ces jugements superficiels n'étaient pas ceux de tous. Les juifs avaient autant d'amis que de détracteurs. Leur gravité, leurs bonnes murs, la simplicité de leur culte charmaient une foule de gens. On sentait en eux quelque chose de supérieur. Une vaste propagande monothéiste et mosaïque s'organisait[40] ; une sorte de tourbillon puissant se formait autour de ce singulier petit peuple. Le pauvre colporteur juif du Transtevere[41], sortant le matin avec son éventaire de merceries, rentrait souvent le soir, riche d'aumônes venues d'une main pieuse[42]. Les femmes surtout étaient attirées vers ces missionnaires en haillons[43]. Juvénal[44] compte le penchant vers la religion juive parmi les vices qu'il reproche aux dames de son temps. Celles qui étaient converties vantaient le trésor qu'elles avaient trouvé et le bonheur dont elles jouissaient[45]. Le vieil esprit hellénique et romain résistait énergiquement ; le mépris et la haine pour les juifs sont le signe de tous les esprits cultivés, Cicéron, Horace, Sénèque, Juvénal, Tacite, Quintilien, Suétone[46]. Au contraire, cette masse énorme de populations mêlées que l'Empire avait assujetties, populations auxquelles l'ancien esprit romain et la sagesse hellénique étaient étrangères ou indifférentes, accouraient en foule vers une société où elles trouvaient des exemples touchants de concorde, de charité, de secours mutuels[47], d'attachement à son état, de goût pour le travail[48], de fière pauvreté. La mendicité, qui fut plus tard une chose toute chrétienne, était dès lors une chose juive. Le mendiant par état, formé par sa mère, se présentait à l'idée des poètes du temps comme un juif[49]. L'exemption de certaines charges civiles, en particulier de la milice, pouvait aussi contribuer à faire regarder le sort des juifs comme enviable[50]. L'État alors demandait beaucoup de sacrifices et donnait peu de joies morales. Il y faisait un froid glacial, comme en une plaine uniforme et sans abri. La vie, si triste au sein du paganisme, reprenait son charme et son prix dans ces tièdes atmosphères de synagogue et d'église. Ce n'était pas la liberté qu'on y trouvait. Les confrères s'espionnaient beaucoup, se tracassaient sans cesse les uns les autres. Mais, quoique la vie intérieure de ces petites communautés fut fort agitée, on s'y plaisait infiniment ; on ne les quittait pas ; il n'y avait pas d'apostat. Le pauvre y était content, regardait la richesse sans envie, avec la tranquillité d'une bonne conscience[51]. Le sentiment vraiment démocratique de la folie des mondains, de la vanité des richesses et des grandeurs profanes, s'y exprimait finement. On y comprenait peu le monde païen, et on le jugeait avec une sévérité outrée ; la civilisation romaine paraissait un amas d'impuretés et de vices odieux[52], de la même manière qu'un honnête ouvrier de nos jours, imbu des déclamations socialistes, se représente les aristocrates sous les couleurs les plus noires. Mais il y avait là de la vie, de la gaieté, de l'intérêt, comme aujourd'hui dans les plus pauvres synagogues des juifs de Pologne et de Galicie. Le manque d'élégance et de délicatesse dans les habitudes était compensé par un précieux esprit de famille et de bonhomie patriarcale. Dans la grande, société, au contraire, l'égoïsme et l'isolement des âmes avaient porté leurs derniers fruits. La parole de Zacharie[53] se vérifiait : le monde se prenait aux pans de l'habit des Juifs et leur disait : Menez-nous à Jérusalem. Il n'y avait pas de grande ville où l'on n'observât le sabbat, le jeune et les autres cérémonies du judaïsme[54]. Josèphe ose provoquer ceux qui en douteraient à considérer leur patrie ou même leur propre maison, pour voir s'ils n'y trouveront pas la confirmation de ce qu'il dit. La présence à Rome et près de l'empereur de plusieurs membres de la famille des Hérodes, lesquels pratiquaient leur culte avec éclat à la face de tous[55], contribuait beaucoup à cette publicité. Le sabbat, du reste, s'imposait par une sorte de nécessité dans les quartiers où il y avait des juifs. Leur obstination absolue à ne pas ouvrir leurs boutiques ce jour-là forçait bien les voisins à modifier leurs habitudes en conséquence. C'est ainsi qu'à Salonique, on peut dire que le sabbat s'observe encore de nos jours, la population juive y étant assez riche et assez nombreuse pour faire la loi et régler par la fermeture de ses comptoirs le jour du repos. Presque à l'égal du Juif, souvent de compagnie avec lui,
le Syrien était un actif instrument de la conquête de l'Occident par l'Orient[56]. On les
confondait parfois, et Cicéron croyait avoir trouvé le trait commun qui les
unissait en les appelant des nations nées pour la
servitude[57]. C'était là ce
qui leur assurait l'avenir ; car l'avenir alors était aux esclaves. Un trait
non moins essentiel du Syrien était sa facilité, sa souplesse, la clarté
superficielle de son esprit. La nature syrienne est comme une image fugitive
dans les nuées du ciel. On voit par moments certaines lignes s'y tracer avec
grâce ; mais ces lignes n'arrivent jamais à former un dessin complet. Dans
l'ombre, à la lueur indécise d'une lampe, la femme syrienne, sous ses voiles,
avec son il vague et ses mollesses infinies, produit quelques instants
d'illusion. Puis, quand on veut analyser cette beauté, elle s'évanouit ; elle
ne supporte pas l'examen. Tout cela, au reste, dure à peine trois ou quatre
années. Ce que la race syrienne a de charmant, c'est l'enfant de cinq ou six
ans ; à l'inverse de Beaucoup des émigrants syriens que le désir de faire
fortune entraînait vers l'Occident étaient plus ou moins rattachés au judaïsme.
Ceux qui ne l'étaient pas restaient fidèles au culte de leur village[59], c'est-à-dire au
souvenir de quelque temple dédié à un Jupiter
local[60], lequel n'était
d'ordinaire que le Dieu suprême, déterminé par quelque titre particulier[61]. C'était au fond
une espèce de monothéisme que ces Syriens apportaient sous le couvert de
leurs dieux étranges. Comparés du moins aux personnalités divines
profondément distinctes qu'offrait le polythéisme grec et romain, les dieux
dont il s'agit, pour la plupart synonymes du Soleil, étaient presque des
frères du dieu unique[62]. Semblables à de
longues mélopées énervantes, ces cultes de Syrie pouvaient paraître moins
secs que le culte latin, moins vides que le culte grec. Les femmes syriennes
y prenaient quelque chose à la fois de voluptueux et d'exalté. Ces femmes
furent de tout temps des êtres bizarres, disputées entre le démon et Dieu, flottant
entre la sainte et la possédée. La sainte des vertus sérieuses, des héroïques
renoncements, des résolutions suivies appartient à d'autres races et à
d'autres climats ; la sainte des fortes imaginations, des entraînements
absolus, des promptes amours, est la sainte de Syrie. La possédée de notre
moyen âge est l'esclave de Satan par bassesse ou par péché ; la possédée de
Syrie est la folle par idéal, la femme dont le sentiment a été blessé, qui se
venge par la frénésie ou se renferme dans le mutisme[63], qui n'attend
pour être guérie qu'une douce parole ou qu'un doux regard. Transportées dans
le monde occidental, ces Syriennes acquéraient de l'influence, quelquefois
par de mauvais arts de femme, plus souvent par une certaine supériorité
morale et une réelle capacité. Cela se vit surtout cent cinquante ans plus
tard, quand les personnages les plus importants de Rome épousèrent des Syriennes,
qui prirent tout à coup sur les affaires un très-grand ascendant. La femme
musulmane de nos jours, mégère criarde, sottement fanatique, n'existant guère
que pour le mal, presque incapable de vertu, ne doit pas faire oublier les
Julia Domna, les Julia Msa, les Julia Mamsea, les Julia Soémie, qui
portèrent à Rome, en fait de religion, une tolérance et des instincts de mysticité
inconnus jusque-là. Ce qu'il y a de bien remarquable aussi, c'est que la
dynastie syrienne amenée de la sorte se montra favorable au christianisme,
que Marnée, et plus tard l'empereur Philippe l'Arabe[64], passèrent pour
chrétiens. Le christianisme, au IIIe et au IVe siècle, fut par excellence la
religion de C'est surtout à Rome que le Syrien, au premier siècle, exerçait sa pénétrante activité. Chargé de presque tous les petits métiers, valet déplace, commissionnaire, porteur de litière, le Syrus[65] entrait partout, introduisant avec lui la langue et les murs de son pays[66]. Il n'avait ni la fierté ni la hauteur philosophique des Européens, encore moins leur vigueur ; faible de corps, pâle, souvent fiévreux, ne sachant ni manger ni dormir à des heures réglées, à la façon de nos lourdes et solides races, consommant peu de viande, vivant d'oignons et de courges, dormant peu et d'un sommeil léger, le Syrien mourait jeune et était habituellement malade[67]. Ce qu'il avait en propre, c'était l'humilité, la douceur, l'affabilité, une certaine bonté ; nulle solidité d'esprit, mais beaucoup de charme ; peu de bon sens, si ce n'est quand il s'agissait de son négoce, mais une étonnante ardeur et une séduction toute féminine. Le Syrien, n'ayant jamais eu de vie politique, a une aptitude toute particulière pour les mouvements religieux. Ce pauvre Maronite, à demi femme, humble, déguenillé, a fait la plus grande des révolutions. Son ancêtre, le Syrus de Rome, a été le plus zélé porteur de la bonne nouvelle à tous les affligés. Chaque année amenait en Grèce, en Italie, en Gaule, des colonies de ces Syriens poussés par le goût naturel qu'ils avaient pour les petites affaires[68]. On les reconnaissait sur les navires à leur famille nombreuse, à ces troupes de jolis enfants, presque du même âge, qui les suivaient, la mère, avec l'air enfantin d'une petite fille de quatorze ans, se tenant à côté de son mari, soumise, doucement rieuse, à peine supérieure à ses fils aînés[69]. Les têtes, dans ce groupe paisible, sont peu accentuées ; sûrement il n'y a pas là d'Archimède, de Platon, de Phidias. Mais ce marchand syrien, arrivé à Rome, sera un homme bon et miséricordieux, charitable pour ses compatriotes, aimant les pauvres. Il causera avec les esclaves, leur révélera un asile où ces malheureux, réduits par la dureté romaine à la plus désolante solitude, trouveront un peu de consolation. Les races grecques et latines, races de maîtres, faites pour le grand, ne savaient pas tirer parti d'une position humble[70]. L'esclave de ces races passait sa vie dans la révolte et le désir du mal. L'esclave idéal du l'antiquité a tous les défauts : gourmand, menteur, méchant, ennemi naturel de son maître[71]. Par là, il prouvait en quelque manière sa noblesse ; il protestait contre une situation hors nature. Le bon Syrien, lui, ne protestait pas ; il acceptait son ignominie, et cherchait à en tirer le meilleur parti possible. Il se conciliait la bienveillance de son maître, osait lui parler, savait plaire à sa maîtresse. Ce grand agent de démocratie allait ainsi dénouant maille par maille le réseau de la civilisation antique. Les vieilles sociétés, fondées sur le dédain, sur l'inégalité des races, sur la valeur militaire, étaient perdues. L'infirmité, la bassesse, vont maintenant devenir un avantage, un perfectionnement de la vertu[72]. La noblesse romaine, la sagesse grecque, lutteront encore trois siècles. Tacite trouvera bon qu'on déporte des milliers de ces malheureux : si interissent, vile damnum[73] ! L'aristocratie romaine s'irritera, trouvera mauvais que cette canaille ait ses dieux, ses institutions. Mais la victoire est écrite d'avance. Le Syrien, le pauvre homme qui aime ses semblables, qui partage avec eux, qui s'associe avec eux, l'emportera. L'aristocratie romaine périra, faute de pitié. Pour nous expliquer la révolution qui va s'accomplir, il faut nous rendre compte de l'état politique, social, moral, intellectuel et religieux des pays où le prosélytisme juif avait ainsi ouvert des sillons que la prédication chrétienne doit féconder. Cette étude montrera, j'espère, avec évidence, que la conversion du monde aux idées juives et chrétiennes était inévitable, et ne laissera d'étonnement que sur un point, c'est que cette conversion se soit faite si lentement et si tard. |