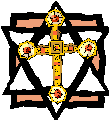LA VIE DE
CHAPITRE VII.
Développement des idées de Jésus pour le royaume de Dieu.
|
Jusqu’à l’arrestation de Jean, que nous plaçons par approximation dans l’été de l’an 29, Jésus ne quitta pas les environs de la mer Morte et du Jourdain. Le séjour au désert de Judée était généralement considéré comme la préparation des grandes choses, comme une sorte de retraite avant les actes publics. Jésus s’y soumit à l’exemple des autres et passa quarante jours sans autre compagnie que les bêtes sauvages, pratiquant un jeûne rigoureux. L’imagination des disciples s’exerça beaucoup sur ce séjour. Le désert était, dans les croyances populaires, la demeure des démons[1]. Il existe au monde peu de régions plus désolées, plus abandonnées de Dieu, plus fermées à la vie que la pente rocailleuse qui forme le bord occidental de la mer Morte. Or crut que pendant le temps qu’il passa dans cet affreux pays, il avait traversé de terribles épreuves, que Satan l’avait effrayé de ses illusions ou bercé de séduisantes promesses, qu’ensuite les anges pour le récompenser de sa victoire étaient venus le servir[2]. Ce fut probablement en sortant du désert que Jésus apprit l’arrestation de Jean-Baptiste. Il n’avait plus de raisons désormais de prolonger son séjour dans un pays qui lui était à demi étranger. Peut-être craignait-il aussi d’être enveloppé dans les sévérités qu’on déployait à l’égard de Jean, et ne voulait-il pas s’exposer, en un temps où, vu le peu de célébrité qu’il avait, sa mort ne pouvait servir en rien au progrès de ses idées. Il regagna la Galilée[3], sa vraie patrie, mûri par une importante expérience et ayant puisé dans le contact avec un grand homme, fort différent de lui, le sentiment de sa propre originalité. En somme, l’influence de Jean avait été plus fâcheuse qu’utile à Jésus. Elle fut un arrêt dans son développement ; tout porte à croire qu’il avait, quand il descendit vers le Jourdain, des idées supérieures à celles de Jean, et que ce fut par une sorte de concession qu’il inclina un moment vers le baptisme. Peut-être si le baptiste, à l’autorité duquel il lui aurait été difficile de se soustraire, fût resté libre, n’eût-il pas su rejeter le joug des rites et des pratiques extérieures, et alors sans doute il fût resté un sectaire juif inconnu ; car le monde n’eût pas abandonné des pratiques pour d’autres. C’est par l’attrait d’une religion dégagée de toute forme extérieure que le christianisme a séduit les âmes élevées. Le baptiste une fois emprisonné, son école fut fort amoindrie, et Jésus se trouva rendu à son propre mouvement. La seule chose qu’il dut à Jean, ce furent en quelque sorte des leçons de prédication et d’action populaire. Dès ce moment, en effet, il prêche avec beaucoup plus de force et s’impose à la foule avec autorité[4]. Il semble aussi que son séjour près de Jean, moins par l’action du baptiste que par la marche naturelle de sa propre pensée, mûrit beaucoup ses idées sur « le royaume du ciel ». Son mot d’ordre désormais, c’est la « bonne nouvelle », l’annonce que le règne de Dieu est proche[5]. Jésus ne sera plus seulement un délicieux moraliste, aspirant à renfermer en quelques aphorismes vifs et courts des leçons sublimes ; c’est le révolutionnaire transcendant, qui essaye de renouveler le monde par ses bases mêmes et de fonder sur terre l’idéal qu’il a conçu. Attendre le royaume de Dieu sera synonyme d’être disciple de Jésus[6]. Ce mot de royaume de Dieu ou de royaume du ciel, ainsi que nous l’avons déjà dit, était depuis longtemps familier aux Juifs. Mais Jésus lui donnait un sens moral, une portée sociale que l’auteur même du Livre de Daniel, dans son enthousiasme apocalyptique avait à peine osé entrevoir. Dans le monde tel qu’il est, c’est le mal qui règne. Satan est le « roi de ce monde[7] », et tout lui obéit. Les rois tuent les prophètes. Les prêtres et les docteurs ne font pas ce qu’ils ordonnent aux autres de faire. Les justes sont persécutés, et l’unique partage des bons est de pleurer. Le monde est de la sorte l’ennemi de Dieu et de ses saints[8] ; mais Dieu se réveillera et vengera ses saints. Le jour est proche ; car l’abomination est à son comble. Le règne du bien aura son tour. L’avènement de ce règne du bien sera une grande révolution subite. Le monde semblera renversé; l’état actuel étant mauvais, pour se représenter l’avenir, il suffit de concevoir à peu près le contraire de ce qui existe. Les premiers seront les derniers[9]. Un ordre nouveau gouvernera l’humanité. Maintenant le bien et le mal sont mêlés comme l’ivraie et le bon grain dans un champ. Le maître les laisse croître ensemble ; mais l’heure de la séparation violente arrivera[10]. Le royaume de Dieu sera comme un grand coup de filet, qui amène du bon et du mauvais poisson ; on met le bon dans des jarres, et on se débarrasse du reste[11]. Le germe de cette grande révolution sera d’abord méconnaissable. Il sera comme le grain de sénevé, qui est la plus petite des semences, mais qui, jeté en terre, devient un arbre sous le feuillage duquel les oiseaux viennent se reposer[12] ; ou bien il sera comme le levain qui, déposé dans la pâte, la fait fermenter tout entière[13]. Une série de paraboles, souvent obscures, était destinée à exprimer les surprises de cet avènement soudain, ses apparentes injustices, son caractère inévitable et définitif[14]. Qui établira ce règne de Dieu ? Rappelons-nous que la première pensée de Jésus, pensée tellement profonde chez lui qu’elle n’eut probablement pas d’origine et tenait aux racines mêmes de son être, fut qu’il était le fils de Dieu, l’intime de son Père, l’exécuteur de ses volontés. La réponse de Jésus à une telle question ne pouvait donc être douteuse. La persuasion qu’il ferait régner Dieu s’empara de son esprit d’une manière absolue. Il s’envisagea comme l’universel réformateur. Le ciel, la terre, la nature tout entière, la folie, la maladie et la mort ne sont que des instruments pour lui. Dans son accès de volonté héroïque, il se croit tout-puissant. Si la terre ne se prête pas à cette transformation suprême, la terre sera broyée, purifiée par la flamme et le souffle de Dieu. Un ciel nouveau sera créé, et le monde entier sera peuplé d’anges de Dieu[15]. Une révolution radicale[16], embrassant jusqu’à la nature elle-même, telle fut donc la pensée fondamentale de Jésus. Dès lors, sans doute, il avait renoncé à la politique ; l’exemple de Juda le Gaulonite lui avait montré l’inutilité des séditions populaires. Jamais il ne songea à se révolter contre les Romains et les tétrarques. Le principe effréné et anarchique du Gaulonite n’était pas le sien. Sa soumission aux pouvoirs établis, dérisoire au fond, était complète dans la forme. Il payait le tribut à César pour ne pas scandaliser. La liberté et le droit ne sont pas de ce monde ; pourquoi troubler sa vie par de vaines susceptibilités ? Méprisant la terre, convaincu que le monde présent ne mérite pas qu’on s’en soucie, il se réfugiait dans son royaume idéal ; il fondait cette grande doctrine du dédain transcendant[17], vraie doctrine de la liberté des âmes, qui seule donne la paix. Mais il n’avait pas dit encore : Mon royaume n’est pas de ce monde. Bien des ténèbres se mêlaient à ses vues les plus droites. Parfois des tentations étranges traversaient son esprit. Dans le désert de Judée, Satan lui avait proposé les royaumes de la terre. Ne connaissant pas la force de l’empire romain, il pouvait, avec le fond d’enthousiasme qu’il y avait en Judée et qui aboutit bientôt après à une si terrible résistance militaire, il pouvait, dis-je, espérer de fonder un royaume par l’audace et le nombre de ses partisans. Plusieurs fois peut-être se posa pour lui la question suprême Le royaume de Dieu se réalisera-t-il par la force ou par la douceur, par la révolte ou par la patience ? Un jour, dit-on, les simples gens de Galilée voulurent l’enlever et le faire roi[18]. Jésus s’enfuit dans la montagne et y resta quelque temps seul. Sa belle nature le préserva de l’erreur qui eût fait de lui un agitateur ou un chef de rebelles, un Theudas ou un Barkokeba. La révolution qu’il voulut faire fut toujours une révolution morale ; mais il n’en était pas encore arrivé à se fier pour l’exécution aux anges et à la trompette finale. C’est sur les hommes et par les hommes eux-mêmes qu’il voulait agir. Un visionnaire qui n’aurait eu d’autre idée que la proximité du jugement dernier n’eût pas eu ce soin pour l’amélioration de l’homme, et n’eût pas fondé le plus bel enseignement moral que l’humanité ait reçu. Beaucoup de vague restait sans doute dans sa pensée, et un noble sentiment, bien plus qu’un dessein arrêté, le poussait à l’œuvre sublime qui s’est réalisée par lui, bien que d’une manière fort différente de celle qu’il imaginait. C’est bien le royaume de Dieu, en effet, je veux dire le
royaume de l’esprit, qu’il fondait, et si Jésus, du sein de son Père, voit
son œuvre fructifier dans l’histoire, il peut bien dire avec vérité Voilà ce que j’ai voulu. Ce que Jésus a
fondé, ce qui restera éternellement de lui, abstraction faite des imperfections
qui se mêlent à toute chose réalisée par l’humanité, c’est la doctrine de la
liberté des âmes. Déjà L’homme surtout préoccupé des devoirs de la vie publique ne pardonne pas aux autres de mettre quelque chose au-dessus de ses querelles de parti. Il blâme surtout ceux qui subordonnent aux questions sociales les questions politiques et professent pour celles-ci une sorte d’indifférence. Il a raison en un sens, car toute direction exclusive est préjudiciable au bon gouvernement des choses humaines. Mais quel progrès les partis ont-ils fait faire à la moralité générale de notre espèce ? Si Jésus, au lieu de fonder son royaume céleste, était parti pour Rome, s’était usé à conspirer contre Tibère, ou à regretter Germanicus, que serait devenu le monde ? Républicain austère, patriote zélé, il n’eût pas arrêté le grand courant des affaires de son siècle, tandis qu’en déclarant la politique insignifiante, il a révélé au monde cette vérité que la patrie n’est pas tout, et que l’homme est antérieur et supérieur au citoyen. Nos principes de science positive sont blessés de la part
de rêves que renfermait le programme de Jésus. Nous savons l’histoire de la
terre ; les révolutions cosmiques du genre de celle qu’attendait Jésus
ne se produisent que par des causes géologiques ou astronomiques, dont on n’a
jamais constaté le lien avec les choses morales. Mais, pour être juste envers
les grands créateurs, il ne faut pas s’arrêter aux préjugés qu’ils ont pu partager.
Colomb a découvert l’Amérique en partant d’idées fort erronées ; Newton
croyait sa folle explication de l’Apocalypse aussi certaine que son système
du monde. Mettra-t-on tel homme médiocre de notre temps au-dessus d’un
François d’Assise, d’un saint Bernard, d’une Jeanne d’Arc, d’un Luther, parce
qu’il est exempt des erreurs que ces derniers ont professées ? Voudrait-on
mesurer les hommes à la rectitude de leurs idées en physique et à la
connaissance plus ou moins exacte qu’ils possèdent du vrai système du
monde ? Comprenons mieux la position de Jésus et ce qui fit sa force. Le
déisme du XVIIIe
siècle et un certain protestantisme nous ont habitués à ne considérer le
fondateur de la foi chrétienne que comme un grand moraliste, un bienfaiteur
de l’humanité. Nous ne voyons plus dans l’Évangile que de bonnes
maximes ; nous jetons un voile prudent sur l’étrange état intellectuel
où il est né. Il y a des personnes qui regrettent aussi que Au fond, l’idéal est toujours une utopie. Quand nous
voulons aujourd’hui représenter le Christ de la conscience moderne, le
consolateur, le juge des temps nouveaux, que faisons-nous ? Ce que fit
Jésus lui-même il y a 1830 ans. Nous supposons les conditions du monde réel
tout autres qu’elles ne sont ; nous représentons un libérateur moral
brisant sans armes les fers du nègre, améliorant la condition du prolétaire,
délivrant les nations opprimées. Nous oublions que cela suppose le monde
renversé, le climat de Qu’il y eût une contradiction entre la croyance d’une fin prochaine du monde et la morale habituelle de Jésus, conçue en vue d’un état stable de l’humanité, assez analogue à celui qui existe en effet, c’est ce qu’on n’essayera pas de nier[23]. Ce fut justement cette contradiction qui assura la fortune de son œuvre. Le millénaire seul n’aurait rien fait de durable ; le moraliste seul n’aurait rien fait de puissant. Le millénarisme donna l’impulsion, la morale assura l’avenir. Par là, le christianisme réunit les deux conditions des grands succès en ce monde, un point de départ révolutionnaire et la possibilité de vivre. Tout ce qui est fait pour réussir doit répondre à ces deux besoins ; car le monde veut à la fois changer et durer. Jésus, en même temps qu’il annonçait un bouleversement sans égal dans les choses humaines, proclamait les principes sur lesquels la société repose depuis dix-huit cents ans. Ce qui distingue, en effet, Jésus des agitateurs de son temps et de ceux de tous les siècles, c’est son parfait idéalisme. Jésus, à quelques égards, est un anarchiste, car il n’a aucune idée du gouvernement civil. Ce gouvernement lui semble purement et simplement un abus. Il en parle en termes vagues et à la façon d’une personne du peuple qui n’a aucune idée de politique. Tout magistrat lui paraît un ennemi naturel des hommes de Dieu ; il annonce à ses disciples des démêlés avec la police, sans songer un moment qu’il y ait là matière à rougir[24]. Mais jamais la tentative de se substituer aux puissants et aux riches ne se montre chez lui. Il veut anéantir la richesse et le pouvoir, mais non s’en emparer. Il prédit à ses disciples des persécutions et des supplices[25] ; mais pas une seule fois la pensée d’une résistance armée ne se laisse entrevoir. L’idée qu’on est tout-puissant par la souffrance et la résignation, qu’on triomphe de la force par la pureté du cœur, est bien une idée propre de Jésus. Jésus n’est pas un spiritualiste ; car tout aboutit pour lui à une réalisation palpable ; il n’a pas la moindre notion d’une âme séparée du corps. Mais c’est un idéaliste accompli, la matière n’étant pour lui que le signe de l’idée, et le réel l’expression vivante de ce qui ne paraît pas. A qui s’adresser, sur qui compter pour fonder le règne de Dieu ? La pensée de Jésus en ceci n’hésita jamais. Ce qui est haut pour les hommes est en abomination aux yeux de Dieu[26]. Les fondateurs du royaume de Dieu seront les simples. Pas de riches, pas de docteurs, pas de prêtres ; des femmes, des hommes du peuple, des humbles, des petits[27]. Le grand signe du Messie, c’est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres[28]. La nature idyllique et douce de Jésus reprenait ici le dessus. Une immense révolution sociale, où les rangs seront intervertis, où tout ce qui est officiel en ce monde sera humilié, voilà son rêve. Le monde ne le croira pas ; le monde le tuera. Mais ses disciples ne seront pas du monde[29]. Ils seront un petit troupeau d’humbles et de simples, qui vaincra par son humilité même. Le sentiment qui a fait de mondain l’antithèse de chrétien a, dans les pensées du maître, sa pleine justification[30]. |