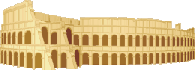ÉTUDES DE MŒURS ET DE CRITIQUE SUR LES POÈTES LATINS DE LA DÉCADENCE
JUGEMENTS SUR LES QUATRE GRANDS HISTORIENS LATINS.
SALLUSTE.
|
En quittant César pour Salluste, on passe de la forme la plus simple de l’histoire à sa forme la plus compliquée, des mémoires à l’histoire proprement dite. Les ouvrages historiques sont de trois sortes, par rapport à la condition de l’historien : Ou bien l’historien a rempli un rôle dans les événements qu’il raconte, et, ce qu’il y a fait, il l’écrit ; Ou bien, il n’y a figuré que comme témoin, et ce sont ses impressions qu’il exprime plutôt que ses actions qu’il raconte ; Ou bien enfin ces événements se sont accomplis avant qu’il fût né, et c’est en s’y transportant par l’imagination qu’il s’en fait le témoin et qu’il en reçoit des impressions qui se gravent dans ses récits. Par un privilège qui n’a été donné à aucune nation, Rome a possédé de grands écrivains dans ces trois conditions, de grands modèles dans ces trois sortes d’histoire. Car, quel plus grand acteur que César dans les événements qu’il raconte ! Quel témoin plus intelligent que Salluste, plus passionné que Tacite, dans la partie de leurs écrits où ils ont retracé des événements contemporains ; Salluste, la conjuration de Catilina ; Tacite, ces règnes, dont il n’a reçu, dit-il, ni injure ni bienfait ! Quel auteur plus ému de la grandeur du passé romain, plus présent à ces sept siècles employés à conquérir le monde et à fonder un gouvernement libre, quel plus fidèle témoin des temps où il n’a pas vécu, que Tite Live ! C’est trop peu dire ; chacun de ces grands historiens a réuni deux conditions et excellé dans deux genres. César, racontant le désastre de Curion en Afrique sur le rapport de quelque officier échappé au glaive des Numides ; n’y assiste pas moins par la force de ses impressions qu’aux événements mêmes auxquels il est présent, et qu’il dirige ou suscite quelquefois de sa personne. Salluste, écrivant l’histoire de Jugurtha, se transporte au milieu d’événements antérieurs de plus de vingt années à l’époque de sa naissance, et il en est tout aussi témoin que de la conjuration de Catilina qu’il vit éclater à vingt-trois ans. Tacite, né l’année même où Néron montait sur le trône, afin que le châtiment naquît le même jour que le crime, Tacite, presque témoin du règne de ce prince, presque acteur dans les règnes contemporains depuis Galba jusqu’à Vespasien, ne respire pas moins pénible= ment sous le règne de Tibère, mort dix-sept ans avant sa naissance, que sous celui de Domitien, dont il fut le contemporain et dont il eut à recevoir des honneurs qu’il a confessés presque comme une faute[1]. Nous avons apprécié le premier, celui que Tacite appelle summus auctorum, le plus grand des auteurs, peut-être parce qu’aucun auteur ne l’a été moins. L’ordre des temps nous conduit au second, à Salluste, lequel écrivit son ouvrage entre les Mémoires de César et l’Histoire, de Tite Live. I. Différences particulières entre César et Salluste, quant à la condition de l’historien et au sujet. C’est une étude toute nouvelle. Entre César et Salluste tout est différent, condition des écrivains, sujet, méthode, langue. Mais, par une admirable propriété de l’esprit humain, autant que par le privilège du genre historique, ce sont deux formes diverses de la même perfection. César raconte ce qu’il a fait. Voilà une première différence entre Salluste et lui. L’auteur des Mémoires en est le héros. Vous savez quel héros, et avec quel art merveilleux il laisse à ses actes à raconter sa gloire. Mais pourquoi parler d’art ? pourquoi supposer ce raffinement de complaisance pour lui-même ? César faisait les grandes choses, non par des efforts dont la conscience chatouillait son orgueil, mais naturellement et parce que le grand était à la portée de sa main. Pourquoi s’en serait-il prévalu’ ? Il n’en avait pas plus d’étonnement que le commun des hommes n’en a de ses actions journalières, et sa grandeur était si soutenue et si semblable à elle-même à tous les moments, que n’y ayant aucun intervalle où il fût au-dessous de lui-même, il ne pouvait pas songer à se faire valoir parce qu’il n’avait pas d’occasion de se comparer. J’admire d’autant plus cette simplicité qu’écrivant ses Mémoires pour se rendre à la fois aimable et redoutable aux Romains, il pouvait être tenté de leur montrer dans sa fortune la part de sa volonté et de leur faire pour ainsi dire les honneurs de sa gloire. Non qu’il ait négligé les séductions ; mais il n’usa que de celles qui lui étaient naturelles, et il en recueillit les fruits, non comme un ambitieux charmé d’avoir pris la multitude à quelque appât grossier, mais comme l’effet prévu d’une cause naturelle. Sa modestie fut une de ses séductions. C’est une grâce commune aux deux plus grandes choses de ce monde, le génie et la vertu. J’allais dire c’en est le cachet le plus certain ; car le génie, comme la vertu, n’est que le plus grand naturel, et le besoin de se faire valoir ou de se rendre témoignage devant les autres, est le contraire même du naturel, à cause de ce qui s’y mêle de servitude et d’imitation. Mais cette réserve même ajoute à sa grandeur. Car, quelque modestie qu’il mette à garder le secret de ses résolutions et de ses ressources, quand on le voit, dans la guerre des Gaules, pousser devant lui ces masses belliqueuses, tracer les routes de la province romaine sur ce territoire habité par trente nations, détourner les fleuves, franchir en hiver des montagnes à travers la neige, et, par un même travail, assiéger une armée de quatre-vingt mille ]gommes, tandis qu’il se protège contre une armée extérieure de quatre cent soixante mille, on est plus près de soupçonner de merveilleux cette histoire que de ne pas trouver assez, grand celui qui l’accomplit. Ce ne sont d’ailleurs que des faits de guerre que raconte César. Ses descriptions sont purement topographiques ; et s’il entre dans quelques détails sur les mœurs des nations qu’il combat, il se borne à ce qu’il en a dû savoir avant de s’engager dans leur pays. Les passions qu’il peint, à grands traits d’ailleurs, non avec le détail de l’historien moraliste, sont les passions nées de l’état de guerre. Il s’agit des mobiles qui entraînent les armées ; ici l’ardeur de la conquête ; là, l’amour de l’indépendance ; ici la force invincible de la discipline ; là, l’élan désordonné de masses tiraillées entre des chefs rivaux ; les malheurs attachés à la témérité ; les défiances du soldat, les paniques ; les effets si contraires de l’emportement et de la patience ; enfin tout ce qui touche au moral de ces grands corps. Plus de place est donnée au technique de la guerre, ce qui ne signifie pas un corps de règles auxquelles César est enchaîné, mais plutôt les innombrables ressources que lui fournissait son génie actif et fécond, et dont son exemple a fait des règles. Voilà pourquoi les Commentaires de César sont plus un livre pour les gens de guerre, et les Histoires de Salluste plus un objet d’étude civile, si je puis parler ainsi ; quoiqu’il ne faille qu’un peu d’attention pour reconnaître dans les Commentaires, touché de la main la plus ferme et la plus exercée, tout ce qui peut intéresser dans une histoire générale. II. Différences entre César et Salluste quant à l’exécution. César n’a pas tracé de caractères. Il ne traite pas ses adversaires autrement que lui. C’est à leurs actes à les peindre. Il nous les laisse caractériser par ce qu’ils ont fait. En donner des portraits étudiés, à la façon de Salluste et de Tacite, si grands peintres de caractères, c’eût été un moyen de se faire valoir par comparaison ; il l’a dédaigné : ou une tentation d’être partial ; et il tenait à ce qu’on le crût. Il n’a pas fait d’exception même pour Vercingétorix, ce jeune chef auvergnat, qui réunit sous son drapeau les trente peuples de la Gaule, et qui eut la gloire de battre César. Quelques mots sur son âge, son rang et son crédit, c’est tout ce qu’en disent les Commentaires. Summæ potentiæ adolescens, c’était un jeune homme très puissant dans son pays. Mais l’impartialité du mot adolescens ajoute au merveilleux des efforts de ce jeune homme, que dis-je ? de cet enfant, à qui la Gaule avait confié sa délivrance. Le portrait se fait et s’achève par les actions mêmes de Vercingétorix, et chaque succès comme chaque revers ajoute un trait à cette physionomie si énergique et si noble. A sa fermeté, quelquefois cruelle, à sa patience et à son élan tout ensemble, à la vivacité de ces courtes harangues qui lui ramenaient la Gaule refroidie et rendue défiante par les échecs, on reconnaît un des ancêtres de ces jeunes généraux, d’il y a cinquante ans, que la présence de l’étranger faisait, au sortir des bancs, hommes de guerre et hommes d’État. César n’est pas moins réservé sur Pompée que sur Vercingétorix. C’est aussi par ses actions que se peint le chef de l’aristocratie romaine. Dans le récit de sa fuite à Brindes, se trahit l’indécision de caractère qui lui fit traverser tous les partis sans se fixer à aucun. Sa défense à Dyrrachium le montre un moment général, et il doit à l’impartialité des récits de son ennemi de prouver que, cette fois du moins, tout ne fut pas du bonheur dans son succès. Toutes ses paroles, tous ses actes dénoncent le héros de théâtre, l’acteur à qui le parterre persuade qu’il est roi, l’homme qui ne se connaissait que par l’opinion, et qui ne se retrouvait plus quand la fortune se retirait de lui. Il est pourtant échappé à César d’en donner comme un croquis, dans un trop court récit des motifs qui faisaient agir ses principaux adversaires. Quant à Pompée, dit-il, excité par les ennemis de César, et ne voulant point souffrir d’égal en puissance... Ipse Pompeius, ab inimicis Cæsaris incitatus, et quod neminem secum dignitate exœquari volebat[2]. C’est tout l’homme en deux traits. Ses haines mêmes ne lui sont pas personnelles ; voilà le premier. Le second est plus caractéristique encore. Les historiens et les poètes n’ont su que le répéter. Lucain en a fait un des plus beaux vers de ce passage où, comme inspiré par la touche de César, il esquisse César lui-même : Tous deux, dit-il, ne veulent souffrir ni César de supérieur, ni Pompée d’égal : Nec
quemquam jam ferre potest, Cæsarve priorem Pompeiusve parem..... (Phars., I, vers 125) Pourquoi César ne veut-il pas de supérieur ? C’est parce qu’ayant des vues et un plan de gouvernement, voulant réformer à fond, et, au besoin, changer la vieille république devenue incapable de se gouverner et de gouverner le monde, il ne pouvait rien s’il n’était le maître. Pourquoi Pompée ne souffre-t-il pas d’égal ? Parce qu’il a plus de vanité que d’ambition, et qu’il veut moins le pouvoir pour réaliser des vues de gouvernement, que pour l’apparence et la réputation. On le vit dans les moments les plus difficiles, retiré à la campagne, vieux mari de jeunes épouses dont il était épris, ne faisant rien et empêchant tout ; et pourvu qu’il n’y eût personne au gouvernement, s’inquiétant peu que Rome fût gouvernée ; aimant mieux voir les choses tomber en interrègne que de les laisser prendre à d’autres ou de les prendre lui-même ; ombre d’un grand nom, comme l’appelle Lucain. Quand on enfonce dans cette pensée si simple de César, on arrive jusqu’à l’âme de Pompée. Devenir le maître, il n’osa jamais se le dire, même tout bas ; empêcher que personne l’égalât, ce fut toute sa politique ; politique insensée dans une république où il n’y avait pour les hommes supérieurs que deux positions, ou l’égalité, c’est-à-dire le partage alternatif des honneurs, ou l’usurpation. Pompée ne voulait pas de l’égalité, et n’était pas capable de l’usurpation. Il est un autre ordre de beautés historiques dont César n’est pas moins avare que de portraits. Ce sont les réflexions ; mais leur rareté même ajoute à leur prix. On croirait y voir l’aven qu’un certain jour sa grande âme a été remuée, et que l’ébranlement dure encore. A Dyrrachium, une manœuvre habile de Pompée le mit dans le plus grand danger. Il fut battu, et si les pompéiens eussent poussé leur chance, A courait risque d’être détruit. Mais l’ennemi prit son avantage pour une victoire et il s’arrêta. Ce succès manqué n’en fut pas moins annoncé dans tout l’empire comme la fin de la guerre. César en fait le sujet d’une réflexion que rend sublime la modestie des mots. Ils oubliaient, dit-il, les communs accidents de la guerre, et combien souvent les plus petites causes, un soupçon mal fondé, une panique, un scrupule de religion, avaient produit les plus grands désastres ; que de fois une armée avait eu à souffrir soit de la faute d’un chef, soit de l’erreur d’un tribun. Mais comme si leur courage les eût rendus vainqueurs, et qu’aucun changement de fortune ne fût possible, leurs messages et leurs lettres annonçaient à tout l’univers la victoire remportée ce jour-là. Non denique communes belli casus recordabantur, quam parvulæ sæpe causæ vel falsæ suspicionis vel terroris repentini vel objectæ religionis magna detrimenta intulissent, quotiens vel ducis vitio vel culpa tribuni in exercitu esset offensum; sed, proinde ac si virtute vicissent, neque ulla commutatio rerum posset accidere, per orbem terrarum fama ac litteris victoriam ejus diei concelebrabant. (De la guerre civile, III, 72.) Ailleurs, parlant de ces mêmes pompéiens, qui, à la veille de la bataille de Pharsale, se disputaient ses dépouilles : Il n’était question parmi eux, dit-il, que de leurs honneurs, des récompenses qu’ils voulaient en argent, ou de leurs vengeances privées ; et ils pensaient, non aux moyens de vaincre, mais à l’usage qu’ils feraient de la victoire. Postremo omnes, aut de honoribus suis, aut de prœmiis pecuniœ, aut de persequendis inimicis agebant : nec quibus rationibus superare possent, sed quemadmodum uti victoria deberent, cogitabant. Il n’y a pas d’amertume dans la première réflexion ; il n’y a pas d’indignation dans la seconde. César ne cède jamais à des sentiments si vifs ; sa générosité naturelle l’empêchait d’être amer ; la corruption de son temps, et l’usage qu’il en avait fait lui-même, lui ôtait le droit de s’indigner. Un exprimant des jugements, il garde l’impartialité du récit, et peut-être cette sorte d’indifférence de la forme ajoute-t-elle à la force de ces deux réflexions, lesquelles sont à la fois une peinture du vieux parti aristocratique romain, et une lumière sur les mœurs de tous les partis. Un historien de cabinet se serait cru tenu d’assombrir ces couleurs et de railler, soit la vanité des pompéiens après l’avantage de Dyrrachium, soit leur cupidité avant Pharsale. Mais si l’émotion de son langage ne nous eût pas rendu les faits suspects, l’éclat de ses couleurs y eût trop intéressé notre imagination pour en juger sainement. La simplicité de César n’y intéresse que notre raison ; il ne veut pas nous faire haïr les choses humaines ; il tient seulement à nous avertir que les partis sont pleins d’illusion, et que les motifs qui dirigent leurs chefs ne sont pas toujours désintéressés. Telle est la manière dont César explique les faits. La politique est pour beaucoup dans cette sobriété de réflexions. Faire des réflexions, c’est porter des jugements. Juger, engage trop, surtout pour un homme qui voulait rester libre pour être plus maître. Il laisse donc aux faits à s’expliquer. S’ils sont causes ou effets, c’est à eux de le dire. Peut-être aussi, écrivant pour ses contemporains, était-il sûr d’être compris à demi-mot. On ne trouve pas non plus dans ses Mémoires, ce que, par un emprunt fort judicieux fait à la langue des arts, la critique littéraire appelle des tableaux. Tout tableau suppose l’art de faire valoir les lointains par les premiers plans et de disposer toutes choses pour l’effet. Les historiens de profession y donnent les plus grands soins, et le plus habile est celui qui rend vraisemblable l’ordre un peu arbitraire dans lequel il arrange des faits qu’il n’a pas vus. Dans César, on ne sent pas cet art, de grand prix d’ailleurs, et où il est glorieux d’exceller. On n’y voit aucune disposition artificielle, aucun morceau réservé et de choix. Il n’y a pas de tableau, et pourtant il y a de l’effet. C’est l’effet d’événements retracés par l’homme qui les a vus, façonnés ou dominés, et qui leur avait donné, dans ses desseins, l’ordre suivant lequel ils se sont produits sur le terrain. Les récits de ce qui s’est fait hors de sa présence ne sont pas moins frappants. On sent qu’il a suivi du regard, au delà des mers, ces corps d’armée qui, selon que son impulsion lès soutient ou les abandonné, aident ou compromettent sa fortune ; et due, par la connaissance qu’il avait des caractères, il a assisté en personne aux revers comme aux succès qui s’accomplissaient loin de lui. Un des plus beaux ornements de l’histoire, telle que les anciens l’ont traitée, ce sont les harangues. Il s’agit de ces pièces d’éloquence composées, soit d’après la tradition de discours prononcés en effet, soit, à défaut de traditions, d’après la situation et les mœurs des personnages. Thucydide y a le premier excellé et a transmis aux Latins l’art de ces mensonges ingénieux qui donnent uniformément aux personnages les plus divers le tour d’esprit et le langage de l’historien qui les fait parler. A peine en trouve-t-on un exemple dans César. Mais, en revanche, ses récits sont coupés, tantôt par des discours indirects qui donnent la substance de ce qui a été dit, et nous épargnent le luxe un peu vain du travail oratoire, tantôt par de courtes harangues militaires qui, au lieu de suspendre l’action, la continuent. Tout y est vrai et nécessaire. La circonstance provoque le discours ; il faut s’expliquer ; tout est prêt ; le lieu de la scène, les auditeurs ; parler, à cette heure, c’est la seule façon d’agir efficacement. Dans la méthode des harangues de cabinet, l’historien semble un appariteur qui dresse froidement une tribune sur la scène, pour qu’un orateur, formé par quelque Gorgias, y récite un discours étudié. Les harangues composées sur ce modèle veulent si peu être lues à la place qu’elles occupent dans le récit, qu’on en a fait des recueils détachés qui s’étudient à part, et non sans fruit d’ailleurs ; et tel a su par cœur les harangues qui n’avait pas lu le récit d’où elles sont tirées. On n’a pas fait un choix des discours de César, bien que le plus court soit un chef-d’œuvre ; il faut tout lire, discours et récit. Par cette force de naturel qui ne s’accommode d’aucun artifice littéraire, en même temps qu’il échappait à l’imitation de la rhétorique grecque, il indiquait aux modernes dans quelle mesure l’histoire doit mêler les discours au récit. Je doute qu’il ait imaginé aucun de ceux qu’il fait tenir à ses personnages ; mais, s’ils sont supposés, il faut avouer que la vérité elle-même n’a plus d’avantages sur la vraisemblance. C’est ainsi que César a employé dans ses Mémoires les principales parties de l’histoire, tableaux, peintures de caractères, réflexions, harangues. Ces parties ne sont pas des inventions de rhéteur ; ce sont les membres d’un corps : point d’histoire parfaite qui ne soit le théâtre complet de la vie humaine, qui n’en déploie les spectacles si divers et si attachants ; qui n’en fasse voir les acteurs, par le fond et par le masque, agissant ou parlant ; qui, par des réflexions discrètes et profondes, n’en donne la moralité. La preuve que ces parties sont vraies et nécessaires, c’est que, dans les historiens supérieurs, à chacune d’elles répond un ordre de beautés durables. En notant donc celles que César n’a traitées qu’incomplètement, et celles qu’il a négligées, je reconnais qu’il n’a pas réalisé toute la beauté des premières, et qu’il â laissé à d’autres à donner des modèles des secondes. S’il ne fait qu’indiquer les caractères, s’il est tout simple qu’il n’ait pas besoin des couleurs du peintre et du moraliste. En omettant les réflexions, il s’interdit les nuances les plus délicates du langage. Les harangues de moins, dans ses récits, c’est de moins le pathétique qui échauffe certaines de ces pièces dans les bons historiens. On ne regrette pas qu’il se soit refusé le vain éclat qui vient des figures prodiguées, des mots poussés à l’image, et d’une certaine disproportion ambitieuse entre le fond et la forme ; mais on y voudrait plus souvent la vive lumière qui éclaire, en les peignant, les faits du monde moral, et l’accent de l’historien qui s’émeut du mal et du bien. Toutefois, si César n’a pas porté certaines qualités aussi loin que nous le voudrions, par comparaison avec l’idéal que nous nous sommes fait du genre historique, on sent que ce n’est point impuissance, mais dessein. Il n’a dit ni plus ni autre chose, parce qu’il ne l’a pas voulu. C’est de la force qu’il avait en réserve, et qu’il a gardée, aimant mieux laisser croire qu’elle lui manquait que de l’employer hors de propos. A moins que je ne me fasse illusion, cette sorte de retenue et d’économie judicieuse est une beauté propre à César. Quoi de plus beau en effet que de voir celui qui pouvait tout, s’en tenir à une chose et la faire si exactement ; celui qui excellait dans la raillerie, effleurer à peine d’un doigt moqueur les moins estimables de ses ennemis ; celui qui, dans l’éloquence, savait, au rapport de Cicéron, faire de chaque preuve comme un tableau placé dans un beau jour[3], se borner à de courtes harangues, pour la plupart indirectes ; celui qui, entendant la défense de Ligarius, laissait tomber l’acte d’accusation de ses mains, savoir être impartial jusqu’à paraître insensible ; celui qui avait tous les talents, les gouverner si bien, et tour à tour les réunir ou les séparer si à propos, que ses facultés semblaient comme des corps d’armée distincts qu’il conduisait devant lui, les poussant tous ensemble du séparément, selon le besoin, et les proportionnant, pour le nombre ou le degré de force, à l’obstacle qu’il avait à vaincre. Bien donc que l’histoire ait à étendre son champ, après les Mémoires de César, il faut s’arrêter longtemps à ce premier modèle incomparable. Avec les qualités dont l’art s’enrichira, naîtront, comme par compensation, les défauts qui y répondent. Le récit, pour être plus dramatique, s’embellira de circonstances imaginaires, et deviendra comme ces tableaux où les premiers plans sont de l’invention du peintre, et servent à faire valoir les fonds. On rencontrera dans les portraits, à côté des traits pris à la nature, des caprices d’analyse morale ; et des études plutôt que des ressemblances. Les réflexions dégénéreront en sentences ou deviendront déclamatoires. Les harangues seront trop souvent des pièces de rhétorique. Trop d’art conduira au procédé. Les Mémoires de César sont une première forme parfaite de l’histoire. Ce qui y manque, ne convenait ni au sujet, ni au dessein de l’auteur. Ce qui s’y voit est en perfection. Il y a profit à fréquenter cet esprit si sain, si proportionné, si grand sans efforts, si vigoureux sans affecter la force, si élégant sans recherche, si propre à nous faire connaître et estimer notre naturel, en nous faisant admirer le sien. Il reste, du commerce des autres auteurs, une impression trop forte de la qualité qui y domine ; de la concision archaïque chez celui-ci, des ornements chez celui-la, de l’éclat des figures chez un autre. Prenons garde que le plaisir que nous y trouvons ne nous rende imitateurs. Tel fait des vers durs, pour avoir été séduit par ce qu’il y a d’âpre dans la force d’un modèle ; tel autre en fera de vains et de sonores, parce que, dans un modèle où règne l’élégance, il n’aura senti que l’harmonie qui en est l’effet extérieur, et point la proportion des mots aux pensées, et des pensées au sujet, qui en est la cause. Je défie qu’on imite César ; car, qui pourrait y trouver une qualité dominante ? Quel ton, quelle forme de discours y revient plus souvent qu’il ne faut ? A quel piège l’esprit pourrait-il s’y prendre ? Les critiques n’y ont noté qu’un défaut : ce sont les négligences. Ils appellent de ce nom les répétitions des mêmes mots. Mais, à moins de s’amuser à compter les mots, on ne s’aperçoit même pas de ces répétitions, tarit la clarté du discours les rend nécessaires. Outre que, par un privilège de la langue latine, le même mot, en changeant de cas, changeant aussi de son, de forme et pour ainsi dire de physionomie, les répétitions y sont moins sensibles que dans notre langue où le même mot, à tous les cas, se présente sous le même aspect et rend le même son. Il n’y a pas de tour d’esprit dans les Mémoires de César. Un tour d’esprit est bien près d’être un défaut ; on l’a dit, on tombe du côté où l’on penche, et cela est vrai des lettres comme de la politique. Je n’y vois qu’un esprit libre, égal, maître de lui-même, tranquille miroir, qui reçoit le vrai et qui le rend comme il l’a reçu. César a voulu raconter de sang-froid, comme s’il se fût agi d’un autre, de grandes choses exécutées avec l’ardeur de la passion. Semblable au général de l’armée d’Italie qui commandait à David de le représenter calme sur un cheval fougueux, il a voulu que, soit dans ses dix années de combat avec la barbarie, soit dans les bouleversements de la guerre civile, toujours en présence de l’extrême péril, toujours au moment de perdre sa fortune, sa gloire et sa vie, son récit le montrât, au-dessus de tant de vicissitudes, indifférent et serein. Le seul défaut littéraire des Mémoires de César, c’est que l’étude seule et pour ainsi dire la pratique de l’auteur en peuvent faire goûter les perfections discrètes et cachées. Les ouvrages de ce genre passent par-dessus bien des têtes, j’entends même des têtes bien faites. Ils n’avertissent pas l’esprit ; ils ne lui font pas d’avances ; leur modestie les lui dérobe. On le dit dans la morale mondaine. Il faut une certaine habileté, même aux honnêtes gens, même à la vertu, pour se recommander et se rendre utiles. La maxime n’est pas moins vraie des auteurs. S’ils ne font rien pour attirer les yeux, ils risquent qu’on ne les voie pas. Un peu de cette habileté ne leur messied donc pas, pourvu qu’elle ne soit qu’un appât innocent pour attirer à la vérité. III. Salluste est le premier historien de profession chez les Latins. Cette habileté est une des séductions de Salluste. Salluste est tout art. J’en vois une première preuve dans le plan même qu’il s’était tracé. Au lieu d’écrire la suite des événements de l’histoire romaine, il avait choisi les plus mémorables, pour les traiter séparément. Je résolus, dit-il, dans le préambule du Catilina, d’écrire les faits du peuple romain, par morceaux détachés, en m’attachant aux plus dignes de mémoire[4]. Ainsi l’histoire s’est présentée à lui tout d’abord sous la forme d’une série de tableaux de choix. Par une première différence entre César et lui, Salluste n’a pas été acteur dans les événements qu’il raconte. La guerre de Jugurtha était finie vingt ans avant sa naissance. Il avait vingt-trois ans à l’époque de la conjuration de Catilina, et il ne paraît pas qu’il en ait été témoin. Quant à sa grande histoire, elle comprenait les temps écoulés entre ces deux événements. Excepté pour quelques-unes des années qui précédèrent le second, et durant lesquelles la jeunesse de Salluste dut recevoir quelques impressions des causes générales qui enfantèrent la conjuration de Catilina, il n’écrivit que ce qu’il avait vu par la force de l’imagination, et par l’étude critique des témoignages. Salluste est, chez les Latins, le premier historien de profession. Les faits militaires ne sont que l’accessoire dans les récits de Salluste. Ce qui y domine, c’est la politique ; ce sont les peintures, soit des mœurs générales, soit des personnes ; c’est l’explication des actes parles caractères. Même dans les récits des faits de guerre, le technique est subordonné au moral, et il s’y trouve moins de préceptes sur l’art de conduire les armées que de lumières sur les passions qui font mouvoir ces grands corps, et sur les caractères et les intérêts de ceux qui les commandent. La guerre n’est pour Salluste que le dénouement du drame qui se joue au sein de Rome. On la voit sortir de la jalousie des deux ordres, des passions, des rivalités personnelles, de la soif du pouvoir et de l’argent qui travaillaient alors la république. C’est par là que Salluste est le premier, chez les Latins, qui mérite le nom d’historien politique. Les caractères de la langue de Salluste sort de deux sortes. Les uns lui viennent du fond même des choses, par lequel Salluste diffère essentiellement de César. Pour des rapports nouveaux, il fallait des manières de dire nouvelles. L’histoire, devenant civile, pour ainsi dire, de militaire qu’elle était dans César ; et l’historien, de narrateur des événements, s’en faisant le juge et le peintre, c’est du côté de la politique et de la morale historique que la langue latine s’est étendue. Aux détails délicats sur les caractères et les humeurs, à ces peintures si fines de l’intérieur de l’homme, correspondent des délicatesses et des nuances dont elle s’enrichit pour la première fois. En même temps que les tableaux la colorent, les réflexions la rendent plus subtile, et les harangues plus chaude et plus harmonieuse. La nécessité de passer du simple au figuré, pour exprimer par des mots de l’ordre matériel des faits de l’ordre moral, l’embellit d’acceptions inusitées. La lumière du style qui, dans les Mémoires de César, n’éclaire que les actions, lesquelles sont les images visibles des pensées, rend visibles, dans les récits de Salluste, les pensées elles-mêmes, et peint tous les mouvements de cet esprit que Salluste proclame si éloquemment éternel et incorruptible. Au reste, ces qualités de la langue de Salluste, sont les caractères mêmes de la belle latinité. C’est la part d’un écrivain supérieur dans l’œuvre de la langue de son pays. Car, de même que l’empire romain s’est formé des conquêtes successives de ses hommes de guerre ; de même le corps de la langue latine s’est formé des inventions de ses grands écrivains. Dans l’empire, on ne reconnaît pas la trace des annexions de territoire ; dans la langue on ne distingue pas les accroissements qu’elle a reçus ; et de même que du spectacle de l’empire il reste une impression de la grandeur du peuple romain bien plutôt que des qualités particulières de ses grands hommes ; de même le corps de la belle latinité donne plutôt l’image générale du génie de ce peuple dans les lettres que des images particulières et diverses de ses écrivains. Les autres caractères de la langue de Salluste sont l’effet de son tour d’esprit particulier. Le plus saillant est cette concision fameuse ; dont parle Quintilien, sallustiana brevitas. On ne veut point parler d’une concision qui ajoute au sens ce qu’elle retranche aux mots. Tout discours qui en est marqué, a ce mérite singulier qu’il. ne vient à l’esprit de personne de l’y noter. On n’a l’idée de la concision que par comparaison avec un discours diffus, ou parce que l’effet que s’en promettait l’auteur ne répond pas à la peine qu’il y a prise. Il ne faut pas louer Salluste d’avoir réussi dans la première ; mais on pourrait le blâmer quelquefois de s’être trop travaillé pour affecter la seconde. Une preuve que cette recherche de la concision est un défaut dans Salluste, c’est qu’il l’a imitée d’autrui, et qu’il y a été imité lui-même. Or, on n’imite pas les qualités ; on les a de nature, et l’exemple d’autrui peut tout au plus vous y fortifier, en vous donnant des motifs de vous approuver de ce que vous faites naturellement. On imite, par faiblesse, pour s’appuyer ; on imite, parce qu’on manque de fonds ; on imite, soit par illusion, parce qu’on prend pour beau ce qui réussit ; soit par vanité, le besoin du succès par la mode étant plus vif que l’amour du vrai. De quelque côté qu’on le prenne, on n’imite que par l’effet d’un défaut, et c’est toujours quelque défaut qu’on imite. Chez un écrivain supérieur, si l’imitation ne vient -ni de faiblesse, ni de paresse, peut-être vient-elle du désir de faire de l’effet. Il en est parmi les plus grands qui se sont parfois plus aimés que le vrai, et l’ont quitté pour quelque moyen plus grossier, mais plus prompt, d’attirer les regards. Mais, quels que soient les défauts qu’ils imitent ou par lesquels ils sont imitateurs, j’y vois la marque que, dans leur art, il doit y avoir plus excellent qu’eux. L’historien dont Salluste a imité la concision est Thucydide. On a eu tort de dire qu’il l’a imité dans tout le reste. Salluste a excellé à peindre les mœurs, après Thucydide, non sur le patron de Thucydide. Placés en présence de la même nature, la voyant des mêmes yeux, doués au même degré du talent de la rendre, tous deux y ont réussi, chacun dans son pays, par les meilleurs moyens, qui sont les mêmes partout. L’un n’a pas imité l’autre ; tout au plus pourrait-on dire que le premier venu a averti le dernier de son propre talent. Mais il est très vrai qu’en cette recherche de la concision, Salluste à imité Thucydide, et si le principe qu’on n’imite que les défauts est vrai, c’est un défaut de Thucydide qui a égaré Salluste. Les critiques anciens ont noté ce défaut. C’est cette obscurité étudiée dont parle Marcellin, le biographe de Thucydide, lequel, dit-il, s’étudiait à écrire obscurément, afin de n’être pas accessible à tout le monde, explication qui ne diminue pas le tort de l’historien. Comme il arrive de toute imitation, le défaut est plus choquant dans l’imitateur que dans l’original. La concision de Salluste paraît plus affectée que celle de Thucydide, outre le désavantage du latin. Thucydide, écrivant dans une langue d’une richesse infinie, non seulement dit beaucoup de choses en peu de mots, mais fait entrer dans le même mot plusieurs choses. Il abonde en termes composés, espèce de foyers lumineux où se concentrent plusieurs rayons, lesquels, selon l’application, éclairent ou éblouissent. Salluste, mal servi par une langue plus sobre ou plus timide, à défaut de mots composés, contraint quelquefois des mots simples à exprimer le tout par la partie ; et pour rendre sa pensée plus vaste, il se contente de l’indiquer, laissant au lecteur à la compléter et à remplir ses omissions ambitieuses. On en est séduit tout d’abord, et on sait gré à l’écrivain de compter ainsi sur la capacité de son lecteur. Mais, peu à peu, on s’aperçoit qu’il a moins pensé à faire valoir son lecteur qu’à se faire valoir lui-même. C’est à l’exemple de cette faiblesse que Salluste, imitateur de la concision excessive de Thucydide, fut lui-même fort imité. Au temps que Salluste fleurissait, dit Sénèque, le discours haché, les mots tombant tout court et à l’imprévu, et la brièveté obscure, furent à la mode[5]. Il parle d’un certain Arronce, tout sallustien, lequel avait écrit de ce style une histoire des guerres puniques. Il allait, dit Sénèque, au-devant des défauts que Salluste n’avait fait que rencontrer. Vitanda illa sallustiana brevitas, disait Quintilien aux orateurs de son temps[6]. Il la souffrait toutefois dans les écrits, où, dit-il, elle peut être saisie par un lecteur de loisir[7]. Si cette brièveté lui eût paru de bon aloi, ou qu’il se fût agi de celle de César, telle que Cicéron la qualifie par ses effets, pura et illustris, pure et qui fait tout voir, je doute que Quintilien ne l’eût pas trouvée de mise même dans l’éloquence. De ces deux sortes de brièveté, l’une est un tour d’esprit individuel ; l’autre, qui ne porte point le nom d’un homme, est une qualité et une beauté de l’esprit humain. Ce défaut, dans un auteur si excellent, doit nous le faire lire avec précaution, soit pour n’être pas dupe d’une fausse profondeur, soit pour nous défendre de l’imiter. Il est un autre motif de défiance plus grave ; c’est le contraste que l’on a signalé entre les écrits de Salluste et sa vie. IV. De la vie et du caractère de Salluste. S’il fallait en croire certains témoignages, la jeunesse de Salluste aurait été souillée par de prodigieuses débauches. Cet homme, qui achetait un cuisinier cent mille sesterces, aurait, pour subvenir à ses prodigalités, vendu la maison paternelle du vivant de son père, lequel en serait mort de douleur. Surpris en adultère avec Fausta, femme de Milon, il aurait été battu de verges et renvoyé après rançon. C’est à cause du scandale de ses débauches que le censeur Appius l’aurait, en 704, chassé du sénat. Plus tard, redevenu sénateur par la faveur de César, et chargé du gouvernement de la Numidie, ses extorsions auraient épuisé cette province, et il n’aurait échappé à un procès de concussion qu’en achetant d’une partie de ses rapines la protection du dictateur. Enfin, sa vie tout entière, démenti flagrant donné à ses écrits, lui aurait mérité le reproche ironique que lui fait Macrobe d’avoir été le censeur impitoyable des vices d’autrui[8]. Des panégyristes de Salluste, dans le louable désir de faire accorder ses actions avec ses écrits, ont mis toutes ces actions sur le compte d’un certain Lénéus, affranchi de Pompée, auteur d’un libelle diffamatoire, dans lequel il aurait vengé son maître des injures de Salluste. C’est, disent-ils, sur la foi de ce Lénéus que Macrobe lui aurait infligé ce blâme rendu plus sanglant par l’ironie du tour ; que Lactance l’aurait qualifié de nequam (un mauvais homme, un méchant) ; que quelque élève des écoles de déclamation aurait composé cette invective, faussement attribuée à Cicéron, oit Salluste est accusé de turpitudes qui répugnent à la pudeur de l’histoire. Leur piété pour le génie va jusqu’à nier l’évidence. C’est par Varron que l’on sait le scandale de ses adultères : ce Varron, disent-ils, n’est qu’un obscur homonyme du savant Varron. L’accusation de rapines en Numidie est confirmée par Dion Cassius : c’était, disent-ils, pour le compte de César que Salluste pillait sa province. La vérité sur Salluste n’est ni dans les complaisances de ses panégyristes, ni dans les exagérations de ses détracteurs. Mais, s’il a été calomnié, c’est qu’il y donnait prise. Je crois à la prévention qui grossit les fautes et à la vengeance qui les envenime ; j’ai peine à croire à la froide calomnie qui tout à la fois ment et renchérit. Mais n’avons-nous pas les aveux de Salluste ? Je n’en sache pas de plus explicite que ce passage du préambule du Catilina, où rappelant les fautes de sa jeunesse, sa faiblesse contre les séductions d’une ambition mauvaise (ambitio mala), il parle du moment où son esprit trouva enfin le repos, après bien des misères et des périls. Animus ex multis miseriis atque periculis requievit[9]. La sévère qualification de mala, vient d’une conscience qui s’accuse ; et je crois voir un regret des fautes où elle conduit ainsi que des faux biens qu’elle procure, dans ce mot miseriis, le premier de toute la langue du paganisme qui ait passé dans la langue chrétienne. Les fautes qui ont fait à Salluste une si mauvaise réputation étaient-elles de celles que les exemples publics enseignaient, pour ainsi dire, à la jeunesse romaine ? S’agit-il de ces moyens de parvenir que se permettaient les jeunes patriciens ou les plébéiens riches, et que Salluste comprend dans le mot malœ artes ; les accusations intentées légèrement pour faire son apprentissage oratoire, les brigues, l’achat des suffrages, les violences au Forum ? S’agit-il dés désordres de la vie privée ? Quoi de pire pourtant, et quoi au delà ? Sans doute, sous l’empire d’une autre morale, c’en serait trop pour déshonorer un homme. Mais, au temps de Salluste, l’exemple universel diminuait la faute de chacun, et l’époque était plus déshonorée que les individus. Contre une telle corruption, il n’y avait de résistance possible que dans une sorte d’adoration fanatique pour la vertu, forcée de se faire secte. C’est ainsi qu’on s’explique l’opposition du jeune Caton, attaquant les vices avec l’exaltation d’un sectaire de la vertu. Pour les autres, il fallait succomber, chacun selon sa nature ; les bons pour s’en relever, avec de beaux débris de leur vertu ; les faibles ou les mauvais, pour y rester ensevelis. Je veux bien que Salluste n’ait pas été dans les mauvais ; mais faut-il le mettre dans les bons ? S’il n’eût failli que comme tout le monde, aurait-il songé à s’en confesser publiquement, et avec une sorte de solennité, en tête de ses écrits ? La morale de son temps ne demandait pas cette satisfaction. Mais il en avait plus fait qu’elle n’en pouvait excuser. Si l’obscurité qui couvre sa vie publique le protégé contre des chefs d’accusation précis, les richesses trop fameuses au sein desquelles il la termina le taxent plus qu’homme de son temps de cette soif de l’argent que la morale même d’alors flétrissait par la bouche de Cicéron, dénonçant les dilapidations de Verrès, et, plus éloquemment encore, par l’exemple de ce même Cicéron, revenant de son gouvernement de Cilicie, les mains pures, non seulement de toute rapine, mais même de ces dons de joyeux avènement par lesquels les provinces conjuraient la rapacité de leurs gouverneurs. C’est sur des tables d’or, payées des dépouilles de l’Afrique, qu’il écrivit contre le luxe de la noblesse ; c’est au milieu de tableaux, de statues, de ciselures, dans les délices de ces jardins appelés de son nom, dont il suffisait autrefois de gratter le sol pour en exhumer des chefs-d’œuvre, qu’il composait les harangues de Marius et de Catilina contre le luxe des ouvrages d’art, et contre ces richesses des nobles, que ne pouvait épuiser la folie de leurs excès[10]. V. Que les plus grands écrivains sont les plus honnêtes gens. Faut-il donc, en ce qui regarde Salluste, cesser de croire à cette maxime, le premier dogme dans la religion de l’art, qu’il n’y a de beaux écrits que par l’accord des actions et des paroles, et que les plus grands écrivains sont les plus gens de bien ? Non, et quelles que fussent les apparences, il faudrait se débattre jusqu’à la fin contre un doute qui ruinerait la vérité elle-même, en ruinant l’autorité des hommes divins qui ont reçu le don de l’exprimer dans leurs écrits. Je n’y veux pas croire, quant à moi, ni pour mon pays, où la maxime contraire ne serait qu’un injurieux paradoxe, ni pour aucun pays ayant laissé au monde un ouvrage de littérature durable. Mais, s’il est vrai que le plus grand doit toujours être le plus homme de bien, il y a des degrés entre les grands écrivains, et nul ne peut faire passer dans ses écrits plus de beauté morale qu’il n’en a dans son âme. Il faut savoir reconnaître ces degrés, se garder de tout éblouissement, aimer mieux la vérité que Platon, ou plutôt n’aimer dans Platon que la vérité qu’il a vue d’un cœur droit ou d’un esprit libre de passion. S’agit-il d’un homme supérieur dont la vie a donné prise à de graves reproches ? il faut se défendre de ses séductions, conserver la liberté de sa conscience même dans cette douceur de s’abandonner à un maître ; il faut chercher courageusement s’il n’y a pas dans ses écrits quelque imperfection littéraire qui trahit des imperfections de caractère ou des vices de cœur. C’est dans cet esprit que j’ai étudié Salluste, averti par sa vie de me défier de ses écrits. Je n’y ai reconnu ni la sensibilité de Cicéron, ni cet amour du grand, par le génie et par la vertu, qui enflamme Tite-Live pour les fondateurs de la grandeur romaine, ni l’amertume vertueuse de Tacite. Salluste s’indigne un peu à froid ; je crains qu’il n’y ait chez lui du faux honnête homme se cachant derrière ses protestations de vertu. Cette sorte de pruderie peut tromper plus d’une personne. A la distance où nous sommes de Salluste, dans le manque de preuves de fait, par la faveur que le talent jette sur l’homme, de bons juges même y sont pris. Nous l’avons vu par ces apologistes de Salluste, lesquels n’ayant pas la force de le trouver imparfait comme écrivain, en ont voulu faire un parfait homme de bien. Un auteur consommé, tel que Salluste, peut, à force d’art, imiter la conviction d’un homme de bien. Que dis-je ? par cette contradiction de notre nature, qui nous fait aimer la vertu dont nous sommes incapables, sa raison peut se révolter contre les images de ses propres vices. Mais on sentira, dans ses pages les plus sévères, ou l’homme qui veut faire illusion aux autres, ou l’homme qui ne peut pas se faire longtemps illusion à lui-même. En voici un exemple tiré du préambule de Jugurtha. Salluste y parle, en spectateur aigri, des mœurs du temps présent, en comparaison desquelles il trouve à louer l’époque où il exerçait de grandes magistratures. La peinture en est forte ; Caton l’Ancien, dont on l’accusait de voler les mots[11], n’eût pas mieux rudoyé son époque. Tout à coup il s’interrompt : Mais, dit-il, je me laisse emporter trop loin et à trop de franchise dans le dépit et l’ennui que me causent les mœurs de Rome. Je reviens à mon sujet. Verum ego liberius altiusque processi, dum me civitatis morum piget tœdelque : nunc ad incœptum redeo[12]. Est-ce bien là le mouvement d’une âme généreuse qui s’apaise, après avoir déchargé sa colère, et non pas plutôt le scrupule d’un auteur qui craint d’avoir fait une digression trop longue ? Quoi de plus sec, et qui sente plus la formule, que ces deux petits mots : piget tœdetque, si disproportionnés à de si grands sentiments ? Il est un certain accent que donnent aux écrits un cœur que les passions ont remué, mais point gâté, et la raison, quand elle n’est qu’une conscience pure, jugeant les actions des hommes : cet accent, Salluste ne l’a pas. Mais si cette beauté suprême lui a manqué, il a toutes les autres dans une perfection qui n’a point été surpassée. Tout ce que le style peut recevoir de lumières d’une raison élevée et fine ; tout ce que l’imagination la plus forte et la mieux réglée peut y répandre de couleurs habilement assorties ; tout ce qui peut se faire avec tous les talents de l’écrivain, Salluste en offre des modèles. Semblable à certains hommes qui, avec de grandes qualités et beaucoup d’art pour cacher leurs défauts, parviennent à persuader aux autres qu’outre les qualités qu’ils ont réellement, ils ont encore les qualités des défauts qu’ils cachent ; Salluste est un si grand écrivain, et il sait si bien donner le change sur sa vie par ses maximes, que plus d’un lecteur s’y laissera prendre encore, et qu’il y aura toujours quelque péril à exprimer des doutes sur sa moralité. Nous pourrons donc admirer beaucoup Salluste ; mais nous continuerons à croire que le plus beau génie est celui qui tire ses pensées d’une conscience droite et d’un cœur tendre aux choses humaines, et que, parmi les grands écrivains, les plus grands sont ceux qui ont le plus vécu en gens de cœur et en gens de bien. Les anciens ont, pour ainsi dire, tourné autour de cette maxime. Ils définissaient l’orateur : L’homme de bien, qui sait parler. Mais les modernes l’ont étendue à toutes les productions de l’art, et en ont fait un principe qui oblige à la fois la critique à être morale, et l’auteur à recommander ses écrits par sa vie. C’est une maxime née de la philosophie chrétienne, c’est une maxime de l’art français. Nos maîtres dans les lettres sont nos modèles dans la vie. On y reconnaît, dans l’art de bien dire, la science de bien faire, et quiconque s’y plaît en vaut déjà mieux. Corneille, Racine, Pascal, Bossuet, quelles sources pures et profondes du beau et du bien ! Et Molière, pourquoi est-il le premier, sinon parce qu’il a été le meilleur ? Nous étudierons Salluste d’après la méthode suivie pour son prédécesseur César. Ce sera encore une lecture approfondie, à laquelle nous demanderons tout ce qu’un esprit cultivé peut chercher dans un monument historique : la vérité des faits et des jugements, et la beauté littéraire qui n’en est que l’expression parfaite. Pénétrer, sans vains raffinements, dans la pensée d’un écrivain supérieur ; voir, par delà ce qu’il a écrit, le dessein qui l’a fait écrire ; entrer, pour ainsi dire, dans sa confidence et son secret, et en sachant à fond tout ce qu’il a voulu qu’on sût, savoir encore tout ce qu’il a pensé cacher ; voilà ce que j’appelle lire un auteur pour en rendre la lecture digne d’un auditoire. Une première lecture, comme on l’entend d’ordinaire, nous découvre à peine quelques beautés de détail éclatantes. Une seconde nous rapproche du plan, des proportions, nous fait voir plus avant dans le dessein de l’auteur. D’autres beautés se révéleront dans une troisième lecture, et seront comme la conquête attachée à chaque effort nouveau. Mais pourquoi parler d’effort ? Ceux qui nous disent de lire les grands écrivains nous invitent au plaisir bien plus qu’à la peine. Quand vous entendez parler de quelque homme supérieur, mêlé aux brandes affaires, vous enviez celui qui vous dit : Je l’ai vu. Eh bien ! en étudiant les grands écrivains,-vous les voyez, ils vous parlent, ils vous font leur confident. Ce ne sont plus des morceaux de littérature, des préceptes de goût, des règles de style, ou des vérités générales sous la forme de beautés littéraires ; c’est l’écrivain lui-même qui vous appelle dans un coin et vous entretient à voix basse des motifs qui ont conduit sa plume. Dans l’histoire de la conjuration de Catilina, Salluste aura plus d’une explication à-nous donner. Nous lui demanderons s’il n’a. rien omis ni rien outré ; s’il a été juste pour tout le monde, et pour Cicéron notamment, même quand il le qualifie d’excellent consul ; s’il a été assez explicite sur les causes de la conjuration ; si, pour en faire valoir l’effet dramatique, il n’en a pas négligé le côté politique ; nous verrons s’il a tenu la balance juste entre tous ceux qu’il prétend y peser, et si sa morale est une foi ou une contenance ; nous l’admirerons avec liberté, et nous ne sacrifierons aucune vérité aux séductions de ce commerce avec l’un des écrivains de l’antiquité qui ont le plus de prestige. Dans l’histoire de Jugurtha, Salluste étant plus loin de l’événement, et n’ayant qu’un intérêt pour ainsi dire rétrospectif dans les luttes de parti que suscita cette guerre, nous pourrons admirer avec moins de réserve cette suite de caractères, de peintures, de harangues, qui font de la Jugurthine un morceau d’histoire accompli. En suivant Jugurtha dans ses fuites et dans sa guerre d’embûches, sur cette terre de Numidie devenue l’Afrique française, les allusions viendront s’offrir à nous d’elles-mêmes. Nous ne les rechercherons pas. Je ne voudrais pas mettre des études sévères sous la protection de quelque préoccupation contemporaine. Entre deux torts, celui de mal faire valoir un monument admirable, et celui d’attirer ou de retenir des auditeurs par des caresses à leurs idées d’un jour, j’aimerai toujours mieux le premier qui ne commet que le professeur, que le second qui commettrait l’enseignement. Mais, je regarderais comme un très bon fruit de cette étude, que nous pussions y prendre quelques leçons de patience, afin de ne pas nous étonner que, n’ajoutant pas, comme les Romains, à tous les moyens de guerre la trahison ; nous n’ayons pas encore abattu le moderne Jugurtha[13]. Il y aura d’ailleurs d’autres différences entre la conquête romaine et la nôtre, non moins certaine, mais plus pure. Ce n’est point pour la donner en pillage à des gouverneurs, que nous voulons nous rendre maîtres de l’Afrique. La civilisation française en face de la barbarie arabe, c’est la raison en face de l’instinct sauvage, c’est la justice en face de la violence, c’est la liberté en face de la fatalité. Nous n’avons point de Calpurnius ni de Scaurus, et la déclamation n’en est point venue jusqu’à dire que Jugurtha avait des amis dans notre sénat. Je dois remercier, en finissant, ceux qui, l’année dernière, ont bien voulu me suivre dans ces études aujourd’hui négligées, auxquelles on ne se porte plus guère que par profession. Le double écueil d’un enseignement des littératures anciennes, c’est, d’une part, que le professeur est prêt à se faire un tort personnel de n’y savoir pas attirer d’auditeurs, et, d’autre part, qu’il risque de se trop passionner pour des dieux qu’il croit abandonnés. Je remercie ceux de mes auditeurs qui m’ont persuadé à la fois que des efforts sincères et persévérants, dût-il y manquer la grâce du talent, obtenaient toujours une estime encourageante, et que ces dieux auxquels ont cru nos plus grands hommes ont encore des fidèles. J’avais pu craindre que cette douceur d’admirer les chefs-d’œuvre du génie latin ne fût que pour moi ; ils m’ont prouvé qu’elle nous était commune. Je leur dois une partie du plaisir profond que je viens de tirer de mon long commerce avec Salluste. Celui pour qui les beautés des lettres ne sont que des vérités pratiques, ou sévères ou charmantes, n’ose pas les aimer seul et secrètement ; il craint de s’y tromper, et il suspecterait d’illusion ses délices solitaires. Pour aimer avec sécurité, il a besoin de savoir qu’il a raison d’aimer ; il ne jouit des vérités que l’étude lui a révélées qu’au moment même où il les partage avec d’autres ; et c’est ainsi seulement que l’assentiment d’un auditoire fortifie le professeur et ennoblit l’enseignement. |