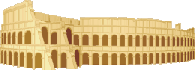ÉTUDES DE MŒURS ET DE CRITIQUE SUR LES POÈTES LATINS DE LA DÉCADENCE
LUCAIN, OU LA DÉCADENCE.
QUATRIÈME PARTIE. — DU STYLE DE LA PHARSALE ET DES POÈTES CONTEMPORAINS DE LUCAIN.
|
I. Nécessité de faire un peu de philologie. L’examen du style de Lucain et des poètes de son époque me force, à mon grand regret, à faire de la philologie, chose à laquelle je suis peu propre et nie sens peu de goût, outre la conscience que j’ai que je n’y serai peut-être pas suivi par ceux d’entre les lecteurs auxquels s’adressent les parties les moins arides de ce livre. Mais comment dire d’utiles choses sur le style d’un poète et d’une époque, sans faire de la philologie ? Il s’agit ici, non pas seulement de comparer la manière d’un écrivain à un type général du style, nais de surprendre, dans les changements et les altérations qu’a subis une belle langue, les lois de la décadence des littératures. Une appréciation trop générale courrait le risqué de toutes les généralités, qui est d’être contestées et, en tout cas, de laisser le procès en suspens : mais avec le secours de citations choisies, cette appréciation peut avoir la rigueur d’une démonstration scientifique. II. Distinction entre la forme et le fond dans le style des poètes de la décadence. Il y a deux choses à remarquer dans le style de Lucain et des poètes de son époque 1° le fond, 2° la forme. Ce que j’entends par le fond du style, ce sont ses qualités et ses défauts essentiels. C’est ce qui fait qu’il est clair ou obscur, énergique ou mou, élégant ou barbare, conforme ou contraire au génie de la nation ; qu’il copie ou qu’il innove ; qu’il imite les idiomes étrangers ou qu’il reste fidèle à l’idiome national ; qu’il est d’une école ou qu’il fait lui-même école. Ce que j’entends par la forme, ce sont les qualités les plus extérieures du style, celles qui s’adressent pour ainsi dire aux sens. C’est le rythme, l’harmonie, le nombre ; c’est tout le détail de ces trois qualités, les arrangements des mots, les coupes, 1es suspensions, toutes choses qui dans les poésies primitives ou des grands siècles ne sont que les accessoires de l’art, et, dans les poésies de décadence, sont l’art tout entier. J’examine d’abord le style de Lucain, quant au fond. III. Dans quel état Lucain a trouvé la langue latine. Les traditions du siècle d’Auguste sont encore la loi universelle, quant à la poésie. Pour la prose, elle a déjà rompu les belles formes de la harangue cicéronienne, le nombre et la symétrie de Salluste, plus concis mais non moins harmonieux ; la grande et redondante manière de Tite-Live : je dis redondante, dans le sens du mot latin, qui n’est pas une critique. La prose du grand siècle me fait l’effet d’une belle statue grecque, vêtue d’une robe aux longs plis majestueux, qui reste immobile pour ne pas s’embarrasser dans son large et magnifique vêtement. Vient l’esprit sentencieux, bref, antithétique de Sénèque et de l’école stoïcienne, lequel rogne le manteau de la statue ou le relève sur son épaule, afin de lui donner une allure plus libre. Mais ce qu’elle a gagné en mouvement, elle l’a perdu en noblesse. Ce n’est plus la statuaire (stare, sto) : c’est une imitation de la peinture. La poésie en est restée aux souvenirs de Virgile et d’Horace. Entre eux et Lucain, il n’y a ni poésie ni poètes. Le seul qui soit entre les deux âges et qui en remplisse l’intervalle, c’est Phèdre. Mais Phèdre n’a pas fait école ; son genre ni son talent n’étaient faits pour cette gloire. D’ailleurs, il remonte, par sa naissance, aux beaux jours du siècle d’Auguste ; son éducation s’est faite au milieu de l’admiration que venaient d’y exciter ces deux grands poètes. Phèdre ne touche au siècle qui vit naître Lucain que parce qu’il a plu aux dieux de prolonger sa vieillesse jusque-là ; mais il est mort pour la poésie et pour la renommée longtemps avant d’être descendu dans la tombe. Enfin, le fabuliste romain, malgré une grand finesse de goût, un style plus qu’agréable, est un poète trop chétif pour qu’on dise de lui qu’il remplit une lacune, et une lacune d’un siècle : je n’ai donc pas tort de prétendre qu’entre Virgile et Lucain il n’y a que du silence. Silence étrange, il faut le dire, et qui n’a guère d’exemples dans l’histoire de l’art ! D’ordinaire, les grandes époques de poésie laissent derrière elles un troupeau d’imitateurs, qui vont diminuant et pâlissant, jusqu’à ce que le goût du nouveau suscite une école originale : En France, entre deux grandes époques littéraires qui se succèdent dans l’espace de deux siècles, deux sortes d’imitateurs végètent dans l’intervalle, lesquels prouvent, par la faiblesse de leurs copies, qu’ils ne savent pas admirer ce qu’ils osent imiter. Dans l’histoire littéraire de Rome, rien de cela n’a lieu. On saute brusquement de l’âge d’or dans l’âge de décadence, et l’innovation ne naît pas du mépris pour les imitateurs, comme chez nous ; c’est un fruit qui parait transplanté du sol de l’Espagne dans le sol romain par cette famille ingénieuse et hardie des Annæus et des Mela de Cordoue, gens spirituels et vains, écrivains de fortune, de la nature du charlatan et du penseur, les plus propres, dans les temps d’épuisement, à réveiller les esprits, mais par contrecoup à précipiter les langues. J’ai déjà fait ailleurs quelques remarques à ce sujet[1]. Lucain trouve donc la langue de Virgile intacte, et probablement honorée dans les écoles. Mais, d’autre part, Lucain trouve la prose de son oncle Sénèque honorée à la cour, et admirée dans le public. Des deux modèles, l’un est loin, l’autre est près : l’un a la gloire, l’autre a la vogue, plus étourdissante et plus séduisante que la gloire. Or, une langue ne se divise point en deux ; il ne peut pas y avoir de bonne prose dans un pays où il n’y a plus de bonne poésie : Lucain prend donc naturellement la langue de Sénèque pour toute la langue latine, et il fait .des vers comme la prose de son parent. Ce qu’a fait l’oncle pour la prose de Cicéron, le neveu le fait pour la poésie de Virgile. Ces deux Espagnols attaquent dans ses deux formes la belle langue du siècle d’Auguste. La Rome provinciale l’emporte sur la Rome métropolitaine. Les poètes de souche italienne, les Romains par le sang sont désertés pour les poètes de souche étrangère, pour les Romains par droit de cité. L’étoile des Annæus a fait pâlir le soleil de l’âge d’or. La poésie de Virgile, c’est une muse chaste et doucement voilée, au visage naïf, quoique déjà plus réfléchi que la muse grecque, à laquelle d’ailleurs elle ressemble par tant de traits. Le génie de Lucain ôte à la muse de Virgile son charme de chasteté, déchire son voile, la fait rire et pleurer avec scandale ; il dénoue sa belle chevelure et la livre à tous les vents. Ainsi défigurée, cette muse n’est plus la noble sœur d’Apollon ; c’est peut-être la moins retenue de ses prêtresses. De ce changement dans les choses devait résulter une double altération de la langue latine. Au lieu de la prose saine, réglée, abondante du siècle d’Auguste, nous avons la prose maigre, écourtée, sautillante de Sénèque. Au lieu de la poésie douce, profonde, reposante de Virgile, nous avons la poésie violente, superficielle, inquiétante de Lucain. IV. Comment Lucain renchérit sur Virgile dans la peinture des mêmes objets. Quelques exemples justifieront ces remarques. Je ne m’occupe de la prose de l’oncle que par allusion : mon sujet, c’est la poésie du neveu. Je vais donc citer quelques passages où Lucain se rencontre avec les idées de Virgile, et se voit forcé, par peur de l’imitation, d’imaginer des formes nouvelles pour exprimer des choses déjà dites. 0n saisira plus aisément, dans ces exemples, les altérations de la langue, quand on la verra employée par deux génies différents à revêtir les mêmes idées, et on aura une notion exacte des accroissements que reçoivent les langues à leur déclin. Premier exemple : Il s’agit d’exprimer comment la Sicile s’est séparée de l’Italie, les causes et les effets de cette séparation. Virgile dit : On raconte que ces lieux furent jadis déchirés en deux par une commotion violente qui fit de vastes ruines ; tant la durée des siècles peut changer la face des choses ! Auparavant, les deux terres se continuaient et n’en faisaient qu’une : la mer vint un jour fondre de toute sa force contre ces rivages ; elle détacha l’Hespérie de la Sicile, et ses flots pressés entre les deux rivages, baignèrent des champs et des villes désormais séparés. (Enéide, III, 44 4.) Lucain a décrit deux fois le même phénomène. Je joins les deux passages : L’Apennin était alors plus long que l’Italie, jusqu’à ce que le poids de la mer rompît la chaîne et refoulât les terres de chaque côté. Dans ce déchirement produit par les deux mers[2], les dernières collines de l’Apennin devinrent, sur le rivage de la Sicile, le promontoire de Pélore[3] . . . Curion reçoit l’ordre de passer dans les villes de Sicile, là où la mer engloutit soudainement, le sol, ou seulement le déchira et se fit deux rivages des terres intermédiaires. Sa vague y est d’une immense violence, et les eaux font de perpétuels efforts pour empêcher les deux moitiés du mont de se rejoindre. (Pharsale, III, 59.) Il n’est pas difficile de voir pourquoi la description de Virgile vaut mieux que celle de Lucain. Virgile peint à grands traits ; Lucain analyse, discute : c’est ceci, ou c’est cela, dit-il ; la terre a été engloutie ou séparée en deux ; Lucain ne manque pas à son devoir d’érudit ; il donne les deux opinions des savants. Il est spirituel là où Virgile est simple. La mer de Lucain, quoique nommée six fois en huit vers de six noms différents, pontus, œquor, profandum, mare, pelagus, œquora, comme s’il y avait eu un Gradus ad Parnassum de son temps ; cette mer qui fait d’incessants efforts pour empêcher les deux rives de se rejoindre ; cette mer qu’il représente tantôt par le poids de ses flots, tantôt par sa profondeur, afin qu’on sente encore mieux sa présence et sa puissance, est-elle aussi présente et aussi puissante que la mer de Virgile, cette nier qui vint fondre de toute sa force, vinit vi, pour accomplir un de ces changements des âges, auxquels le poète fait une allusion mélancolique ; cette mer qui vient avec son seul nom et sans le cortége d’aucun synonyme, qui fait deux rivages et deux contrées d’une seule terre, et qui baigne les champs et les villes qu’elle a désormais séparés ? Autre exemple : Virgile et Lucain veulent peindre la grandeur et la violence du Pô. Vers de Virgile : Le roi des fleuves, l’Éridan, roulant les forêts dans le gouffre de ses ondes déchaînées, emporte, à travers les plaines, les troupeaux avec les étables. (Géorgiques, I, 484.) Vers de Lucain : Et l’Éridan, la plus grande déchirure que se soit faite la terre pour y recevoir un fleuve, entraîne dans la mer des forêts fracassées, et épuise d’eau toute l’Italie. (Pharsale, II, 408.) Le Pô de Virgile, c’est le roi des fleuves, fluviorum rex. Virgile est italien ; pour lui, le Pô est le roi des fleuves. La comparaison est tout de sentiment ; c’est de l’orgueil national ; l’enfant de Mantoue ne sait rien de plus grand à dire de ce fleuve, sinon qu’il est le roi des fleuves. Le mot est beau, parce qu’il est naïf, parce qu’il vient du cœur plutôt que de l’imagination. Voyez, au contraire, en quels frais d’esprit s’est anis Lucain pour parler magnifiquement du Pô ! Le cours d’un fleuve est un sillon profond creusé dans la terre, une grande déchirure faite dans son sein ; L’Éridan est, dans toute l’Italie, le creux le plus profond, la déchirure la plus large où coule un fleuve. Quel détour pour en dire plus que Virgile ? Mais Lucain a beau faire, il a le dessous ; car le roi des fleuves sera toujours quelque chose de plus que le plus grand des fleuves. La peinture des ravages du Pô., dans Virgile, est complète. Sept ou huit mots pourtant y suffisent, nais ces mots sont encore de sentiment. Ce sont des troupeaux et des étables que roule l’Éridan débordé ; c’est toute la fortune et toute la vie des pasteurs ; c’est tout ce que l’homme possède sur les rives des fleuves, des troupeaux, des étables et des champs ; et cette destruction couvre toutes les plaines, campos per omnes. L’Éridan est grand comme un déluge.. Virgile peint comme Poussin, lequel, sur une toile de quatre pieds, et avec trois ou quatre figures, fait disparaître la terre sous les pluies de Dieu. Lucain détaille ; ses forêts sont rompues, avant d’être entraînées. Vraiment, nous ne nous en serions pas doutés. Mais passe. Ce n’est qu’une épithète inexacte ; l’eau ne rompt pas, elle déracine. Peut-être Lucain entendait-il donner ce sens à fractas. Mais comment expliquer le second trait ? De quelles eaux le Pô épuise-t-il l’Italie ? C’est, à savoir, de tous les fleuves, rivières et courants qui se déchargent dans son sein, et qu’il enlève par là même à l’Italie. Mais le trait est doublement faux, d’abord parce qu’il y a en Italie des fleuves, des rivières et des courants, et en assez grand nombre, qui ne se jettent pas dans le Pô, quand ce ne serait que l’Arno, le Tibre, et toutes les eaux de l’Italie méridionale ; ensuite parce qu’à mesure que le Pô se grossit des eaux qui affluent dans son cours, les montagnes renouvellent ces eaux, de telle sorte qu’il n’y a pas épuisement, mais simplement écoulement par le grand canal du Pô de toutes les eaux de l’Italie supérieure, ce qui est fort différent. Voici un exemple du même genre, appliqué à un autre ordre d’idées ; il s’agit de peindre une mêlée, où les combattants sont si pressés qu’ils peuvent à peine se mouvoir. Virgile dit : Les deux armées s’attaquent avec des forces égales et des chefs égaux ; les derniers rangs épaississent la ligne de bataille ; la foule est si pressée que le soldat ne peut ni mouvoir son bras ni lancer ses traits... (Enéide, X, 432.) Lucain renchérit : L’armée de Pompée, serrée en épais bataillons, avait rapproché ses armes sous une voûte de boucliers entrelacés ; le terrain où elle va combattre lui laisse à peine assez de place pour mouvoir ses bras et lancer ses flèches ; les soldats, foulés par les soldats, craignaient de se blesser avec leurs propres épées. (Pharsale, VII, 492.) Virgile omet ce détail, fort insignifiant, fût-il vrai. A quoi bon se mettre en frais de style pour si peu ? Les soldats sont si près l’un de l’autre, qu’ils ont à peine ou qu’ils n’ont pas du tout la liberté de leurs mouvements. Voilà le fait. Ce fait ne demande que les mots dont il ne peut pas se passer. Je vous accorde qu’il soit nécessaire comme trait dans la peinture d’une mêlée ; mais ne le développez pas. Je ne fais déjà qu’une très médiocre attention au fait en lui-même ; si vous le délayez, je ne vous lirai pas, je m’échapperai de votre mêlée, pour arriver plus tôt à l’événement. C’est ce que Virgile sait bien ; aussi ne fait-il qu’indiquer le détail brièvement après quoi il va aux choses intéressantes. Lucain développe ; en quatre vers il nous donne les trois espèces d’armes, tant défensives qu’offensives, dont se servaient les soldats romains : le bouclier, umbo ; les traits, tela, pour le combat de loin ; l’épée, gladius, pour le combat corps à corps. Ce n’est pas tout : les soldats de Lucain ne sont pas seulement, comme ceux de Virgile, dans l’impossibilité de remuer les bras et de lancer les flèches ; ils ont peur de se blesser avec leurs propres épées. Voilà une armée à qui ses propres armés font peur ! voilà le sentiment des soldats de Pompée pendant cette pause qui précède la charge ! ils s’effrayent de voir leurs épées si près d’eux ! Lucain sacrifie l’honneur de ses amis à son goût pour l’exagération ; voulant que ses Pompéiens soient plus serrés et plus empêchés que les Troyens et les Rutules de Virgile, il en fait des peureux qui se préoccupent du mal qu’ils peuvent se faire avec leurs glaives ; il les rend ridicules pour faire une image. Dans l’exemple qui suit, le contraste des deux manières sera encore plus sensible : les deux poètes vont décrire les mêmes phénomènes. Virgile raconte les présages qui accompagnent la mort de César ; Lucain les présages des guerres civiles. Il est évident que Lucain a voulu rivaliser avec Virgile, et refaire un tableau de son devancier. Je ne doute même pas que les amis de Lucain ne missent ses présages fort au-dessus de ceux de Virgile. Vers de Virgile (Géorgiques, I, 466-488.) : 1. Le soleil cacha sa tête brillante sous un sombre voile de rouille, et le siècle impie craignit une nuit éternelle. D’un
nuage sanglant tu voilas la lumière, Tu
refusas le jour à ce siècle pervers ; Une éternelle nuit menaça l’univers[4]. 2. Que de fois avons-nous vu l’Etna débordé rompre ses fournaises, se répandre en bouillonnant dans les champs des Cyclopes, et vomir, parmi des tourbillons de flammes, des pierres liquéfiées ! Combien
de fois l’Etna, brisant ses arsenaux, Parmi
des rocs ardents, des flammes ondoyantes, Vomit
en bouillonnant ses entrailles brûlantes ! 3 et 4. Les Alpes ressentirent des tremblements inconnus..... Les bêtes parlèrent, prodige inouï ! Sous
leurs glaçons tremblants les Alpes s’alitèrent... Et, pour comble d’effroi, les animaux parlèrent... 5. Jamais la foudre ne sillonna plus souvent un ciel serein ; jamais on ne vit flamboyer plus de comètes funèbres. Même en
un jour serein l’éclair luit, le ciel gronde, Et la comète en feu vient effrayer le monde. 6. Les profondes cités retentirent pendant la nuit des hurlements des loups. 7. La Germanie entendit un bruit d’armes dans tout le ciel..... Une grande voix perça le silence des forêts sacrées, et des fantômes d’une étrange pâleur se traînèrent dans l’obscurité des nuits. Des loups hurlant dans l’ombre épouvantent nos murs... Des bataillons armés dans les airs se heurtaient... On vit
errer, la nuit, des spectres lamentables ; Des bois muets sortaient des voix épouvantables. J’ai cité quinze vers d’un morceau qui n’en a guère qu’une vingtaine. Les passages de Lucain sont extraits d’une description qui en compte quatre-vingts. 1. Le soleil lui-même, à l’heure où sa tête, touchait le milieu du ciel, cacha son char brûlant sous d’épaisses ténèbres, enveloppa l’univers d’ombres, et força les nations à désespérer du jour. 2. Le farouche Vulcain ouvrit les gueules de l’Etna ; mais au lieu de lancer ses flammes droit vers le ciel, le mont Sicilien pencha sa tête et versa ses feux du côté de l’Hespérie. 3. Les Alpes secouèrent leurs vieilles neiges sur leurs cimes branlantes. 4. Alors la langue des bêtes se façonna aux murmures humains. 5. Des nuits obscures virent apparaître des astres inconnus, un ciel tout en flammes, des traînées de feu qui traversaient obliquement les airs ; des astres à la redoutable chevelure, et la comète qui change la face des empires ; des foudres sillonnèrent un ciel d’une sérénité trompeuse, et des feux de diverses formes percèrent l’épaisseur des airs. 6. On dit que les bêtes féroces, quittant de nuit leurs forêts, vinrent audacieusement établir leurs tanières au sein même de Rome. 7. On entendit un grand cliquetis d’armes, et, dans la solitude des bois, retentirent des voix épouvantables ; des ombres vinrent tout près des vivants. (Pharsale, I, 523-583.) Présages pour présages, pourrait-on dire, fantasmagorie pour fantasmagorie, un trait vaut l’autre ; et la modération dans le fabuleux ne le rend pas plus vraisemblable. Ce serait une bonne raison ailleurs qu’en poésie. En poésie, il y a une vérité dans des présages, une vérité dans des fantasmagories. Or, dans ce que j’ai cité de Virgile, cette vérité est si bien saisie et si énergiquement exprimée, que la fiction a tous les caractères et produit tout l’effet de la réalité. C’est une erreur de croire que l’imagination puisse être frappée par des peintures qui blessent la raison. Tout se tient dans les esprits bien faits, les seuls auxquels le poète doive penser. L’homme intelligent ne peut pas se scinder ; il ne peut pas lire avec son imagination toute seule, pendant que sa raison sommeille ; les deux facultés sont également présentes, et leur action est simultanée ; il ne se peut pas faire que l’une approuve pendant que l’autre blâme, et réciproquement, ni que l’une abdique pour le plaisir de l’autre. La maxime qu’il faut se prêter au poète est absurde ; l’omnipotence est du côté du lecteur et non du côté du poète : c’est donc lé poète qui doit se prêter au public, et, par public, j’entends non ceux dont le poète établit -arbitrairement la compétence, afin de n’admettre que les juges qui lui plaisent, mais tout homme sain d’esprit et cultivé. Ce que j’admire dans les présages de Virgile, c’est d’abord ce respect pour la tradition dont j’ai déjà parlé plus haut ; il raconte, en homme qui y a foi, les superstitions populaires. Lucain est moins scrupuleux : il n’y voit qu’un thème poétique ; il le brode, il l’amplifie, il l’embellit. Voyez, pour ces feux qui éclatent dans un jour serein, quelle subtilité, que de distinctions météorologiques ! Il y a six vers, et, dans ces six vers, il y a six phénomènes différents. Nous avons d’abord des astres inconnus ; c’est trop peu. Au second vers, le ciel est tout en flammes ; au troisième, voilà des météores ignés (faces), qui volent dans le ciel en décrivant une ligne oblique dans le vide ; une ligne oblique, quelle conscience d’observateur ! Les avez-vous donc vus, Lucain ? La fin du troisième vers et le commencement du quatrième nous donnent une espèce d’astre à la chevelure redoutable ; puis vient une comète, présage de révolutions, qui est autre chose que cet astre à chevelure. Au cinquième, brillent les éclairs, et au sixième, comme pour servir de bouquet d’artifice, des feux de toutes formes sillonnent les airs. J’ai omis les formes de ces feux, dont les uns s’allongent comme des javelots, et les autres rayonnent comme une lampe ; et ces foudres muettes qui éclatent dans des cieux sans nuages ; et les étoiles inférieures qui apparaissent au milieu du jour ; et la lune se voilant au moment même où elle était dans son plein. Toute la précision de Lucain est ce qui peut s’imaginer de plus vague, tandis qu’il n’est rien de plus précis et de plus frappant que le vague des deux vers de Virgile. C’est que toute peinture de ce genre, pour produire de l’effet, doit être vague, vague comme ces feux qui éclatent, et qui ont disparu avant d’avoir été vus, vague comme les éclairs qui font baisser les yeux aux hommes, vague comme le sentiment d’effroi qu’inspirent les présages d’une catastrophe. L’exagération de Virgile n’est pas dans la forme ni dans la nature des météores fatidiques qui accompagnèrent la mort de César ; elle est dans leur nombre. Jamais on n’en vit tant ! dit-il. Exclamation naïve et pleine de vérité ! C’est ce que devait dire et croire le peuple à qui César avait pensé dans son testament ; car le peuple ne braque pas un télescope sur les phénomènes célestes ; il les voit seulement plus nombreux qu’ils ne sont, et il ne les voit quelquefois que parce qu’il les craint. Quand les poètes parlent de présages, c’est au nom du peuple ou de ceux qui ont sa superstition sans avoir son ignorance ; c’est pour s’adresser à un sentiment involontaire et vrai qui n’est pas inconnu même à ceux qui se croient les moins crédules ; mais ce n’est point pour fournir des notes et des justifications au bureau des longitudes. Dès lors celui-là réalise la plus grande vérité de l’art, qui laisse aux phénomènes ce caractère de visions vagues et rapides, par lequel ils échappent à une description technique, et qui a bien plus songé à nous faire partager sa terreur qu’à nous communiquer sa science. Delille ne paraît pas l’avoir compris, quand il a paraphrasé les deux vers de Virgile sur les éclairs et les comètes par ceux-ci : Même en
un jour serein l’éclair luit, le ciel gronde, Et la comète en feu vient effrayer le monde. C’est le fait, moins le sentiment. Au lieu d’un poète ému, étonné, qui a sa part de la frayeur publique, voici un versificateur qui s’évertue à décrire un phénomène auquel il ne croit pas. Au reste l’habile traducteur des Géorgiques a pu être poète quelquefois à côté de Virgile ; il n’a jamais rendu Virgile. Il est tout habileté et tout esprit, et son original était tout sentiment. Lucain, qui a la prétention d’être si précis dans la peinture de phénomènes imaginaires, recherche volontairement les traits vagues ou le fabuleux, quand il s’agit de peindre des phénomènes réels et connus. Ainsi, dans la description des fureurs de l’Etna., tandis que Virgile s’est contenté de dire ce que tout le monde savait de son temps des éruptions volcaniques, ce qu’il en avait ouï peut-être de la bouche des pâtres qui conduisaient leurs troupeaux sur les flancs de la montagne, Lucain faisant intervenir le plus usé des dieux de l’Olympe, Vulcain, nous le présente dirigeant l’éruption de l’Etna, ouvrant de sa main les bouches du cratère, et les tournant du côté de l’Italie, afin qu’on sache bien que le volcan ne se dérange ainsi de ses habitudes, et ne verse sa lave de ce côté, que pour désigner la terre maudite dans laquelle vont s’enfanter et se consommer tous les maux de la guerre civile. Dans tous les autres détails, Virgile conserve ce vague de la tradition superstitieuse, qui n’exclut pas d’ailleurs la clarté ni la précision des paroles. Rien assurément n’est plus vague et pourtant plus nettement exprimé que ces bruits entendus par la Germanie dans tout le ciel, toto cœlo, que ces hurlements des loups, pendant la nuit, jusque dans le sein des grandes villes, que ces mouvements inconnus qui agitent les Alpes, que ce soleil qui cache sa tète sous un voile de rouille, que ces générations impies qui craignent une nuit éternelle, que ces bêtes qui parlent. Dans Lucain les mêmes phénomènes sont accompagnés de telles circonstances, et peints de telles couleurs, que tel qui aurait cru aux présages de Virgile, sur la foi de son émotion, et par l’effet même du vague mystérieux des paroles, sourit des présages si minutieusement circonstanciés de Lucain. Nul n’est tenté de croire, même poétiquement, à ces Alpes qui secouent leurs vieilles neiges sur leurs cimes branlantes ; à ces bêtes féroces qui viennent, jusque dans le milieu de Rome, établir leurs tanières, après avoir quitté les forêts, ajoute le poète, pendant la nuit ; à ces langues d’animaux qui se façonnent aux murmures humains[5] ; à ces nations qui sont forcées, parla disparition volontaire du soleil, de désespérer du jour. Encore si c’était le vrai soleil ; mais non, il s’agit du soleil de la mythologie : c’est Titan, fils d’Hypérion, petit-fils de Titan et de la Terre, arrière petit-fils de Cœlus[6], qui cache sous une nuit épaisse son char ardent. Dans Virgile, c’est le soleil, le beau soleil d’Italie, ce globe de feu, plus poétique que toutes les mythologies, et qu’adorent certains peuples brûlés de ses feux ; c’est ce soleil des Géorgiques qui féconde les travaux du laboureur, et qui dore ses moissons ; c’est le soleil, père de toute lumière, qui couvre sa tête d’un voile de rouille. Des deux poètes, assurément ni Virgile ni Lucain n’étaient dupes des traditions superstitieuses qu’ils célébraient dans leurs vers ; mais si l’un d’eux pouvait être mythologique avec candeur, c’est Virgile, lui qui était tout plein des dieux d’Homère, et qui avait toutes les croyances que peut donner l’amour de l’art. Et pourtant il s’abstient avec soin de faire de la mythologie : il sait que le peuple, emporté par son admiration pour César, voyant Rome vide du seul homme qui pût la remplir, excité par les partis politiques que sa mort privait d’un chef et d’un appui, et surtout par les riches largesses de son testament ; que ce peuple pouvait avoir changé à son insu ses regrets pour César en présages fatidiques de sa mort, que ce sentiment était simple et vrai, et que, pour le bien rendre, A fallait le partager. Il abdique donc ses doutes d’homme éclairé et exprime avec sa foi de poète la foi populaire ; et, comme tous les sentiments superstitieux sont vagues, il est vague pour être vrai. Lucain, qui n’a plus même cette sorte de religion poétique que Virgile avait retenue de son commerce avec Homère, Lucain appelle à son aide, outre Titan et Vulcain, Téthys, qui présage la guerre civile en faisant déborder ses flots sur les rivages d’Afrique et d’Espagne ; puis les dieux Lares, dont les statues se couvrent de sueur ; enfin la gigantesque Érinnys, qui vole autour des murs de Rome en secouant un pin enflammé. Il y a pourtant un trait, dans la citation de Lucain, que je préfère beaucoup au trait correspondant de Virgile : c’est la peinture de ces fantômes qui apparaissent au milieu des nuits. Les ombres pâles de différentes manières de Virgile sont moins effrayantes que ces ombres de Lucain qui viennent tout près. C’est Lucain qui cette fois a le mieux exprimé le vague des superstitions populaires. Rien de plus vague, en effet, ni de plus terrifiant que ces fantômes qui s’approchent des hommes, qui les effleurent et les glacent de ce vent de la tombe qui circule autour des fantômes. Je ne sais si je suis trompé par une impression personnelle ; mais ces trois mots si simples de Lucain, venientes cominus umbrœ, me rappellent ces fantômes qui ont si souvent agité mes rêves, entrouvrant mes rideaux de leur main décharnée, s’approchant de moi, dardant sur moi leurs yeux de flamme, et tout à coup disparaissant au moment où ils me touchaient, chassés par d’autres visions, ou par l’effroi qui m’avait réveillé. Je veux citer un autre trait qui n’appartient qu’à Lucain, et oit il a encore l’avantage sur Virgile, car Virgile le lui a laissé à trouver. Il parle des monstres humains, parmi tant d’autres présages. De l’homme, dit-il’, naissent des êtres hideux par le nombre et la forme de leurs membres. L’enfant épouvante sa mère[7]. Ces mots-là auraient pu sortir du cœur de Virgile. Enfin, la magnifique peinture du laboureur de Virgile, heurtant du soc de sa charrue des javelots rongés par la rouille et des casques vides, et contemplant les grands ossements des aïeux[8], n’est pas plus brillante que cette fiction de Lucain nous montrant les mânes de Sylla qui se dressent au milieu du Champ de Mars, pour faire entendre de sinistres prophéties, et près de sa tombe brisée, Marius qui lève sa tête du sein des froides ondes de l’Anio, et fait fuir le laboureur épouvanté. . . . .
Et medio visi consurgere campo Tristia
Syllani cecinere oracula manes ; Tollentemque
caput, gelidas Anienis ad undas, Agricolæ fracto Marium fugere sepulcro[9]. V. Des innovations de Lucain. Voyons maintenant les innovations de Lucain. Ces innovations sont de deux sortes. Il innove dans les mots par des créations, des additions au vocabulaire de la langue latine, des modifications introduites dans sa grammaire : ce sont proprement des innovations matérielles. Il innove dans les tours, par les images, les figures de pensées, les métaphores ; ce sont des innovations dans l’ordre des idées, des altérations du génie même de la langue, lequel ne consiste pas dans un certain fonds invariable et sacré de mots et de tournures, mais dans la conformité de tout mot et de toute tournure avec le génie d’une nation, avec les monuments littéraires où cette nation se reconnaît. J’ai fait cette distinction pour plus de facilité et de clarté ; mais on sent que les deux sortes d’innovations rentrent souvent l’une dans l’autre. Il est cependant certaines nuances par lesquelles elles diffèrent. Je donnerai successivement des citations où ces nuances sont marquées. Voici d’abord les innovations de mots. VI. Des innovations de mots. Je me borne à quelques exemples des unes et des autres ; une énumération complète, outre qu’elle ne prouverait pas plus qu’un choix raisonné d’exemples, aurait de plus l’inconvénient d’être parfaitement ennuyeuse ; et la matière que je traite n’est pas déjà si plaisante que je n’évite, par tous les moyens, de la charger d’une érudition superflue. Il y en aura cependant de quoi satisfaire même les exigences d’un philologue. I. Adde quod adsuescis fatis[10]. Adsuesco est ici pris dans le sens actif, contre l’usage qui l’avait fait neutre jusque-là. Le passage d’où est tiré cet exemple est curieux. C’est celui où Cornélie éplorée déclare à son mari que, parmi tous les inconvénients qui résulteront de sa relégation dans l’île de Lesbos, il y a celui-là par-dessus tout, qu’elle pourrait fort bien s’accoutumer à l’absence et apprendre à la longue à supporter la douleur. Adde quod adsuescis fatis signifie donc : Ajoute à cela que tu m’accoutumes à mes destins errants, c’est-à-dire à être loin de toi. Adsuescis est pour adsuefacis assurément, mais n’en est pas le synonyme, du moins dans la belle langue du siècle d’Auguste. On trouve, il est vrai, dans Horace : Pluribus assuerit mentem[11], et dans Virgile, Ne, pueri, ne tanta animis assuescite bella[12]. Mais, dans ces deux exemples, il y a seulement action réfléchie ; dans Lucain, il y a action directe, c’est-à-dire que le verbe est tout à fait actif. Stace a dit comme lui : Rhodopen assueverat umbra[13]. II. Pati employé dans le sens absolu de vivere. On passerait à peine cette hardiesse à Héraclite, pour qui, sans doute, vivre et souffrir devaient être la même chose. On trouve, à la vérité, dans Virgile : Certum
est in silvis inter spelæa ferarum Malle pati[14]... Mais, ici, il s’agit de vivre dans les forêts, au milieu des bêtes féroces. Le mot pati indique l’extrême misère et l’extrême souffrance, et il peut très bien être pris dans son acception ordinaire, souffrir. Il n’en est pas de même dans Lucain. Disce sine armis posse pati[15] : Apprends qu’on peut bien vivre sans se battre. Et ailleurs : Et nescis sine rege pati[16] : Et tu ne sais pas vivre sans roi. Il n’y a pas là la moindre idée de souffrance ni physique ni morale ; loin de là, pati veut dire vivre bien, vivre heureux ; c’est tout l’opposé de la souffrance. Au reste, l’oncle de Lucain lui avait donné l’exemple de ces importations qu’on peut qualifier d’espagnoles, car c’est l’exagération qui y domine. On trouve dans la tragédie, ou plutôt dans la déclamation en vers, intitulée Thyeste, ce vers qui contient à la fois un jeu de mots et une innovation : Immane regnum est posse sine regno pati[17]... C’est un monstrueux royaume que celui où l’on peut vivre sans royaume, c’est-à-dire sans gouvernement, maxime qui devait être fort goûtée de l’élève de Sénèque, Néron. III. Durare avec un verbe : Les dieux ne disent pas à ceux qui doivent vivre qu’il y a du bonheur à mourir, afin qu’ils persévèrent à vivre[18]. Sans compter que felix, qui ne s’applique qu’aux personnes dans la belle latinité, ou du moins aux êtres qui peuvent percevoir d’une façon ou d’une autre l’état de bonheur, et qui en ont plus ou moins conscience, s’applique ici a une chose, à un état passif, sans conscience de lui-même, au mourir. IV. Exire per ferrum, sortir à travers le javelot. Per ferrum tanti securus vulneris exit (leo)[19]... Littéralement : Sans se soucier d’une si large blessure, le lion passe à travers le javelot.... Jusqu’à Lucain, c’était le fer qui sortait du corps du blessé, et non le blessé qui sortait du fer. Ici encore, c’est l’oncle de Lucain qui a les honneurs de l’innovation. Dans le Traité de la Colère, on lit cette phrase : Gaudent feriri, et instare ferro, et tela corpore urgere, et per vulnus suum exire[20].... Ils aiment à être frappés, à se pousser sur le fer, à enfoncer les traits avec le poids de leur corps, et à sortir à travers leur blessure. » Quant à l’expression securus vulneris, elle n’est guère moins insolite, quoiqu’elle ait plutôt l’air d’une négligence que d’une innovation. Dans la langue de Virgile, on disait déjà très hardiment : Securus amorum germanœ[21] (Pygmalion) : S’inquiétant fort peu des amours de sa sœur (pour Sichée). Lucain renchérit sur cette hardiesse. Avant lui, Sénèque avait dit : Secura melus Troïa pubes[22] : La jeunesse troyenne, libre de toute crainte. Et c’est d’après ce double exemple de l’oncle et du neveu, que vous trouvez dans Valerius Flaccus : Tantœ molis securus[23] ; dans Stace : Tantique maris secura juventus[24] ; dans Silius Italicus : Securus cædis[25] ; toutes innovations qui ont fait perdre au mot securus son acception vraie et générale. Il y a une nuance très profonde et très distincte entre la signification de ce mot securus dans la belle latinité, et ce qu’on lui fait dire dans la latinité de la décadence. Cette nuance porte tantôt en deçà, tantôt au delà de l’acception vraie ; mais jamais les deux latinités ne se rencontrent. Je ne dis rien de l’idée qui a donné lieu à la citation de Lucain, ni de l’espèce de magnanimité de ce lion qui sort â travers le fer, avec l’insensibilité du fer lui-même entrant dans ses flancs. Ces exemples de fausse grandeur se voient à chaque instant dans Lucain. V. Stimulis negare, résister à l’aiguillon. Pompée hâtant son cheval épuisé et qui résistait à l’éperon[26]. Je ne sache pas qu’il y ait, dans la belle latinité, un seul exemple de ce singulier emploi du mot negare. Il signifie quelquefois refuser, et le plus souvent nier. Dans le premier cas, il est actif ; dans le second, neutre. Jamais il n’a signifié résister. On voit la même expression dans Stace : saxa negantia ferro[27], des rochers qui résistent au fer. VI. Degener, qu’on ne trouve pas dans Horace, que Virgile n’a employé qu’une fois[28], dans le sens de dégénéré, abâtardi, et en l’appliquant aux esprits ; aux courages, s’applique dans Lucain aux choses inanimées. Ainsi : 1. Degener toga. Traduisez : La toge portée par des sénateurs dégénérés. Et tandis que tes bras vigoureux peuvent lancer le javelot, souffriras-tu la domination de la toge dégénérée, et laisseras-tu régner le sénat ?[29] 2. Degener rogus. Traduisez : Un bûcher indigne de celui qui est brûlé. Il s’agit de l’apothéose de Pompée. Pompée s’élança de son bûcher, et, laissant là ses membres à demi consumés et son indigne bûcher, il monta vers la demeure de Jupiter[30]. 3. Mais César, ne se confiant pas aux murailles de la ville, se met à l’abri derrière les portes du palais, s’abaissant ainsi â d’indignes cachettes[31]. Tacite, qui ne se défend pas toujours des façons de dire exagérées de Sénèque et de son neveu, ne me fait pas trouver bon prece haud degenere permotus[32] : Touché d’une prière qui n’était pas sans dignité. VII. Sponte, dans la latinité du grand siècle, se joint avec mea, tua, etc., ou s’emploie seul, adverbialement. Dans Lucain, sponte se joint très fréquemment à des génitifs. Ainsi vous trouvez : Non sponte ducum[33], malgré les chefs. Sponte deorum[34], du consentement des dieux. Non sponte Dei[35], contre le gré de Dieu. Tacite dit, à l’exemple de Lucain, sponte principis[36]. VIII. Fidem facere, donner la confiance. Dans la latinité classique, fidem facere veut dire invariablement, et dans tous les écrivains de cette latinité, raire croire, prouver. Cicéron dit : Fidem facit oratio[37], le discours fait foi ; et ailleurs : Fac fidem, te nihil nisi populi utilitatem quœrere[38], prouve-moi que tu ne cherches que l’avantage du peuple. Lucain donne un sens tout différent à cette locution : César, dès que l’immense appareil de ses forces l’autorisa, l’enhardit à tenter de plus vastes entreprises[39]. Quel exemple plus curieux pourrait-on citer de ce penchant de Lucain à détourner de leur sens primitif et populaire des expressions consacrées par tous les monuments littéraires de l’âge précédent ? IX. Difficilis, toujours employé dans le sens neutre, est employé à l’actif par Lucain. Ô dieux ! qu’aisément vous nous élevez à la souveraine puissance, et que malaisément vous nous y soutenez ![40]... C’est là le sens de difficiles. X. Pensare iter, abréger son chemin. Celui-ci abrégeait son chemin[41]. Expression nouvelle. XI. Beaucoup de mots ajoutés par Lucain au vocabulaire de la langue latine. 1. Arenivagus, qui erre à travers les sables. Cette épithète, qu’on s’attend à voir appliquée à un fleuve ou à un ruisseau perdu dans le désert, Lucain la donne au grave Caton traversant les sables de l’Afrique. C’est un mot tout joli et tout sautillant qui jure étrangement à côté du plus grand nom du stoïcisme. Phébé deux fois éteignit et deux fois ralluma son flambeau, tandis que son lever et son déclin virent Caton errer dans les sables du désert[42]. Ce qui, sans périphrase mêlée d’astronomie et de fable, veut dire : Deux mois entiers, Caton erra dans les sables du désert. 2. Bellax, vaillant à la guerre. Là, se confiant en la vaillante nation des Curètes[43]... 3. Fastibus pour fastis[44] ; c’est une innovation pour le seul besoin de la mesure. On ne peut pas traiter plus cavalièrement une langue. 4. Un grand nombre de substantifs en or, tirés des verbes et joints à des génitifs : Consultor dei[45], qui vient consulter un dieu. Editor aurœ nocturnæ[46], qui élève des vapeurs pendant la nuit. Il s’agit d’un fleuve marécageux. Finitor orœ circulus[47], l’horizon d’un pays. Haustor aquœ[48], qui puise de l’eau. Il s’agit de Caton donnant à son armée l’exemple de tous les genres de courage. Il marche en avant, sous le brûlant soleil d’Afrique, chargé de ses armes, la tête nue ; il dort le moins, et, si l’on rencontre une source, il est le dernier à y puiser, ultimus haustor aquœ. Humator consulis[49], qui inhume un consul. C’est Annibal faisant chercher sur le champ de bataille de Cannes le cadavre du consul Paul Émile, et lui rendant les honneurs funèbres. Au vers suivant, le bûcher, c’est Cannes allumée par une torche africaine libyca succensœ lampade Canne. Périphrase auprès de laquelle l’humator consulis est presque de bon goût. Simulator belli[50], qui fait semblant de vouloir attaquer. Épithète que Lucain donne à Sabura, lieutenant du roi Juba, qui attire Curion dans une embuscade. Mutator anni[51], qui change les saisons. XII. Beaucoup de mots devenus, dans Lucain, indéterminés et vagues, de clairs et précis qu’ils étaient dans les auteurs du siècle d’Auguste. Il faut remarquer que Lucain se sert de ces mots vagues très souvent pour faire son vers. Quand le mot propre ne peut pas entrer commodément dans la mesure, il y joint un de ces mots généraux et supplétifs qui aident à tous les sens et se prêtent à tous les rythmes. Parmi ces mots, fides, fœdus, fatum, fortuna, jouent un grand rôle. Fœdus, par exemple, sert à tous les genres d’alliance possibles : ici, à la paix[52] ; là, à la parenté[53] ; ailleurs, à l’harmonie du monde, à son organisation, à sa destruction[54] ; ailleurs, au droit des gens[55] ; ailleurs, au mariage[56], etc. Voyez à combien de choses différentes s’applique tour à tour fides : 1. Voici d’abord fides dans son acception vraie et générale : La fidélité qui avait changé avec la fortune[57]. 2. Fides, foi qu’on ajoute à certaines choses : S’il faut en croire ceux qui racontent[58]. 3. Fides, pour témoignage : Il veut qu’une preuve de son crime reste[59]. 4. Fides, garant de la véracité : Il connaissait aussi ces tristes autels consacrés aux évocations funèbres, et par lesquels on force Pluton et les ombres à dire la vérité[60]. 5. Servata fade templi[61].... Cela signifie : Sans avoir éprouvé si le temple disait ou non la vérité ; même sens, à une nuance près, que dans l’exemple précédent. 6. Fides audendi : On l’a vu tout à l’heure : Lui donnèrent la confiance d’oser de plus grandes choses[62]. 7. Fides superum, conformité d’un événement avec une prédiction. Dès qu’ils ont compris combien de malheurs va coûter à l’univers la véracité des dieux[63]. » 8. Fides, dans le sens d’honneur : Un honneur à engager dans le bouleversement du monde[64]. Il s’agit d’un des motifs qui poussent certains citoyens à prendre parti dans la guerre civile. Fides est ici l’honneur ou le déshonneur, on ne sait lequel. Qu’est-ce que des gens perdus de dettes et de crimes peuvent vouloir abîmer dans les ruines de la guerre civile ? Est-ce leur considération ? leur crédit ? leur honneur ? Ils n’en ont plus. Est-ce leur honte ? Je conçois cela. Mais, selon Lucain, ils ont encore quelque chose à perdre, et ce quelque chose, c’est fides ; mais qu’est-ce que fades veut dire ? Il y a deux mots en particulier dont Lucain fait un étrange abus. Ce sont les mots mors et fatum. Dans une description des serpents de toute sorte qui attaquent l’armée de Caton en Afrique, voici le rôle que le poète fait jouer successivement à ces deux mots : MORS.1. Voyant des morts inouïes résulter de petites blessures[65]. Mortes est pris ici dans le sens propre. 2. Accessit morti Libye[66]... Lucain parle d’un homme atteint d’une morsure qui lui donne une soif inextinguible. Il faut traduire : Les ardeurs de la Libye s’ajoutèrent aux causes de sa mort. 3. Il ne sent ni le genre de son mal, ni les propriétés mortelles du venin[67]. 4. Quoique petit, nul autre reptile ne donne une mort aussi sanglante[68]. Littéralement : Nul autre n’a la propriété de faire mourir avec une aussi grande perte de sang. Ailleurs, le mot mors est employé tantôt activement, tantôt passivement. Sans compter que, quand il est épuisé, ou quand la mesure en a besoin, ce mot d’un usage si universel est relevé par son synonyme letum. Ainsi, letum fluens, est une espèce de mort par suite de laquelle tous les membres se décomposent immédiatement et tombent à l’état de putréfaction liquide ; mort qui est d’ailleurs toute de l’invention de Lucain. Étrange philosophe, qui ne trouve pas que l’homme meure de morts assez tristes, et qui en imagine d’impossibles, pour le besoin de sa description ! FATUM.1. Caton voyant mourir misérablement tant de ses soldats[69]. Fata tristia est pris dans le sens de tristes trépas. 2. Et vous n’avez même pas besoin de venin pour donner la mort[70]. C’est une allocution que Lucain adresse aux dragons ailés, lesquels étouffent les troupeaux dans leurs replis, replis si vastes que l’éléphant lui-même n’est pas protégé par sa grandeur (spatio). 3. Et la dipsade (c’est l’un des serpents décrits par Lucain), aidée par ces contrées brûlantes, a moins de mérite à donner la mort[71]. Cela ôte à la dipsade un peu de son mérite, de sa réputation, de tuer les gens, non avec ses seules forces, mais avec l’aide d’un climat de feu. Comment trouvez-vous l’espèce de dédommagement que Lucain offre à ceux qui ont été piqués par la dipsade ? Il les console en rabattant d’avance l’orgueil que pourrait avoir le serpent. Dans cette ridicule phrase, fatum est employé dans un sens actif. Fama fati ne peut se traduire que par la réputation de donner la mort. 4. Il ne sent pas la nature de son mal[72]... Fatum signifie mal, maladie, ou simplement accident, comme on voudra. 5. Les os même s’en vont, et suivant le sort de la moelle déjà putréfiée, ils ne laissent subsister aucune trace de cette destruction rapide[73]. Fatum signifie destruction, néant, quelque chose de plus que la mort. 6. La mort et la blessure furent instantanées[74].... C’est ici la mort subite, violente, la mort d’un homme foudroyé. 7. Qui croirait que le scorpion (vu sa petitesse) a le pouvoir de donner la mort ?[75] Fata veut dire ici, comme tout à l’heure mors, propriété mortifère ; et habere fata signifie, en conséquence, avoir la propriété de donner la mort. 8. Mais ils se roulent sur la terre, le corps exposé à la dent mortelle des serpents[76]. Tout ce qui suit et précède ce passage détourne de l’idée qu’il s’agit ici simplement de destins. Évidemment Lucain a mis fatis pour suppléer à serpentibus, qui ne faisait pas son affaire. Fatis résume tout : les serpents, leurs morsures, les trépas qui en résultent. Plus loin[77] se retrouve le même mot avec la signification de mort lente ; plus loin[78], avec celle de sort, destinée ; ailleurs, enfin[79], avec celle de derniers moments, derniers soupirs. Sans compter que mors et fatum se trouvent quelquefois dans le même vers ou dans la même phrase ; ainsi : Nec sentit fatique genus, mortemque veneni[80]... . . . . . . . . . . . . . . . Quis fata putaret Scorpion, aut vires maturæ mortis habere[81]... Enfin, je vais citer un dernier exemple, et cet exemple est fréquent dans la Pharsale, de trois de ces mots vagues employés dans la même phrase et dans deux moitiés de vers : Le hasard d’une mort prochaine (c’est-à-dire prématurée) avait livré ce jeune homme aux destins[82]... Ce que fait dire Lucain à chacun de ces mots est le plus souvent inexplicable. Il est douteux qu’il se rendit compte de l’emploi qu’il en faisait. Ces mots le menaient à son insu, et sa pensée, toujours vague ou tendue (le tendu ou le vague se touchent) s’en payait presqu’à chaque instant. Il y met même une négligence qui ressemble beaucoup à de la paresse. Il en est de même de ses apostrophes, qui sont innombrables, et qui, chose singulière, ont le plus souvent pour sujets ces mêmes mots vagues, et particulièrement fortuna, qui est d’une commodité métrique incalculable. On croit, au premier abord, que c’est l’astre poétique, l’enthousiasme qui s’impatiente d’un récit régulier, et s’exhale de temps en temps en apostrophes. Point ; regardez de plus près : c’est tout simplement la mesure qui appelle l’apostrophe ; c’est la simple différence métrique qui existe entre la seconde et la troisième personne des verbes, l’une représentant l’apostrophe, l’autre le récit, qui détermine toute cette chaleur. Prenez au hasard un morceau de Lucain, vous y trouverez, à n’en pas douter, ou quelque mot vague et général, ou une apostrophe, très souvent les deux choses. Regardez bien pourquoi ce mot et cette apostrophe sont là, et vous verrez que la différence d’un dactyle à un spondée y est pour plus de moitié. Le secret de la poésie de Lucain et des poètes de son époque n’est pas un de ces mystères où l’œil des profanes n’a rien à voir. Il ne faut, pour se rendre compte de leur travail, ni faire la dépense d’un aigle ou d’un cygne, ni bâtir un chaste sanctuaire où s’enferme le poète, ni le parer de grâces mystérieuses, ni lui prêter des attitudes recueillies et méditatives : il suffit de savoir que l’expression propre coûte plus de peine que l’expression vague et le récit direct que l’apostrophe ; que les à peu près viennent plus aisément sous la plume que les choses nettes et claires, et les tours chaleureux que le discours doux et tempéré ; que, quand on vit dans un siècle qui se contente de peu, qui a des appétits de dessert, capricieux et féminins, plutôt que des appétits virils, on fait vite et on fait avec paresse, la paresse, dans les lettres et les arts, étant toujours en raison directe de la vitesse ; il faut, dis je, savoir toutes ces petites choses pour se rendre témoin, par la pensée, du travail de. Lucain et de ses contemporains, et pour avoir une représentation exacte d’un poète de l’époque de décadence à l’heure de l’inspiration. VII. Des innovations dans les tours. - Efforts de style pour exprimer des idées communes. - Métaphores et images fausses. A la seconde espèce d’innovations dans la langue se rattachent naturellement : 1° Les efforts de style que fait Lucain pour exprimer des faits très simples ou des idées très communes. 2° Les exemples de métaphores fausses ou forcées. Je bornerai mes citations, étant plus pressé encore que mon lecteur de quitter le terrain aride de la philologie ; car le mérite, s’il y en a, n’en vaut jamais la peine. Le désir d’être exact, et la peur de ne pas l’être, sont deux tourments dont on est bientôt las, surtout quand on n’est pas très sûr de la longanimité de son lecteur. EFFORTS DE STYLE DE LUCAIN POUR RENDRE DES IDÉES COMMUNES.1. Voici l’idée : Rome se détruit elle-même en se donnant trois maîtres. La fortune ne prête à aucune nation étrangère sa jalousie contre un peuple puissant sur mer et sur terre. La cause de tous ces malheurs, c’est toi, ô Rome, qui t’es donnée à trois maîtres ; c’est encore ce funeste partage d’une autorité qui ne u doit jamais appartenir à plusieurs[83]. Quelle fatigue, quel labeur d’esprit et de mots ! que de détours pour arriver à une vérité si vraie ! que de voiles pour donner un faux air de, nouveauté à une pensée commune ! La fortune n’a choisi aucune nation étrangère pour en faire l’instrument de sa jalousie personnelle contre Rome ; elle n’a voulu se venger de Rome que par les mains de Rome ! Que cette fortune est raffinée dans sa jalousie ! La traduction affaiblit ce qu’il y a de prétentieux dans ce mot commodat, qui signifie prêter de la main à la main. Lucain est un des poètes qui gagnent le plus à être traduits, parce que, sous peine d’être barbare, la traduction doit lui ôter quelques images qu’elle ne peut ni ne doit rendre ; alors il n’est plus que commun. 2. César accuse Pompée d’accaparement. Que dirai-je des campagnes fermées (comme on dirait des greniers) par tout l’univers, et de la famine rendue docile à ses projets ?[84] Traduisez une seconde fois : les campagnes fermées, c’est-à-dire l’exportation prohibée, et tous les blés concentrés à Rome par Pompée, lequel avait été chargé pour cinq ans de l’administration des subsistances. 3. Il s’agit de Marius, non de Marius le jeune, mais du frère adoptif du grand Marius, que Sylla fit égorger sur le tombeau de Catulus. Un vieillard rappelle cette odieuse exécution. J’ai vu ses membres déchirés, et ses blessures aussi nombreuses que ses membres, et, sur son corps tout meurtri, nulle blessure assez grave pour lui donner la mort — on ne lui faisait pas la grâce de le blesser assez grièvement pour qu’il en mourût, — et ce raffinement de cruauté barbare qui ménageait la mort d’un mourant[85]. Quel besoin avions-nous de ces contorsions pour détester dans Sylla une cruauté que Caligula devait lui envier, et qu’il avouait dans ce mot, lequel a du moins le mérite d’être clair et de bonne latinité : Ita feri, ut sentiat se mori : Frappe de façon à ce qu’il se sente mourir ? 4. Étonnement des Marseillais à la vue des tours de César, qui marchent sur des rouages cachés. Ces tours, mues par une cause cachée, firent beaucoup de chemin en rampant. Et quand la jeunesse marseillaise vit se mouvoir une si lourde masse, elle crut que c’était quelque vent souterrain qui cherchait d sortir du sein de la terre ébranlée, et elle s’étonna que les murs de Marseille restassent debout[86]. Quel tort l’imagination de Lucain ne fait-elle pas à l’intelligence des Marseillais ! C’est pourtant de cette sorte qu’il en agit, presque à chaque instant, avec ses meilleurs amis. Les Marseillais avaient toute sa sympathie ; il les aime jusqu’à leur attribuer les faits d’armes des soldats de César. 5. Des naufragés s’attachent à un vaisseau ; on leur coupe les bras ; ils tombent. Laissant leurs bras pendants au navire grec (synonyme de marseillais), ils tombèrent de leurs mains, ou du haut de leurs mains, ou séparés de leurs mains[87]. Pour préparer cette image, Lucain remarque qu’on leur a coupé le bras à la moitié, vers le coude ; de cette sorte, ils peuvent laisser tout à la fois leur avant-bras au navire et tomber du haut de leurs mains. 6. Méduse pétrifie tous ceux qui la regardent en face. Méduse a cela de terrible que tout le monde peut la regarder impunément ; car cette bouche hideuse, ce visage, qui donc en a jamais eu peur ? Qui est-ce qui a pu regarder en face Méduse, à qui Méduse ait permis de se sentir mourir ? Le monstre précipite les destins hésitants, et devance les craintes. Les membres sont morts sans que le dernier souffle ait pu s’échapper, et les mânes emprisonnés se glacent et se pétrifient[88]. » Lucain n’est pas toujours de ceux qu’on interprète en les traduisant. Après la traduction, il faut donc les commentaires ; et quelquefois ni la traduction ni les commentaires ne peuvent tirer du passage de Lucain une idée nette ou seulement spécieuse. Pourquoi donc n’a-t-on jamais craint la bouche et la face de Méduse ? — C’est parce que la pétrification est si subite, si foudroyante, qu’on est mort avant d’avoir eu peur de mourir. L’oncle de Lucain, Sénèque, avait déjà caractérisé cette singulière espèce de mort, qui n’est précédée d’aucun sentiment. Parlant d’un homme frappé de la foudre, il dit : Sed non exit cogitationi locus. Casus iste donat metum : nemo unquam fulmen timuit, nisi qui effugit[89]. Il n’y aura pas place pour une pensée. Ce malheur vous fait grâce de la crainte. Personne n’a jamais craint la foudre, si ce n’est celui qui y a échappé. Lucain va plus loin : Méduse ne souffre point que ceux-là meurent qui l’ont regardée. Comment cela ? pourquoi ne meurent-ils pas ? — Parce qu’ils sont morts. Sénèque avait dit : Il n’y a pas place pour une pensée ; Lucain dit : Il n’y a pas place pour un souffle. Sénèque admet au moins qu’il puisse se passer un clin d’œil entre le coup de la foudre et la mort ; Lucain vous tue avant le clin d’œil. Il a imaginé une mort qui n’arrive ni avant le regard, ni pendant ni après. Il y a progrès et perfectionnement dans le neveu. J’ai souligné le dernier vers, parce que si je l’ai traduit, je ne puis pas dire que je l’entende. Un commentateur me dit que ces mânes (umbrœ) étaient des images subtiles des corps : à la bonne heure. Or, ces images sont en prison comme le souffle ; rien ne sort du corps. Mais que fait donc Lucain des âmes des pétrifiés ? Méduse avait donc la propriété de soustraire des morts à Pluton ? EXEMPLES DE MÉTAPHORES FAUSSES OU FORCÉES.1. Exorde du discours de Brutus à Caton. Ô toi, seul gage de la vertu exilée et mise en fuite sur toute la terre, toi qu’aucune tempête de la fortune ne détournera de ses voies abandonnées, ô Caton, dirige mon esprit chancelant, affermis par ta force mon courage incertain[90]. Il fallait dire labantem firma, dubium dirige : car on ne dirige pas ceux qui chancellent, on les soutient ; de même on n’affermit pas les incertains, on les dirige. Il est vrai que Lucain, dont les habitudes étaient peu sévères sur la propriété des mots, donnait peut-être au mot labantem le sens du mot dubium, et réciproquement. 2. L’inspiration donne la mort aux prêtresses d’Apollon : Car la structure humaine se dissout sous l’aiguillon et le flot de la fureur divine, et l’impulsion des dieux ébranle ces âmes fragiles[91]. Vous devez être frappé de la confusion et du peu de lien de cette triple action des dieux sur la prêtresse : cet aiguillon, ce flot, cette impulsion, jurent ensemble ; l’aiguillon surtout, et le flot, qui n’ont qu’un verbe à leur service, labat, lequel ne peut convenir à l’un qu’autant qu’il ne convient pas à l’autre : ici il ne convient ni à l’un ni à l’autre. Au reste, cette accumulation de mots métaphoriques qui s’excluent est précédée par deux vers admirables de précision et de mélancolie. Je les cite avec plaisir : Car si le dieu descend dans une poitrine humaine, une mort prématurée est la peine ou le prix de cette visite mystérieuse[92]. 3. Détails des causes générales de la guerre civile. Tels étaient les mobiles des chefs ; mais sous ces mobiles se cachaient ces semences publiques de guerre, qui abîmèrent toujours les nations puissantes[93]. Semina et mersere ne vont guère ensemble. Qu’est-ce que des semences de guerre qui submergent des peuples ? 4. Apothéose de Pompée. Mais les mânes de Pompée ne restèrent pas ensevelis dans ce bûcher égyptien ; un peu de cendre u n’apaisa pas une si grande ombre[94]. Cette traduction très mauvaise, comme toutes celles que j’ai faites, n’a pas éclairci ce qui ne peut pas l’être. C’est d’abord par pure complaisance que j’ai traduit favilla par bûcher ; la signification propre c’est cendre du bûcher, c’est cette même cendre que Lucain appelle de son vrai nom cinis dans le vers suivant. La métaphore commence par des mânes qui ne sont pas ensevelis dans la cendre d’un bûcher, et finit par la cendre d’un bûcher qui ne suffit pas pour apaiser une grande ombre. C’est un désordre d’esprit et d’imagination, qui peut s’analyser d’autant moins qu’il se sent mieux. Un vers plus loin, cette même ombre de Pompée, par une nouvelle figure tout aussi peu exacte, sequitur convexa Tonantis, suit les demeures circulaires de Jupiter, par un vol particulier à Pompée apparemment ; car il n’est donné à personne, oiseau ni âme, de sequi convexa : on monte vers l’empire. Itur ad astra, comme dit Virgile ; en monte, on va ; on ne suit pas. Lucain change toutes les allures, celles des vivants comme celles des morts. Je, termine ici cette critique de détails. Il serait aisé de multiplier les exemples ; mais un luxe de preuves serait déplacé dans une matière où beaucoup de lecteurs aimeraient mieux croire le critique que d’y aller voir. VIII. De deux défauts propres à Lucain. Deux défauts généraux, en apparence contradictoires, me semblent caractériser le style de Lucain Le premier, c’est le luxe des combinaisons de mots ; Le second, c’est le manque de variété. Comment un style luxuriant peut-il être monotone ? Comment, là où les combinaisons de mots abondent, n’y a-t-il pas diversité ? Je tâcherai de l’expliquer. Les exemples que j’ai cités me laissent peu à dire sur le premier de ces défauts. Jamais langue ne fut plus chargée que celle de Lucain. Jamais riche vocabulaire ne fut plus profondément remué par un écrivain. Pour peindre un objet, non seulement Lucain épuise toutes les dénominations de cet objet, mais encore il en imagine de nouvelles. Sa langue contient toutes les synonymies des mots, en plutôt il n’y a pas de synonymies dans sa langue ; car de choses identiques il fait des choses différentes ; il invente des feux sans flamme et des flammes sans feu ; il imagine des astres à queue qui ne sont pas des comètes, et des comètes qui ne sont pas des astres à queue. Un bûcher, c’est pour lui de la cendre d’abord, puis du bois, puis du feu, puis des flammes ; mais ce n’est jamais toutes ces choses à la fois. La mer, c’est l’eau, puis l’eau profonde, puis la vague, puis le flot, puis les abîmes salés ; jamais l’ensemble de tout cela : Chacune des qualités de la substance devient substance elle-même, avec des qualités à part, le plus souvent insaisissables, comme toute nuance qui n’est qu’imaginaire. Certes, si Lucain avait autant d’idées qu’il emploie de mots qui en ont le semblant, ce serait à la fois le plus riche de tous les écrivains et le plus fécond de tous les penseurs. Si même toutes ses synonymies exprimaient des nuances réelles, il lui resterait encore le mérite rare d’être un peintre d’une touche délicate ; mais ces idées ni ces nuances n’ont jamais existé ni dans la réalité ni dans l’imagination du poète. C’est un fruit de sa mémoire qui lui fournit les mots avant que sa raison ou son cœur lui aient envoyé les idées ; c’est de là que lui vient l’abondance stérile, comme l’a très bien nommée Boileau, lequel n’aimait pas plus cette façon de faire qu’il ne la pratiquait. L’horreur même de Lucain pour l’imitation a été, en mille endroits de son poème, la cause de ses bizarreries. Ne voulant rien prendre à la langue d’Auguste, et n’ayant le plus souvent à dire que ce qu’elle avait déjà dit, il a fallu qu’il bouleversât toutes les formes reçues, qu’il essayât de tout, qu’il mêlât le vieux au neuf, le patois de province au pur langage de la métropole, pour cacher aux autres ou pour se dissimuler à lui-même qu’il passait par où d’autres avaient passé. Dans ses batailles, par exemple, lesquelles sont nombreuses[95], il fallait bien, quoi qu’il fit pour l’empêcher, qu’il eût des harangues guerrières, des traits de courage, des morts comme dans Homère et Virgile ; et quoique César ne se battit pas comme Achille ni comme Énée, les différences ne sont pas telles dans les modes de s’entre-tuer dont se servent les hommes, que Lucain pût faire des batailles de nouvelle invention sans ressemblance avec les batailles de ses devanciers. Il y a d’ailleurs, dans toutes les armées et dans toutes les batailles, des passions invariables qui animent de la même façon les hommes chargés d’exécuter ces hautes œuvres de la civilisation, ici compagnons de guerre d’un usurpateur, là citoyens combattant pour leur pays, tantôt armés par les religions, tantôt par les maîtresses des princes, et qui font avec le même cœur et pour le même prix les plus nobles comme les plus fâcheuses besognes. Or, il fallait, de gré ou non, que Lucain repassât par ces invariables passions, par les hontes après la défaite, par les joies bruyantes après la victoire, par les révoltes, par les souffrances du soldat, invariables, hélas ! comme ses passions, quel que soit le chef qui le mène au combat. Mais déjà les grands poètes de la Grèce et de Rome avaient représenté au vif ces scènes de la vie humaine. Homère surtout, le peintre de toutes les situations, avait été le poète des armées ; Virgile, dont le petit champ avait été donné aux vétérans des guerres civiles, Virgile, qui avait pu voir tout enfant l’avidité de ces vieux compagnons se jetant sur les biens de leurs compatriotes, et se gorgeant de ce pillage autorisé et légal, Virgile avait ajouté d’admirables détails aux grandes peintures d’Homère. Que restait-il à faire à Lucain ? Imiter ou faire du neuf à tout prix. Imiter, il était trop fort et trop vain pour cela ; il fit donc du neuf à tout prix. Mais comme on ne fait pas, même à. tout prix, du neuf dans les idées, il en> dans les mots. De là tant de bizarreries dans les peintures de ses armées. Pour ne pas ressembler à ceux d’Homère et de Virgile, les soldats de Lucain ne sont pas des hommes. On a vu comment ils meurent : leurs morts, pour être plus terribles que dans Homère et Virgile, ne sont qu’invraisemblables. Ils tombent du haut de leurs mains ; ils ont des âmes qui se partagent en deux par l’effet des javelots, et des morts qui se répandent sur leurs blessures ; s’ils se tuent pour échapper à l’ennemi, leur mort étant leur œuvre, la mort en général n’a aucun mérite à leur destruction. . . . . . Minimumque in morte virorum Mors virtutis habet[96]... Ce n’est pas leur main qui pousse le fer contre leur gorge, c’est leur gorge qui pousse le fer contre leur main. Ils ont les plus étranges sentiments du monde, les Pompéiens surtout, dont Lucain aime mieux faire des stoïciens que des braves. Les Pompéiens, à Pharsale, souffrent la guerre civile ; les Césariens la font. Dans la main des Pompéiens, l’épée est froide et reste la pointe en l’air ; dans celle des Césariens, l’épée est chaude de sang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civilia bella Una
acies patitur, gerit altera : frigidus inde Stat gladius, calet inde nocens a sanguine ferrum[97]. Ils ont des alliés qui, au lieu de tirer droit leurs flèches, les lancent dans les airs, comme les enfants qui jouent à l’arbalète ; seulement les flèches, en retombant, donnent la mort ; ou plutôt, les trépas tombent d’en haut. Inde cadunt mortes[98]... Ils tuent ainsi, pour qu’il n’y ait pas crime à tuer. Car ces alliés sont ceux de Pompée ; et quoique Arabes, Ituréens et Mèdes, ils sont si nourris de stoïcisme, qu’ils ne veulent pas que ce soient eux qui tuent, mais leurs flèches. Ils se bornent à faire innocemment une nuit tissue de traits. Mais du côté de César, tout est crime : les vainqueurs de la Gaule tuent pour le plaisir de tuer. C’est le plus souvent pour faire du style, que Lucain défigure ainsi et métamorphose les caractères les plus simples, les situations les plus connues, les passions les plus générales. On ne l’entend pas toujours, parce qu’on veut trouver dans son poème autre chose que des effets de mots. Avec Lucain et les poètes de son époque, il faut se laisser payer de mots par le poète qui s’en est payé lui-même. Ils vont du mot à, la chose, et non de la chose au mot. Ils doutent avec les expressions qui servent à affirmer, et affirment avec celles qui servent à douter ; ils font des vers sans pensée, comme Vertot faisait un siège sans faits. C’est le mécanisme du vers qui décide s’ils pensent ce qu’ils disent ; on dirait un jeu de hasard, où les brèves et les longues sont les dés. Le second défaut du style de Lucain, le manque de variété, est la conséquence naturelle et inévitable de ce faux luxe. Ce qui rend Lucain monotone, malgré toutes les innovations qu’il impose à la langue du siècle d’Auguste, c’est que le procédé de ces innovations est toujours le même. Dans les choses que Lucain traite de seconde main, c’est-à-dire dans les trois quarts de son poème, ce procédé ressemble à celui d’un homme qui, ne voulant pas passer par où tout le monde passe, retournerait toute la terre du chemin, pour cacher sa trace quo ne s’en verrait que mieux. Il développe ce qui doit être court, abrége ce qui voudrait être développé ; il obscurcit les choses les plus claires, pour les faire trouver profondes ; il rend étrange ce qui n’est que commun ; il fait soupçonner un sens détourné et délicat là où il n’y a aucun sens ; et cela lui réussit auprès de plus d’un commentateur. Celui qui fait profession d’interpréter les écrivains de l’antiquité, n’ose pas prendre sur lui d’y trouver des choses inintelligibles ; d’abord par respect pour ces écrivains, ensuite pour le cas qu’il fait de sa propre sagacité. Et si tel passage est impénétrable ; il en accuse des interpolateurs imaginaires ; il raille l’ignorance des copistes. Lucain avait écrit : Quid jam rura querar totum suppressa per orbem. Les commentateurs de crier : Haro sur les copistes. Il s’agit bien de rura ! Que signifient des campagnes supprimées ? C’est farra qu’il faut lire. On accapare des farines, on ne supprime pas des campagnes. Mais, dans les choses qui sont de l’invention propre de Lucain, sa langue est énergique et originale. Il est grand poète, si de beaux détails suffisent pour faire un grand poète. C’est la politique ou la philosophie stoïcienne qui lui inspire ses plus beaux passages : j’en ferai l’objet d’un chapitre spécial. Cette monotonie du procédé, dans Lucain, se communique à la partie la plus extérieure de son style, aux sons, et, si je puis parler ainsi, à la physionomie de sa langue : car l’oreille et la vue ont plus de part qu’on ne pense dans les impressions qu’on reçoit de la poésie. Dans Virgile, dans Horace, dans Ovide, dans ce dernier avec quelques négligences de mauvais exemple, la variété est l’essence même du style ; et l’on pourrait plutôt dire ce qu’elle n’est pas, que ce qu’elle est. Virgile surtout, le plus grand et le plus profond artiste de cette époque, y est sans égal. Il n’est pas de poésie qui ménage avec plus de délicatesse l’attention humaine, si prompte à se lasser, et qui intéresse plus les yeux et les oreilles aux plaisirs de l’âme. L’art s’aperçoit sans doute dans ces délicieuses combinaisons de langage ; aussi, beautés pour beautés, peut-être préférerais-je à cette muse ingénieuse la muse naïve d’Homère, à cette science de l’harmonie le chant qui sort de la bouche des poètes primitifs, harmonieux comme la voix des vents et de la mer, grand comme les bruits que fait entendre Jupiter dans l’immensité de l’Olympe. Mais la comparaison n’est pas entre Virgile et Homère ; elle est entre Lucain et Virgile. La variété de Virgile, la science si sûre et si cachée de ses coupes, toutes ces délicatesses de l’art virgilien lui venaient de son propre fonds. L’harmonie de Lucain lui venait d’autrui. Virgile compose dans la solitude. Une sauvagerie douce, mais très jalouse, le tient éloigné du public. Auguste est venu plus aisément à bout des farouches meurtriers de César, que de ce jeune homme blond et candide qui rougit aux avances impériales, par modestie de jeune fille, disent les courtisans, par pudeur d’homme de génie, selon moi. On l’a rattaché au nouvel ordre de choses, parce qu’il est trop occupé d’art, pour faire la différence d’un gouvernement avec un autre gouvernement, d’un empereur avec un consul. Il vient à la cour, où il est traité avec honneur ; on lui rend ses champs et on rebâtit sa maison ; mais personne ne peut se flatter d’être le maître de son âme ; et toutes les fois que la cour et la mode ont cru le tenir, il a glissé d’entre leurs mains. C’est sa muse qui est cette vierge dont on fait de si agréables railleries, mais dont Auguste lui-même n’a eu après tout, pour toutes faveurs, que quelques hémistiches brillants, où la flatterie n’est que de l’admiration exagérée par la reconnaissance. Quant au public, Virgile ne s’y mêle point ; il laisse les lectures publiques à quelques poètes de peu de valeur, et il sait tenir pendant des années ses poésies cachées à tous les regards. Virgile n’écrit que ce qu’il sent, an lieu d’écrire avant de sentir, ce que font les poètes raffinés des époques de décadence. Il est affecté de ce qu’il peint ; il est ému par les spectacles qu’il décrit et par les passions qu’il chante ; il va du sentiment à l’expression. S’il fait de l’harmonie imitative, s’il fait trembler et gémir les profondes cavités du cheval de Troie, ou crier les dents de la scie aiguë, c’est que ces bruits ont déjà retenti dans son imagination avant de se répercuter dans des mots expressifs. Il n’y a tant de vie et de chaleur dans ses descriptions, que parce qu’il en est le témoin oculaire, et qu’il y assiste avec toute la surprise et toute la vivacité d’émotions d’un spectateur. Son harmonie est pleine de variété, parce qu’elle suit le mouvement de son esprit, lequel est tout à la fois varié comme l’esprit humain, et fécond comme les esprits supérieurs. Sa césure change à chaque instant, ses coupes se transportent tour à tour, et sans efforts, à tous les endroits du vers, parce qu’elles s’harmonisent avec toutes les inégalités de l’haleine poétique tantôt longue et abondante, tantôt pressée, tantôt tranquille et régulière. Toutes les prosodies citent de lui des vers dont la composition syllabique représente sinon l’aspect des objets, du moins le bruit qui leur est particulier, et d’autres, qui, soit par le rapprochement de voyelles douces, soit par le cliquetis de consonnes énergiques, en représentent les propriétés ou le caractère. Ces exemples sont nombreux dans Virgile ; mais il faut remarquer qu’ils consistent en un vers, en deux très rarement, ce qui prouve qu’ils ne sont pas un jeu à froid, mais un sentiment, un souvenir qui n’occupe qu’une place proportionnée, et que le poète ne refroidit pas en le développant. Virgile n’appartient ni à la cour ni au public ; Lucain appartient à tout le monde. Où est Lucain à cette heure du jour ? Chez Sénèque. — J’y cours : il est chez Néron. — Non. Alors il est au Capitole, assistant en sa qualité de consul à la fête de Jupiter. — Je vais au Capitole ; Lucain fait une lecture chez Calpurnius Pison. Jamais Lucain n’est chez lui ni à lui. Néron, en le disgraciant, lui a rendu sa solitude, mais hélas ! il n’a eu que quelques jours de recueillement, et c’était pour mourir ! Il n’a eu de solitude que pour arranger le drame de sa mort, dans ce temps où l’on mourait avec des poses choisies, et où le dernier soupir s’exhalait parmi des sentences et des vers. Jusqu’à sa mort, Lucain a été tout à tous, exploité, admiré, gâté par un public plus curieux du bel esprit qu’amoureux de véritable poésie. Ce public prenait les poètes des mains du déclamateur à la mode, les usait avant l’âge en tours de force et en gentillesses, puis les renvoyait, comme Stace, épuisés et chagrins, inquiétés par des retours tardifs de goût, et par la crainte que cette gloire, dont on les avait tant flattés, ne fût que fumée. Lucain, ainsi exploité, n’a donc rien en propre. Il pense en public et tout haut ; il écrit en public et avec la main de tout le monde. L’harmonie de ses vers n’est pas l’image de sa pensée. Ce sont des sons combinés pour un auditoire. Lucain, n’écrivant que pour lire, n’écrit que comme il lit. Là surtout est la cause la plus sensible de sa monotonie. Vous avez sans doute entendu des poètes lire leurs vers en publie. Chaque poète a un ton particulier, lent ou rapide, sourd ou clair, selon la nature de sa voix et le caractère de ses poésies. Ce ton est d’ordinaire uniforme. Quand on est accoutumé à composer la veille pour la lecture du lendemain, quand on ne garde rien pour son tiroir secret, comme au temps d’Horace[99], on ne songe qu’aux effets qu’on produit à la lecture, aux césures et aux suspensions qui font bien, aux chutes qui appellent les applaudissements et les baisers. On n’écrit avec soin que ce qui sera lu avec succès i et au lieu que, dans l’art de Virgile c’est le sentiment du poète qui se manifeste par des paroles harmonieuses ; dans le procédé des poésies lues en public, c’est la mémoire des choses applaudies qui inspire les vers. . Quelque chaleur que le poète mette à sa lecture, il n’échappera pas à cette espèce d’intonation uniforme dans laquelle on retombe, bon gré mal gré, après chaque phrase, si on lit mal ; après chaque paragraphe, si l’on a appris l’art de lire. Il y échappera bien moins encore, si c’est la mode de son temps de chanter en lisant, de se dandiner dans la chaire, de manière à imprimer à sa voix le balancement de son corps. Or, il parait qu’on lisait de cette façon du temps de Lucain, et plus tard même Quintilien se plaignait que cette détestable mode eût prévalu contre tous ses avis. La conséquence de tout cela, c’est que le poète affectait, en composant, un certain refrain de prédilection, qui revenait aussi uniformément que l’intonation dans la lecture. Ainsi faisait Lucain. Le refrain de Lucain, c’est une phrase finie oit suspendue à la césure du troisième pied. Par exemple : Æger
quippe moræ, flagransque cupidine regni, Cœperat
exiguo tractu civilia bella Ut len | tum dam | nare ne | fas[100]... Non
iratorum populis urbique Deorum est Pompei | um ser | nare ne | cem[101]... Cladis
eo dedimus, ne tanto in tempore bellum Jant posset civile geri[102]... . . . . . . . . . . Dum munera longi Explicat
eripiens ævi, populosque ducesque Constituit
campis : per quos tibi, Roma, ruenti, Ostendat quant magna calas[103]... Non jam
Pompeii nomen populare per orbem, Nec
studium belli ; sed par quod semper habemus, Libertas et Cæsar erunt[104]... Omne
malum victi, quod sors feret ultima rerum ; Omne nefas victoris exit[105]... Advenisse
diem, qui fatum rebus in ævum Conderet
humanis, et quæri Roma quid esset, Illo
marte palam est : sua quisque pericula nescit, Attonitus majore meta[106]... Ce vers brisé au troisième pied est le vers favori de Lucain. C’est l’hémistiche à effet ; c’est à cette césure que le poète s’arrêtait, soit pour reprendre haleine, soit pour recueillir les murmures approbateurs. Tous les exemples que je viens de citer sont des traits, et ce qu’on appelle des idées, par opposition aux choses qui n’en veulent pas faire l’effet, et qui souvent en méritent davantage le nom. Toutefois, ce n’est pas seulement pour ses idées de choix, pour ses traits applaudis, que Lucain réserve cette phrase suspendue dont la chute est si pleine de promesses. Il la prodigue ou plutôt il y retombe involontairement ; on la retrouve souvent dans trois vers qui se suivent ; mais comme cette coupe paraît plus spécialement affectée aux choses d’éclat, quand on la trouve là oit elle n’a rien à faire valoir, elle est la pire sorte de négligence, une négligence qui sent l’apprêt. Quoi de plus disgracieux, par exemple, que d’employer les promesses de cette coupe dans des passages comme celui-ci ? . . . . . Cornus tibi cura sinistri, Lentule,
cura prima, quœ tutu fuit optima bello, Et quarta legione, dater[107]... Ce qui caractérise l’emphase, en poésie, c’est moins encore la recherche des idées, et l’appareil des mots, que ces détails insignifiants pour lesquels on fait, comme dans cet exemple-ci, la double dépense d’une apostrophe et d’une suspension. Outre ce refrain qui rend très pénible la lecture de la Pharsale, il y a deux autres formes que Lucain fait revenir très souvent, et qui, pour avoir moins de prétention, n’en contribuent pas moins à la monotonie du poème. Ce sont de longues tirades sans rejets, où les vers tombent un à un, comme si le poète était tout essoufflé ; puis une espèce de vers où le substantif forme invariablement le sixième pied, et l’adjectif, qui lui sert d’épithète, le second. Exemples : Immittit
subitum, non motis cornibus, agmen... Non
bene barbaricis unquara commissa catervis... Incaput
effusi calcavit membra regentis... In sua conversis præceps ruit agmina frenis[108]... Sur huit vers que je prends au hasard, en voilà quatre où cette sorte de balancement, insipide à la longue, se fait sentir. Passe encore quand l’épithète et le substantif n’ont pas la même consonance finale ; mais quand cette espèce de rime a lieu, cela fait une sorte de faux-bourdon qui assourdit. Les tirades sans rejets sont très fréquentes dans la Pharsale. Lucain n’a pas l’art de la période poétique. Sa phrase est ou lâche ou tendue, tantôt se traînant péniblement de vers en vers, tantôt suspendue uniformément, au même pied ; quelquefois arrêtée à chaque incidente, quelquefois à chaque mot. Il y a des exemples, dans Lucain, de vers coupés par quatre ou cinq virgules, comme par compartiments symétriques, ce qui leur donne un air sautillant, tout à fait en désaccord avec les idées, qui sont presque toujours guindées et sentencieuses. Assurément, on rencontre toutes ces formes de style-là dans les belles poésies du siècle d’Auguste ; mais elles y sont ménagées avec un art délicat, et loin de se succéder uniformément, elles se relèvent l’une par l’autre ; les rejets courent tour à tour d’un pied à l’autre, avec grâce, variété, harmonie. On n’a pas là l’idée d’une manière, d’une façon de faire particulière, parce que toutes s’y trouvent, et chacune où elle convient le mieux. il n’y a que dans les poésies raffinées, dans les poésies de décadence qu’on remarque une manière exclusive, une habitude, soit système, soit paresse. J’imagine que le sentiment de cette monotonie qui est propre à la prose de Sénèque comme aux vers de Lucain, est une des causes qui ont rendu Tacite si soigneux de la variété dans le style, et qui le font tomber dans l’inconvénient de dépayser les esprits par peur de les ennuyer. IX. Différences entre la période de Virgile et la tirade de Lucain. Rien ne ressemble moins à la période de Virgile que la tirade de Lucain. La période de Virgile est d’un mouvement doux, égal, évitant les effets, les choses trop fortement accusées, tout ce qui peut altérer la pureté des lignes et inquiéter la vue ; elle s’arrondit sans s’enfler, elle court sans se mettre hors d’haleine. La tirade de Lucain est lourde, inégale ; elle a tous les défauts des écrits capricieux et rarement leur grâce ; elle est âpre ; elle rompt les horizons, elle brise les lignes, et se plait à dérouter l’œil : si elle marche, c’est d’un pas ambitieux ou incertain ; si elle court, la voilà sautillante et haletante ; elle s’allonge croyant se grandir ; elle crève pour vouloir être trop pleine. C’est tantôt un cheval vicieux, qui a des mouvements brusques, inattendus, des réactions sans motifs, qui marche avec inquiétude, de telle sorte que jamais le cavalier ne peut se lier au cheval ; tantôt un animal lent, lourd, n’ayant qu’une allure et qu’un pas, faisant sa tâche de porter l’homme, comme une bête de charge, n’obéissant ni ne résistant. En lisant la Pharsale, ou bien la pensée du lecteur est à chaque instant déroutée ; elle cherche çà et là celle du poète, elle la poursuit, elle veut s’y lier, comme le cavalier au cheval, mais sans y parvenir ; ou bien elle chemine d’un pas assez égal, sans choc ni heurt, mais aussi sans intérêt ; de telle sorte que le lecteur et le poète restent indifférents et comme étrangers l’un à l’autre, ce qui arrive dans tous ces endroits de la Pharsale où Lucain n’a ni le piquant des choses bizarres, ni l’éclat de ses qualités, ni celui même de ses défauts. Les mêmes observations s’appliquent aux poètes contemporains de Lucain, avec quelques différences qu’il n’est peut-être pas inutile de caractériser. Je procéderai par rang de date. X. Du style des tragédies dites de Sénèque. Le style des déclamations en vers de Sénèque, vulgairement appelées Tragédies, aurait dû être caractérisé avant celui de Lucain, qui procède de son oncle, et qui l’a eu pour guide et pour maître dans cette voie fausse où toutes les corruptions politiques et sociales réunies avaient jeté la belle langue de Lucrèce et de Virgile. Mais l’importance de l’œuvre a déterminé les rangs bien plus que le hasard de la priorité, et la Pharsale a d’ailleurs un mérite d’originalité, même comme style, que n’ont pas les tragédies de Sénèque. La poésie de Sénèque est le fruit de toutes ces corruptions mêlées ; c’est le mauvais langage de tout le monde ; l’ingénieux, l’esprit de mots, les combinaisons plus bizarres que hardies à un certain travail d’alliage plutôt qu’une refonte puissante de la langue. On ne peut pas dire d’un tel poète. Quel dommage qu’if ne soit pas venu à une époque où les belles intelligences n’étaient point perverties par la contagion universelle, mais pouvaient encore se communiquer, dans un langage naturel, à une société saine et éprise du beau. ! C’est un regret qu’il faut réserver pour Lucain, lui qui, un siècle plutôt, aurait eu si peu à faire pour être un grand poète, et qui, un siècle plus tard, n’a été qu’un illustre exemple de l’influence d’une époque gâtée sur les plus riches natures poétiques. Dans les poésies de Sénèque, il n’y a pas cette forte originalité de Lucain, qui domine quelquefois le mauvais goût de son temps, et qui laisse apercevoir son vigoureux naturel sous les défauts de son éducation. Seulement, parmi des innovations qui ne sont pas toutes malheureuses, et qui veulent donner à la langue la précision des aphorismes de la philosophie stoïcienne, on y remarque quelques pâles imitations de la poésie des âges précédents, et ces centons qui témoignent des premières études de l’a jeunesse. C’est une sorte de plagiat que Lucain avait tout à la fois la force et l’orgueil de s’interdire ; il aimait mieux risquer son goût que son indépendance, et, là où il était forcé de repasser par les idées de ses devanciers, il remplaçait audacieusement les belles formes de leur langage par des remaniements téméraires, mais parfois éblouissants, qui pouvaient faire hésiter les esprits d’un goût incertain entre ses maîtres et lui. XI. Du style de Perse. Perse est nomme étouffé entre la stérilité de ses idées et l’ambition de son style. Souvent les idées lui manquent, souvent le style, souvent tous les deux ; il en résulte une langue étrange, inintelligible, qui n’est simplement qu’à lui. Dans Lucain, vous trouvez des traces de beau style, de ce style qui revêt la pensée, comme la draperie d’une statue antique. C’est qu’il y a dans Lucain des vérités générales, des choses dignes d’entrer dans le trésor de la connaissance humaine ; et comme jamais, à aucune époque, les langues ne manquent aux idées nécessaires ou seulement utiles, la sienne alors est naturelle : c’est à la fois la langue latine et la langue de l’humanité. Dans Perse, on trouve peu de poésie franche et naturelle, parce qu’il n’y a guère que des ébauches d’idées, et des mouvements ou images qui en veulent faire l’effet ; c’est un travail sur les mots, mais ce n’est pas du style. Perse provoque et sollicite tour à tour toutes ses facultés ; nais une seule lui répond : la mémoire. Les commentateurs, qui ne pouvaient se décider à trouver mauvais un monument de l’antiquité, voulant élever la valeur de Perse au niveau de sa réputation et surtout de son titre de poète ancien, se sont imposé un labeur à peu près semblable à celui de Perse, pour expliquer ses pensées ; singulière façon de l’honorer, que de s’envelopper d’énigmes plus impénétrables que ses vers ! Ils ont conclu de son obscurité qu’il devait être fort original, et ils ont fait dire tout ce qu’il leur a plu à ces formes vagues, entortillées, livrées dès l’abord à toute la subtilité des interpolations, voile opaque à travers lequel on voit tout ce qu’on veut. On ne saurait trop répéter qu’il n’y a d’obscurité que là où il n’y a pas d’idées, ou, ce qui revient au même, que des idées mal élaborées et qui ne sont pas venues à terme. Pour moi, Perse n’a eu le plus souvent que du bon vouloir comme penseur et comme écrivain. Esprit confus et inarticulé, si je puis dire, mais non sans une certaine force de volonté, Perse me paraît être, dans l’ordre littéraire, ce que sont, dans l’ordre physiologique, ces hommes privés de quelqu’un de leurs sens, qui tâchent d’y suppléer par de pénibles et convulsifs efforts de pantomime, sans jamais atteindre à cette expression pour laquelle il faut le concours des facultés et des sens. Rien ne sort pleinement et librement d’une telle intelligence ; Perse est un génie douteux qui n’a jamais pu secouer ses langes d’enfant ; il a voulu engendrer avant l’âge de puberté, et il est mort à cette tâche contre nature. Chose remarquable ! dans les temps où le poète n’est plus bon que pour la distraction des femmes de la cour, ou pour les lauriers des jeux pythiques institués par l’empereur, ou pour chanter la majesté et les façons clémentes du lion apprivoisé de César, on ne laisse pas à ces pauvres enfants le temps de grandir. On les force à produire à peine sortis de l’école, comme si le siècle avait de si grands besoins intellectuels qu’il fallût dévorer à l’avance les générations pour y suffire. Au contraire, aux époques où le poète est l’instituteur des nations, où la poésie et la philosophie ne sont qu’une seule et même Muse, où les vers ont toute la puissance et toute la réalité des lois, le siècle est patient. Il ne trouble point par une impatience indiscrète la chaste et. mystérieuse adolescence du génie ; il laisse se former lentement, et par le concours de toutes les expériences, ceux qui doivent être ses maîtres ; il ne -les couronne pas dès le berceau, pour qu’ils ne puissent pas échapper à cette vocation imposée ; mais, loin de là, il fait semblant de ne pas les voir, il les attend, et, quand ils paraissent, il les salue comme s’ils descendaient du ciel, ou comme si, à l’exemple des grands poètes de la Grèce, ils revenaient des pays lointains de l’Égypte ou de l’Inde, rapportant quelques trésors de ces contrées favorisées, les premiers et les plus riches dépôts de la poésie et de la sagesse humaines. XII. Du style de Silius Italicus. Silius Italicus est un poète bâtard, ni tout à fait de l’ancienne école, ni tout à fait de la nouvelle. Il n’a ni la force des beautés de la première, ni la force des défauts de la seconde. Écrivain facile, commun, n’étant empêché par aucune originalité, ni, soyons juste, par aucun amour-propre exagéré, de prendre, tantôt dans la langue de ses devanciers, et tantôt dans celle de ses contemporains, de quoi aider sa pâle imagination, Silius Italicus s’était mis modestement sous l’invocation des poètes du siècle d’Auguste ; et, de même qu’il leur avait consacré des sanctuaires avec un petit sacerdoce domestique entretenu à ses frais, il leur faisait le sacrifice quotidien de sa petite et honnête intelligence, mettant sa plus grande gloire à répéter leurs vers, et les pillant par respect. Mais comme la nouvelle poésie avait tous les honneurs à Rome et tout le crédit à la cour, Silius Italicus, aussi accommodant comme poète que comme homme politique, sacrifiait, comme on dit, au goût du jour. Toujours poète par la mémoire, il empruntait des hémistiches à ses contemporains et les cousait assez adroitement à ses imitations virgiliennes. Triste exemple, dès ce temps-là, de ces natures de poètes équivoques, faites pour l’abnégation et la transaction, qui flottent entre les différentes écoles, se teignant tour à tour, et selon l’à-propos, de la couleur dominante, mais sans réussir à se faire compter dans l’une ni dans l’autre. Disons pourtant, à l’honneur de Silius Italicus, qu’il ne faisait pas de ces transactions une affaire d’argent, .comme cela s’est vu plus tard, par un perfectionnement de la civilisation. Plus âgé que les jeunes poètes ses contemporains, dont les renommées rapides et bruyantes venaient l’inquiéter, dans sa riche solitude, sur le succès des poésies restées fidèles aux traditions du siècle d’Auguste, poète amateur plutôt que de profession, oisif qui honorait ses loisirs, tout ce que Silius Italicus pouvait vouloir tirer de ses concessions à la nouvelle école, c’était apparemment quelques baisers, reste de ceux dont on couvrait Lucain. Le style de Silius Italicus participe donc de l’ancienne et de la nouvelle école, ou plutôt n’appartient ni à l’une ni à l’autre ; car on n’est d’une école que par des beautés éclatantes ou par des défauts marqués d’une certaine force, et dans Silius Italicus il n’y a ni de ces beautés ni de ces défauts. Là où il écrit d’après l’imitation virgilienne, sa poésie n’est qu’une pâle copie, et c’est à peine si on lui sait gré d’être clair, sa clarté ne servant qu’à faire mieux voir la faiblesse de sa pensée. Perse peut du moins faire illusion, car pour beaucoup d’esprits, l’obscurité n’est pas toujours un mauvais calcul, et il y a des auteurs qui gagnent à n’être pas compris ; Silius Italicus ne peut tromper personne. La pauvreté de ses conceptions n’a pas su s’envelopper d’ambiguïtés spécieuses, et c’est un poète dédaigné en raison directe du peu qu’il a donné à faire aux commentateurs, lesquels mesurent assez ordinairement le mérite d’un auteur sur la peine qu’il leur a coûté. Là où Silius Italicus fait des concessions à l’école de Lucain et se prend de hardiesses soudaines, il n’a réussi qu’à être bizarre. C’est un écrivain hardi à la suite des autres : on dirait qu’il cède au cri public, ou que, voyant les lecteurs lui échapper sur un point, il veut les rattraper sur un autre : son plus grand mérite, peut-être, est la mauvaise grâce qu’il y met. Car Silius était un esprit sage, doué de jugement, très propre à goûter, sinon à continuer les belles poésies du siècle d’Auguste, et il est juste de dire que les trop rares beautés de ses Puniques appartiennent à l’école virgilienne. Il lui est arrivé çà et là, comme à tout homme de quelque aptitude littéraire, d’être bien inspiré par son goût, et de faire honneur à ses maîtres ; au lieu que ses concessions à la jeune école impériale, dont le principal mérite était le mépris de l’imitation, ne lui ont pas inspiré dix bons vers, même de la bonté imparfaite et contestable des morceaux de choix de cette école. XIII. Du style de Stace. Stace est un écrivain fort supérieur à Silius Italicus et à Perse. Stace et Lucain sont les deux poètes de cette période de la langue latine qui ont imaginé le plus de formes nouvelles, et ont eu le plus d’invention de style, hélas ! à une époque où cette espèce d’invention ne pouvait plus être que de peu de profit pour l’esprit humain. Seulement Stace et Lucain inventent tous les deux dans un esprit, sinon dans un procédé différent. La plupart de leurs innovations ne sont guère que des remaniements artificiels de langue, systématiques, non dans un mauvais dessein, comme se l’imaginent les critiques intolérants, mais par le noble besoin de, ne pas imiter. Pour tous les deux, l’indépendance consiste, là où ils se rencontrent avec les idées de leurs devanciers, à cacher l’imitation sous l’altération du langage, là où ils tirent de leur fonds, à plus donner aux mots qu’à la pensée, à se fier à la fortune bien plus qu’au goût, souvent à se payer de mots de la meilleure foi du monde, habitudes d’esprit que j’ai longuement analysées en traitant de Lucain. . Il y a cette différence entre Stace et Lucain, que la poésie du premier paraît être plus grave et celle du second plus spirituelle ; et cela tient à ce que Lucain était beaucoup plus près d’avoir du génie, et que Stace n’avait que beaucoup d’esprit. On dirait que Lucain charge la langue de Virgile, et Stace celle d’Ovide. Du reste, dans Stace comme dans Ovide, mêmes ressources ou à peu près de versification ; ni l’un ni l’autre ne faillit à dire ce qu’il veut en vers : mais la muse d’Ovide tire une certaine aisance aimable et naturelle de l’époque favorisée où il écrit. L’esprit est plus une qualité de l’homme chez Ovide, c’est plus une qualité de l’écrivain chez Stace. Ovide a plus d’esprit qu’il n’en fait ; Stace en fait plus qu’il n’en a. Dans l’un, c’est la pensée surtout qui est spirituelle ; dans l’autre, c’est plus souvent l’expression. Quand je lis Ovide, je cherche la pensée sérieuse qu’il a pu cacher sous ces formes faciles et légères ; je cherche si ce poète exilé de la cour n’a pas été disgracié pour une certaine indépendance philosophique bien plus que pour d’indiscrètes amours. Quand je lis Stace, je n’y soupçonne jamais d’idées utiles ni d’arrière-pensées indépendantes. Ce qui m’y intéresse, c’est seulement l’habileté de l’écrivain ; c’est, le dirais je, cette fatalité qui fait qu’un poète, qui ne nous apprend rien, qui n’est bon à rien, qui n’entre pour rien dans l’éducation de l’humanité, qui chante la chevelure d’un eunuque, un platane, le lion de César, a pourtant été dopé, à un degré élevé, de ces qualités qui, à certaines époques privilégiées, révèlent au poète les vérités d’un intérêt éternel, et lui suggèrent l’expression qui les fait durer. XIV. Du style de Martial. Le style de Martial lui appartient plus en propre, quoique par plus de sagesse que d’invention. Ce poète avait peu d’imagination : or, c’est surtout par les écrivains doués d’imagination que périssent les belles langues. Tant il est vrai que, quand la dernière heure d’une langue a sonné, non seulement tout est bon pour la détruire, mais que les plus propres à cette œuvre fatale sont ceux par qui les langues semblent, à d’autres époques, s’enrichir et se fixer. Martial, poète de goût, malgré tout son libertinage d’esprit encore plus que de mœurs, n’avait pas l’ardeur de nouveauté des poètes d’imagination, ni cette négligence propre à toutes les poésies ambitieuses. Ses petites pièces sont, pour la plupart, dans l’expression, timides et travaillées. Martial se souvenait des préceptes d’Horace ; il composait, selon la méthode de l’Épître aux Pisons, pour l’oreille fine de quelque Metius[109]. De là bon nombre de morceaux d’une facture excellente : Martial avait le génie de l’épigramme au degré où Boileau voulait qu’on eût le génie du sonnet. Que si Martial, au lieu d’être épigrammatiste, eût fait de l’épopée, nul doute qu’il ne se fût mis à la suite de l’ancienne école, comme Silius Italicus, mais avec plus de goût, et moins de recours au centon. La nature de son esprit le portait à continuer les maîtres ; il avait le sens de leur grande poésie ; il l’aimait et l’admirait ; et j’ai peut-être eu tort de ne pas indiquer, parmi les causes probables du silence réciproque gardé par Martial et Stace l’un sur l’autre, que Martial devait faire peu de cas des hardiesses de Stace ; et Stace de la correction de Martial. Au moment où écrivait Martial, il se faisait en poésie une sorte de réaction classique, si je peux me servir de ce mot tout moderne, dont il était le principal et le plus spirituel organe. On sentait la nécessité de revenir au simple ; Quintilien commençait à la prêcher ; la langue de Lucain pâlissait ; le siècle d’Auguste reprenait peu à peu l’autorité. Mais cette réaction fut stérile, parce qu’elle portait sur les mots seulement : et qu’importe qu’on se dégoûte du style bizarre, à une époque où il n’y a pas une croyance, pas une vérité qui puisse inspirer, en le rendant nécessaire, un style simple et grand ? Quintilien nous apprend comment il faut écrire ; que ne nous apprend-il plutôt sur quoi écrire ? Pourquoi ne nous donne-t-il pas, au lieu de la recette des bons styles, le secret des bonnes idées ? J’ai indiqué une première cause de la simplicité du style de Martial, c’est sa fidélité intelligente aux traditions de la poésie d’Auguste. Il y en a une autre : c’est la nature même des sujets qu’il a traités. Cette satire au petit pied, née des vices et dès ridicules monstrueux de son époque, n’est pas de la littérature purement d’imagination, comme sont les épopées de Stace, de Valerius Flaccus, de Silius Italicus. C’est de la poésie contemporaine des sujets qu’elle décrit et tenue à une certaine précision et à une certaine clarté qui en facilite l’intelligence à tous les témoins de ces faits. Dans les épopées que je viens de rappeler, les faits sont de pure invention. lis ne touchent personne au vif, et comme ce n’est ni un besoin de l’époque, ni une croyance, ni une passion, qui a déterminé le poète à les mettre en vers, il y suffit d’une langue vague, pourvu qu’elle soit à la mode. C’est en effet à une portion du public que tout cela s’adresse, faits et langue. C’est à un auditoire ambulant, qui se transporte d’une salle de lecture à une autre, toujours le même, qui s’est institué l’arbitre de la littérature, mais qui, en réalité, reçoit la loi de tous les poètes auxquels il croit la faire ; protecteur de toutes les innovations, et qui permet aux poètes de tout oser, pour se donner à lui-même le relief de tout comprendre. Martial n’écrivait pas pour cet auditoire disponible qui louait son admiration, comme les parasites leur appétit, à quiconque le mandait pour une lecture, et lui offrait des rafraîchissements. Le pauvre poète n’était pas assez riche pour subvenir à la location d’une salle, et d’ailleurs ses poésies n’étaient pas de celles qui se lisent en public ; elles sont à la fois trop courtes et de trop peu d’apparat, et ne comportent ni les éclats de voix, ni les suspensions préméditées, ni le geste théâtral, ni toute cette pantomime dont les faiseurs d’épopées accompagnaient leurs solennelles lectures : outre que ses petites satires pouvaient tomber à l’improviste sur quelques-uns de ses auditeurs. Par toutes ces raisons, il n’avait pas, comme ses frères en poésie, un publie à lui, public voué à sa manière, et mettant un intérêt d’amour-propre à soutenir ses fautes. Son public était pris dans toutes les classes et de tous les côtés, public indépendant, lisant pour son plaisir bien plus que pour des querelles d’école, et qui demandait un style simple, sans grands frais d’invention, populaire, et des vers qui pussent s’apprendre et se répéter comme des airs faciles. De là, de temps en temps, la simplicité de Martial, sa concision, sa clarté ; sauf un reste de barbarie espagnole, soit que les pièces gâtées par ce défaut soient plus près de son début littéraire, soit qu’à certains moments de paresse et de relâchement le naturel provincial reprît le dessus sur son éducation romaine. Mais les poètes qui ont plus de qualités que de défauts doivent être caractérisés par leurs qualités ; aussi est-il juste de ranger Martial parmi les poètes qui savent être originaux en restant fidèles à la tradition. Sa langue est de bon aloi, malgré quelques fautes qui lui viennent soit de son pays, soit de concessions faites au goût du jour, concessions d’autant plus choquantes qu’elles manquaient de cette tournure ingénieuse que les poètes d’imagination savent donner même à l’extravagance. Il n’y a personne de plus maladroit pour le langage de mauvais goût qu’un poète qui a plus de sens que d’imagination. Un poète d’imagination est du moins barbare avec esprit ; et cela peut faire illusion. L’esprit fait pardonner la barbarie : car, en poésie comme en morale, la façon nous rend coulants sur le fond. XV. Du style de Juvénal. Reste Juvénal et sa vigoureuse manière, j’allais dire sa brutale manière, car je ne sache que cette épithète qui rende toute ma pensée sur le style de Juvénal. Il y a de tout dans ce style si franc dans ses belles parties, si évidemment marqué de décadence dans son ensemble. J’y trouve le labeur de Perse, mais non pour cause d’impuissance, l’énergie téméraire de Lucain, l’affectation des formes grecques de Stace, la barbarie provinciale de Martial, le tour aigu et sentencieux de Sénèque, et aussi la simplicité et le nombre des poésies du siècle d’Auguste. C’est le style le plus original de l’époque de la décadence ; il semble que la langue latine ait fait un dernier effort pour se prêter au rude génie de son dernier poète. Juvénal a dû écrire tard. Sa jeunesse s’était écoulée dans les études de la déclamation, et il avait trop donné de temps à l’art de parler pour s’occuper de l’art d’écrire. Cette manière d’écrire ne sent pas le poète qui a fait des vers avant de revêtir la robe prétexte. Dans le style des poètes adolescents, on rencontre des réminiscences, et surtout des expressions vagues, par où se trahissent les études molles et l’habitude de se contenter des premières formes qui se présentent à l’esprit. Dans le style de Juvénal, tout est arrêté, tout est vigoureux ; il n’y a pas plus de jour entre les mots qu’entre les idées, tant le discours se presse, et tant les plans sont serrés. Point de phrases d’attente, point de chevilles, point de choses lâchées ; ce style pécherait plutôt par la roideur et le trop plein que par la négligence et le vide. Il peut y avoir des analogies entre la poésie de Juvénal et celle de ses contemporains ; il n’y a pas d’imitation. On n’y sent pas la mémoire des mots, par laquelle on imite ; à l’âge où Juvénal écrit, ou l’on n’a plus cette mémoire, ou l’on ne l’a pas du tout. De même, s’il s’élève jusqu’au style des anciens, il ne leur fait pas d’emprunt. Évidemment Juvénal n’avait pas fait d’études pour écrire. Rien n’indique dans ses satires qu’il fût un de ces poètes, comme Stace, Perse, Lucain, et les autres, instruits dès l’enfance à l’art des vers, et nourris pour les concours littéraires et les couronnes. Martial parle de lui, mais point comme poète ; Pline le jeune, qui connaissait si bien tous les poètes de son temps, et qui en a dressé une liste oit la postérité a rayé plus d’un nom, ne fait aucune mention de Juvénal. On ne sait quel motif le fit écrire. Les uns disent : la vertu. J’ai expliqué pourquoi j’en doutais ; peut-être n’est-ce qu’un violent esprit de contradiction qui lui mit, comme à Rousseau, un stylet à la main. Quoi qu’il en soit, son style ne marque ni la jeunesse de l’homme, ni l’éducation des lectures publiques ; il est venu au monde viril et original. Ce style n’a que deux phases : maturité et impuissance ; car ce talent si fort a des défaillances étranges ; c’est alors que Juvénal est déclamatoire sans être éloquent, haletant sans être chaud. Les endroits où le style de Juvénal est le plus franc, et où sa poésie est vraiment sœur de la poésie d’Horace, ce sont ses descriptions des vices monstrueux de son temps. Là où il touche, après Horace, à quelque vérité de la philosophie morale, son style n’a pas cette aisance noble, ce calme du discours socratique qui convient si bien aux choses de philosophie. Mais dans la peinture des saturnales dont il était le témoin, sa langue plus expressive et plus colorée que celle de Martial, est aussi précise et populaire. Il semble accomplir alors une sorte de mission ; il enrichit l’histoire des corruptions humaines ; il parle au nom de la morale épouvantée ; il, fait une œuvre nécessaire, et pour tout ce qui est nécessaire, pour tout ce qui peut servir à ce que je me suis permis d’appeler l’éducation éternelle de l’humanité, il n’y a pas d’exemple, je le répète, qu’une langue ait manqué au poète. La langue de Juvénal est alors aussi belle, aussi pure, aussi classique, que celle de Virgile et d’Horace. Tant qu’il reste encore quelque idée utile à glaner, après ces grandes moissons qu’on appelle les âges d’or des littératures, les langues les plus corrompues se purifient, les langues les plus épuisées rajeunissent pour revêtir de formes durables des idées qui doivent servir aux hommes. Au contraire, elles ne font rien pour ces œuvres de caprice, pour ces petites littératures de mode, nécessaires seulement pour alimenter l’espèce de curiosité littéraire propre à chaque époque, qui naissent d’une querelle d’école et meurent dans une querelle de commentateurs. Aussi, rayez de la langue latine l’Achilléide, la Thébaïde ou les Puniques, est-ce cette langue qui y perd ou seulement son vocabulaire ? Essayez, au contraire, d’en retrancher les vigoureuses peintures de Juvénal, et dites alors si la langue latine a payé toute sa dette au monde ? Pour moi, je ne le crois pas. XVI. De ce qu’on peut appeler les beautés dans Lucain et les poètes de son époque. Je ne ferai pas de théories sur la question du beau. On y a dépensé beaucoup d’érudition et d’esprit, sans la résoudre, c’est-à-dire sans donner du beau une idée assez nette et assez populaire, pour qu’on en fit naturellement le critérium des jugements littéraires. Le beau est un peu comme la vérité dont parle Pascal, vérité en deçà des montagnes, erreur au delà ; l’Allemagne le conçoit d’une façon, la France d’une autre. Je ne ferai donc pas la faute d’en essayer une définition alambiquée ; aussi bien, c’est un legs de l’ancienne critique qu’il faut laisser de côté avec beaucoup d’autres. Le mot beautés, quoique un peu trop abstrait, l’est pourtant moins que le beau, et il est plus facile de dire des choses nettes et évidentes sur ce qu’on peut entendre par des beautés poétiques, que sur ce que peut être le beau en poésie. Tenons-nous-en donc aux beautés. Après tout, c’est un mot adopté à peu près généralement, et j’aime mieux m’en servir, comme tout le monde, que de me donner le ridicule d’en imaginer un nouveau. Dans tous les ouvrages de poésie, on peut distinguer deux ordres de beautés, les unes exprimant des faits du monde extérieur, comme sont les beautés de description ; les autres représentant les vérités du monde moral, les pensées, les sentiments, et généralement toute notion, toute peinture de l’âme humaine. Cette distinction éclaircit déjà l’expression abstraite de beautés. Ne la surchargeons pas d’une distinction nouvelle entre les beautés de style et les beautés de pensée. Le style et la pensée sont tellement liés et nécessaires l’un à l’autre, qu’on ne peut pas concevoir le style sans la pensée, ni la pensée sans le style. Il y a, dans le travail mystérieux du poète, de telles affinités entre le fond et la forme, et quelquefois une telle simultanéité de la pensée et de l’expression, qu’on risquerait fort de se tromper en décidant si ce sont les choses qui sont venues les premières, ou si ce sont les mots. Nous avons donc deux sortes de beautés : Les beautés descriptives ; Les beautés morales. En ce qui regarde l’époque poétique qui fait le sujet de cet ouvrage, j’en ai dit assez sur les beautés de description. Le principal mérite, je le répète, des poètes de cette époque, c’est la description, quoique déjà ce ne soit plus la descriptions grands traits des poésies primitives, ni même la description savante, mais pourtant si simple encore et si expressive des poésies des grands siècles. Je remplirais tout un volume de morceaux pris dans Lucain et dans ses contemporains, où l’on verrait des ressources de langue infinies, et un luxe de nuances de style égal à celui des nuances d’idées. J’ai dit aussi ce que je pensais de ce genre de beautés ; parfaitement inutile à l’éducation de l’humanité, mais qui a pu donner d’agréables distractions au public littéraire de l’époque, et y susciter des querelles ingénieuses. On peut dire de ces beautés comme de certaines inventions, qu’elles n’ont qu’un temps ; ce temps passé, la vie s’en retire ; elles n’occupent plus, de loin à loin, que les philologues qui n’y voient que des questions de teste à éclaircir. Il en est tout autrement des beautés dans l’ordre moral. XVII. Des beautés dans l’ordre moral. Quoique réduite ainsi, la question est encore assez vaste ; car quoi de plus vaste que le monde moral ? Combien d’espèces de sentiments, combien de vérités philosophiques, combien de sortes de notions ne peut-on pas compter ? combien d’analyses à faire ? combien de nuances à exprimer ? Et comme chaque sorte d’idées, bien plus, chaque idée particulière peut donner lieu à une beauté, combien de beautés à distinguer ? Une première ; classification a déjà, je pense, facilité l’intelligence de ce qu’on peut appeler beautés ; je m’aiderai d’une seconde classification pour faire apprécier combien de sortes de beautés il peut y avoir. On peut compter, ce semble, trois ordres d’idées principales, sur lesquelles roulent toute poésie et, je puis dire, toutes les époques de poésie. Il y a les idées nécessaires, les vérités éternelles, qui vont à toutes les intelligences, à toutes les nations, à toutes les époques où brille non pas seulement la civilisation, mais quelque lueur de civilisation. Le monde ne peut les ignorer sous peine de périr ; elles sont le fond même de l’esprit humain ; elles dirigent tous les êtres pensants. Dieu nous a mis dans le monde avec ce fond ; et ce sont bien là les idées dont l’humanité ne peut pas se passer, parce qu’elle ne vit pas seulement de pain. Les hommes de génie, dans la poésie, sont ceux qui recueillent le plus de ces idées et les expriment dans le langage le plus simple et le plus populaire. Ils ont le dépôt de la sagesse humaine, ils tiennent le fil à l’aide duquel l’humanité sort des ténèbres des révolutions et de la barbarie, dont l’heure fatale arrive pour toutes les nations. Il y a, en second lieu, un ordre d’idées déjà moins élémentaires, et d’une autre espèce de nécessité que je vais définir. C’est toujours le même fond, mais avec des développements et des nuances que les civilisations, les différences de gouvernement, les variétés de mœurs et d’institutions sociales, y ont ajoutés. Elles sont nécessaires encore, car elles fleurissent aux époques de grandeur des nations ; seulement elles prêtent déjà à la contestation, parce qu’il ne suffit plus, pour les comprendre et y consentir, de l’assentiment involontaire de la raison ou de la sensibilité ; il y faut un certain temps de réflexion dont profitent le doute et l’esprit critique. C’est toujours la sagesse humaine, mais avec certaines parties d’erreur ou d’exagération que l’aiguisement des esprits et la diversité des intelligences ont mêlées à son pur dépôt. Cependant les poésies qui expriment ces idées paraissent un progrès sur les poésies dépositaires des premières, parce qu’en effet elles contiennent implicitement celles-ci, et qu’elles les ont complétées par des développements que ne comportaient pas les époques où les intelligences étaient plus simples. Ces poésies ont fait donner le nom d’âge d’or aux siècles qui les ont vues naître successivement, et par une sorte d’évolution périodique, dans les trois pays qui peuvent passer pour les trois grands chemins de la civilisation, je veux dire, la Grèce, l’Italie et la France. Enfin, il y a les idées particulières et locales qui tiennent au climat, au tempérament, à la nature du sang, vraies pour un Celtibérien, fausses pour un Germain, claires pour un Italien, obscures pour un Grec ; nées d’une mode, d’un tour d’esprit passager, d’un de ces caprices auxquels les peuples sont sujets comme les individus. Ces idées ne se peuvent pas peser dans la balance philosophique ; elles échappent à l’analyse, et flottent sur les confins du monde moral ; elles donnent à tel lecteur, et pas à tel autre, un certain plaisir peu réfléchi, dont on ne peut dire s’il est produit par la pensée ou par les mots, ni si c’est l’âme ou seulement l’oreille qui est affectée. Ces idées ne sont d’aucune utilité, si ce n’est peut-être pour les érudits, lesquels ne pourraient pas être érudits avec ce que tout le monde sait, ni avec ce qui sert à tous. . Aux deux premières classes d’idées, à la première exclusivement, à la seconde avec des restrictions déjà, se rattachent deux ordres de beautés qui s’adressent à tous les hommes, et sont saisis immédiatement par toutes les intelligences. A la troisième classe, et aussi à quelques unes des idées de la seconde, se rapporte une espèce de beautés qui s’adressent aux littérateurs seulement, aux curieux de style, qui aiment l’art pour l’art, et aux commentateurs, qui font profession d’en disserter. Vous trouvez les premières dans la Bible, dans les épopées religieuses d’Homère et de Dante, dans les drames de Shakespeare, dans ce que nous connaissons des grandes poésies primitives de l’Orient et du Nord. Là, elles sont naïves et simples comme des oracles descendus du ciel ; nul apprêt ne s’y fait sentir : elles ne sont pas nées de la réflexion, mais de l’instinct. Le poète n’a pas pensé qu’il fit des morceaux de choix ; il a rendu ce qu’il sentait. ; il a communiqué aux hommes ce qu’il recevait d’en haut. Vous trouverez ces mêmes beautés dans les littératures des grands siècles, et elles y sont ou simplement reproduites, dans d’autres idiomes, des poésies primitives, ou développées par l’art, mais sur le modèle de ces poésies. Vous y sentez quelque peu le travail et la préparation. Le poète des grands siècles a imité ses devanciers, parce que son goût lui a appris qu’il vaut mieux répéter certaines choses qu’y rien changer. C’est de l’inspiration où se mêle un peu de critique. Quand ; en outre, il a développé ces beautés ; quand, par exemple, à la peinture simple et sommaire d’une passion, d’un sentiment, il a ajouté des traits négligés par le poète primitif, alors vous apercevez le travail et je ne sais quelle adresse de mise en œuvre qui distrait votre esprit du fond même des choses pour l’occuper de la grâce de leur arrangement. Le poète sait qu’il fait un morceau choisi ; il s’y dispose longtemps à l’avance, et y dispose son sujet. On peut prédire un développement brillant ; les choses vous y mènent, mais par une pente si douce et si bien cachée, qu’on s’y voit arrivé avec autant de plaisir qu’au milieu de beautés inattendues. Toutefois, et malgré cette fine fleur que l’art a ôtée à la pensée du poète primitif, les grands écrivains des grands siècles sont aussi populaires, à compter les voix, que leurs devanciers. A première vue, même, leur popularité paraît plus choisie et d’un plus grand prix. Leur public a plus de culture ; si on ne les chante pas dans les fêtes, on les lit et on les médite dans la solitude ; ils entrent comme élément nécessaire dans toutes les éducations. Ce qu’il y a d’apprêt dans leurs beautés n’en empêche pas l’effet moral, mais, loin de là, le sert et l’accommode à plus d’intelligences. Au contraire, l’extrême simplicité des poésies primitives, l’étrangeté des mœurs et des époques qui leur servent de cadre, peuvent quelquefois en compromettre l’effet pour certains esprits qui sont trop de leur temps, et ne savent pas vivre dans tous les temps. Et comme on ne se donne pas volontiers le travail de découvrir des beautés qui ont négligé de s’annoncer, on appelle cette simplicité enfance de l’art, et on ferme un livre qui se recommande si peu. Les poésies des époques secondaires n’ont pas à craindre ce désappointement ; pour instruire et pour plaire, elles savent tous les chemins par où l’on arrive à toutes les intelligences, et elles s’arrangent toujours pour ne se compromettre avec personne. Ce n’est pas là d’ailleurs leur seul avantage sur les poésies primitives. Celles-ci encore manquent souvent leur effet pour être trop sommaires ; la force d’attention des hommes est si petite que souvent une beauté de premier ordre leur échappe, parce qu’elle n’a pas été préparée de loin, ou parce qu’elle est tout entière dans un mot. Les poésies des époques secondaires montrent plus longtemps la même chose à l’attention de l’homme, et la lui montrent sous plus de faces. De là, non seulement leurs beautés ne risquent pas de n’être pas vues, mais encore on leur en prête qui ne sont point dans leurs livres. N’en savez-vous pas dont c’est un crime de dire que tout n’y est pas beauté et perfection ? Enfin, en dernier lieu, cette espèce de beauté qui ne va qu’aux gens du métier, aux critiques, aux annotateurs, vous la trouverez d’abord dans les moins parfaits des écrivains des grands siècles, ou bien dans certaines parties négligées ou hasardées des plus parfaits ; et vous n’en trouverez guère d’autre dans tous les poètes des époques de décadence, dans les poètes alexandrins, dans Lucain et ses contemporains, dans les poètes de notre temps, avec des différences qu’il n’y a pas lieu d’indiquer en ce moment. Les poètes primitifs chantent. Les poètes des époques secondaires écrivent des ouvrages d’art et des morceaux choisis. Les poètes de la décadence font de beaux vers. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de morceaux choisis dans les poètes de la décadence. On en rencontre de fort beaux surtout dans Juvénal et dans Lucain, quoique d’une poésie inférieure à celle de leurs devanciers. Mais cela veut dire que les plus grandes et les plus réelles beautés des poètes de la décadence sont des vers isolés, et ce qu’on appelle, en termes de critique, des traits. XVIII. Du trait, considéré comme le beau des époques de décadence. Le trait, voilà donc le beau aux époques de décadence. Il n’y a plus là ou presque plus de ces magnifiques développements virgiliens, dont toutes les parties sont animées d’une égale chaleur, où l’image vient naturellement, sans être cherchée ni préparée ; où rien n’est sacrifié aux endroits saillants, où le langage ne fait jamais illusion sur la portée de la pensée. Le trait, c’est cette beauté piquante, mais équivoque, qui éveille le lecteur dans un morceau languissant. Dans le trait, quelque chose vous plaît et vous pique ; mais dites-moi si c’est l’idée ou si c’est le tour. Prenez ce trait et pesez-le : analysez ce plaisir que je ne nie pas, mais dont je vous défie de me rendre compte par la sensibilité ou par la raison ; comparez-y le plaisir que vous font les beautés poétiques de l’épopée primitive ou des grands siècles littéraires. Ici, c’est le sentiment d’une grande notion acquise, soit en morale, soit en philosophie, d’une vérité sentie et qui a passé dans notre intelligence, d’une lumière qui nous fait voir notre cœur. Là, qu’y a-t-il autre chose que le plaisir de surprise causé par un rapport singulier, par une heureuse combinaison de mots, une chute, une pointe ? Dans le poète des époques secondaires, le poème est fait pour le morceau choisi ; dans le poète de la décadence, le morceau choisi est fait pour le trait. Aussi, que de préparations pour l’amener ! de combien de négligences on le paye ! En effet, comme si le poète savait qu’il ne peut rien offrir de mieux que son trait final, il y sacrifie tout le reste. il vous fatigue de détails communs, de vers lourds, comme pour vous faire trouver plus de goût à son trait. Dans les poésies rimées, le trait est amené par des chevilles ; c’est le même procédé, ou à peu près, partout où la poésie est en décadence. Après tout, le trait, tel qu’il est, malgré l’admiration douteuse qu’il inspire, et le peu de résistance qu’il offre à la critique, le trait serait d’un effet agréable, surtout après des tirades de remplissage, s’il ne venait pas si souvent. Mais, dans le poète de la décadence, le trait vient à tout propos, au bout de chaque alinéa, de chaque tirade, comme le refrain d’une chanson. Plus le poète a d’imagination et d’esprit, plus il le prodigue ; et comme les traits sont comptés pour des beautés, cela fait dire quelquefois de certaines poésies qui en sont fortement relevées, qu’elles ont le tort d’être trop belles. C’est un mot plus naïf qu’ironique, et que j’ai souvent entendu dire de certains poètes contemporains très féconds en traits de ce genre, et qu’on blâmait doucement de se faire trop souvent admirer. Ln effet, aux premiers traits qu’on rencontre dans un livre de poésie, on est tout admiration ; s’ils se multiplient, l’admiration se refroidit, on ne persiste que pour ne pas se démentir ; s’ils sont tout le livre, on le met de côté, sauf à le trouver trop beau, comme tout à l’heure. La vérité est que des beautés dont on se lasse ne sont pas des beautés réelles ; l’admiration qu’elles inspirent ne dure pas plus qu’une surprise, tandis que l’admiration pour les beautés vraies est une douce chaleur qui ne s’éteint qu’avec la vie. C’est un sentiment où il entre plus d’égoïsme qu’on ne pense : nous n’admirons que ce qui nous profite, que ce qui ajoute à notre valeur intellectuelle ; mais toute poésie qui ne se résout pas pour nous en acquisition réelle n’est admirée que par respect humain, ou bien quelquefois par mode. XIX. Le trait est l’espèce de beau le plus goûtée par les jeunes gens. Le trait est un genre de beauté fort goûté de la jeunesse, alors que l’admiration n’est mêlée d’aucune pensée d’acquisition intellectuelle. Il y a certaines années vagues, entre l’adolescence et la première virilité, où l’esprit se repaît d’apparences, de couleurs, sans soupçonner rien au delà, et où son extrême mobilité, jointe à une curiosité excitée par toutes les restrictions et toutes les contraintes de l’éducation première, le portent à tout voir et l’empêchent de rien voir à fond. Ces années-là appartiennent au poète des époques de décadence. On goûte d’autant plus ses beautés équivoques, qu’on ne songe pas à en tirer profit. On demande des impressions et point des connaissances ; c’est ce qui explique comment de méchantes poésies semées de traits sont préférées à ces chefs-d’œuvre où l’inspiration n’est que la raison éloquente. L’esprit, à cet âge-là, glisse si vite et si légèrement sur les choses, qu’il faut, pour le fixer, agiter devant lui des lambeaux de pourpre étincelants ; sur des poésies profondes et recueillies, il passera en courant, sans se douter de ce qu’elles cachent. J’ai remarqué que, même pour les jeunes gens élevés dans l’étude de ces sortes de poésies, ce qui les y frappait le plus, c’est le très petit nombre de traits soit d’harmonie imitative, soit de grandeur exagérée, qu’une défaillance de la muse, une erreur de goût y a glissés. Les vers d’apparat, les beautés d’école, car il se mêle de ces paillettes de fer aux littératures des âges d’or, les charmaient. Quand on leur présentait des poésies de décadence, les croyant assez protégés contre les séductions de ces poésies par un bon fonds d’études classiques, non seulement ils y mordaient avidement, mais il semblait qu’ils missent dans ces admirations nouvelles l’ardeur d’esprits émancipés, qui secouent un goût de commande, et sont libres enfin de ne plus admirer sur parole. Rien de plus simple et de plus naturel. Des beautés équivoques doivent convenir à un âge incertain ; des hardiesses de style sont plus du goût d’un jeune homme qu’une vérité pratique qui est revêtue d’un style modéré. Les beautés de la poésie des grands siècles ne sont, le plus souvent, que de belles et populaires expressions de vérités universelles, de faits d’expérience ; on ne peut les accepter que sur la foi du maître, tant qu’on n’est pas arrivé à l’âge où l’on compare ses connaissances avec ses expériences. On a dit : comparaison n’est pas raison ; il y a quelque chose d’aussi vrai, c’est que raison est toujours comparaison ; donc, à qui n’a rien pu comparer, on ne peut pas faire goûter librement des beautés poétiques qui ne sont que l’expression de faits par lesquels il n’est pas encore passé. N’y a-t-il pas même quelque inconséquence à rendre juge de certaines notions sur le cœur un jeune homme qui n’a pas encore senti son cœur ; à faire apprécier de hautes vérités pratiques à celui qui n’a pas encore quitté la tutelle ; à parler de la vie à qui n’a pas encore vécu ? Nous ne revenons aux grands poètes qu’après avoir été, chacun dans notre petite sphère, et dans la proportion de notre sensibilité, les héros de leurs poèmes ; c’est-à-dire, après avoir aimé, haï, souffert, comme ces caractères généraux auxquels ils ont donné des noms d’hommes, et qui jouent dans leurs poèmes le drame de la vie humaine. Au sortir des écoles, nous sommes quelque temps séparés de ces maîtres, soit par d’autres directions, soit par des entraînements littéraires où nous jettent des génies équivoques. Mais après quelques années données à toutes les impressions, bonnes et mauvaises, quand nous apprenons enfin à nous régler, nous découvrons, à notre insu, entre ces premières expériences de la vie et les souvenirs des poésies apprises aux écoles, mille rapports délicats qui nous surprennent, nous piquent, nous intéressent, et qui finissent par nous ramener à ces maîtres du beau parce qu’ils sont les maîtres du bien. C’est alors que nos idées en littérature se forment et se fixent. Nous disons adieu aux poètes des époques de décadence et à leurs lambeaux de pourpre, et nous gardons nos loisirs pour les poètes primitifs, pour les poètes des âges d’or, pour ces génies d’élite qui ont exprimé, clans un langage immortel, les vérités nécessaires à la conservation et à la grandeur de l’homme moral, en quelque lieu et en quelque temps qu’il vive, soit seul, soit dans la famille, soit dans l’État. Si l’on me demandait à quoi peuvent servir les poésies de décadence, et leurs beautés douteuses, après que la critique en a tiré des notes pour l’histoire de l’art, je dirais : A faire aimer les poésies des grands siècles. Pour les esprits qui ne sont pas faux, admirer quelque temps les beautés des écrivains de décadence donne du ressort à leur imagination, excite en eux l’esprit de comparaison, et y produit à la fin une réaction de bon sens et de naturel au profit des belles poésies délaissées au sortir des écoles. Quant aux esprits faux, se traîner toute la vie sur les poésies des grands siècles ne les redresserait pas. XX. Exemples de traits dans Lucain. Je crois superflu de donner des exemples du trait. On peut ouvrir Lucain au hasard ; il n’y a presque pas une page de la Pharsale où l’on n’en rencontre. Tantôt ce sont des demi-vérités, des nuances à peine sensibles, des rapports tirés de trop loin, mais non faux pourtant, où il y a encore quelque idée sous les mots. Mais les exemples sont plus nombreux de passages où le style étouffe l’idée. Il n’y a pas d’analyse assez subtile pour séparer, dans l’impression que vous en recevrez, ce qui revient au style de ce qui revient à la pensée. On ne sait à quel ordre de produits de l’esprit peuvent appartenir certains vers de Lucain, bien que séduisants au premier aspect, soit par leur rythme, soit même par leur orthographe ; car il faut bien que ce soit par quelque chose qu’ils fassent illusion. Mais j’aime mieux citer quelques belles et profondes pensées auxquelles le trait n’a pas nui, à mon sens. Frapper fort n’est un défaut que quand on ne frappe pas juste. César, entré dans Rome, assemble dans le temple d’Apollon une troupe de sénateurs, dit Lucain, quoiqu’il ait dit ailleurs que le sénat tout entier avait suivi Pompée[110]. Cette ombre de sénat, convoquée irrégulièrement, sans l’ordre des consuls, est prête à donner à César tout ce qu’il pourra lui prendre fantaisie de demander, le trône, si c’est le trône, ou l’or des temples, ou la tête de ceux qui ont suivi Pompée. Heureusement César mit plus de pudeur à ordonner, que Rome n’en mit à obéir[111]... Pensée vraie et bien rendue : ici, la forme s’ajuste admirablement au fond. Il n’est que trop vrai qu’à certaines époques, et pour certains hommes que la fortune a couronnés, les peuples ne s’interdisent que les bassesses dont ces hommes n’ont pas besoin. Il faut remarquer que Rome veut dire ici, comme le mot peuple dans la réflexion que je viens de faire, cette partie de la nation qui transige avec tous les pouvoirs, qui prête serment à tous les gouvernements de fait, et qui tient les clefs d’un État à la disposition de quiconque est assez hardi pour en forcer les portes. L’exemple suivant mérite les mêmes éloges. Pompée, vaincu à Pharsale, s’enfuit à toute bride dans la direction de la mer. Il rencontre des gens qui venaient à Pharsale rejoindre ses drapeaux ; il est forcé de leur apprendre sa défaite. Lucain le plaint amèrement de cette humiliation : La fortune punit cruellement Pompée de sa longue faveur. Elle charge son adversité de tout le poids de sa grande renommée ; elle l’accable de tout l’éclat de ses destinées premières... Ainsi, trop d’âge abat les grands cœurs, quand l’homme survit à sa puissance[112]. Il y a un peu de recherche dans la première pensée ; la seconde est aussi simple que profonde. Les hommes supérieurs, qui vivent trop longtemps, défont dans la seconde moitié de leur vie ce qu’ils ont fait dans la première. Dans leurs vains efforts pour se maintenir sur la scène du monde, après que le monde les a quittés, ils perdent leurs talents, et ils compromettent leur gloire. Les hommes d’État, devenus vieux, qui se trouvent tout à coup au milieu d’événements et d’intérêts jeunes, les suspectent parce qu’ils ne les comprennent pas, et ils croient que l’expérience prévoit en proportion de ce qu’elle a appris. Dans cette fausse idée, qui couvre le plus souvent une ambition tenace, ils engagent la lutte, et ils y risquent follement toute la popularité de leurs belles années. Ils sont grands et font de grandes choses tant qu’ils représentent l’intérêt général ; mais le temps vient bientôt où ils y substituent l’intérêt de leur conservation. Ils croient être encore les hommes de tout le monde, et ils ne sont plus que les hommes d’un parti ou d’une maison. Alors ils font des fautes, et la fortune les abandonne, c’est-à-dire la faveur des hommes et des choses. La fortune était passée du côté de César, parce que Pompée ne représentait plus qu’une poignée de républicains entêtés des vieilles formes, et de sénateurs sans résolution, lesquels s’étaient déclarés pour lui parce qu’il était près, et contre César parce qu’il était loin. On avait gravé, en 1789, sur les sabres de la garde nationale, cet autre vers de Lucain, Ignorantque datos, ne quisquam serviat, enses[113]. avec cette variante : Ignorantne
datos, ne quisquam serviat, enses ? Ignorent-ils que le glaive a été donné aux hommes pour qu’il n’y ait point d’esclaves ? Je voudrais aussi qu’on écrivît dans le code politique des nations libres, à la fois comme conseil aux hommes supérieurs, et comme précaution contre leurs fautes : . . . . . . . . . . . . . . Sic longius ævum Destruit
intentes animos, et vita superstes Imperio... J’ai dit que les beautés les plus neuves de Lucain, dans l’ordre moral, se rapportent à des choses de politique et de philosophie stoïcienne. Parmi les beautés philosophiques, on pourrait citer la réponse que Lucain prête à Caton sur les oracles[114], et plus d’un passage où le poète donne ses propres opinions sur la religion naturelle, sur les présages. Quant aux beautés inspirées par la politique, la Pharsale n’en offre pas de supérieures aux éloges de Caton et de Pompée, le premier, que Lucain fait en son nom, le second, qu’il met dans la bouche de Caton. Voici l’éloge de Caton : Jusqu’à la bataille de Pharsale, Caton n’aimait pas Pompée, quoiqu’il eût suivi ses drapeaux ; il s’y était rattaché, parce que les lois de la patrie et le sénat étaient du côté de Pompée. Mais, depuis le désastre de Pharsale, Caton était devenu tout pompéien. Il embrassa la patrie privée de son appui ; il réchauffa les peuples que la frayeur avait glacés ; il fit reprendre l’épée aux lâches qui l’avaient jetée, et soutint la guerre civile sans désir de régner, sans crainte d’avoir jamais à servir. Caton ne fit rien dans cette guerre pour sa propre cause ; et, depuis la mort de Pompée, tout le parti pompéien fut uniquement le parti de la liberté[115]. L’éloge de Pompée, quoique tracé d’une main partiale, et malgré le tour antithétique, est un morceau admirable. Il nous est mort un citoyen, dit Caton, qui, sans approcher de la modération et de l’équité de nos pères, était cependant un exemple utile dans un temps où la justice est méprisée. Il fut puissant sans que la liberté pérît ; il eut le peuple à ses ordres, et sut rester simple citoyen. Il gouverna le sénat, mais un sénat qui régnait. Il ne s’attribua jamais aucun des droits de la guerre : ce qu’il voulait qu’on lui donnât, il voulait qu’on pût le lui refuser. Il fut trop riche, mais il mit plus d’argent dans les coffres de l’État qu’il n’en garda pour lui. Il prit les armes, mais il sut les quitter. Il préféra l’épée à la toge, mais l’épée ne l’empêcha pas d’aimer la paix. Chef des armées, il mit autant d’empressement à déposer le pouvoir qu’à le prendre. Sa maison fut chaste, modeste, et la fortune n’en gâta pas les mœurs. Son nom fut grand et révéré chez les nations, parce que ce nom servit puissamment l’influence de Rome[116]..... XXI. Du trait dans les poètes contemporains de Lucain. Tout ce que j’ai dit du trait, comme la principale beauté du style de Lucain, s’applique parfaitement à tous ses contemporains, avec des restrictions qu’il est à peine nécessaire d’indiquer, Les traits sont moins nombreux dans Silius Italicus, parce que, outre ses habitudes d’imitation classique, il est dépourvu de l’espèce d’invention qui fournit le trait. Stace, avec son imagination un peu vaine, et son esprit de mots infini, est, au contraire, tout plein de traits ; mais ils n’ont point l’éclat de ceux de. Lucain, et portent sur des rapports encore plus vagues, sur des nuances de vérités encore moins saisissables. L’idée n’est là que l’occasion de petits effets de style d’une adresse et d’une inutilité singulières. J’excepte de ce jugement plus d’une charmante comparaison dans le goût d’Homère. Martial, est tout trait, car l’épigramme, c’est le trait ; mais là, ce genre de beauté est à sa place, ce qui ne veut pas dire que tous les traits de Martial soient des beautés. Le trait paraît être originaire dans les tragédies de Sénèque ; Sénèque en est le père ; c’est lui qui pensa le premier à raccourcir le beau en poésie aux proportions d’un jeu de mots. Quant à Juvénal, on peut regretter qu’il ait enfermé trop souvent sa puissante faculté poétique dans ces petites formes de convention ; mais comme en beaucoup d’endroits de ses satires chaque vers est un trait vigoureux, le grand effet du procédé en fait oublier l’apprêt. Cela devient de l’éloquence un peu renforcée, mais qui étonne par son étrange puissance. On admire malgré soi un poète qui, au lieu de se réserver pour le vers à effet,’se l’impose pour chaque chose qu’il dit, et, qu’on me passe cette comparaison, fait son ordinaire des mets que d’autres gardent pour les jours de fête. |