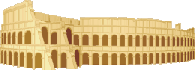ÉTUDES DE MŒURS ET DE CRITIQUE SUR LES POÈTES LATINS DE LA DÉCADENCE
PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION.
|
Ce livre a deux buts, ainsi que son titre l’indique : l’un d’histoire et de biographie, l’autre de théorie et de critique. Je demande à expliquer brièvement cette double pensée. En étudiant les prosateurs latins de l’époque de la décadence, j’ai toujours été frappé d’une chose ; c’est que, sauf quelques exceptions, il n’y est presque jamais question de la vie intérieure et domestique des Romains. Dans les moralistes et les critiques, la plus grande place est consacrée, soit’ à l’exposition et à la discussion des systèmes de philosophie, soit à des subtilités de dialectique, soit à des théories littéraires, soit à des prescriptions pour la pratique des lettres ou du barreau. Dans les historiens, les révolutions de gouvernement, les séditions des armées, la constitution de l’empire, les mœurs politiques des Hommes de pouvoir, les portraits des princes, le peuple et la cour considérés comme deux abstractions, toutes ces choses, qui sont de pure politique, occupent exclusivement la sagacité de l’historien, et se disputent les pages de son livre. Ni dans les uns, ni dans les autres, on ne trouve d’études de mœurs proprement dites, ni cette curiosité des détails domestiques, qui est un des goûts les plus sérieux et les plus vifs de notre époque, et qui s’est presque élevée à l’état de science. Ils restent sur les hauteurs et ne descendent point dans le foyer ; ils spéculent sur les générations, et ne s’embarrassent pas des individus, si ce n’est quand ces individus sont des Césars, ou seulement des agents supérieurs dans la politique générale. Ce n’est pas le lieu de rechercher les causes de ces omissions ; je veux seulement constater un fait dont, sans doute, je n’ai pas été le seul frappé, et qui laisse un certain vide dans l’esprit quand on a lu les prosateurs romains. Au contraire, en étudiant les poètes de la même époque, et ceux particulièrement qui ont fait des vers de fantaisie, des poèmes, des silves, des épigrammes, toutes poésies qui, pour être soumises à des règles de composition et de goût, ne sont pourtant pas des ouvrages d’art proprement dits, comme pourraient l’être, par exemple, des épopées et des odes, j’ai rencontré souvent, avec tout le plaisir que peut donner l’imprévu, des révélations précieuses sur la partie anecdotique de l’histoire de Rome, aux deux premiers siècles de l’empire. Ce sont ces révélations que j’ai consignées dans ce livre, en les complétant, bien entendu, de tous les détails analogues que j’avais pu trouver dans les prosateurs. Je me hâte de dire, pour qu’on ne s’exagère pas l’importance de mes découvertes, que ces révélations des poètes, même complétées par celles des prosateurs, sont peu nombreuses, et ne nous font pas voir l’ensemble de la société romaine ; mais elles en éclairent certains côtés, et nous en montrent les ridicules les plus saillants. J’aurais voulu pouvoir être plus érudit et avoir plutôt à enregistrer de grandes richesses qu’à en mettre en œuvre de petites ; mais il n’est pas permis de créer des sources qui n’existent pas, ni de fabriquer des mœurs de fantaisie, à défaut de mœurs authentiques. Le lecteur ne m’en voudra donc pas de n’être pas plus riche, et il jugera si le peu que j’ai trouvé a quelque intérêt. Je dirai maintenant pourquoi j’ai résumé et classé ces détails sous cinq ou six titres généraux, qui forment autant de seconds titres avec les noms des poètes de cette époque[1]. Comme il m’a paru que parmi les différentes institutions, mœurs, habitudes, dont j’ai recueilli çà et là les traits caractéristiques, telle avait agi plus particulièrement sur le talent et le caractère de certains poètes, j’ai cru qu’il était de bonne critique et qu’il pourrait être piquant de placer le poète en regard de l’influence particulière sous laquelle il a écrit, et de faire l’histoire d’une institution en même temps que la biographie d’un écrivain marqué plus ou moins profondément des effets de cette institution. C’est ainsi qu’ayant reconnu que le stoïcisme théorique faussa l’esprit de Perse ; que les habitudes de déclamation tournèrent à la fausse chaleur le sévère et sobre génie de Juvénal ; que la popularité des lectures publiques fit de la précieuse faculté poétique de Stace une muse d’épithalames et de dîners de saturnales ; que l’infériorité sociale du poète, dans la Rome dés Césars, son renons et sa pauvreté, ses honneurs à la cour et son dénuement, son rang au théâtre et sa toge râpée, firent de Martial, poète spirituel et plus honnête que sa réputation, un flatteur et un mendiant ; — j’ai rassemblé, sous le nom de Perse, tout ce que j’ai pu savoir des stoïciens fanatiques ou charlatans ; sous le nom de Juvénal, tout ce qui regarde la déclamation ; sous le nom de Stace, toute l’histoire de la grandeur et de la décadence des lectures publiques ; sous le nom de Martial, tous les embarras, toutes les anxiétés, toutes les luttes d’un poète pauvre au temps d’un Domitien. Chemin faisant, la biographie de chaque poète se mêle à ces détails, les anime, les éclaire, les retire de l’érudition morte pour en faire des causes actives, dans ma pensée du moins, sinon dans l’exécution. On verra d’ailleurs qu’il !n’arrive souvent d’emprunter à l’un des détails qui servent à compléter l’étude que je fais de l’autre. Ainsi, Perse m’aura aidé à expliquer Sénèque ; Sénèque, Stace ; Stace, Juvénal ; Juvénal, Martial, ou plutôt tous ces poètes m’auront servi à expliquer chacun d’eux. Voilà pour le but historique et biographique de ce livre. Je dirai maintenant en quoi consiste la partie de critique et de théorie. D’abord, à l’occasion de chaque porte en particulier, j’apprécie le caractère général de ses ouvrages ; je recherche le lien qui existe entre lui et l’influence particulière qui a déterminé sa vocation ; je détaille et je précise, autant que faire se peut, les différentes parts que son éducation, ses maîtres, sa position sociale, son caractère, ont pu avoir dans l’ensemble de son talent ; je tâche de fixer pour combien chacune de ces choses y a contribué ; je donne des exemples à l’appui de mes jugements ; je fais enfin une critique individuelle du porte, me réservant de l’examiner ailleurs comme l’homme d’une époque dominé par la fatalité bonne ou mauvaise de cette époque. En second lieu, sous le titre de Lucain ou la Décadence, j’expose une théorie développée sur les caractères communs des poésies en décadence ; j’analyse ces caractères et les montre dans chaque poète de l’époque de Lucain, en tenant compte des légères différences qui naissent de la diversité des talents. Je tâche d’expliquer par quelles nécessités successives et insensibles l’esprit humain arrive à ce singulier état d’épuisement, où les imaginations les plus riches ne peuvent plus rien pour la vraie poésie, et n’ont plus que la force de détruire avec scandale les langues. Je détermine les trois états par où passent fatalement toutes les poésies humaines avant de mourir, et les trois ordres de poètes qui correspondent à ces trois états. J’entre, en ce qui regarde Lucain, dans un examen de l’épopée, de ses caractères, des temps où elle est possible et de ceux où elle ne l’est plus. Je traite du style des décadences, de ses défauts, de ce qu’on peut en appeler les beautés ; et, revenant aux poètes de l’époque de Lucain, je distingue le style propre à chacun, et j’indique par quoi ce style est tout à la fois celui d’un poète et celui d’une époque. Enfin, je touche aux ressemblances qui existent entre la poésie de notre temps et celle du temps de Lucain ; et, à côté des ressemblances, je note les différences, disant avec réserve mon impression personnelle, plutôt que concluant par des formules absolues ; car il y a, pour les poètes de notre époque, une partie d’avenir, d’inconnu, qu’ils pourraient toujours opposer avec succès à quiconque refuserait de croire en eux[2]. Voilà pour le but critique et théorique de ce livre. A la suite de cette exposition, je dois au lecteur quelques aveux. Pour la partie de mœurs et de biographie, je ne me suis pas toujours borné et réduit aux seuls traits authentiques consignés dans les écrits du temps. J’ai été plus loin ; j’ai conjecturé, à mes risques et périls, tantôt m’autorisant d’un hémistiche, d’un vers livré à toutes les interprétations, et, par conséquent, n’en excluant aucune, pour hasarder quelque spéculation sur un usage, une coutume, un caractère ; tantôt, avec l’aide simultanée des documents authentiques, et des analogies que présentent invariablement, à toutes les époques, les hommes, poètes et public, reconstruisant de petites scènes de vie littéraire, une lecture publique, par exemple. Si la conjecture est piquante, il faut avouer qu’elle est scabreuse d’autant. Je livre les miennes au jugement du lecteur. Si, après avoir vu ce que l’histoire mettait à ma disposition, et ce que j’y ai ajouté de traits, empruntés à ce qui nie paraît être la vérité universelle, il me fait l’honneur de dire C’est ainsi que les choses ont dû se passer, ce succès vaudra bien celui d’avoir inventorié avec exactitude des documents existants. Pour que l’érudition ne soit pas aride, il faut qu’elle soit un peu aventureuse ; mais une érudition aventureuse n’est pas nécessairement fausse. Qui est-ce qui oserait dire que certains discours, prêtés aux hommes politiques par les anciens historiens, soient des discours faux ? Or, ces discours ne sont-ils pas l’œuvre de l’érudition et de la conjecture ? En ce sens, l’art pourrait être plus vrai que la vérité : ce que je ne dis pas d’ailleurs pour surfaire mes très petites et très peu importantes hardiesses. Je sens que le même principe ne saurait couvrir des chefs-d’œuvre de raison et de langage, et les imaginations d’un obscur critique de 1834. Pour la partie de critique et de théorie, j’avoue que mes principes sont plutôt exclusifs qu’éclectiques. Je tiens la poésie de Lucrèce, de Virgile, d’Horace, non point pour la seule, mais pour la meilleure, la plus philosophique, celle qui réfléchit le plus de côtés de notre nature, celle qui contient le plus d’enseignements pour la conduite de la vie ; la seule enfin qui puisse former des hommes de bon sens. Je suis bien plus frappé, dans l’époque de la décadence latine, des pertes que des acquisitions ; et celles-ci ne me paraissent point compenser celles-la. Toutefois, si je faisais de la critique dans un temps sain, où il y eût moins d’individualités et plus de gens de goût, moins d’indépendance littéraire et plus de bon sens, je serais disposé à céder sur mes doctrines exclusives ; car j’aime et je comprends très bien cette facilité qui ne s’effarouche point des défauts et ne tient compte que des beautés, qui procède par admission au lieu de procéder par exclusion, qui a des poétiques pour toutes les poésies, et des principes pour expliquer et absoudre toutes les individualités. Mais, comme ce temps-ci est mauvais, qu’on y croit plus aux entrepreneurs de littérature qu’aux grands écrivains, qu’on y prend la témérité entêtée pour du génie, et l’orgueil immuable pour une mission ; que beaucoup perdent le goût, et, ce qui est bien plus triste, le sens moral, à lire nos écrivains autocrates et autonomes, j’ai pensé qu’il fallait prendre parti pour les principes contre les admirations faciles et accommodantes de l’éclectisme, et que là où la question littéraire se complique d’une question de moralité, la critique mérite mieux d’un pays libre, et montre peut-être plus d’intelligence et de courage en venant au secours de la discipline littéraire, qu’en immolant le peu qui reste de principes incontestés au prétendu besoin d’affranchir de toute entrave les génies douteux que nous réserve l’avenir. La critique peut être, selon les temps et les lieux, ou une simple spéculation ou un devoir. Dans un pays où la littérature n’a pas une action immédiate sur l’état social ou politique des peuples, où c’est une distraction instructive bien plus qu’un agent direct de civilisation, un miroir qui réfléchit la société bien plus qu’un levier qui la porte en avant, la critique peut se contenter d’être spéculative, et par conséquent facile et conciliante. Permis à elle d’agrandir à l’infini le champ des récréations littéraires, et de se plaire même aux plus choquantes bizarreries, comme à des variétés de l’esprit humain. Mais dans un pays où la littérature gouverne les esprits, même la politique, domine les pouvoirs de l’État, donne un organe à tous les besoins, une voix à tous les progrès, un cri à toutes les plaintes ; où elle est la plus vitale liberté au lieu d’être le stérile dédommagement de toutes les libertés confisquées ; où elle agit, non seulement sur le pays, mais sur le monde, la critique n’est plus une spéculation oiseuse, mais un devoir à la fois littéraire et moral. Elle doit être intelligente, mais point complaisante ; elle doit tout connaître, mais non pas tout approuver ; elle doit surtout ne pas mettre en danger l’unité d’une belle langue pour y donner droit de cité à quelques beautés suspectes. Telle est ma conviction profonde ; et si j’ai un regret en relisant ce livre, c’est de m’y trouver toujours au-dessous de cette conviction. C’est, dit-on, le supplice de tous les écrivains qui font leurs livres avec leur cœur, et qui respectent leur art à l’égal de leur conscience, qu’ils craignent toujours de ne pas assez honorer cet art, et d’être meilleurs que ce qu’ils font ce supplice a toujours été et sera toujours le mien, non seulement pour ce livre-ci, mais pour tout ce que j’ai écrit et écrirai ultérieurement. 1834. |