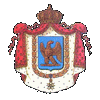LA FÊTE IMPÉRIALE
CHAPITRE HUITIÈME. — PROMENADE À CYTHÈRE.
|
I Heureux temps. — Moissons pleines. — Aux différents étages de la pornocratie rayonnante. — Conditions précaires des lorettes du deuxième ou du troisième plan. — En revanche, train de luxe étourdissant des arrivées du plaisir. — Une évocation de plein air. — Le défilé quotidien des femmes célèbres, au Bois de Boulogne et dans leurs équipages. — Des noms, des portraits. Il fut un temps à peine éloigné du nôtre d'une moitié de siècle, où les femmes étaient hors de prix, où des créatures de luxe et de joie moissonnaient avec une aisance incomparable des succès et des prospérités inouïs. Aussi, quel milieu ! quelles circonstances ! La société cosmopolite, qui s'était agglomérée dans Paris, si nombreuse et si prenable, si légère de scrupules et si prodigue d'écus, n'était-elle pas un merveilleux domaine de chasse et de pêche ouvert aux appétits de ces ravageuses ? D'une main preste et sûre, celles-là jetaient la ligne dans la direction d'aimables Russes occupés, en la capitale française, à manger leurs paysans. Non moins promptes à tendre leurs filets celles-ci ramenaient à elles, le plus adroitement du monde, des pachas turcs en déplacement et de généreux Egyptiens, dont la munificence faisait pâlir les enchantements des contes arabes. De tous côtés les femmes prodiguaient leurs sourires marchandeurs ; et les hommes jetaient leur bourse avec une égale désinvolture. Ce fut une heure de bénédiction pour les gourmandises féminines. La vogue de quelques dégrafées célèbres, tout le bruit qui se faisait autour d'elles, de leur train de maison, de leurs équipages rivalisant de correction et de chic supérieur avec ceux des duchesses ou des ambassadrices et tout ce qu'on disait de leurs amours fastueuses avaient excité prodigieusement, dans le monde des filles et des femmes libres de leur corps, la fièvre de la concurrence. Le bruit s'était répandu, par la ville et la campagne, qu'il y avait, à Paris, des placers en portefeuille ; et toute la bohème des rêveuses de diamants s'était empressée d'accourir sur ce marché d'esclaves, chacune espérant rencontrer, un beau soir, à Mabille, son prince russe ou son banquier de Francfort. De singulières ambitions avaient germé dans le Cerveau des bourgeoises les plus paisibles. La notoriété fournie par des procès scandaleux à des arrivées du plaisir bien en vedette, la description de leur luxe intime, rémunération de leurs richesses, si facilement obtenues provoquaient une émulation excessive. Comment se dire qu'il y avait des femmes vivant ainsi, couvertes de pierreries, toujours en fête, ayant hôtel, chevaux, voiture, et ne point mordre à la tentation ! A la vérité, les lorettes du deuxième plan avaient plus de peine à conduire la barque des Amours. Comme elles croissaient en nombre et en hardiesse, au point d'inquiéter sérieusement les regards honnêtes, des ordonnances spéciales, renouvelées des vieux âges, s'étaient abattues sur la corporation des marchandes de sourires, restreignant fort les droits et les limites de leur commerce. Au mois de juillet 1860, n'avait-on pas eu l'inhumanité de les bannir du trottoir, de leur chez soi, pour ainsi dire ? Les propriétaires de tous les cafés placés sur la ligne des boulevards Montmartre et des Italiens avaient dû se résoudre, pendant un laps de temps, à ne plus recevoir cette portion de leur clientèle féminine, qu'on, voyait s'asseoir devant, les petites tables de zinc, d'abord en face d'un grog américain et ensuite en face d'un monsieur chargé d'acquitter la consommation. Le vertueux Figaro versa presque un pleur de compassion sur le malheureux sort des grogueuses, comme on les avait baptisées. Mais connaissait-on ces petites misères, au faite de l'échelle pornocratique ? Elles étaient une douzaine à guider, haut la main, le mouvement accéléré de la grande vie. Les clubmen de la plus fine fleur d'aristocratie, les meneurs attitrés du high life les avaient proclamées maîtresses et reines en cette vague principauté de la bamboche et de la fantaisie. Ostensiblement ils fréquentaient chez elles et s'entendaient à leur donner le ton, qui les mettait hors du commun. Tout en ne se privant point de rançonner à outrance les exotiques en liesse, les financiers mondains égarés dans leurs parterres, les bourgeois opulents en rupture de fidélité conjugale, en un mot la catégorie des amants sérieux et piastreux[1], elles n'avaient pas perdu leur temps à l'école des cocodès en renom, mais y avaient contracté des habitudes d'élégance, qui avaient de beaucoup accru leur prestige. Isolément, elles possédaient le charme et le chic. Réunies, groupées en une coterie remuante et brillante, elles représentaient le faubourg Saint-Germain du demi-monde. On connaissait, on redisait au loin leur réputation. Ne se nommaient-elles point : Adèle Courtois, Giulia Barucci, Anna Deslion, Gioja, Cora-Pearl, Caroline Letessier, Juliette Beau, Lucile Mangin, Morancy, Adèle Remy, Marguerite Bellanger, Esther Duparc. Léonide Leblanc ? Leur train était extraordinaire. On aurait cru qu'elles avaient improvisé, comme par la vertu d'une baguette magique, le luxe dont elles s'entouraient et leurs habitations de princesses. L'une d'elles s'était fait bâtir, dans Paris, un merveilleux palais. Alphonse de Rothschild lui disait, un jour, devant un témoin, qui nous en répéta le propos : Quand je rentre chez moi en sortant de chez vous, mon hôtel me fait l'effet d'un taudis. On commettait, pour elles, des folies de dépenses aussi extravagantes qu'injustifiables. Vingt mille francs... quelqu'un avait pu payer ce fol salaire pour la nuit de quelqu'une. Et, comme en l'exagération de sa libéralité il se croyait autorisé à former des plans aussi pour le lendemain : Vous êtes donc bien riche ? lui demanda l'orgueilleuse. Des duchesses se montraient, roulant sur l'avenue de l'Impératrice, une femme à la Rubens, pas très belle mais d'une carnation et d'un épanouissement de formes superbes, une Nana triomphante[2], et l'appelaient de son vrai nom Blanche d'Antigny. N'avait-elle pas, tout récemment, ramené de Saint-Pétersbourg, ce curieux attelage russe et ces trotteurs de l'Ukraine, conduits par un moujik à la blouse de soie écarlate, qui accrochaient si violemment l'œil ? Les attelages de Cora, les daumonts, les speeders de Mme Skittels excitaient l'admiration publique. Aux heures du Bois, c'était le jeu des experts ès sciences galantes de les désigner à coup sûr, de mettre des noms sur les visages, à mesure que se succédaient leurs voitures, sillonnant les larges voies ou contournant les bords du lac. Et nous pourrions aisément, nous aussi, reconstituer par le souvenir l'image de ce défilé provocant des parvenues de la haute noce. J'ai, par hasard, sous les yeux, une sorte de catalogue en vers de ces beautés d'alors, un péché de jeunesse qu'on ne voulut pas signer, mais que je soupçonnerai fort être sorti de la plume alerte du marquis Philippe de Massa. La liste en est instructive, à distance, et nous la compléterons, chemin faisant. Mais ne nous arrêtons pas aux présentations : le mouvement a commencé. Maria la Polkeuse ouvre la marche, une amazone émérite, jamais lasse et toujours sur la brèche, bien qu'elle ait de plusieurs mois fleuronné son quarantième printemps. On n'a pas le loisir d'en remarquer davantage, que déjà on l'a perdue de vue. En son superbe coupé jaune vient de passer la baronne de Steinberg, baronne de la main gauche et qui n'est rien de plus ni de moins que la belle Adèle Courtois. De près emboîtent le pas Constance Rezuche, dont on a reconnu l'équipage à ses couleurs, et Juliette de la Canebière, c'est-à-dire la très engageante Juliette Beau, que son accent marseillais n'empêche de tenir le duo d'amour avec une chaleur, un feu, une maestria dignes de ses origines. D'un goût parfait, d'un style ravissant est ce nouvel équipage : Hermance s'y prélasse, songeant peut-être qu'il ne lui fallut, pour le gagner, que la fraîcheur de son teint de pastel, ravivée soir et matin, adroitement, et le velours noir de ses yeux. Julia l'Italienne a pris la file du cortège ; par la précellence de sa beauté comme par le nombre de ses amants, elle en pourrait tenir hardiment la tête ; n'est-elle pas la grande courtisane romaine, la Barucci ? Qui hésiterait, maintenant, à nommer cette autre, mollement couchée plutôt qu'assise, qui ne la reconnaîtrait d'abord à son profil antique, à son air d'abandon tranquille, plein d'attirance voluptueuse ? Des saluts, des sourires s'empressent à la rejoindre ; car, c'est Anna Deslion. Sur ses traces roule, moins aperçue, tendrement appuyée contre son inséparable compagne la Bertin, Alice Labruyère, une Parisienne de Lesbos, infidèle aux hommes par trop d'amitié pour les femmes. Puis, Voilà les Blum, au badigeon de rose Enjolivé de deux couches de blanc. Quel air ! Quel chic ! Quelle admirable pose ! C'est d'Israël le type de pur sang. La procession cythéréenne se déroule interminablement. On se montre Clara, souriant à son rêve de la nuit prochaine ; Adèle Remy entrevoyant, à travers les verdures fuyantes, les mystérieux ombrages de Saint-Firmin, où se nichera bientôt sa dernière toquade ; et Soubise, la grande Soubise, s'obstinant à retenir une dernière illusion sur le pouvoir affaibli de ses charmes : on dit qu'elle a vendu, la veille, sa robe et sa chemise, pour garder, aujourd'hui, des chevaux à sa voiture. On s'accorde à peine une minute ou deux pour lorgner Chonchon, et la discrète Brochet et la tapageuse Mary Laval ; car, du plus loin, s'est annoncée la radieuse Léonide Leblanc. Jeune et charmante, elle règne à Paphos, et n'y borne pas son empire ; on prétend que les autels lesbiens ne connaissent pas de nom plus souvent invoqué que le sien par des ardeurs impures. Les yeux ne voudraient pas la quitter, si la fringante Cora Pearl ne s'était révélée dans toute sa gloire avec la tenue sans égale de ses harnais, de sa livrée et de ses gens. Armée de sa belle impertinence, elle a croisé tout à l'heure l'équipage à la daumont de la baronne de Rotschild et l'attelage renommé de la maréchale Serrano. La voilà donc, cette centauresse ! Pour elle, a remarqué sur son passage le spirituel Roqueplan le cheval n'est pas seulement un luxe, c'est un art, ce n'est pas seulement un art, c'est une administration. Dans les groupes, on échange, on colporte des détails. Cora dépense des sommes folles ; on lui sait, à l'écurie, douze chevaux anglais, soignés et respectés par les domestiques, autant qu'ils le méritent. Quant à ses voitures, les raffinés n'ont qu'une opinion là-dessus : ce sont de purs modèles, autant sous le rapport de la coupe que des couleurs. Dans la poudre de cette apothéose file bon train la calèche de Caroline Hassé, attelée de deux demi-sang, que les dilettante estiment étoffés au mieux et d'un fond irréprochable. Tout à coup se dessine, en son huit-ressorts, la Duverger. Hier, elle jouait, à la Gaîté, dans un drame pathétique. On sourit de son talent, qui se cache ; on rit à sa beauté, qui se montre... Cependant, le défilé touche à sa fin. Le soleil descend sur l'horizon. Il se fait tard ; c'est le moment de tourner bride et de ramener chez elles, pour les préparatifs du soir, ces élégantes filles de marbre. II. — Léonide Leblanc Des souvenirs, des confidences. — L'une d'elles. — Les commencements de Léonide ; succès de femme et d'artiste. — Des épisodes. — Une aventure plus que risquée. — Mlle Maximum et ses adorateurs princiers. — Ne dérangeons pas Son Altesse. — Dernières touches au portrait. Chacune d'elles a sa marque, son individualité, presque son histoire. Le dire, c'est inspirer l'envie de le constater, en feuilletant des pages de ces histoires un peu court-vêtues, et par cela même, hélas ! intéressantes à considérer. Avant de poursuivre notre examen d'ensemble, accordons-nous licence de les examiner pendant une petite heure ou deux. Contentons ce désir de lier intimement connaissance avec les plus belles, ou les plus originales, ou las plus spirituelles d'entre celles-là. Ce seront : Léonide Leblanc, la Barucci, Adèle Courtois, Anna Deslion, Cora Pearl[3], Caroline Letessier, Esther Guimond, Caroline Hassé, les sœurs Rezuche, Marguerite Bellanger. Grisées par le nombre et la continuité de leurs succès, certaines avaient conçu l'ambition singulière non seulement de vivre leur jeunesse le plus agréablement du monde, mais de se survivre à elles-mêmes en léguant à la postérité les souvenirs de tant d'exploits heureux consommés dans les alcôves profondes ou les cabarets de nuit. Elles s'enquéraient, aux alentours, de gens de lettres disponibles, leur glissaient la plume entre les doigts et d'une voix bien engageante, leur susurraient à l'oreille : Soyez indiscrets, chantez nos amours, et que l'on apprenne, jusque dans les temps les plus éloignés, quelles sources de jouissance surent verser à plusieurs générations d'hommes une Céleste Mogador, une Cora Pearl, une Esther Guimond, une Léonide Leblanc. Vers 1860, Marguerite Badel[4], dite la Huguenote, dite Rigolboche, écrivait de plusieurs mains ses Mémoires, qui n'étaient pas des Mémoires[5], et dont l'annonce fut presque un événement. On réimprima cinq ou six fois, dans l'année, ces menus bavardages sur les cascadeuses de différentes catégories, des riens, des fadaises et qui se réduisaient à démontrer par l'exemple que la robe de soie est plus facile à gagner que la robe de laine. Céleste Mogador, la Vestris en jupon, promue comtesse de Chabrillan par la grâce d'un gentilhomme ruiné, qui, ne possédant plus rien en portefeuille que son titre, l'avait offert à sa maîtresse ; Céleste, avec une candeur digne de son nom, écoula sur le marché parisien des révélations si scandaleuses qu'elles produisirent un esclandre énorme[6]. Les éclaboussures en rejaillirent jusqu'en Autriche, où le comte Lionel de Chabrillan, petit-fils de Choiseul-Gouffier, cet ancien ambassadeur de France à Constantinople, occupait une situation diplomatique, qu'il lui fut impossible de conserver. Céleste Mogador était ressuscitée, on la revoyait costumée de pied en cap à la vitrine des libraires. Et non pas seulement la quadrilleuse intrépide de Mabille ou l'écuyère du Cirque, mais une autre femme, Céleste Vainard, à ses débuts de professionnelle soumise aux pires servages de la basse galanterie. Elle y racontait sans feinte comment elle avait commencé sa carrière d'amuseuse dans une maison close, dépeignant trait par trait les visiteurs de hasard avec lesquels on l'envoyait... causer pour un louis, et le reste à l'avenant ! Cora Pearl, la dompteuse de chevaux effrénés, tombée des escaliers de marbre dans la dernière détresse, livra à une publicité non moins tapageuse un catalogue d'amourettes sans passion, sans poésie, et qui n'était, au fond, malgré les soins du blanchisseur appelé à son aide, qu'un carnet de linge pas très propre. Esther Guimond, cette collectionneuse de célébrités, aurait visé plus loin et plus haut : elle eût voulu revêtir d'une couleur politique et philosophique digne de ses partenaires le récit de ses conversations de jour et de soir avec des hommes tels que Guizot, Girardin, Roqueplan, Dumas fils, Sainte-Beuve, Jérôme Napoléon. Par malchance, elle ne rencontra point l'auxiliaire indispensable... Et ce fut le grand désespoir d'Esther Guimond. Léonide Leblanc, femme de théâtre et princesse d'amour émérite, fut de celles qui songèrent, toutes moissons faites, à s'annexer un mémorialiste capable de tisser une prose élégante autour des secrets de l'oreiller. Elle griffonna même quelques feuilles d'une vague autobiographie, rassembla quelques lettres à nobles parafes plus galantes les unes que les autres ; puis, le travail en resta là. De ces pages volantes, de ces épistoles des fragments nous sont venus aux mains en quantité suffisante pour nous permettre de tracer une esquisse sommaire mais exacte de la vie et des gestes de l'héroïne. Léonide avait commencé, comme beaucoup d'hétaïres finissent, par le mariage. Un Allemand à la barbe flavescente, qui exerçait, en pays parisien, le métier de photographe, fut le possesseur légitime de ses charmes ; il n'en garda pas longtemps le monopole. Ces épousailles n'eurent dans l'existence de Léonide que la durée d'un stage assez court, et les conjoints se disjoignirent pour ne plus se revoir. Elle put se livrer sans gêne à ses goûts de théâtre et varier ses plaisirs. Car, avec son entrain et sa figure, elle eût été bien contrite de ne pas cultiver dans les grands prix l'admiration et les applaudissements des avant-scènes. Ses débuts s'étaient annoncés tôt. Elle n'avait que dix-sept ans, lorsqu'elle apparut, pour la première fois, aux Variétés, éblouissante de fraîcheur. Le caractère de son teint était si pur, si délicieuse l'expression de son sourire, des éclairs si vifs sortaient du feu noir de sa prunelle, une harmonie si capiteuse enveloppait l'ensemble de sa personne qu'elle avait immédiatement séduit chacun et tout le monde. Les habitués de l'orchestre se pâmaient. Si superlatives que fussent les louanges, elles semblaient trop faibles à ceux qui les lui décernaient. Tel de ses fanatiques assurait que sa mère avait dû la concevoir en avalant une perle. D'autres prétendaient qu'il était défendu aux plus jolies femmes de l'être autant que celle-là. Elle passa des Variétés au Gymnase et du Gymnase à la Porte Saint-Martin, tenta le voyage à l'Odéon et faillit forcer les portes de la Comédie-Française, à l'instar de Blanche Pierson et de Céline Montaland, des charmeuses aussi, qui formaient, avec elle, au théâtre, un trio d'enchanteresses. Elle eut l'honneur de jouer Dolorès, dans Pairie, très mal, d'ailleurs, et se tira passablement d'affaire, en général, pour des raisons... plastiques. Le public suivait ses pas, moins curieux de l'entendre que de la regarder. Ses toilettes, la profusion de perles et de pierreries dont elle faisait un cadre resplendissant à sa beauté étaient l'attrait le moins contestable de ses rôles. On acclamait sas robes et ses bijoux. C'est que véritablement nulle endiamantée, pas même la Barucci, ne fut plus furieusement éprise de gemmes et de joyaux. Elle s'en parait avec amour ; ses minutes les plus exquises elle les savourait à baigner son regard dans les reflets irisés des écrins ouverts. Elle possédait une collection de bagues merveilleuses, un collier de perles devenu légendaire, des agrafes précieuses, des bracelets anciens et modernes à ne savoir où les mettre. Ainsi chargée de parures se souvenait-elle des jours de simples espoirs et d'amours candides, où, à la place de. la fameuse bague au diamant bleu, elle n'avait au doigt qu'un modeste anneau brisé, avec cet mots gravés à l'intérieur : Aurélien à Léonide. Pour toujours ? Cet Aurélien n'était autre que Schöll, aux heures sentimentales où il croyait à l'éternité de ce toujours. Dix ans plus, tard il était, bien revenu de ses jeunes illusions, lorsqu'il disait à un ami de lettres : Léonide ! que c'est loin ! Elle était fort belle ! Elle l'est toujours. Mais, vois-tu, mon cher, on la placerait sur le mont Blanc qu'elle serait encore accessible ! Tant d'éclat à ses oreilles, dans ses cheveux, sur sa poitrine, autour de ses bras, prouvaient clairement que Léonide se connaissait autre part qu'au théâtre des appréciateurs et qu'ils justifiaient de leur bonne opinion avec munificence. Attractive, certes, elle l'était. Sa bouche mi-ouverte respirait la volupté. Sa peau semblait une caresse. En outre, le plus joli corps du monde, une taille modelée à ravir, les épaules et le sein d'une bergère-déesse., on devine les ravages que de tels charmes pouvaient porter dans les cœurs. Hélas ! ailleurs aussi, à en croire une historiette, que nous contait, à table, longtemps après, le comte Edmond de Lagrené. A la suite, de quelle pernicieuse influence, par quelle rencontre, d'épidermes fortuite et néfaste pareille chose arriva-t-elle ? On en sut moins la cause que les conséquences. Mais voici cet épisode, dans sa nue réalité. Le comte de L... étudiait, en ce temps-là, à l'université de Bonn. Une fâcheuse histoire, un duel qui s'était terminé par la mort de son adversaire, l'avait obligé de quitter en hâte le territoire allemand, il venait d'arriver à Spa, lorsqu'il y fit la rencontre de son ami Eugène de Talleyrand. On s'aborde, on s'interroge. Des paroles sont échangées sur les conditions et les desseins réciproques. Talleyrand engage vivement son jeune compatriote à l'aller rejoindre en l'hôtel où il est descendu lui-même, avec Léonide Leblanc. On aura la même table, on fréquentera le même cercle ; on ne s'ennuiera pas de compagnie. Il est convenu qu'on arrêtera trois chambres d'affilée, chacun occupant la sienne, et Léonide ayant marqué ses préférences pour la pièce médiane. La première soirée de cette réunion s'est ouverte sous de
gais auspices. L..., qui, négligemment, a risqué quelques louis à la
roulette, s'est retiré du jeu, avec un gain de quatre-vingt mille francs. Les
soucis de la veille se sont envolés. Il ne songe plus qu'à se mettre au lit,
avec la meilleure intention d'y dormir sans trouble. Mais il avait compté
sans Léonide. Comme il allait éteindre sa bougie, la porte de sa chambre s'entrebâilla
doucement ; une adorable statue vivante semblait glisser vers sa couche ;
c'était elle, n'ayant pour tout vêtement que ses longs cheveux ondoyant sur
le marbre de ses épaules. Que de fortune en un seul jour ! Quelles félicités
olympiennes ! Vénus descendant dans la couche de Mars, pendant que Vulcain
forgeait, n'y apporta pas une beauté plus parfaite. Léonide, au surplus,
était câline à souhait, ensorcelante au suprême degré. Comment n'eût-il pas
mordu au fruit savoureux ? Le lendemain, le surlendemain, même visite et
pareils accomplissements. Que faisait, pendant ces minutes-là, l'insoucieux
possesseur, à quoi songeait donc Talleyrand ? Il dormait, ayant une telle
maîtresse ! C'était impardonnable. Il méritait son sort, en vérité. Puis, il
y avait eu, dans ces jeux infidèles, un moment d'interruption, par le retour
de certain empêchement de nature, auquel sont soumises les créatures
féminines. E. de L... alors s'aperçut que son ami devenait triste, qu'il
portait partout des airs navrés et mélancolieux. Soupçonnait-il la trahison ?
Prudemment on s'informe, on pose des questions. Qu'avait-il
? Quel était son tourment ? — Ah ! mon ami
répondit le jeune duc, en termes simples, je suis fichu, décidément fichu. Il
ne me reste qu'à implorer le dieu Mercure. Et je dois ce beau présent à
Léonide ! A cette révélation aussi funeste qu'inattendue, l'ami
s'effare, se dresse tout d'une pièce, saute au col de son interlocuteur, en
s'écriant d'un ton presque furieux : Tu aurais bien
dû me prévenir ! Il ne s'interroge pas longuement sur la résolution à
prendre, mais aussitôt boucle ses malles et prend le premier train qui le
mènera à Paris, chez Ricord. Le lendemain, il a conté sa mésaventure à
l'illustre spécialiste : Oui, dit Ricord, j'ai connu de ses victimes ! Il fallut s'astreindre
à des consultations suivies. Par bonheur le tempérament de la personne était
réfractaire. Il n'y eut d'autres suites à l'incident qu'une grosso frayeur,
infligée comme une pénitence. Mais ne sont-ce pas les risques de l'amitié des
courtisanes ? Le mot même, le nom dont on les appelle en est l'emblème parlant
: on commence par leur faire la cour et l'on finit par boire de la tisane. Ces contre-temps des amours mercenaires ne suspendirent que d'un arrêt à peine sensible la marche conquérante de Léonide Leblanc. Ce n'était pas sans raison qu'on l'avait surnommée Mlle Maximum. Elle s'entendait fort bien à n'aliéner son capital qu'à bon escient ; et, dans l'éparpillement de ses faveurs, elle n'oubliait pas d'être adroite et calculatrice. Elle était capable de céder à une toquade ; elle pouvait être prodigue, par intermittences, de ses charmes et de sa bourse, pourvu qu'elle y trouvât son compte. Car elle désirait et voulait que chaque heure servît à la réalisation d'un plaisir ; elle menait la fête, petite ou grande, sans désemparer. Chemin faisant, son cortège avait grossi d'importance et de qualité. Des adorateurs princiers la couchèrent sur un lit de roses et de billets bleus. Sans parler de Jérôme Napoléon, qui ne fit que traverser son boudoir, ayant l'humeur trop voyageuse pour se fixer nulle part, la liaison de Léonide Leblanc avec Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fut le grand événement, le lit de parade de sa carrière amoureuse. Intelligente et fine comme elle était, elle demanda et fit rendre à cette précieuse protection tout ce qu'elle pouvait produire d'avantages directs ou indirects. Je n'en citerai qu'un seul point : l'histoire de la statue de cire. Une admirable invention, celle-là, de l'astuce féminine. Lorsque Léonide recevait, pour la première fois, un personnage considérable, extra-chic ou simplement piastreux, elle ne manquait jamais de lui offrir de visiter ses appartements. Elle n'en oubliait rien. Il fallait tout voir : le luxueux vestibule, les salons enjolivés des fantaisies les plus coûteuses, les chambres où les moindres détails trahissaient une intention, une recherche de volupté, les meubles dorés, les soies, les velours, et les intimes raffinements du cabinet de toilette. Avec sa démarche pimpante, ses façons moelleuses, la grâce de ses mouvements de tête, elle allait, de pièce en pièce, tout au plaisir apparent de révéler les douceurs, le confort élégant de son chez soi. Soudain, on la voyait changer de contenance ; elle n'avançait plus qu'avec lenteur et précaution, et devenait toute sérieuse, comme si elle allait franchir le seuil d'un sanctuaire. C'est qu'en effet elle venait de toucher le bouton de la porte, qui ouvrait le tabernacle, je veux dire le cabinet de travail réservé à Son Altesse. Mais, chut ! Elle avait mis un doigt sur ses lèvres. Le prince était justement là. On avait eu le temps d'entre-apercevoir sa noble silhouette, dans l'attitude d'un homme qu'absorbe l'effort de la réflexion ; Dieu soit loué ! Il n'avait rien entendu. On se retirait sur la pointe des pieds, religieusement. Et l'effet était produit. Le tour était joué.. Les actions de Léonide avaient monté du coup au plus haut de la cote. Gomment récompenser, à leur prix, se disait-on, les faveurs d'une jolie femme, en si belle passe de fréquentations aristocratiques ! En réalité, il n'y avait eu du prince qu'une imitation fort réussie, une statue de cire si parfaitement ressemblante que chacun y était trompé. A la suite de ces relations éclatantes, en dehors des cœurs considérables qu'elle tint entre ses doigts, bien des individualités confuses se mêlèrent sur la liste de ses mille et une nuits. On lui donnait un tel... puis un tel... sans compter l'incomptable. Dans l'intervalle des conversations intimes, Léonide se plaisait à recevoir, d'abord en son hôtel de la rue d'Offémont et plus tard en son appartement somptueux du boulevard Haussmann. Des artistes, des poètes y rivalisaient d'empressement. Avec une générosité toute lyrique, ils appariaient les rimes d'or, dont elle était l'objet sinon le prix. Elle y répondait de bonne grâce ; car elle était pourvue d'esprit. Des mots heureux traversaient ses causeries légères. Maintes fois, chez soi, ou au dehors, elle prouva qu'elle avait la repartie prompte, originale. Telle grande dame, un certain jour, en fit l'expérience à ses dépens. C'était à l'époque du procès Bazaine, dont les audiences étaient extrêmement courues. Léonide s'y trouvait des premières, assise pour bien voir et bien entendre, lorsque cette noble dame voulut lui enlever sa place, prétextant qu'elle était sienne et qu'elle lui avait été donnée par le président du conseil, c'est-à-dire par le duc d'Aumale en personne. Léonide ne bougeait point C'est trop fort ! s'écriait la patricienne toisant avec un dédain courroucé l'audacieuse. On n'a pas l'idée d'une pareille inconvenance ! Je dîne ce soir, chez Monseigneur, et je me plaindrai à lui de cet affront. Ça ne se passera pas comme ça, mademoiselle ! — Ah ! vous dînez chez Monseigneur, répliqua l'artiste de sa voix la plus tranquille. Eh bien ! moi, j'y soupe et j'y couche ! Léonide Leblanc savait causer. Elle affichait des prétentions à se connaître aux choses sérieuses. Des velléités intellectuelles honoraient ses occupations folâtres de jour et de nuit. Elle jouait à l'Egérie. Elle discutait politique avec une insistance voulue, comme pour varier le ton de ses dialogues habituels. D'un petit air convaincu elle disait à l'un des publicistes parisiens les plus en vedette : Téléphonez-moi, vers cinq heures, tous les jours, nous jaboterons politique. Pendant la lune de miel de sa liaison princière, ingénument elle s'essayait à faire du prosélytisme, recrutant des adeptes parmi les monarchistes, les tièdes, les indifférents, conseillant à ses amis de l'Empire mal satisfaits ou tombés en disgrâce de se faire orléanistes : Il n'y a encore que ça de bon, en ce moment-ci, disait-elle, avec l'air d'y croire. Au demeurant, très éclectique par état, instruite à plusieurs écoles, dans le même temps elle souriait au duc d'Aumale et riait à Clemenceau. Non moins accommodante, quant à la constance et à la profondeur des sentiments, elle eut beaucoup d'amis et ne se brouillait avec personne autant que possible. Et, chose plus difficile, mérite plus singulier, elle sut conserver des relations amènes, — d'apparence tout au moins, — avec la plupart des femmes à la mode, qu'avait adoptées, proclamées, la fleur du gandinisme parisien. Par exemple se voyait-elle en très bons termes de conversations et de lettres avec la blonde Adèle Rémy, l'une des plus attrayantes entre les hétaïres de haute volée, sentimentale et douce, jouant volontiers à la femme du monde en délit d'aventure galante, et dont les amours aimaient à s'envelopper de mystère et de discrétion, sous les ombrages de sa maison des champs, à Saint-Firmin, entre Senlis et Chantilly. Léonide avait pour Adèle des attentions d'amie, de camarade et d'artiste, dont je retrouve des traces, en cet échantillon de son style épistolaire : A la plus belle, la plus blonde, la plus infidèle, la plus dangereuse des biches. Voici la loge, que tu as désirée pour aujourd'hui. Elle est très bonne ; en face est la loge Aguado et devant toi seront tous les amoureux, à qui tu as donné rendez-vous, grande gredine. De plus, je n'y serai pas : ton bonheur est donc complet. A tantôt. La grande biche. J'ai retenu la même, pour mercredi prochain, avec la Cruvelli. L'intention était délicate. Il n'y aurait pas à croire, toutefois, qu'elle fût la bonté et la sincérité mêmes. Au contraire, son péché mignon était la médisance, secondée des ressources de l'imagination. Sans paraître s'en apercevoir, elle se montrait inventive terriblement sur le compte de ses amants et des gens de sa connaissance ; elle façonnait de toutes pièces des histoires énormes, et vous les coulait à l'oreille comme des secrets d'Etat. C'était là sa manie, je dirais presque une maladie ; elle avait l'hystérie du mensonge. Léonide Leblanc s'attacha longuement, obstinément au vouloir d'aimer et de plaire. A mesure que s'accusaient, devant le miroir, les outrages inévitables des ans, elle, par un effort contraire, rajeunissait de plus en plus le cercle de ses tendresses. De même qu'elle avait su jadis aiguillonner le désir des chevronnés de la galanterie par l'innocence poivrée de ses vingt ans, sur le tard elle goûta un charme doux et maternel à nouer de ses mains encore blanches et fines le bandeau de l'amour sur des yeux d'adolescents. Un sceptique chroniqueur, Francis Chevassu, nous en livrait un trait parlant. Il l'avait rencontrée, le matin, au Bois, sans équipage, presque fraîche dans sa robe de printemps et gardant, au visage, assez d'éclat naturel ou emprunté pour ne souffrir trop du voisinage des roses qu'elle avait piquées à son corsage. Où courait-elle ainsi, de son pas diligent ? Il aurait voulu la retenir, pour l'apprendre. Je ne m'arrête point, fit-elle d'un air d'espièglerie équivoque, je vais rejoindre mon petit amoureux. Follette ! remarquait-il un peu cruellement : elle avait alors un demi-siècle bien sonné. On disait d'elle, par une allusion maligne au batail Ion sacré de la vieille garde, qu'elle se rendait toujours et qu'elle ne mourait jamais. Ce terme fatal arriva, cependant, et plus tôt qu'on ne l'aurait prévu. Un terrible mal, une affection cancéreuse détruisit les restes de sa beauté. Depuis des mois, on ne la voyait plus nulle part ; elle avait déserté le théâtre, qui n'avait jamais été, selon le mot d'Edmond Le Roy, que le tremplin de ses charmes ; elle avait aussi renoncé à jouer, à la ville, le rôle de demi-mondaine inlassable. Elle cessa de vivre, à cinquante-deux ans. Léonide Le blanc avait été l'une des dernières grandes courtisanes, comme en produisit l'antiquité grecque et la Renaissance italienne, artistes, affinées en leurs goûts, formées aux conversations et aux plaisirs des hommes d'élite, et qui, très légèrement armées de valeur morale, relevaient par de l'esprit et de la culture la vénalité de leur sacerdoce. III. — Anna Deslion Humbles débuts ; ascension conquérante. — Comment elle arrêta dans ses filets le prince Jérôme Napoléon. — A propos de ce cousin de César ; le côté mœurs et femmes dans sa vie. — Comment il avait pris à cœur de ne pas démériter des exemples paternels. — Détails rétrospectifs. — Retour au logis d'Anna Deslion. — Communauté de prince et de vaudevilliste ; Jérôme Napoléon et Lambert Thiboust. — Le faste des réceptions d'Anna Deslion. — Grandeur et décadence. Belle à miracle, grande, brune, bien campée, douée d'un léger embonpoint, qui stimulait le sentiment, avec une peau mate, d'une blancheur éclatante, des yeux lascifs, de jolies mains, de jolis pieds, et une expression nonchalante, qui la rendait continuellement désirable : telle était Anna Deslion, telle on la revoit par les yeux de Zed, un chroniqueur très-informé de la Vie parisienne, pour qui les filles de marbre avaient déchiré leurs derniers voiles. Qu'elle fût la perfection accomplie, comme l'assurait Arsène Houssaye, c'était dire beaucoup. Des seins impertinents par leur fierté, des épaules tombantes, une chair de rose et de lait, des hanches savoureuses : tous ceux qui avaient assisté à ses déshabillages — ce qui n'était pas une faveur rarissime, car elle posait à la Phryné devant l'aréopage aussi complaisamment que la Barucci — juraient qu'elle possédait cela et davantage. Il fallait, néanmoins, s'apercevoir que si elle avait une bouche adorable, à fossettes, son front était petit, étroit, bombé, et que son nez d'une ligne fine se retroussait, au bout, d'une façon un peu canaille. Mais, lorsque les yeux d'un homme étaient conviés à cette fête de voir la masse de ses cheveux noirs inonder son buste opulent, ils ne s'arrêtaient guère à mesurer le diamètre du front ni la ligne impeccable du nez. On l'avait surnommée Marie-Antoinette, pour la ressemblance de son profil avec celui de la reine. La comparaison était flatteuse. Pour le reste : l'expression de sa physionomie, la tenue de son langage, les traits de son caractère et le fond de ses habitudes, elle était demeurée peuple, foncièrement peuple. D'où venait-elle ? De très bas. Si la mémoire de Marie Colombier ne l'a pas égarée dans ses dires, il serait exact que la Deslion, avant de resplendir, à côté de la Guimond, dans la loge de Roqueplan, à toutes les premières de l'Opéra, où elle attirait invinciblement les regards, n'avait été qu'une humble officiante dans un temple d'amour. Diamants, chevaux, voitures étaient encore dans les nuages lorsque, un peu plus tard, dégagée de la servitude banale, mais ayant à se demander, le matin, d'où lui viendrait le dîner du soir, elle priait la domestique des Goncourt, comme d'une grâce, avant que les maîtres fussent rentrés, de lui laisser faire le tour de leur table servie, pour se régaler les yeux d'un peu de luxe. De son manque d'éducation première elle avait gardé, dans l'étourdissement de sa chance, des façons d'être, de parler, de se tenir, sentant la vulgarité des commencements. Cette fille d'ouvrier, qui parvint à pouvoir dépenser de quatre à cinq mille francs par mois pour le blanchissage de ses dentelles, en le surprenait avant midi très abandonnée, en jupe noire, en camisole blanche et portant là-dessus un fichu jaune, le terrible fichu de la fille soumise, disent les Goncourt, — qui ne la gâtèrent pas dans leur Journal — souvent les pieds nus dans ses pantoufles. Pendant un assez long temps ce fut son obstination d'avoir à table, pour boire, un litre, qu'on ne remplissait pas de piccolo, certes, mais dont la forme plébéienne plaisait à son regard, parce qu'elle lui rappelait son enfance, où elle allait tirer le vin au tonneau. Puis, c'avait été la montée brusque, l'avènement dans la fortune insolente, les salons dorés et surdorés avec la chambre à coucher spacieuse en satin rouge, les boudoirs en satin jaune, les cabinets de toilette rehaussés de glaces, avec les cuvettes énormes en cristal de Bohême jaunes, et les bijoux sous la vitrine jetant à la clarté du jour pour trois cent mille francs d'éclairs ! La coquetterie, chez Anna Deslion, s'était éveillée moins vite ; elle était restée un peu lourde, sans beaucoup de raffinement ni d'initiative pour occuper et retenir. Elle avait les voluptés calmes. Dormir le jour et la nuit autant qu'il lui aurait été possible : c'eût été, à son goût, le bien suprême. Elle siestait avec des langueurs heureuses d'Orientale. Dans la soirée, à la première bougie qu'elle voyait allumée, elle aspirait à sa chambre, à son lit déjà. Si j'étais riche, disait-elle, bien riche, j'apprendrais à ne pas dormir le soir. Seulement elle se devait à elle-même et elle devait à ses amis de s'habiller, de veiller, de se montrer, la nuit, et fort souvent, par exemple, dans ce cabinet infernal du café Anglais, où la crème des noceurs allaient soupailler et cocotter. Avec ses airs lassés, son nonchaloir et cette insuffisance de mise en train, Anna Deslion n'en était pas moins l'une des trois ou quatre femmes, de Paris les plus lancées, les plus en vogue. Des seigneurs du premier rang s'inscrivaient à sa porte. Elle avait aussi son salon, et l'on y distinguait des princes comme Jérôme Napoléon, des auteurs dramatiques comme Lambert Thiboust, des journalistes comme Albert Wolff ; et d'autres encore, qui n'étaient point des sots. La plus considérable de ses liaisons l'avait mise dans une évidence extraordinaire. Ce fut bien, par hasard, qu'elle arrêta dans ses filets le prince Jérôme Napoléon. Rachel avait cessé de régner dans l'intime de la maison pompéienne du cousin de César. Mme Arnould-Plessy né présidait plus les joyeux dîners du Palais-Royal. Jérôme, dont le tempérament était aussi fougueux en amour qu'en politique, hésitait à qui jeter le mouchoir. Emile de Girardin, se trouvant là, lui rendit le service de diriger son choix en lui désignant Anna Deslion. Le côté mœurs et femmes tenait, en effet, beaucoup de place dans la vie de cet homme, que se partageaient, sans le contenter, les choses de la politique, des arts et du plaisir. Ce serait même l'un des plus curieux chapitres à tracer de son histoire, l'histoire d'un grand ambitieux, dont les rêves avortés dérivaient, comme ils le pouvaient, aux passe-temps de l'esprit et aux jouissances du corps. Car il chassait de race, Jérôme Napoléon, frère de la princesse Mathilde. Il avait fait ses preuves de bonne heure, sans gêne, et sachant de reste que pas un dans sa glorieuse famille, à commencer par l'auteur de ses jours, ne s'était embarrassé des règles d'une morale austère. L'ancien roi de Westphalie eût été mal venu à gourmander l'héritier de son nom pour des atteintes à la vertu. La réponse aurait été trop facile, à lui mettre sous les yeux la liste de ses exploits passés. Lorsqu'il s'était trouvé, à la suite des victoires foudroyantes de son frère, maître d'un peuple et possesseur d'un trône, le premier et plus sensible avantage qu'il avait découvert à son heureuse métamorphose, c'est que sa condition de roi allait lui permettre d'avoir des favorites autant, s'il le voulait, que de courtisans. A quoi bon régner si l'on ne commençait point par jouir ? Courte fut l'ivresse, mais complète. Jérôme Napoléon était bien entouré pour cela. Il avait appelé à Cassel, en l'instituant son lecteur et son bibliothécaire, le licencieux Pigault-Lebrun, dont la principale occupation était d'apprendre à ce chef d'Etat à être libertin sans hypocrisie et débauché sans scrupule. Quelle miraculeuse aventure pour ce jeune Corse, fils d'un bourgeois d'Ajaccio, élevé au rang d'un potentat et qui pouvait, à son aise, maintenant, vider toutes les coupes du plaisir ! Sa soif était grande. Il n'en déguisait point les exigences et ce n'était pas de moyens termes qu'il usait pour en brusquer la satisfaction. Sa femme en avait eu la preuve toute la première, dès le soir de ses noces, s'il faut en croire les indiscrétions du temps, qui représentèrent le fougueux Jérôme approchant sans ménagement une princesse orgueilleuse et timide, riant de ses pleurs, la poursuivant jusque dans les bras de sa gouvernante, Mme de Westerholz, auprès de qui elle s'était réfugiée, et jetant, par cette scène de nuit, un émoi extraordinaire dans le gynécée des dames d'honneur et des demoiselles de compagnie. Mai encouragé du côté conjugal, il s'était adjoint non pas une amie plus expansive, mais cinq à la fois, choisies à merveille pour varier le jeu du roi. On ne parlait que des cinq maîtresses de Jérôme. Aucune n'était en titre. Les confidents du prince avaient l'air de les avoir pour leur compte ; et les apparences se disaient sauves, mais elles ne trompaient personne. Les pudeurs germaniques en frémissaient d'indignation. Au bruit des orgies de Napoleonshöhe[7], les bons Westphaliens crièrent au scandale. La plainte en était montée aux oreilles de l'hôte puissant des Tuileries, qui tança vertement le coupable sur le mauvais train qu'il menait, avec ses maîtresses et ses festins : Mon frère Jérôme Napoléon, vous aimez la table et les femmes. La table vous abrutit et les femmes vous affichent. Jérôme, qui ne s'illusionnait pas sur la durée du spectacle extraordinaire que le héros donnait au monde, non plus que sur celle du régime de domination qu'il faisait peser sur l'Europe, ferma l'oreille à ces observations et continua de puiser à la source aussi longtemps qu'elle ne fut pas tarie. On peut même dire qu'il ne s'amenda jamais entièrement et qu'il persévéra jusqu'à son dernier jour dans les voies du péché. J'en rapporterai, pour preuve, une anecdote inconnue. Napoléon III dînait à la table de sa mâle cousine Elise Baciochi, agriculteur dans le Morbihan. Il était allé la visiter, pour vingt-quatre heures, à Korner-Hoüet. D'humeur causeuse, ce soir-là, il contait des histoires de famille et le trait suivant, parmi d'autres, montrant bien que Jérôme était voué à l'impénitence finale. On venait de télégraphier à l'empereur : La fin du roi est imminente. Et aussitôt il avait mandé le cardinal Morlot : Napoléon Ier est mort en catholique, dit-il. Je veux que mon oncle Jérôme meure proprement. Allez à lui, sans tarder. Le cardinal fit diligence. Sa première question en arrivant au palais est pour demander : Le roi a-t-il sa connaissance ? Ce qui, pour le prêtre, signifie : est-il en état de se confesser, de recevoir l'absolution, les sacrements ? Les mots n'ont pas la même valeur, sans doute, pour les serviteurs de Dieu et pour les gens de service. Le majordome, à qui l'on parlait de la connaissance du roi, ne douta point qu'il ne fût question de Mme de Plancy : Sa connaissance ? Mais oui, Eminence. Elle a passé la nuit auprès de lui. Elle ne le quitte pas. Le cardinal estima que sa robe rouge et la jupe de soie de la baronne pouvaient alterner, au chevet du moribond. Tout se passa convenablement ; et, en fin de compte, malgré la première connaissance et grâce au maintien de la seconde, le roi de Westphalie put quitter le monde, muni des sacrements de l'Eglise. Le prince Jérôme Napoléon avait hérité des appétits de son père pour le pouvoir, l'argent et les femmes. Nul, au monde, n'était plus exempt de préjugés. Et la pudeur, la continence étaient, à ses yeux, du nombre de ces préjugés. Quels que fussent son rang, ses titres et l'attention générale qu'ils provoquaient, le jugement d'autrui était la dernière de ses craintes. Il n'avait de règle que celle-ci : gêner le moins possible ses goûts et ses actes. Il avait, en pareil propos, des principes d'indépendance vraiment païenne. On se souvint longtemps d'une partie de chasse aux halbrands, où il en fit éclater la démonstration à la vue de tout le monde. C'était par une journée superbe de septembre, où le soleil dardait ses feux, comme au plein de l'été. Le prince avait transporté en Seine-et-Oise- le théâtre de ses exploits cynégétiques, sans restriction d'autres jeux de plaisance. Il était venu chasser le halbrand, aux étangs de Villefermoys, où, par prodige, l'un des inspecteurs des forêts de la Couronne, M. de la Rüe, était parvenu à fixer de nombreux couples de canards sauvages. On avait instruit de cette expédition les échos d'alentour. Avec Jérôme Napoléon se trouveraient là son beau-frère le prince Humbert, futur roi d'Italie, le commandeur Nigra, ambassadeur de Victor-Emmanuel, les généraux Duhesme et d'Autemarre, Maxime du Camp, le comte Primoli, le baron de Plancy et maints invités. La qualité des personnes, la nouveauté de la chasse, la splendeur de la journée, tant de raisons engageantes avaient fait sortir de leurs demeures bien des châtelaines du voisinage et nombre de femmes ou de jeunes filles des villages environnants. L'affluence des curieux et des curieuses surtout était grande pour assister au tableau des pièces abattues. Pendant qu'on attendait ce dénouement de toute chasse à tir ordonnée comme il convient, le prince Napoléon, que le soleil et l'exercice avaient échauffé, eut Le désir de prendre un bain. N'avait-il pas avisé, d'un coup d'œil, et très à propos, une cabine construite au bord de l'étang, pour l'usage balnéaire des riverains ? Il en fait demander la clef, se dépouille de ses vêtements les laisse à l'intérieur et, sans prendre garde à l'assistance, sort de là, dans un état de nudité complète, traverse pour gagner l'eau, s'y plonge, en ressort, s'égoutte au soleil, lentement, tranquillement, pour revenir à la cabine, après avoir écarté d'un geste dédaigneux le peignoir, que lui tendait son aide de camp. Les villageoises ne parurent pas effarouchées du spectacle, mais les châtelaines s'étaient précipitées dans leurs voitures avec des mines indignées et des oh ! stupéfaits, qui avaient beaucoup amusé la galerie. Tel était l'homme. Il menait à la diable ses fantaisies, ses impulsions, et se préoccupait faiblement du reste. Avec son intelligence prompte et lucide, avec ses qualités d'esprit et ses dons d'éloquence, contrecarrés par une turbulence de caractère indisciplinable, il n'avait pu être qu'un jouisseur dans, la vie et un expectant dans la politique. Au moins voulait-il que ses moments ne frisent pas tous perdus. Il avait rêvé de tenter et d'accomplir de grands desseins. La place était prise. Réduit à se croiser les bras, il s'ennuyait. La Cour et les courtisans, ces derniers surtout qu'il avait en horreur, ne faisaient que lui rendre plus insupportable cette vacuité d'âme. Pour en chasser l'impression il ne connaissait rien de mieux que la fréquentation des belles et des spirituelles. Souriant à ses visions d'antiquité, il se comparait volontiers aux sages de la Grèce lorsque, de tous leurs exemples, réalisant le plus facile à suivre, il soupait avec des comédiennes ou des courtisanes. Marié à une femme de bien, dont la pudeur était à exaspérer la Pudeur même, il avait tôt repris le chemin du demi-monde, où il se plaisait si fort. Et c'est ce genre de contentement que le prince Jérôme Napoléon, général de division, ministre des colonies, Altesse Impériale et le premier prince du sang du premier empire du monde, goûtait, pour le moment, dans les bras d'Anna Deslion, que nous avons oubliée et à laquelle il est temps de revenir. Comment s'était nouée l'aventure, Esther Guimond le racontait de bon cœur à ses amis. Un jour que, contrairement à ses habitudes, elle avait l'humeur douce et obligeante, elle s'était mise en tête, connaissant, d'ailleurs, les intentions d'Emile de Girardin et de Jérôme, d'assurer le sort de la belle Deslion. Je te ferai dîner avec le prince,
lui avait-elle annoncé ; seulement, il faudra
résister ; c'est un homme qui aime qu'on lui résiste. — C'est bien difficile, répondit-elle. — Difficile peut-être, mais indispensable. A table, Anna fut placée à côté du noble convive, très coquettement attifée, les épaules et les bras nus. La conversation s'échauffa, dès le potage. Esther, qui observait le train des choses, trouvait qu'il allait un peu bien vite. En vain donnait-elle des signes d'agacement et faisait-elle de gros yeux. On n'y prêtait aucune attention. Anna s'abandonnait visiblement aux empressements du prince. Enfin, au rôti, ne pouvant plus se contenir, Esther se leva de table, et glissa à l'oreille de sa galante protégée : Anna, j'ai deux mots à vous dire. Elle l'entraîna dans la pièce voisine ; et, lui mettant le poing sous le nez : Ah ! ça, veux-tu bien résister, petite malheureuse ! Et la Guimond, rappelant l'anecdote, ajoutait : Enfin, je me donnai bien du mal ; tout ce que je pus obtenir, ce fut de la faire traîner jusqu'à onze heures. Pour se distraire des gentilshommes et des princes, Anna Deslion lia commerce avec des gens de lettres. Elle ne collabora qu'une nuit ou deux avec Théodore Barrière, mais retint plus longtemps à son chevet le spirituel et jovial Lambert Thiboust, sur lequel nous reviennent des souvenirs. Ce Thiboust avait le caractère joyeux, le cœur bon et
exempt de jalousie, quoiqu'il s'étonnât de certains succès et les trouvât un
peu plus rapides qu'il ne les aurait souhaités peut-être, en les comparant à
sa situation acquise d'auteur dramatique. Figurez-vous,
confiait Albert Wolff à deux rédacteurs du Figaro, en se reposant sur
leur discrétion professionnelle, figurez-vous que
les jeunes lauriers de Sardou ont déjà troublé la cervelle de Lambert
Thiboust. Il vient de me dire : Ce petit Sardou va bien ; il commence à me
faire peur. Le mot fut imprimé vif, comme il fallait s'y attendre
; et Thiboust, irrité de cette félonie, avait juré ses grands dieux qu'il ne
parlerait plus à Wolff, pendant trois ans, de rien ni de personne que d'Anne
d'Autriche. Singulier châtiment d'une parole indiscrète, et qui ne tarda pas
à recevoir son commencement d'exécution. A peu de temps de là, Wolff
rencontre Thiboust, à l'encoignure de la rue Drouot. Il prend en l'abordant
son air le plus innocent, lui serre la main et lui demande : Eh bien ! mon ami, que dit-on de neuf ? Lambert Thiboust, froidement : J'ai ouï conter que le cardinal avait dansé une sarabande devant la reine ; cependant, j'ai peine à le croire. Mais, cette digression nous égare... Favorisé d'amour, pour la seule raison qu'il plaisait, la tête sur l'oreiller, Lambert avait ses jours réservés, dans la petite maison qu'occupait la demi-mondaine, rue Lord Byron. Il y était reçu, les soirs d'Opéra. Les soirs des Italiens appartenaient au prince Napoléon. Des confusions s'établirent de sorte que le hasard les fit se rencontrer dans l'escalier de la belle. Ce n'était le cas de manifester, de part ni d'autre, beaucoup de surprise. On se salua courtoisement : Trompé par un homme d'esprit, dit le prince, c'est encore du bonheur. — Déshonoré par une Altesse, répliqua le vaudevilliste, c'est encore de l'honneur. Anna Deslion se lassa la première et lui redemanda la clef de son boudoir. Très assiégée d'hommages, elle avait à limiter ses complaisances et devait partager son temps avec économie. Elle était au plein de sa gloire d'impure et ne chiffrait plus ses conquêtes. Elle ne réalisa point l'idée, qu'elle avait eue de se faire bâtir un palais, avec une piscine en marbre... où elle recevrait. Mais elle avait son hôtel et une salle de jeu bien étonnante. Dans le petit salon, réservé aux émotions du baccarat, on remarquait une vasque chinoise énorme, et dans cette vasque, qui n'était surveillée de personne, il y avait toujours de trente à quarante mille francs en or ou en billets, pour servir de fonds éventuels. On jouait comptant, c'était la règle. Celui qui se trouvait décavé allait prendre dans la vasque le nécessaire pour couvrir sa perte ou sauver sa mise nouvelle ; et, le lendemain, an y remettait ce qu'on y avait pris, très exactement. Où reverrait-on, aujourd'hui, pareille chose et dans des conditions telles de confiance ! Cela dura à peu près une année. Anna Deslion y avait gagné du cent cinquante pour cent, par le nombre d'amis généreux que la curiosité de la circonstance avait poussés chez elle. Le fracas de son luxe, en ce temps-là, était étourdissant. Lorsqu'elle recevait tout le monde, a dit un de ses meilleurs amis, c'étaient des fêtes royales ; lorsqu'elle recevait son amant, c'était encore tout le monde. Tant de prospérité n'alla pas jusqu'au bout sans éclipse. Tout le long du chemin, Anna Deslion avait ruiné passablement de cocodès et de rastaquouères opulents. Quant à compter, supputer, balancer la recette et la dépense, quant à se faire des rentes en prévision des saisons froides et moroses, elle n'y pensa oncques. Du jour où le prince Napoléon s'était retiré d'elle pour tourner sa fantaisie du côté de Léonide Leblanc ou s'afficher avec Cora Pearl, la fortune d'Anna Deslion avait commencé à s'obscurcir. Ce déclin eut des arrêts ; la baisse eut des retours à la hausse ; puis, ce fut une descente rapide, implacable. On vit ses élégantes féminités, ses dentelles, ses meubles précieux s'entasser à l'Hôtel des Ventes, ce capharnaüm usuraire, comme l'appelait Paul de Saint-Victor, ce pandemonium de luxe et de misère, de ruines et de maléfices. Qu'étaient devenus tout à coup ses équipages de haut style ? Où s'en était allée cette cour d'adulateurs, qui se pressaient chez elle, à flot, comme l'inondation envahissant les maisons ?... Elle traîna ses derniers ans, soutenue plutôt qu'entretenue par un Espagnol au cœur fidèle, un gentilhomme Perez, qui s'était ruiné précédemment à son service, et s'éteignit dans un petit appartement de la rue Taitbout, où végétaient tristement quelques débris épars de son ancienne splendeur. IV. — Julia Beneni, dite La Barucci Courtisane complète, et fière de l'être. — Tableau d'un souper de prince ; la plus audacieuse des présentations. — Un appartement très visité, au 120 de l'avenue des Champs-Elysées. — Soirée d'amour et soirée de jeu. — L'affaire Calzado-Garcia-Barucci et son retentissement. — Fin prématurée de la belle Romaine. Lorsque Giulia Barucci — la belle Bibirucci, comme l'appelait Marcelin —, ayant en poche quelques rares deniers, les employa pour voyager de Rome à Paris, avec l'espoir d'y moissonner fortune, ses visées n'avaient rien de complexe. Modèle ou courtisane elle vivrait par sa beauté. De l'orbe de ses yeux noirs, à la fois profonds et doux, par moments traversés d'une expression violente, quand y passait la flamme de la colère, sortait un feu magique. Une opulente chevelure brune réchauffait la matité de son teint. Sa bouche lascive était pareille à un fruit de pourpre. Son col et sa gorge avaient en perfection la blancheur et le plein, si goûtés des connaisseurs... On ne la laissa pas longtemps languir dans les séances de pose. Un M. de Danne, dont le nom figurait en place honorable sur le livre d'or de la vénerie française, avait eu le flair d'un bon chasseur de proie féminine. Il sut à propos braquer son monocle sur cette belle créature à prendre. Sous les pauvres ajustements il avait pressenti des formes divines. Il l'arrêta, rhabilla et l'emmena dîner. Ce fut dans un restaurant très fréquenté du demi-monde, sous l'enseigne du Petit Moulin rouge. De tiers avec ledit seigneur et la Barucci se trouvait, comme invité, un homme du meilleur monde, écrivain d'art, au surplus, et qui, longtemps après, tisonnant des souvenirs, remuant des historiettes, en glissait des détails à mon oreille attentive. Oui, lui disait l'amphitryon, c'est une petite Italienne, que j'ai découverte en me promenant. Que pensez-vous de la trouvaille ? — Exquise, adorable. La question appelait la réponse. Il n'y avait pas d'autres mots à prononcer en la circonstance ; mais, par hasard, ces superlatifs n'avaient que la valeur de la vérité. Mais si de la considérer était un ravissement, on éprouvait moins de plaisir à l'entendre. Son vocabulaire français était maigre, et le peu qu'elle connaissait de cette langue, elle le mêlait à l'idiome italien en une sorte de jargon assez barbare. Au demeurant, pendant le repas, l'occasion manqua pour juger si elle avait ou non de l'esprit. De temps en temps elle se levait de sa chaise, courait à la glace ornant ce salon particulier, étroit comme une alvéole de ruche, se mirait, s'ajustait en s'écriant : Grande Dio ! que je suis belle ! Elle n'articula pas d'autres paroles de toute la soirée. Telle une de ses compatriotes, danseuse à l'Opéra, enivrée de son rôle et comme folle de son corps, s'arrêtait devant le miroir et embrassait son image en s'admirant : Que tu es belle ainsi, ma fille ! Ce premier protecteur était de commerce aimable, mais l'état de ses finances conseillait un train modéré et ne permettait point qu'on croquât les louis d'or, en sa maison, comme des pralines. La Barucci avait les dents belles et gourmandes. Elle s'était dit qu'elle aurait à changer de dépendances avant qu'il fût longtemps. L'accord durait depuis un mois, pas davantage, lorsque le beau prince d'Hénin, l'ayant trouvée de son goût, l'en avertit sans détours. Le pauvre Anatole, comme elle appelait celui qui lui fournissait le vivre et le couvert, à défaut du superflu, ne pesa pas lourd dans la balance : entre les deux son cœur n'hésita point. Elle quitta sans hésitation la chaumière pour le palais. Quelques mois plus tard, le tiers convive, qui avait eu l'heur de toaster aux débuts de la Barucci, cheminait à pas lents sur l'avenue des Champs-Elysées. Comme il tournait l'encoignure d'une des rues débouchant sur le rond-point de la magnifique allée, il entendit qu'une voix chuchotante l'appelait par son nom ; une jeune femme, accoudée à la fenêtre d'un entresol, l'engageait à s'arrêter pour lui rendre visite. Il monta l'escalier, pénétra dans l'appartement, reconnut et félicita Julia sur le luxe qui l'environnait. Oh ! dit-elle, vous n'avez pas vu mon coffret à bijoux ; allons l'admirer dans ma chambre. Elle tenait à ce qu'il mesurât des yeux l'espace parcouru entre l'autrefois et le présent et se rendît compte, à ces preuves, de tout ce que peut obtenir une femme de beauté, sans autre peine ni sacrifice que l'abandon voluptueux de son corps. Voici l'objet, dit-elle. Et il jeta ses regards sur ce coffret merveilleux haut comme la cheminée et divisé par cases bien définies. Elle ouvrit les tiroirs. Chacune de ces cachettes précieuses, capitonnées d'ouate et de soie, ne servait que pour un genre unique de pierreries. Il y avait le compartiment des diamants, le compartiment des émeraudes, et celui des perles ou des rubis et celui, enfin, des simples bijoux en or. Aux rayons du soleil filtrant par la fenêtre mi-ouverte les diamants allumaient leurs blancs éclairs. C'était éblouissant. Elle en était la plus fière du monde. Quant à mêler à toutes ces richesses un souvenir de tendre gratitude pour celui-ci ou celui-là, quant à remonter par l'amour aux sources de ces trésors, c'est à quoi elle ne songeait vraiment point. Toutefois, on n'aurait su dire qu'elle eût le cœur ni les sens glacés. Elle ressentait des toquades subites, qui prenaient les apparences d'une passion exaltée, farouche et jalouse, avec des abandonnements, que suivaient des effusions pleines de fougue. Ces intermèdes violents se renouvelaient par périodes, comme de six mois en six mois ; et puis, en moins de rien, s'évanouissaient. Giulia Barucci avait une ligne superbe, des mouvements d'une aisance patricienne et une allure, une démarche, qui lui donnaient vraiment grand air, quand elle se tenait au calme, et' sans parler. Mais de l'éducation, de la pudeur, un souci quelconque des mondaines convenances, de tout cela pas une ombre. Son principe était que la beauté n'a de règle aucune, sinon le culte de soi pour le plaisir d'autrui. A l'inverse de bien des femmes de sa condition, chez qui subsistent presque toujours un fond d'honnêteté et un semblant de vertu, l'idée qu'elle se faisait de son rôle était de se montrer courtisane complète dans toute la superbe et toute l'impudicité de son œuvre de volupté. Il ne lui venait jamais à la pensée qu'elle eût à fournir pour excuse cette éternelle histoire d'un premier amour trompé[8], l'erreur d'un jour et la cause de perdition d'une vie promise aux joies honnêtes de la famille ! Le besoin de respect était un désir inconnu d'elle. Elle s'intitulait la plus grande... de Paris et du monde. Ma plume se refuse à écrire le mot, mais il se devine si aisément ! De ce mérite équivoque elle tirait gloire avec ostentation. Tous les princes, a écrit l'une de ses tendres amies par la plume de Maxime Formont, passèrent en son alcôve. Ils n'eurent pas à s'en repentir, s'il est vrai qu'elle fût avec ses gestes lents, ses nobles attitudes l'universelle idole. Pas toujours si nobles, pourtant, dans leur inconscience osée, ces gestes, ces attitudes ! La vérité nous oblige à le confesser ; et, s'il nous est facile de le remarquer d'une façon générale, il le sera beaucoup moins d'en exposer des preuves flagrantes, telles que l'histoire de son dévêtement trop audacieux en présence du prince de Galles et de ses commensaux à la Maison d'Or. Combien nous seront nécessaires les détours de l'euphémisme et les ombres de la périphrase pour en voiler la nudité ! L'héritier du trône d'Angleterre qui, longtemps après, devait révéler, dans le calme exercice du pouvoir, des qualités de premier ordre, noyait alors dans le vin de la fête les langueurs de son inaction forcée. Entre autres fantaisies nées du besoin de se distraire, il avait manifesté le désir qu'on lui présentât ce qu'il y avait de mieux comme demi-mondaine. Giulia Barucci avait eu les honneurs du choix, à l'unanimité. Il fut convenu qu'on organiserait un dîner, où seraient priés, en même temps, des amis du prince. Gramont-Caderousse, à ces choses très entendu, en voulut être l'ordonnateur. Le jour, l'heure, le menu du souper, les détails de la présentation, avaient été préparés avec un soin parfait. On n'avait pas oublié de faire la leçon à Giulia, dont on appréhendait soit une saillie malheureuse, soit une incartade déplacée en présence de Son Altesse Royale. Jusque dans les parties les plus joyeuses, il importait de maintenir un reste de décorum : — Tu auras de la tenue, disait-on à la belle Romaine ; n'oublie pas le titre et le rang de celui auquel tu devras t'appliquer à plaire ; reste aimable comme toujours ; et, si tu le peux aussi, sois convenable. — Mais oui, mais oui. Ne croirait-on pas qu'on ne sache point ce qu'il faut aux grands de ce monde ? Elle avait promis, en outre, de n'arriver point en retard au rendez-vous, comme elle en avait la mauvaise habitude et comme elle allait en fournir la preuve une fois de plus. En effet, on eut à l'attendre. Depuis trois quarts d'heure elle aurait dû être là. Le prince donnait des signes d'impatience. Enfin, elle s'annonça, tranquille, contente de soi, avec son teint chaud, ses lourds cheveux partagés en deux bandeaux et nattés derrière la tête ; elle parut, le corsage en avant, très décolletée et portant une robe d'étoffe si légère qu'elle semblait enveloppée d'un voile impondérable. — Monseigneur, prononça le duc de Gramont, je vous présente la femme la plus inexacte de France. Serait-ce un reproche ? La réplique ne tardera pas. Giulia se retourne et, dans un geste si prompt qu'on en fut comme ébloui, écartant les derniers voiles, elle découvrît à la vue du noble amphitryon les blanches rondeurs de ses charmes callipyges. La chose n'avait duré qu'une minute. Quel irrespect ! Quelle impertinence ! Sont-ce là des façons, quand on a l'honneur d'être invitée à la table du prince de Galles ! Elle, ingénument, s'étonne des observations grondeuses qui lui sont adressées : — Comment ! ne m'avez-vous pas dit qu'il fallait être aimable pour le prince ? Je lui montre ce que j'ai de mieux. Et ça ne lui coûte rien ! Giulia Barucci avait de ces candeurs énormes. Le témoin oculaire, qui m'en certifia le détail, en avait été sur le coup passablement offusqué. Mais le prince d'Albion aux yeux connaisseurs ne fit qu'en rire ; chacun ensuite l'imita, et le festin fut continué, à la satisfaction générale. Elle occupa longtemps un appartement connu du tout Paris fashionable, au 120 de l'avenue des Champs-Elysées. Elle n'y donnait pas que des rendez-vous clandestins. On y dînait. On y dansait. On y jouait surtout. C'est là qu'eut lieu, dans la nuit du 4 février 1863, une bataille de cartes des plus mouvementées, et dont les suites provoquèrent un bruit énorme, sous le nom de l'affaire Garcia et Calzado. Pour fêter la prise de possession de son hôtel des Champs-Elysées, Julia Barucci avait prié à une soirée, chez elle, un certain nombre de ses amis. Il s'agissait de prendre le thé, puis de souper gaîment ensemble. La réunion fut nombreuse. Garcia, le joueur impénitent, réputé dans tous les tripots à la mode, et son ami Calzado, directeur du Théâtre-Italien, avaient eu vent qu'il viendrait là des jeunes gens fortunés. Ils n'eurent garde d'y manquer, espérant bien stimuler aux coups de cartes hasardeux ces opulents fils de famille. Avant le souper, Garcia avait amené le comte de Miranda à lui faire face au trente et quarante. Le grand seigneur espagnol commença par gagner, et lorsqu'on se leva pour passer à table, la perte de Garcia s'élevait à une trentaine de mille francs. Il fallait réparer ce dommage. Garcia et Calzado étaient avertis que Miranda portait plus de cent mille francs en poche, et c'était une proie qu'ils entendaient ne pas laisser échapper. Pendant le festin, on avait remarqué que l'un et l'autre, à tour de rôle, s'étaient absentés plusieurs fois et assez longuement. Aussitôt qu'on eut sablé la dernière coupe de Champagne, ils retournèrent au salon de jeu. Comme pour animer la galerie, ils entamèrent l'un contre l'autre des parties simulées d'écarté. Autour d'eux ne se manifestait que peu d'entraînement à reprendre la partie, soit qu'une vague défiance se fût élevée dans l'esprit de ces gentilshommes, soit qu'ils se rappelassent avec raison qu'on n'était pas venu pour cela, mais pour se divertir en prenant le thé. Enfin Miranda se décida à courir les chances du baccara. Garcia lui faisait face. Le jeu prit aussitôt des allures inquiétantes. En quelques minutes les pertes de Miranda étaient énormes. Elles montaient à plus de cent mille francs. Les coups se présentaient d'une façon bizarre. Calzado, qui ne jouait pas, mais gagnait en pariant, comme à coup sûr, sur les mises de Garcia, avait éveillé une attention soupçonneuse. On échangea des regards. Plusieurs des invités se concertèrent. Ils se rapprochèrent de la table ; on regarda de plus près, et il fut reconnu clairement qu'on avait mêlé aux jeux, qui avaient servi toute la soirée, des cartes neuves, distinctes pour celui qui les y avait glissées. Garcia, absorbé par sa veine frauduleuse, ne s'était pas aperçu de la surveillance dont il était l'objet. Comme il venait de ramasser encore soixante-quatre mille francs, l'un des jeunes gens, Feuilhade de Chauvin s'écria : Ce jeu est trop cher ; ce n'est point ici un tripot ! Caderousse, nettement, lança cette apostrophe au visage de Garcia : Vous avez ajouté des cartes ! Vous avez triché ! Un troisième posa son chapeau sur les cartes, pendant que Mme Barucci donnait l'ordre de fermer toutes les portes. Ce fut une émotion, un tumulte extraordinaire. Tous sommèrent Garcia de restituer les sommes qu'il avait indûment gagnées et de se laisser fouiller, ainsi que Calzado ; on avait vu tomber des vêtements de celui-ci une liasse de billets de banque, qu'il avait essayé de dissimuler. Après de violentes protestations, Garcia était arrivé à abandonner une quarantaine de mille francs. Il en avait reçu le triple. Où était le reste ? Alors commença une poursuite vive et continue ; les billets de banque semaient le sol de l'appartement. Des sommes considérables furent ramassées derrière les sièges et les rideaux, et rendues à Miranda, auquel manquait encore une trentaine de mille francs. Il porta plainte ; l'affaire eut un retentissement prodigieux. On arrêta Calzado... Garcia s'était enfui. Pendant qu'on instruisait ce procès, — qu'il appelait une mauvaise nuit, — Garcia prenait patience devant le tapis vert de Monaco. Le mardi 20 mars 1863, à onze heures du matin, on vit affluer au Palais de Justice, les aspirants auditeurs, les gens de loi, les notabilités du monde et de la société parisienne, le Jockey-Club, les journalistes et une multitude de curieux, se déversant par tous les vomitoires du monument. Julia Barucci eut à comparaître sous les yeux de cette assistance extraordinaire ; elle était venue en toilette étudiée, tout en noir et tout enveloppée de fourrures serpentant sur les contours de son manteau de velours. Elle répondit aux questions, puis s'en retourna à sa place, convaincue qu'elle avait déposé comme oun anze ; et avec cette douce satisfaction de soi qui ne l'abandonnait jamais, elle distribuait ses sourires anzéliques à l'auditoire masculin. La personne et le témoignage net, incisif, du duc de Gramont[9], si sûr de sa position, de son esprit et de sa volonté, produisirent une vive impression. Et après lui, passèrent tour à tour : Feuilhade de Chauvin, le comte Gaston de Poix, le marquis de Vivens, le comte d'Ignauville, le vicomte Robert de Brimont et le comte de Noblet. L'avocat général rendit évident que Calzado n'avait pas été seulement le complice de Garcia, mais son co-auteur. Ils furent condamnés, Garcia par défaut, à cinq années de prison et Calzado à treize mois de la même peine. Il a été raconté que Giulia Barucci, par complaisance ou par intérêt, à ses moments perdus, prêtait son appartement des Champs-Elysées pour des rencontres intimes, d'où elle était absente ; et que d'honnestes dames y occupèrent passagèrement, — étant avec leurs amis, deux ou quatre, — sa grande chambre à coucher, au lit monumental tout garni de valenciennes, ou son boudoir capitonné, au jeu de divans et de chaises longues expertement combiné. Quoi qu'il en fût de ces désaffectations occasionnelles, pour service mondain, du temple d'amour où la Barucci déshabillait sa beauté, il est certain que bien des puissants personnages s'y introduisirent et y demeurèrent, n'ayant en vue qu'elle seule. Elle y fut l'objet, entre autres, d'un chassé-croisé d'intrigues, qu'Arsène Houssaye a détaillé plaisamment. Un homme célèbre du Second Empire — dont il n'est pas malaisé de deviner le nom tant de fois répété dans nos récits — était possesseur légitime d'une femme charmante et passionnée, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une maîtresse aussi charmante et non moins passionnée. Il avait les goûts divers et instables ; c'était encore son faible d'aimer la comédie et les filles d'Opéra, sans préjudice des hasards de la rencontre. Or, par une nuit d'hiver, sa femme s'était réveillée matinalement. Comme le sommeil l'avait quittée et qu'elle s'ennuyait seule, la fantaisie lui vint de se glisser, comme une belle aurore, dans la chambre à coucher voisine de la sienne. Hélas ! le mari nomade n'était pas dans son lit. Oh ! mon Dieu, s'était-elle écriée avec la franchise de termes d'une simple Manon, il sera retourné chez cette catin, lui qui m'avait tant promis de ne plus la voir ! Décidément, il fallait en finir. Elle s'habille hâtivement, et, sans avertir sa femme de chambré ni personne, elle s'échappe, elle court à l'adresse de sa rivale. Elle sonne. On ouvre. Elle entre, elle se précipite vers la chambre à coucher, animée d'un ardent courage, prête à tous les scandales. Mais ! là non plus n'est pas celui qu'elle réclame. Qu'y a-t-il donc ? Que voulez-vous si matin ? demande la personne surprise par cette invasion. — Ce qu'il y a ? pourquoi ? vous le savez bien ; je viens chercher mon mari. — Mais il n'est pas ici. — Dites plutôt que vous le cachez dans une armoire. Il n'en est rien, pourtant, et c'est la maîtresse qui devient jalouse à son tour : Votre mari n'est pas chez vous ; mais alors, il nous trompe ! Et, pour un peu, ces deux femmes qui, tout à l'heure, se seraient arraché les yeux, maintenant pleureraient, dans les bras l'une de l'autre, en se disant que l'infidèle était allé dormir chez la Barucci. De l'appartement des Champs-Elysées, où elle avait connu tant d'heures joyeuses et qui fut occupé depuis par Gordon-Bennett, Julia Beneni alla s'installer dans son hôtel de la rue de la Baume, mais ce fut pour y couler des jours de langueur et de tristesse. Sous des apparences triomphantes, avec son port de reine, ses lèvres rouges, son corps moulé comme une statue antique, elle portait en elle les germes d'un mal mortel. Pendant les enivrements des soirs de Bade, comme on riait et tapageait autour d'elle, elle avait laissé tomber ces mots qu'elle se hâtait d'en prendre sa part, parce qu'elle n'aurait pas longtemps à vivre, parce qu'elle était guettée par la phtisie. Alors, on s'était raillé d'elle en disant qu'elle voulait jouer les Dames aux Camélias. Elle en mourut, cependant, et ce fut après les sombres événements de la guerre. Son prince était resté dans la capitale assiégée ; et, malgré l'inclémence do la saison, malgré la fragilité de sa poitrine, elle avait tenu à y rester comme lui, prise au cœur, pour la première fois, d'un véritable amour. Il est si beau, murmurait-elle, pâle et les yeux brûlants de fièvre, qu'on oublie qu'il est si riche ! V. — Adèle Courtois Une existence tranquille et satisfaite. — L'esprit d'ordre dans le désordre. — Sur le tard, conversion éclatante d'Adèle Courtois. — Comment sa maison semblait n'être plus qu'une annexe de l'église Notre-Dame des Victoires. — Spectacle édifiant d'une fin de carrière. Vivant sur le pied de cent mille livres de rente, à sa guise, et sans compromettre une santé, qui lui était chère, dans les folles aventures de jour et de nuit, avouant qu'elle n'avait aucune vocation pour la haute noce, ajoutant qu'il fallait à ce métier-là ce qu'elle n'avait point : la capacité de deux estomacs et les forces de quatre ouvrières, préférant à la gloriole, au paraître dont quelques-unes de ses pareilles étaient éprises étourdiment, la commodité d'une vie bien ordonnée dans le désordre, au reste ne surfaisant point son intelligence moyenne, mais se tenant, à bon droit, satisfaite de son sort : Adèle Courtois, qui habita jusqu'en 1904, un luxueux appartement rue Pierre-Charron, fut la plus tranquillement heureuse de toutes ces irrégulières. Dès la première rencontre presque, sa chance avait été fixée. Le gouvernement danois venait d'envoyer à Paris, parmi les membres de sa légation, un diplomate très avantagé de biens, mais à qui la morale courante reprochait des penchants plus que bizarres. Il avait paru convenable et nécessaire de l'en tenir averti. Ordre lui fut donné secrètement d'avoir à faire cesser ces fâcheux bruits, ou de sauver, au moins, les apparences. Le baron s'était mis en devoir d'obéir ; il avait cherché l'alibi féminin, qu'on exigeait, et il le trouva dans la belle personne d'Adèle Courtois, renommée sur la place. Ce fut au mieux des deux parts. Elle n'était pas embarrassée de préjugés ; la tiédeur de son tempérament lui permettait de n'être pas exigeante ; elle se contenta donc d'être sa maîtresse honoraire, sans y rien perdre, d'ailleurs, quant au positif de la chose : toilettes, voitures, train de maison. Impatient de se réhabiliter dans l'estime des femmes, le baron ostensiblement la promena, l'afficha comme sa dernière conquête. Une après-midi qu'il l'avait à sa droite, dans un landau découvert, levant le nez, se pavanant, voulant être vu, reconnu, vint à passer l'impératrice. Soit distraction, soit maladresse, il salua. Le lendemain, la souveraine demanda pourquoi le baron n'amenait point sa femme aux Tuileries. Avec beaucoup de ménagement on expliqua qu'il n'était pas marié, qu'il ne l'avait jamais été, et qu'il conduisait sa maîtresse au bois... Et il ose me saluer ! s'écria-t-elle. L'impératrice s'en plaignit comme d'une atteinte formelle et grave aux bienséances. Des représentations furent adressées de haut au malavisé diplomate, qui fut suspendu de ses fonctions pour avoir suivi trop à la lettre — extérieurement parlant — les avis de son gouvernement. Par quel miracle parvint-elle, la pseudo-baronne, à devenir la célèbre Courtois, entourée d'opulence et comblée de satisfactions ? Personne n'a jamais pu le comprendre. Notoirement... cela se disait et se répétait : elle avait l'air bien ; elle paraissait de bon genre, sous ses aspects de bourgeoise discrète et rangée. On ne se compromettait pas avec elle ; on prenait, en son chez soi, des habitudes de liaison calme et régulière ; on tendait presque à s'y incruster, comme Edmond de Castries, un très joli garçon, qui, pendant vingt ans, si je ne me trompe, eut des retours de constance pour son alcôve. Tout en avançant sur le chemin de la vie, Adèle ne se résignait point à languir dans l'isolement du cœur ; mais elle se consolait de la perte de sa jeunesse par celle de ses amants. On la citait, du reste, avec admiration, pour la fière résistance qu'elle opposait à l'assaut des années. Les changements de saisons n'effleuraient que d'une atteinte lente et peu sensible son visage régulier et doux. Les attraits, qui furent, au printemps de sa vie, sa gloire facile et son triomphe, gardèrent, jusqu'à l'extrême limite, leur séduisante action. Lorsque s'imposa enfin l'heure du renoncement, elle se composa une seconde existence en se jetant dans la dévotion, qui, pareille à l'amour, prend toutes les nuances du caractère. Les galants étaient partis ; les prêtres et les nonnes, à leur suite, pèlerinèrent chez Adèle Courtois, objet de leur considération infinie. Ce fut un beau spectacle que cette métamorphose. Elle s'était rendue l'exemple vivant des Manons converties. Sa piété, sa charité, ses largesses répandues dans le sein de l'Eglise, édifiaient les serviteurs des autels. Elle-même ne se souvenait plus de l'ancienne Adèle Courtois. Qu'elle n'eût point gagné ses millions par de pieux exercices, elle le savait, hélas ! mais comme on la faisait souffrir en le lui rappelant ! Son âme n'allait plus qu'aux pensées graves. Nulle pratiquante n'était assidue autant que la dévote Courtois aux messes de Notre-Dame des Victoires ou aux offices de Sainte-Geneviève. Son cocher la conduisait régulièrement, le matin, à l'église de Notre-Dame des Victoires ; et pendant que le valet de pied gardait la voiture, cet homme ingénieux allait s'agenouiller devant l'image de saint Antoine de Padoue. Il demeurait là, comme pétrifié, dans l'attitude la plus recueillie. Sa maîtresse ne pouvait manquer de l'apercevoir, en cette posture. N'est-ce pas Jean, qui prie là-bas devant l'autel consacré au bon saint Antoine de Padoue ? demandait-elle à sa femme de chambre. — Oui, madame, c'est Jean. L'impression était produite. On comblait de gratifications le pieux domestique. Vers ce temps, elle eut comme une dernière velléité sentimentale en faveur d'un jeune homme du nom de Leverd[10] : Oh ! protestait-elle, ce n'est pas de l'amour profane, mais de l'amour divin. Maintes fois, au retour de la maison de Dieu, elle lui disait : — Mon enfant, j'ai prié pour toi, ce matin. — Oh ! merci ! Il écoutait ses sages conseils, baissait la tête sous ses remontrances, et, l'ayant assez entendue, la quittait pour aller voir de petites femmes. Chacun prenait le ton dans cette succursale de l'église, où passaient et repassaient continuellement, comme sous le porche d'un monastère, des coiffes et des robes de bure. Elle avait sans cesse des sœurs à sa table. Souvent elle renvoyait le maître d'hôtel et se plaisait à les servir. Rien n'était si touchant. Oh ! ma sœur ! on entendait souvent ces mots ponctuant un religieux entretien. Ô mon Dieu ! soupirait-elle. Je suis prête. Prenez-moi quand vous voudrez. Elle n'était qu'amour pour le Seigneur et ses ministres. Elle nourrissait neuf Pères blancs. Il était un point, cependant, où il ne semblait pas qu'elle eût signé une renonciation complète aux frivolités de ce monde. Très tardivement elle conserva l'envie de se déguiser en jeune femme. Je la vis à soixante-treize ans, fort soignée dans sa mise, et elle en donnait cette raison : — Quand les femmes sont jeunes elles s'habillent et se parent, dans le dessein de plaire ; quand elles ne le sont plus, c'est pour ne pas déplaire. VI. — Adèle Rémy Crise de jeunesse sentimentale. — Douces liaisons. — Quelques lettres. La blonde et frivole personne d'Adèle Rémy n'apparut jamais avec l'éclat de triomphe dont s'enveloppait une Barucci, une Deslion. Les organes officiels du demi-monde, les journaux littéraires et artistiques, dont les tendresses de rédaction étaient sans bornes pour les cocottes illustres, ne firent point sonner son nom dans leurs échos avec la persistance et le fracas qu'ils apportaient à répéter celui d'une Cora Pearl. Néanmoins, on lui reconnaissait des états de service signalés, au cours de ses galantes campagnes. Elle avait la grâce attractive, l'intelligence très découverte et des talents secrets. Avec cela du montant, de l'originalité sous des apparences tranquilles et de l'initiative à rendre jalouses les plus savantes. Je m'abstiendrai de reprendre une histoire d'escarpolette à deux[11] auprès de laquelle paraîtrait chaste le célèbre tableau de Fragonard et dont les détails avaient eu pour témoins fâcheux des regards qu'on n'avait pas conviés à la fête, sous les grands arbres. Il était difficile de la voir sans l'aimer et plus difficile encore de la quitter, quand on l'avait connue. Des amis d'importance grossirent la liste de ses amants. Ses émules de haut bord la recherchaient et qui, plus est, aidèrent à la lancer. Nous citions tout à l'heure un billet de Léonide Leblanc, la grande biche, comme elle signait, fort complimenteur pour cette autre biche. En remuant les papiers intimes de celle qui fut l'ensorcelante Adèle Rémy, j'y découvre une autre lettre de pareille origine, celle-ci de Cora Pearl, sans grande signification en soi, mais intéressante parce qu'elle nous montre qu'on s'entr'aidait, à l'occasion, chez ces dames. Paris, 61, rue de Ponthieu. Chère Adèle, Si vous ne partez pas pour la campagne avant dimanche, vous serez mille fois aimable de venir dîner à la maison, en revenant des courses. Ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance avec le baron, qui vous a trouvée, hier, une toute charmante maîtresse de maison. Ne me refusez pas. Je désire vous prouver, dans mes petits moyens, que je sais être reconnaissante des gracieusetés que vous avez toujours eues pour moi. Il n'y aura que trois dames en nous comptant, et trois ou quatre messieurs, pas plus de huit personnes : un petit dîner sans façon à la mode de mon pays. Toute à vous et mille gracieusetés, Cora PEARL. C'était sa marque particulière : n'ayant ni le goût ni le tempérament faits pour les dissipations effrénées, aux changements perpétuels elle préférait les liaisons prolongées, qui ressemblaient à des mariages successifs. Elle avait des coins d'âme où fleurissait le sentiment. Toute jeune elle eut son roman, sa passion de tête. Et pour qui ? Pour un vague inconnu sur lequel elle n'eut pas seulement daigné, quelques années plus tard, abaisser sa prunelle. Mais elle l'avait choisi dans ses rêves adolescents. C'était son héros, son idéal, je n'ose dire son type. Lui, cependant, allait sa route sans prendre, aucune attention à la fillette ingénue, qui suivait ses pas d'un regard chargé d'adoration. Elle en avait reçu un désespoir affreux, et jura d'en mourir. Elle avait allumé déjà le réchaud fatal... Il était temps ! Son voisin de chambre, un artiste, un peintre nommé Peaublanc, enfonça la porte et l'arracha à ce vain sacrifice. Quel enfantillage ! dut-elle se dire, quand fut venu l'âge de raison. Elle avait pu faire cela, elle, Adèle Rémy, elle avait pu vouloir s'asphyxier, au temps jadis, comme une grisette hystérique ! C'était à ne pas croire !... Une fois au haut de la roue, elle n'oublia pas son sauveur, son peintre, et lui fit commander des copies de tableaux richement payées. Adèle n'échappa pas à l'école de la misère ; mais elle n'y traîna pas longtemps ses chaussures. Avant de se fixer à l'ami sérieux et positif, que fut, pour elle, le baron d'Opff, elle noua quelques attaches passagères. Elle avait gardé des inclinations à la tendresse. On ne lui connut point cette ordinaire impassibilité des courtisanes, due à leur naturel mépris pour leur moyen d'existence ; elle se restreignait dans ses choix assez pour s'épargner le dégoût et conserver encore le désir. Tout cœur bien épris recherche la solitude : dans les verdures de Saint-Nicolas, près de Senlis, elle nicha de sincères amours ; et ce fut, par exemple, en faveur d'un officier des Guides et poète de cour, qui n'y passait point le temps à feuilleter avec elle les Commentaires de César. Pour lui, étourdiment, elle avait quitté le baron d'Opff, le protecteur dont les hommages amoureux s'accompagnaient du solide, qui reluit et qui sonne. La brouille survint, comme il en arrive toujours de ces sortes de liaisons. Elle en eut le cœur tout malade. Il fallut qu'elle changeât de pays, afin de distraire son âme dolente. On dut s'ingénier, dans le cercle de ses connaissances, à seconder ses intentions de voyage, en lui procurant, sur le parcours, des moyens de se guérir doucement. Ainsi, le prince Joachim Murat s'empressa d'y concourir, en lui traçant son itinéraire, et en l'appuyant de cette singulière lettre de recommandation auprès d'un autre officier de l'armée d'Afrique : Paris, le 28 octobre 1862. Mon cher de Gressol, Je charge de vous remettre elle-même cette lettre d'introduction une personne que vous connaissez, comme tous les anciens des Guides, depuis longtemps. Des troubles étant survenus dans la vie intime de la camarade de Gasquet[12], elle éprouve le besoin de se dépayser pendant quelque temps. Je vous l'adresse donc, afin que vous soyez assez bon, au moins pendant les premiers jours, pour l'initier à la vie orientale. Je suis heureux, mon cher Gressol, d'une telle et si favorable occasion pour vous assurer de nouveau de mes plus dévoués sentiments de camaraderie. Prince Joachim-Napoléon MURAT. A travers ses courses au nord et au midi, Adèle Rémy manqua devenir princesse. Je ne sais plus à quelle date précise, elle était partie en Russie avec le jeune prince Bagration. Il était fou de sa chevelure, qui se déroulait en ondes soyeuses jusqu'à ses talons, et des attraits de sa personne entière. Elle se disposait à agréer ses offres. On la déconseilla d'accepter une proposition dont les suites regrettables auraient été de la tenir enfermée perpétuellement dans un château du pays des neiges. Les horizons parisiens lui eussent été fermés à jamais. Adieu les libres essors, à la campagne voisine, adieu cette douce indépendance qu'elle adorait au-dessus de toutes choses ! Adèle repoussa la couronne. Elle fit ses adieux mouillés de larmes au cher prince, qu'attendait une fin si tragique[13], et revint à Paris. Différents noms se confondirent sur son carnet d'alcôve, étrangers comme celui de Wieloposki, français comme ceux de Riancourt et de Martigny. Mais surtout elle avait retrouvé son baron, qui ne cessa point de la revoir, lui conserva une flamme fidèle et poussa la prévoyance jusqu'à lui laisser une pension, quand il mourut. Cet homme de bien lui voua une constance méritoire et qui faisait l'édification des compagnes d'Adèle Rémy. On dînait chez Cora Pearl. Il y avait là des viveurs réputés. L'audacieuse Cora eut l'idée de faire le tour de la table, dévisageant ses invités, ressaisissant ses souvenirs. Vraiment, dit-elle, il n'y a que le baron d'Opff avec qui je sois restée vierge. Des amours durables et des amitiés illustres : Adèle Rémy posséda ce double privilège. Alexandre Dumas fils, entre autres, qui eut toujours un faible d'indulgence pour les sœurs de sa Dame aux Camélias, Dumas, qui se laissait appeler par Mogador, passée comtesse de Chabrillan, son grand ami, et qui n'en déniait pas le titre non plus à Esther Guimond, avait gardé un souvenir affectueux d'Adèle Rémy ; et il le lui marqua dans plusieurs lettres, comme celle-ci retrouvée par hasard, et où il s'annonçait en visiteur. 98, avenue de Villiers. Je reçois une lettre de Mme de Ghabrillan, qui me demande si je me souviens de vous. Vous n'êtes pas de celles qu'on oublie et souvent je me suis demandé ce que vous étiez devenue. Vous êtes châtelaine et campagnarde, paraît-il, et, de plus, à Senlis, où j'allais quand j'avais quinze ans, et que je reverrai avec plaisir, avec d'autant plus de plaisir que je pourrai vous y serrer la main. Dites-moi vos heures, et vous me verrez apparaître, dans le premier rayon de soleil, qui me rappellera la couleur de vos cheveux. Mille bons souvenirs, Alexandre DUMAS. On a pu s'en rendre compte : Adèle Rémy n'était pas exclusivement une jolie femme et une maîtresse désirable. Elle avait d'autres qualités : l'esprit vif, les manières élégantes, et le ton irréprochable, — hors de sa chambre à coucher. C'était son penchant, son idée fixe, j'ajouterais presque sa marotte, de viser à la distinction. On l'avait surnommée la petite femme du monde, et ces mots, comme une suprême louange, la remplissaient de joie. Elle s'était composé un cadre très XVIIIe siècle ; son bonheur était qu'on la photographiât ou la peignît, sous les atours d'une marquise d'antan. Elle en venait à croire que la chose était arrivée et qu'elle descendait en droite ligne de cette aristocratie régence. A son insu, elle prenait quelquefois de petits airs de hauteur. Elle en avait conçu un brin d'orgueil, qui ne fâchait point ses amis, mais les disposait à sourire des prétentions nobiliaires d'Adèle Rémy. VII. — Esther Guimond Une curieuse physionomie d'irrégulière. — Son cercle à Paris. — Esprit et caractère de cette collectionneuse de célébrités. — A l'occasion d'une vente de demi-mondaine ; un joli tour d'Esther Guimond ; Antonia Sari et la rédaction de la Presse. — Ce qu'eussent été, ce qu'eussent dit les Mémoires d'Esther Guimond, s'ils n'avaient pas été qu'une espérance, un projet. Entre ces irrégulières nulle n'était plus remarquée par les côtés originaux de sa physionomie que la prodigieusement adroite Esther Guimond. Sortie de bas lieu, à peine savait-elle écrire. Et, cependant, elle avait assez, d'esprit naturel pour en prêter à plusieurs. Beaucoup d'entregent et d'audace s'alliait, en elle, à un cynisme imperturbable. On en citait maints exemples. Ses mots étaient colportés, soit qu'on les relevât sur place, soit qu'elle les eût rapportés de voyage, comme ce trait-ci. Elle pérégrinait dans la péninsule italique. A la descente du bateau de Naples, les douaniers, qui examinaient ses passeports, lui demandèrent sa profession : Rentière, fit-elle. On ne l'avait pas comprise. Elle fut priée de répéter le mot. Alors elle cria aux gens qui l'interrogeaient : Courtisane !... Et retenez-le bien, pour le dire à l'Anglais, qui est là-bas. Je crois même qu'elle s'était servie d'un autre vocable plus populaire. Elle s'était composé un cercle, à Paris, qui n'avait rien de banal. Amis ou amants, Guizot, le prince Napoléon, Emile de Girardin, Roqueplan s'étaient succédé ou s'étaient rejoints dans ses relations. Alexandre Dumas fils l'avait prise en amitié, s'il ne la tenait pas en estime. Il écrivit chez elle une partie de la Dame aux Camélias. Nestor Roqueplan, le Parisien achevé, recherchait ses appréciations et leur attribuait d'autant plus de prix qu'elle ne l'aida pas seulement de ses avis, soit dit en passant, mais de sa bourse. Emile de Girardin, qui, par contre, lui fit bâtir un petit hôtel, au coin de la rue de Chateaubriand[14] lui soumettait ses feuilles volantes, sûr d'avance qu'elle trouverait à glisser ici ou là une observation ou un trait de malice profitable. Ses propos, ses anecdotes, ses médisances fournissaient à la chronique. Volontiers elle signalait des sujets et, de préférence, quand ils devaient tourner au déplaisir d'une personne de ses amies. Car, nous aurons a le redire, son âme n'était rien moins que douceur, aménité, charité. Des journalistes se rendaient auprès d'Esther Guimond en consultation d'articles. Et, à ce propos, le comte de Lagrené, avec sa mémoire intarissable, me faisait le récit d'un amusant souvenir personnel. Elle et lui conversaient. On parlait d'Emile de Girardin, l'une des puissances du jour, et de son journal la Presse, une feuille célèbre où s'exerçaient les meilleures plumes des lettres françaises : Une occasion admirable se présente, déclara-t-elle ; je vous engage à en profiter sans retard. Antonia Sari, dont vous connaissez l'installation somptueuse, rue Scribe, va être vendue. Au commencement de la semaine prochaine aura lieu l'exposition de ses meubles. Ecrivez donc une chronique là-dessus. Ce sera pour la curiosité des grandes dames un morceau de friandise. Lagrené endosse le conseil d'Esther comme un effet de sa complaisance et n'hésite pas à le mettre en circulation. Rentré chez lui, il brode d'une plume agile d'ingénieux motifs autour de cette information alléchante, y ajoute quelques réflexions bien senties sur les brusques vicissitudes de la fortune et remet la page à Girardin, qui la fait imprimer toute vive. Les femmes du monde ont appris avec joie une nouvelle aussi intéressante. Sous prétexte d'acquérir un objet d'art, un colifichet de toilette, elles pourront aller la comme dans un mauvais lieu où elles auraient le droit d'entrer. Plusieurs journaux ont reproduit les lignes révélatrices de la Presse. N'est-ce pas une sorte d'événement parisien ? La vente a été annoncée pour le mardi. Le mercredi, survient tempétueusement Antonia Sari chez Edmond de Lagrené ; la colère enflamme ses yeux et son visage ! Elle accable l'écrivain de reproches- et y ajoute presque des menaces. Car elle n'est pas venue seule. Un homme de belle carrure et de forte barbe est entré avec elle. Lagrené a paru surpris de ce renfort de visite ; pour rendre la conversation égale, il sonne son valet de chambre et l'engage à s'asseoir en face du visiteur inconnu. Antonia comprend la leçon ; elle invite son garde du corps à se retirer ; le valet de chambre du comte aussitôt le suit dans sa retraite. Le ton de la belle s'est apaisé ; néanmoins, elle continue à se plaindre du tort qu'on lui a causé, dans l'exercice de sa douce profession : Vous avez ruiné mon crédit ! s'est-elle écriée. — Mais non, lui répond le coupable auteur. Vous savez bien, madame, que tant que les affaires ne sont point paralysées, le crédit reste sauf. Elle n'a rien perdu de sa beauté, de sa grâce reconnue, de ses talents variés. Doit-elle avoir souci de ces difficultés passagères ? Elle sourit. On arrive à se comprendre. C'est Esther qui vous a dit cela, n'est-ce pas ? Pure jalousie de femme. Elle ne me pardonne pas de lui avoir pris son Girardin. L'entretien se termine en douceur. On se quitte presque bons amis. Edmond de Lagrené croit l'incident clos ; il s'en félicite et n'y songe plus. Mais, en sortant de chez lui, la perfide Antonia n'a rien eu de si pressé que de courir au logis d'Emile de Girardin et de se répandre en doléances sur l'indiscrétion de son rédacteur. D'où résulte une semonce directoriale. Il faudra retourner à la Presse, redonner des explications, se justifier en quelque sorte. Très mécontent de l'aventure, Lagrené projette un coup d'éclat. Descendant à l'imprimerie du journal, il donne l'ordre de composer immédiatement un filet qu'on suppose venir en droite ligne du cabinet de Girardin. Or, ce filet était ainsi conçu : Nous devons reconnaître nos erreurs. Nous nous sommes trompé, quand nous avons dit que Mlle Antonia Sari avait été vendue par autorité de justice. Fidèle aux principes qu'elle a toujours suivis, elle s'est vendue elle-même[15]. Ce fut un beau tapage, le lendemain. On parla de duel, d'échange de témoins entre le directeur de la Presse et l'auteur de la note. Toutefois, les choses n'allèrent pas au delà d'une brouille momentanée. Esther Guimond avait infiniment d'esprit, mais d'une sorte d'esprit sans bienveillance et fertile en intentions mauvaises. Elle occupa une bonne partie de sa vie à faire le mal, blessant à droite et à gauche, ne ménageant ni les hommes, ni les femmes, encore moins celles-ci. C'est en exaltant les transports d'une passion jalouse, insinuait-on, qu'elle avait provoqué le suicide de Mme Bazaine. Elle employa un génie infernal à brouiller les gens, à jeter le doute ou la colère dans les âmes, à susciter la discorde à travers les unions régulières ou irrégulières, qu'il lui plaisait de troubler. Elle jouissait avec une inconscience parfaite des discordes qu'elle avait causées. Cette Esther Guimond, qui avait passé ses jours au milieu des suicides, des empoisonnements et des scandales, dont elle avait plus ou moins aidé les dénouements tragiques ou risibles, eut son tour de cruelles souffrances. Elle s'en plaignait au Ciel comme d'une peine imméritée. Les ravages d'un mal intérieur la condamnaient à des souffrances intolérables. Elle se mourait d'un cancer. Lagrené, qui connaissait en détail son passé de malfaisance, était venu la voir, pendant la période aiguë de sa maladie. Il la trouva, comprimant ses entrailles de ses mains crispées : J'ai là, disait-elle, comme un chacal qui me dévore. Oh ! pourquoi, dois-je souffrir ainsi ! Et elle ajoutait : Moi qui n'ai fait de mal à personne ! Entendant cela, Lagrené n'avait pu s'empêcher, en sortant, de lancer ce mot aux domestiques : Allez chercher le médecin : elle a le délire ! De tant d'intelligence et de malignité quelles ressources elle aurait pu tirer en les mettant au service d'une ambition durable ! N'avait-elle pas été mêlée intimement à mille intrigues, à toute espèce d'aventures clandestines et de secrètes machinations ? Les Mémoires d'Esther Guimond ! Elle y songea sans cesse. Elle en parlait à tous ses amis, cherchant partout une plume dévouée dont c'eût été le rôle de se mettre à la besogne complaisamment et discrètement. Maurice Talmeyr, qui fut de ses derniers visiteurs, en a devisé spirituellement, dans ses souvenirs journalistiques. Il l'avait entendue si souvent faire l'affiche de ses éternels Mémoires, sans jamais les montrer, qu'il brûlait d'impatience d'en connaître enfin quelque chose, ne fût-ce qu'un chapitre, un fragment, un paragraphe. Il se rendait chez elle assidûment, à cette intention-là. A chacune de ses apparitions se répétait le même cérémonial. Aussitôt qu'avait résonné le timbre de la porte, il voyait se soulever derrière une fenêtre un petit rideau de couleur. La femme de chambre, qui Pavait reconnu, venait ouvrir la grille et l'introduisait dans la bibliothèque. Régulièrement il y trouvait Esther Guimond occupée à fouiller de ses petites mains ridées et jaunies les tiroirs d'un meuble vitré. Là dormaient les documents précieux, le corps des Mémoires. Ah ! s'écriait-elle, en retirant du tabernacle un paquet ficelé et le posant sur une table, tu viens causer des Mémoires ? Eh bien ! les voici, regarde. Et elle se plongeait dans ses paperasses, sans en rien livrer. Tout est là... mon enfance, mes débuts dans la couture... et la suite. La couture ; ça n'allait guère, la couture ! Elle feuilletait avec fièvre, tenant à distance le regard et la main du visiteur : Que de noms amis ! continuait-elle. Et quels amis ! Il n'en manque pas un. Voilà Sainte-Beuve... Voilà Musset... Et Roqueplan... Et Girardin !... Et Jérôme... Elle n'arrêtait pas de nommer et de remuer. Voyons donc ! disait Talmeyr en se rencoignant dans son fauteuil, prêt à écouter une lecture, qui devait être, à en juger par ces préambules, d'un intérêt extraordinaire. Cependant, elle continuait à fourrager dans ses notes. Tiens ! c'est, maintenant, un billet de Victor Hugo. Ecoute-moi cela : Quel jour ? Quelle heure ? Voulez-vous lundi ? Préférez-vous mardi ? Craignez-vous vendredi ? Moi, je ne crains que le retard du plaisir. — Commençons donc ! Je suis tout oreille. — Attends ! attends un moment. Et elle repartait à la poursuite de ses souvenirs, sur des traces qu'elle saisissait au passage : Ah ! Dumas ! Alexandre Dumas fils
! Un homme encore, celui-là ! Il eut toutes les joies, toutes les gloires.
Mais il avait tellement souffert, étant enfant ! L'Affaire Clemenceau
en dit long sur les misères de sa vie de collège. Car, le petit collégien,
c'était lui-même. On l'avait mis en pension, et comme abandonné là ; nous
étions seulement deux ou trois amies de son père, qui allions le consoler de
temps en temps... Alors il pleurait,
pleurait. Et nous lui remontions le moral avec des caresses et des gâteaux. Elle ne s'arrêtait plus : Et la Dame aux Camélias. Tu te souviens bien du cinquième acte, la scène où elle meurt. Or, celle qui meurt là-dedans, ce n'est pas elle ni une héroïne imaginaire. C'est moi, Esther Guimond, que Dumas a fait mourir dans cette scène-là. J'étais malade de la fièvre typhoïde. On m'avait presque condamnée. Et il se trouvait là, au moment d'une de mes syncopes, qui pouvait bien être la dernière crise ! II s'était assis près de mon lit et ne me quittait plus du regard, quand tout d'un coup me voyant reprendre mes sens et revenir de si loin, il s'écria : Ah ! j'ai mon cinquième acte ! Et que de choses encore ! J'en pourrais causer jusqu'à demain sans épuiser la matière... Et devine qui m'a lancée ? Guizot, oui, le grave, l'austère, le respectable Guizot. J'étais encore, en ce temps-là, dans mon atelier de couture ! Ah ! cette malheureuse couture ! — Or donc, voyons, lisons. — Quoi lire ? Il faudrait d'abord que ce fût écrit. — Comment ! La chose n'est donc pas faite ? — Mais non ! Et c'est dommage...
Ah ! si je savais écrire ! Quand je songe à tout ce que j'aurais pu mettre
sur le dos de Girardin, par exemple ! On aurait eu à le soigner, celui-là
aussi ! Car, entre nous, Girardin... Est-ce que je pourrais, en toute vérité,
dire uniquement du bien d'un homme qui, pour mon roulage, ne me donna jamais
que ses vieux coupés ?... Ah ! je puis en raconter... J'en connais !
Seulement, j'aurais besoin qu'on me vînt en aide. Roqueplan avait commencé à
y mettre la main. Et comme il s'y entendait ! Hélas ! Roqueplan est mort. Les
autres aussi sont morts. Et les Mémoires en sont toujours à l'état
d'espérance. Mais tu es là, toi, à propos. Veux-tu, dis-le-moi, veux-tu être
mon blanchisseur ? On n'avait pas prévu celle-là ! Alors de se retirer en douceur, d'alléguer des faux-fuyants, et, en dernière raison, de gagner la porte pour ne plus revenir. Inutiles furent les rappels dont la poste transmettait l'instance de huit jours en huit jours. Lé confident espéré ne se montrait pas. Et les Mémoires embryonnaires ne sortirent point de leur obscure cachette. Lorsque les journaux, en des échos clairsemés, annoncèrent à la fois la mort et les obsèques d'Esther Guimond, les notes furent brèves. Des lignes écourtées sur son âge, sur son ancienne célébrité et l'oubli où s'était enfoncée sa vie : on n'en mit pas davantage. Et de tous ses anciens amis il n'en parut qu'un seul à l'enterrement. Un seul, dis-je, eut de la mémoire : Alexandre Dumas fils. Il s'était rappelé les gâteaux du collège. VIII. — Les sœurs Resuche et Caroline Hassé Sur la liste des patriciennes de l'amour s'inscrivaient encore les sœurs Resuche. L'une, baptisée Armande, de taille courte et irrégulière, et en qui des regards de femmes sans complaisance découvraient un dos bombé et des pieds plats, rachetait ces imperfections de la nature par un savoir-faire particulier, qu'on appelait le génie des combinaisons. Des amies par contre la gratifièrent d'un surnom fâcheux. L'un de ses amants, un fils de famille, avait rendu le dernier soupir chez elle, ne lui léguant que sa dépouille mortelle en héritage : pieusement elle l'avait fait inhumer dans un sien mausolée ; et, depuis ce temps-là, les méchantes langues ne la qualifiaient plus autrement que la femme au cadavre. Pauvre Armande Resuche ! L'autre, dénommée Constance, eut des destins plus complètement heureux. Svelte, grande et d'une jolie blondeur, celle-ci était véritablement belle ; au surplus, elle avait autant de bonté dans l'âme que de séduction en sa personne. Elle était l'amie déclarée du marquis de Galliffet ; car, avec son mépris parfait de l'opinion publique et privée en ces matières, le fringant officier ne prenait aucune peine pour envelopper cette liaison des ombres du mystère. Quant à Constance, elle n'était pas femme à retenir l'expression de ses sentiments. Pendant la guerre de Crimée, où Galliffet signala sa bravoure, ce galant officier français avait fait disposer pour elle, à l'arrière-garde, une tente ornée de cachemires de l'Inde. Et des officiers de son escadron, dont l'esprit était frotté de littérature, s'empressèrent à dire que c'était Clorinde auprès de Tancrède. Trompée par son amour ou cédant trop à ses illusions, elle avait fortement aspiré aux consécrations du mariage. Il s'était fait quelque bruit autour de cela. La famille de Galliffet avait dû intervenir. Des questions d'argent s'y mêlèrent ; et les tribunaux, avec leur indiscrétion habituelle, jetèrent les yeux là-dedans. Des traces en restèrent, en de certaines pièces cataloguées à la Préfecture de police et cotées sous un numéro spécial avec cette estampille : Affaire concernant la demoiselle Constance. On disait, à Bade, les deux Caro, en parlant de Caroline Letessier et de Caroline Hassé. Les actions de cette dernière avaient monté sur le marché de la galanterie, depuis qu'elle avait fait gratifier Daniel Wilson d'un conseil judiciaire, à la -suite des folles dépenses où elle avait entraîné ce viveur à froid. Un violent accent alsacien, des façons un peu lourdes et des traits sans délicatesse ne l'avaient pas empêchée de parvenir. Caroline Hassé a été l'une des premières horizontales de grande marque, qui se soient établies au boulevard Malesherbes. Elle y affichait un luxe tapageur. Lorsqu'elle se présentait aux regards, l'air osé, le front haut, le buste en avant et portant en montre une gorge bien assise, Caroline Hassé impressionnait les sens. Le visage seulement laissait à désirer, sous le rapport de la féminité, de la grâce attractive. Quelqu'un de notre connaissance le lui avait fait un peu cruellement sentir, à l'occasion. Dans un festin de réjouissance avait été placé près d'elle un jeune et séduisant gentilhomme. L'entrain qu'il n'avait cessé de déployer d'un bout à l'autre du repas et le piquant de sa conversation avaient charmé Caroline. Elle l'invita à la reconduire chez elle. Il y resta et, sous l'impression d'une fin de souper, parmi les fleurs, les vins et les femmes, il se montra à la hauteur de sa bonne fortune. Un sommeil réparateur borna le cours de ces exploits. Il faisait grand jour, au dehors, lorsqu'il s'éveilla, le premier. Impatient d'admirer sa conquête, il écarta les rideaux et la contempla dormant, les cheveux dénoués. Sur l'oreiller ne reposait point la jolie tête qu'il aurait désiré y voir. Telle fut sa déception qu'il se jeta au bas de la couche et s'habilla précipitamment. Il voulait fuir. Cependant, elle avait déclos ses paupières : Qu'est-ce ? Où vas-tu ! Quel
vertige te prend ? — Oh ! ne me le demande pas.
Rester davantage est impossible. Je suis le fils d'un orléaniste, et tu
ressembles trop à Louis-Philippe ! La comparaison était dure, physiquement parlant. C'était, du reste, juger d'elle avec un peu de rigueur. Tous n'en parlaient pas de même, fort heureusement pour cette désirable personne aux traits empreints d'une certaine virilité, mais grande et bien tournée, fort élégante, qui ravagea le cœur et le coffre-fort de Daniel, et brilla, sans conteste, parmi les étoiles les plus apparentes du demi-monde[16]. IX. — Marguerite Bellanger Son noviciat. — Du cirque au théâtre. — Des débuts singuliers et sans lendemain. — Le quartier favori de ses campagnes galantes. — Changement à vue. — A la suite de la fameuse rencontre impériale. — La rieuse Margot est devenue la favorite de César. — Ce que dura cette faveur. — Après 1870. — Métamorphose de Marguerite Bellanger en milady Coulback. — Dans une maison de Touraine. La Marguerite des Marguerites, ainsi l'appelait un écrivain de boudoir de ses amis, grand amateur du mundus muliebris et n'y regardant pas de si près pour lui décerner ce compliment superlatif, qu'on accorda jadis à la plus spirituelle des princesses de France, Marguerite d'Angoulême. C'était beaucoup d'honneur. Elle débuta de façon modeste dans la voie des libres échanges, cette favorite de hasard, cette vice-impératrice de quelques nuits. Son nom véritable et ses simples origines fleuraient médiocrement le parfum d'aristocratie. Elle avait nom Julie Lebœuf, un nom fâcheux à porter, dans ces milieux de mœurs faciles, pour la confusion du masculin et du féminin auquel il induisait trop volontiers les gens dénués de politesse. Aussi avait-elle remplacé de bonne heure Julie par Marguerite et Lebœuf par Bellanger. Du côté de l'éducation, les parents qui veillèrent sur sa jeunesse en étaient restés aux tout premiers rudiments. Elle-même n'éprouva pas le besoin d'en compléter les lacunes. Jolie de visage sans avoir beaucoup de physionomie, fine de taille sans être grande, ayant la bouche faite pour les baisers et les yeux pour les œillades, elle jugea qu'il ne lui en fallait guère davantage et qu'elle se créerait bien avec cela une place dans le monde. Son noviciat d'amour n'eut rien de romanesque ; les choses se passèrent en des coins de villes provinciales, à Angers, à Nantes, et dans des conditions que je ne dirai point très particulières, étant, comme elles le furent, publiques. On la vit plus tard écuyère de cirque, déployant, à cheval, de la grâce, de la souplesse, caracolant, sautant, faisant de la haute école et distribuant du bout des doigts, à la ronde, les baisers quêteurs d'applaudissements. Des amateurs de ses talents privés la dissuadèrent de continuer ces exercices périlleux. On lui conseillait le théâtre. Elle n'en avait le goût que très modérément. Bien des jolies femmes d'alors, demi-mondaines par vocation, s'étaient senties piquées à fleur de peau de la tarentule dramatique. Elles se plaisaient à relever d'une apparence d'art les colifichets de la galanterie. Comme nous l'avons vu, Marguerite Bellanger n'eut pas longtemps cette fantaisie, cette velléité. Ludovic Halévy me contait, un matin — et de quelle façon attrayante ! — l'histoire de ses débuts sans lendemain. Meilhac et lui-même, gui la connaissaient bien — surtout Henri Meilhac— avaient arrangé pour elle un spectacle, au minuscule théâtre de la rue de la Tour-d'Auvergne, alors dirigé par un nommé Boudeville, professeur, acteur, organisateur, et qui n'était pas éloigné de croire que sa petite maison ne fût le dernier refuge de l'art dramatique français. C'est le même Boudeville qui, par miracle, ayant aperçu aux fauteuils d'orchestre un confrère, s'était précipité sur le théâtre pour adresser à Mme Gibeau, sa meilleure élève, ces paroles mémorables : Tenez-vous bien, mon enfant, le directeur de Belleville est dans la salle ! Ce théâtre jouissait d'une certaine réputation d'originalité, pour le caractère indépendant de ses artistes et les allures bruyantes de son public. On se souvenait qu'à l'une des dernières représentations, cinq jeunes gens facétieux, qui occupaient une loge de face et qui n'avaient pas été satisfaite : du spectacle, en avaient manifesté publiquement d'abord par des bâillements en mesure, puis en se coiffant tous ensemble de bonnets de coton, en signe d'ennui. La représentation avait été suspendue. Un agent de police avait dû prier les manifestants de rentrer les bonnets de coton dans leur poche, l'hilarité des spectateurs empêchant l'amoureux en scène de continuer sa tirade, — qu'il débitait, les mains derrière le dos, comme Napoléon, à la veille d'une bataille. C'était le ton de l'endroit de parler haut en plein spectacle, de siffler avec rage ou d'applaudir avec fracas Mlle Bellanger était-elle informée suffisamment de ces dispositions du parterre et des loges ? Le plus certain de l'affaire est qu'elle avait eu l'ambition de jouer Mademoiselle de Belle-Isle, tout comme Mme Arnould-Plessy. Elle devait y paraître, ce soir-là, en même temps qu'une femme rendue célèbre par le détournement d'un mineur, un mineur de dix-sept ans, le jeune Brousse, qui s'était laissé séduire sans résistance, fut réclamé par sa famille, s'assagit, devint sur le tard un homme grave et fonda des prix d'Académie. Armée d'un beau courage, et, d'ailleurs, jolie comme un cœur, Marguerite entra en scène. Elle manquait évidemment de préparation. Elle parut gauche ; et les amateurs de céans commencèrent à manifester leur opinion d'une manière indiscrète. Les murmures grossissaient jusqu'au tapage. Elle ne s'obstina point, mais, arrêtant les frais du dialogue sur un dernier mot au public : zut ! elle ramassa ses jupes et quitta la scène. Ces façons lestes n'étaient pas pour ramener le calme dans les esprits. L'assistance, qu'on laissait là sans pièce et sans acteurs, poussait des cris aigus. Le directeur Boudeville était dans la désolation et conjurait Meilhac de ramener la fugitive. C'est une affaire très ennuyeuse, soupirait-il, et, ce qui est plus désagréable encore, c'est que nous allons être obligés de rendre l'argent. Voyons, mon cher monsieur Meilhac, vous avez de l'autorité sur cette capricieuse, décidez-la donc à revenir. Meilhac ne dit pas non, va retrouver Marguerite Bellanger dans la coulisse, lui fait valoir de bonnes raisons, et n'obtient, malgré tout, aucun succès de son ambassade. Je joue pour m'amuser, répliquait-elle. Je ne veux pas qu'on m'ennuie. Et puis, j'en ai assez. Elle ne sortait plus de là. Les gens, au dedans, continuaient leur vacarme. On avait éteint le gaz, en la salle. N'importe, ils réclamaient encore à pleine voix, du milieu de l'obscurité. Il fallut, cependant, qu'ils s'en allassent. Et ce fut l'unique représentation de Mlle Bellanger. Elle espérait bien que les succès de la femme remplaceraient ceux que n'aurait pas obtenus la comédienne. Aux jours de ses demi-réussites, le quartier favori de ses campagnes galantes était l'avenue de la Motte-Picquet, sur les confins de l'Ecole militaire. Les officiers de la garde y avaient établi une sorte de colonie spéciale, où présidaient les jeux et les ris. On n'y voyait pas de maisons hautes autant qu'à présent, mais des villas simplettes et des séries de logements, entre cour et jardin : Mars et Vénus y voisinaient en excellents termes. L'élément civil se tenait discrètement à l'écart de ce caravansérail militaire, comme l'appelait un de ses hôtes du temps héroïque ; en revanche, l'uniforme y commandait prépondérant, indiscuté. Ce n'était que flamboiement d'aiguillettes et d'épaulettes d'or, sous le clair soleil. L'aspect de plein jour en était plutôt sérieux et tranquille ; il se modifiait sensiblement, à la tombée du soir. Il était visible alors que les habitants de l'avenue de la Motte-Picquet se sentaient véritablement chez eux. On en prenait tout à son aise, fréquentant de maison en maison, allant de porte en porte, sans se soucier de la tenue réglementaire. Furtivement ; glissait sur la chaussée la traîne soyeuse d'une jupe élégante ; c'était l'incomparable Barucci, ou la très belle Constance Resuche, ou Lucile Mangin, Catinette, Esther Duparc, Marguerite Bellanger, se rendant en visite chez ces messieurs de la Garde. De certains soirs, il y avait rassemblement au quartier. Les fashionables de la bande étant de service et ne pouvant songer à faire une intime bombance dans l'intérieur de Paris, ils convoquaient à domicile la fleur de la haute bicherie et, c'était, aux alentours de minuit, un train, un vacarme érotico-militaire, dont se seraient horrifiés les bourgeois du Marais. Si j'en crois un témoin et, sans doute, un acteur de ces jeux nocturnes, qui en coucha les détails par écrit, maintes fois, on risquait, en pénétrant, au hasard, chez le lieutenant ou le capitaine X..., de trouver l'escalier en ébullition et illuminé a giorno, le palier encombré d'accessoires de festin, et la maison tout entière envahie par des couples épanouis, qui manquaient totalement d'austérité. Marguerite était la bienvenue en ces lieux hospitaliers. Non pas qu'elle tînt un des premiers rôles, le rôle à effet d'une Barucci, d'une Esther Duparc, ni qu'elle y prétendît seulement : elle ne suivait qu'à respectueuse distance le pas des illustres cocottes. Son prestige était mince et, de ceux-là qui s'égayaient au feu de son humeur réjouie, nul ne se serait imaginé qu'elle dût être appelée jamais à des destinées extraordinaires. On la savait bonne fille, toujours dans le ton de la fête, blagueuse, jouisseuse, noceuse en diable. De l'esprit elle n'en avait pas du plus fin et suppléait à ce qui lui manquait en cela par une hardiesse de mots, imagée Dieu sait combien ! car, elle poussait aux bornes extrêmes la franchise du langage. Tantôt sur le point d'atteindre aux raffinements du luxe et tantôt battant la dèche, elle s'en allait, par la vie, au petit bonheur, lorsqu'une rencontre inespérée, une chance fantastique la tira de l'ombre. Comment se produisit la chose, on l'a narré de différentes façons. Et, de cette manière, d'abord. Par une après-midi de printemps, la rieuse Margot se promenait seule, à pied, dans le parc de Saint-Cloud. Elle sortait d'un rendez-vous ou s'y rendait. Tout à coup, le ciel chargé de nuages se fond en eau ; le tonnerre gronde ; la pluie tombe à torrents : elle se blottit en hâte sous un arbre. Elle y attendait, depuis quelques moments, la fin de l'orage, quand, brusquement, débouche, sur l'avenue, dans son phaéton à la livrée vert et or, le maître du château, rentrant de sa promenade habituelle. Elle s'incline, gentille et respectueuse, devant l'empereur ; il a eu le temps de l'apercevoir, mouillée, transie, et semblant espérer quelque sauveur sous son arbre ; rapidement, par une inspiration de galant homme, il saisit la couverture qu'il avait sur les genoux, la lui lance, disparaît et s'efface dans une rapide vision. Margot, sans posséder une intelligence primesautière, n'était pas une sotte. Comme elle rentrait chez elle, à petits pas, sous la protection du plaid impérial, elle se mit à réfléchir au meilleur moyen possible de revoir l'auguste donateur. Il était plus que roi et dominait de haut tous les hommes de son empire ; mais il n'était lui-même qu'un homme faillible auprès des femmes, et soumis en esclave à l'appel de ses sens. Marguerite était expérimentée là-dessus ; elle eut bon espoir. Ayant des intelligences au château, elle se permit d'en tirer avantage et arrêta la résolution ferme d'y pénétrer, sous le prétexte d'une mystérieuse restitution. Et, en effet, le lendemain, entre onze heures et midi, l'aide de camp de service, entrant dans le cabinet de Napoléon III, soumettait à son attention qu'une jeune femme s'était présentée, qu'elle sollicitait d'être reçue par Sa Majesté, qu'elle n'avait pas voulu donner son nom et qu'aux objections qui lui avaient été faites sur l'impossibilité d'accueillir une telle demande elle avait répondu, en insistant beaucoup, qu'il fallait absolument qu'elle vît l'empereur, qu'elle avait à lui remettre à lui-même un objet précieux, et qu'elle ne s'en irait point avant d'avoir rempli sa mission. Intrigué, Napoléon désira qu'on lui esquissât l'image de cette singulière et obstinée visiteuse ; aux traits qui lui en furent dessinés, il parut se souvenir ; et comme si l'odor di femina l'eût déjà pénétré de son essence subtile, il laissa tomber ces mots : Qu'on la fasse entrer. La nouveauté de la démarche, les façons vives et originales qu'employa cette jolie fille du peuple, pour remercier le souverain de sa bonté de la veille et le prier aussi de lui continuer ses bontés du lendemain, émurent les sens impressionnables de ce froid voluptueux. Il se dit à part soi que ce serait là une maîtresse agréable et divertissante, qu'elle le changerait, par intervalles, de l'atmosphère lourde et solennelle, où le confinait sa grandeur ; et peut-être lui vint-il à l'esprit qu'ayant aimé jusqu'à ce jour tant d'étrangères, deux Anglaises, une Espagnole, des Italiennes, des Polonaises, des Russes, des Américaines[17], il pourrait bien aussi nationaliser ses sentiments en les reportant sur une Française. Et il avertit l'intendant de son palais, chargé du service des femmes, qu'il eût à comprendre Mlle Marguerite Bellanger sur la liste de ses gratifications particulières. Voici, maintenant, une autre version moins romanesque et plus vraisemblable. Depuis quelque temps, autour du maître, les confidents de ses faiblesses intimes, se préoccupaient de l'ascendant qu'il avait laissé prendre sur sa volonté, et qui pesait jusque sur les tendances de sa politique extérieure, à la fière, indépendante et fantasque comtesse de Castiglione. Ils appréhendaient un retour de favoritisme féminin, rappelant les complaisances de l'ancien régime. Pour détourner l'empereur de cette liaison tyrannique et compromettante, ses fidèles du service intime avaient projeté de faire naître, à propos, une inclination sans importance et sans péril, choisie hors de la Cour et des Tuileries. On avait failli porter les yeux sur une sémillante actrice, Marie Colombier ; et celle-ci, plus tard, en publia le secret, non sans laisser deviner son regret très vif d'avoir manqué l'heure. Le hasard, un hasard apprêté, servit mieux la fortune de Marguerite Bellanger. Napoléon eut occasion de la voir, dans une partie de chasse, montant à merveille et menant hardiment son cheval sur l'obstacle. Il était sensible aux prouesses d'amazone et l'avait prouvé en décernant une couronne à la plus belle chasseresse des grandes équipées de Fontainebleau et de Compiègne. Un rencontre fut arrangée dans un pavillon de Saint-Cloud. Le sultan en sortit satisfait. Les gamineries de Margot, ses irrévérences déclarées à la face de l'étiquette, ses familiarités grivoises l'avaient mis en belle humeur. Il trouvait du piquant au sans gêne, à la grosse gaîté, aux libres propos de sa nouvelle conquête. Il y prit goût. Gela dura deux années. Mocquart avait acheté, pour Marguerite, un petit hôtel, rue des Vignes. La chronique fit courir le bruit que l'empereur y venait fréquemment, accompagné de son secrétaire. Marguerite Bellanger était passée, dans l'opinion parisienne, à l'état de petite puissance. Elle excitait des curiosités. On se demandait, on voulait savoir par quels enchantements cette ancienne écuyère de cirque avait établi son pouvoir en si haute place. On en cherchait les raisons bien loin. Sur la réputation de son espiègleries l'idée s'était formée qu'elle était spirituelle, Un gentilhomme de grand âge, sceptique et voltairien, très dix-huitième siècle, le marquis de Montaigu, éprouva avec une force étrange le désir de s'en assurer. Il demandait à tous ses amis comme une faveur inestimable qu'on lui procurât l'heur de voir et d'entendre M 116 Bellanger. Il y insistait, il y mettait une pétulance singulière chez un vieillard de quatre-vingts ans. Vous qui l'avez un peu connue, disait-il à un ancien ami et collaborateur de Girardin, de qui je tiens l'historiette, ne voudrez-vous pas me prêter aide ! Intervenez, agissez, faites-moi dîner avec la favorite, un soir qu'elle ne sera pas requise au petit coucher de l'empereur. Vous aurez contenté l'un de mes derniers vœux, et je vous en aurai une gratitude extrême. — Quelqu'un de mes amis, répondit Charnacé, aurait plus de chance que moi-même de l'amener à ce que vous désirez. C'est le baron de Pierre. Je vais l'en prier, de ce pas. M. de Pierre se prêta de bon cœur à la fantaisie du marquis. La favorite sut donc, sans tarder, qu'on souhaitait ardemment l'avoir à dîner entre amis, et n'y opposa pas de résistance. Le marquis de Montaigu, informé du succès d'une négociation qu'il s'imaginait devoir être plus laborieuse, ne se tenait pas d'impatience. Sûrement, il s'attendait à voir tomber des perles de la bouche de Marguerite... Elle se montra, comme d'habitude, bonne fille, pas farouche, pas bégueule. Je crois même qu'elle causa club, écurie, cheval, mieux qu'un sportsman émérite. Quant aux mots de finesse, quant à ces traits imprévus qui partent comme des fusées et enflamment la conversation, on s'aperçut trop qu'elle n'en avait point l'usage. Elle avait si bien caché son esprit qu'on la soupçonna de n'en avoir pas du tout. Et le vieux gentilhomme retourna, de désespoir, à ses admirations contemporaines de la Guimard et de Sophie Arnould. Cependant, la Bellanger se plaisait dans son rôle, au point d'espérer qu'il se changerait en habitude. Par des étourderies et des imprudences 1, elle perdit ce qu'elle avait gagné par une adroite soumission. Le luxe qu'affichait l'écuyère étonna. D'où venaient ces chevaux, ces bijoux, ces parures ? On en soupçonnait bien la source. Elle eut le tort de la trop préciser. La tête lui tournait. Elle se fit indiscrète, se mêlant presque d'intrigues, usant de son pouvoir futile pour obtenir des places, des faveurs. On remarquait qu'elle se trouvait trop souvent sur le chemin de l'empereur, et, ce qui était plus grave, de l'impératrice ; que sa calèche était très voyante aux Champs-Elysées et au Bois de Boulogne ; enfin qu'elle tirait le regard à l'excès. L'empereur lui-même avait eu la légèreté de s'afficher un tant soit peu avec Marguerite Bellanger, durant un séjour à Vichy ; et il en était résulté une scène de jalousie des plus chaudes. Eugénie avait fait tapage, au retour de Napoléon ; elle se plaignit, gronda, sur un ton de vivacité dont les éclats traversèrent les parois du salon jusqu'à frapper distinctement les oreilles d'un homme politique — nous le sûmes de lui-même ; par hasard[18] —, Emile Ollivier, qui attendait pour entrer chez le chef de l'Etat. D'une voix hautement irritée elle reprochait à son époux une infidélité d'autant plus blessante pour elle que cette inconstance était d'espèce vulgaire. Avec son habituelle douceur, Napoléon plaidait les circonstances atténuantes, cherchait des raisons, arguait des précédents : Je ne te comprends pas, ma chère amie. Pourquoi tant de sévérité, maintenant ? Tu n'ignorais pas, auparavant, que Mme V... était ma maîtresse ; et, pourtant, lu ne m'en avais jamais rien dit. — Comment ! Mme V... était aussi votre maîtresse ? Eh bien ! en voici la première nouvelle, je suis heureuse, vraiment, de l'apprendre de votre bouche. Et le chamaillis conjugal avait recommencé sur cet autre délit. Le bon prince avait manqué de diplomatie. Toujours était-il que Marguerite Bellanger s'était rendue impossible. Mocquart eut à lui signifier son congé, délicatement mais définitivement. Elle fit mille efforts pour rentrer en grâce, accabla son cher seigneur de lettres et de protestations, empruntées à la plume de ses amis[19], joua pour l'attendrir, une comédie de maternité, dont les subterfuges et les plaisantes machinations ont été divulgués en détail ; mais, enfin, dut se résigner à comprendre qu'il n'y avait plus de Jupiter et qu'elle n'était plus Danaé. Après 1870, elle passa en Angleterre. Un gentleman de la marine britannique conçut la folle envie de l'épouser. Elle s'appelait, désormais, milady Coulback. Reconnaissante à milord Coulback du nouvel état civil qu'elle devait à sa galanterie, elle en usa du mieux qu'elle put avec ce gentilhomme, jusqu'au moment où elle l'embarqua pour les Grandes-Indes, et n'entendit plus parler de lui. Elle revint à Paris, sur le théâtre de ses anciens exploits, mais transformée, régénérée, et ne voulant plus rien avoir de commun avec l'ancienne Marguerite Bellanger. Elle fit quelques apparitions dans un genre de société panachée, où s'entremêlait le monde de tous les mondes. Arsène Houssaye la rencontra chez la vicomtesse de Rugy, une Viennoise, toute couronnée de cheveux blonds enflammés, et qui avait ouvert, à deux battants, les portes de ses salons de la rue François Ier. Il s'empressa d'en causer, en attendant l'heure prochaine d'en écrire. On la lui avait annoncée sous le nom de milady Coulback, qu'il ne connaissait pas. L'étonnement et le plaisir furent réciproques : C'est vous ! — C'est vous ! — On
se retrouve toujours. — Oui, mais on ne se reconnaît plus après de pareilles
évolutions. — Vous êtes plus belle que jamais. — Vous n'en pensez pas un mot. Et l'on était passé à table, où milady Coulback était sa voisine de droite, pendant que la princesse Rattazzi était sa voisine de gauche. On n'en était qu'aux préliminaires du repas. Déjà Mme Rattazzi paraissait très occupée de conversation avec un ambassadeur. Sans en avoir l'air, néanmoins, elle avait remarqué la voisine de droite d'Arsène Houssaye. Qui est-ce ? glissa-t-elle à son oreille. — Vous ne l'avez donc jamais vue ? — Si, mais j'ai perdu son nom. — Vous avez été adorées toutes deux par le même potentat. Voulez-vous que je vous présente Marguerite Bellanger ? — Mais, certainement. Marie-Letizia Bonaparte tenait à se montrer bonne princesse. Elle tendit la main à Margot, qui, toute confuse de tant d'honneur, se jeta pareillement devant Arsène Houssaye, placé au centre, de sorte qu'ils s'embrassèrent tous les trois, sous les regards intéressés des dîneurs. On causait de l'autrefois, du bon empereur. Marguerite soupirait de regret. Il ne la revit plus. Elle se retira peu de temps après, en son château de Villeneuve, ayant vendu à la belle Antoinette Leninger l'hôtel qu'elle s'était fait construire, avenue de Friedland. Elle vivait, en ce manoir de la Touraine, bonne toujours, discrète, oubliée. Une maladie soudaine l'emporta. Elle s'éteignit, sage et pacifiée, en la grâce de Dieu. X. — Le gros bataillon de Cythère Des particularités intéressantes sur les tempéraments, les caractères ou les habitudes de ces prêtresses de Vénus. — Situation brillante faite à des parvenues de la beauté, en leur jeunesse. — Ce qu'elles devinrent, n'étant plus jeunes. — Sort final de Rose Léon, de Cora Pearl, de Caroline Letessier, d'Anna Deslion, de Blanche d'Antigny et de plusieurs autres. — Des considérations d'ordre plus général. — Les circonstances qui aidèrent à l'avènement du demi-monde sous le second Empire. — Un 89 dans les mœurs. — Mélange des deux sociétés. — Traits et anecdotes. — Comparaison d'hier et d'aujourd'hui. Comme nous l'avons pu voir, beaucoup de ces jolies femmes voulurent être un peu comédiennes, un peu chanteuses, un peu artistes. Cela les relevait, puisqu'on les disait des femmes tombées. Léonide Leblanc, Caroline Letessier, Blanche d'Antigny, Athalie Manvoy, Judith Fereira, Deveria, Léontine Massin, Lasseny, Juliette Beau et diverses demandèrent au théâtre de servir de tremplin à leurs charmes et d'en rehausser le prix. D'autres particularités signalaient au regard intéressé de leurs amants ces prêtresses de Vénus. Par exemple, plusieurs présentaient ce contraste savoureux entre l'air de leur physionomie et les occupations de leur état que, très profanes, pour ne point dire très vicieuses dans le tête-à-tête et prêtes à se porter, en compagnie, à des débordements inimaginables, elles gardaient, en leur visage, une expression candide et pure. A l'inverse de ses lascivetés savantes, Léonide Leblanc avait conservé dans ses yeux les frais étonnements de l'enfance. Une autre de ces charmeresses avait été surnommée la Madone, parce que, à défaut d'une virginité de corps mille fois perdue et reperdue, elle offrait l'aspect angélique des vierges de l'école primitive. Avec sa chevelure d'un blond doré, ses longs cils baissés, ses regards limpides, où ne passait aucune lueur de pensée immodeste, Anna Mikaelis semblait une élue du Seigneur ; et rien n'était plus diabolique que cette enivrante personne, les portes closes et les rideaux tirés. Beaucoup d'entre elles, passives et les sens morts[20], ne voyaient que dans le sommeil la vraie, la profonde volupté, lorsque même elles n'éprouvaient pas une sorte d'aversion contre le théâtre ordinaire de leurs exploits, — pareille à cette horizontale, qui, posant pour une statue de marbre, recommandait à l'artiste de la représenter, non pas couchée, mais debout. Et, comme il lui demandait le motif de cette préférence pour la station verticale : Cela me repose, avait-elle répondu. Néanmoins, les expérimentés citaient des femmes rares, qui n'avaient point cette inertie professionnelle. On évaluait à leur prix les qualités capiteuses d'une Constance Resuche. La corruption intense de la noble demoiselle Marguerite de Janny n'était un mystère pour aucun de ses amis. On renommait singulièrement les Allemandes, Lucy de Kaulla et Anna Mikaélis pour la sincérité de leur science voluptueuse. La Barucci encore était une passionnée. Lorsque le cœur était de la partie, dans les renouvellements de ses caprices, elle frémissait d'amour et de jalousie. Toutes n'étaient pas exclusivement des courtisanes habiles ou sensuelles, il s'en trouvait, dans le nombre, qui ne restaient pas fermées aux jouissances de l'esprit. Quoique leurs moments fussent très occupé ?, quelques-unes montraient du goût pour la lecture et les délassements de, l'intelligence. Entre cinq et sept, il n'était pas rare de rencontrer de ces dames galantes, à la Librairie nouvelle, où fréquentaient, comme dans un salon, les auteurs à la mode. Parmi celles qui consommaient le plus de livres, on citait Blanche d'Antigny et Anna Deslion. La première donnait dans les romans et les ouvrages d'histoire. Une fois qu'elle était chargée de jouer une reine de France, dans une opérette d'Hervé, elle vint à la Librairie nouvelle, accompagnée d'un jeune seigneur et se fit payer par lui toute l'Histoire de France d'Henri Martin, puis toute celle de Jules Michelet, — une double pile de volumes reliés et dorés sur tranche : — Je veux, disait-elle, étudier cette reine-là dans les livres authentiques, afin de bien entrer dans sa peau ! Quant à la seconde, dont l'éducation première avait été aussi négligée que possible, elle affectait la passion des livres graves et sévères. Anna Deslion s'enorgueillissait moins de ses salons et de son cabinet de toilette que de sa bibliothèque. Sur les rayons s'alignaient, à côté des manuels du métier, comme les Mémoires de Mogador ou l'histoire de Manon Lescaut, de sérieux tomes, tels que l'Imitation de Jésus-Christ ou les Questions de mon temps, d'Emile de Girardin. De fait, Anna Deslion n'avait pas l'intelligence très cultivée ni la conversation brillante. Par contre, Esther Guimond, qui la lança, s'était fait un cercle d'élite. Des princes de l'art et des lettres allaient chez elle s'inspirer d'esprit. C'est Esther Guimond, qui disait à Girardin : Il n'y a vraiment que nous, courtisanes, qui soyons dignes de causer avec des philosophes. Une Cora Pearl, avec ses façons vulgaires, ses airs canailles, sa voix rauque, était loin de représenter une image de grâce et de délicatesse spirituelles. Dans le nombre des arrivées, il en était de bien connues pour leur insuffisance de conversation, — hors de ces entretiens nocturnes où la valeur des mots n'a que la moindre importance. C'est d'une de celles-là, renommée pour sa bêtise[21], et qui, après avoir longtemps erré, longtemps cherché, avait fini par doubler le cap du protectorat, que ses camarades disaient : Enfin, voilà la cruche casée ! En revanche, une Léonide Leblanc pouvait prétendre à n'avoir pas seulement le plus joli corps du monde, mais aussi de la malice et de la finesse. Tout comme Emilie Williams ou les sœurs Keller, elle savait causer et surtout répondre. Entre les plus déliées et les plus madrées on n'oubliait pas de nommer les deux sœurs Drake, si parfaitement assorties dans la pratique des mêmes goûts qu'elles s'étaient mises d'accord à exploiter ensemble les ressources de la vie galante, qu'elles en expérimentaient les procédés sous le même toit et qu'il était difficile sinon impossible à ceux qui recherchaient l'une ou l'autre, la blonde ou la brune, de les courtiser l'une sans l'autre. Leur appartement, raconte Zed en son bréviaire des amours faciles de cette époque, était une merveille de recherche, d'ingéniosité, d'entente savante de la destination et du cadre approprié. Machiné comme un décor de féerie, divisé, comme chez les dentistes, en une suite de cabinets indépendants dissimulés derrière les draperies et au milieu desquels il était impossible à un profane de se reconnaître et de se débrouiller. Trois ou quatre visiteurs pouvaient s'y trouver en même temps, sans être exposés à se rencontrer ni à se voir. On ajoutait à ces détails qu'une soubrette futée, admirablement dressée et d'une habileté sans seconde, était préposée à la garde du labyrinthe et chargée de régler la marche du service, afin d'empêcher toute collision intempestive. Les habitués l'avaient surnommée l'Aiguilleuse. Adèle Courtois n'avait que peu d'esprit et s'en consolait à l'idée que l'esprit perdit toujours les cocottes. La Barucci triomphait lorsqu'elle posait en Vénus sans ouvrir la bouche. Il en allait très différemment chez Caroline Letessier. Celle-ci était le bel esprit du bataillon de Cythère. En sa jeunesse, abreuvée aux pures sources du gay savoir, elle s'était essayée, pendant un temps, à en pratiquer les leçons avec sagesse, comme institutrice ; puis, elle avait pris la clef des champs, à la première bonne occasion qui s'était offerte. Et la fashion parisienne, qui ne laisse jamais, comme on sait, la vertu sans récompense, l'avait dotée promptement de la calèche indispensable. Elle avait gardé les façons dont on l'avait instruite, mettait de l'amour-propre à se tenir bien, à s'habiller avec élégance et distinction et, par suite, ne ménageait point, dans ses remarques à haute voix, certaines de ses rivales plus avantagées de bijoux que de goût. C'est elle qui, parlant d'une diva d'opérette, supérieurement costumée au théâtre mais attifée à la ville comme une bourgeoise du Marais, ne passait jamais à côté de la comédienne sans demander à. l'amant de celle-ci, un lord Carrington : How is your lady-cook ? — Comment se porte votre cuisinière ? Parlant de toutes choses avec bonne humeur et malice, Caroline était redoutée des femmes et d'autant plus recherchée des hommes. Ses propos n'avaient rien de vulgaire, mais s'accompagnaient d'une certaine retenue, jusque dans les licences permises à sa condition d'amoureuse. On lui trouvait de la ressemblance avec Mme de Metternich dans le port de tête, l'aisance hardie de la démarche et l'expression spirituelle du visage. Il apparaissait visiblement qu'elle avait joué les princesses au théâtre Michel de Saint-Pétersbourg et qu'elle avait failli en porter le titre. Lorsqu'on la voyait entrer au salon de la Conversation, à Baden-Baden, les épaules tombantes, le cou dégagé, le buste élancé, la taille ronde, très scintillante de perles et de diamants, elle n'avait pas besoin d'être jolie pour produire un grand effet. Après tant de satisfactions recueillies, avec tant d'agréments personnels, il n'était pas surprenant que le monde à part des grandes cocottes se fût pris réellement au sérieux et qu'on ne s'y estimât guère au-dessous de l'aristocratie oisive égrenant les jours sans autre but que de posséder et de jouir, et encore moins de la bourgeoisie parcimonieuse, consumant les meilleurs dons de la vie dans les occupations et les soins médiocres. Elle ne déguisait pas son opinion, en la cause, cette jeune lorette, qui, voulant désigner une de ses sœurs, disait d'elle avec une pointe de dédain : Vous savez, celle qui a mal tourné, celle qui est mariée ! Les parvenues de la beauté avaient oublié vite leurs origines, au sein de la fortune acquise. Elle se voyaient riches, groupées, célèbres. Que pouvaient-elles désirer davantage ? ***Tout cela eût été parfait, si plus fatalement, plus cruellement que d'autres femmes elles n'avaient pas été soumises à la nécessité de vieillir ! Et la question se pose aussitôt. Que devinrent ces étoiles ? Comment finirent ces patriciennes de la galanterie, après la période éblouissante de leur règne, sous le second Empire ! On résiste mal à l'envie de l'apprendre. Des adroites et des chanceuses : Adèle Courtois, Léonide Leblanc[22], Lucile Mangin, ne connurent pas d'éclipse. La prospérité les suivit jusqu'au bout. Adèle Courtois, en particulier, dont les dernières années se convertirent à la dévotion, garda autour de soi, sans un moment d'interruption, les commodités les plus enviables d'un cadre opulent. Quelques-unes arrivèrent à se créer un état de maison presque respecté, grâce aux rédemptions du mariage. Certaines furent emportées hors de leur sphère par des caprices du sort fantastiques. La Madone disparut tout à cou de la circulation parisienne, comme enlevée dans un sillon de lumière. Elle avait épousé le prince Soltikof, qui l'emmena dans son palais, en demeura follement épris et jaloux, et, lorsqu'il l'eut perdue, ne se résigna point à lui survivre. Juliette Beau, après avoir ébloui le demi-monde de son luxe étincelant, fut accaparée, un beau jour, par un noble étranger, d'une race illustre, immensément riche, qui ne put résister, en sa passion grandissante, au désir de l'avoir uniquement à soi et pour la vie : elle agréa son nom, ses titres et ses trésors. La gracieuse Maucourt fut enlevée au théâtre et à l'opérette par un Russe encore, qui lui composa, à Saint-Pétersbourg, un genre d'existence au dernier point confortable. Marguerite Bellanger, Margot la rigoleuse, comme la qualifiaient ces messieurs de la Garde et du régiment des Guides, trouva la fortune dans un caprice prolongé de Napoléon III. Rosalie Léon eut une histoire merveilleuse, comme on croirait qu'il no s'en lit que dans les contes de fées. Née à Guepavas, près de Brest, elle avait débuté à seize ans, sous le tablier d'une fille d'auberge, en son village natal. Un comédien de Paris passa, qui l'emporta. La scène n'eut pas à la garder longtemps. De suite elle s'était créé une physionomie tout à fait à part, grâce aux charmes de son fin profil, de ses traits gracieux et délicats et de sa distinction innée si contrastante avec la vulgarité de sa naissance. Elle fut spéciale ment remarquée, courtisée et adulée par le prince Pierre de Wittchtenstein, général de division et aide de camp de l'empereur de Russie, lequel lui offrit sa main et ses quarante-cinq millions. Il s'était démis pour elle de ses fonctions diplomatiques ; il lui avait sacrifié les plus hautes ambitions de sa vie. La félicité de Rosalie Léon, princesse morganatique de Wittchtenstein, dépassait l'imaginable. Cependant, elle s'ennuya de cet excès de bonheur ; et prise du besoin, après cela, d'interroger et d'éprouver des sensations surnaturelles, elle se mit à boire de l'éther. Elle y épuisa les sources de sa vie. Le prince en ressentit un désespoir affreux ; il alla s'enfermer dans la solitude d'un grand château, qu'il avait fait construire en Bretagne, pour contenter un des souhaits de Rosalie, et ne tarda guère à la rejoindre dans son tombeau. ***Il se fit encore, de-ci de-là, parmi les grandes abandonnées d'alors, sept à huit comtesses et une princesse ou deux. Ce fut la part des chanceuses. Voici, maintenant l'envers de ce tableau fortuné. Un bon nombre échouèrent dans la détresse finale, Clarisses perdues, elles s'en allaient entraînées par le tourbillon, jetant l'or à pleines mains, escomptant à l'aveugle leurs forces, leur santé, les biens éphémères de la mode. Elles jouissaient du présent éperdument ; elles oublièrent les moyens d'assurer les heures pâlissantes du crépuscule. On les avait vues passer ivres et folles de leur joie jusqu'au moment où elles étaient tombées lasses, malades, ruinées, expiant les joyeuses nuits par des nuits sérieuses, et servant d'exemples aux moralistes du lendemain sur les malheurs attachés aux amours vagabondes. Maria la Polkeuse, qui fut la reine fêtée de Mabille et du Ranelagh, ayant des adorateurs à la douzaine et ne sachant plus que faire de tous les présents dont on la comblait, un jour dut monter au plus haut d'une mansarde dont elle avait grand'peine à payer l'humble loyer. Cora Pearl, après une ascension déconcertante par les conditions phénoménales où elle s'était accomplie, Cora Pearl, qui cota ses faveurs jusqu'à dix mille francs la nuit, tomba au rang des demoiselles à cinq louis et plus bas encore. Elle avait foulé l'or à ses pieds comme de la boue. Elle avait eu toutes les impertinences du triomphe le plus complet qui puisse se fonder sur l'argent et la vogue ; et l'on disait qu'elle conduisait ses chevaux avec plus de douceur que ses amants. Mais le jeu avait fini plus tôt qu'elle ne l'avait pensé. Elle avait mal calculé ses mesures et la date où finirait son empire. Une courtisane, écrivait Plautius, est pareille à la mer ; tout ce qu'on lui donne, elle le dévore sans qu'il y ait accroissement pour elle. Du moins, la mer conserve ; et ce qu'elle renferme subsiste toujours. Mais donnez à la courtisane tout ce que vous voudrez : il n'en reste rien ni pour celui qui a donné ni pour celle qui a reçu. Il y eut maintes exceptions à la règle, depuis que prononça ces paroles le vieux poète latin. Instruites par l'exemple des prodigues, quelques-unes surent se garder à. temps contre les retours sans merci d'une existence de hasard et d'aventure. Cora n'avait pas été du nombre des sages, des économes. Ni sa compatriote la blonde Skittels, qui, pendant la courte phase de son, séjour à Paris, avait transporté d'enthousiasme tout le clan des hommes à la mode par son galbe aristocratique et la tenue merveilleusement pure de ses équipages. Elle fut retrouvée longtemps après, si j'en crois l'information d'un chroniqueur de la Vie parisienne, devant le comptoir d'un bar de chemin de fer, sur la ligne de Canterbury, très épaissie, dit ce témoin, très fanée, mais très reconnaissable et ayant conservé, malgré les ravages du temps un certain éclat, pâle reflet des splendeurs d'antan. De même, Caroline Letessier, qu'avait entourée une réputation prodigieuse d'élégance et de perversité, eut bien à regretter les nuits d'abondance, où elle travaillait dans les grands-ducs. L'une de ces Altesses lui avait fait entrevoir la prochaine conclusion d'un mariage morganatique, quand, à Saint-Pétersbourg, elle déguisait sa personnalité sous le nom de princesse Dolgorouki et semblait avoir rapproché déjà les distances, à l'aide de ce titre imaginaire, que la défense expresse du tsar empêcha d'être une réalité. Elle avait su tirer d'une rencontre furtive les arrhes d'une liaison durable. Que n'eût-il fait pour elle, le haut personnage, qui, dans un bal où il s'était rendu tout chamarré de croix et de grands cordons, lui donna des marques publiques si flatteuses de son intime affection ! Caro dansait avec ardeur. Dans le tourbillon s'était produit un léger accident, une déchirure à sa robe de tulle, qui menaçait de l'abandonner. On voyait la minute où l'étoffe légère allait quitter ses épaules nues. Son danseur eut un beau geste : il détacha le grand cordon de Saint-André qu'il partait au col et le passa à Caroline ; elle s'en servit pour réparer le dommage. Grâce à l'impérial ruban elle put relier les parties rompues de sa robe. Et les valses, et les quadrilles et les contre-danses se continuèrent dans la joie jusqu'au matin. Son luxe faisait l'admiration de ses amies de théâtre et de ses compagnes de plaisir. Aimée Desclée, qui entretenait avec elle un commerce épistolaire des plus suivis, lui écrivait de Naples, avec tout l'élan de son cœur sans jalousie : Oui, nous parlons très souvent de vous. Je leur ai dit que vous aviez des diamants à remuer à la pelle, des propriétés en Touraine, des chevaux de 20.000 fr., douze serviteurs, enfin je les laissai bouche béante. On la distinguait, dans toutes les fêtes, vêtue de satin clair et sa chevelure piquée de lépidoptères aux mille couleurs. On la reconnaissait d'abord, au théâtre, ayant étalé devant elle, sur le rebord de son avant-scène, les accessoires de coquetterie dont elle ne se séparait jamais, disait-on : la glace, la pomme d'or à poudre de riz et la lorgnette où scintillaient les pierres précieuses. Elle était bien l'une des grandes du second Empire. Cependant, l'or coulait entre ses doigts sans qu'elle songeât à fermer la main. Inévitablement il arriva qu'elle dut se déprendre de ces habitudes insouciantes et prodigues et resserrer dans les bornes les plus étroites les conditions de sa vie. Singulière coïncidence ! Elle était devenue comme une sorte de dame de compagnie d'une trafiquante d'amour plus jeune et mieux armée d'adresse calculatrice : une demoiselle Cléry, qui lui faisait porter son chien. Elle avait pu garder son petit hôtel, non loin de l'avenue de Villiers et y conserver pieusement quelques-uns des objets d'art, qu'elle avait réunis autrefois avec beaucoup de finesse et de goût. Elle y vivait d'une rente mensuelle de quinze louis, que deux amies prévoyantes : Adèle Courtois et Isabelle Ferrand lui faisaient par charité. On l'avait oubliée tout à fait, lorsqu'un écho de journal apprit au public, qui ne savait plus son nom, qu'une gloire évanouie de l'ancien demi-monde venait de s'éteindre. Par une matinée maussade, au fond d'une nef froide et triste, un cercueil avait été déposé. Les échos de l'église n'avaient retenti ni de musique ni de chants consolateurs. Deux ou trois prières psalmodiées par le prêtre ; un court service, une vague assistance, à peine des fleurs et la terminaison hâtive de toutes choses. Caroline Letessier, la femme tant adulée, jadis, du Paris qui riait et s'amusait, n'eut pas d'autres funérailles[23]. Anna Deslion chuta, elle aussi, d'un étage de prospérité inouïe dans un abîme d'ombre et de médiocrité. Il vint un moment de complet abandon, où, comme nous le disions tout à l'heure, elle n'ôtait plus ses robes que pour les vendre. Blanche d'Antigny eut des heures ruisselantes de lumière et de joie. Elle mourut pauvrement, dans un hôtel meublé, des suites de la variole noire, qu'elle avait rapportée d'Egypte. Son dernier protecteur avait été un Nariskhine ruiné, dont l'assistance s'était rendue, avec le temps, rare et précaire. Je laisse de côté, dans l'énumération de ces déchéances, celles qui, à l'exemple de la baronne d'Ange et d'Athalie Manvoy, n'ayant plus assez de jeunesse pour officier en personne sur les autels de Vénus, demandèrent des compensations appréciables aux pratiques de la mutualité, je veux dire aux entremises d'un proxénétisme ingénieux. Plusieurs de ces belles dissipées périrent de consomption, en pleine jeunesse. Giulia Barucci, en laquelle on avait admiré l'incarnation la plus complète, qui fût souhaitable d'une beauté saine et plantureuse, avec sa gorge haut placée, son corps de déesse, son teint chaud, ses yeux magnifiques, Giulia Barucci s'en alla de la poitrine, comme la belle Pomaré, comme la sentimentale Marie Duplessis, comme Esther Duparc, l'aînée de cinq sœurs vouées toutes à la galanterie, et la plus attrayante, la plus aimable, la plus désirée d'entre elles. D'autres enfin furent les victimes de leur tempérament excessif. La fougue indomptable d'une Pauline d'Angeville, l'emportement et la fièvre avec lesquels, sans désemparer, elle se livrait aux désordres de l'aphrodisie et la trépidation incessante qu'elle infligeait à ses nerfs en leurs débordements maladifs la conduisirent au pire dénouement. Atteinte de folie érotique, elle fut enfermée dans un hospice d'aliénées, où les fureurs hystériques achevèrent de briser son misérable organisme. Une autre névrosée, Jeanne Desroches, qui avait le feu dans le sang, et que les plus violentes ivresses ne parvenaient pas à calmer, succomba, dans sa vingt-cinquième année, à la phtisie galopante... Mais il faut borner une liste, qui menacerait de s'allonger outre mesure. ***Quelles qu'aient été leurs destinées particulières, favorisées d'un succès continu ou traversées des pires déceptions, il reste indéniable que le monde même auquel appartenaient ces créatures d'exception, avait pris une importance extraordinaire, sous le second Empire, et cela par des raisons d'ordre général, qu'il ne sera pas sans intérêt d'exposer, avant de conclure. Il n'y avait pas longtemps, une marge bien définie, de chacun bien reconnue, rendait toute confusion impossible entre les femmes dites galantes et les femmes supposées vertueuses. Les filles entretenues, de plus haute catégorie que les voleuses de cœurs de la rue Bréda et des alentours, ne prétendaient pas encore traiter de puissance à puissance, dans le coudoiement des lieux publics. On les voyait rarement à l'Opéra, à la Comédie-Française. Elles se dissimulaient dans les baignoires des théâtres secondaires et n'affectaient point, comme on dit, de prendre le haut du pavé en allant au Bois. Lorsque celle qu'on appelait mystérieusement la femme brune fit monter Ponsard dans un landau attelé à la daumont, ce fut, raconte A. Houssaye, tout un scandale et le poète de Lucrèce, qui aimait les belles filles par amour de fart et par amour de l'amour, en fut lui-même comme effaré. Les mondaines et les quart de mondaines commencèrent à se rencontrer, aux courses de chevaux. Déjà des yeux attentifs auraient pu remarquer que ces dernières en prenaient à leur aise, avant que la tribune de course eût remplacé la traditionnelle procession des toilettes aux environs de la vieille abbaye ruinée du Bois de Boulogne. A l'une des grandes fêtes données sur le turf par le Jockey-Club, les femmes de l'aristocratie furent suffoquées de voir les demoiselles monter dans les tribunes au bras des hommes du monde. C'était un 89 dans les mœurs ! Le premier contact avait causé forte surprise. Il se répéta, le lendemain, puis si souvent, avec l'aide de la littérature et les complicités de la mode, qu'on s'y accoutuma par la force des choses. Des frôlements, des chocs même se produisirent, dont la chronique tira sujet de badiner et de rire. Une certaine aventure de courses, entre autres, égaya tout Paris. Esther Guimond, qui n'était pas une trembleuse, s'était affichée osément dans les tribunes. Si je ne suis pas du monde de ces dames, déclarait-elle, je suis du monde de ces messieurs. L'une de ses pareilles avait déjà dit : Je suis de la Cour par les hommes. Quand vint le moment du retour, Esther donna un louis au cocher qui conduisait sa Victoria, en lui enjoignant d'aller de pair et compagnie dans le défilé avec l'automédon, qui menait le landau de la vicomtesse de Courval. En celui-ci se trouvaient trois dames de noble parage. En celle-là étalaient leurs jupes, à droite et à gauche d'Esther Guimond, deux jolies drôlesses réputées sous leurs surnoms de la Madone et de la Joconde. Et, tout le long du chemin, pendant que les chevaux marchaient à une allure de procession, elle avait improvisé, sur l'air de la ri fla, avec autant d'impertinence que d'esprit, une chanson libre en trente-six couplets, qui n'était pas pour réjouir des oreilles aristocratiques. Paris en répéta le refrain. Et voilà, racontait la Guimond, comment j'ai fait mon entrée dans le monde ! Elle avait montré la route. Bien d'autres l'y suivirent. Aux courses de Satory, en 1860, le pêle-mêle fut complet. On ne savait plus ; en considérant cette foule de toilettes excentriques, si l'on avait devant soi le demi-monde ou le quart, ou le huitième de monde. De leurs robes à longue queue elles soulevaient des flots de poussière, satisfaites, s'arrêtant à chaque pas, pour s'admirer en leur démarche et demander à leur cavalier suffoqué par la poussière : Est-ce que je balaye bien ? Car, bien balayer[24] était le suprême du bon genre, dans cette société bigarrée, sans distinction de rangs. Aux réunions sportives de La Marche, biches et cocottes s'étaient si bien poussées qu'elles avaient fini par s'emparer de la place entière. Qu'est-ce que c'est que toutes ces jeunes femmes ? demandait autour de soi, en mars 1863, un Russe fraîchement débarqué. — Ce sont des lorettes, lui fut-il répondu avec une grande franchise. — Et où sont les honnêtes femmes ? — Il n'y en a pas. Dans le Paris d'hiver et de printemps, aux bains de mer, aux stations thermales, dans les endroits de villégiature les mieux cotés, affluaient les mangeuses d'argent. Rien ne donnerait l'idée, par exemple, de ce qu'étaient les réunions des viveurs et des viveuses, dans la première période de septembre, à Bade, quoique le luxe y fût moins extérieur qu'aujourd'hui. A peine pouvait-on leur comparer la semaine carnavalesque de Naples, débordante de plaisir et de voluptés. Tous les mondes étaient là rassemblés : artistes, patriciennes, courtisanes, à la recherche des mêmes étourdissements. Les frontières que les honnêtes femmes auraient tant voulu voir maintenir, comme des démarcations sociales indispensables, se brouillaient de plus en plus. D'elles-mêmes elles y aidaient par des curiosités, qui devinrent bientôt des complaisances. Les grandes dames demandaient aux favorites de Vénus des conseils sur les robes nouvelles qu'elles désiraient lancer. Et l'or ruisselait ; et les mains prodigues des Caroline Letessier, des Cora Pearl, des Blanche d'Antigny, des Léonide Leblanc, des Massin, des Soubise, de toutes celles qui taillaient au large sur le budget du Tout-Paris — lisez la fleur des pois de la Russie, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, des pays ottomans et des nouveaux débarqués de l'Amérique du Sud — n'essayaient point de le retenir, dans la sensation grisante, qu'ils avaient tous et toutes d'une dissipation effrénée. ***Les contacts, les mélanges, les infiltrations s'appuyaient de mille occasions, de mille prétextes pour se produire, sous le couvert de l'art ou de la charité. De gré ou de force, des relations s'établirent entre les deux camps. De cocodette à cocotte l'entente était permise. La question de toilette avait servi, comme par hasard, de terrain de rapprochement. On se prêtait des modèles ; par l'intermédiaire d'hommes spirituels et aimables, la pure crème des fashionables, on condescendait à s'envoyer des renseignements ; obligeamment, entre faubourg Saint-Germain et boulevard Malesherbes on se montrait ses hôtels. Il s'en fallait de peu que de calèche à Victoria on n'échangeât des sourires voilés, de petits signes aimables, voire même des compliments ; c'étaient des alternances de bons procédés tout à fait édifiantes. Les femmes du monde finirent par tourner la tête aux grandes horizontales d'alors en s'occupant avidement d'elles, en encourageant de leur empressement les pièces de théâtre, ourdies pour la plus grande gloire des lorettes, en affichant un goût excessif à s'instruire en détail de leurs toilettes ou de leur mobilier, et des ventes, des grandeurs et des chutes de ces beautés faciles. De part et d'autre, on s'observait, on s'étudiait, avec la ferme envie de se dérober réciproquement les lumières profitables à l'embellissement des toilettes ou à l'agrément des façons. Les indépendantes se rendait aux Italiens y étaient moins portées par l'amour du bel canto que par une secrète intention de plonger du regard au fond des loges aristocratiques et d'y surprendre, à leur avantage, de certains airs de distinction qu'elles n'avaient pas reçus de naissance, ou des manières choisies qu'on ne leur avait pas apprises, et d'en ajouter les séductions à leur arsenal de coquetterie, bien sûres, d'ailleurs, que leurs rivales de la bonne société ne leur enlèveraient jamais à, elles-mêmes le je ne sais quoi, d'où leur venait tant de pouvoir sur les hommes. Et ces dernières, curieuses et dépitées, investiguaient à force pour découvrir par quels moyens victorieux ces créatures de soufre et de chair réussissaient à tirer chez elles les galants et les maris. C'était une espèce d'enseignement mutuel, dont les leçons n'étaient point perdues pour la galerie. Les belles et nobles dames se sentaient les plus mortifiées de ce que l'issue du duel tournât rarement en victoire pour elles. De leur côté, les irrégulières de marque se tenaient mal satisfaites de ce qu'on ne leur prodiguât pas encore assez d'hommages, en public, et que leurs amis en réservassent trop l'expression pour le seul à seul des cabinets particuliers. Cet isolement, qui avait sa raison d'être, qui comportait même un avantage, parce qu'il leur donnait un relief spécial, chiffonnait leur amour-propre ; elles se plaignaient entre elles qu'on les laissât seules dans leurs loges[25]. Dirait-on pas, exclamaient-elles, que nous sommes abandonnées du Ciel et des hommes ? Comme si nos diamants ne prouvaient pas le contraire ! Enfin elles y mirent bon ordre, avec de la patience, et alors elles n'eurent plus à envier rien — à part famille, considération et sécurité — aux femmes du monde. Les moralistes du théâtre et du roman feignaient, il est vrai, de se scandaliser de cette irruption éhontée. Lorsque, vers 1850, Manon envahissait la scène française pour n'en plus sortir et y garder une place correspondante à celle qu'elle avait si largement prise dans les mœurs publiques, on avait commencé par s'attendrir sur le sort des courtisanes sensibles et poitrinaires. On en était venu jusque-là : de les plaindre, de pleurer presque sur le luxe qui leur était imposé, sur l'argent qu'elles étaient obligées de recevoir, et qui leur coûtait si cher, chacun de leurs meubles soyeux, chacun de leurs bijoux devant rappeler à leur mémoire la honte d'une prostitution. Puis, on avait réagi contre ce courant sentimental. Des mains honnêtes avaient brandi le fouet de la satire, flagellant les femmes sans honneur et sans âme, qui précipitaient la jeunesse dans le désordre et portaient la ruine au sein des familles. Indignations très louables, quant à la forme, mais de si peu d'effet, quant au résultat apparemment cherché ! Les vertueux poètes y gagnaient un surcroît de réputation et d'avantages positifs non dédaignables. Et des filles de marbre si sévèrement jugées n'avaient, au fond, qu'à remercier les auteurs pour la plus-value qu'ils avaient ajoutée, par leurs vitupérations scéniques, à la denrée d'amour dont elles tenaient comptoir. Témoin ce trait bien instructif, en l'espèce. Théodore Barrière passait devant le Vaudeville, où l'on jouait la pièce fameuse qui met aux prises Desgenais le raisonneur et la folle Marco. Une actrice, fort à la mode dans la galanterie comme au théâtre, passait, là aussi, dans sa voiture. Elle a reconnu Barrière, fait arrêter son cocher et d'un geste gracieux appelle l'auteur dramatique : Que de reconnaissance je vous dois ! lui dit-elle gaîment. — Pourquoi m'avez-vous tant de reconnaissance, chère amie ? — Charmante, la pièce que vous avez donnée en face ! Si vous saviez comme elle fait prospérer nos affaires. Je n'avais qu'un cheval à mon coupé : depuis le succès de vos Filles de marbre, j'en ai deux ; regardez plutôt. Barrière se mit à sourire : Votre histoire est un peu la mienne. Jusqu'à présent, je n'avais monté que des chevaux de location ; avec mes droits d'auteur, je viens d'acheter un superbe arabe. Tout le profit pour la morale était dans le vague des intentions. Au point où en étaient arrivées les choses, inévitable
était la mêlée des qualités et des personnes. Elle se rendit évidente et
publique. Dans un bal masqué se rencontraient deux impures : Ah ! s'écria l'une, d'un air offusqué, comment une femme qui se respecte peut-elle se déguiser en
débardeur ? — Tu es encore bien plus déguisée
que moi, répondit l'autre, puisque tu t'es
mise en femme du monde. Que l'erreur se produisît fréquemment, il n'y
avait plus à s'en étonner. Mais le piquant de la situation est que celles qui
s'en plaignaient n'étaient pas toujours les honnêtes
dames, qui auraient dû s'offusquer surtout qu'on les prît pour ce
qu'elles n'étaient pas. Une couturière célèbre, à qui le génie de la coupe et
la vogue donnaient le droit d'insolence, une autre Palmyre, tenait le propos
ci-contre à l'une de ses nobles clientes : C'est curieux comme on se défigure ! je viens de recevoir la femme de M. de M***. Je l'ai prise pour une lorette. — Ah ! se récria la grande dame avec un accent de reproche, vous ne m'auriez pas fait ce compliment-là ! Il était notoire que des femmes très haut placées s'étaient libérées des préjugés, au point de paraître sans mystère chez ces demoiselles et jusqu'à sembler à celles-ci presque indiscrètes : Il y a longtemps que je n'ai rencontré chez vous la princesse une Telle, faisait-on observer à Léonide Leblanc. — Je ne la vois plus, répliqua-t-elle ; elle me compromettait ! Non moins consciente de ses mérites, non moins assurée de sa valeur égale était une autre hétaïre en renom. A la suite d'un dîner qu'elle avait présidé en sa villa de Trouville, avec une grâce hautaine, un complimenteur n'avait pu s'empêcher de lui couler ces mots en l'oreille : Vraiment, vous avez l'air d'une duchesse. — Qui vous dit que je n'en suis pas une ? avait-elle riposté en levant sur lui ses grands yeux clairs. Aussi bien, les temps convenaient-ils encore à se targuer, ici ou là, de l'orgueil de classe ? Jules Vallès l'avait exprimé sans réticences : il n'existait plus de gradins élevés sur lesquels aucune famille pût jucher son honneur. Dans le sac aux écus les mains s'étaient mêlées. On finit par se dire que toutes les oisives se valaient et qu'il n'y avait pas lieu vraiment de tirer un cordon de décence, sous le prétexte de séparer les viveuses de hasard des enrichies de pacotille. Quelques-unes des nôtres avaient conçu, de ce fait, une superbe extraordinaire. Rien n'étonnait leur confiance, ni les belles aventures qui leur advenaient, en réalité, ni les chances miraculeuses qu'elles s'imaginaient avoir eues, pour la douceur d'en caresser l'illusion ou pour le plaisir d'être jalousées par les amies en les leur racontant. Telle, Clara Blum[26]. Celle-ci avait une assurance, un aplomb imperturbable. Il m'en fut signalé des traits plaisants, un soir qu'on causait entre gens de connaissance, les coudes sur la table. En dépit de ses origines, elle visait à la distinction et jouait la femme de qualité, quitte à s'oublier vite, par exemple, quand elle disait à l'une de ses collègues en visite : Tu vois toutes ces caisses ; eh bien ! ma chère, elles sont pleines de bijoux et de diamants ! Sur le tard d'une matinée, entre onze heures et midi, Adèle Rémy, la blonde Rémy s'annonçait chez elle, au 127 de la rue de Rivoli. Avant qu'elle fût assise, Clara l'avait saluée de cette question : Tu n'as pas rencontré Louis, dans
l'escalier ? — Qui, Louis ? — L'Empereur. Il sort d'ici. Elles coûtaient cher et en convenaient. Mais, n'entrait-il pas, dans leurs concessions, en apparence si faciles, puisqu'elles ne consistaient, en somme qu'à prendre opportunément l'attitude horizontale, n'entrait-il pas là une part de sacrifice, qui les absolvait du reste ? Elles pouvaient répondre, en pareil cas, à leurs adorateurs chenus, comme une des petites Parisiennes de Grévin : Je suis jeune, vous êtes vieux ; je suis jolie, vous êtes laid ; on me trouve, quelquefois, spirituelle, vous êtes ordinairement peu drôle ; de plus, vous m'aimez, et je ne vous aime pas. Voyons, mon bon, osez donc dire encore que je vous coûte cher. A l'heure même de l'ivresse, leur franchise spéciale ne laissait guère durer l'illusion. Si tu ne veux plus être trompé, déclarait, avec une pointe d'effronterie, l'une encore de celles-là à son amant, il faut le dire ; on te cherchera d'autres distractions ! Encore ne fallait-il pas croire qu'elles acceptassent les libéralités de quiconque, ni qu'elles eussent pris l'habitude, comme y sont contraintes bien des momentanées d'à présent, de tabler plutôt sur le nombre que sur la valeur des occasions. Elles se piquaient d'être indépendantes, de choisir, à bon escient, entre leurs amis de cœur ou leurs galants de circonstance, et de n'accorder point au premier venu la faveur de se ruiner à leur service. Elles étaient achalandées de manière à pouvoir se permettre ce luxé d'agréer où de refuser la commande. Quelque opinion qu'elles eussent d'elles-mêmes ou qu'on eût à porter sur leur manière de dire et leur façon de se conduire, il fallait bien reconnaître que les cocottes occupaient une large place, une très large place, au soleil. Une complaisance si générale aidait à leur tendre l'échelle qu'elles étaient parvenues à dicter le respect à leurs entreteneurs. Elles finirent par exiger les mêmes égards dans la forme que les femmes honnêtes. N'avaient-elles pas imposé aux mortels plus ou moins chevronnés dont elles étaient les maîtresses la qualification de serviteurs ? Et ils s'y étaient soumis. Ils avaient accepté le mot. Ce fut un de leurs derniers et plus sensibles succès. Mais rien ne dure. Tout lasse et tout passe. Les temps changèrent ; et la société qui avait assuré à ces femmes des privilèges- peu ordinaires se modifia sensiblement. Le groupe des viveurs de la grande période s'était émietté, dispersé. Les habitudes du plaisir s'altérèrent, ou plutôt se banalisèrent. La pornocratie se démocratisa, comme le reste. Ces créatures de luxe et de joie, dont nous parlions, devinrent foule. Elles se ressemblent terriblement toutes, à l'heure actuelle. Elles sont identiques par les habitudes et par la régularité de leur existence irrégulière. On leur reprocherait presque de manquer de vice ; quant à la finesse d'esprit, on ne saurait, en bonne justice, leur réclamer ce que leur état ne comporte plus. Entre les recrues de Vénus, qui forment ce qu'on a coutume d'appeler le bataillon de Cythère, la similitude est si complète, sauf de rares exceptions, qu'on s'émerveille comment les hommes peuvent les différencier les unes des autres. Cette transformation amoindrie, ce déclin spécial du monde galant est d'une observation trop sensible pour qu'on n'en ait pas glissé la remarque, ne fût-ce que pour l'intérêt et la vérité du contraste. C'était un point à constater, sans se perdre en dès regrets hors de raison, sans en gémir évidemment, mais comme un fait positif, dans l'histoire des mœurs, qui n'est jamais l'histoire de la vertu. Les cocottes, les tendresses, les biches de haute volée, telles que nous les avons dépeintes, ayant leur individualité précise, leur influence personnelle, leur nom, leur originalité, ont bel et bien disparu. A deux ou trois exceptions près, que nous pourrions citer, il n'y a plus, dans cette portion de monde, que des femmes entretenues et des maîtresses publiques, comme il en existera toujours pour le contentement et le danger des hommes. FIN DE L'OUVRAGE |