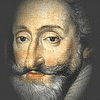HENRI IV
LIVRE TROISIÈME. — LE ROI NATIONAL - 1591-1598
CHAPITRE II. — SUCCÈS ET REVERS - 1594-1599.
|
Henri IV était rentré dans Paris, après cinq années de patiente et laborieuse attente, comme il rêvait, dès 1590, d'y revenir, c'est-à-dire en maître qui rentre chez lui, en père qui reprend le gouvernement de sa maison, pardonnant aux enfants prodigues, désabusés et repentants, en roi rappelé par le vœu unanime d'une capitale longtemps rebelle, confondant désormais tous ses regrets, toutes ses espérances, toutes ses aspirations dans ce triple cri de : Vive le roi ! Vive la paix ! Vive la liberté ! qui résume si bien le triple besoin de tous les esprits sensés, modérés, honnêtes du temps, l'universelle lassitude de l'anarchie, de la tyrannie, de la guerre. La royauté légitime, traditionnelle, héréditaire, représentait alors, comme elle la représente encore aux yeux de beaucoup, l'unique source des remèdes à tant de maux, l'unique port de réparation et de salut après tant de tempêtes et de naufrages, l'unique arche d'alliance de tous les partis qui aspiraient aux progrès raisonnables, à l'ordre sauveur, à la règle tutélaire, à la discipline vivifiante, seuls capables de reconstituer la nation et de réorganiser la patrie. La réduction de Paris était un grand pas, un pas de géant fait dans cette voie de la pacification et de la régénération du pays. Mais s'il rapprochait du but, il ne suffisait point pour y atteindre. La conquête de la capitale était nécessaire, indispensable même à la conquête du royaume. La défaite de la Ligue française était nécessaire, indispensable même à l'expulsion de l'étranger. Mais la Ligue expirante devait mettre encore des années à achever une agonie opiniâtre et désespérée. Les mains crispées de l'invasion espagnole ne devaient lâcher, que doigt par doigt pour ainsi dire, les flancs de la France épuisée et destinée encore à plus d'un déchirement. Henri avait encore à résoudre, à force d'habileté et de courage, maint redoutable problème. Il lui fallait garder sa conquête, consommer la victoire, réorganiser l'administration du royaume livré si longtemps aux extorsions et aux factions, achever de réduire l'ennemi intérieur, et contraindre à la paix libératrice la coalition, appuyée encore sur tant de complicités, de l'Espagne, de la Lorraine, de la Savoie, et de la cour de Rome. Fidèle à ses principes, qui consistaient à rallier à lui non moins les intérêts moraux que les intérêts matériels, et à toujours faire précéder la lutte d'une négociation, Henri, après avoir rétabli à Paris, et par l'exemple de Paris, toujours contagieux, dans toute la partie de la France disposée à le suivre, l'ordre religieux, politique et civil, reprit avec la cour de Rome les ouvertures tendant à obtenir pour sa conversion la consécration, nécessaire encore aux yeux de beaucoup de ses partisans eux-mêmes, de l'homologation du Souverain Pontife, la levée de cet interdit politique plus que religieux, qui en admettant l'homme dans le giron de l'Église, prétendait en exclure le roi. Quelques détails sont nécessaires pour faire apprécier, dans ce double ordre de mesures et de faits, la façon supérieure dont Henri comprit sa mission, l'art profond avec lequel il déploya, au profit de l'affermissement de son pouvoir, les ressources de ce génie éclairé par le cœur qui savait si habilement concilier les nécessités de la politiqne, les devoirs de la justice et les inspirations de la générosité. Le 28 mars, le Roi rendit un édit sur la réduction de Paris, dont voici les principales dispositions. La religion catholique, la religion de la majorité, est partout rétablie ; l'exercice de cette religion est seul permis à Paris et à dix lieues à la ronde, conformément à l'édit de 1577, qui cependant était le plus favorable de tous aux réformés. Paris conserve ses droits, privilèges, franchises et libertés : la même faveur est accordée à tous les corps et corporations. L'amnistie la plus entière, l'abolition et la décharge pour tout ce qui s'est passé dans l'ordre politique est accordée mit habitants sous condition qu'ils prêteront serment de fidélité au Roi ; l'oubli du passé et le silence sont prescrits à tous ; les seuls crimes dans l'ordre civil, commis depuis cinq ans, seront poursuivis et punis ; les jugements rendus, les actes passés pendant le gouvernement de la Ligue reçoivent leur exécution. Ceux qui ont été pourvus d'offices civils ou militaires par Mayenne les conservent, sous la condition seulement de recevoir du Roi de nouvelles provisions. Les saisies faites sur les habitants sont annulées et chacun rentre dans ses biens. Les débiteurs de rentes ne sont obligés à payer que les intérêts de l'année courante ; les arrérages des années précédentes seront réglés par un arrangement amiable entre eux et leurs créanciers, afin qu'au milieu du profond dérangement des fortunes particulières, les débiteurs ne soient point réduits au désespoir[1]... Après avoir ainsi rétabli l'ordre public dans les rapports des citoyens avec le gouvernement, et des particuliers entre eux, il fallait restaurer la justice et l'administration. Le roi y pourvut par ses lettres patentes du même jour 28 mars. Il leva l'interdiction prononcée contre le Parlement et les autres cours souveraines de Paris, au commencement de 1589, et au moment de la translation des cours de justice et de finances à Tours. Il rétablit le parlement de Paris dans le droit da rendre la justice, et réintégra pareillement dans leurs attributions la Chambre des comptes, la Cour des aides, la Cour des Monnaies. Henri, qui avait dit à La Noue, dont les bagages avaient été saisis par ses créanciers, le jour même de son entrée dans Paris, en lui donnant ses pierreries à mettre en gage afin de les désintéresser : Mon ami, il faut payer ses dettes, je paye bien les miennes, n'eut garde d'oublier le corps stoïque et patriotique, qui avait combattu pour son droit par les armes de la résistance légale, avec une persévérance et un désintéressement souvent héroïques. Il ne pouvait oublier davantage les inspirateurs et les chefs de cette conspiration civique grâce à laquelle il était rentré d'une façon si digne de lui et si douce à son cœur, c'est-à- dire sans effusion de sang, dans sa capitale. Le rôle des Parlements, surtout du Parlement de Paris, pendant la Ligue comme plus tard pendant la Fronde, dans la majorité de leurs membres et en dépit de quelques erreurs et de quelques défaillances, fut admirable. Le Parlement de Paris, sauf la partie corrompue par l'or de l'Espagne ou fanatisée par la Ligue, joua un rôle décisif, et déploya une fermeté exemplaire dans des circonstances où il n'était pas moins difficile de discerner son devoir que de l'accomplir. Nous nous souvenons de ses luttes contre les Seize, Mayenne, la domination espagnole, les États généraux mercenaires où elle trouvait les complicités de l'intérêt ou de la peur. Nous nous souvenons des emprisonnements, des confiscations, des exils, même des assassinats qui punirent cette intrépide rébellion des héros du droit et quelquefois des martyrs de la loi. Nous nous souvenons de la conduite patriotique et loyale des magistrats dans l'affaire de l'abjuration, de l'appui qu'ils prêtèrent au clergé fidèle, dans sa résistance aux injonctions du légat. Les parlementaires royalistes n'avaient pas seulement payé de leur parole, mais de leur personne au siège de Paris ; sous Henri III, d'Espesse et de La Guesle jugeant que la saison ne dispensoit personne du service des armes, avaient jeté leur robe aux orties, endossé la cuirasse et porté le mousquet. De Harlay avait été enfermé huit mois à la Bastille et n'avait conquis la liberté de se dévouer de nouveau que contre une rançon de 30.000 livres du temps, environ 108.000 livres d'aujourd'hui. De Thou, échappé à la persécution sous un habit de soldat, ruiné par la confiscation de ses propriétés à Paris, le pillage de son mobilier à Chartres et à la Fère, avait secondé Henri dans ses plus délicates négociations en Allemagne, en Italie, en Suisse, avant de venir défendre le pouvoir légitime au sein du Parlement réfugié à Tours. Pasquier, chargé des fonctions de procureur général de la Cour des comptes, au temps des extorsions impunies et de la misère régnante, avait lutté, au prix de sa propre ruine et de son deuil domestique, pour défendre les débris de la fortune publique. Sa femme, longtemps détenue à Paris en expiation du crime d'un mari coupable de résister aux Ligueurs, n'avait pu survivre à tant d'épreuves, et n'était sortie de prison que pour se coucher dans la tombe. Des trois fils voués par lui à la cause nationale, l'un avait été tué au siège de Meung-sur-Loire, l'autre avait été grièvement blessé. Tels étaient les magistrats de ces cours dont nous avons vu les membres épargnés seconder les efforts de l'évêque Gondy, des trois curés Benoist, Chavaignac, de Morenne, des ordres religieux fidèles, les Génovéfains et les Bénédictins, enfin contribuer, en armant les gardes bourgeoises, et en parcourant Paris avec elles, à la réduction de la capitale. Henri récompensa le Parlement de Paris en le rétablissant solennellement et triomphalement sur ces bancs fleurdelisés qu'il avait si dignement occupés, jusqu'à ce qu'il en fût chassé par le despotisme triomphant des factions. Il créa pour Le Maistre une septième charge de président, en donna une de président à la Cour des comptes à L'Huillier, gratifia Du Vair et Langlois d'un office de maitre des requêtes. A peine assis de nouveau sur ces sièges, si longtemps vides, de la justice, si longtemps absente, les magistrats fidèles, honorés, réunis aux défectionnaires pardonnés et punis seulement par la préséance des autres, continuèrent leur œuvre. Le premier usage que le Parlement de Paris fit de ses nouveaux pouvoirs fut de réparer les atteintes portées à la puissance royale et de lui rendre toutes les portions d'autorité que les factions en avaient distraites. Par son arrêt du 30 mars, il abolit les arrêts donnés, les ordonnances et décrets faits, les serments prêtés contre Henri III et Henri IV, depuis le 29 décembre 1588. Il ôta à Mayenne le titre et la puissance de lieutenant général. Il enjoignit à ce prince et à tous les princes lorrains de reconnaître Henri pour roi. Il ordonna aux princes, nobles, prélats, villes, de renoncer à la Ligue, sous peine d'être traités comme criminels de lèse-majesté. Il cassa et révoqua en général les délibérations et les actes des États de 4595, et il atteignit ainsi le fameux vote du 20 juin, qui, en décrétant l'élection, appelait au trône un autre prince que Henri[2]. Reconnu par le peuple, l'Hôtel de ville, le Parlement, Henri n'avait plus qu'a obtenir l'adhésion du clergé pour que la soumission de tous les ordres de l'État à son autorité fût entière. Bans ce but, il bannit de Paris temporairement, et jusqu'à la pacification complète, les prêtres ou moines, ligueurs forcenés, ou trop engagés avec l'Espagne, qui n'avaient point pris le parti de s'exiler volontairement. Il empêcha ainsi ces irréconciliables d'entretenir contre lui impunément un levain dangereux de sédition ou de fanatisme. Le 2 avril, la Sorbonne se rendit en corps auprès de lui, lui offrit ses hommages et l'assurance de sa fidélité. Le 22 avril, la Sorbonne, les quatre Facultés de l'Université, les curés, les ordres religieux ; à l'exception des jésuites et capucins à Paris, des jésuites, des capucins, des chartreux, des minimes en province, prêtèrent serment à Henri daris une déclaration portant qu'il était vrai et légitime roi, ou adhérèrent à cette déclaration. Afin de grossir ce noyau, et d'éviter les dangers qui résultaient pour son pouvoir et même pour sa vie, des scrupules persistants de quelques puritains, ou de la haine implacable des factieux, Henri songea à solliciter, auprès du Pape, la validation de son abjuration et de son intronisation, en triomphant, auprès d'un Pontife intimidé par l'influence espagnole, des obstacles plus politiques que religieux que rencontrait son désir. Sa cause fut habilement et modérément plaidée à Rome auprès de Clément VIII, par le duc de Nevers, chargé de lui rendre obédience en son nom et de solliciter l'absolution. Gagné moralement et personnellement à cette décision par l'effet des démarches d'un prince qui se montrait beaucoup plus soumis envers la papauté que ses tyranniques amis, et par le sentiment de ses devoirs, supérieurs à ses intérêts, le Souverain Pontife n'osa point néanmoins rompre du premier coup le joug de son inféodation à la politique Espagnole et s'exposer aux implacables représailles dont le menaçait Philippe II. Les négociations du duc de Nevers n'aboutirent donc, le 15 janvier 1594, qu'à un refus. Ce refus toutefois n'interdisait pas l'espérance, à la condition que Henri serait assez fort pour ajouter à toutes les raisons qui militaient en sa faveur la plus décisive de toutes, celle de la victoire. Henri dut donc se préparer à affranchir l'Europe et à se délivrer lui-même de cette implacable tyrannie de Philippe II qui opprimait jusqu'à la liberté du successeur de Sixte-Quint. Après avoir, par un arrêt du Parlement du 1er avril 1594, confirmé par l'assentiment de la France fidèle, mis un terme à l'ingérence de l'autorité ecclésiastique dans les affaires de son gouvernement, et tranché net les liens qui entretenaient la regrettable confusion des deux pouvoirs, il se prépara, satisfait d'avoir évité ainsi un schisme imminent, à affronter, avec des forces décisives, la lutte armée contre l'Espagne et les débris de la Ligue, qu'il n'avait pu éviter. La réduction de Paris et la soumission ou l'éloignement des principaux chefs de sa résistance avaient eu un contrecoup des plus favorables pour les affaires d'Henri IV. Au milieu de l'année 1594, le résultat de ces exemples avait été de ramener presque entièrement la Ligue française sous l'autorité du roi, de détruire à moitié la Ligue guisarde, de mettre fin à la guerre civile dans plus d'un quart du royaume, de ranger sous la loi de l'unité nationale et de l'autorité royale les trois quarts de la France. Villeroy et son fils d'Alincourt quittèrent la trêve et la neutralité qu'ils avaient sollicitée, embrassèrent ouvertement le service du Roi deux jours après son entrée à Paris, et lui livrèrent Pontoise dans l'Île-de-France. A la suite d'une épineuse négociation, conduite par Rosny, Villars acceptait un traité qui devait replacer sous la loi de Henri, Rouen, le Havre, Barfleur, Montivillier, Pont-Audemer, Verneuil. Mais Villars mettait sa soumission à un prix exorbitant. Il exigeait la charge d'amiral de France, le gouvernement en chef des bailliages de Rouen et de Caux, c'est-à-dire, outre le gouvernement particulier de Rouen, la domination de toute la Normandie entre la Seine et les frontières de l'Île-de-France et de la Picardie ; enfin une somme de 3.477.800 livres, correspondant à plus de 12.500.000 francs d'aujourd'hui[3]... Rosny rechignait ; le roi, persuadé que l'opportunité est tout en pareille matière, qu'il valait mieux accepter une soumission onéreuse que de demander aux hasards de la force une réduction beaucoup plus coûteuse encore, se moqua des hésitations de son fidèle et positif lieutenant, et conclut le traité, beaucoup moins lourd à ses yeux que l'incertitude. A la fin d'avril, le commandeur de Crillon capitula avec le duc de Montpensier pour Honfleur, et Fontaine-Martel rendit Neufchâtel, l'un et l'autre non sans dédommagement. Mais leur désarmement compléta la possession de la Normandie. Le mouvement se propagea rapidement, irrésistiblement en Champagne et en Picardie, malgré les efforts des princes lorrains, le duc de Guise, le prince de Joinville, le duc d'Aumale, pour arrêter le torrent. A Troyes, le 5 avril, les bourgeois se soulevèrent et chassèrent leur gouverneur, le prince de Joinville. Dans le même temps, Belan, gouverneur de Sens, traita avec le roi. Cinq villes de Picardie suivirent cet élan. Le 20 avril, M. d'Estourmel rendit foi et hommage pour Péronne, Roye, Montdidier, imité bientôt par la municipalité d'Abbeville et le gouverneur de Montreuil-sur-Mer. Dans les provinces du Midi, Riom en Auvergne, Agen, Villeneuve, Marmande en Guyenne, Périgueux et Sarlat en Périgord, Rodez, capitale du Rouergue, se prononcèrent en faveur du roi et lui envoyèrent leurs députés. Il était temps, pour Philippe II, d'enrayer ce mouvement, qui menaçait de ne plus lui laisser en France d'alliés et de points d'appui qu'en Flandre, en Bretagne, en Provence ou en Languedoc. Au mois de janvier 1594, le roi d'Espagne prit ses mesures pour dominer partout à la fois la situation, écraser le prince Maurice, dompter la révolte de Hollande, dépouiller les princes lorrains dont il était mécontent, envahir et démembrer la France, prendre de là son élan contre l'Angleterre, enfin, réaliser ses tenaces projets de monarchie universelle. Il ordonna d'immenses levées d'hommes et de deniers, rejeta les ouvertures de Mayenne, écarta le prince lorrain, ainsi que son fils, de tout partage ultérieur dans les dépouilles de la France, et destina la main de sa fille, l'infante Claire-Eugénie, et la couronne de sa future conquête à l'archiduc Ernest, l'un des frères de l'empereur, nommé l'année précédente gouverneur des Pays-Bas espagnols, se réservant, bien entendu, la direction des affaires et la suzeraineté. Pour inaugurer et caractériser d'une façon irrévocable cette phase nouvelle de sa politique et de ses rapports avec la Ligue, Philippe envoya un nouveau corps de deux mille hommes en Bretagne, ce qui porta le nombre des Espagnols dans la province, à six mille. Il déclara l'infante Claire-Eugénie duchesse de Bretagne, et donna pour instruction à ses lieutenants, d'affaiblir systématiquement la Ligue sous prétexte de l'aider, de lui confisquer tous les avantages, de ne partager avec elle que les revers, de prendre possession, gouverner et administrer au nom du roi d'Espagne. Le duc de Mayenne ne fut pas plus ménagé que le duc de Mercœur. Philippe débaucha de son service, pour l'attirer au sien, moyennant une pension annuelle de 54.000 livres, de Rosne, le meilleur capitaine de la Ligue, non moins redoutable par son génie politique que par son génie stratégique, et le seul capable de réparer pour l'Espagne la perte de Farnèse. En même temps Philippe acheta le duc d'Aumale avec les villes qu'il tenait en Picardie, moyennant une pension de 120.000 livres ; enfin, pour 90.000, il obtint du vice-sénéchal de Montélimar la cession de toute autorité et de tout commandement dans la ville de la Fère. Bien que Philippe II fut un prince habile et opiniâtre, son habileté et son énergie n'étaient point à la hauteur de son ambition. La grandeur du but, en l'enivrant, l'empêchait trop de s'apercevoir de la disproportion des moyens et de l'épuisement des forces, de sorte que sa persévérance, après avoir été une qualité, devenait un défaut. Depuis dix ans, il tentait la fortune au risque de la fatiguer ; et ses efforts réitérés, avec des succès plus apparents que réels, mécontentaient ses troupes et décourageaient ses peuples. Il l'apprit à ses dépens, quand plusieurs corps de Wallons et d'Italiens, employés dans les Pays-Bas, auxquels un arriéré de solde était dû depuis sept ans, se mutinèrent, et non-seulement refusèrent le service, mais occupèrent à les soumettre une portion des bandes espagnoles. A ce contretemps s'ajoutèrent des revers plus sérieux. L'armée employée contre la Hollande fut contrainte de lever le siège de Cœvorden, et laissa prendre Groningue, capitale de la province du même nom, par le prince Maurice. L'armée rassemblée contre la France et conduite par le comte de Mansfeld, dut se borner, tenue en échec par les troupes royales, de la maigre conquête d'une place de troisième ordre : la Capelle-en-Thiévache (9 mai 1594). Henri résolut de répondre, par un succès significatif, à ces démonstrations avortées ; il décida, malgré les objections intéressées du nouveau maréchal de Biron et du duc de Nevers, qui trouvaient qu'il allait trop vite en besogne, le siège de la forte place de Laon, devenue, depuis la réduction de Paris, la capitale de la Ligue. Henri commença les attaques de Laon le 25 mai avec une énergie faite pour emporter tout obstacle ; et encouragé par l'expérience décisive d'Arques à un emploi décisif de l'artillerie, trop négligé jusque-là, il foudroya les remparts de la place avec trois batteries, dont une de treize canons. Il fut fort assisté aussi d'un opportun renfort de trois mille cinq cents hommes que Balagny lui envoya du Cambrésis. C'est en vain que Mayenne et Mansfeld, de concert, essayèrent de dégager la place ; il furent contraints de battre en retraite après la perte de deux convois, et des combats qui leur coûtèrent 1.500 hommes. Laon capitula le 22 juillet et ouvrit ses portes au commencement d'août. Ce brillant succès fut obscurci par un double deuil. Le roi et la France perdirent au siège de Laon M. de Givry, maréchal de camp de la cavalerie légère, un des meilleurs officiers de l'armée et le plus séduisant des hommes de son temps, à ce point que Henri, malgré ses fautes, ne se souvenant que de ses qualités et de ses services, n'avait pu s'empêcher de l'aimer, et le pleura sincèrement. L'autre perte que fit Henri au siège de Laon fut celle de sa confiance, non dans les talents, mais dans la fidélité du maréchal de Biron, héritier de l'ambition insatiable et sans scrupules de son père, qui, mal satisfait de sa nouvelle dignité et impatient d'un gouvernement, menaça net de se retirer. Retenu par les exhortations du loyal La Curée, il se décida à rester ; mais il ne put se résoudre à vaincre lorsqu'il le pouvait et à achever dans sa retraite l'armée espagnole aux abois, estimant que de telles occasions d'en finir d'un seul coup avec l'ennemi, se retrouvent toujours assez tôt, et préférant à la gloire de se rendre inutile, le profit de rester nécessaire. Henri contint son indignation ; plutôt que de démasquer la fourberie, il aima mieux paraître ne l'avoir pas devinée, ménageant, avec une habile générosité, un mécontent utile et qu'il se flattait de ramener, à force d'honneurs, au culte de l'honneur. Les succès, comme les revers, ne marchent jamais seuls. La prise de Laon terrifia les ligueurs de Picardie et de Champagne. Château-Thierry et Amiens s'empressèrent de rentrer dans le giron de l'autorité royale. Henri, pour récompenser le zèle des bourgeois d'Amiens, qui avaient chassé le duc d'Aumale et appelé M. d'Humières, leur laissa leurs privilèges, y compris le droit de se gouverner et défendre municipalement, sous l'unique direction de leur maire et de leurs échevins. Imprudente confiance, regrettable faveur que les deux parties devaient bientôt payer cher ! (14 août). De Laon, le roi se rendit à Cambrai où il conclut avec le gouverneur Balagny, l'un des maréchaux de la Ligue, pour prix de sa soumission et de son opportun secours de Laon, un traité qui ne devait pas être moins décevant que celui d'Amiens. Le roi allait bientôt en éprouver les inconvénients. Mais au premier moment, il ne vit que les avantages ; ils consistaient à constituer, — dans une place frontière que Balagny, demeuré son gouverneur indépendant, sauf le protectorat et la suzeraineté du roi, avait d'autant plus d'intérêt à conserver, — une barrière contre les incursions des Espagnols en Picardie et en Champagne. De Cambrai, Henri alla à Amiens, où il fit solennellement son entrée, et reçut, de façon à les confirmer dans leur soumission, les députés de Dourlens et de Beauvais qui venaient lui offrir les clefs de ces deux villes (22 août). Henri couronna dignement la campagne par la prise de Noyon (1er octobre). Dans toute l'étendue de la Picardie, il ne resta plus -alors d'insoumis que Soissons au duc de Mayenne, Ham au duc d'Aumale, la Fère aux Espagnols. La Ligue n'était pas plus heureuse dans le Poitou, le Maine, l'Anjou et même la Bretagne, qu'en Champagne et en Picardie. L'évêque de Poitiers, le cordelier Porthaise, très-populaire dans cette ville, et M. de Sainte-Marthe, déterminèrent les habitants à chasser le duc d'Elbeuf et à reconnaître l'autorité royale. Laval imita Poitiers ; et le duc de Mercœur perdit l'un des meilleurs postes avancés qui couvrissent ses possessions de Bretagne. Dans cette province même, le maréchal d'Aumont réduisit Concarneau et Redon, rallia à l'armée régulière la bande du colonel Lacroix et détruisit celle du capitaine Laplante. Morlaix, Saint-Malo se soumirent Renforcé par un secours de quatre mille Anglais, conduits par le colonel Norris et par Forbisher, d'Aumont détruisit en partie les formidables établissements dressés sur la côte par les Espagnols ; il s'empara de la citadelle de Crodon, d'où ils dominaient Brest et rançonnaient le pays, rasa ce repaire de l'invasion et tua aux envahisseurs quatre cents hommes, leur élite (17 novembre). Enfin, M. de Montmartin, détaché avec un corps de troupes contre le fort de Corlay, où s'était retranché le farouche et sanguinaire ligueur breton, M. de La Fontenelle, nettoya ce nid de bandits. Ces succès militaires en entraînèrent de politiques, favorisés par la mort opportune du jeune cardinal de Bourbon, qui succomba le 28 juillet aux regrets et aux remords de son ambition déçue, et par celle de François d'O, le surintendant infidèle et rapace, un des chefs de l'opposition sournoise que Henri rencontrait chez plus d'un de ses apparents serviteurs (28 octobre 1594). Le duc d'Elbeuf se soumit à la condition d'être réintégré dans le gouvernement de Poitiers, ce qui lui fut accordé. M. de Guise, par l'entremise de l'habile Rosny, imita son exemple et traita avec le roi au mois de novembre. Il rendit le gouvernement de Champagne, Reims, Rocroi, Saint-Dizier, Guise, Joinville, Fismes, Montcornet, et reçut en échange le gouvernement de Provence, à la charge, suffisante pour l'occuper, de compléter la soumission de la province livrée encore aux factions. Après la mort de M. de Saint-Pol, créé maréchal de France par le duc de Mayenne, et tué par ce prince exaspéré de toutes ces défections, dans une discussion tragique, Vitry, Mézières et autres villes particulièrement soumises au commandement du défunt, entrèrent en composition avec le roi, dans la personne de leurs gouverneurs. Enfin, grand résultat, Henri parvint à entamer la coalition formée contre lui en en détachant le duc de Lorraine, chef de la maison de ce nom, qui, désavouant l'obstination des princes de sa famille, Mayenne et Mercœur, fit sa paix avec le roi (16 novembre). Ce ne fut pas la seule déception de l'ancien lieutenant général de l'Union, à qui Guillaume de Tavannes, chef du parti royal, enleva plusieurs villes importantes de son propre gouvernement de Bourgogne, Mâcon, Avallon, Auxerre, travaillant les autres de telle sorte, qu'elles informèrent le duc, par députés à lui envoyés à Bruxelles, de leur intention de traiter avec le roi, intention qu'elles ne devaient pas tarder à réaliser héroïquement. Comme revers de la médaille, il faut opposer à ces succès de l'autorité royale les représailles fanatiques qu'ils provoquèrent et qui allèrent jusqu'à tenter l'assassinat, les soulèvements populaires qui essayèrent de ranimer, dans le Midi, la guerre civile et la guerre sociale ; enfin le prix que la plupart des nouveaux amis d'Henri, exploitant cyniquement leur soumission, la firent payer au Trésor épuisé. Nous faisons ici allusion à des événements d'un caractère épisodique ou d'un détail trop compliqué pour que nous ne devions pas nous borner à en indiquer la place et à en énoncer le résultat, savoir : l'insurrection féodale, la Jacquerie agraire des Croquants ou Tard-Venus, ligues armées de paysans exaspérés par les extorsions et les misères de la guerre, vaincues et dissipées, grâces à un habile mélange d'énergie et de modération, par un prince qui frappa à côté, en père, des rebelles où il ne cessait pas de voir ses sujets (février 1594 à août 1595) ; l'attentat de Jean Chatel, qui blessa Henri d'un coup de couteau à la lèvre (27 décembre 1594), forfait dont la conséquence excessive, mais passagèrement nécessaire, fut l'expulsion des jésuites (29 décembre 1594) ; enfin, les traités onéreux conclus avec des princes et des villes de la Ligue : écrasante carte à payer qui ne se solda pas par moins de trente-deux millions de livres, correspondant à cent dix-huit millions d'aujourd'hui. Nous ne publierons pas cette liste douloureuse pour l'honneur français, infâmante pour les parties prenantes[4]. Nous ferons largement la part des mœurs du temps, corrompues par quarante années de luttes civiles ; et comme Henri, sans penser davantage à ce qu'ils lui coûtèrent, nous ne songerons qu'aux résultats obtenus à la fin de l'année 1594. A peine une année s'était écoulée depuis son abjuration, et Henri avait rétabli l'autorité royale dans neuf provinces où la Ligue était, sinon seule maîtresse, au moins dominante, puisqu'elle en occupait les capitales : c'étaient la Champagne, la Picardie, l'Île-de-France, la Normandie, l'Orléanais, le Berry, l'Auvergne, le Poitou, la plus grande partie de la Provence. En outre, Henri avait à peu près achevé de détruire l'empire de cette faction dans l'Anjou, le Maine, la Guyenne. Le corps de la monarchie et l'unité du territoire peuvent être regardés dès lors comme reconstitués en principe, quoique la Ligue et les seigneurs, cherchant à rétablir la puissance féodale, tinssent encore quelques grandes villes et quelques pays[5]. Nous arrivons à la dernière période de la lutte entre Henri IV et Philippe II, à la période des alternatives les plus inouïes de succès et de revers, mais où des efforts suprêmes et décisifs permettront bientôt à Henri la double joie et la double gloire d'achever enfin la conquête de son peuple et celle de la paix. Ce qui caractérise principalement cette période et la distingue nettement de la précédente, c'est que la guerre y devient directe, ouverte entre l'Espagne et la France plus encore qu'entre l'autorité royale et la Ligue, dont Philippe II, après avoir été l'allié, puis le chef, ne se sert que pour l'asservir, et ne favorise les derniers efforts que pour mieux faire réussir les desseins qu'il poursuit pour son propre compte. Henri était trop clairvoyant pour ignorer la situation, trop loyal pour combattre à couvert et par les voies obliques, trop Français pour ne pas sentir et ne pas venger l'injure faite au sentiment national, trop habile pour ne pas tirer tout le parti possible d'un réveil du patriotisme. Aussi se décida-t-il, après mûre réflexion et délibérations assez consciencieuses pour refroidir toute passion et ne laisser de force qu'à l'idée, à déclarer solennellement la guerre à l'Espagne et à lui rendre immédiatement, en les portant sur son territoire, l'injure et les ruines de l'invasion. La politique, qui avait longtemps conseillé à un prince dont les forces étaient divisées entre trop de dangers et trop d'adversaires pour être concentrées et réunies vers un seul but, une longanimité prudente et une dissimulation qui laissait quelque chance à un accommodement, était d'accord avec le sentiment du devoir et de l'honneur pour inspirer à Henri, enfin reconnu de son peuple, et plus sûr de ses moyens, une attitude énergique, et lui permettre des efforts décisifs. Il devait relever le gant jeté à la France et à l'Europe par un implacable adversaire, moins habile que lui, qui venait de découvrir les desseins de son ambition, et de démasquer une intervention jusque-là déguisée, en envahissant la France pour son compte et en s'emparant de la Capelle, non plus comme allié de la Ligue, mais comme ennemi étranger. L'art de la politique, e n matière de guerre, consiste à savoir attendre l'occasion, à ne se décider aux extrêmes qu'après s'y être longtemps préparé, et à laisser à l'adversaire le rôle odieux du provocateur, tout en se réservant les avantages de l'offensive, et, s'il se peut, de la supériorité du nombre et des alliances. C'est ce que fit Henri par la déclaration de guerre notifiée à Philippe II, le 16 janvier 1595, à la suite d'une assemblée où il appela les princes de son sang, les officiers de la couronne, les principaux de son conseil. 11 dénonçait en même temps ses intentions à l'Europe par la publication d'un Manifeste exposant ses griefs, intéressant à sa cause tous ceux que menaçait l'ambition espagnole, et resserrant les liens de solidarité qui l'unissaient à l'Angleterre, à la Hollande et à la Suisse. Après avoir ainsi pourvu aux alliances et aux affaires du dehors, Henri régla celles du dedans. Il prit les mesures qui lui paraissaient les plus propres à paralyser les partis, à empêcher les troubles, à réunir dans un élan unanime toutes les forces vives du pays. C'était une politique nécessaire au succès du duel qu'il engageait contre une puissance redoutable, maîtresse encore, malgré ses embarras et son déclin, de la moitié de l'Europe et des deux Indes. Dans ce but, il pansa la blessure que son abjuration avait faite au cœur du parti protestant, en assurant à ses anciens coreligionnaires la liberté de conscience, l'accès à tous les offices, y compris ceux de judicature, et à toutes les charges et dignités de l'État. Le 6 février 4595, il fit enregistrer au Parlement de Paris et dans tous les parlements de France l'édit en faveur des calvinistes par lequel il confirmait l'édit de 1577, le plus avantageux de ceux que ses prédécesseurs avaient accordés aux réformés, en y ajoutant les articles secrets accordés à Mantes. Le roi profita ensuite de la mort de François d'O, pour essayer de réparer les maux de la guerre civile, de donner au royaume une bonne administration intérieure en composant à nouveau et en perfectionnant le conseil d'État et de finances, Il y fit entrer, à cité du maréchal de Retz, du secrétaire d'État Forget de Fresnes, des conseillers d'État de Schomberg et de Maisse, quatre financiers, Lagrange-Le-Roi, les intendants Heudicourt, Marcel et surtout Rosny. Il avait apprécié le génie de cet utile auxiliaire, qui devait à lui seul remplacer tout cet appareil, après avoir conquis, par une initiation patiente, la compétence et l'autorité nécessaires pour accomplir seul ces réformes qu'une assemblée combat toujours ou n'exécute jamais. Ainsi libre ou tout au moins allégé des préoccupations du gouvernement, le roi présida aux armements considérables et aux mouvements qui devaient préluder à l'exécution de son plan de campagne. Ce plan consistait à porter les hostilités sur le territoire espagnol, à détourner ainsi du Boulenois, de la Picardie, de la Champagne les ravages de la guerre, à infliger à l'ennemi les revers les plus, sensibles et les pertes les plus onéreuses, enfin à ruiner la domination espagnole, dans les Pays-Bas surtout, au moins à lui ravir les provinces les plus voisines du royaume. Le premier acte d'un tel programme devait être l'invasion simultanée du Luxembourg, de l'Artois, de la Franche-Comté, par une armée dont voici la composition : Le Roi ne forma pas moins de sept divisions ou corps de troupes. Il donna trois divisions à Longueville, gouverneur de Picardie ; à Nevers, gouverneur de Champagne ; au maréchal de Bouillon. Les deux premières se composaient des forces des provinces de Picardie et de Champagne, auxquelles quelques corps de troupes avaient été joints. La troisième comptait, outre les soldats levés par Bouillon dans sa principauté de Sedan, trois mille Hollandais auxiliaires, commandés par le comte Philippe de Nassau ; car au début de la guerre la Hollande sembla devoir tenir à Henri les promesses que ses ambassadeurs lui avaient faites. Ces trois divisions devaient être renforcées d'un corps d'élite que l'intrépide Villars avait ordre d'amener de la Normandie. Le Roi appela du Languedoc le nouveau connétable de Montmorency et cinq mille hommes dont il disposait, et le dirigea sur le Lyonnais et le Dauphiné, pays menacés à la fois par l'ennemi du dedans et par celui du dehors ; c'était la quatrième division. Biron reçut la cinquième, destinée contre la Bourgogne, province où Mayenne maintenait son autorité et le parti de la Ligue. Les nouvelles levées faites sur divers points du royaume et rassemblées autour de Troyes en Champagne formèrent la sixième division ; la septième se composa de six mille Lorrains auxiliaires commandés par le baron d'Haussonville et par Tremblecourt que le duc de Lorraine, après sa paix faite avec la France, venait de congédier. Henri les prit à son service et en grossit la force publique. Il pourvut aux subsistances et à la solde de toutes ces troupes pour six mois, en partie avec les produits insuffisants des impôts, en partie au moyen d'un emprunt de 100.000 écus qu'il avait négocié avec le grand-duc de Toscane, employant le crédit, dont les ressources ne lui étaient pas inconnues. Il compléta ses armements, en appelant sous son drapeau la noblesse de toutes les provinces ; en sommant les gouverneurs, leurs lieutenants et autres seigneurs qui avaient des compagnies de gens d'armes de les lui amener et de fournir cet appoint à la défense nationale. D'O avait laissé les places fortes dans un état déplorable. Le Roi organisa à la hâte la défense des plus importantes et des plus menacées. Sous le rapport des fortifications, des garnisons, des approvisionnements, là où les fonds manquaient, il pourvut à leur sûreté par des emprunts contractés avec les municipalités des villes, comme on le voit par l'exemple de Metz. Ces préparatifs étaient dignes de la France et du formidable ennemi qu'elle provoquait[6]. La campagne ainsi préparée s'ouvrit sous les plus heureux auspices. Le plan hardi de Henri réussit d'abord sur tous les points. Les Lorrains auxiliaires, aux ordres du baron d'Haussonville et de M. de Tremblecourt, entrèrent en Franche-Comté, s'emparèrent de Vesoul, de Jonvelle et de Luxeuil. Dans le Luxembourg, le duc de Bouillon se maintint dans les places d'Yvoi, Montmédy, La Ferté, Chauvancy, qu'il avait occupées l'année précédente, battit onze compagnies envoyées par le comte Charles de Mansfeld à sa rencontre, et menaça Thionville. L'envahissement de l'Artois, qui avait pour but de prévenir l'attaque projetée par l'ennemi contre la Picardie, ne débuta pas moins bien. Le comte de Fuentès, gouverneur intérimaire des Pays-Bas pendant la vacance occasionnée par la mort de l'archiduc Ernest (21 février 1595), avait chargé le comte de Varambon, gouverneur de l'Artois, d'arrêter, en le devançant sur les confins de la province, la marche du duc de Longueville. Celui-ci battit Varambon, le fit prisonnier, ravagea l'Artois et saccagea la ville d'Avesnes-le-Comte, poussant ses coureurs jusqu'aux portes d'Arras et de Mons (20 mars). Enfin la garnison de Soissons, qui prêtait la main aux incursions des troupes espagnoles et battait avec elles la campagne jusqu'à Amiens et Péronne, poussant même des pointes jusqu'aux faubourgs de Paris, fut refoulée vigoureusement ; la perte de sa cavalerie, taillée en pièces près de Crespy-en-Valois, la réduisit à la défensive, et délivra la Picardie et l'Ile-de-France, impunément rançonnées depuis des années. Ces revers offensèrent sans le décourager l'orgueil de Philippe II. Irrité d'une résistance inattendue, il donna ordre au comte de Fuentès et au connétable de Castille de précipiter l'invasion, dût-il payer des plus grands préjudices l'ardeur qu'il mettait à venger les succès insolents de celui qu'il appelait encore dédaigneusement le prince de Béarn. Cette exaspération, qui ne se contentait point d'un seul coup, et ne put s'assouvir que par l'invasion de la France sur cinq points à la fois : la Picardie, la Bourgogne, la Bretagne, le Lyonnais et la Provence, changea beaucoup la face des choses, et la fortune parut se ranger encore du côté des gros bataillons. La Ligue se réveilla et les troupes espagnoles rencontrèrent partout le concours de Mercœur, de Mayenne, du duc de Nemours (récemment échappé de la prison de Pierre-Encise), du duc d'Épernon lié, dès 1595, à la cause étrangère par un traité secret d'abord, puis formel. La France fut obligée de renoncer à l'offensive pour la défensive. Le duc de Bouillon, abandonné par une partie des Hollandais auxiliaires qu'il ne pouvait payer, dut abandonner le Luxembourg et repasser la Meuse ; les troupes du duc de Longueville, démoralisées par la perte de leur chef, tué par accident à son entrée à Dourlens, évacuèrent l'Artois et se replièrent sur la Picardie. L'entrée en Franche-Comté du connétable de Castille avec l'armée de 12.000 hommes qu'il amenait du Milanais, força les Lorrains de MM. d'Haussonville et de Tremblecourt d'abandonner leurs précaires conquêtes. Enfin les Anglais et les Hollandais manquèrent à la fois à leurs engagements. Loin de renforcer les armées de son allié, la cauteleuse Élisabeth, qui devait constamment se dérober à ses obligations et marchander son appui, rappela le général Norris et les 4.000 hommes qu'il commandait en Bretagne ; et le comte Philippe de Nassau ramena en Zélande les 3.000 hommes dont il avait un instant prêté le concours au duc de Bouillon. Autant la politique d'Henri IV envers ses alliés avait été et continua d'être loyale et désintéressée, autant elle devait être de leur part, de 1595 à 1598, marquée au coin de l'égoïsme et de la duplicité. Le mécontentement de l'abjuration fut pour quelque chose dans ce changement ; les vicissitudes d'une lutte où Henri devait toucher encore plus d'une fois le fond de l'abîme y furent pour davantage. Aussi, nous verrons, chaque fois qu'Henri a le plus besoin de secours, l'Angleterre et la Hollande sa feudataire, retirer leur main au lieu de l'aider à se relever, cherchant à profiter sans lui et même contre lui de toute occasion d'augmenter le prix de leurs services, ou même de prendre pied en France, et de s'enrichir des épaves du naufrage de leur allié, partagées avec le vainqueur. Cette attitude équivoque et jalouse de l'Angleterre se décida dès 1595, non sans dommage pour les espérances que Henri fondait sur un concours qui lui échappa presque toujours. Le roi, attaqué sur cinq points à la fois, choisit pour y porter son principal effort, celui où il était le plus dangereusement menacé. Il opposa aux entreprises du duc de Nemours sur Lyon le connétable de Montmorency, qui débloqua cette ville, s'empara de Vienne (24 avril), et de Saint-Pourçain. Mais ce n'est pas avec 5.000 hommes que le connétable pouvait soutenir le choc imminent des troupes de la Savoie et de l'Espagne, et maintenir sous l'autorité royale Mâcon, Auxerre, Avallon, que le duc de Mayenne cherchait à reprendre. Dans le reste de son gouvernement de Bourgogne, Châlons, Dijon, Beaune, où fermentait, depuis quelque temps déjà, un généreux levain d'indépendance nationale et communale, résistaient de leur mieux à la tyrannie des lieutenants de Mayenne, et pour prix de leur soumission, appelaient à leur aide l'intervention libératrice du roi. Celui-ci ne pouvait demeurer sourd à un tel appel. Aussitôt après la déclaration de guerre à l'Espagne, il avait envoyé en Bourgogne, pour seconder les patriotiques et héroïques efforts de ces maires et de ces bourgeois que les sanglantes représailles de Mayenne exaspéré ne décourageaient point, le maréchal de Biron, qu'il avait nommé gouverneur de la province, en remplacement du prince lorrain, avec mission de l'empêcher de réaliser, grâce à l'appui de l'Espagne, sa chimère ambitieuse d'un royaume de Bourgogne. Le 19 mars, jour des Rameaux, le maréchal de Biron, après un siège de six semaines, entra dans le château de Beaune. Mayenne, qui avait dit que qui lui arracherait Beaune lui arracherait le cœur vit son autorité détruite dans la courageuse cité, soulevée par ses magistrats au cri de Vive le roi ! et qui, au prix du plus pur de son sang, s'était enfin délivrée de la tyrannie lorraine. La révolution communale et nationale dont le succès rendit à Henri le dévouement d'une cité si digne -de ces libertés municipales qu'elle avait employées à secouer le joug de la Ligue, fut l'étincelle qui met le feu à la tramée de poudre. Auxonne, Autun, Nuits, Dijon, électrisées par l'exemple des intrépides bourgeois de Beaune, l'imitèrent presque à la fois ; mais Dijon ne put achever sa délivrance, et demeura sous le feu de sa citadelle et du château de Talan, implacables geôliers. Le péril était pressant, l'occasion décisive ; le duc de Mayenne et le connétable de Castille réunis débordaient la Franche-Comté et menaçaient la frontière française de l'Est, avec des forces auxquelles ni Montmorency, ni Biron, même ensemble, ne pouvaient tenir tête. Les deux capitaines appelèrent Henri à leur secours, et Henri accourut. ... Sa résolution prise, il pourvut au gouvernement général durant son absence. Il remit l'administration et la correspondance avec les souverains étrangers au conseil d'État et Finances, qu'il venait de réorganiser, et qui dut lui renvoyer la décision des affaires les plus importantes. Il confia le gouvernement au prince de Conti par ses lettres patentes du 29 mai ; il le laissa à Paris pour y commander, avec le titre de lieutenant général, et le conseil de Schomberg, l'un des hommes d'État les plus expérimentés du temps. Il pourvut avec un soin extrême, avec des précautions infinies, à la sûreté des provinces septentrionales. Il assigna la défense de la frontière du Nord au duc de Bouillon, à la fois prince de Sedan et maréchal de France ; au duc de Nevers, gouverneur de la Champagne ; au comte de Saint-Paul, nommé gouverneur de Picardie, en remplacement de son frère, le duc de Longueville. Il leur enjoignit de lever chacun un corps de troupes dans le pays qui leur obéissait, et de former de la réunion de ces corps une armée destinée à tenir tête aux troupes espagnoles. Il renforça cette armée d'un corps considérable de gentilshommes et de soldats recrutés en Normandie et commandés par le brave Villars, le héros de la défense victorieuse de Rouen[7]. Le roi partit de Paris le 24 mai, fit son entrée à Troyes le 50 du même mois, et prit le commandement du corps de troupes auquel il avait donné les environs de la cité champenoise pour lieu de rassemblement. A Troyes, il reçut du maréchal de Biron un nouvel et plus pressant appel. Biron se déclarait impuissant à achever sans aide la réduction du château de Talan et de la citadelle de Dijon, encore moins à arrêter le duc de Mayenne et le connétable de Castille, qui s'avançaient au secours de ces deux forteresses en menaçant la Bourgogne et le Lyonnais d'une conquête sans pitié. Car la guerre avait pris un caractère implacable. Le comte de Fuentès et le connétable de Castille rivalisaient de rigueur ; et ce dernier, dans un manifeste où s'étalaient à la fois la jactance et la férocité espagnole, n'hésitait pas à déclarer qu'il n'entrerait en France qu'avec des flambeaux qui chemineraient devant lui pour tout mettre à feu et à sang. Henri, aiguillonné par cet avis, se dirigea à grandes journées sur Dijon et arriva dans cette ville le 4 juin. Là il réunit ses forces à celles de Biron, y ajouta toute la noblesse du pays accourue à son appel, les de Lux, les Mirebeau, Guillaume de Tavannes, frère du ligueur, et une foule d'autres, cités par les relations contemporaines. Là aussi, il apprit que le connétable de Castille était arrivé, avec les forces hispano-ligueuses, à Gray, dernière place de la Franche-Comté, où il traversait la Saône, pour marcher au secours des châteaux de Dijon et de Talan. Henri passa la journée du dimanche 4 juin à reconnaître le château de Talan, à fortifier Dijon, à requérir jusqu'à Mâcon et Lyon des pièces d'artillerie et leurs servants, enfin à concerter avec Biron le plan des opérations hardies mais sages, qu'il avait combinées pour arrêter, avant qu'il eût pris son élan, l'effort de l'ennemi. Il ordonna à l'armée de se rendre, le lendemain lundi, 5 juin, à Lux, à quatre lieues de Dijon, et à une égale distance de Dijon et de Gray. Il fut enjoint à la masse des troupes de stationner dans cette position, et d'y attendre le retour du Roi et du maréchal. Henri et Biron destinèrent quinze cents hommes de cavalerie à des combats d'avant-postes. A la tête de ce corps, ils résolurent de joindre l'ennemi avant qu'il fût assuré de leur arrivée, de tenter de surprendre et d'enlever quelques-uns de ses quartiers ; d'arrêter sa marche par de vifs et fréquents engagements ; de gagner un jour ou deux, pendant lesquels on avancerait les fortifications autour des châteaux de Dijon et de Talan, pour en interdire les approches et en hâter la reddition. Ces avantages obtenus, le roi et Biron devaient se reployer sur Lux et le gros de l'armée, engager avec l'ensemble des troupes françaises une bataille générale contre les forces espagnoles et ligueuses, leur fermer par une défaite et la route de Dijon et l'entrée de notre pays. Ces vues et ces mesures sont toutes non-seulement d'un capitaine consommé, mais d'un général se tenant sur une prudente réserve[8]. Ces dispositions du génie militaire d'Henri faillirent échouer par suite d'une série d'accidents impossibles à prévoir, où l'impéritie des hommes fut compliquée par une sorte de fatalité. Il n'en eut que plus de mérite à rétablir, à force de courage, non sans grand péril de sa vie, ses affaires un moment compromises jusqu'à la défaite et à la captivité, et, avec une poignée d'hommes, à arrêter et intimider une armée. Cet exploit, bien différent, par ses circonstances et ses conséquences, de l'héroïque témérité d'Aumale, eut pour théâtre le paysage pittoresque et accidenté qui s'étend entre les deux éminences par lesquelles sont séparés les deux villages de Fontaine-Française et de Saint-Seine. Parti de Dijon le lundi 5 juin 1595 à quatre heures du matin, le roi arriva à Lux à huit heures. Là il reçut, sur la marche des ennemis, des rapports tellement contradictoires qu'il résolut de s'éclaircir par lui-même en poussant jusqu'à Fontaine-Française, bourg situé à l'extrême frontière. Il assigna ce village pour rendez-vous, dès trois heures de l'après-midi, aux diverses troupes qui composaient son corps de quinze cents cavaliers. Là dessus, il envoya en avant, pour reconnaître soigneusement l'ennemi, deux troupes, l'une de cent chevau-légers, l'autre de soixante, la première commandée par le baron d'Haussonville, la seconde par le marquis de Mirebeau. A une heure, accompagné du maréchal de Biron, le roi parti lui-même de Lux pour Fontaine-Française afin d'être en mesure de disposer, à mesure qu'elles arriveraient, les dernières troupes qui devaient composer son corps de quinze cent cavaliers, en ordre de marche et de combat. Il détacha en avant une compagnie de gens de pied, avec ordre d'occuper deux châteaux situés au village de Saint-Seine, sur la Vingeanne, pour défendre le passage de cette rivière. Il demeurait avec deux cents chevaux, les uns appartenant à la compagnie du baron de Lux, les autres gentilshommes. Arrivé à une lieue de Fontaine-Française, le roi rencontra trois soldats que lui dépêchait le marquis de Mirebeau, chargés d'annoncer qu'il était contraint de se replier sur Fontaine-Française par la rencontre d'un gros de cavaliers ennemis, derrière lesquels il avait eu à peine le temps de distinguer des files nombreuses qui annonçaient l'armée espagnole. Henri résolut de vérifier ce que cette conjecture pouvait avoir de fondé, car, suivant le résultat, il devait ou attendre de pied ferme, avec les troupes réunies à Fontaine-Française, un simple corps d'avant-garde, ou se retirer sur Lux, afin de se mettre en mesure avec toutes ses forces d'offrir la bataille à l'armée ennemie. Par son ordre, le maréchal de Biron partit avec la compagnie du baron de Lux, et une escorte de vingt-cinq gentilshommes volontaires. Il fut rejoint, auprès de Fontaine-Française, par quelques officiers dont les troupes n'étaient pas encore arrivées, entre autres le brave capitaine La Curée. Après avoir traversé le village, Biron rencontra le baron d'Haussonville, envoyé dès le matin à la découverte. Celui-ci déclara que d'après une battue qu'il venait de pousser dans un rayon de six lieues, il lui répondait que l'armée ennemie était encore loin ; qu'on ne risquait d'avoir affaire qu'à deux cents chevaux espagnols, qui l'avaient attaqué, et qui, partis de la montagne située au-dessus de Saint-Seine, cheminaient entre cette montagne et le ruisseau bordé d'arbres par lequel est traversée la plaine de Fontaine-Française. A la guerre tout est ricochet, dans le mal comme dans le bien. Biron, rassuré par les informations erronées de M. d'Haussonville, rassura à son tour le roi, qui s'empressa d'accourir au galop, avec une poignée de gentilshommes friands de la lame comme lui, pour prendre sa part de la fête. Quand il arriva, la fête était une déroute, prélude d'un désastre presque inévitable, dans laquelle il ne sauva à Biron et à ses cavaliers écrasés, cernés par une force dix fois supérieure en nombre, la liberté et la vie, 4u'au risque d'être pris ou tué lui-même. Biron et sa troupe rencontrèrent d'abord un corps de soixante cavaliers détachés du gros de deux cents chevaux espagnols signalés par M. d'Haussonville, qui occupaient la colline située entre Fontaine-Française et Saint-Seine. Le maréchal chassa de la colline les soixante coureurs, la gravit et put alors dominer un spectacle des plus inattendus. La hauteur permettait, en effet, de distinguer, sur l'éminence ou côte située en face, descendant par étages jusque dans le village de Saint-Seine, une foule armée qui noircissait de ses masses et hérissait de ses piques les sentiers obliques qui forment les degrés de cette sorte d'escalier naturel. Il était à peu près hors de doute qu'on était en présence de l'avant-garde de l'armée ennemie. La Curée appela le maréchal et lui dit : Voyez cela ! Biron, reconnaissant l'armée espagnole s'écria alors avec désespoir : Je voudrais être mort, j'ai envoyé quérir le roi et voilà toute l'armée ennemie ! Là-dessus, le maréchal s'empressa de redescendre, afin de rejoindre le Roi en toute hâte et de réparer son erreur. Mais sa retraite fut contrariée par une attaque générale des deux cents chevaux ennemis, qu'il repoussa de son mieux en rompant et reculant sur trois échelons, pour diviser l'effort des assaillants. A ce moment déboucha du coin du bois, en face duquel il était arrivé, un corps considérable de cavalerie ennemie, dont l'entrée en lice portait à douze cents hommes les participants à cette lutte inégale et grossissante, qui d'escarmouche devenait une affaire en règle. Une division du corps de cavalerie ennemie devança le reste. Elle comptait environ cinq cents hommes, moitié Espagnols, moitié corps français, récemment amenés au Connétable de Castille par Mayenne, et commandés par Thianges, Ténissay, Villars-Houdan. Les Français reconnurent Biron et s'acharnèrent dès lors contre lui, dans l'espoir de l'accabler et de le faire prisonnier. C'eût été un beau coup de filet. Mais Biron se défendait en désespéré contre le sort qui lui était réservé. Il appela à son aide M. d'Haussonville et ses cent chevau-légers. D'Haussonville vint seul, ses soldats, intimidés par le nombre des assaillants, ayant jugé l'affaire mauvaise, et tourné bride, quoi que pût leur dire leur chef, indigné de cette lâche désertion. Cependant Biron était serré de plus en plus, et ne se dégageait de la mêlée que par des charges de plus en plus embarrassées. Désespéré du danger où il avait attiré le roi plus que de celui qu'il courait lui-même, blessé au ventre et à la tête, les yeux aveuglés par le sang, le jugement troublé par la colère et la douleur, le maréchal n'avait plus assez de forces ni de présence d'esprit pour échapper au tourbillon qui l'environnait. Il allait y disparaître, vendant du moins chèrement sa vie, quand le roi arriva au galop sur le lieu du combat, suivi seulement de cent vingt gentilshommes de la cornette blanche. Une compagnie de quarante chevaux l'ayant rejoint fut envoyée par lui à la rescousse, mais revint dans une telle déroute, une telle panique, que le roi put à peine retenir au passage quelques fuyards de bonne maison, en les appelant par leur nom. Heureusement Guillaume de Tavannes survint avec soixante cavaliers de sa compagnie, solides comme lui, et qui piquèrent des deux en avant, précédant le roi, résolu à se porter de sa personne au secours de Biron. C'est en vain qu'on lui représenta les dangers de cette détermination et que M. de la Trémoille le supplia de ne point trop hasarder celui de la tête duquel dépendait le salut de l'État. Henri coupa court à ces remontrances et à ces adjurations importunes en disant : Je n'ai pas besoin de conseil, mais d'assistance et en justifiant son audace par ces mots décisifs qui n'attestaient pas moins la sûreté de son coup d'œil, que sa résolution de sauver Biron ou de le venger n'attestait son courage : Il y a plus de péril à la fuite qu'à la chasse. Ce disant, il chargea avec un tel élan, que l'ennemi en fut déconcerté, croyant suivi pour le moins d'un corps d'armée, un capitaine qui frappait si fort. Les cinq cents cavaliers qui entouraient Biron élargirent le cercle, reculèrent, allèrent se reformer en arrière, et attendirent le gros de leur cavalerie pour renouveler le combat. Grâce à cette intervention, le maréchal, dégagé, put se retirer vers le roi et sa troupe, auxquels il devait son salut, mais qui faillirent le payer chers En effet, l'alerte s'étant propagée rapidement, toute l'armée espagnole se trouva bientôt disposée à répondre à ce qu'elle croyait une attaque d'avant-garde, prélude d'une bataille en règle. La plus grande partie de la cavalerie ennemie descendit dans la plaine pour refouler les royaux. Mayenne se tint sur la colline, prêt à appuyer le choc avec une réserve de trois cents chevaux. Une division de l'infanterie espagnole prit position sur la lisière du bois. Le connétable de Castille, avec une seconde division, derrière laquelle fourmillait la masse de son armée, demeura au delà de la Vingeanne, et se posta sur le terrain compris entre cette rivière et Saint-Seine. Pour faire face à tant d'ennemis, le roi, que la compagnie de Biron venait de rejoindre, disposait d'environ trois cents hommes. H les divisa en deux troupes, prit le commandement de celle de gauche, donna à Biron, impatient d'une revanche, son aile droite à conduire, et dirigea fort habilement et fort heureusement son attaque contre les six cent cinquante chevaux ennemis, échelonnés en trois escadrons, qui tenaient la plaine. Au front de sa troupe, Henri avait placé une ligne d'arquebusiers à cheval dont la décharge commença d'ébranler les rangs ennemis. MM. de La Trémoille et d'Elbeuf, à la tête de cent vingt gentilshommes bronzés au feu, firent une charge qui culbuta les escadrons espagnols les uns sur les autres. Henri, avec soixante cavaliers, agrandit la trouée, acheva la déroute, mais se trouva engagé dans une de ces mêlées furieuses où la vie est abandonnée à tous les hasards du corps-à-corps, et où un roi n'est qu'un homme. Mais cet homme était un héros et ne comptait pas avec la mort. Heureusement que quelques dévoués y pensaient pour lui. L'un des gentilshommes qui s'étaient donné la mission de veiller sur Henri, abattit d'un coup de pistolet un ennemi qui s'apprêtait à le frapper ; un autre, M. de Montataire, reçut à ses côtés une blessure qui lui était destinée. Cependant Henri frappait d'estoc et de taille, sans s'inquiéter du danger qu'il courait, et ne songeant qu'au péril qui menaçait ceux de ses amis qu'il parvenait à distinguer à travers la poussière et la fumée. C'est ainsi qu'il préserva, par un avertissement opportun, le brave La Curée d'une mort certaine. Au plus fort de la mêlée, ce dernier entendit une voix vibrante qui lui criait : Garde La Curée ! Il reconnut la voix du roi, et en se retournant, il para fort à propos, avec son épée, la lance d'un cavalier ennemi qui allait la lui passer par derrière au travers du corps. Biron, de son côté,-avait mené, en dépit et peut-être à cause de ses blessures, haut la main la furie française, à sa ligne d'attaque. M. de Mayenne essaya en vain de retenir la débandade, d'encadrer les escadrons en déroute dans ses réserves. Il fut débordé et bientôt entraîné lui-même sous la vive poussée des deux troupes du roi et de Biron, réunies à la poursuite. Il fallut, pour arrêter l'élan des fuyards, la barrière de quatre cents chevaux frais que venait d'envoyer le connétable de Castille, et l'appui de sa division d'infanterie. La lisière du bois fut aussitôt hérissée de files d'arquebusiers et de mousquetaires, menaçant les cavaliers royaux d'une réception trop chaude pour qu'ils songeassent à affronter cette ligne de feux et ces troupes prêtes à les envelopper. Henri donna donc à ses compagnons, qui avaient trop fait pour s'exposer à perdre le bénéfice de leur succès, le signal de la retraite. Ils rompirent en bon ordre jusqu'au milieu de la plaine, où ils se formèrent en une double troupe. Le duc de Mayenne dirigea contre eux mille ou douze cents hommes de cavalerie hispano-ligueuse, qui suivirent le mouvement rétrograde du roi et essayèrent de reprendre l'offensive. Mais il suffit de quelques charges pour refouler et disperser ces troupes fatiguées et démoralisées. Malgré tout, la situation des royaux demeurait précaire, et si l'avis de Mayenne eût été écouté, le roi courait encore risque de la liberté et de la vie. L'expérimenté capitaine, en effet, plus perspicace que ses alliés, s'aperçut sans peine que Henri n'avait derrière lui ni toute son armée, ni même toute sa cavalerie. Il pressa le connétable de Castille de le renforcer de quatre cents cavaliers non encore employés, et de passer lui-même la Vingeanne avec son infanterie, afin de couper la retraite à l'ennemi. Le connétable de Castille n'obtempéra pas à ce désir. Il se refusa à croire que le roi de France fût venu là sans avoir toutes ses forces à ses épaules, attribua le conseil de Mayenne à son impatience de sauver la Bourgogne à tout risque, même à celui de perdre la Franche-Comté, et demeura immobile. A la faveur de ce débat et de cette expectative, Henri fut rejoint par la plus grande partie des corps de cavalerie auxquels il avait donné rendez-vous à Fontaine-Française. Le comte d'Auvergne et Vitry, les compagnies de chevau-légers du roi et du duc de Vendôme, celles du duc d'Elbeuf et du comte de Cheverny, du chevalier d'Oyse, des sieurs de Rissé et d'Aix débouchèrent successivement dans la plaine. Henri rallia ses isolés, et poussant son avantage, reprit l'offensive en lançant contre l'ennemi les compagnies nouvellement arrivées. Mais les escadrons hispano-ligueurs en avaient assez ; ils n'attendirent point le choc, firent demi-tour, et se retirèrent derrière leur infanterie, abandonnant au roi le champ de bataille, les deux côtés de la colline jusqu'au bois, leurs morts et une centaine de prisonniers. Ce fut alors au tour des royaux de faire halte et de se livrer à des congratulations provoquées par l'issue si inespérée d'un engagement qui avait failli être si désastreux. Dans un de ces transports sincères d'admiration et de reconnaissance que provoque la victoire, une acclamation unanime, où il n'y avait pas de flatteurs, proclama qu'elle était due au roi. C'était la vérité et celui-ci ne se refusa pas à le reconnaître. II dit, en souriant, à Biron : Qu'il l'avoit échappé belle, et que ce jour-là, il avait été son compère et son parrain. Il reçut avec plaisir les remerciements de La Curée. Celui-ci, embrassant sa botte, s'écria : Sire, il fait bon avoir un maitre qui vous ressemble ; car il sauve au moins une fois le jour la vie de ses serviteurs. J'ai reçu aujourd'hui deux fois cette grâce de Votre Majesté, l'une en ce que j'ai participé au salut général, et la seconde quand il vous plut de me crier : Garde La Curée ! — Il est vrai, répliqua le roi ; voila comme j'aime la conservation de mes braves serviteurs. Les résultats du combat de Fontaine française furent pareils à ceux d'une bataille rangée. Il sauva notre frontière de l'Est d'une invasion étrangère, consolida les conquêtes de Montmorency en Dauphiné et en Lyonnais, celles de Biron en Bourgogne ; il abattit sans retour la Ligue dans toutes les provinces de l'Est, et prépara sa ruine dans les provinces du Midi. Le soir même du lundi, 5 juin, l'armée espagnole retourna à Saint Seine. Le lendemain, elle repassa les ponts qu'elle avait jetés sur la Saône, évacua le territoire français et se retira en Franche-Comté, aux environs de Gray, où elle se retrancha. Cette retraite était la condamnation des châteaux de Talan et de Dijon, qui capitulèrent le 28 juin. Mayenne, de rage, quitta l'armée espagnole et alla à Châlons cuver son dépit. Il ne conservait plus, de son ancien gouvernement, dont il voulait faire un royaume, que cette ville et Senne. Le roi pacifia la Bourgogne, reconstitua le Parlement, mit un terme, par quelques exemples dont la rigueur le rendit populaire, aux excès de la soldatesque, qui trouvaient dans le maréchal de Biron trop de tolérance ; puis il consacra les mois de juillet et d'août à porter la guerre en Franche-Comté. Le connétable de Castille demeura dans ses lignes sans oser affronter la bataille offerte. Dans l'unique rencontre de la campagne, à Apremont, le 12 juillet, les Espagnols furent battus, et Alphonse Idiaquez, général de la cavalerie et lieutenant du connétable, fut fait prisonnier. Henri soumit tout le plat pays, y fit un immense butin ; il se préparait à pousser plus loin ses avantages quand il fut arrêté par les représentations des cantons suisses, et le désir ou même la nécessité de respecter une neutralité chère à des alliés qu'il devait ménager. Le.roi céda donc, abandonna, non sans regret, la Franche-Comté, et, le 24 août, il arriva à Lyon. Là, la joie de ses succès allait être empoisonnée par l'issue si différente de la campagne engagée dans le nord par des lieutenants rivaux et préférant la défaite commune à la victoire d'un seul. La présence de Henri en Bourgogne avait vivifié ses affaires ; son absence en Picardie les stérilisa. Il y avait là de braves capitaines, mais qui, sauf Villars, n'étaient, comme talent militaire, que la monnaie des Montmorency et des Biron. Ils avaient d'ailleurs à lutter, outre l'infériorité des forces, contre le ligueur de Rosne, passé à la solde de l'Espagne, et qui employait au détriment de sa patrie son double génie d'homme d'État et de général. Aussi, un premier succès, la prise de Hani, payée par la mort du brave d'Humières, lieutenant-gouverneur de la Picardie et le premier gentilhomme de la province, fut-il bientôt suivi de revers tels que la réduction du Castelet (25 juin) et le siège de Dourlens (15 juillet) qui fermait aux Français la route de Cambrai, en isolant sans défense ce rempart de nos possessions du Nord. Le duc de Bouillon, calviniste et politique, M. de Saint-Paul, catholique, mais politique, refusèrent d'écouter les avis du catholique et ancien ligueur Villars, qui leur conseillait d'attendre, avant d'essayer de dégager Dourlens, l'arrivée du duc de Nevers et de ses renforts. Des susceptibilités de jalousie et de préséance firent rejeter, comme pusillanime, cette sage opinion, et précipitèrent l'action fatale du 28 juillet. Plus habiles et plus unis que leurs adversaires, le comte de Fuentès, le prince de Chimay, Varambon, le duc d'Aumale, après avoir préposé à la garde de leurs lignes devant Dourlens deux mille cinq cents hommes, sous la conduite de Hernantello de Porto-Carrero, s'avancèrent au-devant des Français, en laissant à de Rosne la direction de leurs opérations. De Rosne, se souvenant de la tactique d'Henri IV, l'employa contre ses capitaines avec un irrésistible succès. Foudroyées par une batterie meurtrière de six canons placée en avant de l'infanterie ennemie, les troupes royales, décimées, battirent en retraite. Villars, désespéré, se dévoua pour sauver notre cavalerie et protéger notre arrière-garde. Il fit reculer la poursuite de l'ennemi et l'aurait peut-être victorieusement arrêtée, sans l'inaction égoïste de Bouillon et de Saint-Paul, qui continuèrent leur marche, en réduisant l'héroïque Villars à n'être plus que la victime de leur salut. Ils échappèrent, en effet ; mais Villars, accablé, fut fait prisonnier au milieu d'un désastre qui nous coûta la perte de presque toute notre infanterie, de près de la moitié de notre cavalerie, taillées en pièces, et, parmi trois mille morts, six cents gentilshommes plus de noblesse qu'il n'en avait péri à Coutras, Arques et Ivry. Impitoyables après la victoire, les Espagnols massacrèrent de sang-froid, comme traîtres, Villars et le maréchal de camp de Sesseval, coupables à leurs yeux de la plus noble des fidélités. Non-seulement ils dépouillèrent, mais ils écorchèrent le corps des vaincus. Ils ne signalèrent pas par de moindres atrocités leur entrée dans Dourlens, pris d'assaut ; ils passèrent au fil de l'épée plus de deux mille personnes, parmi lesquelles des femmes, des enfants, des vieillards. Le 11 août, poursuivant ses succès, Fuentès abandonnait la Picardie et se jetait sur Cambrai, dont il ouvrait le siège. Pendant ce temps, Henri faisait à Lyon, au milieu des acclamations populaires, une entrée triomphale ; puis il achevait l'œuvre, commencée par Montmorency, de la destruction de la Ligue dans le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez et l'Auvergne, où il ne demeura plus au marquis de Saint-Sorlin, devenu duc de Nemours par la mort de son frère (13 août) que Montbrison, Ambert et quelques menues places. Henri donna pour boulevard, à Lyon, la place de Montluel, enlevée au duc de Savoie ; puis il pourvut au gouvernement de la province, à la tête de laquelle il plaça Philibert de La Guiche, le premier gentilhomme de la contrée, qui, comme grand maître de l'artillerie, avait tant contribué au gain de la bataille d'Ivry. Un traité, onéreux par ses conditions, mais avantageux par ses conséquences, conclu avec Bois-Dauphin, maréchal de l'Union, livra à Henri, avec les villes de Sablé et de Château-Gontier, les moyens de rétablir complètement son autorité et la paix publique dans les deux provinces du Maine et de l'Anjou. Les lieutenants d'Henri dans le Languedoc et en Guyenne, MM. de Ventadour et de Matignon, profitant habilement des ferments de réaction royaliste qui venaient d'éclater dans le Midi, occupèrent Lautrec et Rodez, travaillèrent Narbonne et Carcassonne, menacèrent Toulouse. En même temps, les négociations du cardinal d'Ossat et de l'évêque d'Évreux (Du Perron), auprès de Clément VIII, en vue d'obtenir de ce pontife une absolution qui seule pouvait prévenir en France un schisme imminent, pareil, dans ses conséquences pour la papauté, sinon pour la foi elle-même, à celui de l'Angleterre, touchaient au succès, favorisées par la menace de représailles poussées par le roi, sitôt qu'il en serait le maître, en Savoie et jusqu'en Italie où il comptait, dans le grand-duc de Toscane et les Vénitiens, des alliés zélés de sa cause. Enfin le pape, malgré les intimidations et les intrigues de l'Espagne, se laissa toucher. Le 17 septembre, Clément VIII prononça solennellement, dans l'église de Saint-Pierre, l'absolution de Henri IV, sa bénédiction, comme on disait alors, après avoir procédé, avec les négociateurs français, à la signature de la plus importante des conventions intervenues entre la France et le Saint-Siège, entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle, depuis le Concordat de François Ier et de Léon X. Les effets de cette réconciliation définitive du roi et du Saint-Siège, pour la destruction des restes de la Ligue et la pacification du royaume, ne se firent pas attendre. Le premier et le plus important de tous fut un traité provisoire, préliminaire d'un accommodement définitif, signé le 23 septembre, à Châlons, entre Henri et le duc de Mayenne. Il eut pour premier résultat de préparer et d'imposer la soumission prochaine du nouveau duc de Nemours et du duc de Joyeuse, chefs de la Ligue à Toulouse et dans le Languedoc occidental. Enfin dans la Provence, livrée aux intrigues et aux compétitions du roi d'Espagne, du duc de Savoie, du duc d'Épernon, et où deux tyrans locaux, Louis d'Aix et Casaux, prêts à se vendre à l'étranger, opprimaient Marseille, le roi établit un centre de ralliement et de propagande en sa faveur, en attendant l'heure des mesures plus décisives, et renforça les troupes du duc de Guise de celles de Lesdiguières. Dès lors ayant fait, à l'Est et au Midi, tout ce qu'il y avait à faire pour le moment, Henri reporta sur le Nord toute sa sollicitude et toute son activité. Il partit de Lyon la nuit, en poste, le 25 septembre, pour se rendre à Paris, et de là aller délivrer Cambrai des étreintes de plus en plus resserrées de l'armée assiégeante. Ce qui compliquait la situation de la place, c'est qu'elle était une souveraineté indépendante et héréditaire entre les mains de Balagny, le premier des chefs de la Ligue qui s'était prononcé, durant la trêve de 1593, en faveur d'Henri IV, et qui, en 1594, avait coopéré utilement à la prise de Laon. Lié vis-à-vis de Balagny par trois traités, le roi de France ne pouvait influer sur ses actes que dans la mesure des droits de sa suzeraineté, des devoirs de son protectorat. Il devait donc se borner à user de son ascendant pour inspirer la défense de Cambrai, paralyser les dissensions des partis qui s'y disputaient la suprématie, et user de sa puissance pour fournir à Balagny les ressources, en argent et en hommes, dont il avait besoin afin de résister aux attaques du comte de Fuentès. Malheureusement il ne pouvait donner en même temps à Balagny l'art de saisir les occasions, de profiter des obstacles, le génie de prévoyance et de persévérance qu'il possédait lui-même, Il ne pouvait pas davantage obliger Nevers et Bouillon à interrompre leurs rivalités et leurs querelles pour voler au secours de Cambrai. Son envoyé Dominique de Vie, l'un des plus éminents capitaines de l'armée royale et son meilleur officier du génie, ne put obtenir du duc de Nevers que quelques centaines d'hommes, commandés par son fils le duc de Rethelois. Ils se jetèrent, le 15 août, dans la place où de Vie les rejoignit, le 2 septembre, avec une troupe qui porta les renforts obtenus par Balagny à mille cinq cents hommes. De Vie, à qui Balagny eut le bon sens de laisser la direction de la défense de Cambrai, la mena si hardiment et si heureusement, que le 30 septembre, au moment où Henri prenait les mesures nécessaires pour venir au secours de la place, encouragé par les succès continus de la garnison et les assurances de fidélité des habitants, le comte de Fuentès délibérait de lever le siège sans attendre l'arrivée de Henri. Comment, en deux jours, tout ce laborieux édifice s'écroula-t-il, et comment la ville, triomphante le 30 septembre, fut-elle occupée le 2 octobre presque sans coup férir ? C'est ce qu'expliquent suffisamment les chicanes intempestives du Parlement de Paris sur les édits bursaux au moyen desquels Henri s'évertuait à trouver des ressources ; les retards qui furent la suite de ce débat ; la mauvaise foi de l'Angleterre et de la Hollande infidèles à leurs engagements ; la révolte, ménagée par les intrigues de De Rosne et l'archevêque, des habitants, de loyaux devenus subitement séditieux ; enfin, l'inaction du duc de Nevers qui refusa, aux instances de De Vic, le secours des six mille hommes dont il disposait et au moyen desquels il pouvait, sinon reprendre la ville, du moins conserver la citadelle. Il dut la rendre, le 9 octobre, au moment où le roi arrivait à Montdidier, mais trop tard pour pouvoir faire autre chose que blâmer Nevers, rassurer la Picardie, et disposer pour le siège de la Fère, revanche vengeresse nécessaire à son prestige compromis, les forces désormais inutiles à la délivrance de Cambrai. L'entreprise était ardue ; il était difficile d'y réussir, périlleux d'y échouer. Henri ne négligea rien pour obtenir le succès, ou du moins sauver l'honneur d'un revers immérité. Le rêve de l'Angleterre était d'avoir en France un pied à terre, Morlaix ou Brest, mais surtout Calais, qu'elle complotait sourdement de reprendre. De là les tergiversations d'Élisabeth qui, sans jamais pousser à bout nos ambassadeurs, ne les satisfaisait jamais complètement, et n'éludait pas moins habilement leurs demandes de secours qu'ils n'éludaient eux-mêmes cette incroyable prétention de l'Angleterre, attentatoire à la fois à l'autorité du roi son allié et à l'orgueil national de son peuple, à posséder, à titre de gage, un de nos ports. Élisabeth n'accorda donc rien aux instances que lui fit renouveler Henri IV à la veille du siège de la Fère ; mais profitant habilement des ouvertures en vue d'une trêve que lui faisait faire Philippe II, soit pour gagner du temps, soit qu'il fût réellement découragé du résultat, si inférieur à son but et ses à moyens, d'une invasion dont l'unique conquête sérieuse consistait dans Cambrai, Henri contraignit les Hollandais, intimidés par la crainte d'une paix qui les livrait à tout l'effort de l'Espagne, à s'exécuter et à lui fournir des hommes, des subsides et des grains. Henri commença le siège de la Fère le 8 novembre 1595, avec une énergie et une activité qui ne sentoient, dit d'Aubigné, ni un roi, ni un royaume, abattus de tant d'incommodités. La Fère était entourée de toutes parts d'un marais et l'on ne pouvait y accéder que par deux chaussées. Elle était défendue par une garnison nombreuse ; et depuis trois ans devenue le magasin d'approvisionnements et le parc d'artillerie des troupes espagnoles entrant en France, elle regorgeait encore de vivres et de munitions. Une place ainsi protégée par toutes les ressources de la nature et de l'art n'était point de celles qu'on peut se piquer de prendre de vive force. Le roi le sentit et résolut d'employer les deux irrésistibles, mais lents instruments de réduction, le blocus et la famine. Dans ce but, il ferma les deux
avenues qui menaient à la Fère par des forts qu'il garnit de canons et dans
chacun desquels il posta mille fantassins ; il logea son infanterie dans un
gros village sur les bords du marais, et sa cavalerie dans les hameaux qui
sont au nord, et qui regardent la Flandre. Il boucha ainsi absolument les
passages qui conduisaient à la ville, et mit les Espagnols dans
l'impossibilité d'y jeter aucun secours de quelque importance sans livrer
bataille. Le désordre des armées espagnoles dans les Pays-Bas favorisa son
entreprise durant tout l'hiver[9]. Les difficultés financières contre lesquelles luttait Philippe II, pour réunir les ressources nécessaires à l'entretien de ses armées, l'état de mutinerie presque permanent de ses mercenaires Italiens, Siciliens, Wallons, refusant tout service avant d'avoir touché l'arriéré de leur solde, réduisaient à l'inaction le comte de Fuentès ; et le cardinal-archiduc Albert, qui succéda, le 13 février 1596, à l'archiduc Ernest dans le gouvernement des Pays-Bas, dut employer les premiers mois de cette année à contraindre à l'obéissance les troupes qu'il devait conduire en France. Le roi profita de cet intermède, sorte de trêve imposée par les circonstances, pour pousser, contre les restes de la Ligue et l'intervention étrangère, en Bretagne et en Provence, un double travail d'opérations militaires et de négociations politiques, qui, dans la dernière de ces provinces, allait aboutir à un résultat des plus encourageants. En Bretagne, malgré la prise de Fougères et de Comper, cette dernière achetée au prix de la mort du maréchal d'Aumont, tué pendant le siège (19 août 1595) les affaires du roi demeurèrent stationnaires ; et quand Saint-Luc, nommé grand maître de l'artillerie à la place de La Guiche, remit la lieutenance générale de Bretagne au maréchal de Brissac, pour venir prendre une part importante au siège de la Fère, le bilan de la campagne se résolvait par un compte balancé de profits et de pertes. Il n'en fut pas de même en Provence, où la seule nouvelle de l'absolution du roi et de sa réconciliation- avec le Saint-Siège lui valut la soumission d'Arles. Le connétable.de Montmorency et M. de Fresne, pour déblayer un peu le terrain de cette lutte compliquée qui livrait à la fois la Provence aux entreprises de la guerre civile et à celles de la domination étrangère, sommèrent le duc d'Épernon de céder le gouvernement de la province au duc de Guise et de sortir du pays. Cette injonction n'eut d'abord d'autre résultat que de changer un rebelle encore prudent en traître déclaré. Le duc d'Épernon ne recula plus devant le crime de s'inféoder à l'Espagne, et traita avec Philippe II, le 10 novembre 1595. Ce défi ne fut pas heureux, il détacha de la cause d'Épernon tous ceux dont l'ambition n'était pas, comme la sienne, capable de tous les moyens. Il prêta au duc de Guise et à Lesdiguières qui s'était fait son lieutenant, l'autorité morale qui doublait leurs forces. Moustiers, Aulps, Forcalquier chassèrent les garnisons d'un homme déclaré criminel de lèse-majesté par le parlement d'Aix. Sisteron, Riez, Martigues, Marignane, se soumirent au gouvernement du roi. La haine et la réprobation des Provençaux contre leur tyran éclatèrent dans l'attentat de Brignoles, ourdi contre sa vie. Philippe II dut concentrer ses ressources dans ses tentatives contre Marseille, qu'allaient lui disputer et lui arracher enfin les efforts du patriotisme local, secondés par notre allié le grand-duc de Toscane, et enfin victorieux, dans une lutte héroïque, de la tyrannie de Louis d'Aix, viguier et de Charles Casaux, premier consul. L'année 1596 s'ouvrit sur le triomphe complet des négociations pendantes, en vue d'un accommodement avec les derniers chefs de la Ligue, et le plus important de tous. Le 31 janvier, le duc de Mayenne fit sa soumission publique. Par l'édit de Folembray, le roi lui accordait, à lui et à ses partisans, amnistie pleine et entière pour le passé ; trois places de sûreté pour six ans : Chalon-sur-Saône, Seurre et Soissons ; le gouvernement de l'Île-de-France, avec distraction du gouvernement de Paris ; des sommes enfin qui, soit pour l'acquittement de ses dettes, soit pour l'accroissement de sa for tune, ne montaient pas à moins de 3.380.000 livres du temps (12.888.000 francs d'aujourd'hui). Il obtenait en outre, pour son fils, M. d'Aiguillon, la duché-pairie. On s'indignait que Mayenne obtint non-seulement impunité, mais récompense pour les maux dont il avait accablé le royaume, et pour le meurtre de Henri III, dans lequel la voix publique l'accusait si hautement d'avoir trempé, que, pour le garantir des poursuites de la justice, Henri fut obligé d'insérer un article exprès dans l'édit de Folembray, et d'écrire à la reine Louise, veuve de Henri III, une lettre dans laquelle il la suppliait au nom de la France et des dangers publics, de se désister de ses poursuites. Aussi le Parlement de Paris refusa-t-il d'abord d'enregistrer l'édit, et ne céda-t-il qu'à trois lussions réitérées du roi, le 9 avril 1596. Mais Henri pensait, avec les hommes les plus sages et les plus expérimentés du temps, qu'au moment où la France épuisée faiblissait dans la guerre contre l'Espagne, on ne pouvait payer trop cher la soumission du chef de la Ligue et le retrait du gouvernement de Bourgogne, placé sur les frontières et dans le voisinage des possessions espagnoles. De plus le duc ramenait sous l'obéissance de Henri, quatre chefs ligueurs, les marquis de Villars et de Montpezat, ses deux beaux-fils ; Lestrange, gouverneur du, Puy-en-Velay ; La Séverie, gouverneur de la Garnache en Poitou. Les événements qui suivirent justifièrent de reste les prévisions du roi et les concessions faites à Mayenne. Dans le même mois de janvier, et par deux autres édits donnés également à Folembray, Henri traita avec le marquis de Saint-Sorlin, devenu duc de Nemours, et avec le duc de Joyeuse[10]. Le traité avec Mayenne et avec Nemours et Joyeuse, qui ne laissait plus hors du giron de l'autorité royale que le duc d'Épernon et le duc de Mercœur, eut pour premier résultat de rendre à Henri la force légale et morale qu'il tirait de la soumission de tous les Parlements, de presque toutes les grandes villes, de la plupart des seigneurs, et de lui permettre de donner tout son développement à la lutte contre l'Espagne, qui gardait désormais sans partage la responsabilité d'une guerre injuste, antinationale, provoquée par l'esprit de domination et de conquête. Par suite de cette réaction, Philippe II, réduit désormais à ses seules forces, fut obligé de restreindre ses ambitions, de retenir son élan et de borner son plan à la possession de la seule Picardie, à l'occupation de trois points, de trois portes d'invasion, de trois ports sur la Méditerranée et l'Océan : Marseille dans le Midi ; Blavet dans l'Ouest ; Calais au Nord. Nous allons voir ce qu'il advint de cette prétention durant l'année 1596. Nous ne résistons pas, avant cet examen, au plaisir de montrer Henri, par une politique habile, achevant de gagner le duc de Mayenne à ses intérêts, limitant à une épigramme sa vengeance contre son plus opiniâtre adversaire, et trouvant moyen de tirer du concours de l'ancien chef de la Ligue un parti décisif dans sa suprême lutte contre l'Espagne. C'est à Sully que nous emprunterons le récit de cet épisode caractéristique de la première entrevue du duc de Mayenne et d'Henri IV au château de Monceau : Il s'en alla coucher à Monceaux, où M. du Mayne le vint trouver deux jours après, ainsi qu'il se promenoit en l'estoille du parc, et s'estant advancé vers luy, l'embrassa par trois fois, l'asseurant qu'il estoit le bienvenu, et embrassé d'aussi bon cœur que si jamais rien ne se fût passé entr'eux. M. du Mayne mit un gent :dia en terre, luy embrassa la cuisse, l'asseura de sa très-humble servitude et subjection, disant quil se recognoissoit grandement son obligé, tant pour l'avoir remis avec tant de douceurs, de bonté et de gratifications particulières dans son devoir, que pour l'avoir délivré de l'arrogance espagnole et des cautelles et ruses italiennes ; puis le Roy l'ayant fait lever et embrassé encore une fois, luy dit quil ne doutoit nullement de sa foy ny de sa parole, parce qu'un homme de bien et de brave courage n'avoit rien tant cher que l'observation d'icelle, le prit par la main, se mit à le promener à fort grands pas, luy monstrant ses allées et contant tous ses desseins et les beautés et accommodement de cette maison. M. du Mayne, qui estoit incommodé d'une sciatique, le suivoit au mieux qu'il pouvoit, mais d'assez loin, traisnant une cuisse aprèz fort pesamment ; ce que voyant le Roy, et qu'il estoit grandement rouge, eschauffé, et soufflait à la grosse haleine, il se tourna vers vous (Sully) qu'il tenoit par l'austre main, et vous dit à l'oreille : — Si je promène encore longtemps ce gros corps icy, me voilà vangé sans grande peine de tous les maux quil nous a faits, car c'est un homme mort. Et là-dessus s'estant arrêté, il luy dit : — Dites le vray, mon cousin, je vay un peu trop viste pour vous, et vous ay par trop travaillé ? — Par ma foy, Sire, respondit M. du Mayne, en frappant de sa main sur son ventre, il est vray, et vous jure que je suis si las et si hors d'haleine que je n'en puis plus ; que si vous eussiez continué à me promener aussi viste, car l'honneur et la civilité ne me permettoient point de vous dire c'est trop, encore moins de vous quitter, je crois que vous m'eussiez tué sans y penser. Lors le Roy l'embrassa, luy frappa de la main sur l'espaule, et lui dit avec une face riante, un visage ouvert et lui tendant la main : — Allons, touchez-là, mon cousin, car pardieu ! voilà tout le mal et tout le desplaisir que vous recevrés jamais de moy, et de celà vous en donné-je ma foy et parole de bon cœur, lesquelles je ne violay ny violeray jamais. — Pardieu, Sire, répondit M. du Mayne en luy baisant la main, et faisant ce quil pouvoit pour mettre un genoûil en terre, je le croy ainsi et toutes les autres choses généreuses qui se peuvent espérer du meilleur et du plus brave prince de notre siècle ; aussi m'avez-vous dit cela d'un si franc courage et avec une si bonne grâce, que mes ressentimens et mes obligations en sont redoublés de moitié ; et partant vous juré-je de rechef, Sire, par le Dieu vivant, sur ma foy, mon honneur et mon salut, que je vous seray toute ma vie loyal sujet et fidelle serviteur, ne vous manqueray ny abandonneray jamais, ny n'auray de vie, ny désirs, ny desseins d'importance qu'ils ne me soient suggérez par vostre Majesté mesme, ny n'en recognoistray jamais en d'autres, fussent-ils mes propres enfants, que je ne m'y oppose formellement, et ne vous en donne advis aussitost. Or sus, mon cousin, répartit le Roy, je le croy ; et afin que vous me puissiez aimer et servir longuement, allez-vous en reposer, rafraischir et boire un coup au chasteau, car vous en avez bon besoin ; j'ay du vin d'Arbois en mes offices, dont je vous envoyeray deux bouteilles, car je scay bien que vous ne le hayés pas (haïssez pas) ; et voylà Rosny que je vous baille pour vous accompagner, faire l'honneur de la maison et vous mener en vostre chambre ; car c'est un de mes plus anciens serviteurs, et l'un de ceux qui a receu le plus de joye de voir que vous me vouliez aimer et servir de bon cœur. Et sur cela, s'en retourna vers le profond du parc, et vous menastes M. du Mayne dans un cabinet fort couvert, car il faisoit grand chaud, où il y avoit des sièges pour reprendre un peu d'haleine ; puis, s'estant fait amener un cheval, il s'en alla peu après avec vous au chasteau ; il vous tint plusieurs discours à la louange du Roy, disant que sa bonté, sa douceur et son généreux courage pouvoient aller de pair avec les plus renommés princes des siècles passés... Vers le même temps, au moment où Marseille touchait à la nécessité de subir le joug étranger, livrée par Louis d'Aix et Casaux aux troupes espagnoles qui étaient logées aux environs, et cernée dans son port par les douze galères de Charles Doria, l'amiral de Philippe II, elle fut affranchie à la fois de l'ennemi intérieur et de l'ennemi extérieur par le succès du noble complot noué entre l'avocat Bausset, le président Bernard et Pierre de Libertat. Le 17 février, en deux heures, par le miracle d'une révolution patriotique imitée de celle de Paris, Marseille était redevenue française et ouvrait ses portes au duc de Guise aux cris de : Vive la liberté ! Vive la France ! Vive le roi ! Telle était l'importance de cet événement, qu'en l'apprenant Henri IV s'écria : C'est à présent que je suis roi ! La réduction de Marseille entraîna la soumission du duc d'Épernon, qui trouva dans la clémence inépuisable d'Henri IV assez de pardons pour tous ses crimes, et qui demeura malheureusement assez puissant pour les aggraver par l'ingratitude (24 mars 1596). A ce moment le territoire de la France, pour être reconstitué en entier, l'unité nationale, pour être complètement rétablie, n'attendaient plus qu'une partie de la Bretagne et quatre villes de la Picardie occupées par l'Espagnol[11]. A ce moment aussi, par une suite de revers inattendus, la fortune de Henri déclina soudain jusqu'à l'abîme, qu'il n'évita que par des prodiges d'habileté et de courage. Arrivé par la soumission du duc d'Épernon à reconquérir l'indépendance de sa couronne, Henri était loin d'avoir accompli sa tâche de général, ni sa tâche de roi. Il pouvait tout au plus se donner le temps de respirer, de reprendre haleine. Il lui demeurait encore, au point de vue militaire, à chasser l'Espagnol de la Picardie et de la Bretagne, à écraser, dans cette dernière province, le dernier et vivace tronçon de la Ligue. Au point de vue politique, il devait achever à l'intérieur l'œuvre de la pacification civile et religieuse, de la réorganisation de l'administration et des finances, mettre un frein définitif aux empiétements d'une oligarchie toujours prête à profiter, pour s'émanciper, des moindres défaillances d'une autorité encore militante, et surtout aux entreprises de ces protestants toujours mécontents, rendus ombrageux par l'abjuration de leur ancien chef, et trop facilement portés par une longue habitude à la guerre civile. Telle est la grande œuvre qu'Henri poursuivra de 1595 à 1598 avec de rares intermèdes de répit, des alternatives inouïes de succès et de revers, mais d'inépuisables ressources d'esprit et de courage, se relevant plus fort à chaque chute, et arrivant enfin à un but qui semble surhumain. Qu'on mesure un moment, comme le roi dut le faire lui-même, les difficultés de l'entreprise, comparées à l'imperfection des moyens, et qu'on dise si tout autre que Henri eût pu arriver, avec d'aussi grossiers leviers que ceux dont il disposait, à soulever ce double poids, devant lequel il ne recula point : la délivrance de la France presque sans armée, réorganisation presque sans argent. Quelques chiffres, à ce propos, seront plus éloquents que toutes les paroles. Lorsque Henri IV succéda à Henri III, voici quel était le bilan de la situation matérielle et financière de la France : On comptait neuf villes rasées ; le feu avait anéanti deux cent cinquante villages, cent vingt-huit mille maisons étaient détruites, la plupart des églises dépouillées ou démolies ; les campagnes étaient dévastées par les brigandages dés soldats de tous les partis, le commerce interrompu, les ateliers sans travaux ; la dette publique montait à 245 millions de ce temps-là. Les sept années du règne de Henri IV, remplies par la guerre étrangère et par la guerre civile étendues à toutes les provinces à la fois, avaient prodigieusement ajouté aux souffrances des villes, aux désastres de l'agriculture et du commerce, à la somme des maux qui pesaient sur les citoyens de tous les états. Les traités de la Ligue y mirent le comble[12]... Ces traités, en 1596, avaient coûté 18 millions de livres ; le chiffre total de cette rédemption, de cette rançon de l'autorité royale devait monter à 32,142.000 livres du temps, plus de 112 millions d'aujourd'hui. Trente-deux ans de guerre civile et étrangère avaient produit ces charges, tout en ruinant le Trésor et les particuliers, dont la détresse augmentait en même temps que s'accumulaient leurs dettes. A la mort de François d'O, en 1595,1a dette de l'État montait à 315 millions environ de ce temps-là, plus d'un milliard du nôtre. Par suite de l'insuffisance des impôts, des difficultés de leur perception, des exactions des fermiers et des concussions des intendants chargés du contrôle, le déficit annuel sur l'impôt direct était de trois millions sur vingt-trois. Le déficit sur l'impôt indirect était en proportion. Quand Rosny (Sully) fut le maître et eut, avec une énergie draconienne, rétabli dans les finances cet ordre sévère dont il est demeuré l'image, le budget de la France arriva à se solder d'abord en déficit, puis en équilibre, enfin en excédant sur un budget de trente-neuf millions de recette[13], y compris les deniers extraordinaires (qu'il faut quadrupler, il est vrai, pour avoir le rapport entre son temps et le nôtre). C'est avec ce budget qu'Henri fit de si grandes choses. Mais en 1595, Rosny n'était pas encore le maitre. Des neuf membres dont se composait le conseil d'État et finances, réorganisé à cette époque, ceux qui ne passaient pas leur temps à voler, les honnêtes, comme de Retz, de Fresne, de Schomberg, de Maisse, perdaient leur temps aux matières d'administration, aux affaires d'État et laissaient la bride sur le cou aux quatre intendants, qui grappillaient à qui mieux mieux et s'engraissaient à l'envi de la maigreur du Trésor. Rosny voulut surveiller, éplucher, se fâcher ; il n'était encore ni assez compétent, ni assez soutenu pour triompher du premier coup dans la lutte qu'il avait intrépidement engagée contre tant d'intérêts et d'ambitions coalisés contre lui. Il dut plier, céder, se laver les mains des abus où tant d'autres souillaient les leurs, se retirer, de guerre lasse, dans ses domaines. Rappelé par le roi, investi d'une sorte de mandat de procureur fondé, autorisé à harceler le Conseil, mais sans attributions assez précises pour se mêler aux délibérations et aux décisions, Rosny ne pouvait encore, à la fin de 1595 et au commencement de 1596, c'est-à-dire au moment où nous sommes arrivés, qu'empêcher un peu de mal et faire un peu de bien. En présence de la misère du pays, de la misère du roi — misère est le seul mot qui résume les lettres d'Henri à cette époque, dont nous allons citer de navrants extraits — on souffre de voir Rosny réduit à n'employer que les remèdes palliatifs, là où il eût fallu et où il eût voulu employer les caustiques, et à ne pouvoir jeter que quelques gouttes dans ce gouffre de nécessités insatiables qu'une pluie d'or eût seule comblé. Écoutez maintenant ces confidences épistolaires datées du siège de La Fère, envoyées par le roi à son commissaire, qui n'est pas encore son premier ministre. L'effet de ces tristes aveux, de ce perpétuel cri d'alarme et d'angoisses, de ce contraste ironique entre la grandeur du but et la pénurie des moyens, est indicible. Quelles couleurs, pour le tableau du temps, que ces appels pressants, ces ordres inobéis, ces reproches souvent inutiles ! ... Si je ne suis secouru d'argent bientôt pour payer les dépenses que je vous ai mandées, je me trouverai en une très-grande peine ; car les Suisses de Desbach se débandent tous les jours ; nos ouvrages demeurent ; ma cavalerie ne peut subsister faute de payement. (6 mars 1596.) Rosny se multiplie, parvient à envoyer quelque argent, et le roi écrit : ... Les treize mille écus que vous m'avez envoyés sont arrivés sûrement et très-à-propos pour contenter notre cavalerie, qui était à la faim et retenir nos Suisses qui se vouloient débander, comme pour continuer nos ouvrages. Mais qu'était-ce que treize mille écus ? une goutte d'eau dans la mer, un grain dans la bouche d'un lion. Dès le, 16 mars, Henri crie de nouveau au secours. Il ne m'est pas possible de faire attendre plus longtemps les Suisses : principalement Diesbach et ses gens ne menacent pas moins que de ployer leurs enseignes et m'abandonner, ce qui m'arriveroit très-mal à-propos sur l'attente des ennemis en laquelle je me trouve, comme vous pouvez trop mieux juger. Le 23 mars, nouvelle insistance : Il me reste de vous prier de tenir la main à ce qui est requis pour la nourriture de mon armée, et que vous donniez ordre qu'il soit envoyé quantité de bled et promptement, comme il est nécessaire ; car il y en a si peu qu'elle ne vit qu'au jour la journée, et bien souvent les gens de guerre n'ont que demi-munition (demi-ration), et quelquefois ne reçoivent rien[14]. Mais si l'on veut avoir une idée de la pénurie d'Henri devant La Fère, des services que lui rendit Rosny, services justement récompensés par la confiance et la faveur de son maître, enfin des rapines des intendants, voici la lettre décisive : Je vous jure avec vérité que toutes les traverses que j'ai subies jusqu'ici ne m'ont pas tant affligé et dépité l'esprit que je me trouve maintenant chagrin et ennuyé de me voir en continuelles contradictions avec mes plus autorisés serviteurs, officiers et conseillers d'État, lorsque je veux entreprendre quelque chose digne d'un généreux courage et de ma naissance et qualité, à dessein d'élever mon honneur, ma gloire et ma fortune, et celle de toute la France, au suprême degré que je me suis toujours proposé.... ... Cela m'afflige infiniment, voire me porte quasi au désespoir, et m'aigrit de telle sorte l'esprit contre eux, que cela m'a fait absolument jeter les yeux sur vous, sur les assurances que vous m'avez souvent données, d'avoir le vouloir et le pouvoir de me bien servir en cette charge, et m'a remis en mémoire ce que vous me dites à Saint-Quentin, des grands divertissements (détournements) qui avoient été faits depuis la mort de M. d'O, de notables sommes de deniers provenus des aliénations que l'on a faites de mes aides, gabelles et autres revenus. Ce qui m'ayant donné l'envie de m'en éclaircir davantage, j'ai bien encore appris d'autres plus que vous ; car on m'a donné pour certain, et s'est-on fait fort de le vérifier, que ces huit personnes que j'ai mises en mes finances ont bien encore fait pis que leur devancier, et qu'en l'année dernière et la présente, que j'ai eu tant d'affaires sur les bras faute d'argent, ces messieurs-là, et cette effrénée quantité d'intendants qui se sont fourrés avec eux par compère et par commère ont bien augmenté les grivelées, et mangeant le cochon ensemble, ont consommé plus de quinze cent mille écus, qui étoient somme suffisante pour chasser l'Espagnol de France, en payement de vieilles dettes par eux prétendues. Je veux bien vous dire l'état où je me trouve réduit, qui est tel que je suis fort proche des ennemis, et n'ai quasi pas un cheval sur lequel je puisse combattre, ni un harnois complet que je puisse endosser ; mes chemises sont toutes déchirées, mes pourpoints troués au coude ; ma marmite est souvent renversée, et, depuis deux jours, je dine et soupe chez les uns les autres, mes pourvoyeurs disant n'avoir plus moyen de rien fournir pour ma table, d'autant qu'il y a plus de six mois qu'ils n'ont reçu d'argent. Partant, jugez si je mérite d'être ainsi traité, si je dois plus longtemps souffrir que les financiers et les trésoriers me fassent mourir de faim, et qu'eux tiennent des tables friandes et bien servies ; que ma maison soit pleine de nécessités et les leurs de richesses et d'opulence, et si vous n'êtes pas obligé de me venir assister loyalement comme je vous en prie[15]. La victoire console de tout un prince et un peuple militaires ; et le bonheur à la guerre fait oublier les adversités intérieures en en faisant espérer le remède. Henri avait-il du moins cette consolation et cette espérance, au commencement de l'année 1596 ? Hélas ! non. Il se trouvait en proie à la pénurie que nous lui avons laissé peindre lui-même en termes si expressifs au moment où Philippe II, pressurant ses peuples sans merci, obtenait par des mesures fiscales impitoyables, les ressources nécessaires pour tenter contre la France un suprême et décisif effort. Et c'est ce moment même que l'Angleterre et la Hollande, rebelles aux sollicitations d'Henri, choisissaient pour le laisser sans secours et l'abandonner égoïstement à sa destinée. Aussi Henri allait-il, et la France allait-elle avec lui, toucher encore une fois à sa perte. Tandis qu'il poursuivait et hâtait de toutes ses forces et de toutes ses ressources le siège de La l'ère, le cardinal-archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas à la mort de son frère Ernest, quittait l'Espagne. Après avoir reçu solennellement, à Bruxelles, en février 1596, les hommages des États des provinces soumises, il avait voulu inaugurer son pouvoir par une expédition heureuse en France, et mériter, par quelque éclatant succès, la faveur du roi d'Espagne et la main de sa fille l'infante Claire-Eugénie, qui lui était destinée, quand il aurait été relevé de ses vœux par le Souverain-Pontife. Au milieu du mois de mars 1596, l'archiduc, après avoir distrait une partie de l'armée qu'il avait rassemblée pour tenir tête aux Hollandais, s'avança en France à la tête de vingt et un mille hommes. Il avait naturellement pour objectif la délivrance de La Fère ; et il débuta par essayer de briser la ligne d'investissement. Il parvint, en effet, à jeter dans la place, le 13 mars, un secours de quelques centaines d'hommes. Mais le roi, redoublant de surveillance, tint si serrées les mailles de son réseau, que l'archiduc dut renoncer à y faire pisser désormais ni un homme ni un pain. Alors, soit pour attirer Henri d'un autre côté subitement menacé, et l'obliger ainsi à relâcher le siège de La Fère, soit pour compenser d'avance la perte imminente de cette place, l'archiduc détourna ses efforts vers quelques villes qu'il savait négligées dans un système de défense forcément réduit au plus essentiel. Au nombre des places que Henri n'avait pu songer encore à préserver efficacement centre une attaque improbable, et qu'il avait un peu imprudemment fiées à la protection de l'Angleterre et de la Hollande, était Calais, que ces deux puissances n'avaient guère moins d'intérêt que nous à garder d'un coup de main espagnol. Henri, dont la sollicitude et la prévoyance s'étendaient tout, avait donné les ordres nécessaires pour que, à tout risque, les fortifications de Calais fussent réparées et que sa garnison fût maintenue au chiffre qui avait suffi à sa défense depuis trente-huit ans. Malheureusement Henri n'avait pu, absorbé par le siège de La Fère, surveiller et vérifier l'exécution de ses ordres. Or, pour être obéi, il faut être en mesure de contrôler. Les membres du conseil d'État et de finances, fidèles à leurs habitudes, ne firent point visiter et réparer les remparts détériorés. Le gouverneur, bien plus coupable encore, ne réclama point, de crainte sans doute de se voir reprocher, à la suite d'une inspection sérieuse, le déficit de sa garnison en partie licenciée par lui et réduite, par une économie lucrative et funeste, au chiffre dérisoire de six cents fantassins. Cette faute, insuffisamment expiée par une mort intrépide, devait coûter à la France une de ses clefs principales, et infliger à Henri la plus imprévue, la plus humiliante, la plus douloureuse des pertes. De Rosne, l'infatigable et trop habile adversaire de la cause qu'il' avait trahie, savait ce qu'Henri ignorait, grâce à des intelligences que ce Français renégat avait facilement conservées un peu partout. Le 50 mars, il proposait à l'archiduc Albert de surprendre Calais et lui promettait le succès. Ce même jour commençait, sur plusieurs points du territoire à la fois, l'invasion espagnole, combinée de façon à masquer, par une série de feintes sur La Fère et Montreuil, l'opération furtivement et vivement poussée contre Calais. Henri, qui avait deviné quelque chose d'équivoque dans la marche de l'invasion, s'empressa de couvrir Abbeville et Montreuil ; mais ses lieutenants Bouillon, Saint-Paul, Belin, moins clairvoyants que lui, négligèrent de secourir à temps Calais, qu'ils ne croyaient pas immédiatement menacé, et laissèrent 'passer successivement de Rosne avec sa division, et l'archiduc Albert avec le gros de l'armée espagnole. De Rosne parut devant Calais le 9 avril 1596. Il précipita l'attaque et emporta en quelques heures le pont de Nieulet et la grosse tour de Risban. Le 11, rejoint par le corps de l'archiduc, il foudroyait la ville par trois batteries comptant au total quarante canons. La flotte hollandaise tenta en vain de forcer l'entrée du port de Calais pour ravitailler la place et renforcer la garnison. Saint-Paul, Belin, Montluc, ne furent pas plus heureux. Pendant qu'Henri, à la nouvelle du danger que courait la ville, se multipliait, faisant appel à ses alliés, réunissait une armée de secours, la ville capitulait (17 avril) et la citadelle était prise le 24. Huit cents soldats furent passés au fil de l'épée. Les vainqueurs firent un butin de 500.000 écus du temps, plus de 5,490.000 francs d'aujourd'hui ; outre bon nombre de canons, ils trouvèrent dans la place une prodigieuse quantité de vivres et de munitions[16]. Les Espagnols, poursuivant leurs succès d'une façon presque irrésistible, s'emparèrent sans coup férir de Ham, de Guines, et, après une dérisoire résistance, d'Ardres (23 mai). C'est en vain qu'Henri répondit à cet insolent défi de la fortune, passée de nouveau à l'ennemi, par la prise de La Fère, où il entra le 22 mai, après un siège de sept mois. Le coup était porté. La France était de nouveau frappée aux sources vives. Le prestige royal était ébranlé. Nos alliés, déjà si tièdes, se refroidissaient tout à fait. Et Philippe II semblait approcher de la réalisation de ses ambitieux projets, tandis que la nation française, épuisée et découragée, paraissait prête à échapper à son roi. Lui seul ne se désespérait pas. Impatient d'une revanche, il offrit en vain à l'archiduc Albert une bataille que celui-ci n'avait garde d'accepter. Alors, faute d'argent, de munitions, de vivres, Henri dut se résigner à renoncer à toute offensive et à préparer, sur un pied d'expectative assez solide pour le préserver de toute nouvelle perte, les ressources de la campagne prochaine. Pendant ce temps, l'archiduc conduisait son armée contre les possessions hollandaises, dans les Pays-Bas, et s'emparait de la forte ville de Hulst, au pays de Waës, mais après un siège long et meurtrier où il laissa cinq mille hommes, et parmi eux ce redoutable transfuge qui lui valait une armée, le ligueur de Rosne, tué devant Hulst le 1er août. Henri employa le répit qui lui était laissé à porter la main successivement à toutes les parties branlantes de son autorité, menacée de ruine par une double tentative d'émancipation et de rébellion de la faction féodale et de la faction huguenote, qui impatientes du joug, profitaient, pour essayer de le secouer, des occasions les plus douloureuses. Il pacifia heureusement, par un mélange de fermeté et de modération, ce double et imminent conflit ; puis il s'appliqua à chercher à l'extérieur, pour continuer la lutte, les ressources qui lui faisaient défaut au dedans, et à resserrer, de façon à les rattacher étroitement à sa fortune, les liens relâchés de son alliance avec l'Angleterre et la Hollande. Après de laborieuses et longues négociations, ces efforts devaient aboutir au traité de Londres, pacte solennel d'alliance offensive et défensive entre la France et l'Angleterre (24 mai 1596) et entre la France et la Hollande (31 octobre). Cette nouvelle alliance ne tarda pas à être scellée, aux dépens de Philippe II, par une guerre maritime qui porta le ravage et la ruine jusque sur les côtes d'Espagne. Un heureux coup de main sur Cadix, accompli par la flotte combinée d'Angleterre et de Hollande, forte de cent cinquante vaisseaux, eut pour résultat la ruine du plus important marché du commerce espagnole, la destruction d'une partie de la marine militaire de Philippe II, et une perte de plus vingt millions du temps, près de quatre-vingt millions d'aujourd'hui (1er et 2 juillet 1596). En même temps, secondant l'effort de ses alliés, Henri lançait le nouveau maréchal de Biron sur l'Ar. tois, qui fut victorieusement parcouru et impitoyablement, ravagé à trois reprises par le hardi capitaine (entre le 12 septembre et le 13 octobre). Philippe, furieux, essaya en vain de rendre à l'Angleterre affront pour affront, blessure pour blessure. De concert avec les rebelles d'Irlande, il dirigea contre la Grande-Bretagne une formidable invasion. Mais il avait compté sans la tempête qui, le 27 octobre, à la hauteur de Viana-del-Minho, fracassa quarante de ses vaisseaux, dispersa le reste et engloutit dans les flots la moitié de son armée. Ce désastre le condamnait à l'impuissance pour le reste de la campagne, et le réduisait à demander, pour la seconde fois, des ressources au honteux expédient de la banqueroute envers ses créanciers d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas (20 novembre 1596). Libre alors de songer aux réformes intérieures, Henri consacra la fin de l'année 1596 et le commencement de l'année 1597 à restaurer l'état financier et militaire de la France. Cette phase rénovatrice et réparatrice de son administration est consacrée par un double événement, dont les conséquences devaient être fécondes pour le pays et ouvrir pour lui une ère de prospérité. Nous voulons parler de l'appel intelligent et généreux fait à la nation elle-même pour panser ses plaies, c'est-à-dire de la convocation, à Rouen, de l'assemblée des Notables, et de la faveur croissante de Sully, enfin de sa prépondérance dans le conseil, qui devait être la suite de l'avortement des mesures prises par une assemblée moins expérimentée et moins énergique que lui. Tandis que Philippe essayait, par la banqueroute, de se rendre les ressources que réclamait l'exécution de ses projets gigantesques et se nuisant l'un à l'autre : l'invasion de l'Angleterre, la soumission de la Hollande, la conquête de quelques-unes des provinces de la France, Henri 's'attachait au projet unique et restreint de trouver les fonds nécessaires pour la défense nationale, pour la continuation de la guerre en vue seule de la paix, sans rien céder du territoire de la France, tout en faisant honneur aux engagements pris, tout en laissant la fortune publique pour garant de leurs créances aux nationaux et aux étrangers. Pour se procurer cet argent, il fallait égaler les recettes aux besoins, réprimer les dilapidations des officiers des finances, des agents du fisc, faire rentrer dans le trésor les sommes qu'ils en détournaient, tirer un meilleur parti des subsides existants, établir de nouveaux impôts, n'atteignant que les classes de la nation qui pouvaient les porter[17]... Tel fut le programme qu'Henri essaya d'accomplir avec les représentants de la nation, et parvint enfin à réaliser, grâce au génie de Rosny. Il chargea d'abord ce dernier de nettoyer les étables d'Augias, c'est-à-dire de faire cesser l'exaction et la concussion des dépositaires infidèles de la fortune de la France. Dans ce but, il le fit rentrer au conseil des finances, et lui délivra les provisions de sa charge d'enquête et d'apuration vers le milieu du mois d'octobre 1596. Rosny (futur Sully) procéda à une enquête méthodique et inexorable sur quatre généralités ou recettes générales. Le résultat de cette inspection et des restitutions qu'elle provoqua fut une recette imprévue, conquise sur les dilapidateurs des deniers publics, de 500.000 écus, 1.500.000 livres du temps, environ 5.490.000 fr. du nôtre. Rosny ramena triomphalement son butin sur soixante-dix charrettes, chargées de ces précieux trophées de sacs d'écus, à Rouen, où se tenait alors l'assemblée des Notables. Ces Notables furent élus dans les ordres désignés par le roi, et qui comprenaient tous les corps compétents pour éclairer ses réformes, autorisés pour les appuyer : le Clergé, la Noblesse, les diverses fractions du tiers état, les Parlements, les cours des Comptes et des Aides, les magistrats municipaux, les trésoriers et les receveurs généraux de France. L'assemblée se composait de quatre-vingt membres : neuf du Clergé, dix-neuf de la Noblesse, cinquante-deux du tiers état. Le roi inaugura les délibérations de ces conseillers indépendants, le 4 novembre 1596, par un discours admirable de bon sens, de noble familiarité, de patriotisme, et qui mérite d'être reproduit eu entier. Si je voulois acquérir le titre d'orateur, j'aurois appris quelque belle et longue harangue, et je vous la prononcerois avec assez de gravité. Mais, messieurs, mon désir me pousse à deux plus glorieux titres, qui sont de m'appeler libérateur et restaurateur de cet État. Pour à quoi parvenir je vous ai assemblés. Vous savez à vos dépens, comme moi aux miens, que lorsque Dieu m'a appelé à cette couronne, j'ai trouvé la France non-seulement quasi-ruinée, mais presque toute perdue pour les Français. Par la grâce divine, par les prières et par les bons conseils de ut serviteurs qui ne font profession des armes ; par l'épée de ma brave et généreuse noblesse, de laquelle je ne distingue point les princes, pour être notre plus beau titre, foi de gentilhomme ; par mes peines et labeurs, je l'ai sauvée de la perte. Sauvons-la à cette heure, de la ruine. Participez, mes chers sujets, à cette seconde gloire, comme vous avez fait à la première. Je ne vous ai point appelés, comme faisoient mes prédécesseurs, pour vous faire approuver leurs volontés. Je vous ai fait assembler pour recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre, bref, pour me mettre en tutelle entre vos mains, envie qui ne prend guère aux rois, aux barbes grises et aux victorieux. Mais la violente amour que je porte à mes sujets, l'extrême envie que j'ai d'ajouter ces deux beaux titres à celui de roi, me font trouver tout aisé et honorable... Tout, bien entendu, hormis une sujétion humiliante, des discussions stériles, des empiétements dangereux. Henri voulait bien recevoir des avis, mais non des ordres ; il avait recherché des conseillers, mais non prétendu se donner des maîtres. Homme d'action, de décision, de pratique, il avait sur les assemblées en général et leur activité stérile, une opinion peu favorable. L'expérience des états généraux factieux de Blois, des états généraux mercenaires de Paris, les uns gagnés à la Ligue, les autres vendus à l'Espagne, l'agitation périodique des synodes et des assemblées protestantes, les prétentions et les chicanes du Parlement lui-même, si fidèle et si éclairé pourtant, n'était pas faite pour inspirer à Henri vis-à-vis des Notables une confiance sans bornes et une sorte d'abdication. Henri voulait être aidé, mais non gêné dans l'œuvre si difficile du gouvernement. Mais il n'avait pas, pour me servir d'une expression de notre temps, donné sa démission. Aussi, à quelqu'un qui s'étonnait de cette résignation, de cette abnégation avec lesquelles il semblait avoir renoncé, vis-à-vis de ses tuteurs, à toute contradiction, à toute résistance, il laissa entendre clairement et pittoresquement qu'il ne s'était point mis en tutelle autrement que de l'unique façon qui convienne à la dignité et à l'indépendance du prince. — Ventre saint-gris, dit-il, il est vrai, mais je l'entends avec mon épée au côté ! Le 5 et le 6 novembre l'Assemblée se constitua et se divisa en trois chambres. Le 8, elle commença ses travaux et voulut d'abord se rendre compte des ressources et des charges, des recettes et des dépenses. Les revenus publics ne montaient qu'à vingt-trois millions du temps, dont seize millions en tailles et le reste endroits divers. Les charges exigeaient seize millions. L'État ne pouvait disposer, par conséquent, que de la somme insuffisante de sept millions pour subvenir aux frais de la guerre, des fortifications, des chemins, ponts et chaussées, maison du roi, marine, etc. Les Notables résolurent de porter les recettes de
vingt-trois millions à trente, et d'augmenter ainsi les ressources de sept
millions. La principale source de ce revenu supplémentaire fut cherchée dans
l'établissement d'un impôt nouveau, le sou pour
livre ou pancarte, dont le
produit fut évalué à cinq millions. Ce droit d'entrée d'un sou pour livre sur toutes les denrées et marchandises qui se vendraient désormais dans les villes, bourgs fermés, foires du royaume, excepté sur le blé comme étant la nourriture du pauvre, était un impôt raisonnable, logique, proportionnel, portant sur une opération à bénéfice, la vente, et non sur un besoin ou un travail, pesant également sur tous les ordres, ne comptant qu'une exception et exemption, celle des villages et des paysans. Il n'en fut pas moins impopulaire, d'une perception difficile, d'un résultat médiocre ; et l'épreuve que Henri et Rosny laissèrent faire, non sans malice, aux Notables, des inconvénients, pour tout corps électif, de l'exercice du pouvoir exécutif, tourna définitivement au profit de l'unité et de la centralisation du pouvoir royal. Elle tourna aussi au profit de l'influence de Rosny, qui avait combattu cette ingérence des Notables dans la perception et l'administration de l'impôt, et qui, successivement victorieux des contradictions de Sancy, des résistances de d'Incarville, des empiétements de l'assemblée des Notables, et de son Conseil de raison, enfin, des intrigues de ses ennemis coalisés, se rendit d'abord utile, puis nécessaire, et, à force de services, gagna le droit de débarrasser impunément Henri des étreintes de celle qu'il appelait plaisamment dame grivelée, autrement dit dame misère. La France, s'abandonnant dès 1597, en dehors de toute chimère, à la direction équitable et progressive d'une administration composée d'un grand roi et d'un grand ministre, eut alors le meilleur gouvernement qu'elle eut jamais possédé jusqu'à ce jour. C'est le témoignage de l'histoire, et la postérité demeure d'accord sur ce point avec les contemporains. Les premiers mois de l'année 1597 furent remplis par d'actives négociations, les unes ouvertes par la France pour précipiter, à force de ressources et d'alliances, la fin de la guerre ; les autres nouées par le Saint-Siège, dans le but d'interposer, entre les parties contendantes, une médiation décisive, et de rétablir la paix. Cette phase spéculative préludant à l'action suprême est marquée par l'ambassade de Bongars et de Guillaume Ancel, envoyée par Henri IV aux princes protestants et aux villes d'Allemagne pour obtenir, au nom de l'intérêt et du danger commun, leur concours dans une lutte à la fois nationale et européenne (décembre 1596 à avril 1597.) Les envoyés d'Henri ne parvinrent à obtenir des princes allemands, indifférents ou intimidés, que de stériles protestations de sympathie et quelques secours insignifiants. Les efforts de Clément VIII en vue de la paix n'aboutirent pas davantage au gré de ce grand et par plusieurs côtés saint Pontife[18]. Ils se brisèrent d'un côté contre l'obstination et l'acharnement de Philippe II, qui considérait le pape comme sa créature, et lui demandait des services, non des conseils ; de l'autre contre les scrupules d'Henri, prêt à tout sacrifier à la paix, hormis la dignité de sa couronne et l'indépendance de ses peuples. Si Sa Sainteté veut mettre la chrétienté en paix, comme elle le montre et comme je crois qu'elle a envie de faire, il ne faut pas qu'elle cherche les moyens de favoriser les desseins du roi d'Espagne au préjudice de ses voisins. Il n'est déjà que trop puissant, et enflé de grandeur et convoitise du bien d'autrui : il a besoin d'un contrepoids, qui serve à tenir la balance égale, et à contenir dedans les limites de la raison et justice ses conceptions. Mon honneur et mon propre bien m'obligent à ne poser jamais les armes que je n'aye recouvré le mien, qu'occupe injustement le roi d'Espagne ; et le sien avec le péril que court sa maison du côté de Hongrie, lui devroit faire reconnoître la raison et borner ses desseins. Si je fais donc ce que je dois, que le roi d'Espagne y manque de son côté, il faut que Sa Sainteté se prenne à lui des calamités publiques ; car il en est la seule cause ; comme elle éprouvera bientôt combien je suis disposé à la paix, si elle peut obtenir de lui qu'il se mette à la raison et me restitue ce qu'il a pris sur moi. Mais je désire que Sa Sainteté sache que je ne ferai jamais paix ni trêve avec lui, qu'il ne se soumette à ce devoir, quoi qu'il puisse arriver. La suppliant trouver bon que je conserve mon honneur et mon royaume entier, pour faire service au Saint-Siège et à la chrétienté, sans céder à l'audace de mon ennemi, qui se baigne en la ruine d'un chacun, pour assouvir son ambition[19]. Henri, obligé par l'exiguïté de ses ressources à se borner à d'étroits desseins, projetait le siège d'Arras. Dans cette vue il avait rassemblé un matériel considérable de guerre à Amiens, où il comptait établir son magasin général de vivres et son arsenal d'artillerie et de munitions pour sa campagne d'Artois. Tout en concentrant dans cette place importante les instruments de son entreprise, il avait pris les mesures nécessaires pour la mettre à l'abri d'un coup de main, et suppléer indirectement et directement, aux défectuosités d'une défense purement municipale et bourgeoise ; car la ville, prétendant se garder elle-même, avait refusé les garnisons royales, et par une confiance qu'il ne devait pas tarder à regretter, Henri avait déféré au vœu des habitants d'Amiens, en respectant les susceptibilités d'une fidélité ombrageuse. Malheureusement, au moment où il était absorbé et détourné par les préparatifs de son expédition sur l'Artois, un habile adversaire, Hernantello de Porto-Carrero, gouverneur de Dourlens pour les Espagnols, profita de l'incurie de Saint-Paul, gouverneur de la Picardie, et de la sécurité funeste où s'endormaient les bourgeois d'Amiens, aussi négligents qu'indépendants, pour tenter contre la ville une surprise combinée avec art, qui réussit avec éclat. La trahison d'un habitant nommé Dumoulin, banni de la ville pour ses méfaits, et la connivence du maire, nommé Famechon, secondèrent ce hardi dessein. Le 10 mars 1597, la ville d'Amiens tombait au pouvoir des Espagnols, par la faute de ses habitants, que lava, mais ne répara point la mort héroïque de quatre-vingt de ses notables, tués les armes à la main parmi eux nous citerons ; le conseiller Lemâtre, le secrétaire Leroi, le trésorier Brisset, Cadot, ancien échevin, et de Blayrie, échevin en charge. Hernantello usa cruellement de la victoire ; la ville subit un pillage de trois jours ; les habitants furent mis à rançon et dépouillés jusqu'à la chemise. Le butin fut estimé à un million d'écus, trois millions de livres de ce temps-là, près de onze millions d'aujourd'hui ; une partie de cette riche proie fut envoyée à Arras. Cette perte n'était ni la seule ni la plus sensible qu'eût essuyée la France. En s'emparant d'Amiens, Hernantello s'était saisi en même temps de la caisse militaire, de l'artillerie, des munitions, des vivres, amassés par le roi pour l'attaque de l'Artois. Le royaume avait perdu tout son matériel pour la guerre du Nord : l'Espagnol avait trouvé dans sa conquête les moyens de la défendre ; la guerre pour lui nourrissait la guerre[20]. La prise d'Amiens était un coup de partie, terrible pour la France et pour le Roi. Hernantello, dans l'ivresse du triomphe, se vantait d'avoir reconquis au pays d'Artois son ancienne borne du temps du duc Philippe de Bourgogne, et rendu Paris frontière. Jamais l'ennemi n'était entré si avant au cœur de la France. Ce fut le signal d'une sorte d'ébranlement universel de l'autorité royale, minée à la fois par le parti de l'aristocratie féodale, les efforts, en Bretagne, de la Ligue ranimée les conciliabules, à Saumur et à Châtellerault, des huguenots mécontents. L'instant était critique et décisif. Pasquier dit : Il sembloit que le Roi eust perdu sa bonne ville, et sa réputation, et le cœur de ses sujets tout ensemble. De Thou ajoute : Ce triste événement sembloit avoir éteint à la fois et la majesté royale et le nom français. Henri sentit le péril. La nouvelle de la prise d'Amiens tomba à Paris, au milieu de la nuit, comme un subit coup de foudre, le 12 mars 1597. Le Roi, en la recevant, ne dit que ces mots qui peignent assez les circonstances et ses sentiments : Il fart ravoir cette ville ou mourir ! Il appela aussitôt auprès de lui, comme aux heures de danger suprême, les princes du sang, les principaux seigneurs de la cour, les chefs de la noblesse, et leur annonça la résolution de marcher à leur tête, à la vengeance du plus sanglant affront qu'eut reçu sa couronne. Il fit cet appel à tous les dévouements, à tous les courages, à toutes les lumières, sans ostentation, sans forfanterie comme sans défaillance. Il manifesta une telle confiance, qu'il en donna à tout le monde. En une matinée il trouva les ressources financières nécessaires à son entreprise : augmentation de quinze sols sur chaque minot de sel ; emprunts sur les plus riches de la cour et des grandes villes ; commission pour la recherche des financiers qui avaient malversé. Le matin du 12 mars, dans cette improvisation inspirée, il avait pourvu à l'argent ; le soir, il avait déjà arrêté avec le connétable de Montmorency le plan de sa campagne. Il se chargea d'aller en personne faire face aux Espagnols sur la frontière du Nord. Il envoya Lesdiguières en Dauphiné ; il fournit au gouverneur Brissac et au lieutenant général Saint-Luc les moyens d'arrêter les progrès de Mercœur et de la conquête espagnole en Bretagne. Il forma, avec toutes ses forces disponibles, deux corps de troupes destinés : l'un à donner des garnisons à la ligne de places situées entre Paris et Amiens ; l'autre à opérer sous les murs de cette ville. Il ordonna une levée générale, destinée à lui fournir les moyens de porter à vingt-cinq ou trente mille hommes, l'armée de siège d'une place reconnue par Mayenne plus difficile à prendre que la Rochelle, et à arrêter toute expédition de diversion et de secours. Il pourvut à la solde immédiate des troupes au moyen des fonds que lui remirent les financiers Zamet, d'Elbène, Cénamy. Il passa un marché de fourniture de 20.000 pains par jour, pendant six mois. Il choisit Paris pour centre de ses approvisionnements et de son armement. Il y mit en train une fabrication incessante de poudre, de boulets, d'affûts, une fonderie de canons. Il y laissa le connétable, la seconde personne du royaume, en le chargeant de poursuivre sans relâche auprès du Parlement l'enregistrement des édits bursaux qui devaient lui procurer des ressources nouvelles, et de présider à l'envoi au camp de Picardie, au fur et à mesure de ses besoins, des hommes, de l'artillerie, des vivres, de l'argent rassemblés par ses soins. Enfin il dépêcha le maréchal de Biron sous Amiens et, parti de Paris en diligence, le 13 mars, avec un gros de gentilshommes, sans même attendre ses gardes et son écurie, il l'y rejoignit au bout de quelques jours. Avant la fin de mars, il avait complété la défense des places de la Somme, cerné, de concert avec Biron, Amiens par deux côtés, tenté contre Arras et contre Dourlens une double entreprise qui échoua, mais dont la hardiesse étonna l'ennemi et rassura la Picardie autant qu'un succès (26 mars). Le 5 avril, quand Henri quitta l'armée pour retourner à Paris où l'appelaient les plus graves nécessités politiques, il avait pourvu à la solde, à l'habillement, à la nourriture de ses troupes, avait rétabli dans son camp, en même temps que le bien-être, une exacte discipline, et fait commencer sous ses yeux, par Errard, le plus habile des ingénieurs français du temps, les travaux du blocus d'Amiens du côté du Nord, destinés à intercepter ses communications avec Dourlens, le Cambrésis et la Flandre, au moyen d'une vaste ligne de contrevallation et de circonvallation. Henri était revenu à Paris où il arriva le 12 avril pour surmonter la résistance du Parlement aux édits bursaux, suivre les négociations pendantes avec nos alliés les Anglais et les Hollandais ; répondre aux nouvelles ouvertures d'accord entre la France et l'Espagne mises en avant par le Saint-Siège ; surveiller les intrigues des partis à l'intérieur et prévenir les soulèvements ; lever une armée suffisante pour assiéger Amiens en règle et tenir tête aux Espagnols quand ils tenteraient plus tard de dégager la ville ; réformer les finances pour subvenir aux frais du siège et à l'entretien de cette armée. Henri suffit à tout, embrassant cette masse d'intérêts, dirigeant ce flot d'affaires par la force de son intelligence et l'énergie de sa volonté[21]. Dès le 17 mars, le Parlement avait déclaré son opposition aux édits bursaux rendus pour faire de l'argent, bien qu'ils eussent été consentis par les députés de ce corps, par les dignitaires de l'Hôtel de Ville, par les notables réunis avant le départ du Roi. Cette résistance inopportune et aveugle n'avait point fléchi devant l'admirable discours suivant, prononcé par le Roi, le 13 avril, à une réunion des principaux membres de la cour souveraine, rassemblés en sa présence. Messieurs, ce n'est pas seulement le soin de pourvoir à ma santé, qui m'a fait revenir de la frontière de Picardie, mais bien le désir d'exciter un chacun de penser aux nécessités qui paraissent ; estimant que nul ne pouvoit ni mieux, ni avec plus de force représenter le mal et procurer les remèdes. Vous avez par votre piété (charité) secouru l'année passée infinis pauvres souffreteux qui étoient dans votre ville ; je viens vous demander l'aumône pour ceux que j'ai laissés sur la frontière de Picardie. Vous avez secouru des personnes qui étoient dans les rues, sur les tabliers ou accagnardés près du feu ; je vous demande l'aumône pour des gens qui ont servi, qui servent nuit et jour, et emploient leur vie pour vous tenir en repos. Je désire, messieurs, qu'on tienne une assemblée générale en cette ville mardi prochain, afin que, comme autrefois, en pareilles occasions, on a fait un effort pour secourir l'État qui n'étoit si faible, ni si allangui qu'il est à présent, chacun contribue à ce besoin. J'ai été sur la frontière : j'ai fait ce que j'ai pu pour assurer les peuples, j'ai trouvé, y arrivant, que ceux de Beauvais s'en venoient en cette ville, ceux des environs d'Amiens à Beauvais. J'ai encouragé ceux du plat pays ; j'ai fait fortifier leurs clochers ; et faut que je vous die, messieurs, que les oyant crier à mon arrivée Vive le Roi ! ce m'étoit autant de coups de poignard dans le sein, voyant que je serois contraint de les abandonner au premier jour. Il ne fit jamais plus beau sur la frontière ; nos gens de guerre pleins de courage et d'ardeur ; le peuple même, qui est entre Amiens et Dourlens, plus voisin des ennemis, plus résolu de s'opposer à leurs armes. Nous avons des nécessités ; nos ennemis n'en sont pas exempts ; c'est chose que nous avons apprises par leurs lettres mêmes. Ils n'ont encore eu moyen de jeter des hommes dans Amiens, et ce m'est un regret incroyable de voir perdre tant de belles occasions. J'ai tenté des entreprises ; nous avons apporté tout ce qui étoit des hommes : Dieu ne l'a pas voulu ; il a fallu subir à son ordonnance. Encore est-ce beaucoup d'avoir essayé à les exécuter, et beaucoup de terreur à nos ennemis d'avoir osé l'entreprendre. Je vous prie, assemblez-vous, car si on me donne une armée, j'apporterai gaiement ma vie pour vous sauver et relever l'Étal. Si non, il faudra que je cherche des occasions, en me perdant, de donner ma vie avec honneur, aimant mieux faillit à l'État que si l'État me failloit. J'ai assez de courage pour l'un et pour l'autre[22]. Ce discours si franc, si chaud, si politique, si éloquent, ne parvint pas à fondre la glace de ces scrupules juridiques, de ces formalistes rigidités conjurées à la résistance. Le 12 mai, les Chambres assemblées refusèrent d'enregistrer les édits. Le 21, Henri, usant de son droit et de son autorité, tint un lit de justice, fit enregistrer les édits en sa présence et, par ses lettres du 4 juin, fixa à 20.000 écus la cotisation du Parlement dans le prêt volontaire. Le Parlement de Rouen imita cette résistance, malgré les exhortations patriotiques de son président Groulart, malgré les adjurations d'une lettre où Henri lui écrivait : Pensez donc aux dangers d'une invasion plutôt qu'aux formalités des lois et ordonnances, qu'il faut maintenant accommoder aux temps, et non prétendre forcer par elles le temps et la nécessité. Il n'y a d'irrémédiable que la perte de l'État. Après de longues négociations, le Parlement de Rouen céda enfin, niais moins à la raison et à la nécessité qu'à la menace d'un lit de justice et d'une contrainte manu militari. Cette mauvaise volonté des Parlements ne trouvait que trop de complices dans les rangs d'une noblesse encore travaillée des ferments de la Ligue et toujours prête à la sédition ou à la trahison. Durant les mois d'avril et de mai, quelques tentatives furent faites pour enlever au Roi, de concert avec les Espagnols, Reims, Poitiers, Rouen, Saint-Quentin. Ces tentatives, qui furent déjouées ou réprimées, n'étaient que le prélude d'un soulèvement général, qu'Henri étouffa dans son germe, en enfermant à la Bastille le vicomte de Tavannes, et en cernant en Auvergne le comte d'Auvergne, tous deux principaux fauteurs du mouvement. Si Henri se multipliait, Philippe ne demeurait pas inactif. Par ses ordres, l'archiduc Albert préparait une levée de 28.000 hommes, et se disposait à jeter dans le débat, engagé sous les murs d'Amiens, le poids d'une intervention décisive, avec la plus forte armée que les Espagnols eussent encore mise sur pied dans les Pays-Bas. A son instigation et grâce à ses secours le duc de Mercœur interrompait les négociations entamées en vue d'un accord et recommençait la lutte en Bretagne. Le duc de Savoie était en même temps instamment provoqué à envahir le Dauphiné avec une armée. Enfin, pour porter sur les forces d'Henri, divisées par une triple attaque, tout l'effort de sa puissance, Philippe n'attendait que l'arrivée de la flotte chargée des lingots d'Amérique et la conclusion de la transaction nouvelle passée par lui avec les banquiers de l'Europe. En présence de ces éventualités redoutables, Henri pressa vivement ses alliés, l'Angleterre et la Hollande, de sortir de leur expectative égoïste, de prendre nettement parti en sa faveur, de distraire l'ennemi par des diversions opportunes, d'accomplir au moins strictement les obligations qui découlaient pour elles d'un traité d'alliance offensive et défensive. Il avait compté sans la casuistique hollandaise, sans la duplicité et la jalousie du ministère anglais, sans la répugnance obstinée des deux puissances à s'engager trop à fond et à le délivrer d'embarras qui pouvaient se dénouer, au profit de leur ambition, par quelque lucrative catastrophe, plus avantageuse pour leurs intérêts que des succès chèrement achetés. Les prospérités de Henri, dit Grotius, avoient fait succéder chez Élisabeth, à une commisération de peu de durée, l'ancienne animosité que les Anglais ont toujours témoignée contre la France. Elisabeth convoitait Calais. Henri lui refusait avec raison ce gage supplémentaire. Quand l'Angleterre a pris un pied quelque part elle en a bientôt pris quatre. Il faut des siècles pour la chasser des pied-à-terre qu'elle aime à avoir chez tous ses voisins, fût-ce au prix et au risque de la fraude et du dol. Cette convoitise traditionnelle dominait tellement la politique anglaise qu'Élisabeth ne devait pas craindre, pour l'assouvir, de faire à l'Espagne, quelques mois plus tard, des ouvertures par lesquelles elle trahissait à la fois la France et la Hollande. Le profit de la convention de 1596 se réduisit donc pour Henri, malgré ses efforts et ses instances, à un dérisoire contingent auxiliaire de six ou sept mille hommes. Poussé à bout par cette mauvaise foi systématique de ses alliés et cette déception de ses plus légitimes espérances, le roi prêta alors l'oreille, — ou feignit de la prêter, — aux négociations d'accommodement ménagées par le Saint-Siège et dont il avait chargé le cardinal de Florence, légat, et le général des Cordeliers, Catalagirone. Mais loyal jusqu'au milieu de ses plus grandes et de ses plus nécessaires dissimulations, Henri cherchait surtout, dans ces manifestations pacifiques, l'occasion de témoigner de sa modération et de servir à la fois la cause de ses alliés et la sienne. Aussi, tout en profitant d'un répit nécessaire à ses préparatifs, il n'abusa pas des illusions qu'il encourageait de bonne foi, tant qu'il lui fut permis de croire à une solution honorable. Elle ne pouvait l'être sans la réparation du guet-apens d'Amiens. Il ne le cacha point aux négociateurs, auxquels il déclara nettement qu'il ne se prêterait à rien qui pourrait blesser sa dignité ou entreprendre sur celle de ses alliés. Je ne fais rien par force : les choses ne sont pas en l'état d'accord, la partie n'est pas bien faite ; nous en reparlerons quand j'aurai repris Amiens, Calais et Ardres. Et puis l'on se trompe de croire que j'entendrai jamais à un accord sans l'avis de la reine d'Angleterre et des États, et de vouloir profiter en cela ou en autre chose de la disgrâce qui m'est arrivée en la ville d'Amiens. J'ai bonne espérance que Dieu, protecteur de la justice et de mes actions, nie fera raison en peu de temps ; que si le dommage que j'ai reçu a été grand, la honte qui en demeurera au roi d'Espagne et au cardinal (l'archiduc Albert), en sera encore plus grande[23]. De l'aveu du roi, conforme au sentiment de l'Europe attentive à ce duel des deux puissances, localisé sous les murs d'Amiens, dont les lignes d'investissement formaient la lice et dont la paix pouvait être le prix, le nœud de la situation était dans l'issue de ce siège mémorable. Des deux parts, mais surtout du côté de la France, rien ne fut négligé pour assurer le succès d'une telle partie. Henri, en vue d'un résultat si désirable, fit des efforts inouïs, qui ne devaient pas être perdus, pour corriger les défectuosités du système d'organisation militaire dont il avait eu si souvent à souffrir, et pour conquérir, sur des habitudes funestes, des préjugés invétérés, le noyau d'une armée régulière, permanente, soldée, nourrie avec exactitude, mais disciplinée avec sévérité. En même temps, le Roi fit un suprême appel à la noblesse, dont il convoqua le. ban et l'arrière-ban, et qui porta en masse, au secours de la patrie en danger, ce qu'on peut appeler ses restes ; car trente-cinq années de guerre civile ou étrangère avaient réduit la classe des gentilshommes, soumise à de véritables coupes réglées, à une effrayante diminution, et épuisé les veines de ce corps généreux. Grâce à ces mesures, Henri put compter réuni, avant la fin du siège, un effectif (français et étranger) de trente mille hommes, dont les pouvoirs nouveaux conférés à Rosny, et l'usage qu'en faisait le futur surintendant des finances, lui garantissaient l'entretien. Henri partit de Paris, le 4 juin, et arriva, le 7, au camp devant Amiens. Il était accompagné de la plupart des princes du sang, du duc de Mayenne, de son fils le prince de Joinville ; et le connétable ne devait pas tarder à le rejoindre. Il trouva les travaux de l'investissement en bonne voie d'avancement, et la ville resserrée, faisant en vain, pour ne pas étouffer sous l'étreinte progressive des lignes de circonvallation et de contrevallation, des efforts désespérés. Il trouva aussi le maréchal mécontent de son arrivée qui le subordonnait, peu empressé à partager avec d'autres l'honneur de travaux qu'il prétendait conduire à sa guise, et le profit d'un succès qu'il regardait comme devant lui appartenir exclusivement. Henri tint, de ces ombrages, le compte que méritait l'erreur même d'un tel serviteur, mais sans rien céder des légitimes et indispensables prérogatives de l'autorité royale. Il prit son poste avec les princes dans l'église de la Madeleine (où il restait encore quelques voûtes entières), et refusa de l'abandonner malgré les volées de canon qui les éraillaient ; longtemps après le siège, on montrait encore la trace d'un boulet qu'on appelait le boulet du Roi, parce qu'il avait effleuré, sans la courber, cette fière et précieuse tête. Le connétable, les ducs de Mayenne et d'Épernon, le prince de Joinville établirent leurs quartiers dans les forts, et le maréchal de Biron fixa le sien dans l'Hermitage, ou chapelle de Saint-Montan, à une portée de mousquet de la contrescarpe, en face de la porte Montre-Écu, contre laquelle il se proposait de diriger d'abord ses attaques. Vers le milieu du mois de juin, la distribution rationnelle des douze mille hommes de pied et des trois mille cavaliers qui composaient à ce moment l'armée royale, ainsi que l'achèvement des lignes avaient rendu complet et de plus en plus étroit le blocus de la place au Midi comme au Nord. Mais les travaux d'approche allaient plus lentement, le roi ayant résolu de procéder à la faveur des tranchées, mode plus lent litais plus sûr, rendu nécessaire par l'impossibilité de cheminer à découvert sous le feu des soixante canons de la place. Du 29 juin au 5 juillet, les assiégés firent, pour contrarier les travaux, une sortie chaque jour. Le 17, Hernantello tenta une sortie générale de la garnison, qui menaça de dégénérer en bataille rangée, et fut d'abord couronnée de succès. Les Espagnols attaquèrent les Français à midi, à l'improviste et par deux endroits à la fois ; pénétrèrent à plus de deux mille pas en avant dans les tranchées, tuant à chaque redoute tout ce qu'ils rencontrèrent ; mirent en fuite le régiment de Navarre ou celui de Champagne, d'après les témoignages divers des contemporains ; taillèrent en pièces une partie du régiment de Picardie avec perte de cinq cents soldats et des trois mestres de camp, l'un des frères Montigny, Flessan, Foucquerolles. Poussant ensuite leur avantage, ils arrivèrent en vue de l'Hermitage, et se disposèrent à emporter les redoutes et à enclouer les canons qui les garnissaient. L'entrée des redoutes était fort étroite. Biron avec quatre gentilshommes de sa suite et une poignée de soldats, la défendit, la pique à la main, contre deux attaques furieuses. Mais le nombre des ennemis augmentant sans cesse, il courut risque bientôt de succomber, et sa batterie de onze canons d'être enlevée. Couvert de sang et de sueur, les cheveux brûlés du côté droit, il faisait des signaux pour annoncer l'extrême danger qu'il courait. Henri les aperçut, et prit sur-le-champ son parti : il mit pied à terre, et s'armant d'une pique, suivi des gentilshommes qui se trouvaient autour de sa personne, il vola au secours de ses serviteurs en péril, sauva la vie au maréchal, comme il l'avait déjà fait à Fontaine-Française, et préserva d'un coup de main la batterie attaquée. Après lui, arrivèrent de proche en proche, les comtes d'Auvergne et de Saint-Paul, et un grand nombre de nobles qui sortirent du poste de la Madeleine. Un combat qui ressemblait fort à une bataille rangée s'engagea alors pendant deux heures entre les Français et les Espagnols. L'aide intrépide que nous prêtèrent les Anglais, les charges exécutées à la tête de son escadron par le prince de Joinville, qui, ce jour-là, fit des prodiges de valeur, la survenue de Mayenne avec six cents chevaux, décidèrent enfin l'avantage en notre faveur. Les Espagnols furent contraints de battre en retraite vers le fossé, et furent poursuivis jusqu'à la contrescarpe, laissant un grand nombre de morts sur le champ de bataille[24]. Ce fut là le suprême effort de la défense, désormais trop épuisée de forces et de sang pour pouvoir franchir les murs de la place. Les combats, les maladies, la disette, avaient réduit une garnison de cinq mille hommes à deux mille, obligés de préserver à la fois de l'assaut à l'extérieur et de la trahison à l'intérieur, une domination précaire, menacée par d'incessants complots, que l'avortement de celui du 10 juin, expié par la mort d'un frère augustin et de sept bourgeois, ses fauteurs, n'empêchèrent pas de se multiplier. L'issue du siège n'était plus qu'une question de temps et semblait devoir être défavorable aux Espagnols. Le grand-maître de l'artillerie, Saint-Luc, bombardait sans relâche la place avec ses quarante-cinq canons, dont une partie avait été fondue au camp, et qui avaient, presque partout, éteint le feu des assiégés. Le 1er août, ayant poussé leurs opérations jusqu'au fossé, les assiégeants les débouchèrent, plantèrent leurs étendards sur la contrescarpe et s'y établirent, sous le feu de leur artillerie, battant en brèche la porte Montre-Écu et les ouvrages qui la protégeaient. Le 29, le ravelin et le bastion de la porte, ainsi que la muraille contiguë, étaient au pouvoir des troupes royales. C'est ce jour-là que l'armée de diversion et de délivrance réunie en Flandre par les soins du cardinal Albert, fit son entrée sur le théâtre des opérations et le menaça du côté de Corbie. Henri, à cette apparition, quitta le camp à la tête de deux cent cinquante chevaux, qu'il renforça en route du corps de Biron, et d'un escadron de cavalerie légère, commandé par le survivant des frères Montigny. Il rencontra un gros de mille cavaliers ennemis, venant, sous la conduite de plusieurs capitaines de bandes espagnoles, reconnaître le prochain logis de l'armée et les moyens de secourir Amiens. Henri contraria ces investigations indiscrètes, tua trois cents hommes aux survenants, leur prit deux cornettes, mit le reste en fuite, et poursuivit la déroute jusqu'à une lieue de Bapaume. Il revint aussitôt sur ses pas, résolu à profiter de cette alerte de l'armée ennemie pour hâter le siège et précipiter la prise de la ville avant qu'elle pût être efficacement secourue. Le 3 septembre, les troupes royales essayèrent d'emporter de vive force les demi-lunes ; mais elles n'y parvinrent pas. Elles firent du moins essuyer aux assiégés la perte sensible de leur chef, Hernantello, tué roide, à l'attaque, d'un coup d'arquebuse, et qui ne fut pas remplacé par son successeur, le marquis de Montenero. Deux jours après, il est vrai, les Espagnols vengèrent cette perte et nous rendirent deuil pour deuil par la mort du brave et spirituel Saint-Luc, l'émule de Givry, héros et victime, comme lui, de la guerre ; aimé et pleuré, comme lui, par son roi. Le 12 septembre, l'armée française, portée à trente mille hommes, grâce aux derniers renforts amenés du Nivernais par le duc de Nevers, et par le duc de Montpensier, de Normandie, tenta, mais inutilement, un assaut qui eût pu être décisif, sans l'inopportune diversion de l'arrivée de l'armée espagnole de secours. Cette armée, conduite par le cardinal archiduc Albert, secondé de généraux expérimentés, comptait dix-huit mille hommes de pied, trois mille chevaux, une artillerie de dix-huit canons et un grand attirail de pontons, de chariots, de munitions. Les ennemis, dit une relation contemporaine, ne croyoient pas que Sa Majesté fût assez forte pour garder les tranchées, faire tête à leur armée, et défendre ensemble les passages de la ville par delà la rivière (la Somme). Les généraux espagnols se flattaient donc de l'espoir de voir le Roi décamper, ou accepter une bataille qu'ils comptaient gagner, on, tout au moins, essayer en vain de les empêcher de faire pénétrer dans Amiens un secours décisif et bientôt libérateur. Le Roi, en telle conjoncture, ne se liant pas à son inspiration, délibéra avec le maréchal de Biron et le duc de Mayenne sur le meilleur parti à prendre. Celui qui aurait le mieux convenu à son impatience d'action et à sa généreuse ambition d'une victoire personnelle et directe sur le roi d'Espagne (un de ses dix souhaits favoris, révélés par Sully), était d'accepter la bataille que les ennemis paraissaient si disposés à lui offrir. Biron appuyait ce plan qui favorisait ses desseins, fondés, chose triste à penser ! sur l'espoir non de la victoire, mais de la défaite. La loyauté et l'expérience du duc de Mayenne virent le piège et le déjouèrent. Il objecta avec raison qu'une bataille était toujours chose hasardeuse, et qu'un échec aurait pour Henri des conséquences redoutables ; que l'objectif unique de la campagne était la prise d'Amiens, certaine dans un délai plus ou moins éloigné, succès suffisant en honneur et fécond par ses suites autant que celui d'une bataille ; enfin, qu'il valait mieux se réduire à un plan étroit et le réaliser, que s'exposer à échouer dans un projet plus vaste et d'autant plus dangereux. Ces sages conseils l'emportèrent, heureusement pour Henri, sur des avis plus flatteurs, mais qui ne caressaient son désir secret que pour mieux le perdre. Le Roi déféra aux représentations du duc de Mayenne, se détermina à attendre l'ennemi à l'abri de ses lignes, et confia à son contradicteur la défense des retranchements. Le résultat de ces mesures ne se fit pas attendre, malgré la mauvaise volonté de Biron, qui avait refusé de fortifier Longpré, découvrant ainsi le camp royal. De plus, par une indigne perfidie, il avait prévenu l'archiduc de l'infériorité, sur ce point, de la position des troupes royales, et désigné à son effort ce côté vulnérable de nos fortifications, ce défaut de notre cuirasse. Heureusement, la clairvoyance et l'activité de Mayenne, obstiné à réparer les fautes que Biron s'obstinait à commettre, veillaient au salut de l'armée, sur la perte de laquelle son propre et indigne chef avait fondé de coupables espérances. Ce fait est attesté par l'historiographe d'Henri IV, Pierre Matthieu lui-même, qui déclare le tenir de la propre bouche du Roi. Le duc de Mayenne ayant reconnu l'armée ennemie du haut d'une colline, jugea que si elle faisoit ce qu'elle pouvoit faire, celle du roi seroit en peine de la repousser. Il donna avis au roi de fortifier Longpré ; et le roi m'a dit depuis que ce conseil avoit été le salut de son armée ; que le maréchal de Biron ne l'avoit pas voulu retrancher, étant d'intelligence avec l'archiduc pour laisser passer et entrer des secours afin, disoit le roi, qu'il me vit toujours en peine, et se rendit toujours nécessaire. Il me l'a confessé depuis et demandé pardon. La journée du 16 septembre justifia les prévisions du duc de Mayenne et la déférence du roi à des conseils plus sages que flatteurs et plus utiles qu'agréables. En effet, l'archiduc Albert, après une série de tentatives partout contrariées, se décida, laissant ses deux ponts entre les mains de l'ennemi, à donner, à son armée décimée, le signal de la retraite dans les Pays-Bas, et à abandonner Amiens à son sort. Ce sort n'était plus douteux. Le 25 septembre 1597 (à dix heures du matin), en vertu d'une capitulation honorable approuvée par l'archiduc, et acceptée par Henri, les Espagnols sortirent d'Amiens par la porte de Beauvais, pour défiler devant l'armée française rangée en bataille, et son chef qui la commandait dans le costume et l'appareil de la royauté. A quatre heures, Henri, accompagné d'un cortège de mille gentilshommes, fit dans la ville son entrée victorieuse, et se dirigea tout d'abord vers la cathédrale pour y rendre grâces à Dieu du succès d'un siège qui avait coûté à la France un effort de six mois et demi, sans compter une dépense de six millions de livres dit temps, environ vingt-deux millions d'aujourd'hui. Mais ce succès devait rapporter bien au delà de ce qu'il avait coûté, c'est-à-dire la soumission de la Bretagne et la paix qu'Henri ne pouvait rechercher, que l'Espagne ne pouvait consentir qu'après un duel dont l'issue avait occupé toute l'Europe. Toute l'Europe estoit en peine, dit l'Estoile, à qui demeureroit la victoire de ce siège, parce que d'icelui dépendoit la servitude du François ou sa liberté. Le Roi ne jouit point de suite de ces glorieux résultats. Ils lui furent disputés, un an encore, par les difficultés de la situation financière du royaume, et quand il eut triomphé de cet obstacle d'argent, par la fonte irrésistible d'une armée qui ne s'était pas habituée encore à demeurer plus de six mois fidèle au drapeau. Le 28 septembre, malgré les objurgations d'Henri, il ne demeurait plus autour de lui que cinq cents gentilshommes sur cinq mille ; et les deux tiers de son infanterie, quoique soudoyée, s'étaient débandés. Avec les dix ou douze mille obstinés qui lui restaient, Henri ne put qu'aller offrir à l'armée espagnole, qu'il canonna dans Arras, une bataille qu'elle déclina. Il tenta aussi le siège de Dourlens, que l'approche de l'hiver et les pluies continuelles l'obligèrent d'abandonner. Ces déceptions furent compensées largement par les succès de ses lieutenants, qui partout avaient fait essuyer des revers aux armées espagnoles, et avaient sur toutes les frontières refoulé l'invasion ; en Champagne, où le capitaine Gaucher échoua piteusement dans son entreprise sur Villefranche (4 août) ; en Bretagne, où le duc de Mercœur fut réduit à l'impuissance par trois défaites successives ; en Savoie surtout où Lesdiguières, délivrant par des victoires le Dauphiné envahi, porta la guerre en territoire ennemi, et se rendit maître de toute la Maurienne et de tout le pays an delà de l'Isère, depuis le mont Cenis jusqu'à Montmeillan. Tandis que ces efforts victorieux, — dit notre plus autorisé prédécesseur — faits sur la frontière du royaume, le préservaient de l'invasion, en même temps, et par une heureuse coïncidence, les projets anarchiques, les tentatives des factions intérieures pour transporter à l'étranger l'autorité du Roi, et pour rompre l'unité nationale, se trouvaient dejoués. Le parti de l'aristocratie féodale, pactisant avec le parti réformé, gagna à ses ambitions, prêtes à acheter une vaine indépendance au prix de l'ingérence étrangère, deux princes du sang, le comte de Soissons et le duc de Montpensier. Une députation que semblaient inspirer seulement les mobiles religieux et les intérêts du protestantisme, mais derrière laquelle tous les brouillons et tous les séditieux du royaume ourdissaient leurs trames, aiguisaient leurs poignards, recrutaient pour la guerre d'émancipation parmi les aventuriers de la noblesse bretonne, poitevine et ardennaise, avec l'appui du duc de Bouillon et du duc de la Trémouille, osa aller en Angleterre solliciter le protectorat d'Élisabeth. Grâce à la prudence et à l'énergie d'Henri, secondé par Duplessis-Mornay, le maréchal de Brissac, les commissaires royaux de Schomberg et de Thou, l'effervescence du fanatisme huguenot et de l'ambition aristocratique s'apaisa peu à peu. Les conjurés n'osèrent risquer la double partie, devenue hasardeuse, d'un soulèvement intérieur et d'une intervention étrangère. La révolte fut contenue jusqu'au moment où le Roi se trouva à même de lui opposer victorieusement sa justice ou sa clémence, emprisonnant à la Bastille et y décapitant au besoin les conspirateurs et les traîtres, dans la personne du comte d'Auvergne ou du maréchal de Biron, foudroyant dans Sedan le dernier asile de la faction huguenote ; enfin, désarmant tous les mécontents de bonne foi par l'Édit de Nantes, qui consommait la liberté et l'égalité civile des deux religions longtemps rivales. A ces succès d'Henri à l'intérieur correspondaient de non moindres revers pour Philippe II. Le prince Maurice, profitant habilement de l'absence du cardinal archiduc Albert, avait partout battu ses troupes chassées successivement par lui des trois provinces de Gueldre, d'Over-Yssel, de Frise, et il achevait, par la prise de Linghen, de dépouiller l'Espagne de toutes ses possessions sur la ligne du Rhin. Le roi d'Espagne n'avait pas été plus heureux dans la dernière de ces tentatives d'invasion qu'il dirigeait périodiquement contre l'Angleterre, avec un acharnement qui n'avait d'égal que celui de la mauvaise fortune. Pour la troisième fois, Philippe avait confié à la fatalité des vents et des mers, qu'il espérait conjurer, une flotte de cent quatre-vingts vaisseaux, commandée par l'Adélantado don Martin de Padilla. Cette nouvelle invincible Armada avait eu le sort funeste de ses aînées. Arrivée à soixante lieues du canal d'Angleterre, à proximité de cette île que semble garder jalousement, plus que le génie de ses hommes d'État et le courage de ses soldats, en vertu d'une irrévocable destination providentielle, la protection de la tempête fatale à tous ses envahisseurs, la flotte espagnole fut assaillie par les aquilons furieux ; huit vaisseaux seulement sombrèrent dans les flots soulevés ; mais le reste fut dispersé et obligé de rentrer bien vite à l'abri des ports de l'Espagne et du Portugal. Cette entreprise avortée coûta à son auteur la perte de toute son artillerie et d'une somme de cinquante mille ducats (18-30 octobre). Ces derniers coups triomphèrent, comme des avertissements célestes, de l'acharnement contre la France d'un prince qui, n'étant pas moins politique que passionné, reconnaissait enfin dans Henri, réconcilié avec l'Église et avec son peuple, un de ces princes prédestinés que garantit de toute atteinte mortelle, jusqu'à l'heure où elle est terminée, le bouclier d'une mission providentielle. L'âge, la maladie, les revers inclinèrent enfin ce prince si longtemps indomptable' aux prévoyances et aux concessions testamentaires. Il ne voulait point léguer à un fils âgé seulement de dix-neuf ans, à une fille non encore établie, le poids, supérieur à leurs forces, d'une guerre à soutenir et d'une dot à défendre contre la France, la Hollande et l'Angleterre coalisées. Il résolut de rétablir la paix entre l'Espagne et la France, de donner à sa fille les États de Flandre en dot et l'archiduc Albert pour mari et pour protecteur (dessein réalisé dès le 2 décembre 1597) ; enfin, de réserver à l'Angleterre et à la Hollande les derniers coups de sa puissance affaiblie mais lion épuisée. Les bases d'une pacification furent posées, les offres en furent solennellement faites dans les conférences renouées entre les agents du pape médiateur, le cardinal de Florence, et le général des cordeliers, Richardot, président du Conseil privé des Pays-Bas, ministre d'Espagne, et Villeroy, secrétaire d'État des affaires étrangères en France. A mesure qu'un nouveau revers leur survenait, les Espagnols, d'abord fort arrogants, devenaient plus accommodants, et, après la dispersion de leur flotte, ils se montrèrent désireux d'une conciliation sérieuse, équitable, durable. Nos justes armes, assistées par la grâce de Dieu, écrivait, le 15 novembre, Henri à Élisabeth, ont enfin humilié notre ennemi ; car il demande la paix et déclare qu'il se mettra à la raison pour l'obtenir. Le Roi se trouvait placé entre deux partis à prendre, sur le meilleur desquels il devait hésiter et hésita en effet. Une paix prochaine le réintégrait dans la possession de tout ce qu'il avait perdu comme territoire, sans autre profit que celui de terminer une guerre dont la France épuisée ne pourrait peut-être pas plus longtemps porter le fardeau. Une paix disputée, marchandée, différée, pouvait bénéficier des conquêtes et des représailles d'une guerre heureuse. Mais le moindre revers pouvait aussi remettre en question le fruit de dix années de lutte. Le souverain et le père se combattaient dans Henri, l'un plaidant pour une complète et glorieuse vengeance de l'injure espagnole, l'autre conseillant de préférer aux stériles triomphes de la guerre et à ses sanglants lauriers, les travaux féconds et bénis de la paix. Henri ne voulut rien céder qu'à la raison et, pour la première fois, il se méfia de son cœur. Il ouvrit donc avec l'Angleterre et la Hollande des négociations décisives, destinées à lui permettre de mesurer le fonds qu'il pouvait faire sur ses alliés, et de savoir si, partageant ses visées généreuses, ils voulaient développer la lutte jusqu'aux vastes proportions, aux sublimes envergures des grandes guerres, de celles qui constituent, en fin de compte, un progrès de l'évolution de l'humanité, et se font pardonner ce qu'elles coûtent par ce qu'elles rapportent. Les ambassades de MM. de Buzenval auprès des États-Généraux, de M. de Naisse auprès d'Élisabeth, achevèrent de convaincre le Roi des intentions dilatoires et décevantes de ses alliés. Il se résigna alors à la paix, ennoblissant cette résolution par la fidélité qu'il témoigna jusqu'au bout aux intérêts d'alliés qui avaient toujours trahi les siens, et par l'ambition qu'il montra de terminer à la fois la guerre civile et la guerre étrangère, afin de mettre définitivement au fourreau l'épée du roi-capitaine pour ne plus garder à la main que le sceptre d'olivier du roi pacificateur, réparateur, régénérateur. Tel fut le but, tel fut le résultat de cette campagne contre la ligue de Bretagne qu'il dirigea en personne, au commencement de l'année 1598, contre son tenace chef, le duc de Mercœur, et ses féroces auxiliaires, les Saint-Offange, les la Fontenelle et les Gouleine, tyrans féodaux dignes du pire moyen âge. Le Discours sur le traité de paix fait à Vervins, le deuzième may 1598, placé à la suite du Mémoire de Sillery, négociateur de ce pacte fameux, et très-probablement composé par lui, établit qu'au commencement de 4598, Henri, en présence du mauvais vouloir et de la trahison latente de ses alliés, en présence des efforts suprêmes faits par Philippe II dans le but de continuer la guerre, des moyens accumulés par lui afin de la continuer jusqu'à l'année 1600, n'avait que six mois de ressources pour achever d'écraser les restes de la Ligue dans la Bretagne, le Poitou et l'Anjou, et pour arriver à un accord devenu le salut de la France. Il n'y avait pas une minute à perdre, pas une faute à commettre. Henri ne perdit pas une minute, ne commit pas une faute. Le 12 janvier 1598, il remettait au général des cordeliers, pour être transmise à l'archiduc Albert, sa réponse définitive aux ouvertures d'accommodement, portant : qu'il consentoit à faire l'assemblée des députés pour la paix qui lui avoit été demandée, et qu'il agréoit Vervins pour le lieu du congrès. Ses plénipotentiaires furent le chancelier de Bellièvre et M. de Sillery, qui s'acheminèrent à Vervins, le 29 janvier, pour ouvrir le congrès, sous la médiation du pape et sous la présidence du cardinal de Florence. Les plénipotentiaires pour l'Espagne étaient Richardot et le prince de Taxis. Pendant qu'ils délibéraient, Henri agissait. Grâce à un suprême effort de Rosny, aux emprunts faits à l'échevinage d'4ngers et à la municipalité de Paris, aux subsides obtenus des états de Bretagne, il se trouva à la tête d'une armée d'expédition de 12.000 fantassins et de 2.000 chevaux, avec 12 canons et des provisions assez abondantes pour garantir de la famine ses soldats, tout en préservant de la maraude un pays ruiné, qui touchait à sa perte, et que ses libérateurs eussent achevé d'épuiser, s'il eût fallu les nourrir. Après avoir prévenu, en menaçant de la réprimer impitoyablement, une prise d'armes imminente, fomentée par les exaltés du corps des églises réformées, et pourvu au gouvernement pendant son absence, confié au prince de Conti, Henri se dirigea vers la Bretagne, par la Beauce, l'Orléanais, la Tourraine, l'Anjou (18 février 1598). La seule nouvelle de son approche suffit pour intimider et réduire à la soumission les chefs ligueurs Du Plessis de Cosme, les frères Saint-Offange, Ileurtault et la Houssaye, qui tenaient les places ou forts de Craon, de Montejean, de Sain t-Sym phorien et de Rochefort, avant-postes et remparts de la rébellion bretonne. Un pardon généreux et onéreux, niais politique, scella la réconciliation de l'autorité royale avec des hommes chargés de crimes, mais dont l'impunité était moins dangereuse que leur désespoir. Le 6 mars, le roi reçut au Pont-de-Cé la duchesse de Mercœur, les agents du duc, les députés de la ville de Nantes, porteurs d'ouvertures de la part du chef de la Ligue Bretonne. Henri, fidèle à son système de préférer les solutions amiables aux solutions armées, toujours hasardeuses, accueillit ces ouvertures, et elles aboutirent au traité du 20 mars, conclu à Angers, accepté et signé par Mercœur le 23, à des conditions rudes pour le Trésor, mais excellentes pour l'autorité royale et la prospérité nationale. La soumission du duc fut suivie de celle de ses partisans : Champigny, maitre de Tiffauges, Villebois, maitre de Mirebeau, Bourcani, d'Ancenis, Fontenelle, de Douarnenez et de l'île Tristan. La pacification de la province fut ainsi consommée, et le vœu patriotique de Duplessis-Mornay accompli : Il n'étoit laissé en Bretagne aucun germe, aucun levain de la Ligue, pour lever la pâte qui en restoit au royaume. D'Angers, Henri se rendit à Nantes où il fit une entrée triomphale et paternelle à la fois, déclarant, quand on lui offrit les clefs de la ville, qui étaient d'argent doré, qu'elles étoient bien belles mais qu'il aimoit encore mieux les clefs des cœurs de ses habitants. C'était gagner ceux qu'il avait conquis et prendre possession, par l'amour plus encore que par la terreur, de cette Bretagne qui, depuis dix ans, se disputait au Roi, au prix de la guerre civile et de la guerre étrangère. Quelques jours après avoir désarmé Mercœur, Henri scella l'édit du 13 avri11598, qui réglait à leur complète satisfaction l'état religieux, civil et politique des calvinistes français. C'est le fameux édit de Nantes, sur l'analyse et l'appréciation duquel nous aurons à revenir. Le 2 mai 1598, était achevé un autre monument du règne : la paix de Vervins, entre Philippe II et Henri IV, conclue malgré les intrigues de l'Angleterre et de la Hollande, qui persistèrent dans leur égoïste opposition, et abandonnèrent leur allié dans la paix comme elles l'avaient abandonné dans la guerre. Le traité de Cateau-Cambrésis était remis en vigueur et devenait la loi commune des deux couronnes. Le commerce entre leurs sujets était rétabli. L'Espagne abandonnait toutes ses conquêtes et restituait à la France, dans le Nord, les six villes de Calais, Ardres, Monthulin, Dourlens, la Capelle, le Castelet ; en Bretagne, la ville de Blavet. Le duc de Savoie était compris dans le traité ; il rendait ferre, la seule place qu'il tint encore en Provence ; il désavouait et abandonnait le capitaine La Fortune, qui jusqu'alors s'était autorisé de lui et du roi d'Espagne pour oser retenir la ville de Seurre en Bourgogne ; le marquisat de Saluces, usurpé par le duc sur la France durant les troubles de la fin du règne de Henri III, était remis à l'arbitrage du pape, qui, dans l'espace d'un an, devait rendre sa sentence, et l'adjuger à celui qu'il en jugerait le légitime propriétaire. Genève, qui, depuis 1580, avait sans cesse été aidée par la France, restait sous sa protection, parce qu'elle se trouvait au nombre des confédérés de la Suisse, et que la Suisse elle-même était comprise au traité comme alliée de Henri. Le grand résultat du traité de Vervins, le seul avantageux que la France eût conclu depuis trente ans, était que le royaume recouvrait entièrement l'intégrité de son territoire continental ; que les dernières des profondes blessures que la Ligue et l'ambition de l'étranger lui avaient faites étaient cicatrisées et fermées. Henri compléta ces résultats en contraignant la Toscane à la restitution de quelques annexes maritimes de notre territoire qui avaient la plus grande importance. Le grand duc de Toscane jugea téméraire de lui disputer une partie de sa frontière du Midi, lorsque le roi d'Espagne venait de lui rendre sa frontière du Nord, et il se hâta de terminer par un traité son différend avec la France[25]. Il s'agissait de la remise de l'ile de Pomègue, de Pile et du château d'If, conservés jusque-là par le grand-duc, en nantissement de ses prêts d'argent à Henri III et à Henri IV. Le roi refusa de se laisser traiter plus longtemps comme un marchand, et Ferdinand se contenta de sa parole, rendant sans restriction à Henri la possession de ses annexes maritimes, délivrant le commerce de Marseille de sa mainmise, heureux de rester l'allié du souverain et de lui donner sa nièce en mariage. Henri, en effet, maître de l'indépendance de sa couronne et de l'intégrité de son peuple, ne devait pas tarder à songer à transmettre un jour à un fils digne de lui, qu'il ne pouvait plus espérer de la stérilité de Marguerite, l'héritage du bonheur et de l'amour de ses sujets et de la continuation de ses grands desseins. Nous le verrons bientôt assurer par une union féconde, sinon heureuse, les résultats si laborieusement conquis durant vingt ans de vicissitudes et de combats. |