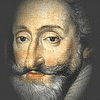HENRI IV
LIVRE TROISIÈME. — LE ROI NATIONAL - 1591-1598
CHAPITRE PREMIER. — CONQUÊTE D'UNE CAPITALE - 1591-1594.
|
Jamais Henri n'avait été plus près de son triomphe que le lendemain de cette victoire d'Ivry, où il avait reçu le sacre de la gloire, le plus sûr de tous en France ; jamais il ne fut plus près de sa perte que le lendemain de cet échec sous Paris, où l'intervention directe de l'étranger, non plus allié secret, mais chef ostensible et despotique de la Ligue, le sacrait roi national, au moment même où il sentait lui échapper la nation De la fin de 1590 au milieu de 1594, Henri devait compter ses années les plus rudes, les plus militantes, les plus dangereuses ; mais il devait opposer au destin un courage et un génie égaux à ses pires inégalités, et offrir à l'histoire le consolant et salutaire exemple d'un homme luttant contre l'injustice du sort et relevant, à mesure qu'elle s'écroule, les ruines de sa fortune. C'est là ce qui fait de l'histoire des grands hommes le bréviaire moral du genre humain. Et c'est pour cela que cette histoire nous apprend surtout à les admirer dans le nombre et l'étendue de leurs malheurs, le courage et le succès de leur résistance. L'histoire ne servirait à rien ou n'aurait que la moitié de sa moralité, si elle nous montrait ses héros abusant seulement, suivant le penchant de la nature humaine, de la bonne fortune. Elle nous les montre, de préférence, et en cela fidèle à la réalité, malheureux et triomphant du malheur immérité. C'est en cela qu'ils sont nos modèles, leur qualité morale les destinant précisément à nous enseigner l'usage à faire de la douleur, et combien d'adversités peut porter, sans plier, l'âme humaine, quand elle est armée du courage et de la patience. A la fin de l'année 1590, la France, violée à la fois sur ses frontières de Languedoc, de Provence, de Bretagne et de Champagne par l'invasion étrangère, saignait de ces quatre blessures de la guerre de Cent ans, renouvelées par Philippe II, par le duc de Savoie et par le duc de Lorraine, coalisés contre nous. Contre tant d'ennemis (la moitié de l'Europe et la moitié de la France), Henri n'avait que lui, son courage et son génie. Ce devait être assez pour un prince habile à profiter de l'expérience et qui en appliqua immédiatement les leçons à la réforme des deux instruments dont il disposait : la force morale et la force matérielle ; l'opinion et l'armée. Tandis qu'il faisait l'éducation de l'opinion en prenant son peuple à témoin de ses bonnes intentions, en lui parlant, dans des écrits familiers, la langue nouvelle du droit, du devoir, de l'intérêt national, Henri, qui ne voulait plus être soumis aux vicissitudes du dévouement de ses amis et aux variations de sa popularité, se donnait une armée mercenaire e par là obéissante, en attendant qu'il pût avoir une armée nationale. Il opposa l'étranger à l'étranger, l'Europe protestante à l'Europe catholique, presque tout entière soulevée contre lui. Mais il demeura le chef et le maitre de sa cause, en employant, contraint par la nécessité, l'appui de ses alliés ; et, contrairement aux princes lorrains, dont l'usurpation désespérée appelait à son aide l'usurpation de Philippe II, il ne sacrifia rien de son indépendance et de l'intégrité du pays aux auxiliaires que, faute -de mieux, il avait dû se résigner à employer et à payer. Toute la première moitié de l'année 1591 fut consacrée par Henri à trouver les ressources, à hâter les préparatifs de cet armement formidable et décisif, de cette levée en masse de ses alliés anglais, hollandais, suisses, allemands, et en attendant leur intervention, à déblayer autour de Paris et en Normandie le tapis sur lequel il voulait jouer sa suprême partie. Henri resserra le demi-blocus maintenu autour de Paris, dont il essaya vainement de s'emparer, à la Journée des farines, émeute alimentaire provoquée par ses partisans, à la faveur de cette diversion intérieure (30 janvier 1591). Après deux mois et demi d'un siège héroïque, il prit Chartres (19 avril), puis Noyon (19 août), interceptant ainsi les convois de la Beauce et dominant le cours de l'Oise. En Normandie, les opérations non moins heureuses de ses lieutenants, le duc de Montpensier et Biron, ne laissaient à la Ligue que Rouen et le Havre (de janvier au 6 juin 1591). En même temps qu'il se montrait roi militaire, Henri se montrait roi diplomate, se ménageait l'appui des parlements et du clergé fidèle. Il défendait pied à pied, contre Grégoire XIV, successeur de Sixte-Quint, et comme lui, inféodé à la cause de l'ambition espagnole, le terrain de son droit contre des excommunications plus politiques que religieuses, qu'il allait bientôt paralyser par l'argument décisif d'une loyale conversion. (Édit du 4 juillet 1591.) Pendant ce temps, corroborant sans le vouloir ses protestations par l'effet de leurs exigences, de leurs prétentions, de leurs empiétements, les alliés étrangers de la Ligue introduisaient dans Paris une garnison de quatre mille Espagnols ou Napolitains (12 février), s'emparaient pour leur compte de la Fère (avril 1591) ; ils occupaient Marseille, livrée au duc de Savoie (2 mars), qu'une double victoire de Lesdiguières arrêta, préservant le Dauphiné et conservant au roi le nord de la Provence. Enfin, en Bretagne, Philippe II se faisait céder par Mercœur le port et la ville forte de Blavet, tandis que la mort de la Noue, tué au siège de Lamballe, paralysait la résistance et préludait au grand revers qui devait bientôt atteindre, sur la frontière de la province, le parti royal et national. La situation se prolongea ainsi, en s'aggravant par les efforts désespérés de la Ligue à Paris, tour à tour en butte au triomphe précaire et aux représailles féroces du parti des Seize ou du parti de Mayenne, des ligueurs espagnols ou des ligueurs lorrains, et par la formation, au sein même de la famille et du camp d'Henri, d'un tiers parti, gagné à l'ambition usurpatrice du jeune cardinal de Bourbon, cousin du roi, excité par son frère, le comte de Soissons. C'est à l'automne de 1591 que Henri, après une année d'attente laborieuse, démasqua son plan et dessina les opérations auxquelles il allait employer le secours de la grande armée étrangère et protestante qu'il ramassait à force de négociations et de sacrifices. Il avait vendu des portions de son domaine privé ou de la couronne de Navarre, jusqu'à concurrence de 200.000 écus de ce temps-là ; des portions du domaine de la couronne de France en Normandie pour 500.000 écus, des rentes pour 6.000 livres ; il avait contracté en outre des emprunts à l'étranger. Au moyen de ces diverses ressources, il s'était procuré plusieurs millions pour payer ses troupes auxiliaires, et leur solde se trouva prèle au moment où elles entrèrent en France. Il alla dans les plaines de Vandy, près de Vouziers, recevoir l'armée allemande que lui amenait Turenne, et qui comptait 14.000 hommes (29 septembre). Dans un intervalle assez court, il joignit à ce corps principal 6.000 Anglais envoyés par Élisabeth en diverses fois, 6.000 Suisses engagés dés lors à son service, et enfin les débris de quelques régiments français, formant 4.000 hommes. Ces divers corps formaient un total de 30.000 soldats réguliers, et en grande majorité protestants[1]..... Henri fit du siège de Rouen l'objectif de cette campagne où il allait encore avoir à souffrir plus de ses amis que de ses ennemis. Il fit ouvrir par le maréchal de Biron les opérations préliminaires de ce siège mémorable, le 11 novembre, se rendit lui-même au camp le 24, et commença à payer de sa personne dans la tranchée, le 1e' décembre, après avoir mis son courage d'accord avec son cœur, en essayant, par des négociations demeurées infructueuses, de décider les habitants à éviter, par une capitulation honorable, une èffusion de sang inutile. Le siège de Rouen, qui devait servir à Henri d'amorce pour des opérations décisives, servit surtout à Philippe II pour imposer à Mayenne aux abois un tyrannique appui. N'ayant pu obtenir de la faction des Seize, dont la trahison avait échoué devant un reste de loyauté et de pudeur, la domination exclusive dans Paris et la proclamation de sa souveraineté sous le nom de sa fille, l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, le roi d'Espagne profita des embarras de la Ligue, menacée par le siège de Rouen d'un suprême coup, pour arracher à son chef, le couteau sur la gorge, le honteux protocole des conférences de la Fère et de Lihons-Saintot. Par ce traité, qui achevait de déshonorer l'autorité précaire des princes lorrains, Mayenne recevait quatre millions d'écus par an, et le secours de l'armée espagnole commandée par Farnèse. Enfin, il échangeait contre la promesse d'un grand établissement pour lui, pour ses parents, pour les chefs de l'Union, celle de reconnaître l'infante en qualité de reine, souveraine propriétaire du royaume de France, et de convoquer, à l'effet de proclamer son droit et de lui déférer le trône, des états généraux composés en majorité de ses partisans. Toutes les réserves ostensibles apportées à cet acte par Mayenne, tous ses désaveux postérieurs et ses infractions secrètes à un traité de trahison qui ne pouvait engendrer, de part et d'autre, que la trahison, n'empêchent point le chef de la Ligue de porter dans l'histoire la responsabilité de ce chef-d'œuvre d'infamie, qui était dans la logique de son caractère, dans la fatalité de sa cause, et que des événements indépendants de sa volonté empêchèrent seuls d'être ratifié et consommé. Henri disposait devant Rouen d'une armée de trente mille hommes de troupes régulières, que l'attrait du danger ou l'élan de la fidélité accrurent d'un contingent volontaire de cinq mille gentilshommes français. C'était plus qu'il n'en fallait pour prendre Rouen, si autour de lui tout le monde dit eu le même désir que lui de réussir, le même intérêt que lui à réussir. Malheureusement des nécessités politiques supérieures à la juste méfiance que lui inspiraient les fausses et fatales manœuvres qui avaient fait avorter le blocus de Paris et l'investissement des marais de Chelles, obligèrent Henri à garder auprès de lui des hommes que sans cela il aurait eus contre lui, et ne lui permirent pas de confier la direction, suprême du siège à un autre que le maréchal de Biron, dont l'ambition et le mécontentement venaient de s'ulcérer d'une nouvelle déception. Henri avait dû refuser tour à tour à l'insatiable vieillard le comté de Périgord, le titre, rival de celui de Mayenne, de lieutenant général de l'Union royale ; enfin, en dernier lieu, la promesse du gouvernement de Rouen, réservé au duc de Montpensier. Le maréchal s'était bien promis de ne jamais prendre une ville dont le gouvernement était réservé à un autre ; et Henri, qui le savait, s'était flatté de l'art, supérieur à ses forces, de l'y amener à son insu ou de l'y contraindre malgré lui, en surveillant de près et en dirigeant sous main des opérations nominalement confiées au maréchal. Mais Henri avait affaire à un rusé compère, qui fit toutes choses par dépit, qui se refusa, malgré la vérité de l'axiome de guerre : Ville prise, château rendu, à concentrer au début tous ses efforts sur la ville, mal fortifiée et mal munitionnée, qui négligea de profiter de l'occasion d'un superbe coup double, la reddition de la ville devant entraîner fatalement la capitulation de la citadelle. Au lieu de procéder ainsi, le maréchal donna au gouverneur de Rouen, l'actif et résolu Villars, le temps de mettre le fort Sainte-Catherine en état de résister à tout effort ; puis il tourna contre la citadelle, ainsi rendue inexpugnable, toutes les forces de l'armée. Mais elle s'épuisa à triompher d'obstacles insurmontables, défendus par une garnison qui passait volontiers et presque toujours avec succès, de la défensive à l'offensive, assiégeant à son tour les assiégeants. Si de toutes les manières de prendre Rouen, Biron avait choisi la pire, c'en était une cependant, parce que la citadelle dominait la ville, et qu'en s'en rendant maître, on pouvait foudroyer Rouen. Aussi, dès que le Roi vint, à partir du 1er décembre (1591), prendre une part active aux opérations, il fit des efforts inouïs pour prendre le fort Sainte-Catherine, et pour réparer la faute calculée du maréchal, dirigeant lui-même les travaux, entrant de quatre nuits l'une dans la tranchée, conduisant les soldats à l'assaut, repoussant les sorties, exposant plusieurs fois sa vie chaque jour. Villars, son ennemi, mais son ennemi généreux, s'écriait avec admiration que ce prince, par son habileté et sa valeur, avait mérité mille couronnes pareilles à celles qu'il portait[2]..... Malgré tant d'efforts et d'exemples héroïques, Henri, qui avait à lutter, outre les difficultés naturelles de l'entreprise, contre les inopportunes rigueurs de l'hiver, n'avait pu réussir à emporter qu'une partie des ouvrages avancés de l'ennemi, quand survint la nouvelle que le duc de Mayenne et le duc de Parme, à la tête d'une armée de vingt-trois mille hommes, s'avançaient au secours de Rouen. Cette diversion obligeait Henri à diviser son effort et à. partager son armée. Il laissa les troupes de siège, infanterie et artillerie, sous la direction de Biron ; puis, à la tête de six mille hommes de cavalerie, il quitta le camp de Rouen (20 janvier 1592) et s'avança au-devant de l'armée de secoués hispano-ligueuse. Ne disposant que de forces de cavalerie, mais de forces supérieures à celles, dans la même arme, de l'ennemi, le but d'Henri était de faire diversion à son tour contre l'armée de diversion, de la reconnaître, de la harceler, de battre à l'occasion sa cavalerie isolée, enfin de lui disputer pied à pied le terrain, de façon à permettre à Biron d'achever sans être inquiété, et de gagner, piqué d'honneur au jeu, la partie du siège de Rouen. Dans cette intention, Henri, laissant à Neufchâtel le gros de sa cavalerie, la devança à la rencontre de l'armée ennemie, jusqu'à Aumale, par une impatience téméraire et qui faillit lui coûter bien cher. Les combats d'Aumale et celui de Fontaine-Française sont les deux seules occasions de la seconde moitié de la vie militaire d'Henri IV où il se soit laissé emporter par la fougue de son tempérament et où il ait joué de sa personne et en vrai cheval-léger. Mais Aumale fut une faute. Fontaine-Française devait être un exploit. La première de ces deux affaires est réparée par la seconde. A Fontaine-Française, le roi devait sauver l'armée. A Aumale, il faillit la perdre et se perdre lui-même par cette faute, trop commune en France de tout temps, qui consiste à aller à la découverte de l'ennemi sans être suffisamment couvert soi-même, s'exposant ainsi à recevoir la leçon qu'on veut donner. C'est ce qui arriva à Aumale. Henri, attaqué, à la tête d'une poignée de cavalerie, par des forces très-supérieures en nombre, faillit être écrasé, puis enveloppé, et n'échappa à la captivité ou à la mort qu'au prix d'une blessure : une arquebusade dans les reins. Il en reconnut l'auteur, qui fut pris, et qu'il incorpora plus tard dans sa garde, estimant avec raison qu'un soldat qui tirait ainsi sur le roi, son ennemi, était homme à défendre, mieux que personne, le roi devenu son maitre (5 février 1592). Henri ne devait pas tarder à prendre sa revanche, et, en poursuivant son dessein, à en justifier l'habileté. Après la prise de Neufchâtel, les ducs, poursuivant leur marche vers Rouen, s'étaient avancés jusqu'au bourg de Bure. Henri, campé à Buchy, à cinq lieues nord-est de Rouen, attaqua et surprit les quartiers du duc de Mayenne et du duc d'Aumale, du duc de Guise et du comte de Chaligny, tua ou dispersa tout ce qui s'y rencontrait, et fit un butin immense (17 février)[3]. On le voit : le roi n'épargnait rien, pas même sa personne, pour ménager à Biron une belle partie, écartant pendant deux mois, à force de vigilance et de hardiesse, l'armée de secours de son objectif et lui fermant la route de Rouen. Mais le vieux maréchal employa ce loisir à ne rien faire, et quand il voulut tenter le coup décisif, il s'enferra avec la conscience de son entêtement. Il fut impuissant à refouler une sortie vigoureuse de Villars, qu'il n'avait pas su prévenir. L'armée royale perdit huit cents hommes, ses provisions de poudre, une partie de son artillerie portée en triomphe par l'ennemi. Biron fut blessé à la cuisse, les plus braves capitaines tués sur place, les tranchées comblées, les mines éventées, l'entreprise ramenée au point où elle était le premier jour du siège. Vainement le roi, de retour au camp, répara cette faute énorme ; vainement il concentra les divers corps de son armée, ranima leur courage, opposa aux ducs une force tellement supérieure que, ne pouvant faire lever le siège sans en venir aux mains, et n'osant livrer bataille, ils se retirèrent sur la Somme. Inutilement encore, Henri, après avoir reçu de la flotte hollandaise des canons et des munitions, rétablit les tranchées, éleva des forts, renversa une partie des murailles de Rouen, vainquit les assiégés dans une sanglante sortie près de la porte Cauchoise, réduisit Villars à de telles extrémités, qu'il écrivit aux ducs que s'il n'était pas secouru dans huit jours, il capitulerait. Par le fait seul que le siège avait duré pendant cinq mois d'un hiver rigoureux, l'entreprise était manquée. En effet, le plus grand nombre des soldats étrangers avait succombé à la fatigue, à la maladie ou dans les combats. La noblesse, selon sa coutume, après quelques semaines de service, s'était retirée dans ses domaines. A la date du 29 mars, bien que Henri eût reçu un renfort de 6.000 Hollandais et Anglais, il ne comptait plus que 14.000 hommes dans son armée, et n'avait presque pas de cavalerie. Dès lors, il se trouvait dans l'impossibilité à la fois de disputer le passage aux ducs, devenus depuis peu très-supérieurs en forces, et d'accepter contre eux une bataille pour les empêcher de faire lever le siège[4]..... Le reste se devine trop facilement. Une marche précipitée porta sans obstacles (16-19 avril) Farnèse et Mayenne des bords de la Somme sous les murs de Rouen. Henri, retiré à Bans, à deux lieues de Rouen, dut assister, frémissant, mais impuissant, à l'entrée de l'armée hispano-ligueuse dans la ville délivrée, ravitaillée et fortifiée de nouveau. Il trouva bientôt du moins le moyen de faire expier à l'armée libératrice son humiliant triomphe. Pour assurer la liberté des communications de Rouen avec le Havre, préserver de toute interception son approvisionnement par le cours de la Seine, rétablir son commerce, les ducs résolurent de s'emparer de Caudebec, ce qu'ils firent non sans dommage, car à ce siège Farnèse reçut un coup d'arquebuse et fut dangereusement blessé au bras en deux endroits. Toutefois, ce succès les décida à pousser plus avant jusqu'à Yvetot, d'où ils comptaient réduire le pays jusqu'à la mer et assurer leur ravitaillement devenu précaire. C'est là qu'Henri les attendait. Puisant dans son génie de nouvelles ressources, dans sa patriotique colère de nouvelles forces, il ne négligea rien pour isoler, affamer, exterminer cette armée étrangère qui, sur la foi de faciles succès, s'était enfoncée dans la Normandie et acculée à la mer. L'occasion était unique ; d'un Sursum corda énergique, rappelant sa promesse à sa noblesse congédiée, le roi l'arracha à son indigne repos, et en quelques jours, par un miracle d'activité, il fit sortir comme de terre une armée de vingt-trois mille hommes, dont 1.000 cavaliers. Supérieur en nombre à ses adversaires, supérieur en position dans un pays dont il avait la parfaite connaissance et où il monopolisait l'approvisionnement au point que la disette régnait dans le camp ennemi, Henri consacra cinq combats heureux et successifs livrés aux environs d'Yvetot, du 28 avril au 10 mai, à réduire l'armée ennemie hispano-ligueuse, désorganisée et démoralisée, diminuée d'un tiers par la maladie, les combats et la désertion, à cet état où il suffisait d'un dernier coup pour l'anéantir. Il en cherchait la place et le moment quand les coalisés lui offrirent l'un et l'autre en levant leur camp, le 11 mai, et en allant prendre position à Ranson, village distant d'un quart de lieue de Caudebec. Henri, qui, de l'avis même de Farnèse, un des plus grands capitaines du siècle, faisoit la guerre en aigle, trouva l'occasion propice pour fondre sur cette armée dont il voulait faire sa proie. Il partagea ses troupes en deux corps, et à la tête du premier, attaqua avec acharnement les quartiers du duc, tandis qu'il confiait au maréchal de Biron la mission, avec sa seconde division, de forcer, écraser le reste de l'armée ennemie dans Ranson même. Tout alla à souhait d'abord. Le corps que commandait le roi détruisit deux régiments hispano-ligueurs. De son côté, le maréchal de Biron pourchassa l'ennemi avec tant de furie qu'il lui tua huit cents hommes, dissipa le reste et dispersa sa cavalerie légère. A ce moment, il ne fallait qu'un dernier effort pour remporter la victoire complète. Mais le vieux maréchal avait intérêt à ne pas achever ce qu'il avait commencé. Il refusa ce coup décisif, ce coup suprême, ce coup de grâce aux instantes supplications de son propre fils, qui ne demandait qu'un renfort de cinq cents chevaux pour changer en déroute la retraite des Espagnols et des Ligueurs. Sa réponse est caractéristique : — Maraud, répliqua-t-il tout en colère à son fils, nous veux-tu donc renvoyer planter des choux à Biron ? Le baron de Biron, qui avait encore toute la générosité de la jeunesse, dont l'ambition ne se voyait pas d'ailleurs sans dépit ainsi frustrée par l'ambition paternelle, reprocha amèrement au maréchal de lui avoir arraché des mains cet éclatant succès, et ne put se tenir de s'écrier dans son indignation : que s'il étoit roi de France, il lui ferait couper la tête. C'est là un mot dont il aurait dû se souvenir plus tard, quand il se montra si âpre héritier des ambitions, des rancunes, des jalousies, du génie inquiet et sournois de son père ; il n'eût point payé de sa tête une trahison pire que celle qu'il blâmait jadis si énergiquement, trahison que le roi avait le droit et le devoir de punir, et qu'il ne tint pas à lui de ne point pardonner. Farnèse, luttant de ruse et d'habileté avec un adversaire digne de lui, sauva les débris de l'armée hispano-ligueuse par un de ses artifices habituels. Dans la nuit du 16 mai, il construisit, en face de Caudebec, un pont avec les bateaux qu'il avait fait descendre de Rouen, transporta ses troupes sur la rive opposée, rompit le pont, et mit ainsi entre Henri et lui la Seine qui, en cet endroit, n'est plus un fleuve, mais un bras de mer[5]. La partie n'était point encore perdue, et l'exemple de Souvré qui, avec un corps de cavalerie, en suivant la route indiquée par Henri, avait attaqué avec avantage l'ennemi en retraite, attestait assez qu'une poursuite vigoureusement organisée avait des chances de l'atteindre et de le décimer, sinon de le détruire. Mais le même concert de mauvaises volontés, d'ambitions coalisées contre tout succès trop prompt ou trop complet, qui environnait Henri de sa conspiration permanente et de son insaisissable réseau, paralysa cc suprême élan, ce décisif effort. On ameuta sous main les Suisses, qui refusèrent de marcher avant d'avoir touché l'arriéré de leur solde. On s'arrangea de telle sorte qu'Henri ne trouvât pas de suite l'argent nécessaire pour les satisfaire et l'occasion passa, c'est-à-dire que Farnèse put gagner impunément Paris, et de là ramener en Flandre son armée éclopée et diminuée de sept mille hommes. Sully, Mézeray, Péréfixe sont d'accord pour signaler et flétrir les intrigues qui privèrent Henri du bénéfice de ses succès et épargnèrent à ses trop politiques serviteurs l'affront d'une entière victoire. A ce moment, le bilan de la situation de la cause royale comptait moins de profits que de pertes et inclinait vers la ruine ; il se résumait par le double avortement du blocus de Paris et du siège de Rouen. La Ligue demeurait maîtresse de toutes les grandes villes, de toutes les capitales de provinces, au nombre de vingt-quatre. Avec les débris de son armée diminuée par le départ des Allemands auxiliaires et les congés arbitraires que prenait la noblesse, Henri ne pouvait plus tenter que des opérations secondaires, comme la prise d'Épernay (8 août), où le vieux maréchal de Biron fut emporté d'un coup de canon, ou celle de Provins succès de menue monnaie qui lui coûtèrent plus cher qu'ils ne valaient. Tel était l'état des affaires d'Henri quand il fut encore aggravé, malgré l'habileté de ses combinaisons, toujours déçues par une organisation militaire défectueuse, le funeste jour de la défaite de Craon (23 mai 1592). Ce désastre affaiblit le parti royal dans le Maine et l'Anjou, où il perdit les villes de Laval, Château-Gontier et Sablé, et laissa le champ libre aux progrès de la Ligue, ou plutôt de l'étranger, en Bretagne, où le duc de Mercœur subissait tout le premier la domination du plus exigeant et du plus tyrannique des alliés. En Languedoc, le gouverneur royal Montmorency, débordé par les entreprises d'Antoine-Scipion de Joyeuse, chef de la Ligue à Toulouse et de ses auxiliaires espagnols, dut lui abandonner Carcassonne, la seconde ville du pays. En Guyenne, un complot qui n'échoua que par hasard, faillit livrer Bayonne à Philippe II. En Provence, Marseille était devenue la trop fidèle image de Paris, en ce sens que la faction tyrannique des ultra-ligueurs, tyrannisée elle-même par l'influence espagnole, y. dominait par la terreur. Enfin, en Dauphiné, une trahison du gouverneur royal Maugiron avait livré Vienne, la seconde ville de la province, à l'ambitieux et remuant duc de Nemours, qui travaillait à faire de Lyon le centre d'une principauté également indépendante de la Ligue et du roi. A ce moment, le plus critique peut-être de la vie d'Henri, menacé à la fois militairement et politiquement, il voyait, profitant de ses revers, le parti du cardinal de Bourbon, ou tiers parti, se grossir de d'Aumont, de Longueville, de Nevers et d'autres chefs royalistes. Bientôt, il allait se trouver en présence d'un concert des plus dangereux entre Philippe II, impatient de l'usurpation, le nouveau pape, Clément VIII, créature de l'Espagne, et le duc de Mayenne, réduit à abandonner à l'étranger une partie de son pouvoir pour garder le reste. De ce concert allait sortir, coïncidant avec un renouvellement et un redoublement des foudres spirituelles, une convocation des états généraux. Battue en brèche par les anathèmes du fanatisme, l'autorité d'Henri allait avoir à subir le redoutable assaut de cette grande machine de guerre légale. Excommunié aux yeux des catholiques, il risquait de se trouver déchu aux yeux de tous par le choix d'un autre roi, choix inspiré, imposé, payé aux prétendus représentants de la nation réunis à Paris, en plein quartier général de la Ligue, sous le fer de Mayenne, sous l'or de Philippe. En présence de ces dangers et de ces maux, tels qu'ils semblaient supérieurs aux forces humaines, et qu'autour de lui ils déconcertaient un moment ses conseillers les plus fermes et les plus dévoués, Rosny, Duplessis-Mornay, le chancelier de Cheverny, Henri résolut d'employer les moyens extrêmes, les remèdes suprêmes. Il avait épuisé successivement, pour rétablir l'ordre et la paix, toutes les ressources que peut offrir à une cause la puissance matérielle. La guerre entreprise tour à tour avec des armées composées en majorité de catholiques et de nationaux, puis de protestants et d'étrangers, avait trompé ses espérances, et des échecs presque inévitables lui avaient chaque fois ravi le fruit de ses victoires. Il ne restait plus à Henri que deux moyens de mettre fin à une guerre civile de trente années et de retenir le pays qui glissait vers l'abîme. Le premier était d'amener Mayenne et la Ligue à poser les armes, à se réconcilier avec lui, et d'opposer à l'Espagnol les partis réunis au moins dans cette pensée. Dés qu'il vit le siège de Rouen mal tourner, il entama des négociations qui durèrent pendant les trois mois d'avril, de mai et de juin 1592. Il poussa les concessions jusqu'aux dernières limites pour obtenir une paix indispensable... Le dernier moyen qui lui restait était de détacher les peuples de la Ligue de leurs chefs, de les gagner, de les attirer à lui par son abjuration, et par la séduction légitime de la paix qu'ils désiraient ardemment, tandis qu'il les pousserait à la soumission en continuant à les presser par ses armes et en augmentant momentanément leurs souffrances[6]. Le premier moyen employé par Henri, c'est-à-dire l'essai d'une conciliation, d'une transaction, échoua devant les prétentions exorbitantes et l'égoïste ambition de Mayenne et des chefs de la Ligue. Ils exigeaient, au point de vue religieux, qu'Henri bornât ses concessions à la réforme à un simple édit de tolérance, révocable à volonté. Au point de vue politique, ils demandaient : Mayenne, la confirmation de la lieutenance générale ou la charge de connétable, la Bourgogne, le Beaujolais, le Lyonnais à titre de gouvernement héréditaire et presque indépendant, 300.000 livres de pension annuelle (un million de notre monnaie) ; les autres en proportion. Si Henri eût accédé à des propositions qui limitaient son autorité à une suzeraineté précaire et grevaient son trésor de charges ruineuses, il n'y aurait eu rien en France de moins roi que le roi. Il consentait bien à se couper un bras pour sauver le corps ; mais on prétendait qu'il subit l'amputation de la moitié de ses membres, et laissât saigner les autres à blanc. Les négociations, poursuivies seulement de son côté avec la bonne foi et l'intention sincère d'arriver à un accommodement, avortèrent forcément, par la faute d'adversaires déloyaux, en juillet 1592. Restait l'abjuration : noble et dangereuse résolution qui risquait de lui aliéner ses plus fidèles serviteurs, sans désarmer la papauté et sans lui ramener des récalcitrants douteux, qui exploitaient au profit de leur ambition des scrupules religieux plus affectés que réels. Mais là où les grands spéculent, les peuples sont de bonne foi ; et il y avait à tenter un coup décisif sur la conscience et l'opinion populaires par un de ces sacrifices dont la grandeur n'échappe point aux petits. Au point où on était arrivé, Henri pouvait faire ce sacrifice sans dommage pour sa dignité, car il était spontané, volontaire et désintéressé, puisqu'il n'était inspiré que par l'intérêt national. Henri n'en aborda pas la pensée sans une noble douleur et des troubles de conscience sincères ; il ne s'y résigna que lentement et ne s'y décida point d'un trait, comme le voudraient faire croire les historiens calomniateurs qui ont transformé cet acte d'abnégation, non d'ambition, longtemps reculé, et accompli seulement au prix de cruels déchirements intérieurs, comme le sceptique hommage, à l'opinion régnante, d'un politique égoïste et insoucieux[7]. Avec une habileté qui n'était que l'écho de sa sincérité et de sa loyauté, et qui témoignait de son désir de ne prendre qu'avec maturité, en cédant à sa conscience plus qu'à la nécessité, une résolution aussi grave, Henri se borna à l'annoncer dans une déclaration préliminaire de ses conférences avec les négociateurs de la Ligue. Il accompagna cette déclaration de démarches directes auprès de la cour de Rome, dont il chargea, le 4 octobre, le cardinal de Gondy et le marquis de Pisani, porteurs d'ouvertures de filiale soumission vis-à-vis du Saint-Père, appuyées de la médiation des Vénitiens et du grand-duc de Toscane. L'effet de ces préliminaires discrets, dont la lenteur attestait mieux la sincérité qu'un empressement qui eût été suspect, fut grand sur les chefs de la Ligue française, sur les bourgeois de Paris et le parlement, dont cette avance bienvenue encouragea la défection et la résistance. Le parti royal, devenu le parti national en haine de l'étranger, recruta l'élite des catholiques, auxquels la promesse d'abjuration ne laissait aucun grief. Il devint bientôt assez fort, assez discipliné, assez confiant dans l'avenir pour opposer aux intrigues de l'Espagne et aux violences de Mayenne le salutaire contrepoids d'une opposition d'abord pacifique et légale, mais qui ne devait pas reculer plus tard devant l'appel aux armes. Pour favoriser ce mouvement propice d'opinion, Henri, qui savait quel prestige la force ajoute au droit, resserra, dans une expectative énergique et prudente à la fois, le blocus de Paris et y fit pénétrer de nouveau la disette. Ce ne fut point la seule alliée d'une cause en faveur de laquelle conspirèrent de nouveau la raison, l'intérêt et une sorte de retour de la fortune. Ce retour était attesté par le succès de Turenne sur le duc de Lorraine, la défaite, la fuite et la mort du duc de Joyeuse en Languedoc, l'attitude menaçante du duc d'Épernon en Provence, et surtout les brillantes opérations de Lesdiguières, qui, pour arracher au duc de Savoie le Dauphiné et la Provence, porta la guerre dans ses propres États, et, lui rendant invasion pour invasion, établit les Français à seize milles de Turin (14 octobre, 19 octobre, 26 novembre, 5 décembre 1592). Les affaires de la Ligue et de l'Espagne commençant ainsi à se défaire partout, comme parlent les contemporains, Mayenne et Philippe II tentèrent de les rétablir par la prompte convocation des états généraux et l'élection d'un roi. Cette mesure devait à la fois affaiblir Henri en lui suscitant un compétiteur, et rendre à l'Union la cohésion et la force, en lui donnant un chef qui tirerait son autorité et sa puissance des suffrages d'une assemblée en apparence nationale. L'élection ouvrait de plus une nouvelle carrière aux prétentions du lieutenant général et du roi catholique[8]. Les états généraux, selon le plan espagnol, appuyé par Farnèse à la tête d'une armée espagnole de 20.000 hommes, prête à opérer en France une troisième invasion, devaient d'abord être réunis à Reims ou à Soissons, où l'intérêt ou la peur, la bourse ou l'épée répondaient de leur docilité. Mayenne sentit moins le danger pour la France que pour lui-même et opta en faveur de Paris, où il pouvait, avec 40.000 bourgeois armés, faire contrepoids à la pression étrangère et préserver ses droits, sinon ceux du pays, dont il faisait bon marché. Déjà Farnèse irrité, accourait pour obtenir par l'intimidation ce que la persuasion n'avait pu gagner, et mettre à la raison un allié qui se permettait de contredire. Une mort opportune, providentielle, plus heureuse pour Henri qu'une victoire, l'arrêta en chemin. Le 2 décembre, le grand capitaine, le grand politique, le seul lieutenant capable de réaliser les vastes desseins de Philippe II, succomba à Arras aux suites mortelles de la blessure reçue à Caudebec peu de mois auparavant. Cette mort faisait disparaître de la scène le seul homme capable de maintenir la discipline dans les armées d'intervention, d'y préserver le lien précaire qui unissait les soldats italiens et les soldats espagnols, de lutter de génie militaire avec un adversaire comme Henri, de lutter de sagacité politique et de connaissance des hommes et des choses avec les hommes d'État de la Ligue française ou du parti royal, enfin d'y dominer les états généraux. Les qualités qui le rendaient si redoutable faisaient heureusement complètement défaut à son successeur ; le duc de Féria. Désormais la politique espagnole entrait en voie de décadence ; le jeu redevenait français. Mayenne le sentit si bien qu'il dirigea tous les efforts de son habileté, encouragée par un si propice événement, vers la consolidation du parti de la Ligue, auquel il chercha à ménager, à force de concessions et de faveurs, le concours des ligueurs français, c'est-à-dire hostiles seulement à l'intervention étrangère, et l'alliance du tiers parti créé par l'ambition du cardinal de Bourbon et du comte de Soissons. Il essayait ainsi d'isoler à la fois le roi des réformés mécontents et des catholiques exclusifs. Il ne put triompher de la répugnance d'une partie de la bourgeoisie, ni de la sagacité du parlement, qui engagea dès lors contre le lieutenant général cette guerre du droit, cette lutte d'arrêts et de remontrances par laquelle furent déjoués tour à tour les calculs usurpateurs de Philippe II et de Mayenne. Nous ne saurions entrer dans le détail de ces débats subtils, de ces combats de corruption ou d'intimidation, ni même résumer et caractériser les vicissitudes souvent contradictoires d'une délibération soumise à tant de courants divers, et dont les orages, heureusement stériles, durèrent toute une année. C'est là une analyse minutieuse, délicate, qui n'aurait qu'un intérêt douteux pour des lecteurs gagnés, par la généreuse influence de cette vie d'Henri IV, au goût de l'action et au mépris des partis. Les états généraux de la Ligue s'ouvrirent à Paris le 26 janvier 1593, indécis eux-mêmes au milieu des indécisions de l'opinion publique. Cette opinion était sollicitée en sens contraires par l'ambition de Mayenne et les intrigues de l'Espagne. Henri combattit l'une et l'autre par le double et habile manifeste des 27 et 29 janvier, où il affirmait son droit et protestait de son désir d'arriver à la paix par une trêve et à l'union par le sacrifice de la dernière dissidence qui le séparât de son peuple, la dissidence religieuse. A la fin d'avril 1593, la situation qui résultait de ce conflit de compétitions, de passions et d'idées n'avait pas encore pris une tournure bien dangereuse en ce qui touchait l'étranger ; car l'ambition et les desseins de Philippe II et du duc de Mayenne se faisant contrepoids, se tenant mutuellement en échec, paralysaient de ce côté toute solution. Mais en ce qui regarde Henri IV, la cause royale ne traversa jamais des auspices plus menaçants ; car l'anarchie n'était pas moins au camp des royalistes qu'au camp de la Ligue. A un moment même, Henri toucha à sa perte, ménagée par cette fameuse conjuration de Mantes, où faillirent éclater les ferments que couvait son propre parti. Henri se trouvait avoir alors pour antagonistes les quatre princes du sang à la fois, le cardinal de Bourbon, le comte de Soissons, le prince de Conti, le duc de Montpensier, dont la convocation des états généraux et le mauvais état des affaires du Roi avaient mis l'ambition en éveil. Autour d'eux se groupaient les huguenots, mécontents des gages que la prochaine abjuration du Roi semblait donner à la cause catholique au détriment de leur indépendance et de leur repos ; les catholiques excessifs, dont le fanatisme ne se contentait plus d'une promesse, et voulait la réalisation immédiate d'une conversion qu'ils prétendaient exploiter uniquement à leur profit ; enfin les seigneurs fatigués de la longueur d'une guerre onéreuse dont ils attribuaient la prolongation à ce prince trop militaire, toujours botté, et qui n'aimait que des courtisans toujours cuirassés. Tous ensemble formaient le dessein de passer à la Ligue et conjuraient pour une révolution... Leur plan était d'écarter Henri, de reconnaître pour roi le cardinal de Bourbon, de désintéresser Philippe II, en faisant épouser l'Infante, sa fille, au cardinal de Bourbon relevé de ses vœux par le Pape. Les agents du prince s'abouchaient avec Villeroy et Jeannin pour persuader à Mayenne de favoriser cette combinaison, sous promesse d'immenses avantages qui lui seraient faits ; le cardinal entrait personnellement en négociations avec l'amiral de Villars qui commandait dans Rouen[9]... Le plan des mécontents était chimérique, mais il était dangereux, car ce qui est le plus chimérique, à certains moments, n'est pas ce qu'il y a de moins dangereux[10]. Henri le sentit ; après une série de graves conférences avec ses conseillers des heures critiques et des décisions suprêmes, le chancelier de Cheverny, le comte de Schomberg et Rosny, il intervint dans la délibération où l'on agitait tous les intérêts et tous les droits, excepté ceux de la nation et les siens, par une double déclaration faite pour dissiper les nuages, pour éclaircir les eaux troubles, pour mettre la déroute au sein de la coalition. En politique comme à la guerre, Henri a de ces résolutions inspirées et décisives, étincelantes et pénétrantes comme l'épée, qui font la lumière dans la nuit et l'ordre dans le chaos. Par cette double déclaration, il rallia à lui définitivement les catholiques, auxquels il offrit de son changement sincère de religion, un gage irrévocable ; les réformés, auxquels il assura, en termes non moins précis, la tolérance et l'égalité par lesquelles il compensait le tort qu'il paraissait leur faire en passant ainsi de l'un à l'autre bord. C'est sous les auspices de cette double garantie que s'ouvrit la conférence de Surène, où l'archevêque de Bourges, chargé d'y présider le parti royal, allait discuter avec les représentants de la Ligue les préliminaires de trêve sinon de paix dont Mayenne n'avait pu refuser la satisfaction aux exigences de l'opinion. Cette opinion éclata en manifestations et en cris caractéristiques dès le jour de l'ouverture de la réunion. Quand les députés de la Ligue sortirent de Paris, un grand peuple amassé à la Porte-Neuve, leur cria tout haut : La paix ! la paix ! Bénis soient ceux qui la procurent et la demandent ! Maudits et à tous les diables soient les autres ! Ceux des villages par où les députés passèrent, se mirent à genoux, et leur demandèrent la paix à mains jointes[11]. La conférence de Surène permit aux Parisiens, à la faveur d'un armistice de huit jours, convenu de part et d'autre, de franchir enfin les murailles de la cité prisonnière, de se répandre dans les champs si longtemps inexplorés, et de goûter un avant-goût de paix et de liberté, rendu plus délicieux encore par les souffles parfumés des premiers jours du printemps. (29 avril-10 mai 1595). Sous ce doux aiguillon, entra dans les âmes que l'esprit de parti n'avait pas gangrenées, une impatience de réconciliation qui n'en sortit plus. Le duc de Mayenne, rentré à Paris le 6 mai, jugea nécessaire de réagir contre ces dispositions en se mettant en mesure de porter aux états la question d'élection d'un Roi et de donner aux esprits la diversion d'une discussion solennelle et quelque peu théâtrale (10 mai). Mais c'est en vain qu'il essaya de précipiter une solution. La conférence de Surène avait porté ses fruits, et tendu à l'opinion un double appât dont elle ne se détacha plus : la certitude de la conversion du roi au catholicisme, et l'offre d'une trêve de trois mois, comme prélude de la pacification générale du royaume. Sur ce double fondement les politiques, les bourgeois royalistes, le clergé fidèle et raisonnable, le Parlement établirent les bases de cette opposition légale à laquelle Molé et Le Maistre allaient, soutenus de l'assentiment populaire, prêter l'autorité de leur incorruptible voix. Le 16 mai, Henri déclara à son conseil la résolution qu'il avait prise d'abjurer, et fixa le mois de juillet pour cet acte important. Il convoqua par lettres, dans la ville de Mantes, pour le 15 juillet, un certain nombre de prélats, tant du parti royal que du parti de la Ligue, dont il devait recevoir les instructions. Il convoqua en même temps les seigneurs catholiques et calvinistes et les députés des divers Parlements pour assister à sa réconciliation avec l'Église, et pour décider toutes les hautes questions relatives à la religion et à l'État. En se séparant des huguenots, il prévint leurs alarmes. Le même jour, 16 mai, il promit par une déclaration spéciale que, dans tout ce qui serait fait aux conférences de Surène, il ne serait pas dérogé aux édits et déclarations données par les rois précédents, et assurant aux Réformés la liberté de leurs personnes et la liberté de conscience. Il fit souscrire cette promesse par le chancelier et par les plus grands seigneurs du parti catholique alors réunis autour de lui[12]. Fidèle à son principe d'user à la fois de toutes ses ressources, de faire appel en même temps à toutes les influences capables d'agir sur l'opinion, qui, de plus en plus, se prononçait en sa faveur, malgré les artifices et les intimidations, enfin d'appuyer au besoin son droit sur la force, Henri employa à se créer une armée le temps que la Ligue perdait à s'énerver, à s'épuiser en stériles disputes et en négociations illusoires. Quand les États, sous la pression de Mayenne et de la Chambre du clergé, eurent repoussé, le 3 juin, ses propositions de conversion et de trêve, Henri, qui avait conclu avec le grand-duc de Toscane un emprunt assurant la solde de cinq mille Suisses pour un an et deux cent mille écus pour payer ses soldats français, se trouva à la tête de forces considérables, et en mesure de jeter son épée dans la balance, de façon à la faire pencher de son côté. Le 8 juin, il commença le siège de Dreux, qu'il prit le 19. Il réunit un corps d'armée en Picardie, fit bloquer Poitiers, et dès le 26 juin, après avoir contraint à la retraite les troupes de secours que Mansfeld amenait des Pays-Bas, il se trouva en mesure de tout entreprendre contre Paris, de nouveau étroitement resserré. En même temps, Lesdiguières battait les Savoyards et les Espagnols dans la vallée d'Aulx, et les royaux qui bloquaient Poitiers faisaient essuyer un échec aux Ligueurs et à Brissac, leur chef. Le 31 juillet, en présence d'un mouvement de l'opinion qui avait fait avorter tous ses efforts pour hâter l'élection d'un roi, et qui le menaçait lui-même d'une déchéance qu'il. n'était plus assez fort pour conjurer, le duc de Mayenne était obligé de donner au sentiment national, surexcité par les protestations parlementaires, la satisfaction de la conclusion avec Henri d'une trêve de trois mois, publiée le 1er août. Cette publication fut suivie d'une prorogation des états généraux, représentés seulement, auprès de Mayenne, par une délégation dont comptait bien se servir lieutenant général pour sanctionner les desseins ambitieux et violents qu'il dissimulait sous une modération de circonstance. Mais c'en était fait de son autorité, qu'il avait avilie en la prostituant à l'Espagne ; il n'allait pas tarder à apprendre, par la plus éclatante et la plus amère des déceptions, que l'heure de l'occasion était passée, que désormais, même avec l'appui de l'étranger, il affrontait contre le vœu national une lutte inégale ; enfin, que s'il est des moments où les hommes peuvent dominer les circonstances, il en est d'autres où elles emportent vers leur but tout ce qui leur résiste, ou le brisent en chemin, quand l'opinion, lasse de souffler en bonace, souffle en tempête. Le 3 juillet, Henri qui ne s'était rendu encore maître que de la ville de Dreux, prit la Tour grise, qui l'avait arrêté plus longtemps ; le 5, le château capitula. Le succès de ce siège, dans les circonstances du moment, valait, comme effet moral, celui d'une bataille rangée ; il attestait le progrès lent, mais sûr et continu, de l'autorité royale, et provoquait un mouvement conforme de l'opinion en sa faveur. L'Espagne et la Ligue n'avaient plus de batailles ni de sièges à leur compte. Faute d'armées et d'argent, elles épuisaient les restes de leur crédit dans des négociations à Rome, ou des intrigues avec le tiers parti. Henri agissait, et agissait à propos, de façon à attirer à lui cet assentiment universel dont la force morale va volontiers au-devant des triomphes de la force matérielle, surtout quand ils servent le droit. Henri vaincu ou menacé de l'être, eût en vain incliné devant le giron de l'Église son front repentant. L'opinion, comme l'Église, ne croit qu'aux conversions désintéressées, et n'est flattée que par l'hommage des victorieux. La démarche par laquelle Henri, fidèle à sa promesse, se prêta, avec la modestie d'un catéchumène et la consciencieuse sincérité d'un prince qui sait le prix de son âme et qui veut être convaincu et non conquis, aux conférences religieuses ouvertes d'abord à Mantes, ensuite à Saint-Denis, fit donc sur les peuples un effet profond et décisif (15 juillet 1593). Le 21 juillet, l'assemblée chargée de provoquer et de recevoir l'abjuration du Roi, après avoir résolu ses questions et dissipé ses doutes, se réunit à Saint-Denis. Elle se composait de l'archevêque de Bourges (Renaud de Beaune), des évêques titulaires de Nantes, de Séez, de Maillezais, de Chartres, du Mans, d'Angers, de Digne, des évêques nommés de Bayeux et d'Évreux (Du Perron). Parmi les membres du clergé inférieur, on comptait sept docteurs en théologie, un docteur eu droit canon, quatre des curés de Paris : Chauveau, curé de Saint-Gervais, dépossédé par la Ligue, de Chavagnac, curé de Saint-Sulpice, de Morenne, curé de Saint-Merry, Benoist, curé de Saint-Eustache, qui avaient sans cesse prêché au peuple la paix, le rapprochement entre les partis, l'obéissance au roi légitime[13]. C'est en vain que le légat et le cardinal de Bourbon tour à tour prétendirent entraver la marche de la procédure en abjuration, et empêcher Henri de recevoir l'absolution ; l'assemblée des prélats et docteurs, avec un admirable bon sens et un admirable patriotisme, après avoir rétorqué victorieusement les arguments d'opposition juridiquement et théologiquement invoqués, passa outre au procès et à l'exécution. Ils déclarèrent en terminant qu'après plusieurs combinaisons échouées, les ennemis de Henri restaient assemblés à Paris pour l'élection d'un roi ; que si l'on temporisait davantage, l'on introduirait le démembrement de l'État et le schisme dans l'Église ; que l'opposition faite paf' le légat à la conversion du roi ne pouvait être considérée que comme la manœuvre d'un partisan déclaré de l'Espagne, et qu'elle ne pouvait enchainer un seul instant la liberté de leurs déterminations. En conséquence, l'assemblée arrêta que les évêques français avaient le droit d'absoudre le roi sans l'intervention immédiate du Pape ; que le roi n'était tenu à l'égard du Saint-Siège qu'à faire des soumissions et à demander la ratification de son absolution ; que cette absolution lui serait donnée par l'archevêque de Bourges, patriarche et grand aumônier de France, sans attendre mandement de la cour de Home ; tous proclamant qu'il étoit plus expédient de passer outre et de procéder sans retard à l'œuvre la plus agréable à Dieu, et la plus salutaire à la France, que jamais ils sçauroient faire[14]. Le 23 juillet commencèrent les conférences, où Henri, en deux mots, définit le rôle qu'il venait jouer, et attesta noblement la sincérité de ce rôle. Il ne se présenta point comme un abjurant spontané, inspiré, éclairé de la grâce, mais comme un néophyte raisonnable, raisonneur, amené, par un grand effort de réflexion et d'abnégation, à la pensée d'abandonner la foi de sa mère, celle de son enfance, celle de sa jeunesse, qui l'avait jusque-là contenté, pour une religion où il trouverait plus complète satisfaction encore de ses besoins d'esprit, de ses besoins de cœur, de ses instincts d'homme, de ses devoirs de roi. Il déclara : Que connoissant de plus en plus l'intention de ses sujets, touché de compassion de la misère et calamité de son peuple, il souhaitoit, avec rareté de sa conscience, pouvoir contenter sesdits sujets. Il ne fit point mystère des déchirements intimes que lui avait coûté cette renonciation, ni des angoisses de raison qu'elle lui laissait parfois, quand il ne se sentait pas suffisamment éclairci, et réclamait un surcroît de lumières et de paix. C'est en termes émus et émouvants qu'il implorait ce rafraîchissement de sa conscience parfois alarmée : Voici, je mets aujourd'hui mon âme entre vos mains ; je vous prie, prenez-y garde, car là où vous me faites entrer, je n'en sortirai que par la mort, et de cela, je vous le jure et proteste. En achevant ces mots, les larmes lui jaillirent des yeux. C'est donc à la suite d'une information sincère, loyale, débattue, disputée, après des discussions qui reflétèrent les orages de l'esprit et du cœur d'Henri, et parfois se résolurent en larmes, qu'il fit dans le giron de l'Église une rentrée vraiment filiale et royale, volontaire, exemplaire, désintéressée, douloureuse, salutaire, comme tout ce qui est amer, féconde comme tout sacrifice. Le dimanche 25 juillet 1595, eut lieu. à Saint-Denis, une scène solennelle, dramatique, émouvante, pittoresques qu'il suffit de raconter sans prétention pour lui laisser tout son effet. Le Roi se rendit en grande pompe, à huit heures du matin, à la basilique historique et légendaire, précédé de ses gardes, accompagné des princes, des officiers de la couronne et d'une multitude de gentilshommes accourus de toutes les provinces. Arrivé au grand portail de l'église, il fut reçu par l'archevêque de Bourges, les neuf évêques, les docteurs et curés, et tous les religieux de l'abbaye de Saint-Denis. L'archevêque de Bourges, prélat officiant, lui adressant alors l'interpellation sacramentelle, lui demanda : — Qui êtes-vous ? — Je suis le Roi, répondit Henri. L'archevêque répliqua : — Que demandez-vous ? — Je demande, déclara Henri, à être reçu au giron de l'Église catholique, apostolique et romaine. — Le voulez-vous ? interrogea encore Mgr de Bourges. La réponse fut : — Oui, je le veux et le désire. Alors le Roi, agenouillé sur le seuil du temple, fit à haute voix sa profession et confession de foi : — Je proteste et jure, devant la face du Dieu tout-puissant, de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, de la protéger et défendre envers tous, au péril de mon sang et de ma vie, renonçant à toutes hérésies contraires à ladite Église catholique, apostolique et romaine. Cela fait, Henri reçut du prélat l'absolution et la bénédiction, et fut introduit processionnellement et triomphalement dans l'église, toute brillante de lumières, toute fumante d'encens, toute riante de fleurs. Arrivé au chœur, il réitéra sur les Évangiles son serment et sa protestation, fit sa confession, entendit la messe, et fut alors pleinement réconcilié avec l'Église. Une révolution était ainsi commencée : l'abîme de la religion, qui jusqu'alors avait séparé le roi des ligueurs de bonne foi, de la population de presque toutes les grandes villes demeurées en révolte, cet abîme était comblé. Le clergé de France haut et bas, séculier et régulier, du parti royal et du parti de l'Union, les archevêques et les évêques, aussi bien que les curés de Paris, aussi bien que les religieux de Saint-Denis, usant de leur droit, venaient d'absoudre le roi, malgré les défenses et les menaces du Saint-Siège, donnaient au corps des fidèles l'exemple de le reconnaître et de lui obéir. Les habitants de Paris, se passant des passeports que Mayenne leur refusait, franchissant les murailles de la ville alors qu'il en faisait fermer les portes... étaient accourus en masse à Saint-Denis et avaient assisté à la cérémonie, plus nombreux que les royaux eux-mêmes, remplissant les voûtes de l'église de leurs cris de : Vive le Roi ! et versant tous, grands et petits, des larmes de joie. Henri reçut un pareil accueil des habitants des campagnes dans la plaine de Saint-Denis, dans la vallée de Montmorency et dans celle de Montmartre, quand il se rendit à l'église de Montmartre pour y faire ses dévotions. C'était une réconciliation morale du souverain avec la moitié de ses peuples, prélude de la réconciliation politique[15]..... Cette réconciliation politique ne pouvait se faire longtemps attendre. Le peuple se sentait de plus en plus entraîné vers le Roi chevaleresque, pieux, paternel. Réparant la faute de la Ligue, si durement expiée, il allait donner au monde, après le mauvais exemple d'une nation ingrate et rebelle, le consolant spectacle d'une sorte d'enthousiasme à se repentir, d'émulation à expier, d'un véritable retour de peuple prodigue, se ruant, avec une furieuse tendresse, au bercail de la royauté[16]. C'est le lendemain de l'abjuration que se répandit, en copies multipliées à l'infini, avant l'impression (qui ne date que des premiers mois de l'année 1594), l'immortel pamphlet royaliste et national, la Satire Ménippée. Il détermina, en attendant le coup de grâce de l'épée, la dissolution morale de la Ligue, commencée, depuis la convocation des états, par l'odieux, achevée par le ridicule dès le jour où parut le chef-d'œuvre collectif, ironique, patriotique, politique, des implacables railleurs Louis Levot, Pierre Pithou, Gillot, Rapin, Fl. Chrétien, Passerat. A ces victoires de la plume, ennoblissant et agrandissant les victoires de l'épée, le sombre désespoir de la Ligue essaya de répondre par l'arme des causes condamnées, par le coup de trahison des partis terrassés, cherchant un suprême salut ou une suprême vengeance dans l'assassinat. Elle endoctrina et dépêcha à Henri, à Melun, un aventurier fanatique, Barrière, chargé de renouveler l'exécrable attentat de Jacques Clément, qui pourtant n'avait pas porté bonheur à ses fauteurs. Mais Dieu veillait sur son élu. Signalé par un dénonciateur fidèle, arrêté le 27 août à la porte de Melun, Barrière fut convaincu de son crime, et livré au bourreau. Il laissait à ses instigateurs, avec la honte de l'avoir envoyé, celle d'avoir échoué, et de voir ce qui devait les délivrer de leur ennemi, servir à le rendre plus fort, l'amour des peuples s'étant accru de toute la crainte et de tout le danger de perdre un être si précieux et si menacé. A partir de ce moment, il se fit dans toutes les villes encore soumises à la Ligue, et parmi ses derniers partisans, un mouvement de révolte et de défection qui présageait et précipitait l'écroulement final de cette puissance ruinée par ses propres excès. Pendant que Boisrozé et Balagny faisaient leur soumission et rendaient aveu au roi pour leur gouvernement de Fécamp et Lillebonne, et de Cambrai, lai seconde ville de France, Lyon, se soulevait contre son tyran le duc de Nemours. Les bourgeois l'enfermaient, avec ses conseillers et ses gentilshommes, au château de Pierre-Encise, attendant l'occasion propice de consommer l'œuvre de délivrance, et après s'être affranchis de ces premiers liens, de faire tomber les derniers, en se remettant aux mains du Roi (18 septembre 1593). L'exemple fut contagieux, 'et comme une traînée de poudre, mit le feu à une sorte d'effervescence royaliste qui ne devait plus s'arrêter. Pendant ce temps, Henri mettait à profit l'embarras de ses ennemis et les loisirs de la trêve, prolongée effectivement jusqu'à la fin de 1593, pour triompher diplomatiquement à Rome, en attendant d'entrer à Paris, à la faveur d'un coup d'État politique et populaire appuyé d'une manifestation militaire. Il écrivait au Pape quatre lettres de soumission et de conciliation rendues habilement publiques ; il lui envoyait une députation de prêtres et de docteurs, chargés de justifier à ses yeux la procédure de Saint-Denis, et d'en obtenir la ratification ; il lui dépêchait enfin, en ambassade, le duc de Nevers. Il poursuivait, à Andrésy et à Milly, avec le duc de Mayenne. des négociations de paix, sur le résultat desquelles il ne se faisait point illusion, mais dont il ajoutait le témoignage à tant d'autres en garantie de ses intentions modérées et conciliantes. Il y gagnait de plus l'adhésion successive de Vitry, de Villeroy et de La Chastre, trois des personnages les plus importants de la Ligue, qui abandonnaient une cause perdue et engageaient Mayenne à les imiter, pendant qu'il était temps encore de paraître céder à la raison plus encore qu'à la nécessité. Quand la trêve expira, Henri était, avec une armée renouvelée, un crédit raffermi par la convention d'août 1593, qui lui assurait le concours de l'Angleterre, en mesure de seconder et d'attendre une explosion décisive du sentiment national et populaire qui fermentait à Paris en sa faveur. Le 3 janvier 1594, la Provence se révolta contre le joug du duc d'Épernon, qui cherchait à se rendre indépendant du roi, et les villes et seigneurs confédérés livrèrent à Henri la ville d'Aix, capitale de la province. Les 7 et 8 février, Lyon suivit l'exemple d'Aix ; les échevins et bourgeois royalistes, achevant ce qu'ils avaient commencé, prirent les armes, ceignirent l'écharpe blanche, et se donnèrent au roi, par une admirable révolution, modérée, impartiale, désintéressée, qui épargna ceux qu'elle renversait, ne demanda rien pour ses auteurs, et ne coûta rien à Henri IV. Ses deux lettres du 20 et du 22 février récompensèrent, par des remerciements attendris et de justes louanges, cette conduite vraiment civique et héroïque à la fois. A Meaux, à Aix et à Lyon, les accords intervenus avec MM. de La Chastre, d'Estourmel, M. de Villeroy et son fils d'Alincourt, ajoutaient aux conquêtes pacifiques, mais souvent onéreuses d'Henri, Orléans, Bourges, Péronne, Roye, Montdidier et Pontoise. Le roi, poursuivant toujours sa politique d'intimidation et de conciliation, resserrait en même temps le blocus matériel de Paris et le blocus moral, en quelque sorte, de la Ligue, à laquelle il jetait ce suprême argument, ce suprême défi de sa consécration, qui achevait de lui gagner le clergé catholique. Reims étant encore au pouvoir des Ligueurs, le roi, autorisé par l'exemple de plusieurs de ses prédécesseurs, se fit sacrer et couronner dans Chartres, par les mains de l'évêque de cette ville, Nicolas de Thon, avec la sainte ampoule de Saint-Martin, tirée de l'abbaye de Marmoutiers, près de Tours. A cette cérémonie assistèrent trois princes du sang et trois ducs, tenant le lieu des six pairs laïques, et les évêques de Chartres, de Nantes, de Digne, de Maillezais, d'Orléans, d'Angers, représentant les pairs ecclésiastiques[17]. (27 février 1594.) Après cette dernière marque de ses sentiments, Henri ayant tout donné, pouvait tout recevoir et au besoin tout prendre. Il donna, à ses amis et à ses ennemis, le signal de son énergique intention d'en finir, de gré ou de force, avec une situation intolérable, en battant, pour leurs étrennes (le 1er janvier 1594), les troupes ligueuses, en les chassant de Charenton, et en fermant la dernière porte de l'approvisionnement et du commerce parisiens. Mayenne, qui prévoyait l'orage de représentations, de protestations et de factions qui allait fondre sur son autorité expirante, avait cherché à le conjurer, en bannissant de Paris plusieurs chefs du parti politique, plusieurs bourgeois influents, entre autres les colonels Daubray, Passard, Marchand (28 décembre 1593). Le 8 janvier, il avait destitué le gouverneur de Paris, M. de Belin, suspect, et l'avait remplacé par le chef des Ligueurs d'Orléans, le comte, de Cossé-Brissac, sur lequel les Espagnols faisaient grand fond et sur lequel il croyait pouvoir compter lui-même. Il avait armé, sous le nom de Minotiers, les derniers séides, les derniers terroristes de la Ligue, recrutés dans la lie de la populace. Enfin, il avait renforcé la garnison française et la garnison espagnole. Le 12 janvier, la lutte commença entre les deux partis, décidés aux suprêmes extrémités. Le Parlement, dont le prestige avait survécu à la ruine des autres pouvoirs, ouvrit d'abord le feu de la résistance pacifique et légale. Le 12 janvier (1594) le procureur général Molé, dans une remontrance et harangue publique en pleine audience, réclama pour Henri l'obéissance, qu'on ne pouvait plus lui refuser depuis qu'il s'était fait catholique, et le Parlement interpella le duc de Mayenne de reconnaitre le roi que Dieu et les lois avaient donné au royaume. Le 14, il rendit un arrêt et dressa par écrit des remontrances portant : La Cour ayant vu le mépris que le duc de Mayenne a fait d'elle sur les remonstrances qu'elle lui a faites, a ordonné mettre par écrit autres remonstrances qui lui seroient envoyées par le procureur général du Roi pour y faire réponse, laquelle sera insérée aux registres de la Cour. Ladite Cour, d'un commun accord, a protesté de s'opposer aux mauvais desseins de l'Espagnol et de tous ceux qui le voudroient introduire en France. Ordonne que les garnisons étrangères sortiront de la ville de Paris. Déclare son intention être de s'opposer de tout son pouvoir que le sieur de Belin abandonne ladite ville, ni aucuns bourgeois d'icelle, et enjoint au prévôt des marchands de faire assemblée de Ville pour aviser à ce qui est nécessaire, et se joindre à la Cour pour l'exécution dudit arrêt. Cessera la Cour toutes autres affaires jusqu'à ce que ledit arrêt soit entretenu et exécuté[18]. C'était une mise en demeure au duc de Mayenne de se rendre au roi, de se ranger à la loi, d'abdiquer la lieutenance générale usurpatrice, le céder au vœu parlementaire et pacifique, s'il ne voulait être forcé de céder aux exigences populaires, qui devenaient menaçantes. Mayenne essaya de la colère et mit la main sur la garde de son épée. Mais il ne sert de rien d'être violent quand on est fort, à plus forte raison quand on est faible, et une épée est peu de chose contre la volonté d'un peuple qui n'en peut plus mené par des chefs prêts à tout et résolus à signer de leur sang la requête qu'ils ont signée de leurs seings. Pourtant, aux interpellations et à l'arrêt du Parlement, aux demandes du peuple, représenté par une députation des bourgeois et des quarteniers ou officiers de la garde bourgeoise, aux adjurations de l'échevin Langlois et du prévôt des marchands L'Huillier, Mayenne répondit en menaçant d'un coup d'État militaire. Il maintint la destitution de M. de Belin et lui enjoignit de sortir de Paris. Il défendit au Parlement de s'assembler et de délibérer sur les affaires publiques. Il fit afficher prohibition, sous peine de la vie, de toute assemblée générale soit au Palais, soit à l'Hôtel de ville, et interdit tout attroupement de plus de six personnes (15 janvier). Le 21 février, il bannit six bourgeois récalcitrants, que le Parlement prit en vain sous sa protection. Il n'avait tenu nul compte des éclairs avant-coureurs de la tempête. Dès la fin de février, la nuée, qui s'amoncelait, creva. Les chefs du mouvement de reddition et de soumission se confédérèrent et se concertèrent définitivement sur les moyens de favoriser l'entrée du roi dans Paris, jouant leur vie en cas d'échec, ne demandant rien en cas de succès, que le bonheur d'avoir réussi. Parmi ces honnêtes, intrépides et patriotiques citoyens, il faut citer les échevins Langlois et Néret, le prévôt des marchands L'Huillier ; et au Parlement et à la Cour des Comptes, MM. le Maistre, Molé, Du Vair, Damours, Marillac, Boucher-d'Orçay, enfin, en masse, les trente mille bourgeois armés qui se montrèrent prêts à attester, de leur sang, leur lassitude d'un maître et leur désir d'un roi. Le 6 mars 1594, Mayenne, menacé à Paris d'une insurrection, resserré militairement entre Meaux, Pontoise, Orléans et Bourges, comme entre quatre sentinelles, songea à sortir du réseau, tandis qu'il en était temps, à échapper à une lutte dont il n'augurait rien de bon, et à organiser à Soissons un centre de résistance plus sûr. Le 6 mars, il quitta la capitale, se retirant ainsi des hasards du choc inévitable et prochain entre les politiques et les parlementaires royalistes, d'une part ; la garnison espagnole et la bande des minotiers ou terroristes de la Ligue parisienne, de l'autre. Henri, loin de profiter brusquement et dangereusement de l'occasion, affecta de la négliger, s'éloigna de Saint-Denis le 17 mars, et installa son conseil à Senlis. Là, il attendit, livrant les Espagnols et les ligueurs parisiens à la plus décevante des sécurités, que l'œuvre préliminaire fût achevée, que la plus loyale et la plus noble des trahisons eût tendu, sous les pas de l'étranger maudit, ses pièges sacrés, enfin, que tout fût prêt pour qu'il n'eût plus qu'à aider ses amis et à recevoir, sans effusion de sang français, Paris des mains des Parisiens. C'est ainsi, en effet, que les choses se passèrent, grâce à la connivence de M. de Brissac, gagné par Saint-Luc, son beau-frère. Le gouverneur, démasquant une médiocrité apparente, dont le rôle lui avait servi à capter la confiance des Espagnols, fit preuve, dans cette conjoncture critique et décisive, d'une habileté, d'une présence d'esprit, d'un patriotisme, d'un dévouement qui mériteraient tous nos éloges s'ils avaient été plus désintéressés, s'il n'avait plutôt rendu que rendu, comme le lui reprocha publiquement la rude franchise de L'Huillier, la capitale, et s'il n'avait reçu, en échange de ses services, un bâton de maréchal qui était celui du succès, mais non celui de la victoire, une rançon qui n'était pas celle de ses ennemis, mais celle de ses amis. Ce qui rendait l'entreprise de l'introduction du Roi et des troupes royales dans Paris plus lente et plus difficile, mais ce qui en assurait aussi le succès, en laissant à cette grande œuvre le caractère de manifestation libre et spontanée dont elle garda le mérite et l'honneur, c'était la nécessité de procéder avec discrétion, avec mystère, à petit nombre, et non sans de grands hasards ; car l'absence de secours mettait les conjurés à la merci de la garnison espagnole et des bandes féroces, exaspérées, des Minotiers ; et l'intervention trop brusque, trop patente des royaux pouvait compromettre le succès. Il fallait donc qu'Henri feignît de se retirer à l'écart, tout en se tenant prêt à entrer en forces ; et il fallait agir à l'intérieur avec assez de prudence, de tact, de bonheur, pour que la garnison fût surprise et ne prit l'éveil que trop tard. Brissac, qui se montra aussi avisé que les Espagnols et les Seize se montrèrent confiants, trouva moyen, le 14 mars, de s'aboucher avec son beau-frère Saint-Luc, en prétextant d'un procès pendant entre eux, sous l'œil de ses surveillants, et sans leur donner ombrage ; Henri, de son côté, pour éviter de donner l'alerte, ne mit à la disposition du premier mouvement que des détachements des garnisons voisines de Paris, montant en tout, au plus, à quatre mille hommes. C'est avec l'appui de ces quatre mille hommes que les bourgeois de Paris, fatigués du joug de la Ligue, devaient parvenir à remettre au Roi une capitale de deux cent mille âmes, défendue par quinze mille hommes de troupes étrangères ou de bandes soldées. Mais ils avaient pour eux ce qui fait réussir les entreprises les plus extraordinaires, et en apparence les plus disproportionnées : le sentiment national surexcité et l'héroïsme civique qui en découle, la nécessité et la résolution de mourir ou de vaincre. Les conditions stipulées par les chefs de la conjuration bourgeoise et le Gouverneur, à savoir : un pardon général du Roi, sa protection et sauvegarde, et d'amples garanties pour la religion ayant été accordées et signées par Henri, le 20 mars, tout se prépara pour l'exécution. ... Dès le 19 mars, dans une réunion secrète qui eut lieu à l'Arsenal, Brissac, le prévôt des marchands, les colonels et capitaines, sur la foi desquels on pouvait compter, les membres du Parlement, Le Maistre, Molé, Damours, Du Vair, arrêtèrent d'une manière précise le plan et l'ordre que l'on suivrait pour l'occupation de Paris. Peu de jours auparavant, à l'instance des Seize, toutes les portes de Paris, hormis celles de Saint-Antoine et de Saint-Jacques, avaient été terrassées, gabionnées et fermées. On convint que la veille de l'exécution, Brissac et L'Huillier, sous prétexte de la faire murer et de n'avoir plus de surprise à craindre de ce côté, débarrasseraient la Porte-Neuve ; qu'au commencement de la nuit ils dégageraient la Porte Saint-Denis. On arrêta que la nuit de l'exécution, Brissac et L'Huillier se saisiraient avec des gens armés de la Porte-Neuve, Langlois de la porte Saint-Denis ; qu'ils y mettraient des corps de garde à leur discrétion et introduiraient les royaux dans la ville par ces deux endroits. Qu'en même temps, le capitaine Grossier, avec des bourgeois et les bateliers de la Seine, dont il disposait, ferait entrer du côté de l'Arsenal, les garnisons de Corbeil et de Melun, descendues par le cours de la rivière. Que les détachements royaux, aussitôt introduits par la Porte-Neuve et la Porte Saint-Denis, se joindraient à la garde bourgeoise, et occuperaient les deux côtés des remparts ; que de la Porte-Neuve on marcherait en toute bite sur la porte Saint-Honoré, occupée par Néret, et qu'on la déboucherait. Que les bandes unies des royaux et des bourgeois partiraient ensuite de la Porte-Neuve, de la porte Saint-Honoré, de la porte Saint-Denis, pour se porter dans l'intérieur de la ville. Que simultanément, d'autres corps de bourgeois, dans les divers quartiers, attaqueraient les lieux fortifiés, et en occuperaient le plus qu'ils pourraient. Le Roi, instruit de ce dessein, arrêta que l'exécution aurait lieu le mardi 22 mars, à la pointe du jour[19]... Nous connaissons maintenant le plan exact, et pour ainsi dire officiel, de cette grande journée dont le programme admettait forcément l'imprévu, mais dont le succès tenait précisément à ce qu'il subît le moins de changements possible, et que dans une exécution aussi compliquée, chaque partie concourût au tout sur le point et à l'heure convenus. Pour quiconque s'en rend compte, cet itinéraire simultané des forces intérieures et des forces extérieures convergeant les unes vers les autres, est frappé au bon coin stratégique, porte cette double empreinte de la grande connaissance des lieux et des hommes de la capitale qui distinguait naturellement les auteurs du complot, et de la divination des obstacles qui caractérise le génie tactique d'Henri. Ce plan d'occupation successive de Paris, avec la connivence d'une force intérieure, est un chef-d'œuvre de prévoyance et d'habileté, et le succès inouï de l'événement justifie notre appréciation. Le Roi partit de Senlis le soir du 21 mars avec un corps de cavalerie, sous prétexte de marcher au-devant des Espagnols, sortis de leurs cantonnements de Beauvais. Il arriva à Saint-Denis à minuit, y trouva rassemblés les divers détachements des garnisons voisines qui devaient prêter main-forte à l'œuvre de délivrance et prendre possession, à mesure, des postes livrés par les bourgeois affidés. Il donna aux chefs les dernières instructions, prohiba, sous peine de mort, tout acte de violence ou de pillage, et prit quelques heures de repos. Ses partisans, cette nuit-là, ne dormirent pas. Les colonels et les capitaines de quartier passèrent la nuit sous les armes, et les firent prendre à tous les bourgeois de bonne volonté, sans découvrir toutefois prématurément leur dessein. Il faut, dans toutes les grandes affaires, ménager la part des entraînements généreux, des adhésions en masse ; mais il se faut garder de la confiance, donner le moins possible au hasard, à la crainte, à la délation, et pour cela réserver à un petit nombre le secret et l'action. Si la reddition de Paris réussit, c'est surtout parce que le but final ne fut connu que de quelques-uns, qui gardèrent jusqu'au bout la direction du mouvement et l'usage des fils principaux de cet immense trame. Brissac, avec une finesse de Normand et un sang-froid de Gascon, se débarrassa d'un capitaine espagnol, le plus gênant de tous, Jacques Ferrarois, qu'il détourna sur la fausse piste d'un prétendu convoi d'argent, dirigé, disait-il, par le Roi de Palaiseau sur Saint-Denis. Le Gouverneur de Paris triompha avec le même bonheur des soupçons du duc de Feria et de M. d'Ibarra. Ceux-ci, inquiétés par un avis de trahison, l'obligèrent à faire le long des murailles une ronde nocturne, sous la conduite d'officiers espagnols qui avaient ordre de le tuer s'ils voyaient quelque chose de suspect, et qui ne virent rien. Cette promenade désagréable eut lieu, sans incident, de minuit à deux heures. Brissac reconduisit ses gardes harassés au logis du duc de Feria, où tout le monde dormit bientôt sur les deux oreilles. La même sécurité ne tarda point à gagner le corps de garde des Seize, qui convaincus de la fausseté de l'alerte, rentrèrent dans leurs maisons. A trois heures, dans les divers quartiers, les bourgeois affiliés prirent les armes et filèrent furtivement dans la nuit silencieuse, se rendant discrètement et individuellement aux postes assignés. Le premier placé le fut en face du logis du duc de Feria, avec ordre de faire feu sur quiconque en sortirait. De là, le Gouverneur et Lhuillier, à la tête d'un gros de milice bourgeoise, se dirigèrent vers la Porte-Neuve qu'ils occupèrent, pendant que Langlois, de son côté, s'emparait de la porte Saint-Denis. Quatre heures du matin avaient sonné depuis peu, quand Langlois fit abaisser la bascule, alla reconnaître M. de Vitry, qui se présentait à la tête d'un détachement royal, lui livra la porte Saint-Denis, et selon l'ordre arrêté, occupa aussitôt avec lui les remparts. De leur côté, M. de Brissac et Lhuillier ouvrirent la Porte-Neuve à M. de Saint-Luc et aux soldats qu'il commandait ; et bientôt se précipitèrent sur leurs pas, à flots successifs, M. De Vic et quatre cents hommes de la garnison de Saint-Denis, M. d'Humières, M. de Belin, le capitaine Du Bolet et leurs détachements. A l'autre extrémité de la ville, dans le quartier Saint-Paul, le capitaine Grossier fit abaisser la chaîne qui barrait la rivière de l'Arsenal, au quartier de la Tournelle, et d'accord avec M. de la Chevalerie, qui était maître à l'Arsenal, il introduisit les garnisons de Corbeil et de Melun. Ainsi eut lieu, sans encombre et à l'heure fixée, l'entrée subreptice des troupes royales dans Paris. Mais ce n'était rien que d'entrer, il fallait pénétrer ; ce n'était rien que de prendre, il fallait garder. Grâce à l'accord parfait des diverses opérations concourant simultanément à étendre, — en en maintenant toutes les parties intactes et maillées entre elles, — le réseau de l'occupation, cette seconde phase de l'invasion ne fut pas moins heureuse que la première. Les trois grandes divisions de la capitale en 4594 : la Ville au nord, la Cité au centre, l'Université au midi, le tout divisé en seize quartiers, furent successivement abordées, enveloppées, pénétrées par les troupes royales et la milice bourgeoise se prêtant un mutuel appui. La Ville fut cernée dans trois directions, au nord, à l'orient, à l'occident, par cet envahissement régulier, méthodique, dont toutes les forces convergeaient vers un centre commun, pour de là passer à la conquête de la Cité et de l'Université. Une des glandes artères de la ville, la rue Saint-Denis, fut fortement occupée par M. de Vitry, à la tête du gros des troupes royales et de détachements considérables de milices bourgeoises, et forma une sorte de digue coupant, les uns des autres, les postes principaux de la garnison étrangère : les Espagnols postés près de la porte Saint-Denis et à la pointe Saint-Eustache, les Wallons établis au Temple. Privés de communication et effrayés par ce flot montant de troupes et de bourgeois armés, les étrangers n'osèrent bouger, et se tinrent coi dans leurs corps de garde, attendant les événements avec le flegme castillan, proche parent du fatalisme musulman. C'est donc sans coup férir que la rue Saint-Denis fut employée à la fois à former, d'un côté, barrière aux mouvements de la garnison étrangère, et de l'autre, réservoir aux troupes chargées de répandre jusque dans les plus petits canaux cette circulation irrésistible du flot royaliste. Quand Vitry arriva au Grand-Châtelet, il s'y rencontra avec les garnisons de Corbeil et de Melun, parties du quartier de Saint-Paul ; elles s'étaient, de concert avec les bourgeois, rendues maîtresses de toute la partie de la ville riveraine de la Seine, depuis l'Arsenal jusqu'au Châtelet. Une autre division des royaux occupait déjà cette forteresse. L'invasion et l'occupation progressive de la Cité et du Palais eurent lieu d'après les mêmes principes, et sans autre incident que quelques rares et vains épisodes de résistance. Nous revenons à la partie de l'invasion qui débouchait par la Porte-Neuve, à l'occident de la ville, parce que c'est là que nous allons retrouver le Roi. Le premier corps, commandé par Saint-Luc, poussa ses éclaireurs jusqu'au carrefour de la Croix-du-Trahoir, vers le milieu de la rue Saint-Honoré. D'Humières, du Rolet, de Belin, le prisonnier d'Arques, le gouverneur révoqué par Mayenne, devenu un des plus dévoués serviteurs d'Henri IV, avaient ordre, avec une deuxième division, de marcher vers le pont Saint-Michel et de l'occuper, pour couper toute communication entre les Napolitains établis au faubourg Saint-Germain et les Espagnols et Wallons qui avaient leurs quartiers au delà de la Seine, surtout pour séparer l'Université de la ville et faciliter l'invasion de la dernière, réduite à ses seules forces. Cette division ne rencontra pas de résistance sérieuse : quarante ligueurs à peine, qui prirent la fuite, après une première et unique décharge de leurs armes. Le troisième corps, conduit par le maréchal de Matignon et M. de Bellegarde, et chargé d'occuper les bords de la Seine, depuis les Tuileries jusqu'au Pont-au-Change, se trouva à peine arrêté un moment par un poste de lansquenets qui fut taillé en pièces, et dont les survivants furent jetés dans la rivière. Le Louvre, la place Saint-Germain-l'Auxerrois, le Grand-Châtelet furent successivement occupés, et les trois divisions, solidement reliées entre elles, se prêtèrent un mutuel appui. La quatrième division, commandée par le duc de Retz obéit à ses instructions, qui étaient de fortifier la prise de possession et d'envahir toute la rue Saint-Martin. Deux corps de troupes, l'un dirigé par M. d'O, l'autre par le roi, réalisèrent leur plan, qui consistait à étendre l'occupation dans la ligne suivie par M. de Saint-Luc. Henri marchait derrière d'O, qui lui était suspect, pour le soutenir et le surveiller au besoin. Mais celui-ci, et c'était là un heureux augure, trouva plus avantageux d'être fidèle que de trahir. Il s'avança vers la porte Saint-Honoré, où l'échevin Néret l'attendait avec sa famille et un gros de bourgeois dévoués. La porte fut débouchée, fortifiée ; les canons, tournés du côté de la ville, menacèrent en enfilade les grandes artères qui leur faisaient face, prêts à y vomir la foudre, en cas de rébellion. Henri, à la tête du corps dont il s'était réservé la direction, traversa le pont-levis de la Porte-Neuve, entre cinq et six heures du matin, suivi d'une troupe de gentilshommes et d'hommes d'armes, avec le corselet et la rondache. Le gouverneur Brissac, le prévôt des marchands L'Huillier, l'échevin Langlois, une partie du corps de ville et plusieurs compagnies bourgeoises s'avancèrent au-devant de Henri, lui souhaitant une patriotique et loyale bienvenue. Le roi reçut ces témoignages de soumission avec une joviale affabilité et un mâle attendrissement. Il accepta l'écharpe brodée que lui présentait le eu veilleur de Paris, en signe d'hommage ; puis il détacha son écharpe blanche et la passa au col de M. de Brissac en le saluant du titre de maréchal de France : premier à-compte payé sur le marché conclu, en un temps où les mœurs comportaient peu le désintéressement. Il accueillit avec des marques d'estime particulière le prévôt des marchands dont la fidélité fière ne lui coûtait rien. Aussi, quand le duc de Brissac lui ayant pompeusement déclaré qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, fut interrompu par cette mordante observation du prévôt, qu'il ne fallait pas le lui vendre, Henri ne put-il s'empêcher de sourire. M. de Brissac se mordit les lèvres. Le prévôt ayant alors présenté, sur un plat d'or, les clefs de la capitale au roi, celui-ci, gracieusement, les refusa, trouvant avec raison qu'elles ne pouvaient être en plus sûres et plus pures mains. Ainsi chacun avait reçu sa récompense, le gouverneur payé avec des honneurs, et le rude bourgeois payé avec de l'honneur. Ces préliminaires solennels étant accomplis, le cortège royal se remit en marche triomphalement. Chacun remarquait que Henri IV entrait par la porte qui avait servi à Henri III pour sortir de cette capitale rebelle, enfin délivrée de la tyrannie des factions par le retour de la royauté légitime ; et ce contraste frappait surtout puissamment l'imagination populaire. Henri et sa troupe, ou plutôt son cortège, car cette entrée, saluée par de perpétuelles acclamations, n'avait rien de militaire que les armes inutiles de ses soldats, remontèrent de la Porte-Neuve à la porte Saint-Honoré, parcoururent la rue Saint-Honoré et les rues qui en forment la continuation, jusqu'aux Innocents et au pont Notre-Dame. Là, le roi se trouva, — grâce à la ponctuelle exécution d'un plan admirablement conçu et partout secondé, bien loin de rencontrer la moindre entrave, par l'élan populaire, et l'accession des troupes bourgeoises, — entouré de toutes les têtes die colonne de ses six corps d'invasion qui refluaient vers le rendez-vous heureusement choisi au lieu d'actions de grâces. Il n'y avait plus, en effet, qu'à rendre grâces à Dieu, qui tient le cœur des peuples dans sa main et le change à son gré, du succès de cette invasion, pour ainsi dire, triomphale de Paris, de cette occupation, presque sans coup férir, de toutes ses artères principales, les rues Saint-Honoré, Saint-Denis, Saint-Martin et les quais, et de toutes ses positions stratégiques, les places, les carrefours, les avenues des ponts. L'œuvre était déjà assez avancée pour qu'il n'y eût point témérité de confiance, mais empressement de reconnaissance seulement à remercier Dieu d'un succès, qui, en admettant sur certains points, une résistance isolée, partielle, désespérée, ne pouvait plus faire doute pour personne. Henri, arrivé au pont Notre-Dame, suivi de cinq ou six cents hommes qui traînaient leurs piques en signe de victoire volontaire, c'est-à-dire provenant de la volonté même de ceux qui se soumettaient et rendaient ainsi le combat inutile, se dirigea aussitôt vers la cathédrale, où des cris, redoublés avec allégresse, de Vive le roi ! saluèrent son apparition. Il en fut touché, et dit, avec une paternelle commisération — : Je vois bien que ce pauvre peuple a été tyrannisé. Quand il eut mis pied à terre pour entrer dans l'église, le difficile fut de le faire sans encombre ou du moins sans embarras. La foule se pressait autour de lui avec une curiosité et une affection indiscrètes, mais par là même plus flatteuses que tous les faux hommages des cours. Comme ses officiers s'efforçaient de maîtriser cet élan et le contenaient un peu brusquement, à coups de manche de hallebarde et de crosses d'arquebuse, afin de faire faire place au roi, qu'on serrait de si près, qu'il était comme porté par la foule, Henri lui-même arrêta en souriant ce zèle intempestif. Il ne lui déplaisait pas de se sentir sacré une seconde fois par l'embrassement populaire, et d'être porté vers le temple sur les épaules d'une multitude avide de réparer le passé. — Laissez, laissez faire, dit-il à ses capitaines des gardes ; il vaut mieux que j'aye quelque peine et qu'ils aient tout leur plaisir. Ne voyez-vous pas qu'ils sons affamés de voir un roi ? Il entra dans la cathédrale au son grave des orgues alternant avec le bruit des cymbales et des trompettes, parfois couverts tous deux par le tonnerre des acclamations populaires. La messe solennelle ouïe, le Te Deum chanté, sa fidélité à sa foi nouvelle solennellement attestée par l'humble baiser donné, sur le seuil de l'église métropolitaine, à l'image du Christ que lui présentait l'archidiacre Dreux, Henri, libre de ses devoirs religieux, songea à ses devoirs politiques. 11 allait achever par la clémence la conquête de ce peuple déjà gagné par sa familiarité et sa piété. Pendant qu'il entendait la messe à la basilique de Notre-Dame, le gouverneur, le prévôt des marchands, les échevins, suivis de compagnies de la garde bourgeoise et des notables qu'ils rencontraient sur leur passage, répandaient jusque dans les quartiers les plus éloignés la bonne nouvelle de l'entrée du roi, et la déclaration, datée de Senlis, par laquelle il accordait aux Parisiens, sans en excepter les Seize, le plus magnanime pardon, la plus entière amnistie. Partout les cris de : Vire le roi ! vive la paix ! répondaient à ces nouvelles, que le cortège, grossi de nouveaux adhérents, allait semer ailleurs avec leur électrique effet de joie et d'espérance. Une double, mais passagère dissonance troubla cependant cet admirable concert. Dans la partie la plus turbulente de la capitale, dans ce quartier de l'Université où ont toujours bouillonné et fermenté volontiers les effervescences révolutionnaires, les étrangers et les Seize essayèrent un suprême effort en s'emparant de deux des portes de Paris, qui étaient alors de véritables citadelles. Les Napolitains, au nombre de douze cents, se saisirent de la porte Bussy, et leur chef, le colonel Alexandre del Monte, se disposa à y résister. Les Seize, soutenus par les bandits enrégimentés appelés Minotiers[20] et qui ne voulaient pas abdiquer sans un suprême crime leur odieuse tyrannie, s'attroupèrent autour de la porte Saint-Jacques. Deux autres bandes d'insurgés, l'une commandée par Crucé, l'autre par Hamilton, curé de Saint Côme, se disposaient à leur prêter main-forte. Le mouvement fut vite étouffé sous les démonstrations contraires, énergiquement conduites par les conseillers du Parlement ou de la cour des comptes du Vair, Damours, Marillac, Boucher-d'Orçay. Les rebelles furent refoulés, dissipés ; et les Napolitains reçurent, sans trop s'en plaindre, l'ordre de se tenir coi, accompagné de l'avis de la généreuse capitulation accordée au duc de Feria. Cette faveur inespérée et imméritée leur permettait de sortir sains et saufs d'une ville qui devait être le tombeau de toute la garnison espagnole. Les rancunes et les fureurs populaires n'eussent fait qu'une bouchée de ces prétoriens de la tyrannie étrangère. Mais loin de céder à cette soif de représailles, Henri la modéra, la calma, la remplaça par la vengeance plus noble d'un dédaigneux congé. Henri était si heureux de se retrouver au Louvre, dans des conditions si différentes de celles où il l'avait quitté, qu'il voulut qu'aucun nuage, surtout un nuage de sang, ne troublât la sérénité de ce retour, dont le miracle le remplissait d'un enivrement qu'il ne dissimulait pas. En même temps, d'ailleurs, qu'il cédait volontiers à une inspiration de générosité et de clémence qui lui était familière ; en même temps qu'il trouvait, une fois de plus, ces grandes pensées qui viennent du cœur, et avaient dans le sien une intarissable source, le roi faisait acte d'habileté militaire et de prévoyance politique. Il épargnait ses soldats en épargnant l'ennemi ; en le congédiant avec une indulgence inouïe, il posait peut-être, dans la reconnaissance d'un procédé si inattendu, les préliminaires de cette paix générale qu'il désirait tant, mais que l'implacable Philippe II devait lui faire encore tant attendre. Si le roi d'Espagne ne sut aucun gré à Henri de cette clémence humiliante, ceux qui en étaient l'objet s'en montrèrent cependant, il faut le reconnaître, fort touchés, et n'hésitèrent pas à admirer un vainqueur qui se vengeait si bénignement. Henri leur avait enjoint, en effet, de se tenir dans leurs quartiers, pour sortir de la ville dans le jour, sous l'unique promesse de ne plus porter les armes contre lui dans la guerre de France. Le duc de Feria et don Diego d'Ibarra jurèrent avec enthousiasme, fort heureux d'en être quittes à si bon marché. A midi, le roi put dîner tranquillement, assuré, par les rapports qui lui arrivaient de tous côtés, que la cité, à peine troublée par quelques bruits de sédition et de guerre, était entièrement joyeuse et tranquille comme un jour de fête. A trois heures, la garnison espagnole à laquelle Philippe Il avait commis, depuis 1591, la garde de sa bonne ville de Paris, évacuait la capitale et prenait le chemin des Pays-Bas. Le roi, qui avait gardé pour dîner son corseta et ses armes, en cas d'alerte, les quitta et alla à la porte Saint-Denis, d'où il assista, entouré des principaux de sa cour, assis devant la fenêtre à balustre ou balcon établi sur le fronton, à la retraite et sortie de Paris des troupes étrangères. Ce défilé était dirigé par MM. de Saint-Luc et de
Salagnac, chargés de faire la conduite à ces maîtres déchus de la capitale
délivrée. Ils étaient bien trois mille armés de pied en cap, dit l'Estoile, et passèrent tous devant le roy, qu'ils saluèrent et
s'inclinèrent profondément, le chapeau à la main, marchant en bon ordre,
quatre à quatre, les Néapolitains les premiers, puis les Espagnols après, le
duc de Feria, don Diego d'Ibarra et Jean-Baptiste Taxis, bien montés sur
beaux genets d'Espagne, avec leurs domestiques, gens de suite et livrée. Le duc de Feria, ajoute le même chroniqueur, salua le roi à l'espagnole, comme on dist, c'est-à-dire gravement et meigrement. Le roi répondit à ce salut avec une expression d'ironique satisfaction, et autour de lui on ouït ces paroles, qui allèrent à leur adresse, mais que firent semblant de ne pas entendre les implacables adversaires dont elles punissaient bien légèrement les attentats : — Allez, messieurs, et me recommandez à vostre maistre. Allez-vous-en, d la bonne heure, mais n'y revenez plus. Puis le duc de Feria passé sous ce compliment goguenard, Henri ne se pouvait empêcher de gouailler cette froide et grise mine du machiavélique Castillan et son salut écourté ; dequoi le roy se mocqua et luy ostant à moictié son chapeau, le contrefaisoit après fort plaisamment. L'Estoile ajoute quelques détails qui ont leur couleur : Une femme d'un Hespagnol passant avec les troupes, pria qu'on lui monstrast le Roy, disant tout hault que la France estoit heureuse d'avoir un si grand Roy, si bon, si doux et si clément, lequel leur avoit pardonné à tous. Et que s'ils l'eussent tenu comme il les tenoit, qu'ils n'eussent eu garde de lui en faire autant. Après qu'on luy eust monstré le Roy : Je le vois, dist-elle, et le regardant, commença de luy crier tout haut : Je prie à Dieu, bon Roy, que Dieu te doint toute prospérité ! Et de moi estant en mon pais et quelque part que je sois, je te bénirai tousjours, et célébrerai ta grandeur, ta bonté et ta clémence. Les Néapolitains aussi s'en allans, disoient : Vous avez aujhourdhui un bon Roy, au lieu d'un prince très-meschant que vous aviés. Le roi, dès son arrivée au Louvre, avait envoyé M. de Saint-Luc fournir des gardes, dans l'intérêt de leur sécurité, au légat du pape et à l'archevêque Pellevé, et donner à mesdames de Montpensier et de Nemours, le bonjour et les asseurer qu'il ne seroit fait tort aucun à leurs personnes, biens et maisons ; lesquelles il avoit pris et prenoit en sa protection et sauvegarde. Lesquelles, bien que déconfortées, en remercièrent bien humblement Sa Majesté, et en dirent un grand merci, bien bas. Madame de Montpensier, la sinistre héroïne de la Ligue, celle qui montrait naguère les ciseaux d'or, avec lesquels elle se flattait de tailler, sur la tête d'Henri III, la tonsure du cloître, celle qui avait armé le bras de Jacques Clément, celle qui eut volontiers, déclarait-elle, percé le cœur d'Henri IV, prit d'abord les choses moins philosophiquement que son triomphant et clément adversaire. Dans l'exaltation de son désespoir, maudissant M. de Brissac, qui lui avait joué le vilain tour d'introduire le roi dans Paris, elle ne parlait de rien moins que de se frapper elle-même de son poignard désormais inutile. Tout ce beau feu de fanfaronne colère tomba devant l'impression de la réalité, et surtout devant les gracieuses avances d'Henri IV, qui n'hésita point, en venant voir.sa cousine, à lui témoigner une confiance dont elle sentit encore plus la générosité que l'ironie. Aussi, le surlendemain, jeudi 24 mars au soir, elle faisait assez gaiement sa partie de cartes avec celui qu'elle avait si longtemps exécré, et qu'elle était bien obligée de trouver aimable. L'Estoile a raconté cette entrevue caractéristique. Ce jour, le Roy vinst voir madame de Nemoux, avec laquelle madame de Montpensier estoit. Il leur demanda, entre autres propos, si elles estoient point bien estonnées de le voir à Paris ; et encore plus, de ce qu'on n'y avoit volé ni pillé personne, ni fait tort à homme du monde de la valeur d'un festu, voire jusques à la racaille des goujats (valets d'armée) qui avoient pavé tout ce qu'ils avoient pris. Et se tournant vers madame de Montpensier, lui dit : Que dites-vous de cela, ma cousine ? — Sire, lui répondit-elle, nous n'en pouvons dire autre chose, sinon que vous estes un très-grand Roy, très-bening, très-clément et très-généreux. A quoi le Roy, se soubsriant lui dit : Je ne sçai si je dois croire que vous parliés comme vous pensés. Une chose sçai-je bien, c'est que vous voulés bien du mal à Brissac ; est-il pas vrai ? — Non, sire, dit-elle ; pourquoi lui en voudrois-je ? — Si faites, si faites, respondit le Roy ; je le sçai trop bien. Mais quelque jour que vous n'aurés que faire, vous ferés vostre paix. — Sire, dit elle, elle est toute faite, puisqu'il vous plaist. Une chose eussai-je seulement désirée en la réduction de vostre ville de Paris : c'est que M. de Maienne, mon frère, vous eust abaissé le pont pour y entrer. — Ventre Saint-Gris, respondit le Roy, il m'eust fait possible attendre longtemps ; je n'y fusse pas arrivé si matin. Le même jour, Henri exprima une réflexion plus grave, et qui servira dignement de conclusion à cette histoire vraiment miraculeuse de la prise de possession d'une capitale de deux cent mille habitants, défendue ou plutôt opprimée par une garnison de cinq mille soldats étrangers et une troupe auxiliaire de dix mille partisans enrégimentés de leur domination, occupée par une troupe de quatre mille hommes, sans autre tentative de résistance que celle du poste de cinquante lansquenets tués ou jetés à l'eau sur le quai de l'École, sans avoir coûté la vie à plus de quatre insurgés français, deux dans la rue Saint-Denis et deux autres dans la Cité, enfin sans dommage pour aucun de ses sujets même les plus coupables, et presque sans interruption du travail de la population laborieuse. Un si prodigieux résultat attestait le doigt de Dieu. II émerveille encore la postérité ; il devait faire l'admiration des contemporains, et arracher à Henri IV maint témoignage de soumission et de reconnaissance envers cette Providence qui avait tout fait. Aussi L'Estoile a-t-il enregistré l'anecdote suivante : Le jour mesme Sa Majesté entrant au Louvre, dit à M. le chancelier : Monsieur le chancelier, dois-je croire, à vostre avis, que je sois là où je suis ? — Sire, lui répondit-il, je croi que vous n'en doutés point. — Je ne sçay, dit le Roy, car tant plus j'y pense, et plus je m'en estonne. Car je trouve qu'il n'y a rien de l'homme en tout ceci : C'est une œuvre de Dieu extraordinaire, voire des plus grandes. Et à la vérité, c'est chose fort miraculeuse de dire qu'une telle entreprise, esvantée comme elle estoit, et sceue de tant de personnes, voire longtemps auparavant, ait peu réussir à la fin : car le secret est une chose rare et peu usitée entre ceux de notre nation. Hâtons-nous de dire, pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César, que l'incontestable intervention de la volonté divine ne diminue pas le mérite d'Henri IV ; car elle lui laissait encore assez à faire. L'œuvre de la régénération et de la pacification française n'était que commencée. Henri devait attendre encore six ans avant de pouvoir l'achever et mettre le couronnement à ce laborieux édifice qui allait encore essuyer plus d'un assaut. Mais il était de ceux qui ne s'arrêtent pas avant d'avoir fini, de ceux pour lesquels il a été dit : Aide-toi, le ciel t'aidera ; et, comme nous allons le voir, il n'allait pas déployer moins de grandes qualités et acquérir moins de gloire à achever l'œuvre qu'à la commencer. |