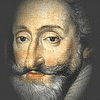HENRI IV
LIVRE PREMIER. — LE ROI DE NAVARRE - 1553-1585
CHAPITRE IV. — LE CHEVAL-LÉGER - 1577-1580.
|
Nous arrivons à cette intéressante, amusante, dramatique phase de sa vie où Henri, qui a tout à faire encore pour être un roi, dans le sens solennel et serein du mot, qui ne possède qu'un titre aussi vain que légitime, contesté partout ailleurs que dans le fidèle Béarn, mérite peu à peu, dans une lutte incessante et longtemps inégale, le dévouement de ses amis et le respect de ses ennemis. Nous l'y verrons sacrer du sang prodigué dans cent combats hasardeux, le prestige de sa souveraineté précaire, ne manquer jamais l'occasion d'un beau coup d'épée, d'une bonne action ou d'un bon mot, et à travers les fautes et les exploits d'une existence vagabonde, militante, chevaleresque, arriver à. triompher de la fortune et (le lui - même, des destins hostiles et des passions contraires, à conquérir enfin, avec leur admiration et leur amour, le droit de faire le bonheur de sujets si longtemps rebelles. Ce n'est pas, on le comprend, sans les vicissitudes les plus orageuses et les épreuves les plus variées qu'Henri parviendra à cette maturité précoce, à cette grandeur décisive ; que de héros de la chronique militaire ou romanesque, devenu un des plus grands hommes de l'histoire, il entrera, le front ceint des lauriers d'Arques et d'Ivry, dans la plénitude sereine de ses droits et de ses qualités ; enfin que sous l'arc de triomphe de Paris gagné avant d'être soumis, il remettra au fourreau l'épée ébréchée de son Iliade, pour monter sur un trône purifié et raffermi, le sceptre de justice et de paix à la main. Dans cette étude progressive de la métamorphose morale, de la palingénésie d'Henri, né avec le mélange de qualités et de défauts des hommes même les plus privilégiés de la nature, les plus prédestinés par Dieu à un rôle majeur, force nous est de le prendre aux débuts encore incertains et troublés de sa vie nouvelle, et de commencer par le commencement. Mais nous glisserons avec discrétion sur le matin frivole et le brûlant midi de cette existence exemplaire en tout, même dans la leçon de ses erreurs et de ses déviations, pour arriver vite à l'heure des nuages vaincus et de la pleine lumière. Nous ne ferons qu'indiquer ce moment de courte incertitude et de suprême effort où Henri semble encore hésiter sur la carrière à suivre et sur le guide qu'il choisira, de la Volupté ou de la Vertu. Le choix ne demeurera pas longtemps douteux, Bientôt les qualités l'emporteront sur les défauts, et les mâles conseils sur les pièges fallacieux d'Armide. Henri n'arrivera pas toutefois de prime saut, à la victoire définitive sur lui-même qui doit précéder ses autres triomphes ; mais ces passagères erreurs, que nous laisserons dans l'ombre, ne dureront que le temps d'attester l'effort qu'exige toute perfection, surtout chez un prince, exposé à plus d'occasions et de tentations dangereuses que le simple particulier, et de faire chérir davantage un homme à qui rien d'humain n'a été étranger. Ce n'est donc que par un scrupule d'historien et de moraliste que nous indiquerons, dans ce tableau des premières campagnes et des premières épreuves d'Henri, la place où, pour être complet, il faudrait raconter quelques-unes des erreurs et des fautes échappées à un prince d'un caractère impétueux, d'un tempérament ardent, qui ne se dompta point d'un coup, et n'entra point de plain-pied, mais en tâtonnant un peu et en trébuchant parfois, dans la grande voie de l'histoire. En 1577, un an après l'évasion si dramatique et si pittoresque que nous avons racontée, Henri n'était point encore complètement maitre de lui-même. Il ne le fut que peu à peu et non sans peine ; il s'exposa plus d'une fois aux reproches de ses catoniens amis, avant de ne mériter que leurs éloges. D'Aubigné, son censeur et son panégyriste en même temps, a exprimé ce contraste et ce regret dans une anecdote caractéristique dont la citation clora dignement cette introduction, en laissant deviner tout ce que nous ne dirons pas En l'an 1577, le roi ayant pris entre la forest de Thouvoie[1] et le parc, un grand cerf, qui, au lieu d'une des branches de sa teste, avoit son endouiller retroussé en la meulle[2] en forme d'un vase ; à l'autre rainure on pouvoit dire qu'il portoit dix-huict mal-semé. Il s'eschauffa longtemps à loûer cette teste, à la considérer, bien brunie, bien perlée, et à délibérer de l'envoyer iusques en Gascongne ; et puis en retournant au parc pour faire la curée, il me disoit que cette rencontre devoit entre en son histoire ; et me conviant à l'escrire, je lui respondis trop fièrement (comme non content des actions passées) : Sire, commencez de faire, et je commencerai d'escrire. C'est d'abord et surtout comme roi militaire, comme roi chevalier, comme roi général et plus souvent encore comme roi soldat que Henri, — qui n'avait pas peur du danger, qui n'en avait point même assez peur parfois, et le recherchait avec un élan téméraire, une furie française qu'il fut longtemps à contenir et à brider, qui d'ailleurs pauvre et peu accompagné, était obligé, faute de mieux, de payer de son exemple, de sa personne, en s'exposant comme ses amis et plus qu'eux au plus chaud de la mêlée, — que Henri disons-nous, commença à faire son histoire. C'est donc surtout des épisodes guerriers, des scènes de chevalerie et presque de chevalerie errante que nous allons avoir d'abord à raconter, d'après les confidences véridiques et parfois rudement sincères de témoins qui ont été acteurs, à la peine encore plus qu'à l'honneur, comme ce d'Aubigné qui se vante d'avoir été soldat cinquante-quatre ans ; capitaine, cinquante ; mestre de camp, quarante-quatre et maréschal de camp, trente-deux années ou comme ce Sully, compagnon de la mêlée avant d'être conseiller du trône, arrivé au pouvoir criblé de blessures, habitant pour palais un arsenal et plus volontiers vêtu du harnois de buffle et de fer du capitaine, que de l'habit de soie et de velours du courtisan. Ceux-là sont des témoins à écouter et à croire ; car ils parlent de ce qu'ils ont vu, aux plus chaudes places, et ce n'est pas leur faute si héros seulement, non martyrs de leur cause, ils ne se sont point fait tuer, ayant plus d'une fois, pour le service de leur dévouement, vu la mort de près. Henri était né intrépide et sa valeur, comme celle de Rodrigue. n'avait pas attendu pour se montrer, le nombre des années. C'est à Pau qu'il fit son premier acte de bravoure, à peine
avait-t-il quatre ans. Le P. Mathieu rapporte qu'il tua un gros serpent. Cet historiographe a célébré aussi en vers cette précoce
témérité : Né pour le bien du monde, en sa première
enfance, Il fit voir qu'il seroit l'Hercule de la
France, Et qu'il relèveroit la gloire de ses fleurs ; A quatre ans s'égayant dans les champs, tête
nue, Il rencontre un serpent, il l'attaque et le
tue ; Il dompte à quarante ans, l'hydre de nos malheurs... Lorsqu'il eut atteint sa quatorzième année, il se lança dans la carrière des combats. Un envoyé de Catherine de Médicis s'étonnait de le voir si jeune prendre parti dans les guerres de religion. Il est visible, répondit le jeune prince de Béarn, que sous le prétexte de rébellion qu'on impute faussement à mon oncle et aux non-catholiques, nos ennemis se proposent d'exterminer toute la race des Bourbons. Nous voulons mourir tous ensemble, afin d'éviter les frais du deuil que nous aurions à porter les uns des autres[3]. Il était plus jeune encore, quand enflammé de cette noble ambition et de cette soif de gloire qui le faisait rêver la nuit, sur sa couche hantée d'ombres illustres et favorites, de Camille ou de Bayard, il trahissait aux soupçons inquiets de Catherine de Médicis la fièvre précoce d'action et d'émulation qui dévorait son âme, et confessait, à tout risque, l'esprit de principauté qui était en lui. Son précepteur, le sieur de la Gaucherie, loin de le faire pâlir sur les rudiments, lui avait appris le grec et le latin par voie de conversation d'exemples, en discourant avec lui dans ces langues (comme il le faisait pour le français) et en gravant dans la cire molle de cette imagination et de cette énergie précoces des sentences choisies, que son élève ne devait jamais oublier. Il les lui faisait apprendre et dire par cœur, sans les écrire ni les lire, dit Palma Cayet, un moment sous-précepteur du prince, et les lui inculquait dans l'esprit par fréquente récitation, en fortifiant et vivifiant cette impression par des commentaires appropriés au sujet et au caractère d'un tel élève. Entre autres, il le retint fort longtemps sur une sentence trop justifiée par les malheurs et les fautes du temps, et dont la traduction est : Il faut chasser la sédition de la ville, etc. Henri enfant répétait ces maximes de la sagesse et de l'héroïsme antiques, d'un tel ton, d'un tel air que son père avait mis en lui une confiance bien supérieure à son âge, et le considérait comme capable de le seconder bientôt dans ses entreprises quelque peu aventureuses, et même de le venger s'il succombait à quelque trahison. Au moment où François II fit arrêter le prince de Condé et se disposait à lui faire faire son procès, on donna avis au roi de Navarre que les ennemis de la maison de Bourbon pourraient bien saisir cette occasion de se débarrasser à la fois, de droit ou de fait, de toute cette famille si importune à la jalousie des Valois, et de faire périr, en guet-apens militaire ou autre, ceux de ses membres qui échappaient à la juridiction des juges, si complaisants qu'ils fussent, par l'absence de toute incrimination possible. Antoine, qui avait ses raisons pour se méfier, et que les horribles représailles de la conjuration d'Amboise exécutées sous ses yeux, — jusqu'à rassasier la haine la plus altérée de sang et à lasser les plus robustes bourreaux, — ne disposaient pas à l'illusion, dressa l'oreille à ces propos et prit en conséquence des mesures qui peignent bien l'homme et le temps, mais surtout font honneur à l'opinion qu'il avait conçue de son fils. Le roi de Navarre, qui, malgré le jeune âge de son fils, voyait déjà en lui un caractère propre à ne pas laisser impuni le meurtre de son père ayant receu cet advis, il dit à Cotin, qui, depuis la mort du roi Henri d'Albret, le servoit d'homme de chambre, car il estoit un des anciens serviteurs domestiques de la maison de Navarre : Cotin, si l'on me tue de sang-froid, ainsi que j'ay eu advis que mes ennemis ont résolu de le faire, je t'en charge qu'estant tué, tu trouves moyen d'avoir ma chemise avec mon sang, et que tu la monstre à mon fils. Ce prince — ajoute le chroniqueur du temps — préjugeoit dès lors la valeur et le courage de son fils, pour ne laisser un tel acte sans vengeance. C'est peu de temps après la perte de son père blessé au siège de Rouen (1562) d'une harquebuzade par l'espaule et mort fort catholiquement et chrestiennement à Andelys dans quelques jours après sa blessure, ayant de grands regrets de laisser le royaume de France en tels troubles, et ses enfants si petits et en bas aâge comme ils estoient que Henri de Navarre eut occasion de faire usage, avec un succès dont le danger ne l'effraya point, d'un de ses axiomes favoris. Le prince de Navarre avoit alors neuf ans, et cependant il estoit eslevé près le roy Charles IX et monstroit en son jeune aâge d'enfance une grande dextérité d'esprit... De toutes les sentences qu'il a apprises, il n'en a affecté pas une tout comme celle qui dit : plut vincere, aut mort (vaincre ou mourir) de laquelle il usa en une blanque (loterie) qui fut ouverte l'an 1565 et 1564, dans le cloistre de Saint-Germain de l'Auxerrois, là où par plusieurs fois ce billet fut leu, et emporta plusieurs bénéfices. La rogne-mère, Catherine de Médicis, vouloit sçavoir de lui-mesmes que c'estoit à dire, ce qu'elle ne put jamais obtenir de luy, et ne voulut s'expliquer, quoy qu'il ne Fust lors qu'un enfant. Néantmoins, elle en sçavoit bien le sens, car elle estoit trop bien assistée ; mais elle défendit de luy en apprendre plus de telles, disant que c'estoit pour le rendre opiniastre. Et dans l'intimité, exhalant sa mauvaise humeur en quelques sarcasmes menaçants, Catherine disait du jeune Béarnais : Ce petit moricaud n'est que guerre et que tempête en son cerveau. Durant tout le grand voyage que le roi Charles fit autour
de son royaume en 1564 et 1565 le prince de Navarre l'accompagna, et se monstra courageux à se
représenter au rang qui lui appartenoit en toute révérence, si bien qu'on ne
le pou-voit vaincre d'honnesteté n'y emporter de bravade, prévoyant toujours
le but des actions ; et surtout estant en ses terres durant ce grand voyage,
il se fit admirer des Français et redouter des Espagnols dez son bas aàge, si
bien qu'a Bayonne le duc de Medina de Rio-Seco le voyant si gaillard, dit en
espagnol ce qui signifioit : Il m'est avis que ce prince est empereur ou
doit l'être. Toute la jeunesse d'Henri, toutes les saillies de son esprit primesautier, tous les élans de cette générosité ardente qu'une raison précoce avait peine à contenir tendaient à justifier l'horoscope de l'homme d'État espagnol. En 1568, de nouveaux troubles ayant éclaté à l'occasion ou sous le prétexte de la religion, et la reine Jeanne, ainsi que son fils, ayant été obligés de se soustraire au projet que le maréchal de Montluc, par ordre du roi Charles IX, avait de les faire prisonniers pour les mener à Paris, elle fit déclarer le prince protecteur de la foi protestante, et il commença à quinze ans son apprentissage de généralissime dans une de ces luttes acharnées et désespérées, où on combat moins pour la gloire que pour le salut. Tel est le caractère de cette campagne désastreuse que signalent les deux dates sanglantes de Jarnac et de Moncontour. C'est en prévision des épreuves qu'allait subir son parti que Jeanne d'Albret avait dicté à chacun sa conduite dans la fière devise gravée sur les médailles à l'effigie de son fils et à la sienne, qu'elle fit frapper et distribuer à la Rochelle aux principaux chefs huguenots : Pax certa, victoria integra, mors honesta, c'est-à-dire : Paix certaine, victoire complète ou mort glorieuse. Henri de Navarre se montra de ceux qu'une telle alternative étonnait le moins, et, au milieu des capitaines blanchis sous le harnois, qui se consultaient incertains sur le meilleur parti à prendre, il parla en prince qui a fait son choix. Le Prince avoit esté nourry dès le berceau à la peine ; depuis la
mort de son père, il avoit receu plusieurs afflictions domestiques, et
maintenant le voicy comme à l'eschole, sous la conduite
de deux grands chefs d'armées, tels qu'estoient M. le Prince de Condé, son
oncle, et l'Admirai de Chastillon, afin d'estre instruit à.la guerre ; le
Prince de Navarre estoit jeune, mais il avoit beaucoup de
valeur, accompagnée de naifveté d'esprit et d'un bon jugement ; à tel point,
qu'aux endroits où il se trouva durant ces troisièmes
troubles, si ce qu'il dit aux plus vieux capitaines de l'armée eust été
suivy, les événements n'eussent été tels qu'ils furent depuis, ny ceux de son
parti n'eussent receu tant de pertes et de ruines comme ils receurent alors. Partout Henri se montra animé de ce feu de la guerre qui en trahit le génie. Il fit preuve d'un coup d'œil de général et d'une intrépidité de soldat. A Loudun, dans la première rencontre, voyant que le duc d'Anjou, qui conduisait l'armée royale, s'abstenait d'attaquer, il devina les motifs de cette réserve et proposa de profiter de l'occasion qui permettait d'imposer la bataille à un ennemi désireux de l'éviter. Si on eût écouté cet avis, il est probable que la victoire et sans doute la capture du prince eussent été la récompense de l'initiative hardie, mais heureuse, qu'il conseillait. A Jarnac, au contraire, non moins prudent ce jour-là qu'il s'était montré impatient naguère, il blâma le parti, pris à contre-sens, d'attaquer, au lieu de demeurer sur la défensive. Il disait : Quel moyen de combattre ? Nos troupes sont trop divisées et celles des ennemis sont jointes, et leur force est trop grande ; de combattre à ceste heure, c'est perdre des gens à crédit ; j'avois bien dit que nous nous amusions trop à voir jouer des comédies à Nyort, au lieu de faire assembler nos troupes, puisque l'ennemy amassoit les siennes. Aussi, ajoute le chroniqueur, ceste bataille fut perdüe, et M. le Prince de Condé y fut tué. A Moncontour, où il brûloit d'envie de jouer des mains, mais où on ne le lui permit pas il ne tint pas non plus à Henry, qui le désapprouva ouvertement, que l'Amiral, en corrigeant le plan de bataille défectueux auquel il s'obstina, gagnât la victoire, au lieu de la perdre. Le Prince de Navarre avait été placé à distance, sur une colline, d'où il voyait la bataille, sous la garde du comte Ludovic (de Nassau) et d'un corps de cavalerie. A un certain moment, le Prince de Navarre, voyant que l'Admiral, faisant, au commencement du combat, une charge de cavalerie contre l'avant-garde de Monseigneur le duc d'Anjou, l'avoit enfoncée, vouloit s'y mesler à toute force, et crioit : Donnons ! donnons ! mes amis, voilà le point de la victoire, ils branslent ! ce qui estoit vray, car si le comte Ludovic, au lieu de se tenir coy, voulant garder les dits sieurs princes (le fils du feu Prince de Condé était présent avec son cousin) eust fait une charge avec tout ce host, (toute celle troupe) qui estoit de quatre-mil chevaux, il eust merveilleusement esbranlé l'armée de Monseigneur, et eust certainement déterminé la victoire... Par ce que Henri de Navarre était à seize ans, on peut juger de ce qu'il fut à vingt-trois, quand, délivré des lisières de la cour, et enfin hors de pages, il put s'abandonner à toute la fougue de son tempérament, à toute la hardiesse de son esprit, à toute la bonté de son cœur, se préparer, par la guerre d'escarmouches, à la grande guerre, et apprendre à dominer dans les petits accidents, avant de la dominer dans les grandes occasions, la fortune contraire. Riche d'espérance plus que d'argent, de courage plus que de moyens, et d'ennemis plus que d'amis, Henri se gagna une armée avant de se conquérir un peuple, en payant sans compter de sa personne et de son cœur, en retenant, par le charme de ses qualités et même de ses défauts, les partisans que n'eussent pas toujours suffi à rendre fidèles les succès intermittents d'une cause longtemps précaire, et recherchée plutôt par les soldats avides d'aventures que par les courtisans avides de faveurs. Henri, qui pratiqua de bonne heure avec tant de succès l'art de séduire les gens, au point de leur faire oublier leurs intérêts les plus chers et jusqu'à leurs plus légitimes rancunes, devait cet art au sentiment élevé qu'il avait toujours eu de l'amitié, de la popularité, de la loyauté, à son habitude de rendre en monnaie d'or d'habiles éloges, de procédés délicats, de récompenses heureuses, ce qu'il exigeait comme dévouement. Il en fallait à ses amis pour tout sacrifier à ce roi toujours militant, chevauchant, négociant, qui pendant trente ans ne quitta point le harnois, qui n'eut jamais le temps d'écrire que le pied à l'étrier ces billets césariens qui lui ont fait tant d'amis et ont gagné jusqu'à la postérité par leur joli tour et leur preste allure. Pendant cette période de la jeunesse à la maturité, de 1577 à 1594, qui ne fut qu'une longue lutte, à peine coupée de quelques intermèdes de Décaméron, Henri ne mit guère que pour quelques nuits l'épée au fourreau ; il eut sept guerres à soutenir, il assista à quatre ou cinq batailles rangées, à plus de cent combats et à deux cents sièges de places. Dans mainte occasion, à Eause, à Cahors, à Nérac, à Fontaine-Française, à Aumale, il fut engagé au plus chaud de la mêlée, et n'acheta la vie qu'au prix de prodiges de courage et de maintes blessures, combattant, comme il le disait plus tard gaiement, moins pour sauver son royaume que pour sauver sa peau. Cette vie, miraculeusement dérobée aux dangers loyaux de la bataille, il lui fallut encore la disputer à la trahison et à l'assassinat mercenaire de plus de cinquante conspirations. On comprend qu'un tel homme eût rencontré peu de gens disposés à le servir, d'autant plus qu'il ne les payait guère, faute de le pouvoir, s'il n'eût été le meilleur des maîtres, donnant l'exemple de la pauvreté, de la sobriété, de la témérité, au point de fermer la bouche aux mécontents. Mais pouvait-il en être ou en demeurer, aux côtés de ce roi chevau-léger, qui s'exposait sans compter et louait sans marchander, trouvant moyen de se faire suivre là où tout autre fût resté seul, et de se faire adorer là où tout autre se fût fait haïr ? Le secret de ce prestige, de ce don : d'ensorcellement, de ces miracles de popularité, il est dans un seul mot : Henri était beaucoup aimé, parce qu'il aimait beaucoup. Il avait des amis fidèles, parce qu'il était lui-même le plus fidèle des amis. Il ne fut jamais abandonné des siens, même aux pires moments de la mauvaise fortune, parce qu'il n'abandonna jamais ceux qui s'étaient fiés en lui, et ne s'abandonna jamais lui-même. D'Aubigné, le rude et intraitable d'Aubigné, avouera tout à l'heure le charme qu'il subit comme tant d'autres et qui le retint, sans le dompter, derrière le panache blanc de ce prince toujours à cheval, toujours cuirasse au dos, et qui usa dans sa vie, il s'en vantait souvent, plus de bottes que de souliers. Pour comprendre cette fascination, il faut se reporter à ces épisodes de jeunesse qui montrent quelle tendresse cordiale, quelle noble ambition de bienfait, quelle émulation généreuse, quel besoin d'aimer et d'être aimé gonflaient, jusqu'à se résoudre en larmes de noble impatience, cette âme du Béarnais, avide de se donner à des amis dignes d'elle. Il était encore bien jeune, lorsqu'il éprouva le besoin d'épancher son cœur dans un cœur sincèrement dévoué. Son précepteur, La Gaucherie, le surprit un jour triste et rêveur. Il l'interrogea sur la cause de ses ennuis. Ce qui me désole, dit Henri, c'est d'avoir à Paris beaucoup de
connaissances et pas un ami ! Vous êtes le seul sur lequel je puisse
compter. Je sens le plus vif désir de rencontrer quelqu'un de mon âge et de
mon caractère, pour qui je n'aie rien à
cacher, avec qui je puisse partager mes plaisirs et mes peines, et qui agisse
de même à mon égard. Les exemples que vous m'avez si souvent cités de la
véritable amitié qui unissait Achille et Patrocle, Oreste et Pylade,
Alexandre et Éphestion, Scipion et Lélius, Auguste et Mécène, ont fait sur
moi une si vive impression, que je ne me croirai jamais parfaitement heureux
tant que je ne pourrai éprouver le même bonheur. La Gaucherie lui fit un tableau des faux amis, si nombreux dans les cours, où la véritable amitié est si rare et si difficile à trouver. Henri s'affligea de ces réflexions, dont il ne pouvait contester l'exactitude. Malgré tout ce que vous me dites, ajouta-t-il, cependant je crois
qu'il faut faire une exception pour deux jeunes gens, qui ont à peu près cinq
ou six ans de plus que moi, et qui me paraissent de vrais amis : je veux
parler de Ségur et de La Rochefoucauld. Je me suis rencontré plusieurs fois
avec eux, jamais ils n'ont eu de dispute ; leur plaisir le plus vif est
d'être ensemble. Ne pourrai-je étre admis dans leur charmante intimité ? La Gaucherie ne se hâta point d'autoriser cette liaison ; il s'assura que Ségur et La Rochefoucauld étaient dignes de son royal élève, et la joie d'Henri fut grande, lorsqu'il vit son amitié acceptée par ces deux jeunes seigneurs avec autant de cordialité qu'elle avait été offerte[4]. Un homme qui appréciait ainsi l'amitié, qui était, suivant le mot de Montesquieu, amoureux de l'amitié, méritait d'avoir des amis, et il en eut comme s'il n'eût pas été roi, ne négligeant rien pour les acquérir ni pour les cultiver. Les Mémoires de d'Aubigné et de Sully sont pleins, sur cette fraternité des armes, sur cette facilité d'abord, sur cette affabilité d'accueil, sur ce don de sympathie, sur cette sollicitude joviale, sur cette bonté familière d'Henri pour ses compagnons, de détails piquants, charmants et touchants. On ne peut ouvrir le Recueil des Lettres d'Henri IV sans se heurter à quelque cordial billet de lui, plein de ces expressions d'intérêt qui, suivant la circonstance, font naître dans l'esprit du lecteur, comme ils la provoquaient dans l'esprit du destinataire, cette émotion profonde, cette chaleur de zèle et de dévouement dont un sourire ou une larme sont tour à tour le signe. Henri était d'humeur attrayante et sémillante ; il aimait à se faire petit avec les petits et à les entretenir dans le langage à leur portée. Il se plaisait à dépouiller le roi, pour ne laisser voir que l'homme. De là l'amour de ses peuples et l'affection de ses serviteurs. Voici, à ce propos, deux anecdotes caractéristiques : Le duc d'Anjou, pendant le séjour qu'il fit à Nérac après la paix de Fleix, étant sorti pour aller parcourir les promenades qui ornent la ville, rentre fort mécontent de n'avoir été salué par personne, et se plaint amèrement à son beau-frère de cette incivilité, qui était si contraire à tout le bien qu'il lui avait dit de ses sujets. — Je ne conçois rien à cela, dit Henri ; mais, ventre-saint-gris ! venez avec moi, nous éclaircirons la chose. En effet, dès qu'ils paraissent, la foule se presse autour d'eux, la joie, l'affection, le respect se peignent sur tous les visages. Henri frappe sur l'épaule de l'un, demande à l'autre des nouvelles de sa femme et de ses enfants, serre la main de celui-ci, fait un salut à celui-là, adresse quelques paroles honnêtes à tous, et rentre au château avec un cortège nombreux. Eh bien ! dit-il au duc d'Anjou, vous avais-je rien dit de trop
sur l'honnêteté de nos braves bourgeois de Nérac ? — Parbleu ! je le crois bien ; c'est vous qui leur faites toujours les avances... — Oh ! par ma foi, mon frère, entre Gascons nous ne tirons jamais à la courte paille. Personne ne calcule avec moi, et je ne calcule avec personne ; nous vivons à la bonne franquette, et l'amitié se mêle à toutes nos actions... Un grand prince de France lui reprochoit un jour d'être inconstant et léger. Il lit venir, pour s'en défendre, tous ses officiers et domestiques : ceux de cuisine, ceux de paneterie, ceux de la sommellerie, ceux des escuries, et quasi tout son train ; il ne s'en trouva pas un qui n'eust servy ou qui ne fust sorty de personnes qui avoient servy son père et son ayeul, et lui-même dès le berceau. L'autre se trouva bien empesché à la réplique, estant accoustumé, de trois mois en trois mois, de faire maison neuve[5]. Henri IV, qui avait été élevé rudement et de façon à n'être point pleureux ni rechigné était gai et prisait fort une pointe de joyeuseté venant à propos. Il n'aimait point les grincheux. D'Aubigné fut le seul grognard de ses serviteurs. Mais Henri lui pardonna, en raison de son dévouement et de son mérite, ces accès de jalousie hargneuse, ces quintes de maussaderie, qui, chez les autres, décourageaient sa faveur et attiraient inévitablement sa disgrâce. Il donnait lui-même la raison très-malicieusement philosophique de cette aversion pour les misanthropes et les hypocondres. Je ne peux me servir, — disait-il, — d'un homme mélancolique ; car un homme qui est mauvais pour lui-même, comment serait-il bon pour les autres ? Peut-on espérer du contentement d'un homme qui ne peut se contenter lui-même ? Il n'épargnait d'ailleurs rien lui-même pour que tout le monde fût content de lui ; et quand il n'y pouvait parvenir en effet, surtout durant cette période d'aventure et de royale bohême, où il avait plus de bon vouloir que de pouvoir, et où sa bourse était beaucoup moins large que son cœur, il prodiguait du moins tout ce qu'il avait à sa disposition, les promesses, les espérances, les compliments, l'exemple de la mauvaise fortune joyeusement supportée, la confiance dans la meilleure, et ces lettres de change de bienveillance formulées en bons mots ou en laconiques billets, qu'il ne laissa point plus tard protester. Nous voudrions pouvoir citer, à ce propos, tout le chapitre de fine analyse psychologique et morale, où M. E. Yung, son historien littéraire, a si heureusement mis à nu en dépouillant sa correspondance, le cœur du Béarnais. C'est là qu'on le voit flattant Sully de l'aveu d'une préférence bien justifiée par ses services, et l'invitant toutefois à ne s'en point targuer, car je ne veux, dit-il, offenser personne. C'est là que nous le voyons prendre la plume pour complimenter de sa main un simple bourgeois qui vient d'être élu maire de Poitiers. C'est là enfin que nous le voyons prodiguer tour à tour à Théodore de Bèze, à Duplessis-Mornay, au maréchal de Biron, les témoignages les plus flatteurs d'un respect d'élève, d'une affection de fils. Je vous prie m'aimer toujours, — écrit-il au premier, — vous assurant que vous ne sauriez départir de votre amitié à prince qui en soit moins ingrat, et continuer vos bonnes admonitions, comme si vous étiez mon père. Personne ne sait louer, comme lui, avec grâce.et sobriété. Nous verrons tout à l'heure ses lettres à M. de Crillon et au baron de Batz. Personne ne sait, comme lui, se plaindre de l'absence d'un ami. Vous ne sauriez croire l'envie que j'ai de vous voir. Surtout je vous prie de vous hâter de nie venir trouver, car je meurs d'envie de vous voir. — Je brûle d'un extrême désir de vous voir, pour vous témoigner comme je vous aime. Voilà dans quels termes il écrit au connétable. Voici maintenant comment il intercédera auprès du duc de Savoie, pour obtenir la mise en liberté de deux de ses meilleurs compagnons. Monsieur, si vous m'aimez, je
vous prie vous employer pour la délivrance des sieurs de la Noue et de
Turenne, desquels je désire la liberté comme de mes propres frères. Si l'ami est malade, il est plein de sollicitude. C'est le moment de prouver son amitié ; en demandant des nouvelles de la santé, en exprimant des vœux. Il a des attentions délicates. M. de Saint-Geniez est souffrant ; il le prie de ne se point forcer à venir à Pau ; il aurait trop de déplaisir d'être occasion d'accroître son mal ou de retarder sa guérison. Il l'ira voir lui-même, pour l'aider à revenir en santé. ; il viendra dîner chez lui et ne mènera que deux ou trois de leurs bons amis. Mais qu'il se repose, pour être trouvé en bon état. M. de Ségur a la fièvre ; il lui offre son propre médecin ; il regrette de ne pouvoir être son garde-malade. S'il n'était à la tête de M. de Nevers, il irait le voir, l'assister avec autant d'affection que si M. de Ségur était son père. Non-seulement il demande à tous leur amitié et leur dit souvent : Aimez-moi ; mais, ce qui est ingénieux et spirituellement habile, il leur persuade qu'ils l'aiment : D'autant que vous m'aimez, écrit-il à Matignon ; et à Duplessis : Vous devriez être plus affamé de me voir, sachant combien je vous aime... je sais que vous m'aimez[6]. D'autres fois, et avec des amis moins délicats, mais non moins précieux, il parle, s'accommodant à leur goût plus grossier, ou cédant lui-même à une veine plus gaie, à une inspiration non moins narquoise que cordiale, le langage de la familiarité du camp ou du cabinet ; il emploie les sobriquets et les quolibets soldatesques auxquels il se plaisait parfois, et qui flattent ceux auxquels il s'adresse plus que des compliments de cour. Voici quelques exemples de ces saillies, où pétille le sel gaulois-plus que le sel attique ; mais il faut parler à chacun sa langue. Tel aime à être flatté d'une caresse ; tel autre d'un horion ; à celui-ci un coup de gant, à celui-là un coup de gantelet sur l'épaule. Dans une lettre inédite à M. de Poyanne, Henri dira sans façon, mais non sans habileté et sans succès : ..... Au demeurant, je voudrais-que le bien de mes affaires vous permit de me venir trouver, pour voir si nous faisons la guerre aussi bien que vous la faites du côté de delà ; mais si vous ne le pouvez, allez vous faire lanlère. Au même, il écrira encore : Grand pendard, je viendrai demain à Poyanne planter tes allées ; bon vin, bon feu, bonne chère. Je t'embrasse : Henry. Avec M. de Sainte-Colombe, c'est du même ton et du même tonneau : Grand pendu, j'irai tâter de ton vin en passant. Avec M. de l'Estelle, Henri ira plus loin encore : Je te prie, crapaud, viens me trouver et amène ce que tu pourras ou ce que tu voudras ; car, en quelque façon que je te voie, tu seras le bien venu. Et voilà comment on parle, quand on fait la guerre avec eux, à de braves gens, qui, fiers d'avoir versé leur vin au roi, versent leur sang pour lui, sans plus marchander l'un que l'autre. Mais les lettres les plus caractéristiques d'Henri sont celles adressées à Crillon et à M. de Batz : Nous aurons occasion plus tard de citer, en son lieu, le billet historique et légendaire, embelli par Voltaire, et qui n'en avait pas besoin. En ce moment, nous nous bornerons à donner quelques extraits de la correspondance avec le baron de Batz, parce qu'il est de ceux qui furent les amis de la première heure comme (le la dernière, qu'il se fit cribler de blessures au service de celui auquel même il sauva la vie, précisément à l'époque où nous sommes parvenus, et que les épîtres à celui qu'il appelait familièrement son faucheur, comme il appelait Harambure, qui avait laissé un œil à la bataille, son borgne, sont de celles où Henri a déployé le plus de mâle verve, de concision énergique, de chevaleresque bonté. C'est à M. de Batz qu'Henri IV écrit, dans l'été de 1576 : M. de Batz, je vous veux bien faire savoir que vous êtes sur l'état de la défunte reine ma mère, de ceux-là à elle appartenants, et de tout temps bons amis et serviteurs des siens. Pourquoi, faisant état de votre bonne volonté, je vous prie de faire et croire ce que vous dira M. d'Arras de ma part. Et serai bientôt à même de connaitre les véritables gens de cœur, qui se voudront acquérir honneur pour bien faire avec moi ; entre lesquels je fais état de vous trouver toujours. C'est M. de Batz que Henri récompense, en ces termes, du service qu'il lui a rendu dans une conjoncture dramatique que nous raconterons tout à l'heure : Monsieur de Batz, pour ce que je ne puis songer à ma ville d'Eause sans qu'il ne me souvienne de vous, ni penser à vous qu'il ne me souvienne d'elle, je me suis délibéré de vous établir en icelle et pays d'Eausan. A donc aussi me souviendra quand et quand d'y avoir un bien sûr ami et serviteur sur lequel me tiendrai reposé de sa sûreté et conservation... Au même il écrivait, sachant bien que le souvenir des services rendus est, encore plus que celui des services reçus, un motif d'émulation et un aiguillonnement à bien faire : En quel autre que vous pourrais-je tenir ma confiance pour la conservation de ma ville d'Eause, là ou je ne puis donner d'autre modèle que le brave exemple de vous-même ? Et tant qu'il me souviendra du miracle de ma conservation que daigna Dieu y opérer principalement par votre valeur et bonne résolution, ne pouvez oublier votre devoir. C'est à de Batz qu'il écrivait encore ce billet qui a la rapidité de la flèche dans son laconisme vibrant, qui multiplie l'éclair étincelant de la courte épée française : ... Mon Faucheur, mets des ailes à ta meilleure bête. J'ai dit à Montespan de crever la sienne pour t'aller engarder de passer à Vic, ni d'entrer à Laverdein. Pourquoi ? Tu le sçauras de moi, demain à Nérac ; mais par tout autre chemin, hâte, cours, vole, viens ; c'est l'ordre de ton maitre et la prière de ton ami... On comprend quel coup de fouet de zèle impétueux et de furie française, indifférente à l'obstacle, de telles lettres provoquaient, et comme le Faucheur, ainsi mandé, brûlait les chemins, quels qu'ils fussent, afin d'arriver au rendez-vous assez à temps pour inscrire à son compte une blessure et un service de plus ! Ainsi en fut-il à Coutras, par exemple, et à cette occasion, le brave de Batz recevait la lettre suivante, où Henri trouve le premier ce mot de caresse, cette charmante préciosité d'affection que madame de Sévigné emploiera après lui quand elle écrira à sa fille malade : J'ai mal à votre poitrine. ... Monsieur de Batz, je suis
bien marri que vous ne soyez encore rétabli de votre blessure de Coutras,
laquelle me fait véritablement plaie au cœur, et aussi de ne vous avoir pas
trouvé à Nérac, d'où je pars demain, bien fâché que ce ne soit avec vous ; et
bien me manquera mon faucheur par le chemin ou je vas... Nous ne pouvions finir par un plus frappant et plus touchant exemple de cette verve d'esprit, de cette éloquence de cœur, de cette séduction irrésistible, de cette fascination sympathique d'Henri, la brève esquisse de sa physionomie à l'heure des débuts encore incertains de sa royauté militante et nomade, à l'heure de la diplomatie d'intrigue et de la guerre d'escarmouches et de coups de mains. Il n'était pas moins nécessaire à l'intelligence de notre sujet, à la connaissance de notre héros, de l'étudier dans son for intérieur que de l'étudier dans son for extérieur, et de montrer Henri dans le premier épanouissement et le premier parfum de ces dons heureux qui feront de lui à la fois un prince si populaire et si littéraire. Désormais nous ne profiterons, pour l'analyse intime de notre héros et pour la philosophie de notre sujet, que des rares intermèdes de cette vie bientôt si agitée, si variée, si remplie d'événements. Nous ne répéterons ses paroles que lorsqu'elles seront le commentaire de ses actions. Mais nous aurons gagné à une digression, qui n'est point un hors d'œuvre, un double bénéfice qui ne saurait nous être indifférent. Nous aurons mieux fait aimer Henri en le faisant mieux comprendre. Nous aurons expliqué pour jamais, en outre, et sans qu'il soit besoin d'y revenir, l'ascendant croissant, le prestige irrésistible qu'il exerça dès les premiers temps sur ses compagnons, et qui lui permit, malgré tant de rigueurs et d'ingratitudes de la fortune, de triompher des obstacles les plus redoutables qui s'opposèrent jamais à un homme, en faisant de sa cause celle de tous ses amis, en les précédant toujours sur le chemin de l'honneur et du péril, et en payant leur dévouement, faute de mieux, avec la monnaie d'or de son esprit et de son cœur. D'Aubigné, en suivant, non sans murmurer, ces méandres d'une existence d'abord si aventureuse, ces oscillations d'une politique flottant à tous les vents comme une enseigne mal cousue, explique très-bien pourtant comment, réduit à des ressources toujours précaires et à des escadrons d'amis plutôt qu'à des armées de sujets, Henri dut longtemps procéder ainsi, par petites opérations, par cartes jouées comme au hasard, à la partisane, à la cavalière, et battre l'estrade plus que tenir régulièrement la campagne. Aussi, selon lui, il fallut à Henri, dès le début, plus de courage, d'énergie, d'industrie, de génie qu'à aucun autre moment de sa carrière, pour se démêler à travers tant de fils entrecroisés et enchevêtrés, dont Catherine de Médicis embrouillait chaque fois l'écheveau, pour se fortifier et se grandir, à l'école de ces difficultés vulgaires qui en énervent et rapetissent tant d'autres. Les judicieux, dit
d'Aubigné, remarquent en ce roi plus de mérite pour
avoir foulé aux pieds les passions du dedans, ennemies de ses affaires, caché
la pauvreté, demeslé les mutineries domestiques, satisraict aux mescontentements
des siens, calmé l'esmeute des peuples abusés, desquels le propre est
d'attribuer à soi l'heure des succez, les défaux aux princes, dissipé les
partis qui naissoient en son parti, que d'avoir passé sur le ventre des grosses
troupes et deffaict les armées qui l'ont affronté. J'ai vu qu'ayant mangé à
la suitte de ce chef la moitié de nos équipages, la promesse d'une bataille
nous faisoit encore partager le reste ; et certes non sans quelque raison :
car il nous donnoit pour monnoye ce qui es-toit le coulas de ses labeurs. Pour payer ses serviteurs avec la promesse d'une bataille, et cette héroïque monnaie de nouveaux dangers à courir et de nouveaux exploits à accomplir, on comprend que Henri dût donner l'exemple, avec une prodigalité de sa personne égale à l'avarice de ses autres moyens. Henri dut donc être et fut donc alors un roi cheval-léger, — suivant l'expression de Sully — tout en sentant fort bien combien la raison politique désapprouvait parfois ces entraînements militaires, mais en sentant encore mieux que la nécessité l'emportait souvent sur la raison. Aussi le vit-on plus d'une fois blâmer ceux qui n'avaient point comme lui l'excuse de ne pouvoir faire autrement ; plus d'une fois, il gourmandera Sully de trop s'exposer, lui qui se ménage si peu, et de faire trop le soldat, lui qui si longtemps ne fera le général qu'en passant le premier et en se battant le plus à tout risque. S'il le faisait, c'est qu'il le fallait et lui-même le confessera aux députés des Parlements et des États qui lui reprochent cette prodigalité d'exemple, ce peu de ménagement d'une vie si précieuse : ... Vous m'avez dit que je me
hasarde trop ; je ne le fais volontiers ; mais j'y suis contraint, parce que
si je n'y vais, les autres n'y iront point. Ce sont tous volontaires que je
ne puis pas forcer. Si j'avois de quoi payer les gens de guerre, j'aurois des
personnes assurées que j'enverrois aux hasards, et je n'irois point ; mais je
n'ai personne. Forcé troupes me viennent trouver ; mais quand je les ai
tenues quinze jours, je ne sais ce qu'elles deviennent. Sous le bénéfice de ces considérations, nous passons maintenant ais' récit émouvant de ces dramatiques affaires d'Eause, de Cahors, pour arriver à cette première victoire de Coutras où Henri décide sa destinée, et sans cesser d'être homme ni d'être soldat, se montre enfin roi. L'épisode où Henri, pour la première fois, courut risque de la vie, se rapporte à l'année 1576, durant une paix précaire, lorsqu'au lendemain de négociations décevantes et de fêtes où l'intrigue avait plus de part que le plaisir, surgissaient à tous moments, des incidents qui mettaient le feu aux poudres et rallumaient la guerre suspendue. Henri, cherchant à se faire des partisans plus encore que des compagnons et à préparer ses plans plus qu'à les exécuter, tâtait le terrain, attendait l'occasion, et profitait de chaque trêve pour se faire connaître, c'est-à-dire aimer, surtout dans les villes et les places de son apanage ou de son gouvernement, en Armagnac ou en Guienne, qui devaient constituer, au moment propice, la base de ses opérations. La guerre civile et la guerre religieuse avaient depuis si longtemps, surtout aux chaudes régions du Midi, travaillé les âmes, excité les passions et hérissé les mœurs, que l'hospitalité y était souvent disputée les armes à la main, et que dans plus d'une de ses visites, Henri, qui avait déjà dû subir, à la Rochelle, un accueil suspect, fut reçu comme un intrus, et obligé de forcer la porte. C'est une mésaventure de ce genre qui faillit lui coûter la vie à Eause. C'était une petite place de l'Armagnac[7], encore de quelque importance, bien que très-déchue de ce qu'elle fut à l'époque romaine, sous le nom d'Élusa, comme capitale de la Novempopulanie. Comme la trêve qui suspendait la guerre dont l'évasion d'Henri avait été le signal, allait expirer, le roi de Navarre apprit que les gens d'Eause s'étaient mutinés contre son autorité, et avaient refusé de recevoir la garnison qu'il leur avait envoyée. Henri en fut d'autant plus surpris et indigné que la ville d'Eause faisait partie de son patrimoine, l'avait salué naguère des démonstrations de la fidélité la plus empressée, et lui avait souhaité une encourageante bienvenue. Il ne pouvait souffrir que la révolte y fût entretenue ou tolérée par les mêmes magistrats qui étaient venus récemment au-devant de lui, en chaperons rouges, pour lui offrir solennellement les clefs de la cité maintenant si inhospitalière. Résolu à fortifier par un exemple son autorité contestée et sa popularité en germe, et à déconcerter l'esprit de discorde et de faction renaissant jusque dans ses domaines héréditaires, Henri concerta un plan où la force devait profiter, pour frapper un coup plus sûr, des précautions de la ruse. Il donna rendez-vous à ses compagnons habituels de coups de main à un endroit où il les retrouva lui-même, prêt pour cette expédition furtive, c'est-à-dire les armes cachées sous les habits de chasse. Il s'avança en tête de son avant-garde, comme toujours, jusqu'aux murs et, parvenu à surprendre ou à forcer la consigne, il pénétra dans la place, s'effaçant de son mieux dans le groupe des premiers entrés. Ce fut en vain, car il fut aussitôt reconnu et hélé par le garde de la tour de la porte, qui se promit le plus beau coup de filet de sa vie. Dans ce but il trancha d'un coup les cordes de la herse-coulisse qui retomba d'un trait, laissant, d'un côté de son rideau de fer, une dizaine de gentilshommes fort penauds, et exposant, de l'autre côté, à la fureur de la populace et de la soldatesque ameutées, Henri et ses quatre compagnons, c'est-à-dire MM. de Mornay, de Béthune l'aîné, de Rosny (Sully) et de Batz[8]. Ce petit groupe d'envahisseurs pris au piège et d'assiégeants assiégés fut aussitôt assailli par un gros de soldats et de peuple, ivres de fureur et de joie, armés de toutes armes, qu'excitaient à la rescousse les volées du tocsin sonnant l'alerte et la voix goguenarde de la sentinelle enchantée de sa ruse et criant dans son patois énergique : — Coupa lo rastel, che prou n'y a, lo Re y es. (Abats le râteau, il y en a assez, le Roy y est.) Mais le roi était de ceux qui ne se laissent point ainsi prendre à la souricière. Pourtant il y eut là quelques rudes minutes à passer, et c'est là aussi sans doute que cette barbe et cette moustache du roi mousquetaire, blanches d'un côté à trente-cinq ans, commencèrent à grisonner. Calme et dédaigneux au milieu de cet assaut, Henri repoussa le premier choc adossé à la herse qui s'était abattue presque sur la croupe du cheval de MM. de Béthune et de Rosny ; et il opposa la plus fière contenance à ces bourgeois et soldats mêlés, fondant sur lui en diverses troupes et à diverses reprises, le tocsin sonnant furieusement et un cri d'Arme ! arme ! et de Tue ! tue ! retentissant de toutes parts. Aucun des quatre cavaliers n'avait plus que son chef perdu la tête, et ils jouaient serré de l'épée au milieu de ce torrent populaire qui grondait à leur botte et tourbillonnait sur leur bride. Henri sentant le moment décisif : — Mes compagnons, mes amis, dit-il, en quelques mots frappés au coin de cette éloquence brève dont il avait le secret et qui préludaient si heureusement à l'action, c'est ici qu'il faut montrer du courage et du sang-froid, car c'est de nous que dépend notre salut ; que chacun donc me suive et fasse comme moi, sans tirer le coup de pistolet qu'il ne porte. La consigne fut exactement suivie. Ce que voyant le roy de Navarre, dit Sully, dès la première trouppe qui se présenta de quelque cinquante, les uns bien, les autres mal armez, luy marchant le pistolet au poing droict à eux... et oyant trois ou quatre qui crioyent : Tirez à cette juppe d'escarlatte, à ce pennache blanc, car c'est le Roy de Navarre, il les chargea de telle impétuosité que sans tirer que cinq ou six coups, ils prirent l'espouvante, et se retirèrent par diverses trouppes. D'autres semblables lui vindrent encore mugoter par trois ou quatre fois ; mais sitost qu'ils se voyoient enfoncez, ils tivoient quelques coups et s'escartoient, jusqu'à ce que s'estant ralliez près de deux cents, ils hasardèrent une offensive suprême, profitant à la fois de leur force accrue et de la fatigue de leurs adversaires. Dans ce danger, le roi, pour éviter d'être enveloppé, se retira avec sa troupe, non encore entamée, grâce à sa bonne contenance et au désordre de l'attaque, devant un portail dont les vantaux le couvraient à demi. Il y tint ferme, pendant que deux de ses compagnons, détachés par son ordre en enfants perdus, montaient précipitamment dans le clocher, pour faire signe à ceux des leurs restés en arrière, de se hâter et d'enfoncer la porte ; ce qu'ils se mirent à faire avec d'autant plus de succès, qu'heureusement le pont-levis, à la faveur du désordre de l'alerte, n'avait point été levé. Cependant la ville, comme toutes celles du temps, était livrée à deux partis, les uns se déclarant pour le roi, dont la contenance encourageait leur zèle, tandis que les autres tenaient contre lui. Les habitants fidèles, triomphant enfin de leur incertitude et échappant à la pression des séditieux, entendant d'ailleurs les cris d'appel et de vengeance du gros de la troupe royale, prête à pénétrer dans la ville, fondirent sur les mutins par derrière. Ainsi prise entre deux feux, l'émeute mollit bientôt, non sans une résistance désespérée. A la faveur de cette diversion, le roi, dégagé, put tendre la main aux survenants, qui avaient pratiqué la brèche et inondaient les rues, prêts à passer les rebelles au fil de l'épée. Aussi clément que brave, le roi contint cette irruption, et criant quartier pour les innocents, même pour les coupables, il fit droit aux supplications des magistrats, leur accorda la grâce de leur ville, interdit le pillage et se contenta de la punition nécessaire de quatre des plus signalés parmi les mutins, qui furent pendus, aux acclamations des habitants délivrés de leur tyrannie. La tradition veut même que celui qui avait le premier, et à bout portant, tiré à la jupe écarlate et au panache blanc, heureusement sans effet, et que ses complices avaient livré eux-mêmes avec le zèle et l'indignation des foules repentantes, échappa miraculeusement au châtiment, par suite d'un incident tragicomique. La corde s'étant rompue sous le poids du patient, Henri, trouvant que le pardon le rendrait plus populaire que l'inflexibilité, fit surseoir à l'exécution et accorda sa grâce au misérable, en disant : Grâce à celui que le gibet épargne[9]. Cette clémence habile et joviale mit le comble à l'admiration des habitants, déjà gagnés par le courage d'Henri. Ils abjurèrent solennellement leurs égarements, et cette ville rebelle, qui n'avait prêté que sous la pique le serment de fidélité, se fit remarquer dans la suite par l'inaltérable dévouement de ses habitants. La journée, si mal commencée, finit donc bien pour Henri. Il y avait montré, à son honneur, comment on prend une ville et, ce qui est plus difficile encore, comment on la garde. II acquitta, sans tarder, la dette de sa gratitude envers ses compagnons, et surtout envers de Batz, le plus intrépide peut-être de tous, en conférant le gouvernement de la cité conquise d'abord à M. de Béthune, ensuite à celui qu'il appelait son Faucheur, et auquel il rappela souvent cette mémorable journée, où sans doute il avait fauché à la satisfaction de son maitre. Pour Mornay et Sully, ils n'eurent pas non plus à se plaindre du souvenir de cette aventure, qui ne devait pas être, dans la vie militante et hasardeuse d'Henri, la seule du même genre. Nous savons en effet, par Sully lui-même, que, la même année et dans la même campagne, le guet-apens d'Eause faillit se renouveler à Mirande, où Henri échappa, grâce à un avertissement opportun, à un danger encore plus grand. L'aventure de Florence vaut aussi la peine d'être contée, et nous y prendrons, comme à tous ces épisodes caractéristiques des hommes et du temps, un plaisir extrême, quoiqu'elle fasse encore plus d'honneur à l'esprit d'Henri IV qu'à son cœur, et à son habileté qu'à son courage. C'est dans cette occasion qu'il se montra non moins habile comédien que Catherine de Médicis, et joua son rôlet de façon à avoir les rieurs de son côté. Le concours de l'industrieux et infatigable de Batz, qui ne se marchandait jamais à l'occasion du péril et du dévouement, ne lui fut pas moins utile dans cette circonstance que dans bien d'autres. Henri le reconnaissait bien volontiers et constatait, non sans quelque amertume, que, bien que catholique, le baron de Batz l'avait servi, en ces temps critiques, plus à propos et plus fidèlement que beaucoup de protestants. Nous savons, par Sully et par d'Aubigné lui-même, que ses coreligionnaires lui donnèrent souvent bien du souci, par leurs brigues, leurs révoltes, leurs mécontentements, leurs intrigues. Et plus d'une fois Henri fut obligé, après avoir eu bien de la peine à amener ensemble à l'ennemi ses compagnons catholiques et protestants, de se fâcher pour l'es empêcher de se disputer, les armes à la main, la faveur du maitre ou les profits de la victoire. Aussi peut-on dire que dès les premiers temps de sa carrière politique, l'expérience non moins que la tendance naturelle de son caractère l'avaient rendu impartial et éloigné de tout fanatisme, au point d'avoir paru presque sceptique quand il n'était que tolérant. Dès les premiers jours de 1577, Henri écrivait au baron de Batz mie lettre qu'on n'a pas assez remarquée, et qui nous semble caractéristique. Le baron s'était plaint sans doute à lui, avec la mâle franchise d'un serviteur qui ne permet pas qu'on le soupçonne, des insinuations malveillantes que des jaloux avaient essayé de faire prévaloir à son endroit, en fondant leurs ombrages sur le prétexte de la différence de religion. Je vous prye de croire que combien que soyes de ceulx-là du Pape, je ne avois, comme le cuydiés (croyiez) mesfiance de vous dessus ces choses. Ceulx qui suivent tout droict leur conscience sont de ma religion ; et moi je suis de celle de tous ceulx-là qui sont braves et bons. L'année suivante, Henry ne manqua pas de témoigner sa confiance à de Batz, en l'invitant à une de ses plus jolies parties. Voici les termes dans lesquels il lui donnait rendez-vous : Tant pis que n'ayez praticqué personne du dedans à Florence[10] ; la meilleure place n'est pas trop chère du sang d'un de nies amis. Ceste mesme nuict, je vous joindray et y seront les bons de mes braves[11]. Voici, sur cette affaire, le récit de Sully : La cour du roy de Navarre et
celle des deux reines (Catherine de
Médicis et Marguerite, que sa mère avait ramenée à son gendre pour le mieux
enjôler) estants ensemble à Auch, un soir,
ainsi que (pendant que) l'on tenoit le bal, un gentilhomme envoyé par M. de Favas
vint advertir le roy de Navarre qu'un viel (vieux) gentil-homme nominé Ussac
— que l'on tenoit pour un des piliers de l'Église
huguenotte, estant des plus authorisez dans les consistoires et accreditez
dans les assemblées, et à ceste cause avoit esté choisi entre plusieurs
autres pour estre gouverneur de la Réole, place des plus importantes pour
ceux de la Religion — avoit esté persuadé par
une des filles de la royne-mère... à se faire
catholique et à remettre la place entre les mains de la royne-mère... C'était là une double trahison, car le serviteur infidèle ne l'était devenu que par suite des suggestions et de la captation d'une affidée de Catherine, qui se souciait aussi peu de violer elle-même la foi des traités, qu'elle tenait à son exacte observance de la part des autres. Henri se contint et résolut de se faire justice lui-même. On va voir s'il ne fit pas mieux que de se plaindre. .....Ce qu'entendu par le roy de Navarre, sans monstrer aucune esmotion, ny faire semblant de rien, s'escoula doucement de la presse, avec trois ou quatre des siens, auxquels il dit tout bas à l'oreille : — Advertissez le plus secrètement que vous pourrez tous mes serviteurs dont vous pourrez sçavoir les logis, que dans une heure je seray à cheval hors la porte de la ville, avec une cuirasse sur ma jupe de chasse, et que ceux qui m'ayment et qui voudront avoir de l'honneur me suivent. Ce qui fut aussi tost fait que dit ; et le tout si heureusement exécuté qu'à portes ouvrantes il se trouva à Florence ; de laquelle (les habitans ne se doutans de rien, à cause que l'on estoit eu paix) il se saisit facilement. Qui fut fort étonné à la nouvelle ? La reine-mère, qui prit le parti de rire, n'osant s'en fâcher, de représailles qu'elle avait elle même provoquées. .... Ce qui ayant esté le matin rapporté à la rogne-mère, qui le pensoit avoir couché à Auchx, elle n'en fit que rire, et en branlant la teste dit : — Je voy bien que c'est la revanche de la Réole, et que le roy de Navarre a voulu faire chou pour chou ; mais le mien est mieux pommé. Ainsi fut prise Florence en Gascogne, par un roi qui n'était pas Gascon à demi ; le plaisir du gain de cette joyeuse partie de représailles eût été complet, s'il n'eût pas été acheté au prix du sang d'un ami. Henri perdit en effet, dans cette surprise, un de ses gentilshommes, nommé Montbertier, qui sortait à peine de page. Nous n'avons pas dessein de nous arrêter trop longtemps à ces épisodes de chronique, qui ne doivent point abuser de leur attrait familier pour empiéter sur la place réservée à des événements plus austères, et plus dignes de l'histoire. Notre intention a été seulement de donner une idée vive et pittoresque des mœurs du temps, du caractère original de cette guerre aventureuse et en somme sanglante, coupée d'intermèdes, de festins, de bals, de carrousels, de chasses, sous prétexte de négociations, où Henri apprenait son métier de roi, après avoir appris son métier de général. L'expérience et l'adversité furent ses deux maîtresses, et il profita de leurs leçons, non sans commettre d'abord plus d'une faute. Celle de la témérité, par exemple, est celle à laquelle il renonça le plus tard, parce qu'il y était entraîné à la fois par la nécessité et par le tempérament. Les Mémoires de Sully et de d'Aubigné sont remplis, à ce propos, de témoignages trop concordants. A Nérac, par exemple, en cette même année 1577, Sully nous le montre s'exposant comme un simple soldat et repoussant presque seul un gros de cavalerie qui s'était détaché pour venir le surprendre. Mais si Henri eut fort à faire pour réprimer en lui-même les excès de cette impatience généreuse et de cette bravoure téméraire dont il donnait encore l'exemple malgré lui, bien après qu'il en eut ressenti les inconvénients et qu'il en eut reproché la faute à certains de ses compagnons, trop disposés à l'imiter, la politique en lui fit des progrès plus rapides ; il rivalisa de finesse avec Catherine de Médicis elle-même, et la déconcerta maintes fois par la malice de ses réparties. Les chroniqueurs du temps nous l'ont montré, en plus d'une circonstance, luttant de ruse avec la ruse elle-même, et tirant ses secrets, sans lui livrer les siens, à cette étrange et énigmatique princesse, qui eût mérité d'avoir Machiavel pour historien, et peut passer pour l'incarnation la plus parfaite, la plus tragique personnification de la Raison d'État. Durant son voyage de Gascogne en 1577, la reine-mère n'eut qu'une pensée, au service de laquelle elle mit tous les artifices d'une politique sans scrupules ; et elle attaqua Henri, qu'elle connaissait bien, par tous les points faibles de sa cuirasse, non encore bien assujettie. Cette pensée, c'était de diminuer chaque jour l'avantage de la paix qu'elle n'avait pu refuser à l'intimidation de la ligue des princes. Elle commença par détacher de cette alliance, qui faisait la principale force de ses adversaires, son digne fils, l'ambitieux et équivoque duc d'Anjou. Elle s'appliqua ensuite à énerver le parti du roi de Navarre par la séduction, la défection, les rivalités, Elle parvint à brouiller le prince de Condé avec le vicomte de Turenne et ensuite avec le roi de Navarre lui-même ; et quand à bout de fraudes et de supercheries, et toutes ses mèches étant éventées, elle prévit la guerre qui allait en effet, en 1580, succéder aux paix bâtardes de 1577 et de 1578, Ile ne partit point sans débaucher du service du roi une partie de ses officiers catholiques, Lavardin, Gramont et Duras entre autres. Mais elle ne parvint point à entamer Henri, qui se tenait sur ses gardes, et intérieurement armé et maillé, c'est-à-dire inaccessible aux coups à l'italienne, sur les points essentiels, c'est-à-dire l'abjuration, le retour à la cour, la remise des places de sûreté. Elle ne parvint pas à le séduire, si elle réussit quelquefois à le tromper ; et du bec ou de l'ongle, car il avait les deux non moins bien taillés qu'elle, il lui rendit toujours, en action ou en paroles, la monnaie de son coup, et quelquefois avec usure. C'est ainsi qu'il riposta par la surprise de Florence à la trahison de la Réole, et vengea, par son succès de Saint-Émilion, son échec de Saint-Macaire. C'est ainsi que, dès le début de la guerre de 1580, il devait répliquer par le coup de main de Cahors à la surprise de Figeac. Nous raconterons tout à l'heure cette entreprise où, à force d'héroïsme, Henri échappe au reproche d'aventure et, à travers le sang et le feu d'une lutte de cinq jours, aux épisodes dignes d'Homère, sort du roman pour entrer dans l'épopée de son histoire. Mais nous ne résistons pas au plaisir de montrer un moment le roi gascon et.la reine italienne aux prises et se rebecquant de saillies ; duel courtois et narquois, où Catherine n'eut guère le dernier mot. Il y eut, dit Le Grain, à Nérac, conférence entre elle et le roy de Navarre, son gendre, en laquelle quelques articles furent éclaircis et non pas tous, car la bonne dame vouloit toujours tenir son genest d'Espagne par la bride tant qu'elle pourroit ; néanmoins, elle caressa fort ce gendre en ceste conférence, en laquelle il y eut entre eux plusieurs propos gaillards... La royne-mère, — dit encore le naïf et malin chroniqueur, — lui fit une infinité de caresses (à Saint-Bris), jusqu'à le chatouiller par les côtes. Lui, s'avisant du dessein de cette dame, qui étoit de tâter s'il étoit couvert, tira les boutons de son pourpoint, et lui montrant sa poitrine nue : Voyez, dit-il, madame, je ne sers personne à couvert. Et comme elle le conjura de ne plus faire la cour aux maires de la Rochelle, disant que c'était faire tort à sa grandeur de se soumettre ainsi à une populace de laquelle il pouvait être souvent éconduit : J'y fais, dit-il, ce que je veux, parce que je n'y veux rien que ce que je dois. On le voit, même avec une joueuse de la force de Catherine, c'était là un rude et malin adversaire, non-seulement au jeu de la guerre, mais au jeu de l'intrigue. Catherine dut donc, assez désappointée, reprendre le chemin de la cour, abandonnant une fois de plus au sort hasardeux des armes l'issue de cette lutte dramatique, où la Ligue venait de faire entrer en scène, avec ses princes usurpateurs, ses bourgeois ambitieux, ses magistrats rebelles, ses soldats fanatiques et ses moines vendus à l'étranger, la plus formidable des intrigues nouant le plus tragique des dénouements. C'est le 15 avril 1580 que commença cette courte guerre, suivie d'une paix plus courte encore, dont la sévérité de l'histoire a puni la frivolité d'un épigrammatique sobriquet, qui en caractérise à merveille les mobiles. Cette nouvelle prise d'armes de la sanglante période des troubles civils et religieux, —qui s'ouvre en 1562, pour ne se fermer qu'en 1598, par le triomphe d'Henri IV et l'expulsion définitive de l'étranger — a pour principal épisode la prise de Cahors. C'est le seul où Henri se montre digne de sa destinée, au milieu de l'énervement et de la décadence — heureusement arrêtés à temps — de ces délices de Nérac, pires que ceux de Capoue, que le sincère et rude d'Aubigné a flétris en quelques lignes éloquentes. C'est au fidèle et incorruptible serviteur que nous devons
le tableau de cette cour charmante et fatale où
l'ayse avoit amené les vices (comme la
chaleur les serpents) et où la rogne de
Navarre avait trop tost desrouillé les esprits et fait rouiller les armes. Elles se dérouillèrent heureusement à cette affaire de Cahors, où Henri faillit tout perdre, même la vie, mais d'où il sortit avec tant d'honneur, et mûr enfin, en un mot, pour la gloire. C'est à Sully, témoin et acteur principal dans cette entreprise, que nous laisserons le soin d'en raconter les dangers et d'en étaler les trophées. Le roy de Navarre estant à Montauban, environ le mois de may ou juin 1580, fit dresser une entreprise sur Cahors, dont l'exécution fut l'une des plus signalées prises de ville par pétard, sans aucune intelligence, qui se soit jamais faite ; car la ville est bonne, grande, et toute environnée de rivières par trois côtez, dans laquelle, outre les habitants bien arme, il y avoit près de deux mille hommes de pied, et cent hommes d'armes estrangers, sous un gouverneur des plus braves et qualifiez gentilshommes de la province, nommé de Vesins, lequel avoit esté adverty, quatre ou cinq jours auparavant, que le roy de Navarre avoit entreprise sur la place ; car ledit advis fut trouvé dans sa batte sur lequel il avoit escrit de sa main, par trois fois : Nergue ! (nargue !) pour les huguenots ! Le roy de Navarre ayant passé par Montauban, Nègrepelisse, SainctAnthonin, Cajare et Sansevières, pour rassembler tousjours des gens, à cause que M. de Choupes, qu'il avoit mandé, n'estoit pas encore joint ; finalement ayant fait une bonne traite, il arriva, environ minuict, à un grand quart de lieue de Cahors ; auquel lieu dans un grand vallon fort plein de pierrotages, sous plusieurs touffes de noyers, où il se trouva une source qui vous fut un fort grand secours, car il faisoit grand chaud, le temps esclatant de toutes parts, de plusieurs grondemens de tonnerre, qui ne furent pas néantmoins suivis de grandes pluyes ; le roy de Navarre, faisant luy-mesme l'ordre de ses trouppes, selon qu'elles devroient marcher, attaquer et combattre, donna dix soldats, des plus dispos et fermes de courage de ses deux gardes, aux deux pétardiers qui estoient, à ce que nous vous avons oüy dire, au vicomte de Gourdon, car aussi c'estoit luy qui avoit fait l'entreprise ; après cela marchoit une trouppe de vingt hommes armez et trente harquebusiers des gardes, commandez par SainctMartin, capitaine des gardes ; cette trouppe estoit suivie d'une autre, à laquelle commandoit M. de Roquelaure, composée de quarante gentilshommes de la cour du roy de Navarre, des plus déterminez, au premier rang desquels vous estiez et soixante soldats des gardes du roy, lequel suivoit après avec deux cents hommes armez, séparez en quatre, et mille ou douze cens harquebusiers, séparez en six trouppes. Il falut emporter trois portes à coups de pétards, et encore entrouvrir les trous qu'ils avoient faits à coups de haches ; d'autant que les hommes armez ne pou-voient entrer qu'à quatre pattes ; dès l'entrée de la ville vous eustes à combattre une trouppe d'environ quarante hommes bien armez, ayant des hallebardes et pistolets, et environ deux cens harquebusiers ; car l'obscurité empeschoit d'en bien juger ; mais au feu des salües d'harquebusades, on voyoit que la plus part d'iceux estoient nuds jambes, n'ayans eu loisir de prendre leurs bas de chausses : les cloches faisoient un merveilleux bruit, sonnans l'allarme de toutes parts ; les voix un autre, criaus incessamment : Charge ! charge ! et Tüe ! tüe ! les harquebusades et cliquets d'armes un autre ; les tuiles, pierres, tisons et pièces de bois, que du haut des maisons l'on jettoit sur vous, un autre ; et les bris des espèes et froissis des piques et hallebardes un autre ; car dès le premier combat on en vint aux mains, jusqu'à se colleter les uns les autres, et dura cette mêlée plus d'un grand quart-d'heure, durant laquelle vous fustes porté par terre d'une grosse pierre, qui, ruée (lancée) d'une fenestre, vous tomba sur le casque, et fustes relevé par le sieur de Bertichère et La Trape, qui combattoient près de vous. Il se fit encore plus d'une douzaine de semblables combats, en quelques-uns desquels le roy mesure se trouva, de sorte qu'il y rompit deux hallebardes, et furent ses armes trouvées marquées de quelques coups d'harquebuses ou pistolets et de plusieurs coups de main ; les vostres n'en furent pas exemptes, et notamment à la troisième meslée lorsque l'on attaqua les barricades de la grande place où estoient les pièces d'artillerie, vos tassettes (cuissards) s'estans défaites, vous fustes blessé d'un coup de hallebarde dans la cuisse gauche, qui ne vous empescha pas néantmoins de vous trouver aux exploits, qui furent en grand nombre, n'y ayant quasi canton, place ou maison de pierre, où ceux de la ville ne se défendissent si obstinément, que vous fustes près de cinq jours et cinq nuicts avant que d'en entre maistres absolus. Les trois dernières nuicts, il y eut incessamment de grandes alarmes sur les bruits de secours meslés d'harquebusades, voix, cris et tel tintamarre et confusion de toutes parts, que nous vous avons souvent oüy dire que vous n'aviez guère veu de choses plus dignes de remarque, pour estre des plus belles et des plus effroyables tout ensemble ; et la ville estant de grand circuit, il n'estoit plus possible, veu le peu de gens de guerre qu'avoit le roi de Navarre, qu'il pùst plus faire faire par tout les gardes nécessaires, tant vous estiez tous las, alterez, affamez et travaillez de sommeil, y ayant desjà trois jours et trois nuicts que vous estiez armez, sans avoir entré en maison (car si on se fust amusé au pillage dès le commencement, tout estoit perdu), beu n'y mangé qu'un coup et un morceau par-cy par-là en combattant, n'y dormy que tout debout, vos cuirasses appuyées sur quelques étaux de boutiques ; et eussiez en fin succombé aux attaquemens des ennemis de dehors, qui venoient de toutes parts au secours de cette ville, qui s'augmentoient journellement et pouvoient entrer facilement dedans, par un des quartiers d'icelle, nommé La Barre, que les habitans tenoient encore, et estoient après à percer la muraille pour cet effet ; tellement que tous les plus sages et considératifs serviteurs du roy de Navarre prévoyans tous ces inconvéniens, luy conseilloient à tous momens, de rassembler le plus de ses gens qu'il luy estoit possible, monter à cheval, abandonner la ville et se retirer ; car tous vous autres, voire luy-mesure, estiez si fatiguez, et outre les blessures de plusieurs, aviez les pieds si escorchez et pleins de sang, que nul ne se pouvoit quasi plus soutenir ; mais à toutes telles propositions de sa retraitte, ce prince respondit toujours constamment et avec un visage riant ; qui resolvoit les cœurs les plus effrayez : — Il est dit là-haut ce qui doit estre fait de moy en toute occasion, et partant souvenez-vous que ma retraitte hors de cette ville, sans l'avoir conquise et asseurée au party, sera la retraitte de ma vie hors de ce corps, y allant trop de mon honneur d'en user autrement, et partant que l'on ne me parle plus que de combattre, de vaincre ou de mourir. Les choses estans en cette extrémité, il n'y a point de doute qu'elles alloient augmentant, lorsque M. de Choupes, qui avoit esté mandé pour se trouver à cette entreprise, et n'avoit pu assembler ses trouppes plustost, arriva aux portes de la ville, du costé ou l'on estoit entré, ayant environ cent hommes bien armez et cinq à six cens harquebusiers, avec lesquels sçachant l'estat déplorable où toutes choses estoient réduittes, il fit de tels efforts, et combattit si bravement dedans la ville, dehors icelle, contre le secours, assisté des moins las et moins blessez du roy de Navarre, qui, par son arrivée avoit entrepris courage, qu'en fin le quartier de La Barre et le Collège qui tenoient encore, furent pris, toutes les courtines, tours et portaux de la ville garnis, le secours ennemy contraint de se retirer, et la ville entièrement conquise, au pillage de laquelle on ne s'épargna pas ; et en vostre particulier, vous gagnastes, par le plus grand bonheur du monde, une petite bouétte de fer, que nous croyons que vous avez encore, que vous baillastes lors à l'un de nous quatre à porter, et l'ayant ouverte, trouvastes quatre mille escus en or dedans[12]..... Tel est le récit, fait par Sully, de ce fait d'armes encore aventureux, déjà héroïque. Le roi de Navarre y dut peut-être le succès à la mort du rude et vigilant gouverneur, tué au début de l'attaque dont il soutenait à la tête des siens, demi-nu, le premier effort. Il le dut surtout à sa persévérance inébranlable et à son électrisant exemple. On peut se faire une idée de son entrain et de son prestige par ce billet écrit à madame de Batz avant le débotté, et qui respire encore, dans sa verve militaire, le frémissement du combat et presque l'odeur de la poudre. On jugera de ce qu'était capable de faire un homme capable d'écrire ainsi : Madame de Batz, je ne me
despouilleray pas, combien que je sois tout sang et pouldre, sans vous
bailler bonnes nouvelles, et de vostre mary, lequel est tout sain et saulf.
Le capitaine Navailles, que je depesche par delà, vous desduira comme nous
avons eu bonne raison de ces paillards de Cahors. Vostre mary ne m'y a quitté
de la longueur de sa hallebarde ; et nous conduisoit bien Dieu par la main
sur le bel et bon estroit chemin de saulveté (de salut) ; car force des nostres
que je regrette fort sont tombez à costé de nous... C'est le mardi 31 mai 1580 que Henri annonçait à sa cousine la baronne de Batz l'issue heureuse de cet assaut de quatre jours ouvert le samedi 28. Le lendemain il n'était pas revenu de l'ivresse à la fois joyeuse et mélancolique de ce triomphe acheté au prix de la mort vue de si près, et de tant d'amis perdus, et il écrivait à M. de.Scorbiac une lettre, où se remarque le passage suivant : Je croy que vous aurès esté bien esbahi de la prise de ceste ville ; elle est aussy miraculeuse, car aprez avoir esté maistre d'une partie, il a fallu acquérir le reste pied à pied, de barricade en barricade. La prise de Cahors marque un point décisif, un point de phase dans la carrière d'Henri IV, et eut des résultats politiques et militaires très-supérieurs à la précaire possession de cette ville, qui dut être rendue à la paix signée à Fleix, le 26 novembre 1580. A dater de l'entreprise de Cahors, le prince cheval-léger devient un prince militaire, encore susceptible de céder à de téméraires entraînements, mais capable aussi de ces combinaisons que toute la bravoure du monde ne donne ni ne supplée, capable en un mot de toutes les habiletés et de toutes les vertus du commandement. De capitaine Henri passe général. De prince prétendant, il devient, si les têtes qui le séparent encore du trône s'effacent, un roi possible. Il a enfin une armée et un parti. Il a conquis à Cahors l'attention de l'Europe et la sympathie de la France. Il va mériter l'une et l'autre, à cette première bataille, à cette première victoire de Coutras où Henri, mûri par l'expérience, se montre un grand politique, en tendant au roi de France la main du roi de Navarre, et en offrant à l'autorité souveraine, tenue en échec par la Ligue catholique, l'épée de la Ligue protestante ; où il se montre un grand capitaine en battant son adversaire et en gardant de l'enivrement du triomphe ces deux grandes et rares qualités sans lesquelles il n'en est point de durables : la modestie et la clémence. |