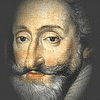HENRI IV
LIVRE PREMIER. — LE ROI DE NAVARRE - 1553-1585
CHAPITRE II. — LES NOCES VERMEILLES - 1571.
|
Henri II de Béarn, Henri III de Navarre, futur Henri IV de France, épousa Marguerite de Valois le lundi 18 août 1572, suivant le commun des historiens et Sully lui-même qui, il est vrai, se trompe parfois sur les dates ; le samedi 16 août, suivant quelques autres, qui fondent leur attribution sur un document du musée du Louvre[1]. La Saint-Barthélemy est de la nuit du samedi 23 août au dimanche 24. Ce simple rapprochement, que nous plaçons en tête de cette étude, en résume l'intérêt tragique et la leçon funèbre, trop conformes aux prophétiques pressentiments de Jeanne d'Albret, et à cette énergique répugnance du vieux Rosny, père de Sully, qui refusa d'assister aux fêtes de cet hymen fatal, scellé par la raison d'État, dont les livrées, suivant lui, devoient être vermeilles. Pouvait-il, en effet, rien sortir de pur, d'heureux, de fécond de ce mariage funèbre auquel la mort avait présidé ? N'était-elle pas d'avance condamnée, maudite et stérile, cette union contractée malgré l'incompatibilité d'humeur, de religion, malgré les prohibitions canoniques, cette union suspecte, qui voilait les desseins de deux partis prêts à s'entr'égorger, et que la prévoyante Jeanne d'Albret reculait sans cesse, tandis que le sombre Charles IX en pressait la conclusion avec une impatience farouche ? Dès le mois de mars 1572, Jeanne d'Albret, obligée par la politique à consentir à un hymen que redoutait son affection, exhortait son fils à profiter du moins pour sa liberté d'un mariage où elle tremblait qu'il ne trouvât pas le bonheur, surtout s'il ne s'empressait de fuir cette cour empestée, et d'emporter au galop sa jeune femme dans l'air sauveur du patriarcal Béarn. Elle est belle et bien advisée et
de bonne grâce, écrivait Jeanne d'Albret à son fils, mais nourrie en la plus
maudite et corrompue compagnie qui fut jamais. Car je n'en vois point qui ne
s'en sente... je ne voudrois, pour chose du
monde, que vous y fussiez pour y demeurer... Voilà
pourquoi je désire vous marier, et que vous et votre femme vous retiriez de cette
corruption, car encore que je la croyois bien grande, je la trouve encore
davantage[2]... Pendant ce temps, mû par des sentiments contraires, Charles IX tenait un langage bien différent, et, trahissant une impatience sinistre, il s'emportait contre le pape et ses scrupules, qui retardaient la vengeance du catholicisme et de la royauté, en cyniques invectives. C'est avec contrainte, avec répugnance, avec frisson au cœur que les deux jeunes époux s'avancèrent ensemble vers l'autel, après cette cérémonie tout extérieure, ce mariage en plein vent, sur un théâtral échafaud, entre une princesse catholique et un prince protestant qui n'a obtenu que le droit de traverser le temple. Quel saisissant et ironique symbole d'une union sans élan, sans tendresse, sans fruit, que cette rapide promenade nuptiale dans l'église de deux époux distraits et se tenant à peine du bout des doigts comme du bout des cœurs ! Au moment suprême, Marguerite, dit-on, hésita. Sa bouche muette se refusait à prononcer le sacrilège serment. Son consentement fut un silence, pendant lequel le roi son frère, appesantissant sur sa tête éplorée sa brutale main de chasseur, tenait sa tête inclinée en signe d'assentiment ou du moins de résignation. Que lui importaient, après tout, ces larmes, ces pâleurs, ces terreurs, cette dernière révolte contre une barbare destinée ? Son but était atteint. Il pouvait recevoir sur la façon dont il avait joué son rôlet les félicitations de sa machiavélique mère, l'encourageant à les mériter encore davantage. Malgré de nombreux avertissements, les indiscrétions même échappées à la loyauté ou à la légèreté de quelques-uns des affidés d'un complot qui menaçait et affiliait trop de monde pour être resté complètement mystérieux, malgré l'exemple de la prudente défection de quelques avisés qui profitèrent du conseil qu'on leur avait donné de partir, l'assistance était aussi nombreuse que brillante à Notre-Dame et au Louvre ; et, par une sorte de point d'honneur d'insouciance ou de dévouement, les seigneurs protestants se pressaient en foule à ces fatales noces que devait ensanglanter le massacre de dix mille victimes. Charles IX ne dissimulait point sa satisfaction de cette émulation chevaleresque, de ce galant empressement. Les charmes de Marguerite servant d'appeau au farouche oiseleur, il avait pris à la pipée tous les huguenots. Il avait dit gracieusement qu'il donnait sa sœur pour sauvegarde à tous les protestants du royaume. Ce n'était là qu'un compliment, peut-être une épigramme. La vérité est que la malheureuse princesse trahissait innocemment tous ceux à qui elle avait inspiré si naturellement confiance, et qu'elle les livrait sans le savoir aux arquebuses et aux poignards de deux mille bourreaux fanatiques et mercenaires, ivres de vin, de sang et d'or, certains de l'impunité, et, chose plus horrible, de la récompense ! Aussi, tandis que Henri et Marguerite, dans les rares intermèdes de ces fêtes fiévreuses où chacun s'étourdissait à l'envi, ceux-ci sur le danger, et ceux-là sur le crime, tremblaient le soir et frissonnaient au réduit nuptial, épiant les gens suspects, prêtant au moindre bruit une oreille inquiète, interrogeant les tapisseries ondoyantes d'un œil brûlant d'insomnie, Charles 1X se frottait joyeusement les mains dans le cercle des flatteurs intimes et des exécuteurs serviles, et exhalait en cyniques propos la satisfaction sinistre de l'ogre qui flaire la proie. Pauvre prince, après tout, et qu'il faut plutôt plaindre que blâmer, car il fut la dupe et la victime de cette mère implacable, au visage de Fatalité, qui s'attacha à corrompre, dans cet enfant intelligent et généreux, les sources de la vertu et de la vie, autant que les bonnes mères s'attachent à les garder de toute souillure ! Pauvre prince, après tout, que Catherine s'était appliquée à rendre féroce, comme elle s'était appliquée à rendre Alençon envieux et Anjou efféminé, dont elle avait pétri l'âme naïve en ses doigts de Furie, dont elle avait fasciné le cœur et ensorcelé l'esprit, et qui souriait comme un homme ivre à ces diaboliques desseins dont elle lui soufflait l'orgueil, dont elle lui laissait la faute et gardait le profit ! Pauvre prince, après tout, mort jeune, désespéré, furieux, protestant, en présence de la tardive vérité, contre le crime de son aveugle obéissance, 'maudissant sa mère, embrassant Henri qui avait failli être sa victime, regrettant la gloire, la jeunesse, la vie, et détestant ce massacre dont le remords le tuait ! Pour être juste aussi de toute façon et demeurer à la fois dans la vérité de l'histoire et dans celle du cœur humain, il faut reconnaître que d'après ces élégants, charmants, superficiels et artificiels Mémoires (un des bijoux de notre langue et de notre littérature), où Marguerite de Navarre passe en revue, avec une indulgence pour elle-même qui n'a d'égale que son indulgence poulies autres, les événements de sa vie orageuse et aventureuse, elle ne semble pas avoir été longtemps inconsolable de son sort. Elle ne semble pas avoir gardé trop de rancune ni à sa mère ni à son frère, ni au destin, de la décision imprévue et déplorée d'abord, bientôt supportée avec la plus aimable et la plus philosophique résignation, qui avait fait d'elle, à la satisfaction de sa vanité et de son ambition, sinon à celle de son cœur, la femme d'Henri de Bourbon et la reine de Navarre. Le propre, le charme, l'excuse de ces êtres légers, attrayants et décevants, comme Marguerite, c'est d'être les instruments autant passifs qu'actifs des disgrâces des autres et des leurs, de partager les illusions qu'ils donnent et de souffrir du mal qu'ils font, d'être, en un mot, autant et plus dupes que fripons. C'est cette mobilité d'impression, cette facilité d'illusion, ce goût de la nouveauté qui rendirent d'abord très-supportable à Marguerite et même à Henri cette union contractée non sans contrainte et sans appréhension. Henri, jeune, spirituel, courageux, galant, déjà populaire, n'était point, après tout, pour Marguerite, un pis aller de désespoir. De son côté, Henri n'aurait pu se montrer insensible, sans une mauvaise grâce dont il était incapable, à l'effet du charme de sa personne réparant, aux yeux de Marguerite, la faute d'un titre imposé, et au goût qu'il lui inspirait, suppléant à l'absence de cette liberté du choix dont l'un et l'autre avaient été privés. Tout cela explique la faveur attendrie avec laquelle Marguerite dans ces confidences, sincères et frivoles comme elle, — œuvre rapide de quelques soirées de loisir et de rêverie, entreprise en des circonstances où un tel soin atteste une singulière liberté d'esprit, — parle des premiers temps de ce mariage tragique qui eut parfois de si bonnes scènes de comédie. Elle n'y fait allusion dans ses Mémoires qu'avec cette sérénité bienveillante dont témoigne le seul fait d'un tel ouvrage. Car on ne se comptait à se souvenir que lorsqu'on a pardonné aux autres et à soi-même. Marguerite, en un mot, semble plus regretter que maudire ces temps où elle était si malheureuse. C'est qu'elle les revoit dans ses souvenirs comme elle les vit alors, à travers le prisme magique de cette jeunesse qui change si facilement le mal en bien, le laid en beau, l'amer en doux, la crainte en espérance, le deuil lui-même en joie, de cette jeunesse qui console de toue, et se console de tout, parce qu'elle embellit tout et au besoin tient lieu de tout. Marguerite avait, lors de son mariage (étant née le 14 mai 1552), vingt ans et trois mois. Henri était un peu plus jeune. Il suffit de rappeler leur âge pour faire comprendre comment, pendant quelque temps, ces deux époux unis malgré eux, dupes du même mirage, purent croire tous deux, en dépit des protestations de la conscience et des murmures du cœur, être aimés et être heureux. Les mêmes motifs expliquent comment Marguerite avait, au bout de quelques jours, si bien pris son parti de ce mariage, considéré d'abord par elle comme un supplice, et auquel elle avait fait, vis-à-vis de son impérieuse mère, une si énergique et si inutile résistance ; comment enfin, en le racontant, sa vanité s'occupe surtout de l'éclat de la cérémonie, et sa coquetterie se souvient surtout du succès de sa toilette. C'est vraiment sans trop d'amertume ni de regrets que Marguerite se remémore les circonstances de ces nopces qui se feirent avec autant de triomphe et de magnificence que de nulle autre de ma qualité. Elle s'y peint complaisamment et s'y mire, pour ainsi dire, dans son souvenir, telle qu'elle apparut aux yeux ravis de la cour, habillée à la royale, avec la couronne et couet (ou corcet) d'hermine mouchetée, qui se met au devant du corps, toute brillante de pierreries de la couronne, et le grand manteau bleu à quatre aulnes de queue porté par trois princesses. Elle revoit, fièrement éblouie, les eschaffaux dressés à la coutume des nopces des filles de France, depuis l'Évesché jusqu'à Notre-Dame, tendus et parés de drap d'or ; le peuple s'estouffant en bas à regarder passer sur cet eschaffaut les nopces et toute la cour.... C'est ainsi, ajoute-t-elle, que nous vinsmes à la porte de l'église, où Monsieur le cardinal de Bourbon y faisoit l'office ce jour-là, où nous ayant receus pour dire les paroles accoustumées en tel cas, nous passâmes sur le même eschaffaux jusques à la tribune qui sépare la nef d'avec le chœur, où il se trouva deux degrez, l'un pour descendre audit chœur, l'autre pour sortir par la nef hors l'église. Enfin Marguerite, se reportant à la sombre nuit si différente de cette radieuse journée, déplore avec une gracieuse mélancolie, avant de passer au récit de ses pitiés, de ses terreurs et de ses angoisses pendant le massacre, que la Fortune, qui ne laisse jamais une félicité entière aux humains, ait changé bientost cet heureux estat de nopces et triomphe en un tout contraire. Cette phrase de regret naïf, exprimé dans la forme emphatique naturelle à l'époque, nous sert à propos de transition pour passer à l'événement qui devait apporter, dans la situation et dans l'âme d'Henri, de si profondes, de si douloureuses modifications, et déterminer la crise décisive de sa vie. Par une double raison de convenance et d'harmonie, nous ne raconterons pas en détail la boucherie du 25-24 août 1572. Nous ne saurions le faire sans dégoût pour nous et pour nos lecteurs, surtout sans rompre cette unité de plan et d'intérêt qui n'accorde à chaque partie qu'une place proportionnée au tout, et s'oppose à toute digression à propos d'un événement purement épisodique dans la vie de notre héros. Nous ne dirons donc de la. Saint-Barthélemy que ce qui se rapporte directement et personnellement à Henri. Nous ne ferons qu'entrouvrir le rideau sur cette sanglante saturnale, sur cette orgie de soldats-bourreaux, semant dans les rues de Paris l'épouvante et la mort au bruit des cloches et à la lueur des flambeaux. Nous nous transporterons au centre même de la conspiration royale, au rendez-vous des sicaires, au quartier général de la tuerie dont Charles IX devait donner l'ordre et l'exemple, c'est-à-dire au Louvre même. C'est là que le massacre commença par les serviteurs du prince de Condé et du roi de Navarre, au grand dommage, à l'éternelle honte de l'hospitalité et de la loyauté d'un roi, et menaça les maîtres sans oser les frapper, se contentant, pour rançon de leur vie, du sacrifice de leur honneur. Il en est de ce drame comme de toutes les batailles, dont chaque témoin ne voit jamais bien qu'un côté, tout le reste demeurant enveloppé dans des nuages de poussière et de fumée, et dont les meilleurs narrateurs ont toujours été ceux qui, se contentant de raconter ce qu'ils ont vu, l'ont su faire avec cette émotion et cette sincérité qui permettent de deviner tout ce qu'ils ne disent pas. On ne saurait refuser un tel mérite au récit de Marguerite de Navarre, à défaut de celui d'Henri, qui n'a jamais osé écrire ces scènes funestes, dont il osait à peine se souvenir. Nous ne savons rien de plus naïf, de plus touchant, de plus poignant que ce récit, par Marguerite elle-même, de la nuit de la Saint-Barthélemy, simple esquisse supérieure à bien des descriptions plus achevées, tableau de genre plus éloquent que bien des tableaux d'histoire. Elle ne dit que ce qu'elle a vu ; mais comme elle l'a senti et comme elle le fait sentir profondément ! Comme son émotion se communique au lecteur et le fait tressaillir, frissonner et trembler avec elle ! Comme une juste terreur, mêlée d'une généreuse pitié, a gravé dans sa mémoire les plus caractéristiques détails ! C'est par cette unique scène dont elle fut témoin, et qui souilla de sang la chambre royale et nuptiale, qu'on apprécie mieux que par des chiffres et des détails l'horreur de celte nuit fatale. On peut conclure de ce qu'on voit, surtout en un tel lieu, qui a cessé d'être sacré et inviolable, à ce qu'on ne voit pas, et de ce qu'on sait à ce qu'on ignore. On arrive naturellement ainsi à cette émotion intense que le pathétique le plus savant ne donne pas toujours, et sans laquelle, pour notre part, nous n'avons jamais pu lire cet épisode si simplement et par là même si magistralement raconté par Marguerite. Nous laissons donc la parole à la reine de Navarre, certain que nos lecteurs ne s'en plaindront pas. Elle peint d'abord en termes naïfs son isolement au milieu de cette cour en complot, où son mariage la rendait suspecte, et l'impression glaciale que lui laissaient ces menaçants mystères qui s'agitaient autour d'elle. Pour mov, l'on ne me disoit rien de tout cecy. Je voyois tout le monde en action ; les huguenots désespérés de cette blessure[3] ; Messieurs de Guise, craignant qu'on n'en voulust faire justice, se suschetant (chuchotant) tous à l'oreille. Les huguenots me tenoient suspecte, parce que j'estois catholique ; et les catholiques, parce que j'avois espousé le roy de Navarre, qui estoit huguenot. De sorte que 'personne ne m'en disoit rien, jusques au soir qu'estant au coucher de la royne ma mère, assise sur un coffre auprès de ma sœur de Lorraine, que je voyois fort triste, la royne, ma mère, parlant à quelques-uns, m'apperceut, et me dague je m'en allasse coucher. Comme je lui faisois la révérence, ma sœur me prend par le bras et m'arreste, en se prenant fort à pleurer, et me dict : Mon Dieu ! ma sœur, n'y allez pas ! ce qui m'effraya extrêmement. La royne ma mère s'en apperceut
et appela ma sœur, et s'en courrouça fort à elle, luy deffendant de me rien
dire. Ma sœur luy dit qu'il n'y avoit point d'apparence de m'envoyer
sacrifier comme cela, et que, sans double, s'ils découvroient quelque chose,
ils se vengeroient sur moy. La rogne ma mère respond que s'il plaisoit
d Dieu, je n'aurois point de mal ; mais, quoy que ce rust, il falloit que
j'allasse, de peur de leur faire soupçonner quelque chose qui empeschât l'erfect. Je voyois bien qu'ils se contestoient, et n'entendois pas leurs paroles. Elle me commanda encore rudement que je m'en allasse coucher. Ma sœur, fondant en larmes, me dit bon soir, sans m'oser dire autre chose ; et moi je m'en vais toute transie, esperdue, sans me pouvoir imaginer ce que j'avois à craindre. Soudain que je fus en mon cabinet, je me mets â prier Dieu qu'il luy plust me prendre en sa protection, et qu'il me gardast, sans savoir de quoy ni de qui. Sur cela, le roy mon mary, qui s'estoit mis au lict, crie manda que je m'en allasse coucher, ce que je feis, et trouvay son lict entouré de trente ou quarante huguenots, que je ne cognoissois point encore, car il y avoit fort peu de jours que j'estois mariée. Toute la nuict, ils ne firent que parler de l'accident qui estoit advenu à Monsieur l'Admiral, se résolvants, dès qu'il seroit jour, de demander justice au roy de Monsieur de Guise, et que si on ne la leur faisoit, qu'ils se la feroient eux-mesmes. Moy, j'avois toujours dans le cœur les larmes de ma sœur, et ne pouvois dormir, pour l'appréhension en quoy elle m'avoit mise, sans savoir de quoy. La nuict se passa de cette façon, sans fermer l'œil. Au poinct du jour, le roy, mon mary, dict qu'il vouluit aller jouer à la paume, attendant que le roy Charles seroit esveillé, se résolvant soudain de luy demander justice. Il sort de ma chambre, et tous ses gentilshommes aussy. Moy, volant qu'il estoit jour, estimant que le danger que ma sœur m'avoit dict fust passé, vaincue du sommeil, je dis à ma nourrice qu'elle fermast la porte, pour pouvoir dormir à mon aise. Une heure après, comme j'estois
plus endormie, voicy un homme frappant des pieds et des mains à la porte, criant
: Navarre
! Navarre ! Ma nourrice, pensant que ce fust le roy mon mary, court vistement à la porte et lui ouvre. Ce fut un gentilhomme, nommé M. de Léran[4], qui avoit un coup d'espée dans le Coude et un coup de hallebarde dans le bras, et estoit encore poursuivy de quatre archers qui entrèrent tous après luy en ma chambre. Luy, se voulant guarantir, se jeta sur mon lict. Moy, sentant cet homme qui me tenoit, je me jette à la ruelle, et luy après moy, me tenant toujours au travers du corps. Je ne cognoissois point cet homme, et ne sçavois s'il venoit là pour m'offenser, ou si les archers en vouloient à luy ou à moy. Nous ayons tous deux et estions aussi effrayés l'un que l'autre. Enfin, Dieu voulut que M. de
Nançay, capitaine des gardes, y vint, qui me trouvant en cet estat-là, encore
qu'il y eut de la compassion, ne se peust tenir de rire, et se courrouçant
fort aux archers de cette indiscrétion, il les fist sortir et me donna la vie
de ce pauvre homme qui me tenoit, lequel je feis coucher et panser dans mon
cabinet jusques à tant qu'il fust du tout guary. Et changeant de chemise, parce qu'il m'avoit toute couverte de sang, M. de Nançay me conta ce qui se passoit, et m'asseura que le roi mon mary estoit dans la chambre du roy et qu'il n'avoit point de mal. Me faisant jetter un manteau de nuict sur moy, il m'emmena dans la chambre de ma sœur, Madame de Lorraine, où entrant dans l'antichambre, de laquelle les portes estoient toutes ouvertes, un gentilhomme, nommé Bourse, se sauvant des archers qui le poursuivoient, fust percé d'un coup de hallebarde à trois pas de moy. Je tombay de l'aultre costé, presque évanouie, entre les bras de M. de Nançay, et pensois que ce coup nous eut percez tous deux. Et estant quelque peu remise, j'entray en la petite chambre où couchoit ma sœur. Comme j'estois là, M. de Miossens, premier gentilhomme du roy mon mary, et Armagnac, son premier vallet de chambre, m'y vinrent trouver pour me prier de leur sauver la vie. Je m'allay jetter à genoux devant le roy et la royne ma mère, pour les leur demander, ce qu'enfin ils m'accordèrent..... Mais revenons à Henri de Navarre, dont le sort demeura incertain pendant plusieurs jours, et qui n'échappa au martyre dont on le menaçait que par l'abjuration qu'on lui imposa. Pliant pour ne pas rompre, préférant se baisser que tomber, Henri passa sous le joug en attendant qu'il pût le briser, se résigna à être petit en attendant qu'il put se montrer grand ; et, avec une feinte insouciance, une malicieuse souplesse, il se déroba à la haine, en affectant de n'être pas à craindre et en permettant presque qu'on le méprisât. Il n'y avait pas à hésiter entre un sacrifice nécessaire et un héroïsme inutile. Il fallait contrefaire la frivolité, la nullité même et une sorte de joyeuse folie pour détourner de son front la foudre d'un roi capable de tous les crimes, de la violence d'une reine capable de tous les forfaits de la ruse, qui ne se décidèrent à épargner Henri que grâce à l'art qu'il eut de leur persuader qu'il était indigne de la haine de l'un et des soupçons de l'autre. Ce n'était pas le moment de faire le rodomont. On peut apprécier le danger que courut Henri quand on connaît le double courant d'opinions contraires qui divisa et passionna, même après son exécution, les délibérations du conseil des massacres. Dans les délibérations orageuses de ces conciliabules présidés par un roi et une reine, tout le monde était d'accord sur le but ; mais deux partis se disputaient les moyens, les uns inclinant à se montrer implacables pour les chefs seulement, et à épargner les femmes, les enfants et les princes trop jeunes pour n'être pas innocents ; tes autres prêchant, si l'on voulait obtenir une sécurité complète, l'inexorabilité absolue, et déclarant volontiers qu'il fallait envoyer à Dieu tous les proscrits, sauf à lui à reconnaître les coupables. Le premier avis était celui du maréchal de Tavannes, qui voulait une bataille et non une boucherie, ou tout au moins une exécution méthodique, exempte de toute erreur et de toute faute (une fois admis le principe d'un cas de salut public), sinon de tout reproche. Tavannes parlait en soldat, et si l'on tient compte des idées et des mœurs du temps, avec une certaine justice dans l'injustice, une certaine noblesse dans la cruauté, une certaine indépendance dans la servilité. Mais son contradicteur, le maréchal de Retz, n'admettait ni circonstances atténuantes, ni clémences inopportunes, ni exceptions dangereuses. Sa politique sans entrailles ne connaissait pas le pardon ; et la pitié paraissait plus qu'un crime, une faute, à ce dialecticien farouche dont l'histoire nous a conservé la démonstration brutale comme un mousquet, tranchante comme une épée. Voici ce raisonnement typique, devenu celui de toutes les révolutions d'en bas, après l'avoir été de toutes les révolutions d'en haut, que la théorie des coups de peuple a emprunté à la doctrine des coups de roi, et dont Robespierre et Saint-Just devaient se servir pour détruire la monarchie, comme elle s'en était servie pour se défendre. Il disait : Qu'il falloit tout
tuer ; que ces jeunes princes, nourris en la religion, cruellement offensés
de la mort de leur oncle et de leurs amis, s'en ressentiroient ; qu'il ne
falloit point offenser à demi ; qu'en ces desseins extraordinaires il falloit
considérer premièrement s'ils estoient nécessaires, contraints ou justes ;
les ayant jugez tels, il n'y falloit rien laisser qui peust causer la ruine
du but de paix où l'on tendoit ; que s'il estoit juste en un chef, il ne
l'estoit en tous, puisque des parties joinctes, dépendoit l'effet principal
de l'action, il les falloit couper, à ce que les racines 'ne restassent ;
aussi, s'il n'estoit juste, il falloit s'en distraire du tout, et
n'entreprendre rien ; au contraire, que si on rompoit les lois, il falloit
les violer entièrement pour sa seureté, le péché estant aussi grand pour peu
que pour beaucoup... L'opinion du maréchal de Tavannes, plus modérée que celle de son absolu et peu scrupuleux collègue, prévalut ou du moins parut prévaloir ; non-seulement parce que son système se pliait davantage à l'imprévu et comportait des tempéraments dont on pouvait avoir besoin, mais encore et surtout parce que la complaisance du maréchal de Retz pour la politique à outrance sembla inspirée plus encore par certaines arrière-pensées ambitieuses que par son dévouement au roi. Un zèle si impatient finit par inquiéter des maîtres naturellement enclins à la méfiance et qui ne purent croire un tel serviteur désintéressé. On ajourna donc le parti à prendre définitivement vis-à-vis d'Henri de Navarre. On le guetta à la première occasion, à la première imprudence, au premier transport irréfléchi d'un sang impétueux faisant tomber le masque et livrant à ses ennemis le secret de sa dissimulation. En attendant, Catherine de Médicis n'hésita point à le miner auprès de sa jeune épouse, et à la sonder habilement pour savoir si elle se prêterait à un démariage. Ces cauteleuses négociations furent déconcertées et arrêtées net par la résistance imprévue de Marguerite. La fine, et en cette occasion généreuse princesse, sentit le piège et rougit qu'on l'eût pu croire capable d'y tomber et d'abandonner son mari parce qu'il était malheureux. Elle profita donc malicieusement des armes qu'on lui donnait, se montra peu sensible à ce tardif intérêt qu'on lui témoignait après l'avoir sacrifiée ; enfin, se doutant bien qu'on ne la tâtait ainsi que pour trouver les moyens de jouer un mauvais tour à son mari, elle déclara que puisqu'on l'avoit mise avec lui, elle y vouloit demeurer, et n'avoit point le cœur de cire. Catherine en fut donc pour ses frais de sollicitude maternelle. Elle dut ajourner l'entière vengeance et la revanche complète auxquelles la poussait le duc de Guise, son allié du moment, l'ami apparent et en réalité l'implacable rival, en ambition et en amour, de cet Henri qui lui barrait le chemin du trône, après lui avoir enlevé la main, sinon le cœur de la princesse qu'il s'était flatté en vain d'épouser. Quand on songe d'ailleurs à la scène terrible que nous allons raconter, à cette abjuration dont Henri eut à payer sa vie, à la douleur qu'il dut ressentir de la perte de la plupart de ses amis, au supplice volontaire de cette déchéance, dans laquelle il sembla se complaire, s'appliquant, lui si soucieux de renommée, à se faire oublier, lui si avide d'affection, à paraître ingrat ; quand on songe enfin à l'ennui de cette captivité oisive dont il lui fallut paraître s'amuser, on trouve Henri assez malheureux pour que Catherine fût heureuse et ne se reprochât pas trop cette indulgence humiliante achetée si cher et plus cruelle peut-être que ses rigueurs. Pour calculer ce que dut éprouver de joie l'âme ambitieuse et vindicative de Catherine, qu'on se représente, en effet, ce que dut souffrir Henri quand, au bruit des cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois sonnant le lugubre signal des massacres, aux cris féroces retentissant autour du Louvre de : Tue ! tue ! à mort les huguenots ! par lesquels la populace et les soldats s'appelaient à la rescousse et s'excitaient mutuellement, il fut, ainsi que son compagnon, le prince de Condé, brutalement réveillé, deux heures avant le jour, par une multitude d'archers de la garde qui se précipitèrent effrontément dans la chambre du Louvre où ils couchaient, et leur ordonnèrent avec insolence de s'habiller en hâte et de venir chez le roi. On leur défendit de prendre leurs épées, et, ainsi surpris et désarmés, ils furent conduits, pour ne pas dire entraînés, chez un prince maître de leur vie, par une escorte qui semblait, en massacrant sous leurs yeux leurs amis, se préparer à l'ordre de les immoler eux-mêmes. Sully et Péréfixe nous ont montré les malheureux princes qui croyaient marcher à la mort traversant, par un infernal raffinement de Catherine, les voûtes d'un passage obscur que remplissait une double haie de gardes armés de hallebardes et de carabines, et où se répercutaient les cris des assassins et les cris des mourants. C'est à ce moment d'angoisse terrible, quand il vit achever, sans pouvoir les secourir, ses plus fidèles compagnons, quand il entendit, sans pouvoir protester, les plaintes trop fondées et peut-être les injustes reproches de leur agonie désespérée, qu'Henri, accusé d'être la cause d'une confiance qui lui coûtait si cher à lui-même et d'un sort qu'il faillit partager, dut éprouver la première et la plus intense de ces dévorantes secousses morales qui devaient faire grisonner de si bonne heure (dès trente-cinq ans) ces cheveux et cette barbe sur lesquels ; disait-il plus tard lui-même, avait précocement soufflé la bise de l'adversité. Charles attendait les deux suspects, les deux coupables, les deux condamnés auxquels il ne restait plus qu'à mériter leur grâce au qu'à subir leur sort. Il les reçut avec un visage et des yeux où la fureur était peinte. Il leur commanda, avec les jurements et les blasphèmes qui lui étaient familiers, de quitter la religion qu'ils n'avaient embrassée, disait-il, que pour servir de prétexte à leur rébellion. L'état où l'on réduisoit ces princes n'ayant pu les empêcher de témoigner la peine qu'ils auroient à obéir, la colère du roi devint excessive. Il leur dit d'un ton altéré et plein d'emportement qu'il ne prétendoit plus être contredit dans ses volontés par ses sujets ; qu'ils eussent à apprendre aux autres, par leur exemple, à le révérer comme étant l'image de Dieu, et à n'être plus les ennemis des images de sa mère. Il finit par leur déclarer que si de ce pas ils n'alloient à la messe, il alloit les faire traiter comme criminels de lèse-majesté divine et humaine. Le ton dont ces paroles furent prononcées ne permettant pas à ces princes de douter qu'elles ne fussent sincères, ils plièrent sous la violence et firent ce qu'on exigeoit d'eux[5]. Qui pourrait les blâmer d'une faiblesse qui, en pareil cas, échapperait aux plus forts ? Qui pourrait leur reprocher d'avoir traité leur persécuteur comme il le méritait, d'avoir trompé qui les trompait, d'avoir payé de la fausse monnaie d'une soumission feinte ce convertisseur couronné, qui n'admettait pas la contradiction, et se croyait encore clément en leur laissant le choix entre la messe ou la mort, le prêtre ou le bourreau ? Quand la torture interroge, c'est rarement la vérité qui répond. Un Charles IX n'a droit qu'à l'hommage contraint de faux prosélytes ; et un zèle aussi cruel n'est digne que de l'hypocrisie. Receperunt mercedem suam, dit l'Écciture, rani, vanam. Sans doute Henri de Navarre eût pu s'abstenir et risquer, même braver le martyre, mais ce martyre eût privé la France de son plus grand roi, qui se contenta d'être un héros, quand il lui fut permis de l'être, et se résigna à n'être plus qu'un avisé politique quand il ne put pas faire autrement. Faiblesse, si l'on veut, cette faiblesse nous le rend plus cher, parce qu'elle le montre plus humain. Plus sublime nous l'admirerions davantage, nous l'aimerions peut-être moins. La Saint-Barthélemy coûta à Henri de Navarre, parmi ses amis, Jacques de Ségur, baron de Pardaillan ; Armand de Clermont, baron de Piles ; François de la Rochefoucauld, qui, ayant joué une partie de la nuit avec le roi et se voyant saisir dans son lit par des gens masqués, crut que le roi et ses courtisans venaient le surprendre et le fouetter par jeu ; Antoine de Clermont, marquis de Resnel, tué par son propre parent Louis de Clermont de Bussy d'Amboise, avec lequel il était en procès pour le marquisat de Resnel ; car on devine, sans qu'il soit besoin d'insister, le parti que tirèrent les haines privées de la haine publique et l'usage que firent les passions du temps, ambition, rivalités, jalousies, de cette occasion monstrueuse et unique de se débarrasser d'un ennemi, d'un compétiteur, d'un parent trop lent à mourir, et de s'assurer des héritages hâtifs ou une vengeance impunie. Citons encore, parmi les victimes illustres et chères à Henri, de cette nuit funeste où le roi donna à la multitude le signal de ses fureurs, et où fraternisèrent, dans le sang d'une boucherie uniforme, les armes populaires et les armes militaires, Charles de Quellenec, baron du Pont, dont la mort, suivie de profanations odieuses, est un des plus tristes témoignages de la cruauté et de la licence du temps ; François Nompar de Caumont la Force, qui fut surpris par le meurtre dans le lit de famille, couché entre ses deux fils, dont l'un fut poignardé à ses côtés, dont l'autre, blessé, n'échappa au coup suprême qu'en contrefaisant le mort et en se cachant sous les corps de son père et de son frère ; Téligny, gendre de l'amiral ; Charles de Beaumanoir de Lavardin ; Antoine de Marafin, sieur de Guerchy ; MM. de Beaudisner, Pluviant-Berny ; de Brion, gouverneur du marquis de Conty ; Beauvoir, gouverneur du roi de Navarre lui-même ; de Colombiers, de Francourt. Parmi les compagnons et les amis d'Henri de Navarre qui échappèrent au massacre et qui demeurèrent acquis à sa fortune, il faut citer le comte de Montgommery, meurtrier involontaire d'Henri II, qui fut en vain poursuivi jusqu'à Montfort-l'Amaury par le duc de Guise, et ne se déroba au poignard des assassins que pour se réserver, sans le savoir, à la hache du bourreau ; les trois frères du maréchal de Montmorency, qu'on épargna dans la crainte de s'exposer aux représailles d'un tel capitaine ; François de Chatillon, fils de l'amiral, et Guy de Laval, fils de d'Andelot, qui purent se sauver et se réfugier à Genève ; Armand de Gontaut-Biron, qui trouva un asile à l'Arsenal, y fit mine de s'y fortifier et de s'y défendre, et en imposa par cette fière contenance et cette résistance imprévue, à des ennemis non moins lâches que cruels. A ces noms il faut ajouter ceux des seigneurs protestants, plus clairvoyants ou plus méfiants que les autres, qui s'étaient tenus à distance de la souricière du Louvre et avaient quitté la cour ou même Paris, ou du moins s'étaient tenus dans les faubourgs, prêts à décamper à la moindre alerte. Le baron de Rosny, père de Sully, n'avait eu garde de se
lier à cette patte de velours qu'on lui tendait, et sous laquelle perçait à
ses yeux expérimentés la griffe impatiente de la proie. Il avait opiniâtrement
résisté à toutes les insinuations, à tous les exemples, se résignant à jouer
le rôle de Cassandre pour les autres, mais non pour lui-même, et trop avisé
pour aller se jeter dans la gueule du loup, dont ses prophétiques
avertissements avaient en vain essayé de détourner tant d'amis, bientôt
victimes de leur incrédulité. Malheureusement il lui fut difficile de
préserver son fils, retenu par ses études à Paris, et que sa jeunesse
semblait devoir rendre inviolable, de ces dangers auxquels il s'était dérobé
en disant, non sans malice : que l'air des faubourgs
était meilleur à sa santé que celui de la ville, et celui des champs encore
davantage. Sully nous a raconté lui-même, dans un passage émouvant de ses Mémoires, comment, réveillé au milieu de la nuit par les cris de mort et la visite de son hôte éperdu, il s'évada du logis menacé et trouva au collège de Bourgogne un asile précaire, dans lequel il demeura enseveli trois jours entiers, en proie à de légitimes angoisses et suspendu entre la vie et la mort. Quand il fut délivré de sa cachette, ce ne fut que pour pleurer sur le sort inconnu, mais trop facile à deviner, de son gouverneur et de son valet. Leur mort inaperçue avait peut-être empêché la sienne, en occupant les premiers coups de la populace et de la soldatesque ameutées, et en lui permettant de profiter de la diversion pour arriver, protégé par sa robe d'écolier et surtout la grosse paire d'Heures qu'il portait sous son bras, jusqu'au collège de Bourgogne et à l'asile de la cellule où le cacha M. Lafaye, principal du collège, homme de bien et qui l'aimoit tendrement. Pour Théodore-Agrippa d'Aubigné, avec qui nous ferons, au chapitre suivant, plus ample connaissance, son tempérament aventureux et son humeur batailleuse lui avaient ménagé, la veille du massacre, dans la nécessité de fuir, — à la suite d'une affaire d'honneur et d'une rixe avec les sergents — le plus rare et le plus opportun des alibi. A quelque chose malheur est bon. D'Aubigné fut donc sauvé par la folie qui l'obligea de fuir, là où tant d'autres furent perdus par la sagesse qui leur conseilla de rester. Henri de Navarre et le prince de Condé, après cette nuit fatale, durant laquelle ils avaient dû abjurer, sous menace de mort, la religion protestante, se trouvèrent dans la situation la plus équivoque et la plus pénible qui se puisse imaginer. Ils étaient suspects au roi, qui se reprochait sa clémence et les faisait surveiller avec une méfiance d'autant plus âpre qu'il était lui-même peu sincère ; suspects aux protestants, dont les puritains flétrissaient leur reculade devant le martyre, et dont les impatients exigeaient l'accomplissement du pacte vengeur de la mort de Coligny : obligation terrible et sacrée, dont les massacres qui avaient fait à l'amiral un si nombreux cortège de victimes avaient encore resserré les liens. Tout autre homme qu'Henri eût perdu la tête ou le cœur au milieu de ces devoirs opposés et de ces nécessités contraires. Entraîné d'un côté par le serment d'un talion vengeur et par ses propres ressentiments ; retenu de l'autre par le légitime souci de sa vie, principale ressource de sa cause, et la prévoyance qui lui faisait pressentir et lui conseillait d'attendre une occasion favorable, Henri fit ce qu'ont fait de tous temps, au risque de la calomnie des contemporains et même du doute de la postérité, les grands hommes soupçonnés ou méconnus, qui couvent, au milieu de railleries volontairement provoquées et bravées patiemment, un grand dessein dont l'heure n'est pas encore venue, et sur lequel il faut donner le change, sous peine de compromettre le succès et le salut. Henri ne contrefit point la folie comme Brutus. Il singea l'indifférence, l'insouciance, le désœuvrement inoffensif, l'abâtardissement gai. Il se composa un masque de frivolité incurable, d'égoïsme cynique, d'indolence joviale. Il passa son temps à jouer à la paume ou au bilboquet, à babiller, à mugueter ; et quand on lui refusa le divertissement de la chasse, image dangereuse de la guerre, fièvre d'action, tentation de liberté, il se résigna à faire voler des cailles par l'émerillon dans cette chambre ouverte à tous les badauds de la cour, où le duc d'Alençon et lui semblaient n'avoir en tête que les billevesées dont ils s'entretenaient avec un si superbe détachement de toute chose sérieuse. Il joua, lui aussi, si parfaitement son rôlet, que Catherine de Médicis, la grande comédienne, s'y laissa prendre, et que le roi Charles IX, un bon élève en dissimulation et en ruse, ne fut pas moins dupe de cette transformation qu'il désirait trop pour la contester. Si bien qu'à la cour, où l'habitude de l'hypocrisie empêche de la soupçonner chez les autres, chacun de se frotter les mains d'une si prompte métamorphose, d'une si facile conquête ; chacun de se dédommager en lazzis, qu'Henri recevait et rendait avec le plus beau sang-froid du monde, de la ridicule peur qu'on s'en voulait d'avoir eue de ce prince incapable d'ambition et de persévérance, qui, amolli par les délices de Capoue, oubliait et perdait si gaiement son royaume. Les princes et les seigneurs catholiques ne se gênaient
plus pour mépriser tout haut ce prince qu'on brocardait
impunément, jusqu'à dire qu'il avoit plus de nez que
de royaume. La veille de la Toussaint (1572), raconte l'Estoile, le roi de Navarre jouoit avec le duc de Guise à la paume,
où le peu de compte qu'on faisoit de ce petit prisonnier de roitelet, qu'on
galoppoit à tout propos de paroles et brocards, comme on eust fait d'un
simple page ou laquais de cour, faisoit bien mal au cœur à beaucoup d'honnestes
hommes qui les regardoient jouer. Si les amis d'Henri de Navarre avaient mal au cœur de cette déchéance qu'il acceptait si gaiement, pour échapper aux haines et aux dangers contre lesquels cette indifférence affectée, — qui ne l'empêchait pas de prendre ses précautions et de porter dagues, jacques de mailles et bien souvent le cuirassin sous la cape, — était encore sa meilleure défense ; qu'on juge par ce qu'éprouvaient ses amis à un tel spectacle de ce qu'il devait éprouver lui-même. Qu'on juge du courage qu'il lui fallut pour se résigner à paraître poltron ; de l'esprit qu'il eut à prodiguer pour jouer le sot ; de l'effort qu'il dut faire pour soutenir l'assaut de tant d'épreuves terribles, par exemple, devant l'échafaud de ses coreligionnaires et amis Cavaignes et Briquemaut, dont on le força à sanctionner l'exécution par sa présence (29 octobre 1572) ; pour dissimuler sa tristesse quand il avait le deuil dans l'âme et la joie sur le visage ; pour dissimuler son impatience de vengeance et de liberté, quand il ne ripostait que par un sourire à des quolibets qu'il eût voulu punir d'un coup d'épée ; quand il poussait la sollicitude pour la tranquillité du roi et le mépris apparent de son intérêt, jusqu'à lui dénoncer spontanément toutes les mauvaises occasions de s'échapper dont il refusait de profiter, en attendant qu'il pût trouver et saisir la bonne ! C'est cette tentative heureuse, après tant d'autres avortées, que nous raconterons avec ses dramatiques détails dans le chapitre suivant. |