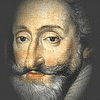HENRI IV
LIVRE PREMIER. — LE ROI DE NAVARRE - 1553-1585
CHAPITRE PREMIER. — LA JEUNESSE D'HENRI IV – 1553-1572.
|
Le 14 décembre 1553, dans une des chambres du vieux château de Pau, s'éleva, entre une et deux heures du matin, une voix de femme, à la fois joyeuse et plaintive, dont le pénétrant appel fit affluer aussitôt, de chaque partie du manoir, tous les serviteurs des rois de Navarre, qui veillaient à la lueur des flambeaux, attendant impatiemment le signal de ce rendez-vous. Cette voix chantait une vieille complainte chère aux Béarnaises en couches, qui avaient l'habitude d'appeler Notre-Dame-du-Bout-du-Pont au secours de leurs douleurs, à cette heure délicieuse et terrible de l'enfantement : Nousté Dame deü cap d'eü poun Adjudat-me à d'aqueste ore ; Prégats aû Diû doû ceû Qu'em boulhe bié deliura leû ; Qué mon frut qué sorte déhore ; D'il maynat que'm hassie lou doun : Tout d'inqu'aû haüt deüs monts l'implore, Nousté Dame deü cap d'eü poun Adjudat-me à d'aqueste ore ![1] La femme qui chantait ainsi, à l'heure où tant d'autres pleurent, s'appelait Jeanne d'Albret, duchesse de Vendôme, future reine de Navarre. Elle chantait encore, la vaillante femme, quand son enfant vint au monde, tout souriant, sans le moindre gémissement, sans le moindre cri, digne en tout de la femme forte qui lui souhaitait si courageusement sa bienvenue. En ce moment, un personnage, un vieillard en robe de chambre, souriant comme la mère et l'enfant, s'avança au milieu des respectueux saluts des assistants, prit le nouveau venu dans un pan de sa robe, l'y enveloppa, le baisa, et remettant à l'accouchée une boite d'or qu'il avait apportée avec lui : Voilà, ma fille, qui est à toi, lui dit-il, et montrant l'enfant : mais voilà qui est à moi. Puis, chargé de son précieux fardeau, il, se retira triomphalement dans sa chambre, remit le nouveau-né à la nourrice, prit une gousse d'ail, lui en frotta les lèvres ; puis, suivant l'antique usage béarnais, rappelé par Rabelais, il lui présenta du vin vieux de Jurançon dans une coupe d'or. Il le regarda avec orgueil soulever, à l'odeur du vin, sa petite tête et aspirer sans la moindre grimace la goutte versée sur ses lèvres. Alors, le grand-père, car c'était là Henri II, roi de Navarre, — dont l'inconsolable veuvage ne se dérida que ce jour-là — le grand-père, transporté de joie à tant d'heureux présages, s'écria : Va, tu seras un vrai Béarnais ! Puis faisant allusion à l'insultante épigramme des Espagnols, qui, à la naissance de sa fille, avaient dit : La vache a enfanté une brebis[2], il répétait : Voyez, la brebis a enfanté un lion. (Mire, agora esta ovieja pario un leone !) C'est bien ainsi que devait naître Henri IV, le roi militaire et populaire, qui reprit son royaume à la pointe de l'épée, et qui voulait donner la poule au pot[3] le dimanche à ses moindres sujets. Pour expliquer cette scène caractéristique, chère à la poésie et à la peinture (qu'elle a si souvent inspirées) et qui encadre si dignement la naissance du Béarnais, rappelons en peu de mots les traits principaux du caractère et de la vie du père et de la mère dont Henri devait en lui confondre, pour ainsi dire, la double image. Sa mère était cette Jeanne d'Albret, fille de Marguerite de Valois, la tendre et spirituelle sœur de François Ier. Femme savante, sensée, courageuse, joviale, à qui l'on ne saurait reprocher que quelques atteintes du mauvais goût d'un siècle mignard et du fanatisme d'un siècle intolérant. Admirable épouse d'un prince prodigue, violent, inconstant, qu'elle suivait fidèlement à l'armée à cheval, à travers les camps et les champs de bataille ; admirable mère surtout, dont l'éducation d'Henri IV fut le chef-d'œuvre, et qui a laissé éparses, çà et là, dans divers recueils imprimés ou manuscrits, des lettres pleines de bon sens et de grâce familière, dont la publication ferait honneur à un des jeunes savants d'aujourd'hui, à M. Yung, par exemple, l'ingénieux auteur de Henri IV écrivain[4]. De son père, grand, bien fait, de nobles manières, brave jusqu'à la témérité, car de cette race des Bourbons, dit Brantôme, il n'y en a point d'autres[5] généreux, éloquent, goguenard, gai convive, auteur de plus d'un malicieux refrain ; de son père, mort enfin d'un coup d'arquebuse reçu dans la tranchée de Rouen, Henri devait faire revivre, avec un visage plus doux, plus fin, plus attrayant encore, les qualités sympathiques. Mais il devait y ajouter les charmes maternels : la souplesse, la grâce, l'urbanité, la malice[6], je ne sais quoi d'honnête et de cordial qui entraînait les yeux et les cœurs. La vérité oblige à ajouter qu'ou retrouve aussi en lui quelques-uns des défauts paternels dont cette conception rapide et brûlante, entre deux batailles, devait graver, pour ainsi dire, plus profondément l'hérédité. La médaille, ainsi brusquement frappée, semble avoir plus exactement réfléchi l'empreinte. Ne nous étonnons donc pas de trouver Henri grand chevaucheur, grand batailleur, grand chasseur comme son père, mais portant, jusque dans ses excès, je ne sais quelle grandeur héroïque ; et aussi grand disputeur, grand discoureur, grand deviseur, comme sa mère, si insinuante, si sagace, si politique enfin, pour dire un mot du temps qui la peint à merveille, De ces deux courants d'influences et d'hérédités fut formé un homme modèle, malgré ses défauts, un prince immortel, dont les fautes n'ont fait, pour ainsi dire, qu'orner la mémoire ; le seul qui ait placé avant tout l'honneur et le bonheur de la France, et le seul dont le peuple ait gardé l'entier et vivant souvenir. Il y a encore de nos jours, sous le chaume, un culte pour l'image et la légende d'Henri IV, et les cœurs les plus frustes, déjà sourds à tant d'autres noms, ont gardé à celui-ci un fidèle écho. Et maintenant, pour clore cet épisode préliminaire, il ne nous reste plus qu'à rappeler que Jeanne d'Albret, dans le neuvième mois de sa grossesse, avait été rejointe en Picardie, à la Flèche, par une députation des Béarnais qui la suppliaient, au nom de leur amour, de venir faire ses couches dans leurs montagnes. Cédant à ces naïves prières, elle avait pris congé de son mari à Compiègne, le 15 novembre, avait traversé au milieu d'un hiver rigoureux toute la France, et était venue, le 4 décembre, s'aliter en son château de Pau, ce nid royal des chères Pyrénées. Jeanne fut logée au premier étage du château de Pau. Henri II, son père, plaça auprès d'elle un vieux serviteur, appelé Cotin, avec ordre de se tenir à portée de la princesse nuit et jour, et de venir l'éveiller dès que la reine éprouverait les premières douleurs, à quelque heure que ce fût. Depuis quelque temps le bruit courait que le vieux prince, après avoir renoncé au projet — qui lui fut prêté un moment — de se remarier avec une princesse de Castille, et exclusivement préoccupé d'une mort qu'il désirait, loin de la craindre, puisqu'elle devait le réunir à sa Marguerite adorée, avait fait son testament à l'avantage d'une grande dame de ses amies (peut-être la même princesse), qui lui avait inspiré une affection très-pure, mais très-vive sans doute, parce qu'elle ressemblait à celle qu'il avait perdue. D'autres ont émis des conjectures encore plus hasardées, mais qui expliquent l'incertitude anxieuse où l'on était, au château de Pau, sur les dernières volontés du vieux roi. Bref, Jeanne n'était pas sans inquiétude à l'endroit de ce mystérieux testament. Elle avait en vain essayé, à plusieurs reprises, d'en dérober le secret à son père à force de prévenances et de caresses. Un jour qu'elle était seule avec lui dans son cabinet, le roi tira d'un de ses coffres une boîte d'or, attachée à une chaîne du même métal, assez longue pour faire trente fois le tour du cou. Il la montra à sa fille, et lui dit : tu vois cette boite, je te la donnerai, avec le testament qu'elle renferme, si tu as le courage, en accouchant, de me chanter une chanson béarnaise, afin de ne pas mettre au monde un enfant pleureux et rechigné. Et voilà pourquoi, le 14 décembre 1553, dans une salle du premier étage du château de Pau, s'éleva, entre une heure et deux heures du matin, cette voix maternelle, à la fois joyeuse et plaintive, qui invoquait Notre-Dame-du-Bout-du-Pont et annonçait Henri IV à la France[7]. Henri d'Albret devait à l'adversité les grandes qualités qui le distinguaient ; il voulut, en conséquence, nourrir son fils à la spartiate, sans délicatesse et superfluité. Il trouvait dans sa fille une princesse capable de sentir tous les avantages d'une éducation mâle et laborieuse ; elle pensait comme lui, que le plaisir et les délices d'un lieu peuvent amollir et corrompre les esprits les plus généreux, et, au contraire, que la sévère nourriture et discipline d'un pays sert à rendre les esprits et courages plus fermes et plus généreux, et plus capables d'entreprendre des choses grandes et louables. Ainsi Henri de Navarre fut nourri à la campagne comme l'aurait été un enfant du peuple. On aurait dit même que l'indigence avait entouré son berceau. Aussi est-il remarquable qu'elle toucha toujours son grand cœur. Une épidémie, qui affligeait alors le pays, rendit les premiers mois de sa nourriture très-difficiles, et s'il n'avait reçu de la nature une constitution robuste et un corps sain, il aurait sans doute succombé, car il eut successivement huit nourrices. Enfin, la duchesse de Vendôme fut assez heureuse pour faire un bon choix dans la personne de Jeanne de Fourcade, femme de Jean Lassansaa[8], pauvre laboureur, qui demeurait à Bilhères, village encore existant et limitrophe de la commune de Pau. Sa maison est encore à peu près ce qu'elle était lorsque Henri de Navarre y fut nourri. C'est une maison de paysan, avec un jardin d'un demi-arpent, fermé d'un mur à hauteur d'appui. La cour a une porte d'entrée dont le fronton représente les armes de France, avec ces mots : Saube garde dou rey (Sauve-garde du roi). Ce fut la seule récompense que la nourrice demanda de ses soins. Le parc de Pau s'étend le long de la rivière du Gave, jusqu'aux premières maisons du village de Bilhères, et celle où Henri IV fut allaité est dans la plaine, à l'extrémité même du parc ; en sorte que Jeanne d'Albret pouvait aller voir son fils et le recevoir sans sortir de chez elle[9]. Le jeune Henri fut baptisé le 6 janvier 1554, selon les uns, le 6 mars selon les autres, avec une grande pompe, dans la chapelle du château de Pau, sur des fonts de vermeil que l'on avait faits exprès pour la cérémonie. Le cardinal de Bourbon le tint pour le roi de France Henri II ; il eut pour second parrain Henri d'Albret, son grand-père, qui lui donna son nom. Sa marraine fut Isabeau d'Albret, sœur du roi de Navarre et veuve du comte de Rohan. Son grand-père le porta au baptême sur une écaille de tortue, qui a toujours été religieusement conservée sous le nom de berceau de Henri IV. Dans les fêtes solennelles, on l'offrait aux regards du peuple, mais on donnait pour l'obtenir, des otages aux gouverneurs ; cette écaille est la grande hercariula de mer. Henri n'avait pas deux ans que déjà il étonnait par sa force, sa vivacité, et une certaine gentillesse de courage, qui ravissait son grand-père[10]. Au sortir des mains de sa nourrice, le prince passa dans celles de Suzanne de Bourbon-Busset, femme de Jean d'Albret, baron de Miossens, qui lui fut donnée pour gouvernante. C'est sous cette digne et sage tutelle que Henri alla habiter le château de Coarraze dans la riante vallée du Gave, au pied des monts Pyrénées. C'est là que, selon le vœu de son grand-père, le royal enfant fut élevé rudement, frugalement, à la béarnaise enfin, et non à la française. Les vieux chroniqueurs et, parmi les récents, l'auteur de l'Éducation d'Henri IV, nous ont laissé sur cette enfance abandonnée à l'air vif et pur des montagnes, sur ces courses dans les gorges, sur ces jeux en troupes, sur cette bande de paysannots hardis et alertes qui fut la garde enfantine du prince, des détails pleins de charme et de naïveté. On ne s'étonne plus en les lisant du contraste si frappant qu'offrira, en dépit de l'éducation de cour qui succédera à ce dur noviciat de la montagne, la mâle et cordiale figure du Béarnais, avec ces hommes-poupées, ces freluquets frisés, à pendeloques et à mouches, qui minaudent et paradent autour de ce sardanapalesque fantôme d'Henri Ill. Certes il n'eut jamais face de mignon, notre Henri, même aux jours les plus efféminés de sa jeunesse. Lui seul a gardé figure française au milieu de cette prostitution générale aux mœurs et façons italiennes. Il doit d'avoir conservé le bienfait de cette originalité morale qui fait son attrait à cette première éducation, la seule digne d'un roi national, à cette trempe ineffaçable que donnent au caractère et au tempérament la liberté, l'égalité et la fraternité de la vie de montagnard et de chasseur. Il était à jamais sauvé des hontes de l'abâtardissement, cet enfant qui avait mérité auprès de ces petits compagnons, par la force et le courage, le titre qu'il tenait de sa naissance, cet enfant, qui fut élevé petit garçonnet par le roi de Navarre, son aïeul maternel, en lieux fort rudes et pierreux, le plus souvent tête nue et pieds nus[11], cet enfant enfin dont sa mère disait qu'elle le vouloit rendre capable et instruit par les peines et le labeur. Les Espagnols apprendront un jour ce que vaut ce petit Vendômet, comme ils l'appellent. Certes, en voyant son petit-fils, vêtu d'une simple tunique serrée à la taille par une ceinture de cuir, courant dans les neiges de l'hiver ou les poussières de l'été, les pieds nus ou simplement défendus par une semelle de cuir rattachée à la jambe au moyen de grossières courroies, certes l'élégante et gracieuse Marguerite de Valois eût poussé les hauts cris. Elle se fût indignée peut-être de cette éducation à la Plutarque, à la Lycurgue. Elle eût rougi de trouver son petit-fils, un futur roi, dans ce petit garçon hâlé, à l'œil vif, nourri de pain bis, de bœuf, de fromage, et trahissant, par une forte odeur d'ail, sa complète initiation aux mœurs montagnardes. Elle eût frémi de l'entendre tutoyer et même gourmer sans façon par ces petits compagnons farouches, qui déjà néanmoins se fussent tous fait tuer, jusqu'au dernier, pour leur Henric, et qui formeront plus tard, derrière le panache blanc d'Arques et d'Ivry, l'escadron sacré, le groupe de ceux qui suivent le Béarnais jusqu'au plus fort de la mêlée, y recevant la mort quand elle l'approche de trop près. En est-il un seul de ces compagnons d'enfance, bergers ou laboureurs, qui ont avec Henri parcouru les vallées, gravi les montagnes, déniché les oiseaux de proie, manœuvré la fronde ou lancé la paume, en est-il un seul de ces amis d'école et d'école buissonnière, de ces hardis grimpeurs, qui ait entendu, sans descendre de sa montagne et sans courir à lui, l'appel du roi de Navarre s'échappant à la faveur d'une partie de chasse et fuyant les pièges d'une cour perfide et dissolue ? Au premier son de ce cor d'Henri IV, comme à celui d'un cor enchanté, ne vit-on pas tout le Béarn, nobles, bourgeois, manants, se ranger autour de Henri ? Qui dira combien de ces braves gens ont survécu aux guerres hâtives et aux champs de bataille nomades de la conquête de la France ? Combien sont entrés dans Paris, derrière leur Henri ? Eh bien ! c'est en vivant avec ses sujets, de bonne heure, qu'Henri leur apprit à mourir pour lui. Pas un n'y manqua. Et qui les plaindrait ? Ils sont morts à la bonne heure, à ce charmant et brûlant midi de la jeunesse, de l'action et de la gloire. Ils n'ont pas vu une reine italienne, une autre Médicis remplacer de son vivant Marguerite de Valois ; ils n'ont pas vu leur roi tomber sous le couteau d'un fanatique excité par des traîtres. Ils sont mores, les compagnons de Coarraze[12] ! Henri leur a donné à chacun une larme, et eux ils n'ont pas eu à pleurer leur roi. Ils ne l'ont connu qu'invincible et triomphant, riant avec eux, avec la gaieté héréditaire des d'Albret, des disgrâces de la fortune, de ce métier de roi obligé de reconquérir son royaume, et leur rappelant après la bataille les parties de barnicole et de tastoure jouées autrefois avec eux. Heureux les enfants de Coarraze, ils sont morts, tous morts, à l'heure du soldat, avant l'heure du courtisan ! Henri n'avait guère que cinq ans lorsque Antoine de Bourbon l'emmena à Paris, pour le présenter au roi de France. Henri II fit un accueil assez froid au roi et à la reine de Navarre. Il pressentait ces dissensions et ces rivalités qui, exploitées par le génie machiavélique de Catherine de Médicis, devaient livrer la France aux horreurs des guerres de religion et d'ambition. Il ne lui plaisait point qu'il y eût en France deux rois, le roi de France et le roi de Navarre. Tout cela avait assombri le visage martial d'Henri II, et il n'avait pu s'empêcher de froncer le sourcil. Mais force lui fut de subir le charme de ce jeune prince, déjà grand, fort, éveillé, et dont on ne fixait pas impunément, fût-on roi, l'œil vif d'aiglon montagnard. Henri II prit le jeune prince dans ses bras et lui dit : — Veux-tu être mon fils ? L'enfant ne savait pas encore le français ; il répondit donc naïvement, dans sa langue natale, en montrant Antoine : — Aquet es lou seignou pay. (Celui-là est le seigneur père.) — Tu as raison, dit le roi ; eh bien ! puisque tu ne veux pas être mon fils veux-tu être mon gendre ? — Obé, répondit l'enfant sans hésiter. Marguerite de Valois avait dix-huit mois de plus qu'Henri de Navarre. C'est à cette époque, dit-on, que remonterait la première idée d'une union qui devait se réaliser plus tard, au grand dommage de l'un et de l'autre. Henri de Bourbon plaisait à chaque instant davantage au roi de
France ; il fut même si enchanté de sa répartie, des grâces de sa figure, et
de son naturel, qu'il voulut le garder auprès de lui, et le faire élever avec
le dauphin son fils, depuis François II. Il en parla à Jeanne d'Albret, la
pressant vivement de le satisfaire sur ce point ; mais quelque chose qu'il lui pût dire, elle n'y voulut point consentir[13]. Elle avait hâte
de le ramener dans cet air pur et au milieu de ces mœurs patriarcales du
Béarn, si différentes de celles de la cour. Cependant Henri entrait dans sa septième année. Jeanne d'Albret le retira des mains de sa gouvernante, Suzanne de Bourbon, pour le confier à un gouverneur. Le choix de ce personnage la préoccupa longtemps. Elle était trop éclairée pour ne pas sentir combien il est important et de quelle conséquence il est pour l'avenir d'un prince et de ses sujets. Il lui fallait un homme qui fût à la fois homme de guerre et de cabinet, de science et de conseil, de spéculation et d'action. Il lui fallait un homme qui, sans négliger la chasse, l'escrime, l'équitation, et toute cette noble gymnastique qui forme le corps, fût capable néanmoins de cultiver avec soin cet esprit si vif, si ouvert, si hardi. Jeanne, qui savait le latin, le grec, et parlait la plupart des langues vivantes, était parfaitement à même de se décider en connaissance de cause. Elle se prononça, après mûre délibération, pour un laïque, l'éducation donnée par un prêtre ou un ministre, en des temps surtout où l'anarchie est dans les consciences, lui paraissant trop exclusive. Charles de Beaumanoir-Lavardin fut celui que la reine de Navarre honora le premier de sa confiance ; mais la santé de ce vertueux gentilhomme ne lui ayant pas permis de supporter longtemps le fardeau dont il s'était chargé, il fut remplacé par le sieur de La Case, de l'illustre maison de Pons, qui le fut à son tour par le baron de Beauvoir, chevalier de l'Ordre du roi[14]. Jeanne associa au gouverneur de son fils un sage précepteur, appelé La Gaucherie, homme de mœurs austères et d'une vaste érudition. La Gaucherie nourrit son élève de la pure moelle de l'antiquité. Le caractère original de cette éducation est qu'elle fut plus morale que littéraire. Henri y puisa sa prédilection pour trois maximes qui devaient être la règle de sa conduite et qui résument sa vie : Il faut chasser de l'État la discorde. — Épargner les vaincus et terrasser les superbes ; et surtout l'axiome spartiate et français : Vaincre ou mourir. Nous n'entrerons pas dans le détail, qui nous mènerait trop loin, de ces intrigues croisées et multipliées qui faisaient toute la politique d'un temps où l'ambition se permettait tous les moyens. : La lutte de la Navarre et de l'Espagne, les premières guerres de religion, la menaçante prépondérance de Catherine de Médicis, sous des rois qu'elle gouvernait à son gré, les disputes, les assassinats, les trahisons, les honteuses incertitudes d'un père tour à tour, selon le vent, protestant ou catholique, ses fautes, ses infidélités ; les malheurs intimes ou publics d'une mère persécutée, jetée dans la Réforme par désespoir, menacée d'une répudiation : tels furent les tristes spectacles qui furent la leçon précoce de l'enfance d'Henri IV et lui fournirent de bonne heure l'occasion d'appliquer ses maximes héroïques. Henri qui, depuis 1561, séjournait à la cour de France eut, dès l'âge de huit ans, à intervenir entre son père et sa mère, que brouillaient l'ambition et la jalousie, et reçut plus d'une fois le fouet pour avoir fait preuve d'une sagacité précoce ou d'une obstination déjà intrépide. Bref, il se montra le digne enfant de cette femme de sens et de cœur, qui bravait l'infortune de la fière devise : Ubi spirites, ibi libertas : où est l'esprit est la liberté. Le 17 novembre 1562, Antoine de Bourbon, père d'Henri, fut frappé au siège de Rouen d'un coup d'arquebuse, dont les suites, aggravées par son intempérance, l'emportèrent au tombeau. Il mourut en reconnaissant ses torts envers sa noble femme, en sollicitant son pardon, et eu lui recommandant son royaume et son fils. Celui-ci était demeuré à Montargis, malade de la petite-vérole. Sa mère avait vainement tenté de l'y enlever. Catherine de Médicis redoutait le mille courage de cette héroïne dévouée à la secte protestante, et elle regardait le jeune prince comme l'otage le plus propre à lui répondre de la conduite de la reine, sa mère. Toutefois, comme elle ne voulait point se brouiller avec une princesse dont elle avait éprouvé la sagesse et la fidélité, elle lui laissa la liberté de disposer, à son gré, de l'éducation de son fils. Elle n'eut même garde de s'opposer à ce qu'il fût élevé dans la religion protestante. Elle regardait, en effet, cette religion comme un obstacle insurmontable à son élévation au trône, et à l'accomplissement de cette destinée dont les astrologues avaient plus d'une fois fait retentir l'importune prophétie. Jeanne laissa auprès de son fils en partant pour le Béarn ; où l'appelaient et la retenaient les soins impérieux du gouvernement, Beauvoir et La Gaucherie. Elle lui laissa surtout pour le guider, au milieu d'une cour hostile et corrompue, ses instructions et son exemple. L'image de sa mère veilla ainsi, en son absence, auprès de son fils pour le confirmer dans cette pratique de la loyauté et de l'honneur dont elle lui avait, de bonne heure, enseigné la religion. Elle lui avait aussi appris à être à la fois intrépide et prudent, et à se dérober avec souplesse aux dangers qu'il ne pouvait braver avec courage. Henri n'allait pas tarder à trouver l'emploi de ces qualités. Il avait à jurer Dieu une propension que ne favorisait que trop l'exemple des courtisans qui l'entouraient. C'est, dit-on, pour rendre cette habitude inoffensive que La Gaucherie, tournant la difficulté en précepteur bien avisé, affecta de répéter devant lui ce Ventre saint-gris ! qu'adopta son élève, et qui devint depuis, par lui, si populaire. Pour encourager ses progrès par l'émulation, on lui donna pour compagnon d'études d'Aubigné, de trois ans seulement plus âgé que lui, et dont l'enfance prodige (à huit ans il avait traduit le Criton de Platon) promettait un grand homme. Pour augmenter encore son zèle, et l'accoutumer de bonne heure au frottement et au maniement des hommes, Jeanne voulut que son fils entrât au collège de Navarre pour y estre institué ez bonnes lettres. Il y eut pour compagnons Henri duc d'Anjou, qui fut dans la suite son roi, et Henri de Guise, qui fit tout pour le devenir. Ces trois Henri, qui devaient être un jour divisés par une haine irréconciliable, offrirent alors l'exemple de la plus intime et fraternelle union. Tous trois, — c'est un rapprochement qui vient de lui-même à la pensée, — devaient mourir de mort tragique. Le prince de Navarre, dirigé par son précepteur, se signala par de rapides progrès dans la langue latine pendant le peu de temps qu'il demeura au collège. Casaubon et le duc de Nevers parlent avec admiration d'une traduction qu'il fit des premiers livres des Commentaires de César. L'écriture en était belle, ajoute ce dernier, et annonce qu'il avait des dispositions pour la peinture. Effectivement, il cultiva le dessin dans ses moments de loisir avec beaucoup de succès. L'histoire a gardé le souvenir d'un vase antique qu'il dessina à la plume, et que les maîtres de l'art eussent avoué. Henri avait écrit de sa main, sur le pied du vase, ces trois mots latins : Opus principis otiosi, œuvre d'un prince oisif[15]. Ce qui sous-entendait : et qui s'indigne de l'être. Plutarque était dès lors, avec les Commentaires de César,
son livre de prédilection. Plutarque, écrivait-il plus tard à Marie de Médicis, me souryt toujours
d'une fraische nouveauté ; l'aymer, c'est m'aymer, car il a été l'instituteur
de mon bas âge. Ma bonne mère, à laquelle je doys tout et qui avoyt une
affection si grande de veiller à mes bons
déportements, et ne vouloit pas, se disoyt-elle, voyr en son fils un illustre ignorant,
me mit ce livre entre les mains, encore que je fusse à peine plus un enfant
de mamelle ; il m'a été comme ma conscyence, et m'a dicté à l'oreille beaucoup de bonnes honnêtetés et maximes excellentes
pour ma conduyte et pour le gouvernement des affaires. Il est impossible, avouons-le, de mieux penser et de mieux dire. Remarquons ce culte de la mémoire de sa mère et son tendre respect pour elle. Henri IV, qui devait être un excellent père, fut le meilleur des fils. Il obéit toujours, avec empressement, aux moindres volontés de la reine. Et elle garda sur lui une autorité telle que bien qu'il eut déjà commandé une armée, elle parlait encore de le faire fouetter parce qu'il avait gagné de l'argent aux dés ; il n'échappa à cette punition qu'en désarmant sa mère à force de caresses. Nous voudrions pouvoir insister sur les détails si intéressants et sur les caractéristiques épisodes de cette première jeunesse d'Henri IV et de cette éducation excellente, vraiment digne d'un prince ; nous voudrions pouvoir suivre de scène en scène cette sorte de drame intime où l'on voit poindre, grandir et s'épanouir une âme choisie, fleur de courage et de bonté, que surveille de loin l'œil vigilant de Jeanne, et que le prévoyant dévouement de La Gaucherie, secondé par le maréchal de Montmorency, préserve des corruptions et des orages de la cour des Valois. Les qualités et les défauts d'Henri, qui percent dans leur premier jet, ont, à ces heures privilégiées, je ne sais quelle grâce naïve et quel printanier parfum. On le voit avec admiration s'indigner contre Coriolan, exalter Camille, et, dans un élan charmant de colère et de honte, courir à la carte généalogique de sa maison pour y effacer le nom du connétable félon et le remplacer par celui de Bayard. Bayant adopté par Henri IV et placé par lui au rang des ancêtres de sa famille, n'est-ce pas là une idée ravissante, toute chevaleresque et toute française ? C'est dans le livre diffus de Duflos, — où quelques jolies anecdotes se noient dans un déluge de digressions et de discours inutiles, — qu'il faut saisir, dans ses manifestations bouillantes et dans ses heureuses promesses, ce caractère énergique et loyal, dont la robuste souplesse ne peut se courber aux félinités d'une cour dépravée, et dont l'impatient ressort, toujours prêt à partir, proteste contre la lâcheté des hommes efféminés qui l'entourent. Henri les étonne plus encore qu'il ne les humilie, et Catherine, en songeant aux prédictions des astrologues, demeure rêveuse et fixe sur l'héroïque enfant ce regard de basilic qui donne la mollit n'est pas douteux qu'il n'ait été condamné d'avance dans cette âme farouche. Une si virile enfance n'insultait-elle pas à cette éducation à l'italienne, qui avait produit de si tristes caricatures de rois : François II, gauche et lymphatique, Charles IX, sauvage et brutal soldat, Henri III, eunuque spirituel et bigot ? Catherine ne l'ignorait point : ce n'est pas avec indifférence que les vieux capitaines assistaient aux exercices militaires d'Henri chez M. de la Coste, son maitre d'armes, et y étaient témoins de sa martiale ardeur, de la fascination qu'il exerçait sur la petite compagnie de nobles volontaires qu'on lui avait confiée, de sa douleur de ne pouvoir aller à Malte combattre les Turcs. A ces nobles signes, on les entendait, émus, se dire entre eux : voilà un enfant qui sera un jour un grand généra ! et sous lequel on verra belles batailles ! A cette touchante ambition du jeune Henri d'être aimé pour lui-même, à l'entrainante bonhomie avec laquelle il était allé prier le baron de Ségur et le comte de la Rochefoucauld de vouloir bien nouer avec lui fraternelle amitié, à son art instinctif, déjà irrésistible, de flatter les esprits et de gagner les cœurs, Catherine devinait en tremblant un prince qui au rait de bonne heure non d'inutiles courtisans, mais de gais, de hardis et de dévoués compagnons. Ce goût des grands hommes de Plutarque ne lui présageait rien de bon. Cet écolier passionné pour les récits héroïques ne lui semblait pas un camarade bien sûr pour ses fils. Elle y voyait plutôt un futur rival. Henri, jouant à la paume avec Charles, n'avait-il pas eu avec le jeune roi une querelle dans laquelle il avait nettement maintenu son droit et refusé de céder ? Et le roi n'avait-il pas été contraint aux premières avances et aux excuses ? Enfin Henri, Henriot, comme elle l'appelait par dérision, ne se permettait-il pas de mépriser l'honneur de l'alliance projetée avec Marguerite, et n'affectait-il pas de dédaigner la jeune et vive princesse pour porter ses vœux et ses hommages enfantins à la belle et pudique la Trémoille (future princesse de Condé) ? Ainsi songeait, soucieuse, la sombre veuve d'Henri II. Et nul doute que plus d'une fois, pendant ces réflexions jalouses, le fantôme tentateur de la Saint-Barthélemi n'ait traversé sa pensée, lui tendant le poignard libérateur et vengeur. Henri revint définitivement à Pau en 4566. Son excellent maitre, la Gaucherie, était morte pleuré de son élève. La reine de Navarre confia l'achèvement de son éducation à un fameux humaniste, appelé Florent Chrestien, en même temps qu'elle le mettait sous la discipline plus spéciale de Beauvoir et l'entourait d'un groupe de capitaines et de savants qui avaient l'esprit délicat, le raisonnement pur, les mœurs irréprochables. Le séjour d'Henri en Béarn fut une perpétuelle ovation. À tout instant les manifestations populaires les plus spontanées témoignaient de l'enthousiaste attachement de ses sujets. C'est le moment d'emprunter à l'unique historien de son enfance et de son adolescence le récit touchant de ces premières fêtes de l'amour et de la fidélité. Il se présenta bientôt pour Henri des occasions de se faire des
amis, et il ne manqua pas d'en profiter. Quand on eut appris, dans la Navarre
et dans lé Béarn, qu'il séjournait à Pau, on s'empressa de tous côtés de
venir l'y voir, d'après la bonne réputation qu'il avait déjà. Cet
empressement était encore plus marqué de la part des habitants de la
campagne, qui accouraient dans cette ville, les dimanches et fêtes, pour
satisfaire leur curiosité. Il se communiquait à tous avec un air riant et des
manières caressantes. Il faisait des questions aux uns et aux autres, sur
leur pays, sur leurs travaux. Lorsqu'il remarquait parmi eux quelque jeune
homme d'une taille avantageuse et d'une constitution robuste, il lui
demandait s'il porterait volontiers le mousquet pour lui au cas qu'on vint
l'attaquer, et chacun répondait que ce serait de tout son cœur. Ils s'en
retournaient tous avec des marques de satisfaction infinie, et se disaient
mutuellement, dans leur langage naïf : Qu'il a bonne
façon, notre prince ! qu'il est courtois ! Avec tout cela, il
a l'air de devoir être un jour un maître gaillard et de ne pas se laisser
manger la laine sur le dos. Les Espagnols n'ont qu'à se bien tenir, car, à
coup sûr, il leur donnera du fil à retordre. Mais de tous ceux qui vinrent le voir, il n'y en eut point qui témoignèrent plus de joie que les paysans qui habitaient les environs du château de Coarraze en Béarn, à quelques lieues de Pau, château où il avait été élevé dans sa première enfance. Ils partirent un jour de grand matin, au nombre d'une centaine,
hommes et femmes. Quand ils furent arrivés à la ville, ils demandèrent aux
passants où demeurait Henri, qu'ils voulaient
le voir : car c'est une vieille connaissance, disaient-ils ; c'est
nous qui l'avons élevé ; il a joué avec nos enfants ; il grimpait avec eux
aux montagnes comme un chat maigre. Oh ! le bon espiègle que c'était alors ! On les conduisit dans la cour du château, où toute la ville accourut pour jouir de ce spectacle. Dès que le jeune prince fut averti de leur arrivée, il descendit promptement avec sa mère, accompagné d'un grand nombre de dames et de seigneurs. Au moment qu'il parut, la troupe champêtre s'écria tout d'une voix : Ah ! le beau garçon ! Comme il a bien profité ! Quel compère ! Lorsque cette clameur fut apaisée, un vieillard de la bande
s'avança, appuyé sur son bâton, tenant à son bras un panier rempli de
fromages, et s'étant approché de Henri, il lui parla en ces termes : — C'est bien de l'honneur pour moi, notre bon prince, que de causer
comme ça avec vous tête à tête. Aussi, je rechignais à me charger de la
commission ; mais ceux de notre village et des environs, dans un parlementage
qu'ils ont eu ensemble, ont dit : Grégoire a la langue bien pendue et n'est
pas si bête qu'il le parait ; il faut que ce soit lui qui fasse le compliment
à notre Henri. Depuis ce temps-là, en bonne foi, je me suis mis la tête à
l'envers pour vous fabriquer quelque chose d'agréable, car je sais que vous
êtes un bon compagnon, qui aimez à gaudir et à rire ; mais je n'ai pas pu
tirer plus d'esprit de ma cervelle qu'on ne tire de l'huile d'un mur. Aussi,
a-t-on bien raison de dire qu'on ne fait pas boire un âne quand il n'a pas
soif. Voyant donc que je orne trouvais rien de drôle et de gentil dans mon
invention, j'ai imaginé un bon tour pour vous dédommager de mon compliment
biscornu ; c'est de vous apporter des fromages. Oh ! c'est là du bon ; vous
pouvez vous en vanter. Nos femmes les ont faits tout pareils à ceux que vous
mangiez avec nous de si bon appétit quand vous n'étiez encore qu'un petit
marmot. Allons, prenez-les sans façon, et que le bon Dieu vous bénisse ;
c'est ce que nous demandons tous pour vous, à cor et à cri, comme des enragés. Henri prit le panier de fromages, remercia l'orateur et la troupe de la manière la plus affectueuse, les régala bien, et pendant le repas se promenait autour d'eux, en leur témoignant mille amitiés, en leur disant mille choses obligeantes. De plus, au moment du départ, il fit donner au harangueur une bonne somme d'argent, pour la partager entre eux tous. Aussi, en prenant congé de lui, le comblèrent-ils de bénédictions, et durant tout le chemin ils chantaient en son honneur des impromptus en langue béarnaise, dont le refrain était : Quel bon prince nous avons ! Qu'il a de bon vin ![16] Pendant ce second séjour en Béarn, Jeanne d'Albret, dans sa prévoyante sollicitude, ne négligeait pas plus le corps que l'âme de son fils. Elle continuait de l'accoutumer à la sobriété, à la tempérance, à la fatigue. Sa table, au palais de Pau, comme au château de Coarraze, fut toujours frugale. Les ragoûts et les friandises lui étaient interdits. La nuit, il couchait, quelquefois tout habillé, sur une simple paillasse. Par ordre de la reine, son sommeil, fixé à cinq ou six heures, était rigoureusement mesuré et souvent interrompu, de façon, dit-il lui-même, qu'il fût maitre du veiller et du dormir. Le matin, quelque temps qu'il fit, son maitre l'obligeait à partir pour la chasse et à faire à cheval, bride abattue, des courses difficiles et fatigantes. C'est ainsi, qu'à douze ans, grâce à cette rude gymnastique et à ces pénibles épreuves, le prince avait déjà une constitution d'homme et de soldat, bronzée d'avance à tous les maux de la guerre. Plus d'une fois il a avoué lui-même que sans ce pénible, mais prévoyant noviciat, il n'eût pu supporter les fatigues inouïes de son métier de roi nomade et conquérant. Sa prévoyante mère, quand il eut passé la douzième année et parvint à cette période ardente de la puberté, redoubla d'efforts et de précautions pour le préserver de ces dangers auxquels l'exposait l'ardeur précoce de son tempérament. Elle bannit plus sévèrement que jamais d'auprès de lui toute occasion de plaisir. Elle redoutait pour lui, avec raison, les pièges d'une cour où il était de bonne politique d'abâtardir les princes. Elle craignait pour son fils jusqu'au danger de ses qualités et de cette popularité éclatante qui multipliait autour de lui les fêtes, les bals et leurs tentations. Déjà, durant ses passages triomphants dans le comté de Fois, à Pamiers, à Mazères, à Toulouse, à Bayonne surtout, où le jeune prince avait été le perspicace témoin des entretiens menaçants de Catherine et du duc d'Albe, il avait fait preuve, eu plusieurs occasions, de cette finesse et de cette dignité précoces qui captivent les hommes, et aussi de cette galanterie et de cette grâce qui séduisent les femmes. Henri, naturellement et comme d'hérédité, avait le goût du jeu, des banquets, festins, saupiquets et friandises, et son éducation sévère, ses longues traites dans les montagnes, ses chasses à l'ours au milieu des forêts et des neiges, n'avaient amorti qu'à demi le feu naissant de ses passions. C'est donc avec bonheur qu'à force d'instances et de soumissions sa mère l'avait, en 1566, arraché à la cour de France et à ce Paris corrupteur, devenu la Babylone des Médicis. Elle ne voulut pas même en Béarn, et dans cette cour austère, dans ce petit Genève de Pau, que Marguerite de Valois devait plus tard tant maudire, lui laisser le temps d'émousser dans l'oisiveté la trempe, si soigneusement entretenue, de sa jeune énergie. Elle chercha à distraire par des voyages cette imagination et cette activité inquiètes, en attendant que vint le moment de le livrer à la guerre, cette maîtresse austère, et de le revêtir de ces armes qui devaient à la fois préserver son corps et son cœur, et le garder de tous les dangers, matériels ou moraux. Mais que pouvaient tant de sages précautions et de jaloux efforts contre la verdeur impatiente d'une riche nature et contre la fatalité de ce sang des Bourbons, irrésistiblement voué à toutes les grandeurs et à toutes les faiblesses ? Henri n'avait-il pas à se défendre non-seulement contre les entrainements de son âge, mais encore contre les facilités de son rang ? En Guienne, comme partout ailleurs, il se montra si agréable, si civil, si obligeant ; il vivoit avec tous d'un air si aisé, qu'il faisoit la presse partout où il étoit. Mais il faut citer tout le passage, emprunté à la relation d'un magistrat de Bordeaux, insérée dans les Mémoires du duc de Nevers. Nous avons ici le prince de Béarn. Il faut avouer que c'est une jolie créature ; il est agréable, il est civil, il est obligeant : un autre dirait qu'il ne tonnait pas encore ce qu'il est ; niais pour moi, qui l'étudie fort souvent, je vous puis assures qu'il le sait parfaitement bien, Il vit avec tout le monde d'un air si aisé, qu'il fait toujours la presse où il est, et agit si noblement en toutes choses, qu'on voit bien qu'il est un grand prince. Il entre dans la conversation comme un fort honnête homme. Il parle toujours fort à propos, et quand il arrive qu'on parle de la cour, on remarque assez bien qu'il est fort bien instruit, et qu'il ne dit jamais que ce qu'il faut dire en la place où il est. Un autre témoin nous met plus naïvement encore à même de juger des succès du jeune prince et des dangers de ces succès pour un esprit et un cœur qui s'éveillent. Le prince de Navarre acquiert tous les jours de nouveaux serviteurs. Il s'insinue dans les cœurs avec une adresse incroyable. Si les hommes l'honorent et l'estiment beaucoup, les dames ne le goûtent pas moins.... Il a le visage fort bien fait, le nez ni trop grand ni trop petit, les yeux fort doux, le teint brun, mais fort uni, et tout cela est animé d'une vivacité si peu commune, que s'il n'est pas bien arec tout le monde, il y aura bien du malheur. Les femmes elles-mêmes, dit mademoiselle Vauvilliers, ne contribuèrent pas peu à le développer ; c'était à qui le flatterait, lui plairait ; elles se le disputaient à l'envi. Un prince embelli du charme de l'innocence et des grâces de la jeunesse, dans un temps où l'on ne voyait plus chez les grands ni jeunesse ni innocence, avait pour elles un attrait bien puissant. Aussi voit-on qu'il lui suffisait de témoigner le désir d'une fête, d'un bal, d'un festin, pour que toutes les dames de la Guienne s'empressassent d'en faire les frais[17]. Le prince de Navarre, continue notre magistrat de Bordeaux, aime le jeu et la bonne chère. Quand l'argent lui manque, il a l'adresse d'en trouver, et d'une manière toute nouvelle et toute obligeante aussi bien pour les autres que pour lui : c'est-à-dire qu'il envoie à ceux ou à celles qu'il croit de ses amis une promesse écrite et signée de lui, et les prie qu'on lui envoie le billet ou la somme qu'il porte. Jugez s'il y a maison où il soit refusé. On tient à beaucoup d'honneur d'avoir un billet de ce prince. Mais voici qu'Henri de Navarre n'est plus un enfant, c'est un homme. Dorénavant ses actes appartiennent à la grande histoire. Il doit nous suffire d'avoir placé, au début de ce livre consacré à toute sa vie, le tableau de son enfance et l'esquisse de son caractère. Cette physionomie morale est aujourd'hui assez distincte aux yeux du lecteur, pour que, abandonnant dans notre héros les détails réservés aux chroniqueurs, nous nous hâtions de nous rendre à Paris, à ces noces tragiques dont les flambeaux éclairèrent le plus horrible des massacres. Ce n'est pas qu'il ne nous fût fort agréable d'accompagner encore minutieusement notre héros, de le voir pour la première fois aux prises avec les dangers des négociations et des combats, et déployant dans leur floraison charmante ces qualités qui doivent lui donner tant d'amis : la finesse, la familiarité, la bravoure. Nous aimerions à le montrer déjouant par de vives ripostes, les efforts captieux de l'ambassadeur de la cour, Fénelon, et se jouant hardiment au milieu de ces filets diplomatiques ou l'on espérait l'embarrasser. A la Rochelle, il répond, en quelques mots d'une joviale et habile modestie, à la pompeuse harangue du maire. Il est déjà maître de lui et de sa parole, déjà en possession de cette éloquence brève, nette, d'une héroïque familiarité dont il nous a laissé tant de modèles. Toujours accompagné de sa mère, son bon génie, docile à ses inspirations tutélaires, il s'efface devant le prince de Condé et l'Amiral de Coligny, affecte pour eux le respect d'un disciple et se montre à la fois capable d'obéir et digne de commander. Il reçoit pour compagnon, pour émule, Henri de Condé, son cousin germain, qu'il appelait dans la suite, son Ulysse, son bras droit. Enfin, il se fait adorer de l'armée par sa modestie, sa sobriété, et, dans les occasions décisives, par son entrain vraiment militaire et français. Il débute par cette désastreuse campagne, féconde en sanglantes leçons, que marquent les deux grandes victoires des catholiques, Jarnac et Moncontour. Ses soldats ne l'ont pas vu encore à l'œuvre. La prudence de Coligny ménage avarement un sang si précieux. Mais il a déjà eu plusieurs fois occasion de parler à l'armée, dont il est devenu le généralissime après la mort de son oncle le prince de Condé, et à l'entendre on devine comment il agira quand il sera temps de faire subir à cette armure, don de sa mère, qu'elle lui a ceinte elle-même, et qu'il portera toujours pieusement, le baptême du feu. Il se donne enfin, à l'affaire d'Arnay-le-Duc, où il commande une partie de la troupe, ce noble plaisir ; et désormais c'est lui qui montrera constamment le chemin aux plus braves. Cependant la cour effrayée de ces succès qui portent la
guerre jusque sous les murs de Paris, s'alarme et offre la paix. Les
négociations commencent, et Catherine, dont Charles IX est malgré lui
l'instrument, y déploie ce sombre et prestigieux génie qui donne le vertige.
Elle fascine peu à peu, par l'appât d'un mariage avantageux, l'honnête et
ambitieuse Jeanne d'Albret, tandis que Charles attire à lui son ancien
camarade par la promesse de toutes sortes de plaisirs, y compris celui qui tente
le plus un jeune homme : la chasse, la bonne chère,
disait le jeune roi dans ses lettres, la danse et tous autres sur lesquels Montafier (son envoyé) s'expliquera
devant le prince. Jeanne soucieuse, rongée de sourds pressentiments hésitait à venir se jeter de nouveau dans la gueule du lion, au milieu de ce peuple de Paris, peuple mutin, disait-elle, ennemi de moi et des miens. Elle savait que le fanatisme catholique qui, à la cour, émoussait l'âpreté de son zèle intolérant et de son mépris pour les huguenots, ne se contraignait pas tant à la ville, et que dans toutes les églises de Paris, des orateurs exaltés prêchaient la guerre sainte et la destruction de l'hérésie et des hérétiques. ll est curieux et intéressant de suivre, dans ses détails, cette lutte de la perfidie et du bon sens. Plus Jeanne se méfie, plus Catherine redouble de caresses et de promesses. Ce duel courtois entre ces deux femmes, l'une douée du génie maternel, l'autre servant par tous les moyens ses implacables projets, est une des scènes les plus émouvantes du grand drame du seizième siècle. Catherine y déploie une triste mais complète connaissance du cœur humain. Elle touche, d'un doigt lent et sûr, le point faible des passions ou des ambitions les plus secrètes. Ce grand clavier du cœur humain n'a pour elle aucun mystère. Coligny, enivré de prospérité et de gloire, heureux époux de cette Jacqueline d'Entremont qui a tout quitté pour venir être la Marcia du nouveau Caton, heureux beau-père de Téligny, le vertueux capitaine à qui il vient de donner sa fille, se hasarde à aller à la cour, y est reçu comme en triomphe, y est embrassé, caressé, fêté à outrance par le jeune roi qui l'appelle son père, son maitre, et qui lui promet de l'accompagner, pour y prendre ses leçons, à cette grande et décisive expédition de Flandre, rêve favori du génie huguenot, la seule revanche possible des injures de l'Espagne, à son tour frappée au cœur. Coligny, gagné, déployait à l'envi toutes les ressources de son crédit devenu l'allié des desseins de Catherine, pour attirer à la cour Jeanne et son fils, ainsi que le prince de Condé, qui venait, lui aussi, de s'amollir aux douceurs domestiques, et d'épouser la belle Marie de Clèves. Jeanne, pressée par ces conseils d'un homme qu'elle vénérait, harcelée d'insinuants négociateurs, porta la question du mariage de son fils au conseil de Navarre, résolue à suivre l'avis de la majorité. Là se firent librement jour les opinions les plus contraires ; et il faut en convenir, le oui et le non étaient également soutenables, les deux partis offrant des avantages et des désavantages qui semblaient se compenser. Aux yeux de Jeanne, l'union de Henri et de Marguerite avait contre elle d'abord l'inconvénient de la différence de religion. Elle redoutait aussi, pour son fils, les charmes et les défauts d'une princesse fille de Catherine, élevée par elle au milieu d'une cour corrompue, pour les succès politiques, plus que pour les vertus du foyer, et sans aucun de ces scrupules maternels et de ces salutaires exemples, qui avaient présidé à l'éducation d'Henri. D'ailleurs, cette jeune Marguerite, si précoce en ses passions, ne pouvait-elle pas l'être également en ses ambitions ? Savait-on bien de quoi était capable cette digne élève de Catherine, dont beaucoup disaient qu'elle était plus fine qu'on ne pensoit et parloient sinistrement ? Les pessimistes ajoutaient à ces raisons de méfiance, à ces incompatibilités, l'effet décisif du projet d'une alliance encore supérieure à celle qu'on discutait, et désignaient Élisabeth d'Angleterre elle-même comme la seule femme qui convint à Henri. Le baron de Rosny, père de ce Maximilien de Béthune qui allait être attaché à Henri, dont il devait être le meilleur et le plus célèbre serviteur, sous le nom de Sully, n'hésitait pas à dire : Voire même pourroit arriver tel succès d'affaires, que cette alliance uniroit pour toujours en la maison de Bourbon, les couronnes de France, d'Angleterre, et de Navarre. Le conseil de Jeanne à peu près tout entier, ses amis les plus intimes, son chancelier François Barbier de Francour, le baron de Beauvoir, gouverneur de son fils, mais surtout l'amiral de Coligny pensaient bien différemment. Ils voyaient dans le mariage proposé le coup de mort porté à la puissance de la maison de Lorraine. Catherine de Médicis n'était plus jeune ; elle devait, selon eux, aspirer au repos. Elle aimerait son gendre comme elle aimait sa fille, qui elle-même ne tarderait pas à sacrifier à un amour inévitable les restes d'une passion déjà éteinte, qu'on lui prêtait peut-être à tort pour son cousin Henri de Guise, qui venait lui-même de se marier. Ils faisaient valoir les avantages de cette union au point de vue des intérêts matériels et pécuniaires. Enfin, ils la montraient comme nécessaire à la paix, ayant été offerte par un prince qui n'avait pas l'habitude de supporter patiemment un refus, et qui vengerait sans doute, par des représailles impitoyables, l'affront fait à ses avances. Jeanne d'Albret, vaincue par ces raisons, imposa silence à ses répugnances et consentit au mariage ; mais voulant tout conduire elle-même, elle résolut d'aller à la cour traiter en personne des détails de l'affaire. Elle décida, contre l'avis de l'amiral et de son conseil et de tous ses amis, que son fils resterait éloigné de la cour, de tout danger ; et s'oubliant elle-même pour ne s'occuper que de lui, elle prétendit, tout le persuade, imposer par la force à la perfidie ; car elle seroit voirement, dit le Grain, à quelles gens elle aroit à faire. Du reste, inaccessible à la peur : vous savez, disait-elle à ses intimes, vous savez si c'est pour moi que je crains ; protestant à tous, que lorsqu'elle seroit arrivée auprès du roi, elle éviteroit toute occasion de mal et qu'elle perdroit la rie, plutôt que de permettre quelque chose contre Dieu, LEQUEL POURVOIROIT AU RESTE[18]. Elle répondit enfin au roi qu'elle n'avoit autre objet que l'avancement de sa religion, la sûreté de ses amis, et le repos du peuple ; qu'elle réputoit à honneur et bonheur les conditions de ce mariage ; mais qu'elle aimeroit mieux être la plus petite demoiselle de France, que, pour élever sa maison en grandeur, ravaler sa conscience en liberté de religion, et offenser son Dieu duquel elle reconnaissoit tenir tout ce qu'elle avoit de bien et d'honneur, voire la vie même. Le roi chercha à la rassurer en lui montrant à son tour : que ce mariage seroit trouvé miraculeux ; qu'il donnoit sa
sœur, non pas au prince de Navarre niais à tous les huguenots, comme pour se
marier avec eux, et leur ôter tout doute de l'immuable fermeté de ses édits. Elle étoit engagée par sa parole ; sa parole étoit inviolable. Ses ennemis le savoient. La cour de France crut son triomphe parfait. Médicis s'empressa de témoigner à cette princesse toute sa joie, par de nombreux messages qui se succédoient sans interruption. Toutes ces protestations ne l'abusoient point. Songeant au contraire, à la sûreté de son fils, elle écrivit de sa main à tous les braves gentilshommes dont elle avent éprouvé la fidélité dans le malheur, à Lavardin, à Ségur, de Piles, la Noue, au jeune Rohan, à Beauvoir, à La Rochefoucaud, au vertueux Rosny, à Caumont de la Force, en un mot à plus de cinq cents gentilshommes. Elle leur donne rendez-vous à Nérac et à Vendôme. Elle les prie de la venir trouver, pour savoir ce qu'elle ne peut leur découvrir par lettres, mon fils vous en prie aussi, ajoute-t-elle dans sa lettre à la Force, mais que ce soit incontinent, car PERICULUM EST IN NORA[19]. Il n'entre pas dans notre dessein de raconter les
vicissitudes et les péripéties de ces longues négociations où Jeanne, sans
autre amis sincères que Louis de Nassau et le vieux Rosny, — qui déplore ce funeste
mariage et qui prédit hautement que si les noces se font à Paris les livrées
en seront vermeilles, —où Jeanne doit lutter contre la haine hypocrite de Catherine,
la duplicité de Charles domptant sa violence pour bien
jouer son rôlet, l'impatience généreuse de Coligny, de Francour, de
Beauvoir, incapables de craindre ce qu'ils seraient incapables de faire, et
la puérile confiance des gentilshommes enchantés de redevenir courtisans. Elle n'avait d'autre consolation et d'autre encouragement que de prier Dieu de la soutenir en ces quotidiens assauts, et d'écrire à son fils, dont l'établissement mettait à de si rudes épreuves une patience digne pourtant, dit-elle, de celle de Griselidis. Enfin, toutes les difficultés aplanies, les articles arrêtés, on dressa le contrat de mariage. La princesse eut pour dot 300.000 écus d'or au soleil, l'écu évalué à 54 sols. La reine mère offrit en présent de noces, 200.000 livres tournois ; les ducs d'Anjou et d'Alençon, chacun 25.000 livres. La misère, mais plus encore l'extrême prodigalité du temps ne permirent pas de donner ces sommes comptant. Elles furent instituées en contrats de !rentes au denier douze, sur la ville de Paris[20]. Jeanne d'Albret, de son côté, déclare son fils héritier de tous ses biens présents et à venir ; lui abandonne dès à présent, la jouissance des revenus, offices et bénéfices du haut et bas Armagnac, son douaire ; 12.000 livres de rente assises sur le comté de Harle et les biens qu'elle tient du cardinal de Bourbon, son beau-frère. Le douaire de Marguerite fut de 40.000 liv. de rente que l'on devait asseoir sur le duché de Vendôme, ou tout autre domaine de la maison de Bourbon, au choix de l'épousée. Le prince s'oblige à fournir le château des meubles et ustensiles, jusqu'à la concurrence de 30.000 liv. Pour les bagues et joyaux, la reine fera ce qu'elle jugera convenable. Le cardinal de Bourbon confirma, en faveur de son neveu, toutes les renonciations qu'il avait faites aux successions paternelle et maternelle, lui abandonna les 100.000 livres qu'il avait héritées de la succession d'Alençon, et spécialement la seigneurie de Château-Neuf en Thimerais. Le prélat avait sans doute perdu le souvenir de toutes ces concessions et des droits de Henri, lorsque, partageant le délire des Ligueurs, il se laissa proclamer, dix-sept ans plus tard, roi de France, au préjudice de son neveu[21]. Le contrat de mariage fut signé à Blois, le 11 avril 1572. Le roi envoya en même temps dans tout son royaume, des lettres pour confirmer son édit, et il accorda aux protestants au delà même de leurs prétentions ; seulement pour les apprivoiser, ajoute un chroniqueur du temps ; car en derrière, il disoit en riant, qu'il faisoit comme son fauconnier, qu'il veillait les oiseaux. Jeanne partit de Blois le 15 de mai et arriva huit ou neuf jours après à Paris. Elle était accompagnée du prince Louis de Nassau, de M. de la Rochefoucauld, avec force noblesse, et un train considérable. Elle descendit rue de Grenelle-Saint-Honoré, chez Jean Guillart, évêque de Chartres, un des prélats excommuniés en 1563 par le pape Pie IV, et qui depuis, emporté par le vertige de la réforme, avait embrassé la religion protestante. La reine de Navarre s'occupa aussitôt, avec son activité ordinaire, qu'aiguillonnaient encore d'inquiets pressentiments, des préparatifs du mariage, courant sans cesse les boutiques et les ateliers. Le mercredi 4 juin au soir, elle fut tout à coup saisie d'une fièvre violente. Elle s'alita, et dès la première heure ne se lit aucune illusion. Elle voyait venir la mort inévitable, à la cour de Charles IX, pour tous ceux que haïssait Catherine. Elle fit ses dispositions et mourut en effet courageusement le lundi 9 juin 1572, dans sa quarante-quatrième année. Cette mort subite et prématurée devait être soupçonnée. Elle le fut. Quand on songe à ce qui la suivit, on ne se reproche point trop des doutes qui ne calomnient aucun de ceux qu'ils accusent. Jeanne d'Albret vivante, Catherine de Médicis savait bien qu'elle n'aurait jamais à sa complète disposition Henri et les protestants. La Saint-Barthélemy, avec ses poignards assassins qui s'aiguisaient dans l'ombre, ne pouvait passer sur le corps d'une femme, d'une reine, d'une mère. Et la Saint-Barthélemy semblait le seul coup d'État possible pour rendre au roi son autorité, à la religion sa force, au pays la paix. Les protestants, ne l'oublions pas, étaient, aux yeux de la reine mère et des hommes d'État catholiques, — entraînés par la haine et la crainte à tous les excès qui souillent parfois les meilleures causes, — des rebelles, et des rebelles dangereux. Ils pouvaient faire la guerre, tenir la campagne, et se retirer au besoin dans leurs places fortes. La Saint-Barthélemy, dont on a voulu faire un massacre religieux, fut un massacre politique, couvert du prétexte religieux. Paris fut le vaste piège où la monarchie aux abois attira, enferma et détruisit d'un coup ses plus puissants ennemis. Et les fêtes du mariage d'Henri de Navarre furent l'appeau de cette chasse aux huguenots. Ceci n'excuse et ne justifie rien, mais fait comprendre tout. Il n'y a de fanatisme religieux, dans le vrai sens du mot, qu'aux époques et dans les pays austères. Les guerres de religion en France sont des guerres d'ambition. N'étant pas sûr de trouver assez de juges pour tant et de si hauts coupables, Charles se fit juge lui-même, et lança les bourreaux dans les rues de Paris. Et ce ne serait certes faire injure ni à sa mère ni à lui que de leur attribuer la mort mystérieuse de Jeanne. Celui-là a commis le crime à qui il profite. Or il fallait que Jeanne disparût de la scène pour que leur appartint ce théâtre qu'ils allaient ensanglanter avec la froide cruauté de l'ambition, de la jalousie et de la peur. Quoi qu'il en soit, le cri populaire du temps se prononça pour l'explication par un crime de cette mort inexplicable. On se rappela que la reine de Navarre avait acheté des gants et des collets parfumés au pont Saint-Michel, chez le Florentin René, parfumeur (et empoisonneur) de la reine mère. On fit, il est vrai, une autopsie, pour donner une apparence de satisfaction à l'opinion, mais on n'ouvrit point, dit-on, le cerveau ; et cependant le bruit public était que Jeanne d'Albret avait été empoisonnée par inhalation. Henri de Navarre, qui arrivait à petites journées, apprit à Chaunay en Poitou, la nouvelle de la mort de sa mère. Il en fut atterré, et tomba malade. Pendant sa convalescence, il écrivit au fidèle d'Arros, lieutenant général de la Reine, et au conseil souverain de Béarn pour ordonner que tout ce qui avait été fait par sa mère fût respecté. Le samedi 16 août, le mariage fatal se célébrait à Paris. Le massacre de la Saint-Barthélemy devait être le lendemain de la fête. Ainsi, dit Péréfixe, le présent nuptial des noces du prince fut la mort inopinée de sa mère ; la fête, le massacre général de ses amis. Un tel événement a trop d'importance dans la vie de Henri IV, en dehors de l'influence qu'il devait exercer sur notre histoire, pour que nous reculions devant le pénible devoir de considérer notre héros en présence de la première trahison de la fortune si longtemps infidèle, aux prises avec une de ces épreuves faites pour tremper ou abâtardir à jamais une âme. Cette épreuve devait le montrer désarmé à la fois par la douleur de la mort d'une mère chérie, le regret de la perte de ses amis les plus dévoués, et les charmes perfides d'une union décevante. Si, devant un ensemble d'obstacles trop redoutables pour être surmontés, Henri se résigna à les tourner, s'il parut un moment accepter le joug qu'il ne pouvait éviter, et courber la tête devant œ niveau sanglant qui ne connaissait pas d'inviolabilité et menaçait tout front, même royal, rebelle à la domination de Catherine triomphante, nous verrons qu'il y a lieu de faire largement, dans cette passagère et apparente défaillance, la part des circonstances, d'une nécessité parfois plus forte que toute vertu, d'une prudence préférable à la témérité. Cette moralité ressortira surabondamment des détails que fournira le chapitre suivant sur le mariage d'Henri, le caractère de sa femme, et les scènes de ce drame de la Saint-Barthélemy, dont un seul épisode nous permettra d'embrasser l'inénarrable horreur. Nous y verrons qu'Henri ne dut son salut qu'à son génie éveillé par l'adversité, à son art, déjà consommé, d'éviter les luttes inégales et les résistances impossibles, et de se contenter d'être égal à sa fortune, quand il ne pouvait lui être supérieur. |