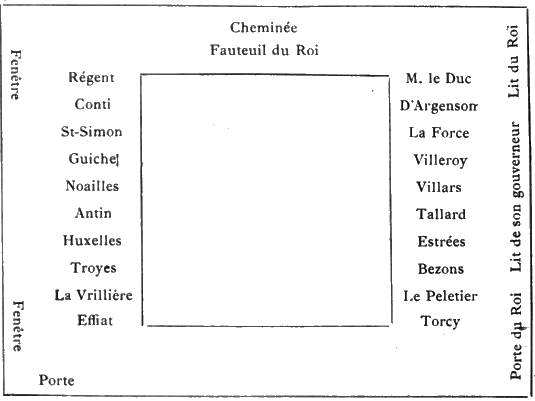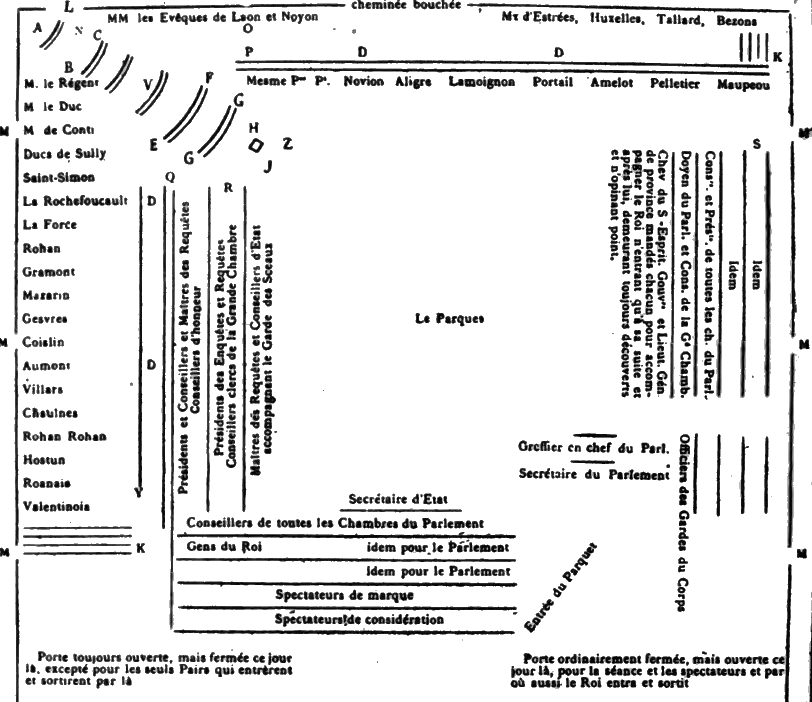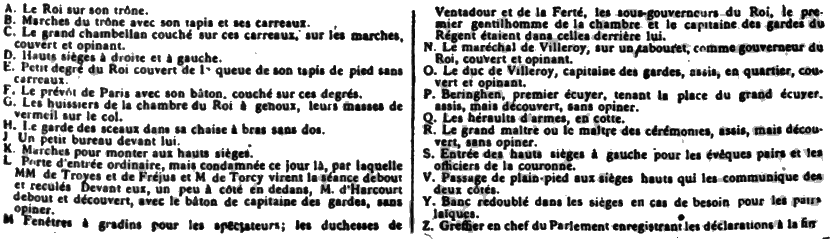HISTOIRE DE LA RÉGENCE PENDANT LA MINORITÉ DE LOUIS XV
TOME DEUXIÈME
CHAPITRE XXVII. — Le lit de Justice (20-26 août 1718).
La fête du Roi. — Préludes du lit de justice. — Journée du 20 août. — Entretien du Régent et de Saint-Simon qui se rend au garde-meuble. — Dimanche 21 août. — Lundi 22. — Mercredi 24. — Préparatifs. — 26 août : Une heure du matin ; Six heures, le Parlement averti ; Le garde des sceaux. — Arrivée et sortie des légitimés. — Disposition de la salle du Conseil. — Lecture du garde des sceaux. — L’affaire des légitimés. — Le comte de Toulouse. — La marche du Parlement. — Les membres du Conseil pris du besoin d’uriner. — Mise en marche du cortège. — Entrée dans la salle. — Premier acte. — Second acte. — Troisième acte. — Quatrième acte. — Enregistrement. — Impressions.La fête du RoiLa Saint-Louis était alors comme une trêve rapide et joyeuse, que l’âge du petit Roi embellissait d’attentions maternelles. Le24août, au soir, il y eut grande musique sous les fenêtres de l’enfant, suivie d’un feu d’artifice représentant une forteresse construite sur le bord*du bassin. Quoique la chaleur fut excessive et qu’on ne se souvint point d’en avoir vu de pareille en France, la fête réussit parfaitement grâce à une grosse pluie qui tomba une heure avant le feu d’artifice et « redonna la joie à tout Paris ». Le Roi prit un plaisir infini à voir la foule fuir sous l’ondée, les dames mouillées et rieuses, n’ayant que la musique pour se sécher ![1] Au lever de Louis XV, on présenta à l’enfant son portrait en émail[2] ; il considéra avec admiration parmi les présents qu’on lui faisait une corbeille contenant une lapine assez petite, son mâle, un petit lapin qui tétait et un cochon d’Inde, tous quatre blancs comme la neige, enrubannés et broutant des feuilles de vigne. Sur les feuilles de ce bouquet étaient posés des hannetons artificiels, les ailes ouvertes, prêts à voler[3]. Ensuite les Carmes du grand couvent vinrent, comme chaque année, aux Tuileries, en procession, et ils célébrèrent la messe dans la chapelle, où le Roi assista. Le soir, il alla entendre le salut dans l’Eglise des Capucins[4]. Préludes du lit de justiceCe calme n’était qu’apparent. « Il gronde un gros orage », disait l’un[5] ; « il y a eu des ordres de faire approcher quelques troupes de Paris », disait un autre[6] ; « on croit que le Parlement pourra s’en sentir, mais on parle aussi de M. du Maine et de M. de Villeroy[7] ». La mère du Régent, retirée à Saint-Cloud, remercie Dieu, le soir en se couchant, de ce qu’il n’est pas survenu quelque malheur dans la journée[8]. Dangeau, toujours averti de tout ce qui se passe et de tout ce qui se prépare, a su qu’on « parlait de tenir un Conseil de Régence extraordinaire le jour même, mais on le croit remis au lendemain ; il est sur, ajoute-t-il qu’il y aura un lit de justice au premier jour et ce pourrait bien être demain. M. le duc d’Orléans se coucha de bonne heure, mais il donna des audiences étant dans son lit et à des gens qui font croire qu’il s’agissait d’affaires importantes dans ces audiences, car ce sont des personnes intelligentes, fort attachées à M. le Duc. On ne doute pas qu’il ne se passe demain quelque chose qui sera fort agréable à ce prince[9]. » C’était, en effet, à un lit de justice que l’influence de Dubois, de Law et de Saint-Simon avait amené le Régent. Saint-Simon s’en fit l’ordonnateur empresse et il en est resté le chroniqueur inoubliable. Aux objections qu’on soulevait, sa verve, teinte de logique, trouvait des réponses péremptoires. Qu’on réunisse le lit de justice aux Tuileries. Par cet expédient, nulle nécessité d’avertir personne que le matin même qu’il se tiendrait, et par ce secret chacun hors de mesure et de garde. Sur le champ, il se mit à dicter un mémoire de tout ce qu’il estimait nécessaire pour assurer l’exécution et prévenir tous les obstacles et l’adressa à Dubois « duquel on ne pouvait espérer de se passer dans sa situation présente auprès du Régent[10] ». Mais Dubois n’était pas homme à se livrer du premier coup, il se montra « tout vacillant, et à propos de rien tout Daguesseau, dont il était auparavant l’ennemi[11] ». Saint-Simon lui prêta aussitôt des projets bien tortueux mais dont il ne s’alarmait guère, étant mandé au Palais-Royal dans l’après-dinée (20 août). Journée du 20 aoûtIl y arriva à quatre heures, trouva Grancey et Broglie, deux des roués, dans le grand cabinet, au frais, familièrement, sans perruques. Après un moment, on l’introduisit dans la galerie de Coypel où le Régent et Villeroy regardaient quantité de plans et de cartes des Pyrénées. Le duc d’Orléans le reçut avec une ouverture et des caresses qui sentaient le besoin, lui dit à l’oreille qu’il avait à l’entretenir mais qu’il fallait laisser sortir le maréchal. Celui-ci n’avait jamais fini ses bavardages, ses protestations, ses vantardises sur les précautions dont il entourait la personne du Roi. Enfin il s’en alla avec la compagnie. Entretien du Régent et de Saint-SimonAlors le duc d’Orléans respira et emmena Saint-Simon dans les cabinets derrière le grand salon de la rue de Richelieu. Le prenant par le bras, il dit qu’il était à la crise de sa Régence et jouait le tout pour le tout. Mais ceci, expliqua Saint-Simon ne dépendait que de lui. Dubois survint, parla sur le Parlement mais avec prudence ; après sa sortie, le Régent défendit qu’on vînt l’interrompre, excepté pour l’avertir de l'arrivée du garde des sceaux ; et seulement à travers la porte, qu’il alla fermer au verrou. Aussitôt Saint-Simon le mit en garde contre Dubois, si promptement changé et sans cause apparente. Le prince répondit de la fidélité de l’abbé, mais convint de ne s’avancer que la sonde à la main. Après ce court préambule, il entra en matière, approuva la tenue du lit de justice aux Tuileries, ajouta qu’il était assuré de M. le Duc, moyennant une nouvelle pension de cent cinquante mille livres comme chef du Conseil de Régence ; depuis le matin, il avait parole de M. de Conti ; enfin M. le Duc voulait que l’éducation du Roi fut ôtée au duc du Maine, ce qui lui convenait à lui-même et lui faisait souhaiter de tenir le lit de justice dès le mardi suivant et là d’ôter l’éducation au duc du Maine. Saint-Simon se récria, le Régent lui coupa la parole et dit : — « Eh ! pourquoi n’est-ce pas votre avis ? — « Parce que c’est trop entreprendre à la fois. Quelle est maintenant votre affaire urgente avant toute autre, et qui ne souffre pont de délais ? C’est celle du Parlement : voilà le grand point ; contentez-vous-en. Frappant dessus un grand coup, et le sachant soutenir après, vous regagnez en un instant toute votre autorité, après quoi vous aurez tout le temps de penser au duc du Maine. Ne le confondez point avec le Parlement ; ne l’identifiez point avec lui : parleur disgrâce commune, vous les joignez d’intérêt. Il sera et se professera le martyr du Parlement ; conséquemment du public dans l’esprit qu’ils ont su y répandre. Voyez donc auparavant ce que le public fera et pensera de l’éclat que vous allez faire contre le Parlement. Vous n’avez pas voulu abattre M. du Maine, lorsque vous le pouviez et le deviez, lorsque le public et le Parlement s’y attendaient et le désiraient ouvertement ; vous avez laissé pratiquer l’un et l’autre au duc du Maine à son aise, et vous le voulez ôter à contretemps. D’ailleurs, espérez-vous que cet affront ne vous conduise pas plus loin ? Mais de plus, M. le Duc veut-il l’éducation ou se contente-il de l’ôter à M. du Maine. — « Il ne s’en soucie pas. — « A la bonne heure, mais tâchez donc de lui faire entendre raison sur le moment présent qui vous engage à un trop fort mouvement. Pensez encore, monsieur, que quand je m’oppose à l’abaissement de M. du Maine, je combats mon intérêt le plus cher : de l’éducation au rang il n’y a pas loin : vous connaissez sur ce point l’ardeur de mes désirs, et que d’ailleurs je hais parfaitement M. du Maine, qui nous a, par noirceur profonde et pourpensée, induits forcément au bonnet, et, de dessein prémédité, nous a coûté tout ce qui s’en est suivi ; mais le bien de l’État et le vôtre m’est plus cher que mon rang et ma vengeance, et je vous conjure d’y bien faire toutes vos réflexions. Le Régent, ému, embrassa Saint-Simon et adopta ses vues. Le duc du Maine serait épargné cette fois ; mais le Premier Président serait chassé. Nouvelle opposition du petit duc et pair qui préférait voir ses deux ennemis succomber en même temps. Il se jugeait héroïque d’épargner un tel « scélérat », mais loin de l’accabler il fallait le caresser en apparence, le perdre aux yeux de sa Compagnie, ensuite on pourrait le déshonorer impunément et s’en défaire à bon compte. Le Régent loua encore, remercia et « après avoir bien discuté tous les inconvénients et leurs remèdes, nous en vînmes à la mécanique, dit Saint-Simon. Je la lui expliquais telle que je l’imaginais, et je me chargeai, à la prière du Régent, de la machine matérielle du lit de justice, par Fontanieu, garde-meuble de la couronne, à l’insu de tout le monde, et particulièrement du duc d’Aumont, son supérieur comme premier gentilhomme de la chambre en année, et valet à gage de M. du Maine et du Premier Président. Il se rend au garde-meubleIl sortit, croisa Dubois qui ne lui dit rien, fut appelé par Law à qui il annonça que tout allait bien et que le Régent à cette heure câlinait M. le Duc dans son grand cabinet ; leur rapprochement était l’ouvrage du financier. De là, après s’être excusé « sur une commission très nécessaire », Saint-Simon courut chez Fontanieu à la place Vendôme. Fontanieu, appelé par ses affaires, s’était rendu au Marais, mais ayant pris le chemin des écoliers, on le retrouva dans le voisinage et on l’amena. Il fallut se dépêtrer de la curiosité en éveil de sa femme, de celle des domestiques, enfin quand ceux-ci furent retirés, Saint-Simon alla voir s’ils n’écoutaient pas aux portes et ferma celles-ci au tour de clef. Fontanieu, sans parole, confondu, hébété, laissait faire. Ce fut pis quand op lui parla d’une affaire qui demandait toute son industrie et un secret à toute épreuve ; mais d’abord Son Altesse Royale pouvait-elle compter sur lui ? A ces mots Fontanieu se mit à trembler de tout son corps et devint livide, il balbutia quelques mots : « Qu’il était à Son Altesse Royale tant que son devoir le lui permettrait. » Le regard de Saint-Simon le transperça. Fontanieu se jeta dans les excuses et apprit « qu’il s’agissait d’un lit de justice pour la construction duquel et sa position nous avions besoin de lui. » A ces mots Fontanieu se mit à respirer quatre ou cinq fois avec bruit disant chaque fois : « N’est-ce que cela ! » Et il promit tout, avec d’autant plus de facilité qu’il ignorait ce qu’était un lit de justice, n’en avait jamais vu et ignorait à quoi cela pouvait servir. Saint-Simon s’attabla, dessina la séance, dicta des explications afin qu’on ne pût reconnaître son écriture, parla, discuta, raisonna, rangea et dérangea table, chaises et fauteuils, figura toute la bataille sans livrer le nom du terrain où elle se livrerait et retourna au Palais-Royal. Un garçon rouge l’attendait et le concierge à l’entrée de l’appartement le prièrent d’écrire, car c était l’heure sacrée des roués et du souper, contre lesquelles rien ni personne ne pouvait prévaloir. Saint-Simon écrivit l’indispensable et pria le concierge de ne remettre son billet au prince que quand il serait en état de le lire, il recommanda de le brûler après. Dimanche 21 aoûtLe lendemain dimanche, après un entretien interminable avec M. le Duc, qui voulait qu’on employât le lit de justice à retirer au duc du Mairie l’éducation du Roi pour la lui donner, Saint-Simon ailla tout rapporter au Régent qui l’avertit que le lit de justice serait retardé parce que d’Argenson doutait d’être prêt pour tout ce qu’il y aurait à faire. Saint-Simon craignit que ce délai ne fut suivi de l’abandon et demanda à quand donc on prétendait remettre ? — « A Vendredi, dit le Régent, car mercredi et jeudi sont fêtes, et on ne le peut plus tôt. » — « A la bonne heure pourvu qu’à tout rompre ce soit vendredi », répliqua Saint-Simon qui raconta sa visite de la veille à Fontanieu. Lundi 22Le lundi, nouvel entretien entre le Régent et Saint-Simon, plus que jamais véritable « mouche du coche ». Le prince fort calme, très décidé à contenir l’ambition de M. le Duc et des Condé, qui veulent profiter des circonstances pour mettre la main sur l’éducation du Roi et sur un apanage pour le comte de Charolais. — « Tout cela ne m’embarrasse pas, dit le Régent. D’établissement, je n’en sais point faire quand il n’en vaque pas et la réponse est sans réplique. Pour l’éducation, je n’en ferai rien, et j’ai un homme bien à moi à cette heure, qui ôtera à M. le Duc cette fantaisie de la tête, car il le gouverne, et je le dois voir tantôt. — « Mais, monsieur, qui est cet homme ? — « C’est La Faye, qui est son secrétaire, qu’il consulte et croit sur tout, et, entre nous, je lui graisse la patte ! » Pour qui connaissait le caractère du duc d’Orléans, il n’v avait pas lieu de douter qu’il abandonnât ce que M. le Duc voulait, avec tant d’énergie, obtenir. Celui-ci se montrait intraitable, mais le détail de ses entretiens journaliers est si fastidieux qu’il ne sert à rien de le transcrire. Les journées s’écoulaient en conférences dont le duc et pair, qui ne s’était jamais trouvé à pareille fête, était l’âme. Mercredi 24. PréparatifsLe 24 août, il courait dans Paris cette histoire ridicule d’une conspiration du duc du Maine pour déclarer le Roi majeur et former un conseil dont le bâtard serait chef[12]. Saint-Simon, Law, Dubois et quelques initiés comme Fagon, le duc de la Force, prenaient leurs dernières mesures ; il en fut de même le lendemain, on prévit et on calcula « la cadence des grands coups du lendemain ». La fin de la journée se passa à remâcher toute la besogne. « Tout était prévu, et les remèdes à chaque inconvénient tout dressés : si le Parlement refusait de venir aux Tuileries, d’interdiction prête, avec attribution des causes y pendantes et des autres de son ressort au grand conseil, les maîtres des requêtes choisis pour l’aller signifier et mettre le scellé partout où il était nécessaire ; les officiers des gardes du corps choisis, et les détachements du régiment des gardes destinés pour les y accompagner ; si une partie du Parlement venait et une autre refusait, même punition pour les refusants ; si le Parlement venu refusait d’entendre et voulait sortir, même punition ; si une partie restait, une autre s’en allait, de même pour les sortants..., si refus d’opiner, passer outre, de même pour peu qu’il restât de membres du Parlement ; au cas que tous fussent sortis, tenir également le lit de justice, et huit jours après en tenir un autre au grand conseil pour y enregistrer ce qui aurait été les bâtards ou quelque autre seigneur branlaient, les arrêter dans la séance, si l’éclat était grand, sinon à la sortie de la séance ; s’ils sortaient de Paris les arrêter de même. Tout cola bien arrangé et les destinations et les expéditions faites, l’abbé Dubois fit une petite liste de signaux, comme croiser les jambes, secouer un mouchoir, et autres gestes simples, pour la donner dans le premier matin aux officiers des gardes du corps choisis pour les exécutions, qui, répandus dans la salle du lit de justice, devaient continuellement regarder le Régent pour obéir au moindre signal, et entendre ce qu’ils auraient à faire. Il fit plus, car, pour décharger M. le duc d’Orléans, il lui dressa, pour ainsi dire, une horloge, c’est-à-dire des heures auxquelles il devait mander ceux à qui il aurait nécessairement des ordres à donner pour ne les pas mander un moment plus tôt, et ce qu’il aurait à leur dire pour ne pas aller au-delà, n’en oublier aucun et donner chaque ordre en son temps et en sa cadence, ce qui contribua infiniment à conserver le secret jusqu’au dernier instant[13]. » Vers huit heures du soir, Saint-Simon se rendit, sans flambeaux au Palais-Royal où le valet de chambre Desbagnets le mena, à tâtons, près du Régent, couché, ayant un accès de fièvre. On décida les dernières dispositions dans cette chambre éclairée par une seule bougie. Saint-Simon voulant écrire quelques mots s’empara d’une niche à chien en guise de table. A dix heures on se sépara, Saint-Simon débordait, embrassait M. le Duc, embrassait le sieur Millin, embrassait le duc de Chaulnes à qui il alla confier « le grand spectacle préparé pour le lendemain matin. Nous nous livrâmes, lui et moi, dit-il, au ravissement d’un rétablissement si imprévu, si subit, si prochain, si secret, dont la seule espérance, fondée comme que ce fût, nous avait uniquement soutenus sous l’horrible marteau du feu Roi. La dissipation et la fonte de ces montagnes entassées l’une sur l’autre, par degrés infinis, sur notre dignité par ces géants de bâtards, ces Titans de la France ; leur état prochain, la commune surprise, mais si différente, si extrême en eux et dans les pairs ; notre renaissance, notre réexistence des anéantissements passés, cent vues à la fois, nous dilatèrent le cœur d’une manière à ne le pouvoir rendre, la juste rétribution des profondes noirceurs si pourpensées du duc du Maine... Nous nous séparâmes enfin dans cette grande attente[14]. 26 août. Une heure du matinDepuis une heure du matin, le Régent manda successivement les ducs de Guiche, de Villeroy et de Chaulnes, colonels des gardes, capitaine des gardes du corps en quartier, capitaine des chevau-légers de la garde ; Artagnan et Canillac, capitaines des deux compagnies des mousquetaires et, en l’absence de Dreux, maître des cérémonies, son substitut des Granges. On avait pensé à tout, excepté aux Suisses. Contade, major des gardes, s’en avisa et alla prendre les ordres du Régent. Il lui fit entendre que l’affection fidèle de ce régiment répondait de tout et qu’on l’offenserait par une marque de défiance. On lui donna ordre d’y pourvoir. Sur les quatre heures du matin, Contade alla aux Tuileries éveiller le duc du Maine, colonel général des Suisses, lequel rentré d’une fête était couché depuis une heure à peine. Contade entra, expliqua son ordre de la part du Régent et le duc du Maine, ayant fait avertir les compagnies, se recoucha. Vers cinq heures du matin, Paris se réveilla au bruit des tambours ; les habitants, assez curieux pour se lever de si bonne heure, aperçurent des compagnies de soldats en mouvement. Des estafettes couraient partout, au logis des pairs, des maréchaux de France, des gouverneurs de province, des chevaliers de l’Ordre Le garde des sceaux envoyait avertir quatre conseillers d’État : MM. Pelletier, Caumartin, Nointel et l’abbé Dubois, et quatre maîtres des requêtes de venir en robes. Six heures ; le Parlement avertiA six heures, des Granges arriva dans la Grand’Chambre pour remettre sa lettre de cachet ; il n’y trouva que quelques conseillers arrivés pour juger des procès, qui bientôt après furent suivis par quelques présidents et d’autres conseillers qui envoyèrent au plus vite avertir le Premier Président qui, souffrant de la goutte, se fit porter en chaise. Pendant ce temps, Saint-Simon, levé à six heures recevait son billet d’avertissement et prenant un habit entièrement noir afin de ne pas paraître insulter à ses victimes, monta en carrosse, assez perplexe sur les Surprises que pouvait ménager l’indécision habituelle du duc d’Orléans. Passant devant le logis de M. de Valincourt, secrétaire général de la marine et attaché au comte de Toulouse depuis sa première jeunesse, il le fit appeler. Valincourt vint, à peine habillé, demandant ce quêtait tout ceci. Saint-Simon le prit par la tête et dit : « Écoutez-moi bien, et ne perdez pas un mot. Allez de ce pas dire à M. le comte de Toulouse qu’il se fie en ma parole, qu’il sait sage, qu’il va arriver des choses qui pourront lui déplaire par rapport à autrui mais qu’il compte avec assurance qu’il n’y perdra pas un cheveu ; je ne veux pas qu’il puisse en avoir un instant d’inquiétude ; allez et ne perdez pas un instant ! » Cola dit il reprit sa marche et arriva dans la cour des Tuileries. Le garde des sceauxLe lit de justice était préparé dans la grande antichambre où le Roi prenait ses repas. Fontanieu était arrivé à six heures du matin avec ses ouvriers et son matériel, avait tout monté et dressé en sourdine, tellement que le Roi n’avait rien entendu ; vers les sept heures, le premier valet de chambre sortant pour quelque besoin de la chambre du Roi n’en put croire ses yeux et courut avertir le maréchal de Villeroy. En attendant l’heure fixée, le garde des sceaux d’Argenson et la Vrillière revoyaient leurs papiers dans un cabinet. Le garde des sceaux, debout, tenait une croûte de pain, aussi à lui-même que s’il n’eût été question que d’un conseil ordinaire, sans embarras, mais un peu en peine de la fermeté du Régent. Il ne quittait guère des yeux deux gros sacs de velours renfermant les sceaux et les instruments de précaution signés et scellés ; ces deux sacs furent tout le temps à portée de sa main. Le chauffe-cire avec de l’eau et du feu tout allumé demeura tout prêt dans une chambre voisine sans que personne s’en fût aperçu. Arrivée et sortie des légitimésOn n’attendait que le réveil du petit Roi qui, depuis les grandes chaleurs, couchait dans le cabinet du Conseil. Dès qu’il fut hors de son lit, on le mena s’habiller dans sa petite chambre et, de là, dans ses cabinets. On tira les housses du lit de l’enfant et de celui du maréchal de Villeroy, au pied duquel on mit la table du conseil. Le Régent arrivait, revêtu de sa robe dulit de justice, pour n’avoir pas à en changer. Dans le cabinet du Conseil régnait un air de contention d’esprit, un sérieux qui coupait, court aux conversations ; chacun, debout ou assis, çà et là, se tenait assez en sa place. Le duc d’Orléans entra d’un air gai, libre, regardant la compagnie avec un sourire. M. du Maine parut à son tour en manteau, multipliant les révérences allant et venant comme pour se donner une contenance. Son frère le comte de Toulouse parut également en manteau, le Régent s’approcha de lui et lui dit sa surprise de le voir ainsi, ne l’ayantpas fait avertir du lit de justice sachant que depuis le dernier arrêt, il n’aimait pas aller au Parlement. « Il est vrai, répondit Le comte de Toulouse, mais quand il s’agit du bien de l’État, je mets toute autre considération à part. » — « Voilà un homme qui me perce le cœur » dit le Régent tout bas à Saint-Simon. Un instant après, il revint vers le comte de Toulouse et lui dit : « Mon pauvre comte, je t’ai toujours aimé et aime encore, mais je te prie de ne point entrer au Conseil aujourd’hui parce qu’on y doit parler d’affaires qui te regardent et le duc du Maine. » Là-dessus le comte de Toulouse voulut entrer en explication : le Régent coupa court et dit que, pour lui, il pouvait rester en sûreté, mais qu’il pourrait se passer des choses désagréables a M. du Maine. Le comte de Toulouse insista, disant qu’il ne pouvait partir du moment qu’on attaquerait son frère. Le Régent répliqua qu’il ne pouvait que distinguer le mérite et la vertu et les séparer. Ils se quittèrent. Toulouse dit quelques mots à son frère qui, livide, gagna le bout de la table et tous deux s’éloignèrent. — « Allons, messieurs, prenons nos places », dit le Régent a haute voix. Chacun gagna la sienne ; alors Saint-Simon vit les deux frères prêts l’sortir. Il sauta d’un bond jusqu’au Régent et lui glissa à l’oreille : — « Monsieur, les voilà qui sortent. — « Je le sais bien. — « Oui, mais savez-vous ce qu’ils feront quand ils seront dehors ? — « Rien du tout ; le comte de Toulouse m’est venu demander permission de sortir avec son frère ; il m’a assuré qu’ils seront sages. — « Et s’ils ne le sont pas ? — « Mais ils le seront, et s’ils ne le sont pas, il y a de bons ordres de les bien observer. — « Mais s’ils font sottise ou qu’ils sortent de Paris ? — « On les arrêtera ; il y a de bons ordres, je vous en réponds. » Tous ces mouvements avaient attiré tous les yeux sur le Régent et la sortie des bâtards avait passé inaperçue. Chacun, en prenant sa place, se mit à les chercher des yeux. Saint-Simon qui avait tout vu, s’assit dans le fauteuil du comte de Toulouse pendant que le duc de Guiche laissait un siège vide, attendant l’absent. Il dit à Saint-Simon de reculer d’un rang, le lui répéta ; à la troisième fois Saint-Simon lui réplique d’avancer lui-même, et le voyant immobile d’étonnement le tira par son habit, si fort que celui-ci s’assit sans comprendre. — « Mais qu’est-ce que ceci, dit-il à peine assis, où sont donc ces messieurs ? — « Je n’en sais rien, mais ils n’y sont pas. — « En même temps le duc de Noailles s’allongea sur la table par-devant le duc de Guiche et dit à Saint-Simon : — « Au nom de Dieu, monsieur le duc, faites-moi la grâce de me dire ce que c’est donc que tout ceci ? » Il n’obtint pas même de réponse. Disposition de la salle du ConseilLa disposition de la salle et des membres était la suivante :
Le Régent se plaça en retour, pas très loin du fauteuil vide du Roi. D’Effiat lui faisait face afin de laisser à La Vrillière plus de facilité pour écrire. D’Argenson avait à ses pieds, à terre, le sac de velours contenant les sceaux à nu, avec les instruments de précaution, signés et scellés ; l’autre sac devant lui sur la table avait tout ce qui devait être lu, rangé en ordre. Lecture du garde des sceauxLorsque tous furent assis, les yeux fichés sur le duc d’Orléans, il dit qu’il avait assemblé ce conseil de régence pour y entendre la lecture de ce qui avait été résolu au dernier ; qu’il avait cru qu’il n’y avait d’expédient pour faire enregistrer l’arrêt du conseil dont on allait entendre la lecture que de tenir un lit de justice, et que les chaleurs ne permettant pas de commettre la santé du Roi à la foule du Palais, il avait estimé devoir suivre l’exemple du feu Roi, qui avait fait quelquefois venir son Parlement aux Tuileries ; que, puisqu’il fallait tenir un lit de justice, il avait jugé devoir profiter de cette occasion pour y faire enregistrer les lettres de provision du garde des sceaux, et commencer par là cette séance et il ordonna à d’Argenson de les lire. De son poste, Saint-Simon dévisageait chacun : Le Régent, avait un air d’autorité et d’attention, M. le Duc gai et brillant, le prince de Conti ne semblait rien voir de ce qui se passait, d’Argenson grave et pensif, bien à son affaire. Le duc de la Force, les yeux en dessous, examinait les visages, Villeroy et Villars se disaient parfois un mot à l’oreille, ils avaient le regard irrité, au contraire Tallard affectait un grand calme, d’Estrées stupéfait, Bezons enfoncé sous sa grosse perruque était grognon. Pelletier curieux, Torcy empesé, Effiat vif, le sourcil froncé, le regard courant de l’un à l’autre avec précipitation et par élans de tous côtés. L’évêque de Troyes ébahi, Huxelles composait son visage, d’Antin « toujours si libre dans sa taille » semblait effarouché, Noailles l’œil aux aguets, dépité, Guiche surpris et Saint-Simon pétillant et radieux. La sortie des bâtards, la réunion du Conseil, l’imminence du lit de justice, tout marquait un plan arrêté et une suite de mesures irrésistibles dans un prince si reconnu pour en être entièrement incapable, que tous en perdaient terre. Le Régent prend les avisQuand la lecture fut terminée, après une petite pause, mais marquée, le Régent exposa ses raisons de tenir un lit de justice vu la disposition présente du Parlement à refuser l’enregistrement ; il avait cru, avec le garde des sceaux, que la fréquence et la manière des remontrances du Parlement méritait que cette compagnie fut remise dans les bornes du devoir, que depuis quelque temps elle avait perdu de vue. Le garde des sceaux paraphrasa ce discours et lut l’arrêt sur les règles à observer à l’avenir. Cette lecture achevée, le Régent, contre sa coutume, donna son avis en louant fort cette pièce et prenant « un air et un ton de Régent que personne ne lui avait encore vu et qui acheva d’étonner la compagnie, il ajouta : « Pour aujourd’hui, messieurs, je m’écarterai de la règle ordinaire pour prendre les voix, et je pense qu’il sera bon que j’en use ainsi pour tout ce conseil.» Puis, après un léger coup d’œil passé sur les deux côtés de la table pendant lequel on eut entendu un ciron marcher, il se retourna vers M. le Duc, et lui demanda son avis. Ce ne pouvait être qu’une approbation ; tous approuvèrent, mais sans phrases et sans conviction. Le Régent opina le dernier, mais avec une force très insolite ; puis fit encore une pause. L’affaire des légitimésEn ce moment, le maréchal de Villeroy, plein de sa pensée, se demanda entre ses dents : « Mais viendront-ils ? » Cela fut doucement relevé. Le duc d’Orléans dit qu’ils en avaient assuré des Granges, et ajouta qu’il n’en doutait pas, et tout de suite qu’il faudrait faire avertir quand on les saurait en marche. Redressé sur son siège d’un demi-pied, le Régent dit d’un ton plus ferme et plus maître encore qu’au début, qu’il avait une autre affaire à proposer bien plus importante que celle qu’on venait d’entendre. Ce prélude rendit chacun immobile. Alors le prince dit qu’il avait jugé le procès qui s’était élevé entre les princes du sang et les légitimés, qu’il avait eu ses raisons pour n’en pas faire davantage, mais qu’il n’était pas moins obligé de faire justice aux pairs de France, qu’elle ne se pouvait plus différer et après avoir laissé entendre que la faveur qui avait interverti le rang des pairs n’avait duré qu’autant que l’autorité qui avait forcé les lois, on put deviner que les bâtards allaient faire les frais de la fête. Le garde des sceaux entama la lecture d’une déclaration pendant laquelle « il se peignit un brun sombre sur quantité de visages, la colère étincela sur celui des maréchaux de Villars et de Bezons, d’Effiat, même du maréchal d’Estrées. Tallard devint stupide quelques moments et le maréchal de Villeroy perdit toute contenance. « Je ne pus voir, dit Saint-Simon, celle du maréchal d’Huxelles, que je regrettai beaucoup, ni du duc de Noailles que de biais, par-ci par-là. J’avais la mienne à composer, sur qui tous les yeux passaient successivement. J’avais mis sur mon visage une couche de plus de gravité et de modestie. Je gouvernais mes yeux avec lenteur, et ne regardais qu’horizontalement pour le plus haut. Dès que le Régent ouvrit la bouche sur cette affaire, M. le Duc m’avait jeté un regard triomphant qui pensa démonter tout mon sérieux, qui m’avertit de le redoubler et de ne m’exposer plus à trouver ses yeux sous les miens. Contenu de la sorte, attentif à dévorer l’air de tous, présent à tout et à moi-même, immobile, collé sur mon siège, compassé de tout mon corps, pénétré de tout ce que la joie peut imprimer de plus sensible et de plus vif, du trouble le plus charmant, d’une jouissance la plus démesurément et la plus persévéramment souhaitée, je suais d’angoisse de la captivité de mon transport, et cette angoisse même était une volupté que je n’ai jamais ressentie ni devant ni depuis ce beau jour. » Pendant la lecture que fit d’Argenson, Villeroy et surtout Villars parurent à l'instant d’éclater. Saint-Simon pour prévenir une sortie, qui pouvait gâter tout, s’avisa de tirer de sa poche et d’établir sur la table la requête des ducs contre les bâtards qu'il posa ouverte à la dernière page couverte de signatures en gros caractères majuscules. C’en fut assez pour ramener le calme. On opina : Saint-Simon débordant de reconnaissance, les autres presque d’un mot seulement. Le comte de ToulouseLes avis pris presque aussitôt que demandés, le Régent prit de nouveau la parole pour proposer un acte de grâce en faveur du comte de Toulouse, dont la vertu, le mérite, l’application, la probité, le désintéressement étaient connus de tout le monde : « Je n’ai pu éviter de le comprendre dans la déclaration. La justice ne fournit point d'exception en sa faveur, et il fallait assurer le droit des pairs. Maintenant qu’il ne peut plus souffrir d’atteinte, j’ai cru pouvoir rendre par grâce au mérite ce que j’ôte par équité à la naissance, et faire une exception personnelle de M. le comte de Toulouse, qui, en confirmant la règle, le laissera lui seul dans tous les honneurs dont il jouit, à l’exclusion de tous autres, et sans que cela puisse passer à ses enfants s’il se marie et qu’il en ait, ni être tiré à conséquence pour personne sans exception. J’ai le plaisir que les princes du sang y consentent, et que ceux des pairs à qui j’ai pu m’en ouvrir sont entrés dans mes sentiments et ont bien voulu même m’en prier. » La surprise était telle que la plupart paraissaient ne pas comprendre, mais toutes les voix approuvèrent. Les opinions données, M. le Duc prit la parole que lui passait le Régent : « Monsieur, lui dit-il, puisque vous faites justice à MM. îles Ducs, je crois être en droit de vous la demander pour moi-même : le feu Roi a donné l'éducation de Sa Majesté à M. le duc du Maine. J’étais mineur, et, dans l’idée du feu Roi, M. du Maine était prince du sang et habile à succéder à la couronne. Présentement je suis majeur, et non seulement M. du Maine n’est plus prince du sang, mais il est réduit à son rang de pairie. M. le maréchal de Villeroy est aujourd’hui son ancien et le précède partout : il ne peut donc plus demeurer gouverneur du Roi sous la surintendance de M. du Maine. Je vous demande cette place que je ne crois pas qui puisse être refusée à mon âge, à ma qualité, ni à mon attachement pour la personne du Roi et pour l’État. J’espère, ajouta-t-il en se tournant vers sa gauche, que je profiterais des leçons de M. le maréchal de Villeroy pour m’en bien acquitter et mériter son amitié. » A ce discours, le maréchal de Villeroy fit presque le plongeon, dès qu’il entendit prononcer le mot de surintendance de l’éducation ; il s’appuya le front sur son bâton, et demeura plusieurs moment en cette posture. Il paraît même qu’il n’entendit rien du reste du discours. Villars, Bezons, Effiat ployèrent les épaules comme gens qui ont reçu les derniers coups ; le duc de Guiche approuva à travers son étonnement prodigieux. Estrées revint à soi le premier, se secoua, s’ébroua, regarda la compagnie comme un homme qui revient de l’autre monde. Dès que M. le Duc eut fini, le duc d’Orléans passa des yeux toute la compagnie en revue, puis dit que la demande de M. le Duc était juste, qu’il ne croyait pas qu’elle put être refusée ; qu’on ne pouvait faire le tort à M. le maréchal de Villeroy de le laisser sous M. du Maine, puisqu’il le précédait à cette heure ; que la surintendance de l’éducation du Roi ne pouvait être plus dignement remplie que de la personne de M. le Duc, et qu’il était persuadé que cela irait tout d’une voix. Ce fut un acquiescement à peu près muet, après lequel M. le Duc donna lecture de ce qu’il avait dessein de dire au lit de justice. Puis il y eut un silence assez prolongé que rompit Villeroy. — « Je ne dirai que ces deux mots-là ; voilà toutes les dispositions du Roi renversées, je ne le puis voir sans douleur. M. du Maine est bien malheureux. » — « Monsieur, répondit le Régent d'un ton vif et haut, M. du Maine est mon beau-frère, mais j’aime mieux un ennemi découvert que caché. » La marche du ParlementA ce mot chacun sentit que le fourreau était jeté et se demanda où l’on s’arrêterait. Le garde des sceaux, pour faire quelque diversion, lut un de ses discours préparés. On l’appela à ce moment et il rentra peu d’instants après, tira le Régent dans une fenêtre. Celui-ci ayant repris sa place dit « qu’il recevait avis que toutes les chambres assemblées, le Premier Président avait proposé de n’aller point aux Tuileries et demandé ce qu’ils iraient faire en ce lieu où ils n’auraient point de liberté ; qu’il fallait mander au Roi que son Parlement entendrait sa volonté dans son lieu de séance ordinaire, quand il lui plairait lui faire cet honneur que d’y venir ou de la lui envoyer dire ». Le Conseil fut étourdi de cette nouvelle, mais le Régent dit, d’un air très libre, qu’il doutait d’un refus et ordonna au garde des sceaux de proposer les mesures à prendre en pareil cas. Pendant qu’on envisageait les mesures à prendre en cas de désobéissance le Parlement résolut de protester contre tout ce qui serait fait au Louvre, comme non libre et forcé et il arrêta que personne n’opinerait, qu’en un mot on demeurerait comme des statues sans rien dire et sans même faire un seul geste de tête. Ensuite, messieurs envoyèrent au plus vite quérir leurs robes rouges chacun chez soi, et quoique la lettre de cachet portât ordre de venir on carrosse, il fut résolu de venir tous à pied deux par deux et de prendre leur route par le quai des Orfèvres et le Pont-Neuf, c’est-à-dire par le chemin le plus long, afin d’être vu du peuple plus longtemps. C’est alors que des Granges vint dire au duc d’Orléans que le Parlement était en marche, à pied et commençait à sortir du Palais ; cette nouvelle « rafraîchit fort le sang » de tous les membi.es du Conseil, plus encore au Régent qu’à tout autre. Là-dessus, il dit aux présidents des consuls de rapporter leurs affaires, mais aucun n’était prêt que Villars, et le conseil finit de la sorte faute de matière. Il était un peu plus de dix heures. On resta ainsi une bonne demi-heure en place, avec assez de silence. Puis l’inquiétude commença à prendre quelques-uns qui se levèrent pour aller vers les fenêtres. Le duc d’Orléans les contint tant qu’il pût, des Granges étant venu dire que le Premier Président était déjà arrivé en carrosse et que le Parlement suivait assez près, il n’y eut plus moyen de retenir le Conseil, le duc d’Orléans lui-même se leva et tout ce qu’il put fut de défendre tout haut que qui que ce soit sortît sous quelque prétexte que ce pût être, qu’il répéta deux ou trois fois ensuite en divers temps. Cependant, on s’ennuyait fort de la lenteur du Parlement et on envoyait souvent aux nouvelles. Plusieurs tentés de sortir, peut-être de jaser, se proposèrent ; mais le Régent ne voulut laisser sortir que La Vrillière, et voyant que le désir de sortir croissait il se mit lui-même à la porte. Il parlait aux uns et aux autres d’un air libre, comme dans une journée ordinaire, et il faut dire qu’il fut le seul de tous qui conserva cette sérénité sans l’affecter. Les membres du Conseil pris du besoin d’urinerEnfin le Parlement arriva, et, comme des enfants voilà le Régent, les ducs, les maréchaux aux fenêtres. Il venait en robes rouges, deux à deux, par la grande porte de la cour qu’il croisa pour aller gagner la salle des Ambassadeurs, où le Premier Président, « qui ne saurait aller à pied » venu en carrosse avec le président d’Aligre, les attendait. Le défilé était fort lent puisqu’il comptait environ cent soixante membres[15], et les membres du Conseil, entassés aux deux fenêtres de leur salle, entendaient des Granges entrer à diverses fois, dire où les choses en étaient, pendant que Saint-Simon gardait la porte prêt à bondir sur l’imprudent qui eut fait mine de sortir. Sait besoin, soit désir du défendu, quelques-uns demandèrent l’un après l’autre à sortir pour des nécessités. Le Régent le permit à condition du silence et du retour sur le champ. Il proposa même à La Vrillière de s’aller précautionner en même temps que le maréchal d’Huxelles et quelques autres suspects, pour ne les perdre pas de vue, ce dont il s’acquitta très bien. Saint-Simon en usa de même avec les maréchaux de Villars et de Tallard, tint en respect Effiat pendant que Villeroy se glissait par la petite porte du Roi où il avait ses habitudes et y guetta son retour, après quoi il ferma cette porte. Mise en marche du cortègePendant cette scène comique, le Parlement achevait de prendre ses places, les pairs arrivés, et les présidents revêtus de leurs fourrures, des Granges vint avertir que tout était prêt. Le Régent lui dit d’avertir le Parlement pour la députation à faire au Roi et dit au Conseil qu'il fallait l’aller chercher. Il entra chez le Roi par le petite porte. L’enfant était sans manteau ni rabat, vêtu à son ordinaire ; après quelques mots chuchotés à voix basse on fit faire place et le cortège s’ébranla. Villars, le duc de la Force et Saint-Simon ouvraient la marche, suivis du prince de Conti, de M. le Duc et du duc d’Orléans. Derrière lui les huissiers de la chambre du Roi avec leurs masses, puis le Roi environné des quatre capitaines des gardes du corps, du duc d’Albret grand chambellan et du maréchal de Villeroy, son gouverneur. Derrière, venait le garde des sceaux parce qu’il n’était pas enregistré au Parlement, puis les maréchaux d’Estrées, Huxelles, Tallard et Bezons, qui ne pouvaient entrer, en séance qu’à la suite, et non devant Sa Majesté. Ils étaient suivis de ceux des chevaliers de l’Ordre et des gouverneurs et lieutenants généraux des provinces qu’on avait avertis pour le cortège du Roi, qui devaient seoir en bas, découverts et sans voix, sur le banc des baillis. On prit en cet ordre le chemin de la terrasse jusqu’à la salle des Suisses, au bas de laquelle se trouva la députation du Parlement, composée de quatre présidents à mortier et quatre conseillers. A ce moment Saint-Simon, La Force et Villars se détachèrent du cortège pour gagner leurs places. « Assis dans un lieu élevé, personne devant moi aux hauts sièges, j’eus moyen, dit Saint-Simon de bien considérer tous les assistants. Je le fis de toute l’étendue et de tout le perçant de mes yeux. Une seule chose me contraignit, ce fut de n’oser me fixer à mon gré sur certains objets particuliers, je craignais le feu et le brillant significatif de mes regards... J’assénai néanmoins une prunelle étincelante sur le Premier Président et le grand banc, à l’égard duquel j’étais placé à souhait. Je la promenai sur tout le Parlement ; j’y vis un étonnement, un silence, une consternation auxquels je ne me serais pas attendu, qui me fut de bon augure. Le Premier Président insolemment abattu, les présidents déconcertés, attentifs à tout considérer, me fournissaient le spectacle le plus agréable. Les simples curieux, parmi lesquels je range tout ce qui n’opine point, ne paraissaient pas moins surpris, mais sans l’égarement des autres, et d’une surprise calme ; en un mot, tout sentait une grande attente et cherchait à l’avancer en devinant ceux qui sortaient du Conseil. Entrée dans salle« Incontinent le Roi arriva. Le brouhaha de cette entrée dans la séance, qui dura jusqu’à ce que Sa Majesté, et tout ce qui l’accompagnait, fût en place, devint une autre espèce de singularité. Chacun cherchait à pénétrer le Régent, le garde des sceaux et les principaux personnages. La sortie des bâtards du cabinet du Conseil avait redoublé l’attention mais tous ne la savaient pas, et tous alors s’aperçurent de leur absence. La consternation des maréchaux, de leur doyen surtout dans sa place de gouverneur du Roi, fut évidente. Elle augmenta l’abattement-du Premier Président, qui, ne voyant point là son maître, le duc du Maine, jeta un regard affreux, sur M. de Sully et sur moi, qui occupions les places des deux frères précisément. En un instant tous les yeux de l’assemblée se posèrent tout à la fois sur nous, et je remarquai que le concentrement et l’air d’attente de quelque chose de grand redoubla sur tous les visages. Celui du Régent avait un air de majesté douce, mais résolue, qui lui fut tout nouveau, des yeux attentifs, un maintien grave mais aisé ; M. le Duc sage, mesuré, mais environné de je ne sais quel brillant qui ornait toute sa personne et qu’on sentait retenu. M. le prince de Conti triste, pensif, voyageant peut-être en des espaces éloignés. Le Roi sérieux, majestueux, et en même temps le plus joli qu’il fût possible, grave avec grâce dans tout son maintien, l’air, attentif et point du tout ennuyé, représentant très bien et sans aucun embarras[16]. » Voici quel fut l’aspect et la disposition de la salle : Seconde antichambre du Roi
où était le dais vide entre le grand cabinet du Conseil et la grande
antichambre où fut tenu le lit de justice figuré ici.
Salle des Gardes du Corps – Les
ducs de Noailles et Charost et plusieurs autres entrèrent avec le Roi et
vinrent se mettre en place parmi ceux qui sont marqués ici et qui y étaient
avant l'arrivée du Roi
Premier acteQuand, tout fut posé et rassis, le garde des sceaux demeura quelques minutes dans sa chaise, immobile, regardant en dessous, et ce feu d’esprit qui lui sortait des yeux semblait percer toutes les poitrines. Après qu’il se fut, à la manière des prédicateurs, accoutumé à cet auguste auditoire, il se découvrit, se leva, monta au Roi, se mit à genoux sur les marches du trône, prit l’ordre du Roi, descendit, se mit dans sa chaire et se couvrit. Remis en place après quelques moments de silence, il ouvrit la scène par ce discours : « Messieurs, le Roi a jugé à propos de créer l’état et office de garde des sceaux et a bien voulu m’en pourvoir. C’est pourquoi Sa Majesté ordonne que par le greffier de son Parlement lecture de l’édit portant création et provision de cet office soit faite, les portes ouvertes. » Le greffier civil de la cour traversa le parquet et reçu du garde des sceaux, qui les tira de sa poche, les susdites lettres en forme d’édit, en donna lecture et regagna sa place. Après quoi le garde des sceaux ayant invité les gens du Roi à parler en disant : « Les gens du Roi peuvent parler », ceux-ci se mirent à genoux, il les fit relever au nom du Roi et l’avocat général Blancmesnil dit ces mots : « Sire. Les clauses des lettres dont nous venons d’entendre la lecture méritent beaucoup d’attention ; nous n’avons pu rechercher les exemples de pareilles lettres et de pareilles clauses ; mais puisque V. M. nous ordonne de prendre des conclusions, le devoir de nos charges nous oblige de requérir que sur le repli des lettres il soit mis qu’elles ont été lues, publiées, V. M. séant en son lit de justice et enregistrées pour être exécutées selon leur forme et teneur. » Alors le Régent s’approcha de l'oreille du Roi et lui parla, ou fit semblant, puis Son Altesse Royale prit la parole et dit que le Roi voulait être obéi et sur-le-champ ; d’Argenson alla aux opinions et revint à sa place prononcer l’enregistrement de ses propres lettres. Second acteCe premier acte fini, le second fut annoncé par la même cérémonie du garde des sceaux montant prendre l’ordre du Roi de qui s’approchait le Régent pour entendre et suggérer la réponse. Redescendu, assis et couvert, d’Argenson dit : « Le Roi tient aujourd’hui son lit de justice pour l’affaire laplus importante qui puisse intéresser sa gloire et le repos de ses peuples, puisqu’il s’agit d’assurer son autorité. Le Roi n’a pu voir sans quelque peine que son Parlement ait paru vouloir se faire des titres contre l’autorité royale* des grâces qu’il en a reçues, et que cette Compagnie non contente de faire à son souverain des remontrances avant d’enregistrer ses ordonnances et ses édits, se soit arrogé le droit de disposer et d’ordonner contre la disposition précise et littérale de ses volontés. Il semble même qu’elle a porté ses entreprises jusqu’à prétendre que le Roi ne peut rien sans l’aveu de son Parlement et que son Parlement n’a pas besoin de l’ordre ni du consentement de S. M. pour ordonner ce qu’il lui plaît. C’est sur de tels principes que la compagnie a rendu depuis quelque temps divers arrêts et nommément ceux du 20 juin et du 12 de ce mois et qu’elle a ordonné le même jour que ce dernier arrêt serait lu publié et envoyé aux baillis et sénéchaux, tandis que plusieurs ordonnances de S. M. rendues depuis plus d’un an sont demeurées sans enregistrement et par conséquent sans exécution. Ainsi le Parlement pouvant tout sans le Roi, et le Roi ne pouvant rien sans son Parlement, celui-ci deviendrait bientôt le législateur nécessaire du royaume et ce ne serait plus que sous son bon plaisir que S. M. pourrait faire savoir à ses sujets quelles sont ses intentions. « Le Roi peut-il dispenser de reprendre et de conserver des droits aussi sacrés que ceux-là ? « Sa Majesté aurait bien voulu cependant ne pas confondre dans la même loi des magistrats judicieux qui ont résisté avec une fermeté sage et constante à l’esprit de critique, d’entêtement et de présomption qui a fait agir les autres, mais la loi devant être générale, il n’a pas été possible d’y distinguer ceux de son Parlement dont la prudence et la fidélité méritent des éloges d’avec ceux dont les discours et les procédés sont également répréhensibles. Telles sont des considérations qui ont déterminé l’arrêt du conseil et les lettres patentes que le Roi a jugées nécessaires dont S. M. ordonne qu’il soit fait lecture en sa présence par le greffier de son Parlement. » Une consternation générale s’était, pendant ce discours, répandue sur les visages des magistrats. Presque aucun d’entre eux n’osa rien dire à ses voisins. Bien que le garde des sceaux ménageât le ton de sa voix, pour ne la rendre qu’intelligible, il le fit pourtant en telle sorte qu’on ne perdit pas une seule de ses paroles. Ce fut* bien avec les lettres patentes qu’il remit au greffier qui en donna lecture. Chaque période semblait ajouter à l’affliction et à l’accablement. Quant la parole fut donnée aux gens du Roi, l’avocat-général Blancmesnil dit avec une parfaite mesure : « Sire. Nous sommes également surpris et affligés du courroux que V. M. témoigne à son Parlement, qui ne se départira jamais du respect et de la soumission qui est due à l’autorité royale et qui ne cessera jamais d’administrer la justice à vos sujets comme il l’a fait par le passé. Les lettres patentes dont V. M. vient d’ordonner qu’il soit fait lecture contiennent des matières si importantes qu’elles mériteraient les observations les plus profondes et les plus étendues. Nous osons même réclamer cette bonté et cet amour pour ses peuples si naturel à V. M. et nous ne pouvons trop la supplier de faire encore toutes les réflexions que sa sagesse et sa prudence peuvent lui inspirer dans cette rencontre. Que si néanmoins Elle persiste, comme nous ne pouvons en douter par l’éclat et l’appareil avec lequel Elle déploie son autorité, nous suivrons en cette occasion les exemples de nos prédécesseurs ; la présence de V. M., son très exprès commandement et le devoir de nos charges nous obligent de requérir que sur le repli des lettres, il soit mis qu’elles ont été lues, publiées, V. M. séant en son lit de justice, et enregistrées pour être exécutées selon leur forme et teneur. » Le grand banc — ainsi nommait-on celui des présidents à mortier — s’était ému. « C’était, écrit Saint-Simon dans une page inoubliable, le Premier Président qui voulait parler et faire la remontrance qui a paru pleine de la malice la plus raffinée, d’impudence à l’égard du Régent et d’insolence pour le Roi. Le scélérat tremblait toutefois en la prononçant. Sa voix entrecoupée, la contrainte de ses yeux, le saisissement et le trouble visible de toute sa personne, démentaient ce reste de venin dont il ne put refuser la libation à lui-même et à sa Compagnie. Ce fut là que je savourai avec toutes les délices qu’on ne peut exprimer, le spectacle de ces fiers légistes prosternés à genoux, et rendre à nos pieds un hommage au trône, tandis qu’assis et couverts, sur les hauts sièges aux côtés du même trône,... mes yeux fichés, collés sur ces bourgeois superbes, parcouraient tout ce grand banc à genoux ou debout, et les amples replis de ces fourrures ondoyantes à chaque génuflexion longue et redoublée, qui ne finissait que par le commandement du Roi par la bouche du garde des sceaux. » Le Premier Président, debout, s’exprima en ces termes : « Sire. Aussitôt que le maître des cérémonies a remis à votre Parlement la lettre de cachet par laquelle V. M. lui mandait de se rendre en ce lieu en robes rouges et en corps de cour ayant l’intention d’y. tenir ce matin son lit de justice, le premier mouvement de la Compagnie à été de répondre qu’elle obéirait aux ordres de V. M. et que les chambres seraient assemblées aussitôt que les officiers qui les composent seraient arrivés ; et peu de temps après la Compagnie ayant été assemblée et ayant prévu dans l’ignorance où elle était de ce dont il s’agissait, qu’il pourrait se présenter quelque occasion de délibérer, elle m’a chargé de représenter en ce cas-là à V. M. avec vie profond respect que nous lui devons que si Elle voulait bien avoir la bonté d’ordonner que l’on nous communiquât les matières sur lesquelles Elle nous ordonnerait d’opiner, nous serions alors en état de lui dire les sentiments de son Parlement. « Il serait bien difficile, Sire, que votre Parlement pût opiner sur l’arrêt du conseil et les lettres, patentes, dont lecture vient d’être faite, par l’importance, l’étendue et le nombre des différentes matières qui y sont traitées, de sorte que nous osons supplier V. M. en toute humilité et avec le plus profond respect de vouloir bien nous faire remettre l’arrêt du conseil et les lettres patentes dont il est question. » Troisième acteLa remontrance finie, le garde des sceaux monta au Roi, puis revint à sa place et dit : « Le Roi veut être obéi et obéi sur-le-champ. » « Ce grand mot fut un coup de foudre qui atterra présidents et conseillers. Tous baissèrent la tête, et la plupart furent longtemps sans la relever. Le reste des spectateurs, excepté les maréchaux de France, parurent peu sensibles à cette désolation. » On passa au troisième acte. Le garde des sceaux ouvrit la bouche et annonça la nouvelle disgrâce qui frappait les légitimés : « Le Roi ayant jugé à propos de rendre aux ducs et pairs le rang et les prérogatives dont ils avaient cessé de jouir, a cru devoir conserver à M. le comte de Toulouse tous les honneurs dont il est en possession, honneurs si justement mérités et dont la durée devrait être indéfinie si le courage, les services rendus à l’État, les vertus du cœur et les talents de l’esprit étaient des titres suffisants pour en perpétuer la jouissance. » « L’effet de cette période sur les visages fut inexprimable. L’étonnement prévalut aux autres passions. Beaucoup parurent aises, soit équité, soit haine pour le duc du Maine, soit affection pour le comte de Toulouse, plusieurs consternés. Le Premier Président perdit toute contenance ; son visage, si suffisant et si audacieux, fut saisi d’un mouvement convulsif ; l’excès seul de sa rage le préserva de l’évanouissement. Ce fut bien pis à la lecture de la déclaration. Chaque mot était législatif et portait une chute nouvelle. L’attention était générale, tenait chacun immobile pour n’en pas perdre un mot, et les yeux sur le greffier qui lisait. Vers le tiers de cette lecture, le premier président, grinçant le peu de dents qui lui restaient, se laissa tomber le front sur son bâton, qu’il tenait à deux mains, et, en cette singulière posture et si marquée, acheva d’entendre cette lecture. « Moi cependant je me mourais de joie. J’en étais à craindre la défaillance ; mon cœur dilaté à l’excès, ne trouvait plus d’espace à s’étendre. La violence que je me faisais pour ne rien laisser échapper était infinie, et néanmoins ce tourment était délicieux. Je comparais les années et les temps de servitude, les jours funestes où, traîné au Parlement en victime, j’y avais servi de triomphe aux bâtards à plusieurs fois, les degrés divers par lesquels ils étaient montés à ce comble sur nos tètes ; je les comparais, dis-je, à ce jour de justice et de règle, à cette chute épouvantable, qui du même coup nous relevait par la force du ressort. Je repassais avec le plus puissant charme, ce que j’avais osé annoncer au duc du Maine le jour du scandale du bonnet, sous le despotisme de son père. Mes yeux voyaient enfin l’effet de» l’accomplissement de cette menace. Je me devais, je me remerciais de ce que c’était par moi quelle s’effectuait. J’en considérais la rayonnante splendeur en présence du Roi et d’une assemblée si auguste. Je triomphais, je me vengeais, je nageais dans ma vengeance ; je jouissais du plein accomplissement des désirs les plus véhéments et les plus continus de toute ma vie. J’étais tenté de ne me plus soucier de rien. Toutefois je ne laissais pas d’entendre cette vivifiante lecture dont tous les mots résonnaient sur mon cœur comme l’archet sur un instrument, et d’examiner en même temps les impressions différentes qu’elle faisait sur chacun. « Au premier mot que le garde des sceaux dit de cette affaire, les yeux des deux évêques pairs rencontrèrent les miens. Jamais je n’ai vu surprise pareille à la leur, ni un transport de joie si marqué. J’avalai par les yeux un délicieux trait de leur joie, et je détournai les miens des leurs, de peur de succomber à ce surcroît, et je n’osai plus les regarder. « Cette lecture achevée, l’autre déclaration en faveur du comte de Toulouse fut commencée tout de suite parle greffier, elle sembla achever de confondre le premier président et les amis du duc du Maine, par le contraste des deux frères... Les importantes choses du consentement des princes du sang et de la réquisition des pairs de France réveillèrent l’application générale et firent lever le nez au Premier Président de dessus son bâton. » Quelques pairs grommelèrent entre leurs dents, mécontents de n’avoir pas été consultés, disant que leurs collègues du conseil de Régence avaient opiné sans mission. Cet accès d’humeur dura peu de temps ; déjà le garde des sceaux ayant pris l’avis du Roi et des princes du sang se dirigeait vers les pairs. Le duc de Sully était en tête, mais Saint-Simon le prévint, avança son chapeau à plumet vers d’Argenson qu’il interpella assez haut : « Non, monsieur, nous ne pouvons être juges, nous sommes parties, et nous n’avons qu’à rendre grâces au Roi de la justice qu’il veut bien nous faire. » Et il le repoussa avant que le duc de Sully eût eu le loisir d’ouvrir la bouche. Le garde des sceaux tourna court, négligea tous les pairs, fut aux maréchaux de France, de là.au grand banc, puis aux bas sièges, remonta au Roi, revint en place et prononça l’arrêt d’enregistrement. Quatrième acteM. le Duc prit la parole et réclama l’éducation du Roi, ce que le Régent approuva aussitôt. Cette nouvelle demande ajouta encore, si c’était possible, à l’étonnement de l’assemblée et la consternation des amis de M. du Maine. Quand le garde des sceaux donna «la parole aux gens du Roi, ceux-ci répondirent qu’ils n’avaient rien entendu du discours de M. le Duc, sur quoi, de main en main, on leur envoya son papier. Blancmesnil ne fit qu’y jeter les yeux et parla. On opina ensuite. EnregistrementAprès cela le garde des sceaux appela le greffier en chef, lui ordonna d’apporter ses papiers et son petit bureau près du sien pour faire de suite, en présence du Roi, tous les enregistrements de ce qui venait d’être lu et ordonné. Ce qui fut long à faire parce qu’il y avait cinq ou six pièces à enregistrer. Le coup d’État était accompli, aucune opposition ne s’était fait entendre et les Parisiens ébahis se demandaient quel événement pouvait bien provoquer le déploiement de force armée qu’on le*ir offrait en spectacle. Dès l’aurore, le régiment des gardes était sous les armes, occupant trois points de la capitale : dix compagnies aux Tuileries, dix autres à l’extrémité de la rue de Richelieu, près de la rue Grange-Batelière, douze autres dans le préau de la foire Saint-Germain[17]. Les gendarmes étaient prêts à marcher, leurs chevaux sellés et bridés dans l’hôtel de M. le prince de Soubise[18] ; les chevau-légers de même ; les mousquetaires gris étaient à cheval dans l’hôtel[19], et les mousquetaires noirs, dont l’hôtel est trop éloigné[20] étaient dans la cour de la foire Saint-Germain. Il y avait un mousquetaire à cheval à la porte des Tuileries, du côté du Pont-Royal, et un au Carrousel pour recevoir des ordres en cas de besoin. Paris ressemblait à une ville conquise et le Régent s’informait avec soin pendant la marche du Parlement s’il y avait beaucoup de peuple à la suite, mais personne ne marqua autre chose que de la curiosité. ImpressionsLe jeune Roi, fatigué de cette longue contrainte, ne songeait qu’à se dégourdir. Pendant que le garde des sceaux et le greffier enregistraient, il se mit à rire avec ceux qui se trouvèrent à portée de lui, à s’amuser de tout, à faire observer que, par cette chaleur, le duc de Louvigny portait un habit de velours qui l’accablait. L’enfant n’avait peut-être rien compris à tout ce qui s’était passé sous ses yeux ; tous attendaient la libération, sauf Saint-Simon à qui les heures ne comptaient plus que pour des minutes. « Pendant l’enregistrement, raconte-t-il, je promenais mes yeux doucement de toutes parts, et, si je les contraignis avec constance, je ne pus résister à la tentation de m’en dédommager sur le Premier Président, je l’accablais donc à cent reprises dans la séance, de mes regards assénés et forlongés avec persévérance. L’insulte, le mépris, le dédain, le triomphe lui furent lancés de mes yeux jusqu’en ses moelles ; souvent il baissait la vue quand il attrapait mes regards ; une fois ou deux il fixa le sien sur moi, et je me plus à l’outrager par des sourires dérobés, mais noirs, qui achevèrent de le confondre. Je me baignais dans sa rage, et je me délectais à la lui faire sentir. Je me jouais de lui quelquefois avec mes deux voisins, en leur montrant d’un coup d’œil, quand il pouvait s’en apercevoir[21]. » Entre une heure et deux heures la cérémonie prit fin et le Parlement s’en alla au milieu d’une foule curieuse. On blâmait généralement la mesure prise contre le duc du Maine, prince sage et estimé du public. Celui-ci donna ordre de démeubler son appartement aux Tuileries dès l’après-midi même. Son frère alla remercier le Régent et lui témoigna que n’étant pas de meilleure maison que son frère et son frère n’étant pas plus criminel que lui, il n’était pas juste qu’il fût au-dessus de lui. Enfin, une rumeur consternait le public : on disait que le maréchal de Villeroy serait remplacé par une créature du Régent et on prêtait au vieux maréchal l’intention de se faire tuer plutôt que d’abandonner le poste que Louis XIV lui avait confié. Quant à la duchesse du Maine on la savait hors d’elle, elle criait sa fureur et ses projets de vengeance. « Mais, ajoutait-on, autant en emporte le vent. C’est une femme qui parle et qui aboie à la lune[22]. » A Saint-Cloud, Madame percevait l’écho de ces colères, car la colère, la rancune, la vengeance d’un Saint-Simon avait rempli la moitié du lit de justice, dont la brutale et aveugle haine de M. le Duc pour sa tante la duchesse du Maine avait rempli l’autre moitié. Cette lilliputienne princesse « s’emportait en menaces horribles et disait publiquement qu’on trouverait bientôt moyen de donner au Régent une croquignolle telle qu’il mordrait la poussière[23]. » On l’avait entendu dire à table : « On dit que je pousse le Parlement à la révolte contre le duc d’Orléans, mais je le méprise trop pour prendre une si noble vengeance de lui ; je saurai bien me venger autrement[24]. » |