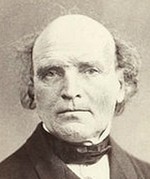LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
ET LE MINISTÈRE ODILON BARROT
VII. — LA LETTRE À EDGAR NEY. - LE MOTU PROPRIO ET LA DÉMISSION DE FALLOUX.
Surprise de certains en face de la mauvaise volonté pontificale. — Inutilité des efforts français. — La lettre de Pie IX à Oudinot. — Remerciements de Pie IX adressés à l'Europe et non pas à la France. — Le gouvernement forcé de se rendre à l'évidence et de constater que les renseignements de la Montagne étaient exacts. — Embarras de la France. — Louis-Napoléon mesure déjà la faute accomplie. — Falloux et le nonce. — Reproches de l'Europe. — Révocation d'Oudinot, promu citoyen romain et inscrit au Capitole. — Le conseil des ministres à l'Elysée. — Ney et Rostolan. — La lettre à Edgar Ney. — Toujours de l'équivoque ; Louis Bonaparte lié. — Louis Bonaparte et Falloux dans les jardins de l'Elysée. — Démission de Falloux. — Conseil des cardinaux à Portici. — Le Motu Proprio. — La France se soumet une seconde fois aux volontés du Saint-Siège. — Le concile de Paris ; envahissement progressif du clergé. — Exaspération du prince-président. — La lettre à Odilon Barrot. — La majorité parlementaire et le président de la République. — Optimisme officiel du ministre des Affaires étrangères au Palais-Bourbon. — But avoué de l'expédition, la Montagne n'étant plus là. — Mathieu de la Drôme rend justice à Ledru-Rollin. — La thèse conservatrice contre le socialisme. — Cavaignac récusé maintenant par la majorité, parce qu'il semble prêt à faire apparaître la faute initiale de la Constituante. — La question de la révision de la constitution se trouve posée. — Victor Hugo rompt avec le parti catholique. — La suprématie de l'Église proclamée à la tribune par Montalembert. — Odilon Barrot. — Défaite de l'opposition. — Le triomphe pontifical ratifié par la Chambre française. — La commission de l'enseignement. — Démission de M. de Falloux. — Falloux à l'Elysée.L'affaire romaine n'avait paru terminée qu'à la masse du public et à certains, mal renseignés. La France avait, en réalité, supprimé une de ses défenses, sinon un appui possible pour l'avenir ; elle se trouvait désormais face à face avec un dangereux ennemi. Se contentant de dire que nous avions échangé un adversaire contre un autre, le président du conseil avait été forcé de reconnaître la contradiction douloureusement inextricable — quoique différente — dans laquelle, la France, après avoir été engagée sans raison, continuait de se débattre. Nous n'avions plus affaire à une démagogie insolente et exaltée dont nous avions pu triompher par la force ; nous nous trouvions en face des résistances passives du Saint-Siège contre lesquelles la force est toujours impuissante[1]. Il s'étonnait naïvement que nos représentants, en entrant à Rome, n'y aient pas rencontré la collaboration satisfaite du parti libéral : ce parti pouvait cependant difficilement oublier le siège, l'esprit de duplicité incertaine d'Oudinot qui rejaillissait sur tous nos actes, le jeu tortueux de nos agents, et il s'abstint sans doute plus pour ces raisons que par manque de courage ou pour de méprisables considérations de sureté personnelle[2]. Il craignait davantage de perdre son avenir à jamais par une collaboration facilement critiquable avec des étrangers qui avaient bombardé la patrie ; il savait, au surplus, de quel ordre serait cette collaboration inégale, dans quel sens il lui faudrait consentir les plus intimes sacrifices, au point de se perdre. Mais attaquer le parti libéral romain et le rendre responsable du malheur de Rome, c'était libérer le ministère de l'accusation qui pesait sur lui et ne pouvait plus à ce moment être discutée, même par son grand maître. Aussi écrivit-il à ce sujet plus tard : Les libéraux avaient été sans force contre l'anarchie et même contre l'assassinat ; ils se montrèrent sans résolution et sans courage pour nous aider à faire sortir de notre victoire quelque liberté pour leur patrie. Il faut bien le dire, c'est là qu'il faut surtout chercher l'explication et l'excuse de l'inutilité de nos efforts. Je me rappelle très bien l'étonnement et le découragement qui me saisirent à la lecture de ces dépêches dans lesquelles nos agents, à cette question : Y a-t-il à Rome, un parti libéral modéré, assez consistant pour qu'on puisse appuyer sur lui des institutions sérieuses et libres ? nous faisaient tous cette réponse uniforme et désespérante : Non, ce parti n'existe pas[3]. N'était-il pas un peu tard pour se renseigner ? L'affaire romaine s'affirmait avec suite celle des déconvenues progressives. Ce parti libéral modéré avait existé principalement, — surtout de la manière fort peu nationale et toute particulière dont on l'entendait à Paris, — dans les calculs ministériels, et il serait intéressant de savoir si les dépêches parlaient de sa retraite, de son refus ou de son absence. Le parti libéral véritable avait soutenu Mazzini, dans les personnes d'Armellini, notamment, et de Saffi, ou encore, du syndic de Civita Vecchia sur lequel Oudinot avait scellé ses nombreuses promesses d'alliance par une lourde porte de prison. Les deux partis extrêmes se trouvaient donc seuls en présence : celui de la gauche, décimé, exilé, sans représentants notoires ou agissants ; celui du pape, ne comprenant que des partisans de l'ancien régime avec tous ses abus, et c'était le seul avec lequel la France allait avoir à traiter. Il suffit de l'avoir déjà connu pour saisir combien l'adversaire nouveau serait plus redoutable que son prédécesseur. Le président du conseil, toujours optimiste en face d'une situation que l'incompréhension ministérielle avait créée, persistant à croire à notre tâche conciliatrice, — si sincèrement manquée, — à condition que, sans nous presser de voir rentrer le pape, afin de nous décharger sur lui des difficultés, forts du droit que nous conférait notre occupation, nous utilisions les éléments actuels afin d'organiser provisoirement l'administration municipale, provinciale et centrale des provinces occupées par notre armée sur le principe de la sécularisation, laissait à la papauté sa part légitime de pouvoir et nous fiant à la puissance du fait accompli comme à l'influence des habitudes prises du soin de transformer ce provisoire en définitif[4]. — Était-ce possible ? En attendant même que l'Autriche parut nous seconder dans cette entreprise, ce qui ne paraissait pas admissible, cette organisation simplement partielle, déjà, puisque nos troupes n'occupaient pas tout le territoire romain, aurait-elle eu de l'influence sur nos négociations avec Gaëte ? Après une campagne aussi habile que la leur, après un triomphe aussi éclatant, les maîtres de Pie IX, qui n'avaient rien cédé dans la défaite, céderaient encore moins dans la victoire, au moment d'en cueillir les fruits. J'aurais voulu, détaille Barrot, organiser un gouvernement provisoire, destiné à offrir le spécimen de celui qu'on pourrait désirer pour l'État romain. La base de ce gouvernement, dans nos idées, devait être une forte organisation municipale et provinciale complètement sécularisée et dans laquelle le principe électif aurait été introduit dans une sage mesure. Je n'allais pas jusque-là, malgré l'autorité bien imposante de M. Rossi qui avait cru à la possibilité de concilier le pouvoir temporel du pape avec la plénitude des institutions représentatives et du gouvernement parlementaire ; seulement je regardai comme indispensable de donner à une assemblée élue le droit de voter les recettes et les dépenses en dehors de la liste civile assurée, non au pape, mais à la papauté. La sécularisation de la justice et des ministres, sauf celui des Affaires étrangères, et l'adoption de toutes les dispositions de nos codes qui ne seraient pas incompatibles avec les lois de l'Église auraient complété cet ensemble de réformes qui, accompagné d'une déclaration européenne de la neutralité des États romains, me paraissait devoir assurer pour longtemps aux Romains les bienfaits d'un gouvernement sagement libéral et à la papauté un long avenir de sécurité, peut-être une plus grande force morale dans le monde catholique, et surtout en Italie, qu'elle n'en pourra jamais espérer dans la situation forcée et tendue où elle s'obstine[5]. Afin de faire accepter de la papauté des conditions de ce genre, encore qu'elles aient été, sans doute, de son intérêt, une lutte eût été nécessaire, et elle se fût trouvée de suite impossible ; l'Autriche, en outre, l'eût rendue dangereuse, petit à petit, la révolution achevant d'être vaincue, et par nos armes, dans la péninsule ; les avantages mêmes obtenus près des populations par notre protectorat militaire momentané ne pouvaient être un garant d'avenir ou, du moins, le demeurer, étant données les dispositions de la cour de Gaëte ; pour y parvenir, il eût été nécessaire de nous substituer au gouvernement papal, ce qui ne se discutait même pas, et si les populations romaines avaient, quant à elles, admis quelque temps que le pape demeurât sous notre protectorat agissant, ni le pape, ni l'Europe n'y auraient consenti. La bienveillance des populations à notre égard, assez surprenante après le siège, montrait l'espoir qu'elles plaçaient en nous, quand même, en face de la crainte que leur inspirait la papauté ; elles préféraient les soldats étrangers aux prêtres[6]. Les marques de sympathie étaient nombreuses et les affirmations d'Oudinot à ce sujet[7] ne sont pas sujettes à caution, car elles sont appuyées par des Italiens[8]. Nous avions essayé d'ailleurs, en vain, de nous rallier aussi les révolutionnaires ; Oudinot n'avait pu décider les commissaires des finances à demeurer en charge et les officiers chargés de vérifier leurs comptes avaient été presque surpris, non seulement de leur probité absolue, mais encore de leur habileté[9]. Une fois que le corps municipal eut démissionné également, Oudinot, de môme qu'il avait mis à la tête des finances un ancien comptable de la trésorerie pontificale, le remplaça par une congrégation provisoire, composée d'hommes presque tous dévoués à la fortune cléricale[10] ; à côté de la police créée par l'occupation, se réorganisait aussi l'ancienne police pontificale, odieuse et vexatoire[11]. Des journaux étaient suspendus ; toute publication devait en référer à la mesure préventive ; toute réunion de plus de cinq membres était interdite. Les gardes nationales furent désarmées. On expulsa tous les soldats qui avaient servi la République, tous les provinciaux, tous les Italiens, tous les étrangers qui pouvaient être suspectés d'affection à la république[12]... On préparait aussi le terrain aux cardinaux. Les bonnes volontés actuelles du gouvernement français étaient évidentes, car, chaque jour, il était à même de mieux pressentir ce qui se préparait à Gaëte contre lui, mais son impuissance résultait de la situation même, et ses premiers essais de libéralisme[13] n'auraient pu être maintenus sans amener un conflit avec le clergé[14]. Falloux a reconnu que Pie IX, de plus en plus partagé entre les influences favorables ou hostiles à la France, était plus enlacé qu'il ne l'imaginait lui-même dans la politique d'Antonelli[15]. Persuadé, sans qu'il soit nécessaire de l'y aider, d'autre part, que l'avenir de l'Église dépendait du pouvoir temporel et de sa souveraineté totale, Pie IX ne pouvait qu'effacer progressivement la vision plus juste qui avait été sienne au début de son pontificat. Si l'on récapitule, afin de saisir l'esprit de la situation, lés diverses négociations qui avaient enveloppé cette affaire romaine, avant même qu'elle ne soit mise en discussion, son issue fatale ne fait plus aucun doute, soit que la marche ascendante des événements, dans la Constituante, puis dans la Législative, soit évaluée, soit que les conférences de Gaëte prouvent cette réaction, qu'y affirmait déjà, le 30 mars, la simple présence d'Antonnelli que nous nous étions vantés et efforcés d'écarter ; à la seconde réunion, le cardinal, déchirant lui-même toute possibilité d'équivoque, se montrait hostile à nos idées les plus conciliantes. Le 27 avril, la conférence parlait de la République romaine comme si elle avait déjà cessé d'exister, et Pie IX, bien que seuls nous ayons agi réellement, déclarait lui-même que notre initiative ne pouvait pas empêcher les trois autres puissances catholiques de présenter leurs revendications particulières. Enfin, à peine notre intervention commencée, des reproches impératifs étaient adressés à la France afin qu'elle assurât le rétablissement du pouvoir temporel absolu et, afin sans doute de la mortifier, les mandataires de Pie IX lui opposaient, en parallèle, les paroles du représentant de l'Autriche devant Bologne : Je viens relever parmi vous, de concert avec le commissaire de Sa Sainteté, le gouvernement légitime du Saint-Père Pie IX, renversé par une fraction impie, et rétablir la sécurité publique et privée, si gravement compromise jusqu'à ce jour. Le ton de l'Univers aurait suffi à renseigner sur les exigences catholiques. Bien que le colonel Niel eût été envoyé, le 10 juillet, à Gaëte pour remettre au pape les clefs de la capitale, gage d'avenir et de soumission peut-être anticipé, le gouvernement était attaqué parce qu'il ne célébrait pas la restauration pontificale. Les rédacteurs s'indignaient que le président de la République, dans la lettre par laquelle il félicitait Oudinot d'avoir pris la Ville Eternelle, parlât seulement du drapeau tricolore, des soldats qui l'avaient servi, de la fin de l'expédition. Le clergé, de son côté, signalait encore avec une véhémence sournoise le général Vaillant à la vindicte des fidèles pour avoir dit que nous n'avions plus, désormais, qu'à nous retirer, afin de laisser les Romains libres de régler ainsi qu'ils l'entendraient leur situation intérieure[16]. Rien n'était moins justifié que ces craintes hypocrites : Corcelles, aidé de Rayneval, avait été chargé de la réorganisation administrative, et, plus fanatique pour l'ultramontanisme qu'il ne l'avait été au temps de sa jeunesse pour la charbonnerie française, encore qu'il s'en montrât l'adepte fervent, convaincu et mystique[17], il avait toute la confiance du clergé. Il aida et soutint l'empressement[18] d'Oudinot à remettre le gouvernement aux mains du clergé. Ce qui subsistait en lui de national et y revenait, par moments, avec une véritable violence, en face de revendications exagérées, auxquelles il se trouvait contraint, malgré lui, de faire face, était annihilé par sa foi comme par ses exagérations mêmes ; contenir, en effet, les exigences pontificales, intervenir d'une façon efficace dans la réorganisation administrative et concilier les partis opposés n'eût servi qu'à le faire remplacer ; l'Autriche aurait été mise en avant par Antonelli, et le gouvernement français eût craint de voir revenir à un adversaire le bénéfice qu'il s'imaginait devoir recueillir de ses dépenses et du sang versé. Corcelles a dévoilé toute sa pensée d'internationaliste spiritualiste, mal convaincu des qualités humaines et tout à coup revenu en arrière par manque de foi dans l'avenir comme par ignorance économique, au moment où se discuta la question du drapeau à faire flotter sur Rome ; en effet la victoire excluait le nôtre en l'y élevant, et Corcelles proposant de rétablir le pavillon pontifical au milieu de ceux de tous les peuples, ses vassaux, s'imaginait ainsi symboliser dans le triomphe de la France le triomphe du monde chrétien tout entier[19]. A peine si le drapeau italien, levé par Mazzini comme par Charles Albert, entra en ligne de compte, car, à Rome, coiffé du hideux bonnet rouge... il semblait une provocation à nos soldats qui l'avaient abattu dans plus d'une grande ville de France avant de le rencontrer sur les barricades de Rome[20]. Tocqueville avait cependant dit avant la reddition : Nous attachons le plus grand prix à ce que la bannière du pape soit relevée par des mains romaines à la suite d'une manifestation locale. Cela est nécessaire pour conserver à notre expédition le caractère que lui a donné l'Assemblée nationale et que le gouvernement veut lui maintenir. Ce programme était déjà inutile au moment où il fut formulé. Après avoir reçu Niel à Gaëte, sans remerciements sérieux et sans donner aucune garantie, Pie IX avait remis à l'officier une lettre pour Oudinot, dans laquelle il vantait la valeur connue des armées françaises et leur victoire. Acceptez, monsieur le général, mes félicitations pour la part principale[21] qui vous est due dans cet événement, félicitations non pour le sang répandu, ce que mon cœur abhorre, mais pour le triomphe de l'ordre sur l'anarchie, pour la liberté rendue aux personnes honnêtes et chrétiennes... Un autre passage achevait de fixer sur les dispositions pontificales : Sur les graves difficultés qui pourront se rencontrer par la suite, je me confie dans la protection divine. Je crois qu'il ne sera pas inutile à l'armée française de connaître l'histoire des événements qui se sont succédés pendant mon pontificat ; ils sont tracés dans une allocution dont vous avez connaissance, monsieur le général, mais dont je vous remets néanmoins un certain nombre d'exemplaires pour qu'elle puisse être lue de ceux à qui vous jugerez utile de la faire connaître. Cette pièce prouvera suffisamment que le triomphe de l'armée française est remporté sur les ennemis de la société humaine... Dans cette allocution consistoriale, prononcée le 20 avril, le pape affirmait avoir voulu et consenti des institutions libérales, — celles qu'il refusait actuellement. — Il hésitait sur l'opportunité de son retour à Rome, doutant qu'il dût être immédiat, minutieux à estimer les conditions dans lesquelles il serait le plus préférable de reprendre ce pouvoir que notre armée venait de lui rendre. L'essentiel consistait à reculer les réformes, but constant de la politique romaine même quand, en apparence, elle se faisait la plus révolutionnaire, — et le moyen le plus facile était de se faire désirer en utilisant l'impatience manifestée par les Italiens comme par les Français. Ceux-ci étaient entretenus, de plus, dans leurs sentiments par les difficultés suscitées sans cesse autour d'eux. Le drapeau pontifical ne suffisait plus ; ils se devaient de rétablir les armoiries également. Pie trouvait leur indulgence trop inexplicable... Gaëte récusait surtout, et pas toujours en secret, Louis-Napoléon dont elle redoutait le passé, dont elle pressentait la prochaine résistance, renseignée sur sa sourde répugnance du début. La proclamation du Saint-Père à
ses très aimés sujets, du 17 juillet, trois jours après qu'Oudinot eût
proclamé, de son côté, la restauration pontificale, — car il avait choisi la
date de la prise de la Bastille, par oubli, ou par intention, — ne pouvait
plus laisser de doute à qui que ce fût, sur ses dispositions : Dieu a élevé son bras, disait-il, et il a commandé à la
mer orageuse de l'anarchie et de l'impiété de s'arrêter. Il a guidé les
armées catholiques[22] pour soutenir les droits de l'humanité foulés aux pieds,
de la foi attaquée et ceux du Saint-Siège et de notre souveraineté. Gloire
éternelle au Tout-Puissant qui, au milieu de ses colères, n'oublie pas sa
miséricorde. Très aimés sujets, si dans le tourbillon de ces épouvantables
événements, notre cœur a été rassasié d'amertume, en réfléchissant à tant de
maux soufferts par l'Église, pour la religion et pour vous, il n'a pas moins
de cette affection avec laquelle il vous a toujours aimés et vous aime encore
; nous hâtons de nos vœux le jour qui nous ramènera parmi vous et quand ce
jour sera venu, nous rentrerons avec le vif désir de vous apporter la
consolation et avec la volonté de nous occuper de toutes nos forces de votre
vrai bien, appliquant les remèdes difficiles aux maux très vagues et
consolant les excellents sujets qui, tout en attendant les institutions
d'accord avec leurs besoins, veulent, comme nous le voulons nous-même, voir
garantir la liberté et l'indépendance du souverain pontificat, si nécessaires
à la tranquillité du monde catholique[23]. En attendant, pour réorganiser la chose publique, nous
allons nommer une commission qui, munie de pleins pouvoirs et secondée par un
ministère, réglera le gouvernement de l'État. Nous implorons aujourd'hui,
avec plus de ferveur, les bénédictions du Seigneur — que nous implorons aujourd'hui
même éloigné de vous — pour qu'elles descendent avec abondance sur vous ;
c'est une grande consolation pour notre âme d'espérer que tous ceux qui ont
voulu se mettre hors d'état d'en recueillir le fruit par leurs égarements
puissent s'en rendre dignes par un sincère et constant retour au bien.
— Oudinot lui-même, chargé de veiller à ce que la proclamation fût affichée
dans chaque quartier, s'avoua déçu. Il avouait au président du conseil : Les termes dans lesquels est conçu ce manifeste
sembleraient avoir été calculés de manière à enlever à la France le mérite
d'une expédition dont le premier et le plus grand résultat a été le
rétablissement de l'autorité pontificale. Ce document a causé dans le public
une anxiété générale[24]. Il restait
clair que les remercîments adressés à l'Europe et non à la France, même pas
nommée, que le retour à Rome ajourné, semblait-il, indéfiniment, que le
silence, enfin, sur l'amnistie et le statut, prévenaient du recul ; le pape s'occupait beaucoup plus de sa propre liberté et
de l'indépendance de son pouvoir que de la liberté et de l'indépendance de
ses sujets[25]. Corcelles
aussi, cette fois, s'émut, toujours suivi de Rayneval, et tous deux jugèrent
la circonstance assez grave pour se rendre à Gaëte
afin d'y porter au Saint-Père les respectueuses représentations[26] que leur
suggérait ce premier acte de souveraineté
pontificale[27]. Cet avertissement n'arrêta pas Oudinot, ni nos diplomates,
qui se contentèrent de renouveler, un peu plus haut, les protestations
timides qui n'avaient pas servi déjà précédemment. Il eût été plus efficace
de retenir le pouvoir, même avec une certaine brutalité, jusqu'à ce que le
pape et les cardinaux fussent amenés à composition. Il eût été facile, en
tout cas, d'éconduire les commissaires. Dans ces
moments de transitions, toujours accompagnés de certaines hésitations et d'un
grand trouble dans les esprits, il faut compter pour beaucoup l'influence
décisive du fait accompli. Les conseillers du Saint-Père, même ceux qui se montraient
les plus partisans du rétablissement pur et simple du vieux régime, eussent
hésité à détruire une organisation qui aurait eu pour elle l'expérience et
les sympathies des populations. Il est même probable que, voyant se prolonger
et fonctionner paisiblement ce gouvernement sécularisé, au grand contentement
de toutes les classes du peuple romain, les cardinaux eux-mêmes auraient jugé
prudent de presser le retour du pape et, respectant le statu quo, de venir
prendre la part de pouvoir que la nouvelle organisation leur laissait. La
France avait, en outre, dans les mains une arme dont elle ne s'est peut-être
pas assez servie, je veux parler de la menace d'un congrès européen dans
lequel eussent été représentées non pas seulement les puissances catholiques,
mais toutes les grandes puissances de l'Europe, c'est-à-dire celles qui
avaient concouru à rétablir le gouvernement du pape de 1814 et 1815, celles
qui avaient signé en commun le mémorandum de 1831. Or, un tel congrès,
c'était ce que la cour de Rome redoutait le plus au monde, car les trois
gouvernements schismatiques, l'Angleterre, la Russie et la Prusse, eussent
nécessairement fait prévaloir cette politique. Une marche toute contraire fut
suivie[28].
— Le gouvernement commençait à regretter l'état d'esprit de ses officiers et
de ses diplomates, auquel il avait si continuellement aidé. Il comprenait
enfin qu'il aurait dû éviter l'expédition romaine. * * *Pie n'annonça son retour qu'à la dernière limite et décida de se faire préalablement représenter par une commission gouvernementale. Nos agents durent lutter d'autant plus contre les tentatives des partis extrêmes qui proposaient le cardinal Bernetti, célèbre pour avoir réprimé le mouvement de 1831. Ce simple nom, à la suite de la proclamation du 17 juillet, équivalait à une déclaration de guerre. Quand les gouvernements ne s'expliquent pas, écrivait notre ambassadeur, les noms disent tout. Bernetti écarté, l'embarras fut extrême ; tout l'entourage du pontife était médiocre et maladroit, avant même d'agir, dans tout ce qui concernait la politique réaliste. A la fin, le pape désigna les cardinaux Della Genga, Altieri et Vannicelli-Casoni, — le triumvirat rouge destiné à devenir célèbre par ses répressions. Ils arrivèrent le 31 juillet 1849 à dix heures du soir. Della Genga était le chef de ce gouvernement provisoire. Connu pour appartenir en entier au parti autrichien, ce neveu de Léon XII ne démentit pas sa réputation. La première proclamation à laquelle il mit la main avec ses collègues, dès le lendemain de son arrivée, et qui fut datée du Quirinal, précisait les programmes précédents. L'assistance était d'autant plus volontaire que ce nouveau gouvernement, exclusivement composé d'ecclésiastiques, connu pour l'intransigeance de ses membres opposés aux réformes, avait produit sur les Romains une impression détestable. La commission gouvernementale d'État, au nom de S. S. Pie IX, heureusement régnante, à tous les sujets de ses États temporels... La providence a retiré du plus orageux tourbillon les passions les plus aveugles et les plus noires par le bras invaincu et glorieux des armées catholiques[29], les populations de tout l'État pontifical et, d'une manière spéciale, celle de la ville de Rome, siège et centre de notre Très Sainte Religion. C'est pourquoi le Saint-Père, fidèle à la promesse consignée de son vénéré motu proprio, en date de Gaëte, du 17 du mois dernier, nous envoie parmi vous aujourd'hui avec pleins pouvoirs, afin de réparer de la meilleure manière et le plus tôt qu'il sera possible les graves dommages causés par l'anarchie et par le despotisme du petit nombre. Notre première sollicitude consistera à veiller à ce que la religion et la morale soient respectées de tous, comme hase et fondement de toute existence sociale, à ce que la justice ait son cours plein et régulier, indistinctement pour chacun, et à ce que l'administration de la chose publique reçoive la régularité et l'accroissement dont elle a tant besoin après l'indigne abus qui en a été fait par des démagogues sans nom et sans raison. Pour atteindre ces très importants résultats, nous nous aiderons des conseils des personnes distinguées par leur intelligence et par leur zèle, et aussi par la confiance générale dont elles jouissent, et qui contribueront à la bonne issue des affaires ; l'ordre des choses régulier veut qu'à la tête des ministères respectifs il y ait des hommes intègres, familiarisés avec le département dont ils devront s'occuper. En conséquence, nous nommerons le plus promptement possible les personnes qui dirigeront les affaires intérieures et de la police, celles de la justice, des finances, de l'agriculture, des travaux publics, et du commerce, les affaires étrangères restant au très éminent cardinal premier secrétaire d'État qui, pendant son absence, aura à Rome un suppléant pour les affaires ordinaires. Renaisse donc, comme nous l'espérons, la confiance dans toute classe et tout ordre de personnes pendant que le Saint-Père, dans son âme vraiment bienfaisante, s'occupera de pourvoir aux améliorations et institutions qui seront compatibles avec sa dignité et son très haut pouvoir de souverain pontife, avec la nature de cet État dont la conservation intéresse le monde catholique tout entier et avec les besoins réels de ses bien-aimés sujets. — L'affiche fut enlevée pendant la nuit sur presque tous les murs ou elle avait été placardée[30]. Oudinot, qui avait reçu la commission à son arrivée et s'était dépouillé en sa faveur, comme à plaisir, de tous ses pouvoirs, même de ceux qu'il importait le plus de réserver, au point d'aviser dans le plus bref délai les commissaires des divers départements que Sa Sainteté avait daigné leur donner des successeurs, regretta ce nouvel acte de soumission, — comme il avait eu déjà, malgré lui, à en regretter tant d'autres. Il remarqua aussi que le mot en faveur de la France n'avait toujours pas été dit. Dès le lendemain, il constatait la célérité des événements et comme ses protestations prêtaient à sourire. On lui refusa jusqu'au droit de veiller à la police afin de mieux exercer, avec le concours de nos troupes, les vengeances politiques et souhaitées. La Sainte Inquisition fut rétablie. Le papier monnaie émis par la République fut déprécié d'un tiers, ce qui pesa plus lourdement sur les classes pauvres; et ne fallait-il pas reconnaître là la main d'Antonelli, aussi amoureux de l'argent que du pouvoir. Un conseil de censure était institué afin de connaître les qualités et la conduite des employés civils de toutes branches[31]. Les conseils municipaux étaient supprimés. Sous prétexte de vol et de détournements d'objets cultuels précieux, le Ghetto dut être cerné et fouillé par nos soldats. Dans toutes ses lettres, Oudinot se plaignait des résultats de l'expédition. Les mesures prescrites par la commission du gouvernement, écrivait-il le 6 août, au début de son administration, ont déjà excité beaucoup d'inquiétudes et d'agitation. Tant à Rome que dans les provinces, l'attitude calme et énergique de nos troupes parviendra sans doute à prévenir tout désordre, mais la misère tend à s'accroître, et il est douteux que la commission gouvernementale réunisse les conditions voulues pour diminuer les souffrances publiques ; il prévoyait l'avenir du pays compromis et les grandes difficultés qui nous seraient suscitées. D'un autre côté, ajoutait-il, les dispositions à Gaëte sont loin d'être conformes aux intentions généreuses de la France. Le gouvernement pontifical finissait par vouloir faire jouer aux troupes françaises un rôle tel qu'il avait dû protester presque vivement. Il finit par essayer de s'adresser directement à Pie IX, mettant là son dernier espoir, et partit pour Gaëte après avoir remis les pouvoirs au général Rostolan. Il expliqua au pape, avec l'autorité que lui prêtait son irrécusable dévouement[32], la surprise de tous les Français, et la sienne propre, à voir se dresser sans cesse de nouveaux obstacles devant ceux qui voulaient justement aplanir toutes les difficultés. Il regrettait que le retour à Rome fût retardé constamment ; ce retard ne profitait qu'aux ennemis de la papauté, de droite ou de gauche. Les absolutistes justifiant leur opposition à ces premières réformes par le secret repentir qu'ils lui prêtaient, les révolutionnaires raillant notre victoire et prédisant que nous ne tarderions pas à la déplorer[33]. Il représentait aussi que plus d'un prélat, cédant à une irritation non moins imprudente qu'injustifiable, parlait de ramener le pape dans ses Etats par Ancône et Bologne, occupées alors par les Autrichiens[34], et qu'il lui serait impossible de ne pas : voir dans cette préférence une sorte d'affront envers notre drapeau. Pie se récria et demanda si l'armée serait satisfaite qu'il vînt se placer pour quelques jours sous sa garde à Castel Gandolfo. L'officier partit enchanté, persuadé que cette offre se réaliserait ; et l'on sait que le Saint-Père ne revint à Rome qu'après le coup d'État, en 1852. D'autre part, Antonelli, qui avait promis certaines réformes jadis, a la conférence de Gaëte, répondit brutalement à Rayneval, venu lui parler en faveur d'institutions représentatives, qu'un gouvernement parlementaire était incompatible avec la liberté spirituelle du pape. Il savait sans doute qu'il pouvait compter sur l'appui des cléricaux français[35]. Dans le gouvernement, tout au moins, la mesure paraissait comble ; tous les renseignements fournis prouvaient que la Montagne n'avait pas cessé d'y voir clair ; ses prédictions se vérifiaient de point en point ; la France, après l'avoir rendue possible, devait, coûte que coûte, malgré elle, faire servir son protectorat au rebours des principes républicains. Un des premiers dans le cabinet, Tocqueville avait pris l'alarme ; le 2 août, il écrivit à Corcelles : A aucun prix de procès politiques sur le territoire que nous occupons et, surtout, pas d'exécution à l'ombre de notre drapeau, nous serions déshonorés dans le monde. Le 4, il réitérait : Ne vous laissez pas imposer par la prétention qu'a la justice papale de transformer les crimes politiques en crimes de droit commun ; la distinction est vraie, mais c'est nous qui devons la faire. Je vous ai si souvent écrit, et dans les dépêches officielles et dans mes lettres particulières ; qu'il ne fallait à aucun prix laisser exercer sous nos yeux et à l'abri de notre drapeau les vengeances politiques que je n'ai pas besoin d'y revenir[36]. Lui, si conciliant toujours, il allait jusqu'à dire : Vous n'avez certainement pas d'ordre à donner aux autorités papales, mais, quand l'intérêt moral de notre armée ou le soin de l'honneur de notre gouvernement vous semblent compromis par le résultat d'une mesure, vous avez des avis à émettre, et il faut les émettre de telle sorte qu'on réfléchisse avant de passer outre. Nous sommes des conseillers qui avons l'épée au côté, qu'on ne l'oublie pas[37]. — Falloux lui-même s'inquiétait, suivi par les catholiques qui gardaient leur sang-froid et du bon sens[38] ; il ne savait plus que répondre aux doléances de ses collègues, notamment de Tocqueville et Barrot, qui lui reprochaient d'user avec trop de timidité du crédit qu'une sollicitude aussi constante que la sienne avait dû lui assurer. Il répondait en rejetant la faute sur l'impatience de ses interlocuteurs qui servaient, assuraient-ils, le parti rétrograde ; mais ses arguments, quelque peu singuliers, tombaient devant les nouvelles dépêches successives qui, en détaillant l'action pontificale, jetaient dans le conseil un inexprimable malaise[39]. Louis-Napoléon, quoique toujours réservé, ne cachait plus ni son mécontentement, ni sa tristesse. On sentait qu'une lutte ardente s'établissait au fond de son cœur entre les premiers sentiments de sa jeunesse et les engagements contraires que lui avaient imposés son avènement à la tête d'une nation catholique[40]. — Connaissait-il le mot de Louis-Philippe, qui ne voulut jamais céder aux avances du catholicisme : Quand on y met le doigt, tout y passe ? Il se plaignait à Molé un jour : Ah ! Monsieur Molé, dans quelle galère m'avez-vous mis là ![41] Le mot fut rapporté à Falloux qui redouta davantage le lendemain, ne se dissimulant plus que le reproche éclaterait tôt ou tard, dans une explosion d'autant plus violente que la compression serait prolongée[42]. Il alla voir le nonce, Mgr Fornari, et lui tint ce langage qui prouverait ses inquiétudes : Prenez garde, Monseigneur, et n'allez pas entretenir la moindre illusion à Gaëte. On se fie sur ma présence au ministère pour conjurer les périls, et je crois, en effet, mériter cet honneur ; mais remarquez bien que, le cas échéant, je n'aurai d'autre arme que ma démission et que ma démission sera probablement le signal d'un changement de système dont vous n'aurez pas à vous louer. Je n'ignore pas que vous devez négocier avec cinq ou six grandes puissances dont les vues sont fort divergentes ; mais il y a une grande puissance que vous négligez trop, c'est l'opinion publique. Pour gouverner le monde, il faut d'abord le convertir ; pour diminuer la foule et l'obstination des exigences, il faut au moins en renvoyer quelques-unes satisfaites. Depuis trois siècles et plus, la vieille Europe assiste à un monotone et triste spectacle ; en matière de réforme tout se prend, hélas ! et rien ne se donne. Comme il siérait à l'Église, comme il serait digne d'elle d'inaugurer une autre méthode ![43] Tocqueville, afin de mieux influencer Corcelles, le
prévenait des sentiments de Falloux : Je vous envoie
la dépêche officielle ; elle n'a pu être lue que tout à l'heure au conseil :
elle a été approuvée par tout le monde, surtout par M. de Falloux. J'insiste
sur ce point : il est symptomatique. Les modérés et les hommes religieux
eux-mêmes commencent à être embarrassés et irrités de ce qui se passe en
Italie ; ils en redoutent la responsabilité et, si cela continue, ils nous
reprocheront notre mollesse. Indépendamment des nouvelles que vous me donnez,
on répand, sur ce qui arrive à Rome, des bruits inconcevables : on dit qu'on
y a laissé rétablir sous nos yeux et avec notre concours l'Inquisition et le
tribunal du Vicariat, la plus indigne des juridictions qui se rencontrent
dans le système judiciaire romain. On ajoute, et cela je l'ai lu dans des
lettres de modérés de Rome, qu'on persécute les anciens chefs du parti
libéral[44]. On dit que Mazzini a été forcé de quitter Rome, etc.. Si
tout cela se vérifie, rien ne saurait être plus déshonorant pour nous, et je
ne sais de quel front j'oserai me présenter devant l'Assemblée nationale pour
discuter de pareils faits[45]. — Corcelles, ne
sachant plus comment faire, torturé, sans doute, entre ses sentiment
catholiques et ses sentiments français, se souvenant peut-être de ce passé
renié qui lui valait, au moins, la paix de la conscience, prit le parti de
tomber malade, — comme bientôt son ami Falloux, — et de se décharger de tout
sur Rayneval qui, de son côté, dissimulait de moins en moins son
découragement[46].
— Le président du conseil commençait à s'apercevoir que nous étions fort mal
représentés[47]. Les réclamations, nombreuses, arrivaient de toutes parts[48], et le prince-président
subissait comme autant d'injures personnelles les
invectives de l'émigration italienne contre la politique de son gouvernement[49]. A l'Elysée, le
triumvirat pontifical faisait regretter le triumvirat révolutionnaire. Nos
ambassadeurs, en transmettant le jugement de l'Europe, avertissaient des
reproches qui nous étaient adressés de Londres, de Saint-Pétersbourg et de
Berlin, comme de Turin et de Florence ; des conseils les accompagnaient,
celui de retirer nos troupes à Civita Vecchia ou sur le mont Aventin, celui de
renvoyer les cardinaux afin de gouverner directement au nom du pape et malgré
lui : Être maîtres de la situation et ne pouvoir se
faire écouter, avoir la force et laisser à d'autres l'influence, c'était
avouer que nous étions vaincus dans notre victoire et prêter à rire aux
chancelleries comme aux journaux[50]. Louis-Napoléon
était si monté qu'il voulait désavouer au Moniteur, par une note brève, tous
les agents diplomatiques et militaires qui avaient été mêlés à la direction
de l'affaire romaine[51]. Il se contenta
de décider la révocation d'Oudinot, puis de Corcelles. Celle du général fut
décidée le 7 août[52], et motivée sur
les réductions que l'armée d'occupation devait subir. La question militaire qui avait motivé l'expédition, lui écrivit
le ministre de la Guerre, étant aujourd'hui résolue
et l'effectif expéditionnaire de la Méditerranée devant, par suite, être
réduit au chiffre suffisant pour appuyer l'action de la diplomatie, le
président de la République, le conseil des ministres entendu, a jugé que
votre présence à la tête du corps expéditionnaire a cessé d'être nécessaire.
En conséquence et par décret de ce jour, il vous a autorisé à rentrer en
France. J'ai l'honneur de vous en informer. Le commandement était
remis au général Rostolan, le plus ancien des généraux de division. La Rome
pontificale qui voyait d'ailleurs, dans cette disgrâce, une raison de plus
d'affectionner Oudinot, rendit à celui-ci mille honneurs. Elle le nomma
citoyen romain et grava son nom au Capitole, mais l'armée comprit mal le sens
assez particulier de ces hommages, qui ne s'adressaient pas directement ni
précisément à elle, et elle continua d'être d'autant plus sensible au silence
observé à son sujet, que, peu à peu, vaguement, elle se rendait compte de la
besogne qu'on lui avait fait faire. — Quant au prince-président, Oudinot
rappelé, il continuait d'en vouloir à Corcelles et tenait toujours à le
destituer avec éclat. Odilon Barrot eut quelque peine à l'en empêcher[53]. La situation de Falloux devenait de plus en plus délicate.
Tiraillé entre son devoir de ministre et ce qui lui était imposé comme son
devoir de catholique, il était mordu à son tour lui-même, fils bien-aimé, par
cet engrenage romain qui ne lâche pas celui dont il a fait sa proie, et à
l'exemple de Corcelles, il ne lui restait plus qu'à tomber malade. Les uns, a-t-il raconté, trouvaient
que j'en faisais trop, les autres que je n'en faisais pas assez. Sous ce feu
croisé, dans cette incessante perplexité, ma santé s'altéra, et je fus saisi
par un commencement de fièvre nerveuse. Le Dr Récamier, ardent catholique, me
prescrivit, dans l'intérêt même de la mission qu'il désirait me voir pousser
jusqu'au bout, un repos de quelques semaines aux bains de Néry[54]. — Il demanda un
congé qui lui fut accordé. Le jour même de son départ ; il se rendit une
dernière fois au conseil. Louis-Napoléon avait, à sa droite, le président du
conseil, à sa gauche. Tocqueville, puis Passy, à côté duquel Falloux prit
place. Passy lut un volumineux rapport sur les finances au milieu de la
distraction générale, nul n'ayant la prétention d'opposer sa compétence à la
sienne. Le prince-président se pencha bientôt vers Tocqueville, lui dit
quelques mots à l'oreille et lui remit un papier. Tocqueville le lut
attentivement et le passa, derrière le dos de Passy, à son collègue, sans une
parole. C'était la lettre à Edgar Ney. Falloux la lut avec fureur et ne
chercha pas sur-le-champ, môme par politesse, à contenir son premier
mouvement ; il passa derrière Passy, qui continuait son exposé, derrière
Tocqueville qui le suivait d'un air inquiet et dit vivement au prince, encore
qu'à voix basse : Monsieur le président, qu'est-ce
que cela ? Le président de la République lui répondit : Une lettre confidentielle qu'Edgar Ney va communiquer au
général Rostolan. Et ce dialogue s'engagea : Est-ce
que cette lettre est partie ? — Oui, hier au soir. — Alors, vous promettez
qu'elle ne sera jamais publiée ? — Oh ! non, jamais[55]. Il regagna sa
place sans que personne s'interrompît, ce qui lui donna vingt minutes environ
pour réfléchir et se décider à ne pas protester. Je
n'avais point d'avis à émettre ; puisqu'il était en route depuis la veille et
qu'on me garantissait son caractère purement confidentiel[56]. Et, désireux de
se justifier : Ma confiance dans cette promesse
était peut-être moins naïve qu'elle ne doit le paraître après l'événement. Mon
cher Edgar et non Mon cher Ney comme on le lut plus tard dans le Moniteur, et
d'autres expressions ou détails familiers qui disparurent également, me
firent bien au premier moment quelque illusion. Cependant je fus déterminé
par d'autres motifs, dont j'ai donné ici la confession sincère. La lettre,
avec ou sans les transformations qu'elle subit pour la publicité, était la
justification de mon perpétuel discours à la nonciature : Prenez garde, ne
jouez pas avec le feu ! Du moment où la lettre devait être communiquée au
général Rostolan, je ne doutais point qu'elle ne passât, un peu plus tôt ou
un peu plus tard, sous les yeux des trois cardinaux, et j'y trouvais, dans
leur propre intérêt, plus d'avantages que d'inconvénients. Ils vont juger
maintenant, me disais-je, si j'exagère l'irritation du président et si je lui
fais entrevoir des périls chimériques. C'est un essai à huis clos et qui leur
épargnera peut-être une expérience plus désastreuse et plus irrémédiable.
La lettre vengeait jusqu'à Falloux ! Je dois ajouter,
disait-il encore, au bénéfice du président lui-même, que
la mention du code Napoléon était moins excessive dans un message
confidentiel qu'elle ne l'a paru dans un document public[57]... Le ministre de l'Instruction publique, tandis que Passy
continuait interminablement sa lecture, se demandait aussi dans quelle mesure
Barrot et Dufaure avaient réellement ignoré ou inspiré la lettre. J'étais bien sûr qu'ils ne l'avaient point rédigée ; elle
portait trop le cachet de l'homme qui, parlant rarement, veut se soulager
quand il parle ; mais sauf la forme, elle était la pensée même des principaux
membres du cabinet et elle eût été défendue par eux avec la dernière
obstination, si je l'eusse attaquée à fond. Je crus donc préférable de ne les
point heurter à condition qu'ils s'uniraient à la promesse du secret. En
effet, quand la question financière fut vidée, le président lut sa lettre,
répétant tout haut ce qu'il m'avait dit tout bas[58]. — La lettre était
bien l'œuvre de Louis-Napoléon. Elle en accusait l'estampille. Odilon Barrot
n'approuvait pas, ni ne trouvait possible, l'idée de faire décréter le code
Napoléon à Rome ; son ton, de plus, eût été tout autre. Maintenant était-il présumable que ce document, si
visiblement destiné à faire du bruit, n'avait été rédigé que pour passer de
la poche discrète d'un aide de camp dans les archives de la légation
française à Rome ? Pour qui, en réalité, aurait-il été écrit ? Serait-ce pour
le destinataire dont il a gardé le nom ?... Était-ce pour le pape ?[59]... —
Louis-Napoléon prévenait le pape et jetait un appel à l'opinion publique,
destiné surtout à l'avertir. Cette lettre était aussi pour lui une délivrance
; elle lui permettait enfin de protester ; il opposait sa proclamation
napoléonienne à la proclamation pontificale. Il lui semblait se reprendre et
se retrouver, d'accord avec lui-même comme avec la tradition française, pour
le plus grand bien de la France et de l'Europe. Il l'imaginait dans les mains
du général Rostolan, à l'ordre du jour de l'armée, sur les murs de la Ville
Éternelle... Ney se heurta, de suite, au refus de Rostolan. Le général
objectait qu'une pareille publication diviserait le gouvernement, se
retournerait contre nous et que, signée du président seul, elle ne paraissait
revêtue d'aucun caractère constitutionnel. Ney, tout à sa consigne, répliqua
qu'il avait ordre d'obtenir l'insertion du document dans le journal officiel
de Rome ; il remit ensuite à son supérieur une seconde lettre du président
qui confirmait à la fois le contenu de la première et l'injonction de rendre
le texte public. Rostolan, malgré les affronts qu'il avait déjà endurés de la
part des cardinaux[60], s'obstina. Ney
insistant également, et en termes moins mesurés, le général en chef lui
rappela, sur un ton spécial, que nul n'avait le droit de parler de cette
manière devant lui et qu'il le ferait arrêter si la pièce dont il était
porteur venait à être imprimée dans le rayon de son commandement. Oudinot
n'aurait plus tant osé. Le Saint-Siège commandait plus à notre armée que le
gouvernement dont elle relevait. Ney s'arrangea, toutefois, de telle sorte
qu'après son départ la lettre était connue, puis reproduite dans le Moniteur
Toscan. En même temps une dépêche télégraphique, partie le 6 septembre,
signifiait à Rostolan que le ministère désirait, comme le président, la
publication de la lettre à Rome. Le gouvernement l'insérait au Moniteur du 7
septembre. Les catholiques français, en face de la protestation qu'ils
avaient, en somme, nécessitée, firent aussitôt entendre des plaintes et
refusèrent de croire au témoignage de la feuille officielle[61]. Un court
frisson d'espoir glissa sur le cœur des derniers survivants de la liberté. La
lettre à Edgar Ney, datée de Paris, du 18 août, était ainsi conçue : Mon cher Ney, la République française n'a pas envoyé une
armée à Rome pour y étouffer la liberté italienne, mais, au contraire, pour
la régler en la préservant de ses propres excès et pour lui donner une base
solide en remettant sur le .trône pontifical le prince qui, le premier,
s'était placé hardiment à la tête de toutes les réformes utiles. J'apprends
avec peine que l'intention bienveillante du Saint-Père, comme notre propre
action, reste stérile en présence de passions et d'influences hostiles qui
voudraient donner pour base à la rentrée du pape la proscription et la
tyrannie. Dites bien de ma part au général que, dans aucun cas, il ne doit
permettre qu'à l'ombre du drapeau tricolore se commette aucun acte qui puisse
dénaturer le caractère de notre intervention. Je résume ainsi le pouvoir
temporel du pape : amnistie générale, sécularisation de l'administration et
gouvernement libéral. J'ai été personnellement blessé en lisant la
proclamation des trois cardinaux où il n'était pas fait mention du nom de la
France et des souffrances de ses braves soldats. Toute insulte à notre
drapeau ou à notre uniforme me va droit au cœur. Recommandez au général de
bien faire savoir que si la France ne vend pas ses services, elle exige, au
moins, qu'on lui sache gré de ses sacrifices et de son intervention. Lorsque
nos armées firent le tour de l'Europe, elles laissèrent partout comme trace
la destruction des abus de la féodalité et les germes de la liberté. Il ne
sera pas dit qu'en 1849, une armée française ait pu agir dans un autre sens
et amener d'autres résultats. Priez le général de remercier, en mon nom,
l'armée de sa noble conduite. J'ai appris avec peine que, physiquement même,
elle n'était pas traitée comme elle méritait de l'être. J'espère qu'il fera sur-le-champ
cesser cet état de choses ; rien ne doit être ménagé pour établir
convenablement nos troupes[62]. Les protestations catholiques n'étaient pas justifiées. La lettre rappelait, en somme, les instructions données aux agents du gouvernement et le prince y était d'accord avec ses ministres[63] ; il revenait, encore que faiblement, et en partie, aux déclarations faites par Drouyn de Lhuys au début de l'affaire, sur la pression de la Montagne. Elle dépassait cependant le ministère, et par suite du sentiment personnel de Louis-Napoléon, dont nous parlions plus haut, et par la volonté qu'il avait de le faire connaître. La lettre devenait un manifeste ; et les ministres, satisfaits qu'elle fût demeurée inconnue, admettaient difficilement que, ne le restant point, elle les dépassât ; ils estimaient, d'autre part, qu'elle était incomplète, dépourvue de conclusion. Il ne suffisait pas de se plaindre vaguement des procédés du gouvernement papal à l'égard de notre armée, du désir que nous avions de voir notre intervention produire les réformes libérales que nous en attendions, de jeter à nos soldats quelques paroles de sympathie, tout cela était bon pour l'effet du moment, mais n'était pas de nature à influencer bien efficacement sur le dénouement de toute cette affaire : il aurait fallu, à la suite de ces plaintes, formulées avec une certaine hauteur, donner ordre au général qui commandait notre armée de remettre la main sur les pouvoirs, dont il s'était imprudemment dessaisi[64], d'éconduire la commission gouvernementale des cardinaux, de pourvoir, par des mesures sagement combinées, aux nécessités de l'administration romaine jusqu'à ce qu'il plût au pape d'accepter, soit les conditions de notre intervention, soit le recours à un congrès formé par des grandes puissances. Alors la lettre eût eu vraiment les caractères d'un manifeste politique ; telle qu'elle était, nous ne pouvions la considérer que comme étant la répétition plus accentuée de nos précédentes instructions[65]. Par son action précédente, par suite de la défaite des gauches., après avoir tant consenti, Louis Bonaparte se trouvait lié, et le long de cette action même que réclamait son ministre de l'Intérieur, celui-ci eût été le premier à ne pas le soutenir. Ne passait-il pas, auprès d'un public assez nombreux, pour avoir trompé la France en voulant réellement la réaction pontificale[66] ? Le président de la République ne pouvait pas agir. Le présent restait aussi subordonné à l'avenir prochain pour lequel il avait besoin des catholiques. La cour de Rome ne s'égara pas et cacha son sourire sous un aspect de mécontentement. Quel aveu de soumission pour elle dans la déférence montrée par Rayneval qui vint lui demander la permission de publier la lettre! Son refus n'ayant rien empêché[67], ses commissaires manifestèrent quelque mauvaise humeur, et il fut possible, un moment, d'espérer que la lettre à Edgar Ney, contrairement aux critiques ministérielles, allait porter[68], mais, après avoir parlé de se retirer, les cardinaux se ravisèrent vite, revenus à cette politique de résistance passive, sûre de sa force et de son éternité affirmée, dont le clergé a gardé si longtemps le monopole. Falloux rompit sa réserve, estimant qu'il ne pouvait plus collaborer à une politique qui affichait la prétention d'exercer sur le Saint-Père une pression[69]. — En entrant en gare de Bourges, il avait acheté les journaux et lu avec indignation[70] la lettre à Edgar Ney. De retour à Paris, il courut rue de Grenelle où il apprit de son chef de cabinet, Charles Jourdain, que le président inaugurait un chemin de fer à Sens. Il voulait donner sa démission et confia ses doléances à M. Merruau, venu l'entretenir d'affaires municipales, qu'il pria de ne pas le quitter de la soirée, afin d'être, en quelque sorte, un témoin. Merruau s'efforça de le dissuader de son projet en lui représentant qu'il allait marquer une séparation violente entre les catholiques et le prince qui venait de rendre un grand service à la cause du Saint-Père et qui était la principale espérance de l'ordre et de la religion[71]. Il ajoutait que cette retraite, étant un acte de parti, risquait de devenir impolitique et dangereuse pour le pays. Il ne put influencer le ministre ni le décider à prendre conseil de ses amis. Falloux, dès qu'il supposa le président de retour, gagna l'Élysée. L'huissier lui fit savoir que Louis-Napoléon était attendu d'un moment à l'autre, pour le dîner. Je l'attendrai aussi, dit-il[72]. Le prince ne revint qu'entre neuf et dix heures du soir et fit immédiatement entrer Falloux dans son cabinet, quoique ses convives fussent nombreux et impatients de se mettre à table. Monsieur le Président, lui dit le royaliste, vous venez de me donner mon congé et j'ajouterais que je vous en remercie si je ne vous quittais plein d'inquiétude pour de bien graves intérêts. Louis-Napoléon prit l'air le plus étonné : Me quitter? Pourquoi ? — Vous avez rendu public ce qui devait rester secret. — Pensez-vous que la publicité de ma lettre entraîne un changement de politique ? Je ne l'entends pas ainsi ; ce n'est qu'une légitime représaille envers le cardinal Della Genga et ses deux collègues. Mais cela n'atteint point le pape et cela ne changera rien à la marche que je me plais à suivre avec vous depuis un an[73]. Si ces paroles ont été réellement prononcées, et elles le furent sans doute, au moins en partie, le prince justifiait les critiques précédentes du ministre de l'Intérieur; il continuait de rester le prisonnier de cette force catholique, plus forte que lui, plus puissante que la France véritable, simplement française, de cette France ultramontaine, qu'il avait dû servir en dépit de ses préférences. Telle est votre intention, répliqua Falloux, puisque vous me faites l'honneur de me le dire, mais il n'est pas en votre pouvoir d'arrêter le funeste élan que vous venez de donner à la France comme à l'Italie. Louis Bonaparte s'expliqua davantage : Je vais vous dire la stricte vérité et vous allez voir que vous vous exagérez l'incident. Je voulais vous tenir parole et laisser ma lettre faire silencieusement son chemin lorsqu'une dépêche anglaise, interceptée par la police, a été mise sous mes yeux. Cette dépêche, me représentant au cabinet anglais comme le jouet des Autrichiens et m'accablant de piquants sarcasmes, me causa une irritation à laquelle j'ai cédé sans réfléchir. J'envoyai l'ordre au général Rostolan de faire connaître ma lettre à l'armée française et à Rome. Le général refusa d'obtempérer à cet ordre, objectant que ma lettre n'était pas contresignée par un ministre et qu'elle jetterait en Italie une dangereuse effervescence. Le ministère hésitait encore à m'appuyer près du général Rostolan quand ma lettre parut, à peu près intégralement, dans le Moniteur Toscan. Vos collègues, alors, ne virent plus d'obstacle à son insertion dans le Moniteur, et elle y parut. Ce fut une satisfaction qui m'était toute personnelle et dont je n'avais pas calculé l'effet, je vous l'avoue en toute sincérité ; elle ne devait avoir et elle n'aura, soyez-en sûr, aucune influence extérieure sur l'ensemble de notre conduite politique. Falloux objecta que si cette confidence modifiait son appréciation intime du fait en lui-même, le public ne pourrait y être admis et qu'il ne pouvait, en tant que ministre, demeurer l'éditeur responsable d'un document dont ses collègues avaient accepté sans lui la responsabilité. Vous vous trompez, dit le prince, il faut que le public sache la vérité ; je ne demande pas mieux que de la lui dire. Il écrivit alors quelques lignes qui désavouaient la lettre dans les termes les plus catégoriques[74] ; et il demanda : Cela vous suffit-il ? — Falloux se rappela ce qui s'était passé neuf mois auparavant avec Malleville et rendit le papier : C'est trop, Monsieur le Président ; c'est trop pour vous, qui avez écrit la lettre, c'est trop pour MM. Barrot, Dufaure et de Tocqueville, qui en ont autorisé la publication. Puisque vous m'affirmez que rien n'est changé dans notre politique commune, il ne faut point lui imprimer une si brusque secousse. La Patrie a publié une note qui, je viens d'en être informé par M. Merruau, est de la main même de M. Dufaure. Laissez-moi là l'occasion d'une revanche et, surtout, d'un éclaircissement péremptoire[75]. Plusieurs journaux ayant, en effet, argué de la lettre, afin d'annoncer qu'elle avait fait naître un profond désaccord entre Falloux et ses collègues, la Patrie avait déclaré que le ministre de l'Instruction publique avait, au contraire, donné à cette lettre, communiquée au conseil, la plus entière approbation[76], — Falloux s'assit au bureau et écrivit une note rectificative ainsi conçue : La note publiée dans la Patrie n'a pas été communiquée à M. de Falloux, il n'eût pu en autoriser les termes. La communication de la lettre du président a été purement officieuse et excluait toute idée de publicité. Falloux affirmait au président de la République que si le Moniteur publiait la note le lendemain il ne pourrait rien demander de plus. Soyez tranquille, je m'en charge, dit Louis-Napoléon en lui serrant affectueusement les deux mains et en l'invitant à dîner. Falloux refusa. La note parut effectivement au Moniteur. L'Univers
applaudit[77].
Le National protesta[78]. D'autres
journaux alléguaient en même temps que le président, ne voulant pas se mettre
en désaccord avec les ministres, avait maintenu à sa lettre un caractère
purement confidentiel. Le Moniteur leur donnait un démenti ; véritable cacophonie[79] ne résultant pas
tant, ainsi que le disait Barrot, de ce que le Président était sorti des
formes constitutionnelles que de la brouille fatale qui découle toujours de
la lutte dès qu'un gouvernement est amené à contenir une religion par les excès
de cette religion même, — dans les limites concordataires. Enfin la
caricature s'en mêlait, représentant le président assis entre deux gendarmes,
sur le banc des accusés : Falloux présidait le tribunal, composé de
Montalembert et de Faucher, et lisait ; debout, cette mercuriale : Avertissement paternel du P. Falloux. — Que restera-t-il
donc de tout ceci ? Rien, nous l'espérons, qu'un sévère avertissement à M. le
Président de la République. Qu'il ne s'expose, donc pas une seconde fois à
voir un de ses ministres mettre dans le Moniteur des notes semblables à celle
qui a paru ce matin. Et, surtout, qu'il prenne garde, par des témérités et
des légèretés de cette nature, de réveiller contre lui-même les souvenirs
d'un passé que la sagesse la plus constante peut seule faire oublier[80]. Falloux s'interrogeait sur la sincérité de Louis Bonaparte sans arriver à une conclusion. Je me demande encore laquelle des deux paroles du président a été la vraie. Si, en me promettant le secret, il était déjà résolu à ne le point garder, quel bénéfice pouvait-t-il attendre d'une duplicité de quarante-huit heures et comment pouvait-il se ménager volontairement la situation dans laquelle le plaça mon inévitable retour de Néry ? Assurément, il ne ressemble pas, ce jour-là à un homme capable de préméditation ou de prévoyance. D'autre part, s'il n'avait cédé, en publiant sa lettre, qu'à un passager mouvement d'humeur, comment cette lettre se retrouve-t-elle plus tard le programme de sa politique personnelle ? Dans cette hypothèse, il faudrait admettre que la duplicité lui coûtait peu et qu'il n'avait pas pour elle la forte répulsion qu'éprouvent les honnêtes gens en face de cette improbité morale. Il ajoutait sans hésitation : Tromper, en engageant sa promesse, équivaut à tricher au jeu ; cela n'honore pas et ne procure même pas un renom d'habileté. Les hommes qui ne se l'interdisent pas par conscience devraient au moins se l'interdire par amour-propre. Je pose simplement la question. Les historiens de Napoléon III la résoudront[81]. — Qu'auraient donc répondu la Chambre, le ministère et Louis-Napoléon, interrogés sur la franchise de M. de Falloux ? Que pense le lecteur impartial en lisant les Mémoires d'un royaliste ? Il semble, malheureusement, qu'en politique, et par nécessité, — à moins d'un avenir transformé par un système d'évaluation plus exact et des conditions différentes, — la question de franchise soit la plus délicate à contester ; elle ne peut l'être que par des affiliés chez lesquels la pratique des hommes et des affaires, jointe à une qualité de conscience scrupuleuse, permette la connaissance de ce que certaines franchises apparentes comportent de duplicité inconsciente ou voulue et de ce que, d'autre part, la franchise la plus absolue peut entraîner de déplorable jusqu'à équivaloir à une trahison ; seuls, ceux qui luttent le plus près et se sont rapprochés tout contre la question qu'ils servent et veulent résoudre, peuvent apprécier la sincérité de leurs compagnons de lutte dans toutes ses nuances, mais, presque toujours, et de par cette lutte même, ils sont tenus au silence ; de plus, ils doutent souvent encore. Qu'on se souvienne des conventionnels qui survécurent. — Louis-Napoléon ni Falloux ne manquaient totalement de franchise au milieu des mœurs politiques de leur temps, dans une situation de plus en plus embrouillée où l'hypocrisie était, en quelque sorte, imposée, et par le Parlement même ; convaincus l'un et l'autre de la nécessité de chacune des causes qu'ils servaient l'un contre l'autre, et en voulant de part et d'autre, mais d'une manière opposée, les employer à la grandeur, l'un de la France, l'autre de l'Église, ils n'avaient jamais été d'accord que par suite de réserves réciproques ; et ils se demandaient l'un à l'autre plus qu'ils n'étaient susceptibles de s'accorder. Le jour où l'un eut le sentiment, après avoir obtenu l'impossible, de devenir le plus faible, il s'en alla. — Réel événement politique que cette démission de Falloux sensible au président du conseil, qui voyait ainsi s'affaiblir l'élément déjà trop faible qui répondait, dans le cabinet, aux opinions de la majorité parlementaire[82]. La lettre à Edgar Ney, jugée sans suites possibles, prenait une signification nouvelle. Elle semblait, de plus, dégager Louis-Napoléon des responsabilités de l'expédition romaine et marquer, au contraire ses ministres. * * *Le jour même où Louis-Napoléon rédigeait sa lettre, et probablement dans la prévision de celle-ci, comme pour y répondre[83], Pie IX avait réuni à Portici un conseil de cardinaux afin de faire connaître les institutions qu'il entendait donner à ses États. Ces messieurs étaient déjà d'accord sur la mesure des concessions regrettables, mais nécessaires, qu'il fallait consentir ; le véritable débat roula sur l'itinéraire à suivre par le pontife lorsqu'il rentrerait à Rome. Il convenait de décider si le Saint-Père s'arrêterait dans une des villes occupées par les Autrichiens ou passerait par Velletri où campaient les troupes espagnoles. Aucune décision n'était prise lorsque la lettre à Edgar Ney décida le pape à revenir par le plus court chemin, en même temps qu'à répondre au président de la République française, indirectement, à l'aide de l'encyclique déjà commencée et qui fut qualifiée de Motu Proprio, afin d'écarter toute idée de pression étrangère. Ce document, qu'il nous faut citer en entier, signé par le pape le 12 septembre, fut apporté à Rome par Corcelles, remis de sa maladie, le 19, et affiché le 20 — il se modelait en grande partie sur le Mémorandum présenté à Grégoire XVI, en 1831, au nom de cinq grandes puissances[84], avance Falloux. — C'était beaucoup dire. A mes bien-aimés sujets, A peine les vaillantes armées des puissances catholiques[85] qui, avec un dévouement filial, ont concouru au rétablissement de notre liberté et de notre indépendance dans le gouvernement temporel des domaines du Saint-Siège, vous eurent délivrés de cette tyrannie qui nous opprimait de mille façons, non seulement nous avons adressé des hymnes de reconnaissance au Seigneur, mais, en même temps, nous nous sommes empressés d'expédier à Rome une commission de gouvernement, dans la personne de trois prélats considérables. Ils étaient chargés de reprendre en notre nom les rênes du gouvernement civil et d'aviser, avec le secours d'un ministère, autant que les circonstances le permettaient, à prendre les mesures qui, pour le moment, étaient réclamées dans l'intérêt de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publiques. Nous nous sommes attachés à établir les bases d'institutions capables de vous assurer à vous, nos bien-aimés sujets, les libertés convenables et d'assurer, en même temps, notre indépendance que nous avons l'obligation de maintenir intacte en face de l'univers. Cette mesure a pour but de satisfaire les gens de bien qui ont tant mérité notre spéciale bienveillance et notre estime, et de détromper les malheureux égarés qui s'étaient prévalus de nos concessions pour renverser l'ordre social. Ainsi donc, pour montrer à tous que nous n'avons à cœur que votre véritable et solide prospérité, de notre propre mouvement, nous avons résolu et décrété ce qui suit : Article premier. — Il est institué à Rome un conseil d'État. Il donnera son avis sur les projets de loi avant qu'ils soient soumis à la sanction souveraine. Il examinera toutes les questions importantes, dans chaque branche de l'administration publique, sur lesquelles il sera consulté par nous et par nos ministres. Une loi spéciale déterminera le nombre et la qualité des conseillers, leurs devoirs, leurs prérogatives, les règles de discussion et tout ce qui peut concerner le fonctionnement régulier d'une si importante concession (concesso). Article 2. — Une Consulte d'État est instituée pour les finances ; elle sera entendue sur le budget de l'État, elle examinera les dépenses, et prononcera les sentences en reddition de comptes ; elle donnera son avis sur l'établissement de nouveaux impôts et sur la diminution de ceux qui existent, sur le meilleur mode de répartition à suivre, sur les moyens les plus efficaces à faire refleurir le commerce et, en général, sur tout ce qui concerne le trésor public. Les membres de la Consulte seront choisis par nous, sur les listes qui nous seront présentées par les conseils provinciaux ; leur nombre sera proportionné à celui des provinces. Le nombre pourra être augmenté par une addition déterminée de personnes que nous nous réservons de nommer. Une loi spéciale fixera le mode de représentation des membres de la Consulte, les qualités, les règles de l'expédition des affaires de finance, et tout ce qui, efficacement et promptement, peut contribuer à la réorganisation de cette branche si'importante de l'administration publique. Article 3. — L'institution des conseils provinciaux est confirmée. Les conseillers seront choisis par nous sur des listes présentées par les conseils municipaux. Les conseils provinciaux discuteront les intérêts locaux de la province, les dépenses à faire à sa charge et avec son concours, les comptes de recettes et de dépenses de l'administration intérieure ; cette administration sera exercée par une commission administrative qui sera choisie par chaque-conseil provincial, sous sa responsabilité ; quelques-uns des membres du conseil provincial seront choisis pour faire partie du conseil du chef-lieu de la province, pour l'aider dans les fonctions de vigilance qui incombent aux municipalités. Une loi spéciale fixera le mode de présentation, les qualités requises et le nombre de conseillers pour chaque province, les devoirs et les rapports qui devront exister entre les administrations provinciales et les grands intérêts de l'État, et jusqu'où doit s'étendre sa tutelle supérieure. Article 4. — Les représentations et les administrations municipales jouiront des franchises les plus larges que peut comporter l'intérêt local des communes. L'élection des conseillers municipaux aura pour base un nombre large d'électeurs, en ayant principalement égard à la propriété. Les éligibles, outre les qualités intrinsèquement nécessaires, devront payer un cens qui sera déterminé par la loi. Les chefs de communes seront nommés par nous, et leurs adjoints seront nommés par les gouverneurs de province, sur une triple liste présentée par le conseil communal. Une loi spéciale déterminera les qualités et le nombre de conseillers communaux, le mode d'élection, le nombre des membres de l'administration, en la coordonnant avec les intérêts de la province. Article 5. — Les réformes et les améliorations s'étendront aussi à l'ordre judiciaire, ainsi qu'à la législation civile, criminelle et administrative : une commission sera nommée pour s'occuper du travail nécessaire à ce but. Article 6. — Finalement, toujours porté par l'inclinaison de notre cœur paternel à l'indulgence et au pardon, nous voulons faire encore cette fois un acte de clémence envers les hommes égarés qui furent poussés à la félonie et à la révolte par les séductions, par l'incertitude, et peut-être encore par l'inertie des autres. Nous devons avoir présent, en cette circonstance, ce que réclament la justice, fondement des États, les droits d'autrui, opprimés ou lésés, le devoir qui nous incombe de vous protéger contre le retour des maux qui vous ont accablés, l'obligation de vous soustraire aux pernicieuses influences des corrupteurs de toute morale et des ennemis de la religion catholique, cette source éternelle de tout bien, de toute prospérité sociale, qui a fait votre gloire, qui vous distinguait comme une famille élue de Dieu et favorisée de ses dons particuliers. Dans ces sentiments, Nous voulons qu'il soit publié, en notre nom, une amnistie pour les peines encourues, pour tous ceux qui, dans les limites qui seront déterminées, ne se trouveront pas exclus de ce bénéfice. Telles sont les dispositions que, pour votre bien-être, nous avons cru devoir publier devant Dieu. En même temps qu'elles sont compatibles avec les devoirs de nos fonctions apostoliques, nous avons la ferme conviction qu'elles peuvent, étant fidèlement exécutées, produire l'heureux résultat que désirent les hommes sages et honnêtes. J'en ai pour garant le juste sentiment de chacun de vous, dont le cœur soupire après le bien en proportion des épreuves subies. Mais, surtout, mettons notre confiance en Dieu qui, au milieu d'une juste colère, n'oublie jamais sa miséricorde. Donné à Naples dans le faubourg de Portici, le 12 septembre 1849, et de notre pontificat le quatrième. Cette notification suivait le Motu proprio : Commissaire du gouvernement, Sa Sainteté, Notre-Seigneur le Pape, ayant égard aux circonstances qui atténuent, chez un certain nombre de ses bien-aimés sujets, la culpabilité de leur participation aux troubles politiques qui ont récemment affligé les États pontificaux, désirant montrer de plus en plus la bonté de son cœur vraiment paternel et usant de ses pleins pouvoirs en faveur d'hommes égarés, plutôt séduits que séducteurs, nous a ordonné de faire connaître, en son auguste nom, ce qu'il a daigné arrêter par suite de l'article 6 de son Motu proprio souverain du 12 de ce mois. Nous conformant, en conséquence, au vénérable commandement de Sa Sainteté, nous nous empressons de publier les dispositions suivantes, aux termes de la pensée souveraine qui nous a été exprimée : A ceux qui ont pris part à la dernière révolution des États pontificaux est accordé, par bienfait souverain, le pardon de la peine qui leur serait due pour les délits politiques dont ils seraient responsables. Sont exclus de cette grâce : Les membres du gouvernement provisoire ; Les membres de l'Assemblée constituante qui ont pris part aux délibérations de cette assemblée ; Les membres du triumvirat et du gouvernement de la République ; Les chefs des corps militaires ; Tous ceux qui, ayant déjà, une autre fois, joui du bénéfice accordé par Sa Sainteté, ont manqué à leur parole d'honneur en participant aux derniers bouleversements politiques ; Enfin ceux qui, outre les délits politiques, se sont rendus coupables de délits particuliers prévus par les lois en vigueur ; La présente amnistie n'implique pas le maintien dans les emplois du gouvernement, ni dans les emplois provinciaux ou municipaux, de tous ceux qui s'en seraient rendus indignes par leur conduite dans les derniers événements. La même-mesure est applicable aux militaires et aux employés de toutes armes. A notre résidence du Quirinal, le 18 septembre 1849. Le pape, en somme, pour qui savait lire, annonçait son intention de ne pas répondre aux nécessités de son peuple, de son temps et de la situation[86]. Le Motu proprio était dérisoire, l'amnistie cruelle[87]. De plus il fut, presque de suite, diminué, de manière à ne bien demeurer en tout et pour tout qu'un simulacre de réforme. Tout ce qui semblait y être promis, et qui l'était dans des termes fort vagues, dépendait uniquement de l'avenir ; or tout prouvait qu'il y aurait eu folie à croire à la bonne foi de la papauté. L'amnistie comptait si peu que nos représentants à Gaëte durent faire entendre des remontrances. Elles n'eurent pas d'effet ; le Parlement français applaudissait à la politique pontificale et ne les soutenait pas ; les ministres commencèrent même sans doute à regretter dans cette circonstance l'élimination des gauches. Repousser le Motu proprio apparaissait nécessaire, mais c'était s'opposer à la rentrée du pape dans Rome, où les trois cardinaux agissaient déjà en maîtres impérieux et tout-puissants : il nous aurait fallu servir, et même dans une certaine mesure, cette cause révolutionnaire que nous avions vaincue, entrant en lutte constante, désormais, avec le vainqueur créé par nous. La funeste aventure romaine apparaissait là dans toute son insoluble difficulté. La lettre à Edgar Ney avait donc, en résumé, créé en Italie un mouvement de sympathie en notre faveur, un nouvel espoir. Tous les souvenirs de 1831, que M. de Corcelles avait eu à constater, lorsque Louis-Napoléon n'était encore que candidat à la présidence, firent irruption dans la politique[88]. Des révolutionnaires auraient même alors cru que l'ancien insurgé des Romagnes allait reprendre l'œuvre de prédilection de sa famille, qui était de renverser le pouvoir temporel du Saint-Siège[89]. Et ce serait par la crainte de cet avenir proche qu'il faudrait expliquer la retraite du pape à Naples, puis à Portici[90]. Son entourage annonçait que Sa Sainteté gagnerait même l'Amérique plutôt que de perdre son indépendance. Le prince-président, répétons-le, demeurait toujours trop isolé pour agir. Tocqueville, d'abord mécontent, écrivit à Corcelles dans des termes qui prouvaient la soumission de la France. Le Motu proprio fut accepté, sinon en lui-même, du moins comme point de départ des meilleures espérances, tant la volonté de s'illusionner demeurait persistante. Au surplus, Louis-Napoléon ne voulait sans doute pas agir. Il se contenta, suivant ce qui lui était seulement permis, de donner des conseils, à l'efficacité desquels il ne pensait pas pouvoir croire. Il espérait, du moins, un peu dans le rapport de Thiers, chargé du projet de loi qui portait demande du crédit relatif à l'occupation de Rome ; et, à s'en remettre à l'historien de 1860[91], rien n'aurait été épargné afin d'obtenir de lui qu'il confondît dans une même administration la lettre et la politique suivie jusqu'à ce jour par le gouvernement[92]. Cette attente fut peu récompensée ; le rapport, loin de donner aucune satisfaction, ajouta encore à l'irritation présidentielle[93]. Thiers, se solidarisant une fois de plus avec la majorité parlementaire conservatrice, satisfaite du Motu proprio, déclara s'en remettre à la loyauté ainsi qu'au libéralisme bien connu[94] de Pie IX. De la lettre présidentielle pas un mot. Le coup fut ressenti vivement à l'Elysée, peut-être plus que ne l'avaient été les violents outrages de Ledru-Rollin[95] ; il avait été certainement porté avec intention[96], et bien des passages de la rédaction le démontraient, notamment dans la manière dont le Motu proprio était apprécié : L'acte important qu'on appelle le Motu proprio suppose un ensemble de lois qui devront réformer la législation civile ; donner l'équité des tribunaux, amener une juste répartition des fonctions publiques entre les diverses classes de citoyens, prouver, en un mot, aux Romains, les avantages d'un gouvernement sagement libéral. Ces lois sont assurées, et la parole de Pie IX suffit pour lever tous les doutes. Mais les conseils de la France devront être dirigés de manière à convertir en parole efficace le Motu proprio et, surtout, à étendre la clémence du pontife sur tous ceux qui peuvent être amnistiés sans danger pour l'ordre public. Ce doit être l'œuvre d'une influence continuée avec patience, avec calme, avec respect, influence qui constituerait, nous le répétons, une prétention inadmissible si des circonstances impérieuses ne nous avaient amené à l'exercer, mais qui, renfermée dans les bornes convenables, est parfaitement incompatible avec l'indépendance et la dignité du Saint-Siège. Louis-Napoléon était exaspéré[97]. Un concile catholique qui venait de se tenir à Paris lui faisait regretter de plus, malgré ses capitulations, l'envahissement progressif du clergé[98]. La difficulté du ministère, et, surtout, pour Barrot, consistait à lui procurer une satisfaction qui ne coûtât rien, ni à la dignité de l'Assemblée, ni à celle du ministère ; et Thiers semblait avoir prévu l'alternative afin de l'empêcher. S'il y avait eu, entre les conclusions du rapport et notre politique, un point de dissidence, nous en eussions fait de suite notre champ de bataille, et la majorité eût alors prononcé entre le manifeste du président et le rapport de M. Thiers : Louis-Napoléon eût été satisfait de toute hypothèse, car si l'Assemblée donnait son approbation au manifeste, c'est lui qui entraînait le Parlement dans ses vues ; dans le cas contraire, il avait l'espoir de compromettre l'Assemblée avec l'opinion publique, alors assez prononcée contre les résistances de la cour de Rome. En approuvant notre politique pour le passé, comme pour l'avenir, le rapporteur nous enlevait tout terrain de combat et, partant, toute occasion de prouver au président la satisfaction qu'il recherchait ardemment[99]. Barrot discuta longuement avec Louis-Napoléon sur l'attitude qu'il convenait de prendre vis-à-vis de la majorité ; le prince semblait souhaiter qu'il lui fût jeté un défi ; le ministre cherchait à le convaincre qu'il ne pouvait guère qu'exposer très franchement ses vues politiques, déclarer qu'elles étaient absolument conformes au manifeste présidentiel et mettre les opposants au défi de formuler un amendement impliquant un blâme, même indirect ; il n'y aurait ainsi pas lieu de chercher querelle à l'Assemblée, si elle approuvait la politique suivie. Mais le président de la République voulait davantage et quelque chose de plus direct. Il écrivit à Barrot une lettre officielle afin qu'elle fût lue à la majorité contre laquelle elle pointait son avertissement : Monsieur le Ministre, la question romaine allant être de nouveau discutée à l'Assemblée nationale, je vous écris pour expliquer le plus nettement mon opinion et connaître si, en définitive, elle est conforme à la vôtre et à celle de vos collègues. Jamais, vous le savez, il n'est entré dans ma pensée de profiter de la présence de nos troupes à Rome pour imposer violemment nos volontés au Saint-Père. Ma lettre au lieutenant-colonel Edgar Ney n'était que le résumé des intentions généreuses manifestées par Pie IX lui-même à nos ambassadeurs. Elle avait pour but de contrebalancer des influences opposées et de rappeler à nos agents la direction de notre politique : nous avons donc le droit de demander la réalisation des espérances qu'on nous a données. Deux grands intérêts, d'ailleurs, sont à sauvegarder à Rome : l'un, c'est d'affermir par notre appui et d'attacher à la France par les liens de la reconnaissance le chef vénérable de notre religion ; l'autre, c'est de ne pas laisser affaiblir la puissance de notre drapeau et de lui conserver le prestige dont il a toujours été entouré en représentant en Italie la cause de la liberté. Pour obtenir ce double avantage, il est nécessaire que nos troupes restent à Rome aussi longtemps que nos intérêts l'exigeront. Vous n'avez pas oublié, Monsieur le ministre, avec quelle persévérance j'ai secondé l'expédition romaine, alors qu'un premier échec sous les murs de Rome et une opposition formidable à l'intérieur menaçaient de compromettre notre honneur militaire : je mettrai la même confiance à soutenir contre des résistances d'une autre nature ce que je considère comme l'honneur politique de l'expédition. — Elysée national, 14 septembre 1849. La majorité parlementaire, expression de la conservation catholique, avait nécessité cette protestation nouvelle si modérée, adoptée, semblait-il, à la Chambre, de même que la lettre à Edgar Ney répondait à l'armée et à l'opinion publique générale. Grâce à ce nouveau texte, le régulateur, appelé par le pays à le diriger, donnait une leçon d'équilibre, de juste milieu, car il ne parlait à son ministre que pour s'adresser au Parlement[100]. Maintenant qu'il avait un peu tâté le pays et s'en était fait connaître, tandis que les partis subsistants, divisés de suite après la victoire, reprenaient leurs luttes et, par cette persistance, semblaient vouer la nation, faute d'un balancier central, à un émiettement perpétuel, à une élimination si constante que rien, à la fin, n'en subsisterait, il estimait le moment opportun pour faire entendre sa voix et expliquer à tous les citoyens attentifs de quelle façon modérée il entendait partager les forces européennes. Le Parlement, au moment de la révolution, n'avait pas semblé pouvoir réaliser celle-ci, même dans ce qu'elle avait de légitime et de réalisable ; retombé maintenant, mais toujours le maître, ce Parlement dressait avec une audace croissante la thèse contre-révolutionnaire et, le drapeau rouge dès le début éliminé, le drapeau bleu, déjà caché ou fort déteint, préparait le retour du drapeau blanc sous une étiquette républicaine. Louis-Napoléon, dont ces erreurs successives faisaient le jeu, en même temps qu'elles rendaient celui-ci, en quelque sorte, nécessaire ou, du moins, fatal, combattu par ce Parlement, suspecté par son ministère, se dressait au sommet de l'un et de l'autre, grandi par la confusion même de leur masse incapable d'un programme net. et sincère, suprême promesse d'une équivoque constante dont il demeurait d'ailleurs trop l'expression pour ne pas être une sorte d'équivoque lui-même, encore réservé, d'ailleurs. Pour la première fois, d'une façon évidente, il ne semble plus craindre d'entamer déjà un peu la lutte avec le Parlement. N'ayant pu obtenir son concours, quoi qu'il consente, il se servira de son opposition, la provoquera au besoin, se sentant assez fort pour n'avoir pas à la craindre. L'intérêt national est bien de son côté, encore qu'il le modère trop, par suite de la force du clergé ; il se l'est subordonné, par la force du centre et de la droite même, en servant une partie de cette nécessité catholique contre laquelle rien de disciplinable ou, tout au moins, de disciplinable par lui ou la nécessité gouvernementale, ne se dressait ; il représente bien alors l'État français, sa politique séculaire, la possibilité présente. — Toutes les luttes intestines de la nation conspiraient ainsi, semblait-il, en dépit de tout et de tous, pour le grandir. Ce qu'il y avait d'exagéré, au strict point de vue constitutionnel, dans la leçon donnée au Parlement ne pouvait être saisi par la masse des électeurs, et le Parlement, comme le ministère, n'avaient pas aux yeux de ceux-ci assez de poids pour être entendus puis écoutés à ce sujet. Comment aurait-elle pu comprendre, dans sa majorité, que le prince-président profiterait de l'alerte, au besoin, pour se débarrasser de son ministère ? L'aurait-elle deviné qu'elle eût applaudi. Comment, d'autre part, Louis-Napoléon aurait-il pu ne pas souhaiter la chute de ce ministère appelé, comme on sait, celui de la captivité[101] ? — Redoutable mêlée, au milieu de laquelle, comme dans toutes les luttes très confuses, chacun finissait par ne plus penser qu'à soi, et avec une nécessité si pressante qu'il écoutait avant tout son instinct de conservation. Barrot donnait l'exemple en n'examinant guère la question que dans ce qu'il y débattait de personnel : Je ne pouvais consentir à être l'instrument d'une telle politique ; j'avais bien montré, sous la Constituante, que je savais, au besoin, défendre avec énergie les droits et l'honneur du pouvoir exécutif lorsqu'ils étaient attaqués, mais je n'étais nullement disposé à me faire le héraut des défis sans cause que voulait jeter au Parlement le président de la République, dans la vue de son importance personnelle et de son ambition[102]. Aux instances répétées[103] du prince qui le pressait de signifier aux députés, du haut de la tribune, cette espèce d'intimation, il se contenta de répondre qu'il lirait sa lettre, au cours de la discussion, si le débat, par sa direction, lui permettait de la donner comme un témoignage de l'accord parfait qui existait entre la politique du président et celle du ministère ; il lui fit comprendre aussi sa répugnance insurmontable à provoquer un conflit que tous ses efforts avaient tendu jusqu'à ce jour à éviter. Telles étaient les circonstances au milieu desquelles
s'ouvrait le débat. Il ne nous était pas-difficile
de pressentir quelle serait la tactique de l'opposition ; les partis ont de
merveilleux instincts pour deviner les côtés faibles d'une situation :
lorsqu'ils entrevoient, la plus légère apparence de discussion dans les
éléments du pouvoir, c'est là qu'ils placent bien vite leur levier, et ils
n'ont pas tort, car c'est presque toujours ainsi que les combinaisons
politiques qui paraissent les plus solides s'écroulent[104]. Le rapport de
Thiers allait être opposé à la lettre du président de la République ; et le
ministère redoutait que ce qui subsistait de la gauche n'exploitât
l'antagonisme entre Louis Bonaparte et la majorité. — Thiers lut son rapport
le 13 octobre. Tocqueville n'y répondit que le 19 en ayant soin de prendre la
parole de suite afin de parer la manœuvre. En réalité, avant tout autre
cause, Thiers avait soutenu celle du pape, au nom de la conservation sociale
qu'il ne semblait pas voir possible hors de l'unité catholique. Sans l'autorité du Souverain Pontife, disait-il, l'unité catholique se dissoudrait ; sans cette unité, le
catholicisme périrait au milieu des sectes, et le monde moral ; déjà si
fortement ébranlé, serait bouleversé de fond en comble. Mais l'unité
catholique, qui exige une certaine soumission religieuse de la part des nations
chrétiennes, serait inacceptable si le Pontife qui en est le dépositaire
n'était complètement indépendant, si ; au milieu du territoire que les
siècles lui ont assigné, que toutes les nations lui ont maintenu, un autre
souverain, prince ou peuple, s'élevait pour lui dicter des lois. Pour le
pontificat, il n'y a d'indépendance que la souveraineté même. C'est là un
intérêt qui doit faire taire les intérêts particuliers des nations, comme
dans l'État, l'intérêt public fait taire les intérêts individuels, et
il autorisait suffisamment les puissances catholiques à rétablir Pie IX sur
son siège pontifical. C'était, en somme, avec scepticisme, mais avec
soumission, subordonner le monde à la nécessité catholique. Thiers, historien
de la Révolution française, refusait la leçon de celle-ci, et devant ce
problème que sa permanence avait posé en Europe pour la troisième fois, grâce
au mouvement de 1848, par prudence sans doute, avec des regrets qu'il n'avait
pas, peut-être, il concluait pour le passé[105]. Tocqueville débuta en donnant lecture d'une lettre adressée par Rayneval et Corcelles, le 19 août, à Antonelli ; vingt jours donc avant l'épître à Edgar Ney, le gouvernement français soumettait ses demandes dans lesquelles, disait-il catégoriquement, il se croit le droit et le devoir de persister. C'étaient la liberté individuelle, la consécration de la dette publique, l'inviolabilité de la propriété privée, une organisation de tribunaux fournissant toutes les garanties judiciaires, des lois tirées du Code civil, la création d'assemblées communales et provinciales élues, une administration publique sécularisée ; la France demandait aussi que les membres de la Consulte fussent élus par les corps locaux au lieu d'être choisis sur une liste formée par ces corps et que le vote délibératif en matière d'impôt fût accordé à cette assemblée. Les représentants de la France, disait la lettre, ont vu avec la plus profonde douleur et le plus vif regret, par la déclaration du prosecrétaire d'État à la dernière conférence, que les institutions du gouvernement pontifical ne répondaient, pas exactement à l'attente du cabinet français. Sa Sainteté ayant bien voulu suspendre sa décision dernière jusqu'à ce que la France ait fait connaître toute sa pensée, les soussignés ont jugé le moment venu d'obtempérer aux ordres qu'ils avaient éventuellement reçus. Ils renouvellent donc et constatent d'une manière formelle les demandes de la France... Ils ne doutent pas de les voir accueillies par le généreux Pie IX, et ils prennent la liberté d'insister auprès du gouvernement pontifical avec le plus profond respect et, en même temps, avec toute la persévérance qu'autorise le constant dévouement de la France à la grandeur et à la prospérité de l'Église. Et Tocqueville expliquait : On nous a demandé, en dehors de cette Assemblée et dans le sein de la commission, si la politique exprimée par la lettre du président de la République était la nôtre, si c'était bien la République que nous avions pratiquée et dont nous précisions la responsabilité. Nous avons répondu alors, et je suis bien aise de trouver l'occasion de répéter publiquement à cette tribune que cette politique est exactement celle de nos dépêches. L'Assemblée vient d'en juger. Qu'est-ce que contient, en effet, la note de MM. de Rayneval et de Corcelles qui ne soit en substance dans la lettre de M. le président de la République ? Quelles sont les demandes formulées dans cette lettre que nous n'eussions déjà adressées au Saint-Siège, ainsi que nous venons de l'entendre ? La lettre de M. le président peut donc être considérée comme un résumé sommaire, rapide, familier, si vous voulez, de notre politique, mais comme un résumé fidèle ; elle l'a traduite dans son élan généreux et fier. Nous ne l'avons jamais désavouée, nous ne la désavouerons jamais. Et comme le représentant Duprat s'écriait : Alors vous êtes contre les conclusions de la commission ! Il répondit seulement par l'aveu que ce Motu proprio n'avait évidemment pas réalisé immédiatement et complètement tous les vœux de notre diplomatie, mais qu'il renfermait cependant les réformes les plus essentielles que nous avions demandées et que les autres s'y trouvaient en germe. La gauche se récriait et à plusieurs reprises encore, tandis que le ministre continuait à détailler son optimisme officiel. Ces messieurs peuvent douter des paroles du Saint-Père, disait-il, libre à eux ; je n'en doute pas pour mon compte ; ils ne peuvent pas nier, dans tous les cas, que ces engagements n'aient été solennellement pris dans le Motu proprio. Nous avions demandé des libertés municipales et provinciales : elles sont non plus seulement promises, mais données, et de la manière la plus large. Et après que Barrot se fut écrié : Oui ! Et peut-être plus larges que vous ne le voudriez vous-mêmes pour la France !, le ministre des Affaires étrangères donnait lecture d'une dépêche envoyée par le gouvernement à Rome, aussitôt après le Motu proprio, dans un sentiment à la fois de regret et d'approbation. La France assurait que les institutions promises par le manifeste lui avaient paru incomplètes. Elle avertissait ainsi son agent de son rôle : Votre principale mission est de tâcher, autant que vous le pouvez, de hâter par vos avis désintéressés et pressants le prompt et efficace développement des principes d'institutions libérales déposés dans le manifeste. Tocqueville avouait, d'ailleurs, que sur l'amnistie notre langage avait dû être plus vif et plus pressant. Une nouvelle dépêche avait chargé notre représentant de faire entendre à l'autorité pontificale qu'elle risquait d'entretenir une agitation nouvelle, par suite de la manière maladroite, si peu prudente et si exagérément limitée, dont elle avait compris l'amnistie. Il fallait conjurer le Saint-Père de revenir sur cette mesure et d'en modifier profondément la portée et l'effet, lui faire remarquer avec le respect filial qui lui était dû, mais aussi avec la fermeté qui est notre devoir et notre droit, que la France ne saurait s'associer indirectement, ni directement, aux actes de rigueur que de si nombreuses exceptions faisaient prévoir. Le devoir du Saint-Siège consistait dans la conciliation des partis et la pacification réelle du pays. Le ministre avait débuté, et c'était, peut-être, la partie la plus instructive de son discours, en expliquant que le but évident de ceux qui avaient décidé l'expédition romaine était la restauration du pape. — Ledru-Rollin et ses amis n'étaient plus là. Le même langage en face de la Montagne abattue au 13 juin eût soulevé une tempête, peut-être une possibilité d'action et même, la mesure apparaissant alors comble, de coup d'État révolutionnaire. Aujourd'hui les protestations n'étaient plus de taille et trop peu nombreuses ; ceux mêmes qui surent protester courageusement étaient battus d'avance, malgré leur instinctive adresse à vouloir délivrer le président de la République en lui opposant la majorité de l'Assemblée, nouvelle indication de ce qu'il y aura quand même de possibilité révolutionnaire dans le 2 décembre, au point de permettre à Proudhon, désespéré, de vouloir y rêver un moment l'éventualité d'avenir la plus dictatoriale mais, par là même, la plus immédiate. Mathieu de la Drôme, qui prit le premier la parole, essaya même d'opposer ministre à ministre, représentant que le mal venait de ce que le cabinet était un cabinet de coalition ; composé uniquement d'hommes du genre de Falloux, il n'eût pas permis à l'Assemblée constituante d'autoriser l'expédition de Civita-Vecchia ; réunissant divers spécimens d'O. Barrot, il n'eût pas laissé aboutir l'expédition au renversement de la République romaine. Je me placerai, avait-il dit, sur le terrain des arguments pris avec le peuple romain. C'est la seule face de cette grande question que je me propose d'examiner. — Il rappelait combien de fois la minorité avait prévenu la majorité de la difficulté plus grande qu'il y aurait à sortir de Rome que pour y entrer ? Il était plus prévoyant que vous, le grand orateur que votre malheureuse expédition de Rome a jeté sur la terre d'exil. Combien il serait vengé, mon noble ami, s'il pouvait se réjouir de la situation déplorable que vous avez faite à notre pays ! Personne ne voulait comprendre, bien peu comprenaient. Taschereau, achevant de donner sa mesure, indiquée déjà dans la Revue rétrospective, se réjouissait que la France fût devenue la risée de l'Europe démocratique et sociale. — Abordant la lettre à Edgar Ney, l'orateur demandait l'assurance que les promesses au moins, encore que si timides, fussent tenues. M. le ministre des Affaires étrangères nous a dit que le cabinet ne désavouerait par cette lettre. En vérité, je vous l'avouerai, M. le ministre a eu de la peine à faire pénétrer la conviction dans mon esprit. J'en suis convaincu, on la regrette amèrement cette lettre, mais l'Europe tout entière la connaît, le Moniteur l'a recueillie dans ses colonnes et le Moniteur ne rend jamais sa proie ; dans le temps où nous vivons, il a bien raison, car trop de gens lui demanderaient des restitutions. La lettre était tolérée, à condition qu'elle se réduisît à son minimum et à supplier. Quand il s'agit du peuple romain, on a le droit de le supplier... à coups de canon ; mais le pape, il est parfaitement libre... Le langage du député prouvait, cependant, son manque de parti pris ; il indique un des côtés significatifs de la gauche en 1848[106] : Celui qui vous parle, Messieurs, n'est pas un ennemi des prêtres, et puisque votre interruption m'y oblige, je vous dirai que j'ai été élevé dans des sentiments religieux par une famille religieuse ; je vous dirai que le peu que je sais, je le dois à de pieux ecclésiastiques, qui occuperont aussi longtemps que je vivrai une grande place dans mes souvenirs. Mais la reconnaissance ne m'aveugle pas. Je vous dis que la place du prêtre est au lit, au chevet du malade ; là il rencontrera les sentiments de gratitude tandis qu'ailleurs il ne rencontrera que des sentiments hostiles. Revenant à la lettre, il rappelait des choses plutôt désagréables pour la majorité. Il montrait que ce qu'elle demandait, c'était un gouvernement réel, un gouvernement civil. Voilà le sens de la lettre. Il faudra bien que quelqu'un s'en constitue le défenseur. Eh bien, s'il le faut, ce sera moi. (On rit.)... Elle est inconstitutionnelle, dites-vous, Messieurs ; ce n'est pas nous, assurément, qui serons suspects de montrer trop de condescendance au président, mais ce n'est pas nous qui lui avons prodigué l'éloge, d'abord, et l'outrage ensuite... Ce n'est pas nous qui disions que son élection serait une honte pour la France. (Violents murmures et cris : A l'ordre !) J'ai entendu attribuer ces paroles à M. Thiers. Thiers : Je les démens formellement. M. Bixio : Je les ai entendues. Mathieu de la Drôme : Entre M. Thiers qui nie et M. Bixio qui prétend avoir entendu, je laisse le débat et je reprends la discussion... Il demandait à la majorité l'explication de sa surprise en face de la lettre à Edgar Ney. Je lisais l'autre jour dans un journal absolutiste que cette lettre semblait écrite par un général sur la selle de son cheval avec le pommeau de son épée. A qui la faute ?... Vous avez permis une chose à M. le président de la République, aujourd'hui il s'en permet une autre qui ne vous plaît pas. C'est la conséquence nécessaire des choses, la conclusion des principes que vous avez vous-mêmes posés. Mais tranchons là-dessus. La cour de Gaëte ne vous était pas connue, je pense. Oh ! vous auriez bien dû lire la lettre de M. de Talleyrand à l'Académie des sciences morales et politiques ; vous y auriez appris que le dernier des théologiens est aussi le plus fin des diplomates et que vos ambassadeurs n'étaient pas de force à lutter de finesse avec les cardinaux de Gaëte. La lettre du président de la République ? Croyez-vous qu'elle ne soit pas un acte des sentiments intimes de la part de Louis-Napoléon ? Espériez-vous que le combattant de Forli renierait tout son passé et outragerait à la mémoire de son frère, mort en combattant à ses côtés pour une cause identique aux principes contenus dans la lettre du président ? De telles espérances auraient été pour lui l'injure la plus sanglante. Oh ! je sais bien que quelques-uns l'ont ainsi pensé et qu'en votant le 10 décembre pour le neveu de celui qu'ils appelaient l'usurpateur, l'ogre de Corse, ils espéraient faire de ce neveu la victime expiatoire de la gloire de l'oncle. Ce n'est pas ainsi que divers citoyens ou, plutôt, la généralité des citoyens ont voté pour Napoléon Bonaparte. Ils comprenaient que voter pour un Bonaparte, c'était protester d'une manière éclatante contre votre politique de dix-huit années de corruption. Par sa lettre, le président de la République a faussé les pouvoirs constitutionnels... C'est fort possible. Eh bien, vous qui le pensez, pourquoi ne le mettez-vous pas en accusation ? (Rires.) Oh ! je sais bien que vous êtes trop honnêtes et trop modérés pour en venir là ! Vous préférez condamner la lettre et pardonner à l'homme. Mais M. le président de la République ne se contentera pas de cela ; il soutiendra sa politique, dussiez-vous forcer ses ministres à donner leur démission. Il se souviendra qu'il est un Bonaparte, et il repoussera ces accusations des journaux honnêtes qui osent le présenter comme un homme qui n'a écrit cette lettre que pour flatter l'armée... Non ! Non ! Le représentant de la France devant l'étranger soutiendra ce qu'il a écrit aux yeux du monde entier ; il soutiendra son honneur et celui de la France. Il concluait : Trois enseignements ressortent de ce que je viens de vous exposer : le premier, c'est que les coalitions sont toujours funestes aux partis qui les font ; le second, c'est qu'il faut veiller à ce que le pouvoir ne sorte pas des limites que la constitution lui a tracées ; le troisième, enfin, c'est que l'on ne combat pas impunément contre le principe d'où l'on tire sa propre existence et que, s'il est une justice au ciel, elle retombe sur les voltairiens qui se font papistes par calcul. Messieurs, pensez-y bien, c'est une heure solennelle que l'heure où nous sommes ! L'honneur de la France est en jeu ! J'espère que vous maintiendrez toutes les garanties qui sont contenues dans la lettre du président en faveur du sentiment qui règne dans la nation. C'est sur vous que l'histoire et la postérité feront peser toute la responsabilité des graves résolutions qui vont être prises... Ce discours, de l'aveu même du président du conseil, fit une vive impression. C'était la première fois que la Montagne montrait quelque habileté de conduite : faire de la tactique au lieu de cette violence qui était dans ses habitudes, c'était un progrès[107] ; et puis, il était assez poignant d'entendre ce rude montagnard qui, la veille, signait l'accusation de Louis-Napoléon, se montrer si soucieux de son honneur, et laisser même entrevoir les mesures extrêmes auxquelles la majorité pourrait le contraindre ; la voie était tracée ; tous les orateurs qui succédèrent à M. Mathieu adoptèrent la même thèse[108]. Auparavant, un député de droite, M. Thuriot de la Rosière, répondit au nom de son parti et d'une thèse assez personnelle, banale par certains points, mais qui, par ses aveux, montrait plusieurs faces de la neutralité chez ceux qui avaient applaudi à la campagne de Rome. Ainsi, après avoir traité la question religieuse, il expliquait de suite, non sans une sorte de naïveté, que la question religieuse servait à la question sociale et la primait ; la papauté était une garantie contre le socialisme. Il n'y a jamais eu de république romaine à Rome, disait-il, il y a eu l'espérance, le rêve intéressé de la République italienne unitaire de M. Mazzini. Il y a eu encore autre chose... Il y avait à Rome la république sociale que vous aviez vaincue chez vous et qui s'était réfugiée là... La République sociale voulait donc faire sa métropole de Rome... Quel aurait été le pontife de la religion nouvelle ? Je n'en sais rien... Son discours visait, surtout, en effet, le socialisme, qui veut détruire les croyances, le socialisme, dont les bégaiements confus, contradictoires, ne soutiennent pas un moment le parallèle avec les efforts de la morale chrétienne... Le socialisme qui au XIVe siècle, avec Rienzi, préludait à Rome aux scènes de 1848, qui désolait Florence, que nous avons vu ravager l'Angleterre sous la conduite de Tylor et égorger les Francs sous le nom de Jacquerie, le socialisme qui, depuis le XVIe siècle, depuis Jean de Leyde jusqu'à nos journées néfastes de juin, en passant par Babœuf et ses trames criminelles, a tout abîmé, le socialisme qu'on peut suivre dans l'histoire à la trace des ruines dont il a jonché la terre dans tous les temps, le socialisme qui avait rêvé de s'emparer de Rome et de détrôner le christianisme qui, il y a dix-huit cent cinquante ans, s'en est pacifiquement ouvert les portes et les temples, l'Évangile à la main, qui était à la fois son premier et son dernier mot... La droite se dévoilait plus encore[109] quand, le lendemain, Cavaignac, ressentant une fois de plus le besoin de justifier la politique de son gouvernement[110], elle sursautait à ces simples paroles : Je ne parlerai pas ici de justifier la question politique ; j'écarterai même le sentiment, la question religieuse ; il s'agissait d'une réponse empressée à faire à un homme respectable qui s'annonçait disposé à réclamer le secours de la France... Un homme respectable ! s'écriait l'un des siens, c'est bien peu pour le chef de la catholicité ! Et la même indignation se manifestait encore après que Cavaignac eut repris : J'ai voulu dire que notre résolution, qui aurait pu être commandée par le sentiment politique et religieux, était simplement justifié par le simple sentiment d'humanité qui nous portait à répondre à une demande de secours qui nous était faite dans une circonstance aussi critique. La rumeur ne se contenait plus quand il ajoutait : Lorsqu'en Europe le principe des souverainetés populaires aura pris un développement suffisant pour donner une solution aux questions qui s'y traitent, bien certainement, la question de l'autorité temporelle du pape sera subordonnée à celle des souverainetés populaires. Il oubliait peut-être une partie de ce que ses premières concessions avaient permis, quand il avançait : Je dis purement et simplement, dans les termes où je l'ai pensé, dans le sens où je l'ai voté, qu'attaquer le gouvernement de la République romaine était contraire au principe de notre République. Le troisième parti, qui était de le défendre, était, à mon point de vue, aussi contraire, non plus à l'honneur ni au principe du gouvernement, mais à ses intérêts... La discussion dérivait ainsi vers le passé, tant la faute commise par la Constituante, achevée par la Législative, était visible, tant même ceux dont ce n'était pas l'intérêt semblaient attirés, en quelque sorte, en dépit d'eux-mêmes, vers ce point initial d'où venaient de si nombreuses difficultés. Le débat prenait d'ailleurs, et comme de lui-même, également, des proportions infinies, au point d'atteindre à la révision de la constitution. Cavaignac voyait un symptôme grave dans la critique qu'en faisait un homme comme Thiers, et il se demandait si une commission avait le droit de faire ce qui était interdit au Parlement : la question de la révision en elle-même lui paraissait d'ailleurs posée. La constitution a très sagement prévu le besoin de sa propre révision ; elle a sagement fait de la faire et ceux qui l'ont rédigée savaient comme vous ce qui arrive aux constitutions qui se prétendent immuables. Ainsi donc je reconnais que le fait d'une constitution qui pourvoit à sa propre révision est un fait parfaitement sage ; mais la constitution, en prévoyant la révision, a poussé la sagesse jusqu'au bout, et elle a dit dans quel temps et dans quelle forme elle peut être revisée. Eh bien, il est incontestable que l'Assemblée législative ne pourrait pas puiser dans la constitution le droit de sa révision actuelle, par conséquent il est incontestable qu'elle ne pouvait pas puiser le droit de sa discussion... Il rendait ensuite hommage à la lettre présidentielle[111], mais en entendant bien que le pouvoir demeurât dans les mains de la Législative : En ce qui tient aux affaires intérieures et peut-être plus encore en ce qui tient aux affaires extérieures, l'Assemblée législative a la direction suprême des intérêts de la République. Il savait bien cependant les possibilités du conflit et n'hésitait pas à dire au sujet de la lettre : Si, par malheur, les décisions de l'Assemblée ne lui étaient pas conformes et s'il en résultait quelque atteinte morale portée à l'autorité du pouvoir exécutif de la République, assurément dans ma pensée, ce n'est pas à lui que j'en rapporterais la faute... Il se résumait en déclarant que si des garanties plus sérieuses de liberté pour le peuple romain ne corrigeaient pas le Motu proprio, il ne voterait pas les crédits demandés. Thiers gardait le silence, et le président du conseil lui en voulait[112]. C'est alors que Victor Hugo prononça le fameux[113] discours par lequel il rompit presque définitivement avec le parti catholique[114]. Lui aussi cherchait le point initial, mais d'une autre façon que M. Thuriot de La Rozière. Selon lui, la Constituante avait voté l'expédition romaine, afin de faire contrepoids à la bataille de Novare, afin de mettre l'épée de la France là où allait tomber le sabre de l'Autriche. De belles phrases, sincères d'ailleurs, suivaient contre le gouvernement autrichien, aux acclamations de la gauche. Hugo tenait à établir que le vote de la Constituante avait été donné dans un but d'humanité, et s'il arrivait que réellement ce but ne se réalisât point, la pensée de l'expédition, protesterait contre le résultat de l'expédition. Or l'expédition avait dévié. Le pape a été restauré purement et simplement, il faut bien que je le dise. Le gouvernement clérical, que pour ma part je distingue profondément du gouvernement pontifical tel que les esprits élevés le comprennent et tel que Pie IX, un moment, avait semblé le comprendre, le gouvernement clérical a ressaisi Rome... A la lettre, il eût préféré un acte de gouvernement délibéré en conseil. Quant à la lettre elle-même, je l'aurais voulue plus mûrie et plus méditée. Elle demeurait, toutefois, un événement, parce qu'elle n'était autre chose qu'une traduction de l'opinion, parce qu'elle donnait une issue au sentiment national, parce qu'elle rendait à tout le monde le service de dire très haut ce que chacun pensait, parce que, enfin, même dans sa forme incomplète, elle contenait toute une politique. Elle donnait une base aux négociations pendantes.., elle traçait au pape auquel nous avons rendu le service, un peu trop grand peut-être, de le restaurer sans attendre l'acclamation de son peuple, le programme sérieux d'un gouvernement de liberté !... En face de cette lettre, le Motu proprio était inqualifiable. L'acte de la chancellerie romaine a deux faces, le côté politique, qui règle les questions de liberté, et ce que j'appellerai le côté charitable, le côté chrétien, qui règle la question de clémence. En fait de liberté politique, le Saint-Siège n'accorde rien. En fait de clémence, il accorde moins encore ; il octroie une proscription en masse, seulement il a la bonté de donner à cette proscription le nom d'amnistie. Voilà, Messieurs, la réponse faite par le gouvernement clérical à la lettre du président de la République. Et précisant le divorce : Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse pour atténuer la lettre du président, pour élargir le Motu proprio, un intervalle immense les sépare. L'un dit oui, l'autre dit non. Il est impossible de sortir du dilemme posé par la force : vous sanctionnez la lettre, vous réprouvez le Motu proprio et, inversement, vous avez devant vous, d'un côté, le président de la République réclamant la liberté du peuple romain au nom de la grande nation, qui depuis trois siècles répand la lumière à flots et la pensée sur le monde civilisé ; vous avez, de l'autre, le cardinal Antonelli refusant, au nom du gouvernement clérical. Choisissez ! Avec une modération pourtant visible dont personne ne lui tint compte, qu'aucun député de droite ou du centre ne parut remarquer, il disait encore : Réconcilier Rome avec la papauté, faire rentrer, avec l'adhésion populaire, la papauté dans Rome, rendre cette grande âme à ce grand corps, ce doit être là, désormais , dans l'état où les faits accomplis ont amené la question, l'œuvre de notre gouvernement... Pour cela, il faut que la papauté, de son côté, nous aide et s'aide elle-même... — Explosion de murmures à droite ; longue et violente interruption : Nous nions ce que vous dites... — Le poète résumait les torts de la papauté, ses lourdes fautes et s'écriait : Il faut que la papauté se garde de son pire ennemi ; or son pire ennemi, ce n'est pas l'esprit révolutionnaire, c'est l'esprit clérical. L'esprit révolutionnaire ne peut que la rudoyer, l'esprit clérical peut la tuer. — Voilà dans quel sens, selon moi, le gouvernement français doit influer sur les déterminations du gouvernement romain. Et comme ses adversaires le raillaient sur une ou deux phrases peut-être maladroites, il se reprenait vite pour jeter, par une de ces oppositions auxquelles il excellait : La force matérielle échoue et avorte en présence de la puissance spirituelle. Les bataillons ne peuvent rien contre les dogmes, je dis ceci pour un côté de l'assemblée, et j'ajoute pour l'autre côté qu'ils ne peuvent rien non plus contre les idées. Il y a deux chimères également absurdes, c'est l'oppression d'un pape et l'oppression d'un peuple... Il s'indignait qu'un pape, disposant de l'amour et de la foi, eût recours à la force brutale comme s'il n'était qu'un malheureux prince temporel. La droite, interrogée par lui sur la pression qu'elle exercerait au cas que le pontife rejetât nos conseils, répondit : Le pape fera ce qu'il voudra, nous ne le contraindrons pas. Illusionné sur la puissance de ses amis, le poète assurait : Eh bien, nous le contraindrons, nous ! Et s'il refuse l'amnistie, nous la lui imposerons. Nous ne devions pas entretenir une armée à Rome. Notre intérêt, sitôt que l'Autriche aura quitté Bologne, est de nous en aller de Rome, le plus tôt possible. Pour pouvoir quitter Rome, la première condition est de n'y pas laisser la révolution derrière nous, et afin de n'en pas laisser, il faut la terminer, tandis que nous y sommes encore. Comment terminer une révolution ? Je vous l'ai déjà dit une fois et je vous le répète, c'est en l'acceptant dans ce qu'elle a de vrai, en la satisfaisant dans ce qu'elle a de juste. Deux systèmes étaient encore en présence, un de concessions sages qui permettrait à la France de quitter Rome, un de compression qui la condamnerait à y demeurer. Ne voulant pas rompre tout à fait avec ceux qui avaient été jusqu'alors ses amis, en même temps, peut-être, que pour sauver l'honneur des députés fourvoyés au début dans cette aventure, il s'écriait : L'expédition de Rome, irréprochable à son point de départ, je crois l'avoir démontré, peut devenir coupable par le résultat. Vous n'avez qu'une manière de prouver que la Constitution n'est pas violée, c'est de maintenir la liberté du peuple romain. Il faisait appel à la nécessité de la liberté, la vraie, la liberté sérieuse, la liberté propre au XIXe siècle, la seule qui puisse dignement être garantie par ceux qui s'appellent le peuple français à ceux qui s'appellent le peuple romain, cette liberté qui grandit les peuples tombés, c'est-à-dire la liberté politique. Montalembert répondit et, de suite, sur un ton qui ne semblait pas prouver l'adresse ni l'exacte connaissance de la situation. Messieurs, s'écria-t-il, le discours que vous venez d'entendre a déjà reçu le châtiment qu'il mérite dans les applaudissements qui l'ont accueilli... Et, contraint à une amende honorable : Puisque le mot de châtiment vous blesse, Messieurs, je le retire et je lui substitue celui de récompense... Il renouvelait néanmoins l'insulte, avec une facilité d'autant plus gênante que Hugo était absent. Il prévoyait que le poète irait peut-être à Rome y chercher le repos et se repentir de son discours. L'éloge de la papauté qui suivait apparaissait encore plus exagéré par suite des circonstances présentes. Honneur à Pie IX, disait-il, honneur à ceux qui font des ingrats, mais malheur à l'ingratitude qui a trouvé un piédestal à cette tribune et contre laquelle je prosterne ma révérence envers le Souverain Pontife. Il évitait de traiter l'expédition même : La question romaine a trois faces, que les orateurs précédents ont peut-être trop mêlées. Je ne m'occuperai que de la dernière. Je crois que ce qui touche à la souveraineté temporelle du pape et à la conduite de l'expédition romaine est souverainement attaché par les votes de l'Assemblée qui ne peuvent être révisés que par l'histoire. Je ne m'occuperai que de rechercher quelles sont les libertés à accorder à Rome après y avoir fait rentrer le pape. Sur ce point, son discours, plutôt confus, laissait simplement saisir la volonté du pouvoir pontifical absolu ; tout ce que les catholiques consentaient devait être étroitement subordonné. La France n'avait pas été rétablir un souverain, ni un homme infiniment respectable, mais le pape, le Pontife, le chef spirituel des consciences ; si ce chef se laissait prendre, d'ailleurs, à quelques acclamations hypocrites, s'il accordait certaines libertés, ses véritables fidèles lui retireraient leur confiance. Il faut bien, après tout, puisqu'on lui recommande tant de tenir compte de l'opinion publique, qu'il compte pour quelque chose celle des catholiques. Par un examen qui montrait, lui aussi, comme tout se tient en Europe, il revenait à l'examen parallèle de la France et de Rome, touchait le point central du procès politique qui s'effectuait à cette heure dans chaque gouvernement : Si, comme je le crois, il est établi que le suffrage délibératif accordé à la Consulte est identique avec le gouvernement parlementaire, je dis que le Souverain Pontife et ceux qui défendent sa politique ont le droit d'opposer à la création, ou plutôt, au rétablissement du pouvoir parlementaire de l'État romain, différents ordres d'objection que je vais rapidement parcourir devant vous. Ils ont d'abord le droit d'examiner quels sont ceux qui demandent ces institutions parlementaires, ce qu'on appelait tout à l'heure la monarchie représentative. Or il y a deux espèces d'hommes qui demandent ces institutions ; les premiers sont ceux qui les ont détruites en France, ce sont ceux qui s'appellent les républicains de la veille. Comment peuvent-ils demander en Italie des institutions qu'ils ont détruites en France ? Savez-vous pourquoi ils le font ? J'en trouve l'explication dans un passage du journal le National, qui porte la date du 12 septembre 1849, la même date que le Motu proprio : Quoi que fasse Pie IX, le peuple romain n'acceptera pas franchement les libertés nouvelles qui lui seront données ; il ne s'en servira que pour renverser le prince qui aura cru pouvoir les lui accorder et pour le débarrasser de son autorité. — Je trouve les hommes qui parlent ce langage très logiques. Je ne dirai même pas qu'ils sont incompétents dans la matière ; au contraire, je les trouve compétents. Seulement je trouve que leur opinion prouve contre eux, qu'ils parlent pour vous, qu'ils parlent contre, et qu'il faudrait que le pape et ses conseillers fussent bien aveugles pour ne pas être éclairés par des aveux aussi francs et aussi logiques. Voilà la première classe de ceux qui demandent le gouvernement représentatif en Italie. Maintenant il y en a une autre, et ceux-là sortent de la nombreuse classe d'hommes qui ont non pas renversé le gouvernement parlementaire en France, mais qui l'ont au contraire aimé, servi, pratiqué. Je suis de ce nombre. J'ai aimé beaucoup ce gouvernement représentatif ; j'ai fait plus que l'aimer, beaucoup plus, j'y ai cru. J'ai cru de bonne foi, et même si vous voulez que je l'avoue, j'y crois encore. (Rires, murmures, etc.)... Je crois qu'en théorie, et vu l'imperfection humaine, c'est le meilleur des gouvernements. (Murmures.) Permettez : vous m'avez enseigné une pratique toute différente de la théorie, et après avoir vu que ce gouvernement, conduit, dirigé, comme il l'était de part et d'autre, dans le pouvoir et dans l'opposition, par les hommes éminents que je vois devant moi, MM. O. Barrot, Thiers, Dufaure, Molé et tant d'autres, après avoir vu que ce gouvernement ainsi conduit, ainsi dirigé avec toutes les conditions possibles de prospérité, de succès et de durée, a fini comme vous l'avez vu, par une surprise qui l'a renversé net, de fond en comble, en un jour (vives réclamations à gauche, agitation)... je dis qu'après avoir vu se terminer ainsi ce grand et puissant gouvernement constitutionnel en France par une... — vous ne voulez pas que je l'appelle une surprise — une révolution, qui l'a renversé, je suis bien obligé de me dire à moi-même que là n'est pas le remède suprême en fait de politique, et je conçois, par conséquent, que le pape, ou tout autre souverain à qui j'aurais été tenté, moi-même en 1846, ou 1847, de conseiller le gouvernement représentatif, nous dise : Avant de le conseiller aux autres, vous auriez bien dû réussir à le garder vous-mêmes. Il assurait que Pie IX n'avait pas changé, mais que, tout en demeurant, comme au début, le pape libéral, il avait été éclairé par les événements. Et, du reste, s'il avait changé, ce que je ne crois pas, est-ce qu'il serait par hasard le seul qui ait changé en Europe, en France et partout ailleurs ? On a parlé hier de l'apostasie du parti libéral. Eh bien, Messieurs, que s'est-il passé dans le monde depuis quelques années ? Croyez-vous qu'en effet les hommes de sens, de cœur, de conscience y aiment, y adorent la liberté ou croient en elle, croient à la marche ascendante du genre humain, au progrès indéfini de la civilisation et des institutions, comme ils le faisaient il y a deux ou trois ans ? Croyez-vous qu'en France, en Europe, partout, les consciences, les cœurs, les intelligences les plus hardies, n'aient pas été ébranlées ? Croyez-vous qu'une lumière sanglante ne s'est pas levée dans bien des intelligences et bien des consciences ? Et si vous doutez de notre compétence, de notre impartialité à nous, hommes politiques, parlementaires usés et dégoûtés par les fatigues de la vie politique, eh bien, alors, je vous dirai : — Allez sonder les profondeurs des nations, allez auprès de n'importe quel foyer modeste interroger des patriotes obscurs, mais généreux et intelligents, allez demander aux hommes qui ne sont jamais mêlés aux affaires, qui sont toujours restés loin du bruit, de l'agitation, des dégoûts de la vie politique, frappez à la porte de leur cœur, sondez leur conscience et demandez-leur s'ils aiment le progrès et la liberté du même amour qu'ils l'aimaient autrefois, ou bien si, en l'aimant toujours, ils y croient avec la même foi, avec la même confiance ! Vous n'en trouverez pas un sur cent, pas un sur mille ! Montalembert reprochait aux républicains de gauche, aux démagogues d'être la cause de cette retraite de la foi dans la liberté ; en conspirant contre la nature humaine ils avaient tout bouleversé, tout détruit. Eux seuls étaient la cause de tout le mal. Vous avez détrôné quelques rois, c'est vrai, mais vous avez détrôné bien plus sûrement la liberté. L'éloge de Pie IX recommençait, suivi de la phrase demeurée fameuse : L'Eglise n'est pas une femme ; elle est bien plus qu'une femme : c'est une mère ; c'est la mère de l'Europe, c'est la mère du progrès. Toute lutte contre elle est fatale à qui l'entreprend, tôt ou tard. L'ennemi qui se mesure à elle tombe anéanti par le malheur ou frappé par la réprobation universelle... Vous vous efforceriez en vain de vaincre cette faiblesse, vous n'en viendriez pas à bout. C'est que l'Église a des ressources infinies. (Rires à gauche.) Engagez-vous avec elle en une lutte sérieuse et vous ne rirez pas longtemps ! Elle se connaît mal en attaque ; mais pour la défense elle est inimitable. C'est une forteresse que l'on peut attaquer, mais on ne la prend pas. — Une voix à gauche : Elle n'existe plus ! A droite : A l'ordre ! — L'Église a un vieux texte : Non possumus, pris dans son vieux livre les Actes des Apôtres, emprunté à un vieux pape, saint Pierre. Eh bien, avec ce mot, elle vous conduit jusqu'à la fin des siècles et elle triomphera de vous. M. Victor Hugo a proclamé le traité des idées, moi je proclame le traité des dogmes ; les idées sont variables, et les dogmes sont immuables. Les idées, selon moi, passent parce qu'elles sont fabriquées ou par vous ou par moi ; on connaît leur valeur. Les dogmes, au contraire, ont une origine mystérieuse ; ils règnent sur la conscience et vous ne régnez que sur les esprits. Indiquez-moi une idée qui règne depuis dix-huit siècles et sur cent millions de consciences. Le drapeau français n'avait jamais ombragé de ses plis une plus noble entreprise. L'histoire le dira. J'invoque avec confiance son témoignage et son jugement... L'histoire dira, mille ans après Charlemagne et cinquante ans après Napoléon, mille ans après que Charlemagne eut conquis une gloire immortelle en rétablissant le pouvoir pontifical et cinquante ans après que Napoléon, au comble de sa puissance et de son prestige, eut échoué en essayant de défaire l'œuvre de son immortel prédécesseur, l'histoire dira que la France est restée fidèle à ses traditions... Le président du conseil se félicitait peu de ce discours qui, par sa glorification de la cour de Rome et du Motu proprio, avait plutôt aggravé qu'atténué les difficultés de la situation[115]. Il lui fallait inter1venir dans le débat ; tous l'attendaient, et le silence s'affirma quand il fut à la tribune. Comment s'y prendrait-il afin de satisfaire à la fois le président de la République et la majorité ? Comment forcerait-il l'impasse où le ministère semblait acculé ? — Il commença par préciser la portée du vote que l'Assemblée allait rendre, vote égal à un jugement qui avait besoin d'être dégagé de toute équivoque, l'équivoque ne pouvant ici rien résoudre ni fortifier. Le ministère sollicitait une adhésion consciencieuse, sincère, et, afin de l'obtenir, il venait à son tour, après que toutes les fractions du Parlement avaient montré leur manière de voir, attentif à serrer la question de plus près. Il racontait donc, lui aussi, l'affaire de Rome, à sa manière. Il laissait percer, fort timide et déférent, à peine nuancé, le regret que le Saint-Père n'eût pas montré plus de confiance, ce qui eût permis à la France de s'entendre davantage avec lui. — Le récit de cette période l'amenait à la lettre du président : Je le dis à regret, au lieu du Saint-Père, ce sont des cardinaux délégués qui sont venus prendre possession du pouvoir ; leurs premiers actes ont alarmé nos agents diplomatiques..., ont jeté un trouble profond dans les esprits. C'est une déviation à la direction que nous nous étions efforcés de donner aux résultats de l'expédition, un démenti aux espérances qu'on nous avait fait concevoir. A ce moment, le président a fait ce qu'il avait déjà fait dans une autre circonstance ; il a fait entendre le cri de la conscience française. A côté des influences qui s'efforçaient de compromettre la France dans une politique de réaction qu'elle répudie, il a placé l'influence de sa parole loyale et généreuse. Que ceux qui le lui reprochent, lui reprochent aussi cet élan de son cœur et de son âme alors que, s'adressant à nos soldats découragés par un ordre du jour équivoque, il a relevé leur courage, déclaré qu'il ne les abandonnerait pas... Il n'a pas craint alors d'attirer sur lui des violences qui se sont même traduites en une proposition de mise en accusation. Eh bien, c'est cette même conscience qui s'est soulevée aujourd'hui à la pensée de faire servir notre armée à satisfaire des vengeances politiques et à restaurer de vieux abus. De même que le président avait protesté alors dans l'intérêt de l'honneur de nos armes, il proteste aujourd'hui pour l'honneur de notre diplomatie ; il s'est montré conséquent dans les deux circonstances, il a été lui-même... Je me laisse aller à parler de cet acte dans ces termes, et j'oublie qu'il n'était, après tout, que le traducteur fidèle de nos propres dépêches, qu'il ne contient rien qui ne fût déjà, et depuis longtemps, consigné dans ces dépêches... Il était moins heureux, malgré son habileté en s'efforçant de démontrer que le Motu proprio et la lettre à Edgar Ney ne s'opposaient pas. Nous prenons le Motu proprio et la lettre tout à la fois, la lettre comme expression du but que nous voulons atteindre, le Motu proprio comme une concession déjà acquise, comme un premier pas vers ce but... Il essayait d'esquisser la difficulté de notre action à Rome et la déclarait simple en rejetant la complication sur ceux qui avaient intérêt à la faire naître afin d'en voir sortir deux choses énormes : la première que le président de la République et la majorité de cette Assemblée se trouveraient en conflit, la deuxième que la majorité elle-même se scinderait et s'affaiblirait... On a spéculé sur ces deux grands malheurs ; mais, Dieu merci, la majorité saura déjouer cette funeste spéculation. Il prenait une à une chacune des réformes demandées par la France et prouvait que, loin de gêner le pouvoir temporel du pape, elles le fortifiaient. Le recul était tel depuis février 48 que cet aveu si complet ne suffisait pas. Le ministre s'excusait : de se trouver en désaccord, non pas avec les conclusions, mais avec les développements ou, plutôt, les considérations de M. de Montalembert. Il ne voyait pas la liberté atteinte ; il continuait de lui donner sa confiance, se persuadant, non sans quelque facilité, que Montalembert continuerait à être le défenseur de la liberté. Le danger véritable venait de l'école absolue qui semblait dire : Il n'y a pas de milieu entre le pouvoir du Saint-Père et la République. La politique du ministère était celle de la sagesse ; il ne demandait, pour le peuple romain, que la liberté appropriée à ses mœurs, à son idée, à son état de civilisation. Et revenant au désaccord avec Montalembert : On peut très bien différer sur cette mesure de liberté que comportent les mœurs et l'état de civilisation d'un pays ; c'est précisément sur ce point que nous sommes en dissentiment avec la cour pontificale et que je me trouve personnellement en désaccord avec M. de Montalembert. Cet éminent orateur a fait à l'établissement du gouvernement représentatif deux objections qui se sont trouvées identiquement celles que nous avons rencontrées au sein de la conférence de Gaëte. Nos agents auraient, en dépit des paroles de Montalembert, trouvé appui auprès du pontife et même des cardinaux au sujet du gouvernement représentatif ; mais les explications fournies à ce sujet étaient si lamentables, mises en face des faits, que dans tout autre parlement, même composé de la même manière, mais assez conscient de ses devoirs pour faire passer l'intérêt national avant l'intérêt politique, la majorité eût été en droit de demander au président du conseil de se taire. — Barrot ne croyait pas seulement le gouvernement parlementaire possible à Rome, il l'y estimait utile. J'inclinerais à penser que s'il y a un gouvernement au monde auquel conviennent les institutions du gouvernement parlementaire, qui ont pour but et pour effet de placer le chef de l'État au-dessus, en dehors de tout contact avec les passions et les intérêts qui agitent les partis, c'est celui du Saint-Siège. Si de pareilles institutions n'avaient pas existé, peut-être faudrait-il les inventer pour ce pouvoir temporel des papes qu'il importe tant de ménager et de maintenir dans une sphère où les vicissitudes terrestres ne puissent l'atteindre. Comme pour demander pardon de la lettre à Edgar Ney, tout en y parvenant d'une manière détournée, d'abord, qui donnait le change : Quant à nous, je le déclare sans craindre un démenti, je le déclare au nom du président de la République comme au nom du ministère, il n'est jamais entré dans notre pensée de faire violence au Saint-Père... Le fils de Jérôme demanda : Et la lettre du président ? Barrot répondit : A ceux qui prétendaient faire ressortir de la lettre de M. le président de la République la menace ou la contrainte, je suis autorisé à donner un éclatant démenti... Il concluait d'une façon si surprenante que sa bonne foi elle-même semblait être mise en cause par lui ; Dans les discours prononcés par l'opposition, je n'ai pas pu en découvrir un seul qui fût acceptable par une Assemblée qui se respecte... — La gauche cria : La lettre ! La lettre ! Les cris, sans le savoir, étaient différents ; les uns indiquaient la lettre à Edgar Ney ; les autres, renseignés, réclamaient la lettre directe du président de la République au président du conseil. Estimant le danger conjuré à la suite des explications précédentes, Barrot s'apprêtait à donner lecture de la lettre adressée par le prince à l'Assemblée, lorsque dès les premiers mots : Monsieur le ministre, la question romaine devant être de nouveau discutée... il fut interrompu : Non ! Non ! ce n'est pas celle-là ! la lettre du président ! La droite s'opposait de son côté à toute lecture de documents communiqués d'une façon irrégulière à l'Assemblée. Barrot utilisa cette confusion. Il s'arrêta ; puis, la gauche réclamant toujours la lettre, le président de l'Assemblée fit observer qu'il n'y avait qu'à la lire dans les journaux. L'opposition était battue[116]. Le président de la République n'avait pas, de son côté, la satisfaction qu'il recherchait et que son ministre ne voulait pas lui fournir ; il désira du moins lui donner celle d'avoir raison sur le fond des choses et il renouvela ses longues explications, tout en avouant que la papauté avait besoin d'appui dans ses rapports avec les nations. Sa puissance spirituelle ne suffisait pas à la protéger contre les conditions vicieuses de son gouvernement. Le droit, disait-il d'une façon qui enchantait la droite, que nous avons exercé pour maintenir l'indépendance de la papauté contre une démagogie qui avait mis la main sur la tiare, en quelque sorte, dérive de la même source où nous puisons celui de représenter au Saint-Père l'absolue nécessité de placer son pouvoir temporel dans des conditions telles que nous ne soyons pas obligés de tenir soit nous, soit toute autre puissance, garnison permanente auprès du Saint-Siège. Il disait aussi interminablement : Permettez-moi de sortir de la réserve imposée au ministère et d'épancher librement mon âme... Est-il donc fatalement nécessaire, pour que la papauté soit indépendante et pour que cette indépendance soit réelle, sérieuse, qu'il y ait une nation de trois millions d'hommes qui soit vouée éternellement à une situation qui répugne à tout ce qui porte un cœur d'homme ? ... Est-il nécessaire, par exemple, que cette nation soit éternellement jugée par des tribunaux qui, par leur caractère clérical, soient invinciblement amenés à confondre le crime et le péché ?... Est-il nécessaire que la justice continue à défendre dans les jugements terrestres ce qui ne relève que de Dieu et ce qui appartient au domaine de la justice des hommes ?... Non, mille fois non, et j'en atteste les déclarations du Saint-Père lui-même. Nous connaissons déjà par les dépêches de M. de Rayneval ses promesses ; en voici une autre qui parle spécialement du Code Napoléon. Elle est du 31 juillet : Le Saint-Père m'a promis de porter toute son attention sur mon résumé : Vous autres, Français, a-t-il ajouté, vous êtes toujours pressés ; vous voulez aller trop vite. (Rires sur tous les bancs.) Il n'est pas défendu d'être pape et homme d'esprit tout à la fois... Nous autres Romains, nous prenons notre temps ; parfois, nous en prenons beaucoup, je l'avoue, mais il ne faut pas que cela vous effraye... Maintenant direz-vous que l'expédition française a été sans résultat sur les États romains ? Ces pauvretés satisfaisaient la Législative, au point que le ministère, repoussant tout amendement, désireux d'obtenir un vote sans réserve, recueillait une forte majorité, 470 voix contre 165[117]. Barrot n'était pas, cependant, sans comprendre que, loin de satisfaire le président de la République, ce succès contrariait ses secrètes pensées[118] et même qu'en paraissant consolider le ministère, il était peut-être précisément la cause réelle et décisive de sa chute[119]. D'après lui, en voulant assurer aux Romains le gouvernement libre, le prince-président cherchait surtout à se poser en face du pays et à compromettre la majorité parlementaire. La suite semblerait donner raison à cette manière de voir, car Louis Bonaparte abandonna, sur le terrain romain, les négociations de ce ministère une fois que le second, dans lequel il était plus libre, fut constitué. En résumé, Rome achevait d'avoir gain de cause. La question tranchée en Italie, à son entier avantage, par nous-mêmes, prenait une consécration nouvelle du fait que notre Parlement venait de la ratifier. La victoire était si forte que, douze ans après, un narrateur ultramontain devait s'en servir encore en la racontant pour ameuter les catholiques contre le pouvoir et préparer une partie de sa chute. Telle fut la discussion du mois d'octobre 1849, restée célèbre parmi celles qui ont illustré la tribune nationale. La question romaine, déjà résolue à Rome par nos armes, y fut examinée sur toutes ses faces, française, catholique, européenne. Toutes les objections furent produites, toutes les raisons furent données ; l'écrasante supériorité du nombre vint consacrer cette fois la supériorité de la raison et du talent. MM. Thiers et de Montalembert furent les deux vainqueurs de ce brillant tournoi. Si éloignés l'un de l'autre au point de départ, l'homme d'État libéral et l'orateur catholique se rencontraient dans la même conclusion. La politique pure et le sentiment religieux reconnurent également que la France avait dû son appui au pape, qui le lui demandait, et que toute prétention de notre part à restreindre l'indépendance reconquise du Saint-Siège était nulle en droit et déraisonnable en fait. Par le vote mémorable du 20 octobre, l'Assemblée remettait de nouveau à Pie IX les clefs de sa capitale, qu'on avait eu l'air de vouloir lui reprendre[120], et lui disait : Saint-Père, la France vous rappelle à Rome, non en protégé, mais en souverain[121]. Falloux pouvait se retirer tranquille afin de veiller à sa santé, insuffisamment rétablie par un séjour à la campagne. Après son passage à Néry, il avait été transporté au château de Stors, près de l'Isle-Adam, chez le duc de Valmy. Ses amis venaient le voir, cherchant à le détourner de sa résolution, parce qu'ils prévoyaient que son départ entraînerait une crise ministérielle. Tocqueville le renseignait. Molé se faisait l'interprète de Thiers qui lui demandait de retenir le plus possible encore l'envoi de sa démission. Soyez sûr, disait-il dans une lettre où il exprimait un mélange de crainte et de satisfaction, soyez sûr que nous devons nous tenir pour satisfaits du dénouement, mais les esprits sont inquiets. On se sent entraîné vers un avenir aussi obscur que redoutable. Si Dieu ne s'en mêle, je ne sais où nous irons. Falloux dut sourire. Les événements désormais suivaient une pente prévue. L'œuvre avait réussi. Il était rentré au ministère pour la restauration du pape, — qui était faite, — et pour la liberté de l'enseignement — qui se trouvait à l'étude dans une commission qui donnait toutes les garanties désirables[122]. Les résumant et les joignant à celles qui naissaient sans arrêt de l'affaire romaine, il dit sa tranquillité : La commission était composée de MM. Thiers, Montalembert, Fresneau, Armand de Melun, Janvier, l'évêque de Langres, l'abbé de l'Espinay, Baze, Beugnot, Sauvaire, Barthélemy Saint-Hilaire, Barthélemy, de Fougeray, Salmon, Coquerel et Roucher. L'étude de la loi par une telle commission, c'était la certitude de son adoption par l'Assemblée, car toutes les fractions de la majorité y comptaient des représentants éminents. Les catholiques qui, dans la Chambre des Pairs, avaient acquis le plus d'expérience et déployé le plus de lumières, MM. de Montalembert, Sauvaire, Barthélemy, Beugnot étaient là pour échanger avec leurs nouveaux collègues les fruits d'une si longue lutte. M. Coquerel, pasteur protestant, marchait d'accord avec l'évêque de Langres et M. Barthélemy Saint-Hilaire, qui n'avait cessé de me combattre, se trouvait en face de son ami M. Thiers, envers qui il ne perdait jamais l'attitude de la déférence. Toutes les résolutions, sauf quelques-unes, furent prises à la presque unanimité. M. Thiers était, pour ainsi dire, président de droite et, chose plus significative encore, M. Beugnot fut élu rapporteur[123]. — Ce fut de Stors que Falloux informa Persigny, venu le voir en ami, de sa décision formelle ; il adressa, d'autre part, sa démission au président dès qu'il eut pris connaissance du vote parlementaire sur le Motu proprio. Il suivait de près sa lettre à Paris quand il reçut de Louis Bonaparte une réponse anticipée qui s'était croisée avec son message : Elysée national, 24 octobre 1849. Mon cher Monsieur de Falloux, j'ai appris avec un véritable chagrin que votre santé est toujours chancelante et qu'il vous fallait un repos absolu de corps et d'esprit pour vous remettre complètement. Persigny m'a donné, en effet, des détails sur votre état et sur les dispositions de votre esprit qui m'engagent à vous conseiller de quitter momentanément les affaires. D'un autre côté, l'intérim de l'instruction publique ne peut guère se prolonger davantage, de sorte qu'il y a nécessité à ce que vous preniez un parti. Vous devez comprendre combien il m'en coûte de me séparer d'un homme qui a donné tant de preuves de son dévouement au pays, et j'espère qu'en dehors du ministère vous me conserverez toujours le même attachement... Falloux vit Tocqueville, par lequel il pensait apprendre la composition du nouveau ministère. Il fut surpris que son récent collègue ne se doutât de rien. M. Barrot et M. Dufaure, lui demanda-t-il, sont-ils bien sûrs du président par rapport à eux-mêmes ? Et comme Tocqueville s'étonnait : Je veux vous rappeler, mon ami, ce que nous avons cent fois constaté ensemble, c'est-à-dire que le président regarde M. Barrot comme un pur métaphysicien parlementaire, sans coup d'œil, sans vue pratique, et qu'il se contient à grand'peine vis-à-vis de M. Dufaure qui, sans s'en douter, ne perd jamais l'occasion de lui être désagréable. Je n'ai reçu aucune confidence, croyez-le bien, et je ne parle que d'après mes observations personnelles, mais je serai surpris autant que charmé si la modification ministérielle s'arrête à moi. Il ajouta : Je n'ai pas pris congé du président et je vais le faire tout à l'heure. L'interroger n'est pas le meilleur moyen de savoir sa pensée, mais je vous promets que s'il me la découvre, je vous en ferai part immédiatement. A l'Elysée, le président qui allait monter à cheval le reçut debout, s'excusa et lui dit : Je veux vous remercier chez vous et voir Mme de Falloux. J'irai vous retrouver tous les deux au retour de ma promenade. Je veux causer avec vous de la situation. Louis-Napoléon ne vint pas. Le lendemain, Falloux partait pour le Midi et, à trente ans de distance, il se rappelait encore, avec une sensation délicieuse, le trajet de Marseille à Nice. Monté sur le siège de la voiture il respirait l'air du paysage et de la mer, se livrait au soleil de Provence, s'abandonnait au frisson lent des pins qui environnent Fréjus ; il revoyait la descente de l'Estérel où il rencontra lord Brougham ; il lui semblait respirer l'odeur incertaine des orangers qui, parmi les aloès, annoncent l'Italie[124]. — N'éprouvait-il pas aussi à nouveau le plaisir perfide d'avoir utilisé son ministère puis de l'avoir perdu, la besogne catholique une fois terminée, par sa retraite ? Les bases de la loi qui devaient porter son nom étaient déjà solidement assises, grâce à la complicité de Thiers[125]. Il pouvait être de plus en plus tranquille. |