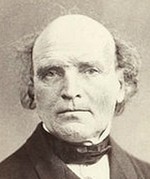LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
ET LE MINISTÈRE ODILON BARROT
VI. — L'ASSEMBLÉE. - L'EUROPE. - LE PRINCE-PRÉSIDENT.
Les députés, les magistrats, et le droit de justice politique. — Parti pris de tous et de tous les partis de l'Assemblée. — Le ministère et l'Assemblée font le jeu du prince-président. — Confession publique de Montalembert. — Réponse de Jules Favre. — Discours théorique et doctrinaire de Barrot. — Lassitude et décadence parlementaire. — Encore la question romaine. — Condamnation de Lesseps au Conseil d'État. — Discours du représentant Mauguin sur la politique française et européenne. — Il est trop tard pour que la France revendique la cause des peuples. — La Prusse et la France. — Origines de 1870. — La politique conservatrice anti-française. — Les prémices de l'unité germanique. — Le rôle de la France. — Les guerres du second Empire se trouvent posées. — Le budget. — Pian de réformes. — Le prince et le ministère. — L'Assemblée. — Inquiétudes en face des éventualités de coup d'État. — Vive la République ! — Le prince-président et la République. — Psychologie de Louis-Napoléon. — Continuation du tour de France politique. — Vive l'Empereur !Les contradictions fatales parmi lesquelles se débattait l'Assemblée faisaient déjà paraître ses embarras comme inextricables. On l'avait éprouvé dès le début, au sujet de la protection que toute réunion souveraine doit à ses membres et du droit disciplinaire qu'il lui faut exercer sur eux. Du point de vue théorique, il n'est pas très difficile, encore que le sujet ait souvent embarrassé les Chambres françaises, de décréter qu'au delà d'une certaine mesure, non délimitée exactement, les Assemblées ne peuvent se servir du pouvoir qui leur permet de s'interposer entre leurs membres accusés et la justice nationale appelée à les juger. Elles ne peuvent se substituer à la justice régulière afin de placer un de leurs membres au-dessus des lois pénales qui atteignent les autres citoyens. D'autre part, si la Chambre était, dans sa majorité, opposée à des députés fautifs, au point de vue légal, au nom d'une légalité supérieure, il était certain qu'elle abuserait du droit de rester neutre afin de mieux perdre ses collègues désarmés. Barrot, quant à lui, avait essayé d'obtenir que les Assemblées aient le pouvoir de faire apprécier le caractère de la poursuite ainsi que de décider si celle-ci est dirigée contre le représentant à raison de ses opinions ou contre l'individu à raison de ses actes, prérogative qui côtoyait de bien près les fonctions du juge et proposait un chemin singulièrement facile à l'arbitraire du Parlement ; c'était même demander l'impossible par suite de la violence où aboutissaient les passions politiques et du fait que l'impartialité parlementaire était requise aussitôt après une lutte livrée dans son sein. Le président du Conseil vantait les défauts de la thèse et la défense qu'il présente à son sujet ne paraît pas lui donner raison : Plus l'Assemblée se rapproche des fonctions du juge, plus il faut qu'elle se rappelle que son investigation doit être toute politique et non judiciaire, et que même pour ne pas jeter le trouble dans les occupations ultérieures de la justice, il importe que la vérification parlementaire à laquelle elle est forcée de se livrer soit, autant que possible, secrète et très réservée. C'est pourquoi, en pareille matière, les membres de la commission qui prennent connaissance des pièces et qui entendent le prévenu sont investis, par la force des choses, d'une sorte de délégation forcée, bien que non écrite dans les règlements. Que si l'Assemblée, après cette investigation, reconnaît que la poursuite a un caractère purement judiciaire, elle ne pourrait se permettre, par des considérations politiques, d'affranchir un de ses membres de la responsabilité qu'il a encourue sans usurper un droit plus exorbitant encore que celui de faire grâce, car ce serait celui d'abolir une procédure régulière, droit que les jurisconsultes contestent même à la monarchie absolue[1]. Barrot redoutait que l'Assemblée, dans la répression n'usurpât ses droits. Pourtant la même crainte était autorisée à l'égard de la magistrature ; elle existait, et si l'on y joint les réflexions suggérées par le déchaînement du pays contre le système parlementaire, on comprend ce qui poussa petit à petit à vouloir réserver au Parlement des prérogatives plus étendues ; on agissait en prévision de l'avenir. La question étant politique avant tout, certains redoutaient encore que, dans le cas présent même, la magistrature ne fût incompétente. Il ne semble pas qu'ils aient eu tort, et Barrot, d'autre part, combattait avec justice leurs prétentions exagérées[2]. Les uns et les autres se débattaient sous les mailles d'un filet auquel, dès maintenant, ils ne pouvaient pas donner eux-mêmes le coup de ciseau libérateur. D'autres montagnards, parmi lesquels Emile Barrault, Bac, Grévy, pensaient plus adroit de plaider la cause de leurs amis en faisant simplement appel à la générosité de leurs vainqueurs ; mauvaise manœuvre, ceux-ci n'ayant aucun sentiment d'humanité et répondant par de beaux discours sur la nécessité du châtiment. L'étendue du pouvoir disciplinaire de l'Assemblée sur ses membres n'était pas une question moins délicate ; au strict point de vue politique, elle l'était même plus encore, et également insoluble : il s'agissait de savoir dans quelle mesure il convenait d'armer les majorités contre les minorités, et la majorité se trouvant déjà très forte par sa majorité même, cette mesure était extrêmement difficile à définir. En outre, il fallait ne pas gêner la liberté du contrôle et de discussion des minorités ; il était non moins nécessaire de ne pas rendre le fonctionnement du gouvernement représentatif impossible en fournissant à la minorité les moyens d'abuser de son droit de parole ou d'abstention. Ce qui se passait tous les jours dans nos séances rendait de plus en plus urgente la solution de cette dernière question ; et. ceux des membres de l'extrême gauche qui s'opposaient à ce qu'on armât le président de moyens disciplinaires un peu énergiques, sous prétexte que la bonne éducation et le respect de soi-même étaient de suffisantes garanties pour la régularité et la décence des discussions, ne parlaient pas sérieusement et recevaient de leurs collègues des démentis éclatants à chaque instant. L'Assemblée, en s'arrêtant, pour les cas les plus graves, à la censure et à une simple exclusion pour cinq jours de l'Assemblée avec privation d'une partie du traitement, se montra plutôt timide qu'exagérée. Le Parlement anglais est bien autrement assuré vis-à-vis de ses membres turbulents[3]. — Le véritable désir du Parlement consistait à liquider ce qui subsistait de la Montagne, et toutes les considérations qui ne tendaient pas à ce but lui paraissaient momentanément secondaires. La gauche aidait à cette exclusion par son désaccord fatal et absolu ; aucun rapprochement ne pouvait être effectué ; quelques-uns paraissaient le conseiller, peu sincèrement ; le ministère seul, à l'exception de Falloux, y avait intérêt ; et, d'ailleurs, même sur ce terrain ministériel, comment arriver à une trêve entre la Montagne et Dufaure, entre Leroux et Cavaignac ? Beaucoup de naïveté ou d'hypocrisie était nécessaire pour s'étonner de ce désaccord ou, même, le déplorer. Ce sont encore les Mémoires de Barrot qui montrent l'incompréhension comme le mauvais point de vue doctrinaire de ceux qui détenaient alors les moyens de la République. Aucune comparaison n'est possible avec Tocqueville, mais en réunissant quelques-unes des citations que nous en avons extraites au chapitre précédent et ce passage du président du conseil, le lecteur se trouvera naturellement conduit à se demander si le manque de pénétration qui a égaré les diverses manières de voir ne vient pas, quoique différemment, répétons-le, d'une sorte d'identique arrêt dans le raisonnement et le sentiment, dans l'instinct et dans la conscience ; les pensées justes sont détournées, diminuées, faussées, même, au point de se transformer en erreurs, souvent, par suite d'incompétence comme de rapide contentement personnel. Ainsi, pas un instant dans cet acte d'accusation, de même qu'au long de ses Mémoires, Barrot n'a cru qu'il pouvait avoir, lui aussi, sa part de responsabilité dans ce qui permit le coup d'Etat : Ce fut un triste spectacle, mais aussi un grand enseignement pour la France, de voir ces hommes élevés, contre toute attente, à la dignité de représentants de leur pays, au lieu de se sentir saisis d'un profond respect en venant prendre leur place dans cette Assemblée où se réunissait l'élite de la France et d'y garder, comme dans un sanctuaire, une attitude respectueuse et digne, n'y porter au contraire que des passions grossières dont ils auraient rougi même dans les habitudes de leur vie ordinaire et dans leurs rapports avec leurs camarades. Il est vrai qu'on leur avait dit et répété que la révolution de 1848 s'était faite par eux et pour eux, que la révolution était leur conquête et qu'elle leur appartenait par le droit de la force, qu'ils éprouvaient une sorte de délire à la seule pensée qu'ils venaient d'être les maîtres de cette société qu'ils tenaient naguère sous leurs pieds. Leurs recours à la force, leurs insurrections pour ressaisir le pouvoir n'était à leurs yeux qu'une revendication légitime de leur droit : ils ne pouvaient consentir à être minorité et de simples opposants là où ils étaient naguère dominateurs incontestés. Non seulement ils déniaient à la majorité ses droits, mais ils la mettaient hors la loi comme usurpatrice, puis, quand ils avaient été vaincus et pris les armes à la main, ils s'étonnaient qu'on leur demandât compte de leur crime ; et le prince montagnard Jérôme-Napoléon criait : A la proscription ! quand la justice faisait son devoir[4]. Le procès de Bourges avait prouvé de quelle façon elle l'entendait ; celui de Versailles le montrerait aussi. Les autres allégations s'expliquaient et tombaient d'elles-mêmes. — Barrot disait encore : Chez eux, les passions de l'orgueil se combinaient avec l'absence d'éducation ; c'est là ce qui explique le triste phénomène auquel il nous a été donné d'assister[5]. L'orgueil ne fut pas le défaut de tous ; n'est-il pas aussi le dernier refuge de ceux qui ont raison et ne peuvent faire prévaloir leur point de vue ? L'absence d'éducation n'était pas vraie, non plus, chez tous ; si elle fermait à quelques-uns la compréhension de plusieurs choses et leur rendait plus difficile lé sens exact de la mesure, elle leur valait une force de jugement un peu simpliste, mais lucide, claire, dont les grandes lignes étaient à utiliser — et elles ne le furent jamais par ceux que l'habitude de l'éducation devait conduire sincèrement, et avec une sorte de dévouement particulier, vers ceux qui en manquaient. Là était le moyen véritable permettant de réaliser les réformes nécessaires[6] ou, du moins, une partie d'entre elles, malgré là droite, et de n'en régulariser que mieux, ensuite, des provocations exagérées, légitimes en elles-mêmes, dans leur essence morale, mais que l'éducation politique insuffisante du pays rendait dangereuses. Le ministère faisait le jeu du président en ajoutant à la loi qui frappait toute attaque contre le principe du gouvernement républicain un article qui, en poursuivant aussi l'offense faite au président, solidarisait celui-ci plus étroitement avec la République. Le Parlement persévérait avec activité dans la réaction en rappelant, par Thiers, l'œuvre de Marie en août 1848, prélude de celle qui était reprise, avec plus de vigueur, maintenant. Montalembert fit une sorte de confession publique au cours de laquelle il acheva de métamorphoser ce qui subsistait encore en lui de son passé. Il rappelait sa politique débutant par un vote contre les lois de septembre, et constatait l'évolution qui le menait aujourd'hui à parler et à voter en faveur d'une loi pire — d'après les adversaires — que les lois de septembre même. Il ne se sentait cependant pas en contradiction avec lui-même, et, au surplus, n'était pas le seul qui se trouvait contraint d'agir ainsi. Il se comparait à un médecin qui, ayant à soigner un homme robuste, lui conseillait un régime énergique et stimulant puis qui, dix ans après, en face du même homme, épuisé par ses excès, lui conseillait un régime d'abstention rigoureuse. Il y a quinze ans, nous avons trouvé la France robuste, capable de résister au régime de liberté absolue qui existait alors. Aujourd'hui, nous la trouvons profondément malade. Il faut la sauver et, avec elle, sauver la liberté. L'orateur étalait, non sans une certaine satisfaction, ce tableau des excès révolutionnaires ; il s'efforçait aussi vainement d'établir une balance en relevant les fautes du parti conservateur : Je ne signalerai pas cette déplorable légèreté avec laquelle, dès le lendemain du combat, on se replonge avec une folle sécurité, disposition si spirituellement caractérisée par un de nos collègues lorsqu'il a dit que dans ce pays, le lendemain d'une victoire, l'ordre avait l'air de demander pardon au désordre de l'avoir vaincu. Ne sommes-nous pas tous coupables, sinon dans le présent, au moins dans le passé, de ce goût dépravé pour l'opposition permanente et perpétuelle ?... Oui, depuis la chute de l'Empire, tous, nous avons, plus ou moins, lorsque nous n'étions pas nous-mêmes au pouvoir, sympathisé avec les agressions dirigées contre le pouvoir, quel qu'il fut : sous la Restauration, les libéraux de toutes nuances ; sous la monarchie de Juillet, les légitimistes d'abord, puis les dynastiques et, enfin, il faut le dire, les catholiques eux-mêmes, moins, beaucoup moins que les autres, mais encore trop, je le reconnais maintenant. Tous, à des degrés divers, nous avons trop présumé de la force de cette société, de la solidité de ses remparts. Nous avons vu, sous le dernier régime, des hommes à peine sortis du pouvoir et qui devaient y rentrer presque aussitôt, user de ce court espace de temps pour affaiblir et discréditer ce pouvoir dont ils avaient été longtemps et dont ils devaient redevenir sitôt les dépositaires. Nous avons vu d'autres hommes continuer pendant dix-huit ans, avec le plus grand talent, avec la meilleure foi du monde, je n'en doute pas, à attaquer le même pouvoir. — Un membre à gauche : M. Odilon Barrot ! — Eh bien ! oui, M. Odilon Barrot et il ne m'en voudra pas de le désigner ; il sait les sentiments que j'ai pour lui et combien j'honore les services qu'il rend à la patrie. Je vous remercie de m'avoir fourni cette occasion de le nommer et de l'honorer publiquement. Eh bien oui, nommons-les par leurs noms si vous voulez, M. Guizot, M. Odilon Barrot, tous les deux ont été successivement condamnés à user tout leur patriotisme, tout leur talent, toute leur énergie à défendre le pouvoir qu'il avaient, dans d'autres temps, déprécié. Qu'est-ce que cela prouve ? Que ce sont des apostats, des hommes corrompus ? Pas un d'entre nous n'a osé le dire et n'osera le supposer. Cela prouve qu'il y a dans la manière dont nous entrons dans la vie politique, dans la manière dont nous apprécions les rôles du pouvoir et de la société, quelque chose de radicalement faux et de téméraire, quelque chose d'incompatible non seulement avec l'intérêt de la société, mais avec celui de la liberté... Aussi, qu'arrive-t-il aux hommes publics dans ce pays-ci ? Ils commencent tous par ne pas assez croire à l'autorité. Et comment finissent-ils ? Les uns vont tomber au fond de l'abîme où ils cherchent à entraîner la société avec eux, les autres consacrent leur talent et leur énergie à défendre la société avec les armes dont ils ont trop souvent essayé le tranchant et affaibli le ressort. Il s'accusait d'avoir, lui aussi, été trop souvent grossir cette clameur téméraire et insensée qui s'élevait de tous les points de l'Europe à la fois et qui a fini par l'explosion de février. Il se pardonnait à lui-même et espérait dans le pardon de Dieu. La liberté, disait-il aussi, peut naître d'une révolution, c'est incontestable, mais elle ne peut vivre qu'à condition de tuer sa mère, de tuer l'esprit révolutionnaire. C'est ce qu'elle a fait en Angleterre. Là elle est née de deux révolutions ; mais qu'a-t-elle fait depuis qu'elle y existe ? Elle s'est constamment appliquée à tuer l'esprit de sédition et de révolte. Puis, aux applaudissements de la droite, il résumait toute la politique réactionnaire des gouvernements qui s'étaient succédé depuis Février : ... La République que nous avons n'a elle-même pu exister jusqu'à ce jour qu'en tuant, autant qu'il était en elle, ou du moins, en combattant énergiquement, courageusement, l'esprit de révolution ; elle l'a fait en juin dernier, elle le fera encore ; si elle ne peut pas le faire, elle périra. Elle sera remplacée par deux dictatures, d'abord celle de l'anarchie que nous connaissons tous... Et après cette dictature-là, savez-vous laquelle nous aurons ! Non pas la dictature de Napoléon, de saint Louis ou de Charlemagne, mais celle du premier caporal venu qui nous apportera l'ordre matériel au bout de son sabre et que vous bénirez tous... (Vive interruption à gauche.) Oui, que vous accueillerez vous-mêmes qui m'interrompez. Vos pères l'ont bien fait... Montalembert comparait la liberté au chêne dont la croissance lente, mais sûre, abrite une longue suite de générations. Excellente image ; mais qui pouvait se méprendre sur ce que le grand catholique entendait par liberté ? Jules Favre désigna le point où mènerait une politique de cette sorte, poussée par ceux qui la préconisaient jusque dans ses conséquences. Il aurait pu montrer aussi quel conservateur intransigeant, sous couleur de progrès, était l'auteur des Moines d'Occident ; n'était-ce pas lui qui, presque à la veille de la révolution de Février, avait dressé un effroyable tableau de la société sapée jusque dans ses racines par l'idéal révolutionnaire ? — Il prévoyait, du moins, l'oppression de la pensée et le règne de la police auquel on allait aboutir. Vous dites que la société est malade. Cela est vrai, mais comme ces médecins empiriques qui ne vont pas rechercher dans le secret des organes, dans le mystère de la science, la cause première des maux, vous n'en voyez que les symptômes et vous voulez les étouffer par la compression pure. Voulez-vous que je vous dise comment je comprends la cause de ce mal social ? C'est que l'âme de cette société ne trouve, pour satisfaire à ses besoins moraux, qu'un corps débile et usé ; c'est que le cœur républicain est encore dans le moule de la monarchie où vous voulez le faire périr. La société, dites-vous, est assiégée. Eh bien si, véritablement, la société est assiégée par le socialisme, savez-vous le moyen de faire cesser le siège ? C'est de donner entrée au socialisme dans la place. Des exclamations ironiques, des rires prolongés, accueillaient le conseil et Barrot, dans un de ces discours auxquels il se plaisait, pesait, appréciait la dose de liberté nécessaire à la presse, à la discussion, à l'opposition. Jamais il n'avait entendu supprimer celle-ci ; il la reconnaissait, au contraire utile, ne fut-ce qu'afin d'éclairer le gouvernement ; il ne réprouvait que la violence et que les écrivains qui la préconisent ; il classifiait interminablement, délimitait des frontières transcendantales. Il rappelait aussi à Favre ses propres paroles du 11 août : Nous voulons que toutes attaques contre les idées sur lesquelles repose la société soient interdites, et voici pourquoi nous ne voulons pas, pour servir à la fortune de quelques ambitieux, mettre en péril le salut de la patrie ; nous savons bien comment leurs utopies, colorées par les mensonges de l'imagination, peuvent armer des mains criminelles. Voilà ce que vous disiez. Etait-ce parce que vos amis étaient au pouvoir que vous teniez ce langage ? Aujourd’hui vous en repentiriez-vous ? Comment répondre que ces paroles, qui n'étaient déjà pas vraies, en août, l'étaient moins encore et faisaient au mieux le jeu des réactionnaires, en 48, contre la révolution et la République, en 49 contre ce qui subsistait de la République ? Comment, sans paraître de mauvaise foi, répondre à Barrot qu'il était dupe d'une illusion, ou ne répugnait pas au mensonge, et conciliait les deux quand il venait dire : Qu'aucun parti ne s'attribue ici le monopole des sympathies pour le peuple ; nous l'avons défendu, nous le défendrons toute notre vie aussi, mais nous ne le tromperons jamais. Il voulait l'ordre dans l'intérêt même du peuple : Quand nous aurons ramené la sécurité et le calme dans ce monde du travail et de labeurs, quand nous aurons rappelé les capitaux désormais confiants, quand la société se possédera elle-même, enfin, quand elle pourra envisager l'avenir sans anxiété, alors ces projets que vous recommandez à notre philanthropie éclairée pourront recevoir, dans la mesure du possible, leur application. Désireux de se justifier, il ajoutait avec adresse : Bien loin d'éloigner le souvenir de ma lutte de dix-huit ans pour la liberté, c'est ce souvenir qui me soutient et qui fait ma force dans celle que je soutiens aujourd'hui pour la cause de l'ordre. Ceux qui voient là une contradiction ne prouvent qu'une chose, c'est qu'ils ne m'ont jamais compris. Qu'ils sachent bien que lorsque, sous l'ancien gouvernement, je revendiquais certains principes et défendais certaines garanties, je combattais autant pour la consolidation du pouvoir qui avait, d'ailleurs, mes affections, que pour la liberté. Ils ne pouvaient pas, d'ailleurs, me comprendre, ceux qui aujourd'hui me reprochent mon passé, car ils étaient alors parmi mes adversaires ; vous le savez bien. Notre lutte n'a pas commencé le jour où j'ai été chargé de défendre et de raffermir cette société ;.... quand je luttais pour fonder dans notre pays une liberté vraie, possible, je vous avais, comme aujourd'hui, en face de moi, contre moi ; il n'y a rien de changé. Thiers avait dit son mot dans ce débat ; et c'était le
même alliage de vérité et d'erreur, alourdi d'un essai de finesse facile.
Aucun ne se demandait si l'absence de mesure de la gauche n'était pas causée
par l'absence de compréhension de la droite. On
discutera dans les actes sans raison, sans mesure, sans justice, disait
l'ancien ministre de Louis-Philippe. Voyez si je vais loin dans ma concession
: Voici un homme qui ne sait rien, qui sort du collège ; il ne sait rien des
affaires de l'Etat ou bien il est déjà bien loin du collège, il a traversé
toutes les carrières, il a été avocat, médecin, négociant, il a échoué dans
toutes. Eh bien, il va faire sa leçon aux hommes les plus consommés qui ont
passé leur vie à étudier les affaires de l'État... Si cela n'était pas, il
n'y aurait pas de liberté de discussion pour les actes. Je vous ai parlé de
l'ignorant, je vais vous parler du malhonnête homme : Voici un homme exclu
des fonctions publiques ; il n'a qu'un désir, c'est de contribuer au
renversement de l'administration et du gouvernement pour avoir les fonctions (il ne demande que cela) même les plus viles... Il accusera les hommes les plus
élevés, les plus attachés à leur pays ; de quoi ? D'ambition. Il faut que
cela soit, car autrement la liberté n'existerait pas... Le sot jugera l'homme
d'esprit ; le malhonnête homme accusera l'honnête homme ; il le faut parce
que, si cela arrive souvent, il arrive aussi que des gens habiles emploient
le même moyen, ce moyen de l'expression de la pensée publique... Quelques
hommes faibles en souffriront, s'arrêteront dans leur carrière, comme ces
soldats qui, impropres aux fatigues de la guerre, restent dans les hôpitaux
dès les premières journées ; tant pis pour eux : le gouvernement n'est que
pour les forts. De longs discours de ce genre, ou des discussions
fastidieuses, encombraient les séances ; une fatigue, une sorte de
contrainte, pesaient sur les débats, et si la majorité s'en montrait, en
somme, satisfaite, quant à ses opinions du moins, elle ne pouvait pas ne pas
ressentir, en tant que Parlement, la diminution d'intérêt qui en découlait
nécessairement pour elle. A se mouvoir dans le même cadre, elle s'ennuya et
la lassitude se laissa voir peu à peu. Les demandes de congé affluèrent,
assez adroites pour déjouer les précautions souvent un peu puériles prises
d'avance contre elles. Le chiffre des absents allait
toujours croissant et l'Assemblée se trouvait souvent en nombre insuffisant
pour voter, ce qui fournissait à la Montagne toute facilité pour, au moyen
d'abstentions calculées, frapper le pouvoir législatif d'impuissance ; les
mots de prorogation, d'abord assez timidement hasardés, circulèrent bientôt
sur tous les bancs et devinrent comme un cri général[7]. Le drame était,
en effet, fini ; le reste du spectacle ne comptait plus ; le pays se
demandait même pourquoi il durait. L'Assemblée législative assurait ainsi
elle-même, au bout de trois mois de siège, l'inutilité, non seulement de sa
tâche, mais encore, semblait-il, la vanité des élections qui l'avaient
composée ; et parmi les députés, trois cents d'entre eux qui avaient
appartenu à la Constituante le constataient mieux encore que leurs collègues.
La prorogation était toute naturelle. Le parlementarisme expirait de
lui-même, en l'avouant presque. * * *Sa décadence présente cependant encore, avant les vacances, un intéressant débat sur la question romaine. Rome, à la suite d'un siège plus sanglant qu'on ne voulait le dire, s'était rendue, et le 3 juillet Oudinot y avait fait son entrée. Des protestations s'étant fait entendre avaient été réprimées, et un suprême drapeau, surmonté du bonnet rouge, dernier symbole de la République expirante[8], avait été abattu sans difficulté[9]. Le colonel Niel s'était rendu pendant ce temps à Gaëte, et, agenouillé devant le Saint-Père, il lui avait remis les clefs de la Ville Éternelle. Pie IX ne sut pas retenir alors ces paroles mémorables, déjà esquissées par lui précédemment : La France ne m'avait rien promis et, cependant, c'est sur elle que j'ai toujours compté. Je sentais qu'au moment opportun la France donnerait à l'Eglise son sang, et, ce qui est peut-être plus difficile pour ses valeureux enfants, ce courage contenu, cette patience persévérante à qui je dois la conservation de ma ville de Rome, le trésor du monde, la cité bien-aimée vers laquelle mon cœur et mes regards pleins d'angoisse demeurèrent tournés[10]. Lesseps avait été définitivement condamné au conseil d'État à la suite d'un rapport de M. Vivien : 1° comme ayant tenu une conduite absolument opposée aux instructions qu'il avait reçues ; 2° comme ayant signé une convention dont les stipulations étaient contraires aux intérêts de la France et de sa dignité. La Montagne détruite, le ministère estimait donc l'affaire close et qu'elle pourrait sans danger venir au Parlement. Mais la politique défendue par la gauche à ce sujet était trop dans la ligne nationale pour disparaître ; elle devait d'elle-même réapparaître, et, en attendant l'heure du réveil, le dernier noyau montagnard assuma la tâche de favoriser les nouvelles explications nécessaires. Le 25 juin, le député Mauguin interpellait sur la situation générale de la politique étrangère. En face de l'Europe en armes, il s'inquiétait devant l'Empire russe et l'Empire ottoman prêts à en venir aux mains, et il souhaitait de voir tourner les éléments d'avenir en perspective à la plus grande gloire de la France. Depuis trois quarts de siècle, précisait-il, il s'est formé dans le nord une coalition qui pèse sur l'Europe, et surtout sur la France. Nous l'avons trouvée dès les premiers jours de notre première révolution ; elle a résisté à tous les revers, même au succès. Elle existait en 1809, au moment même où la Russie marchait avec nous contre l'Autriche ; elle existait aussi, en secret, en 1812, quand la Prusse et l'Autriche marchaient avec nous contre la Russie ; elle s'est reconstituée en 1815 et 1816. Elle a existé en 1830, et nous l'avons revue se montrer tout entière en juillet 1840, quand il s'est agi de frapper un des alliés de la France. On devait croire que les événements de 1848 auraient le pouvoir de la dissoudre. Les événements paraissaient devoir faire entrer la Prusse et l'Autriche dans un mouvement constitutionnel et, conséquemment, dans les alliances occidentales. La diplomatie française aurait pu favoriser ce mouvement ; mais, depuis quinze mois, on ne trouve sa présence nulle part. J'ai tort ; on trouve sa présence sur cette question de coalition. La coalition a été sur le point, non pas de se dissoudre, mais de se diviser, de se faire la guerre, et cela, à l'occasion d'une question qui a passé comme inaperçue en France, je veux parler de la question du Danemark, de la question de Sleswig-Holstein. Le Sleswig-Holstein a le privilège d'avoir des ports sur deux mers, sur la Baltique et sur la mer du Nord. Après notre révolution de Février, il s'est révolté comme il s'était révolté après notre révolution de 1830. Il appelait à lui l'Allemagne ; il voulait faire partie de l'Allemagne. L'Allemagne, d'un autre coté, veut être puissance maritime ; elle a besoin de la mer pour son commerce, pour l'exportation de ses matières premières, de ses marchandises fabriquées ; elle avait donc saisi avec un empressement inouï l'occasion d'avoir des ports à la fois sur la Baltique et sur la mer du Nord. — La Russie ne veut pas qu'aucune autre puissance qu'elle intervienne dans la Baltique ; l'Angleterre ne veut pas que d'autres puissances deviennent maritimes. En conséquence, l'Angleterre et la Russie s'étaient entendues pour soutenir le Danemark, et la Suède les a suivies par obéissance. D'un côté donc, se trouvaient Russie, Angleterre et Suède, de l'autre, décidées à la guerre, ne voulant pas céder, Prusse, Autriche, Confédération germanique, nos six ennemis divisés, prêts à entrer en guerre. Neutres, n'ayant rien à voir dans la question, nous ne devions nous y intéresser en aucune manière. Provoquer à la guerre des ennemis dont nous avions eu tant à nous plaindre, c'eût été un acte coupable ; la générosité n'allait peut-être pas jusqu'à les maintenir en paix. Cependant c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris parti pour l'Angleterre et la Russie contre l'Allemagne, afin d'éviter une guerre à l'Angleterre ; l'Allemagne, redoutant nos armées de terre, à renoncé au Schleswig. La coalition se resserra donc peu de temps après, et par l'œuvre de notre diplomatie toujours si conciliante, si réellement européenne. La Russie, de son côté, devait songer à s'étendre sur le Bosphore. Trois obstacles l'arrêtaient, l'Autriche, l'Angleterre, la France. — L'Autriche, travaillée par le mouvement des nationalités, devait son calme à la Russie, sans laquelle elle se fût disloquée ; la Hongrie eût, à la fois, recouvré son indépendance et rendu l'indépendance à l'Italie. L'orateur cherchait pour quels motifs la France préférait auprès d'elle un empire uni a plusieurs petits pays divisés et libres. Il estimait que la Russie savait pouvoir se maintenir encore facilement à la tête des mécontentements politiques de ces populations, qui comprenaient seize millions de Slaves toujours prêts à écouter la voix du souverain qui s'était placé à la tête du panslavisme. Ainsi, de deux choses l'une, ou l'Autriche reconstituée redevient l'instrument de la Russie et la sert en Orient, ou, dans dix ou quinze ans, l'Autriche tombera devant de nouveaux soulèvements. Ainsi la Russie maintiendra tant qu'elle le voudra le faisceau de l'Autriche. Quand ses intérêts le lui commanderont, ce faisceau tombera, et les Hongrois, les Bohêmes, les Croates, les Slaves formeront des Etats séparés. La Russie est en cela fidèle aux traditions de son histoire ; ainsi avait-elle agi avec la Pologne qu'elle avait maintenue, nécessaire, puis abattue, inutile ; ainsi avait-elle fait vis-à-vis du sultan. L'Angleterre ne lui paraissait pas une ennemie réelle de la Russie, et il la voyait occuper Constantinople moyennant quelque dédommagement. Il n'était pas partisan de l'alliance anglaise ; en cas de guerre, selon lui, la Grande-Bretagne se déclarerait contre nous. La France lui semblait l'alliée naturelle de la Russie et, à une autre époque, il eût préféré cette alliance à celle de l'Angleterre ; en temps de révolution, il en était autrement. La Russie représente l'autorité la plus absolue ; nous représentons la liberté, et l'hostilité morale absolue conduit facilement à l'hostilité matérielle. Examinant notre situation depuis Février, il constatait que, selon notre habitude sous Louis-Philippe, nous avions tendu les bras à l'Angleterre et que nous nous étions fait son agent, son soldat ; et comme on l'interrompait, il corrigeait en accentuant : L'Angleterre veut nous réduire à ce rôle ; nous n'y sommes pas encore. La Russie, qui a pour but suprême d'être maîtresse de Constantinople, sait que les clefs de Constantinople sont à Paris, aussi ne verrait-elle pas avec regret la France affaiblie. M. Mauguin, comme tant de contemporains, croyait que la Russie se pensait appelée à dominer l'Europe. Quand la révolution de Février a été connue à Saint-Pétersbourg, elle a été accueillie d'abord avec faveur ; mais il est bon, malgré cela, de rappeler ce mot fameux : Bientôt, peut-être, il faudra monter à cheval. Après la bataille de Novare, bataille perdue pour la France (A gauche : Oui, c'est vrai !) qu'a fait le csar ? Il a donné à Radetzki la dignité de feld-maréchal des armées russes : il s'est approprié la bataille de Novare !... Il convenait de rechercher, reprenait-il, les raisons de l'armement général de l'Europe, et il en arrivait, quant à lui, à cette conclusion inattendue que la Russie voulait marcher sur Paris en faisant la conquête morale de la Prusse, comme elle avait fait celle de l'Autriche. D'ici à un mois, prédisait M. Mauguin, vous pourrez voir les bataillons prussiens s'étendre sur nos frontières. Qui pourra les empêcher de réaliser leurs projets ? Si la coalition ne marchait pas sur la France, elle referait la carte d'Europe sans nous, malgré nous, contre nous. On établirait une carte de l'Europe, qui donnerait l'Italie à l'Autriche... l'Allemagne à l'Autriche et à la Prusse, l'Europe entière à la Russie. Le czar devient l'Agamemnon des rois. La France alors reléguée, détestée des peuples qui l'accuseraient de les avoir trompés, détestée des rois qui redouteraient son caractère et ses passions, chassée des conseils, expulsée de tous les pays, ne pourrait subir cette humiliation. Elle ne le pardonnerait à personne, car il y a en France un sentiment qui domine tous les autres, c'est celui de la nationalité, celui de l'indépendance, c'est celui de l'honneur militaire. Deux dynasties sont tombées pour avoir blessé ces sentiments. Le député n'allait pas jusqu'à conseiller la guerre, mais il ne cachait pas qu'à ses yeux elle ne serait pas désavantageuse et qu'en tout cas la France ferait bien d'affirmer sa force. Ce long exposé indique une des thèses de la politique française européenne ; il semble, au premier abord, ne pas rentrer dans notre étude immédiate ; il y tient cependant une place à retenir ; il nous servira en 1850, quand nous étudierons les forces européennes sur le vieux continent et leur deux plus redoutables utilisateurs, Cavour et Bismarck. Ici, plus spécialement, il nous fait saisir déjà tout ce qui se massait autour de la question italienne, avant-hier piémontaise, hier et aujourd'hui romaine. Afin de ne pas nous étendre outre mesure, nous pouvons cependant passer par-dessus l'interpellation de M. Savoye et nous arrêter à Tocqueville. Le député Savoye avait parlé des rapports avec les révolutionnaires de Bade et du Palatinat. Or la querelle révolutionnaire, étant données les défaites précédentes, apparaissait sur ce point inutile. Tocqueville n'eut pas de peine à le démontrer[11]. Quant au discours de Mauguin, il lui semblait se résumer à la question de la paix ou de la guerre. Deux espèces de personnes, en France, en ce moment, semblaient désirer la guerre, celles qui pensaient pouvoir, ainsi, renverser l'ordre social européen, celles qui arrivaient au même but grâce à des chemins de détour, par des sentiments et par des idées qui les mènent à croire que la France est entraînée par une sorte de fatalité invincible, qu'en face de nous se trouvent des pouvoirs inconciliables, une coalition déjà formée qui marche, marche chaque jour vers elle, qui, à chaque heure, s'en approche davantage, et qui, dans un temps nécessairement très court, viendra étouffer jusque sur notre territoire la nationalité française. Le ministre des Affaires étrangères, s'il le pensait, viendrait le dire, tout le premier, à l'Assemblée en adjurant le pays de faire face à la nécessité, mais il ne le pensait pas. La coalition, suivant lui, n'existait pas. Je suis convaincu, disait-il, que cet accord, que ces dispositions hostiles n'existent pas, que ce qu'on dit en grande partie, sinon en totalité, est une chimère dangereuse. Et croyez-vous, en admettant que ce soit, en effet, une chimère, qu'il soit sans danger de venir ainsi, chaque année, faire le tour du monde à cette tribune, de venir indiquer du doigt, sur toute la surface du globe, des ennemis qui se préparent pour la France ?... L'exemple du passé a prouvé, Messieurs, que les coalitions de l'Europe contre nous n'étaient ni très longues, ni, même, très dangereuses. L'Angleterre ne tenterait rien contre la France ; une coalition des puissances allemandes contre nous était peu probable ; jamais elles n'avaient paru aussi divisées par des susceptibilités légitimes autant que par des intérêts ; jamais, par conséquent, elles ne se sont trouvées moins à même de faire ensemble cet effort commun et énergique que l'union la plus parfaite pourrait seule leur suggérer. Il n'avait pas constaté de la part de la Russie aucune animosité contre la France. Il ne voyait de coalition que dans le cas où la république démocratique et sociale triompherait ; la guerre lui apparaissait même alors certaine. Et il faisait cette récapitulation curieuse : Quel a été, pendant plus de trente ans, l'état où s'est trouvé la France ? elle a été sans cesse ou isolée ou menacée. D'un côté, elle était seule avec les principes de liberté ; de l'autre, se trouvaient de grandes monarchies de l'Europe vivant sous le principe du gouvernement absolu. C'est cet état de choses, j'ose le dire, qui, pendant trente-deux ans, a été le cauchemar de notre politique. Depuis, il est arrivé que l'Allemagne est devenue constitutionnelle et libérale, que les monarchies absolues se sont transformées en monarchies représentatives. Cela seul changeait notre position dans le monde. Désormais, la France se trouvait libre et indépendante dans sa politique. Il accusait les révolutionnaires d'avoir changé cette situation. La paix était nécessaire à l'extérieur comme à l'intérieur, elle était aussi nécessaire à la République qu'à l'humanité ; il fallait que la République puisse prouver à la France et à l'Europe qu'avec elle on peut avoir l'ordre au dedans, l'ordre véritable non seulement dans les faits, mais dans les idées, et la paix dans le monde. — Emile Barrault s'écriait : C'était le programme du dernier cabinet de la monarchie, et, en vérité, je regrette profondément de trouver dans le ministère qui siège devant moi la monomanie de M. Guizot. Le fils de Jérôme rectifiait : avec moins de talent. Emile Barrault était persuadé que l'Allemagne formait le seul rempart de la France contre la Russie. La discussion continuait le 27. — Un exposé était fait de
la révolution en Allemagne où elle avait suivi d'abord la voie légale, de
préférence à la voie révolutionnaire. L'orateur s'élevait avec force contre
l'alliance anglaise, alliance sans gloire qui a été
notre perte, qui a été longtemps notre honte et qui sera la ruine de la
France. Il déplorait que des hommes aussi éminents que M. Thiers et
que M. Guizot l'eussent patronnée ; il ne comprenait pas que la République
eût tant de ménagements : Je dis qu'une république française
comme celle de Février, au milieu des monarchies de l'Europe, ne peut vivre
qu'à la condition de s'étendre comme les rayons du soleil ; c'est la seule
condition qui la fera vivre ; sinon, le lendemain, elle aura contre elle
toutes les monarchies coalisées de l'Europe. Il n'y avait pas d'autre
alliance pour la France que celle de l'Allemagne, et il la mettait sous le
patronage de Robert Blum, tué par la police
autrichienne, non pas seulement pour sa politique démocratique, mais aussi
pour son amour pour la France. Exprimant les sentiments de la
démocratie allemande, Blum avait dit au Parlement de Francfort, face à la
droite qui tenait sur nous les propos les plus calomnieux : Assez ! gardez-vous de calomnier la France, elle est notre
avant-poste dans la bataille de la liberté que nous allons livrer ; c'est de
la France que sont parties toutes les idées qui ont apporté les améliorations
politiques dans notre pays, et si, aujourd'hui, la liberté allemande demeure
triomphante, c'est aux pieds de la France que nous devons déposer la couronne
de reconnaissance et les palmes de la victoire, et dussions-nous succomber
dans cette lutte, le dernier regard de notre œil mourant se tournera encore
vers la France. M. Mauguin, répondant à Tocqueville qui avait trouvé
son discours dépourvu de conclusion, demandait la mise de notre armée sur le
pied de guerre. Je vous ai dit : Menacez de guerre
si vous voulez avoir la paix, et vous l'aurez. On m'a répondu qu'une grande
nation ne menace jamais. Vous vous trompez : une grande nation, avant de
frapper, menace toujours. Il signalait nos agents diplomatiques comme
ceux de toute l'Europe qui savaient le moins ce qui
s'y passe. Et revenant à Rome : Si vous aviez
su ce qui s'y passait vous ne seriez pas sous ses murs. L'honorable
député paraissait aussi voir dans la guerre un moyen de remettre les
questions sociales, et la droite, sur ce point fort attentive, applaudissait.
Vous parlez d'ordre et de paix, nous voulons tous
l'ordre et la paix, mais sans blesser personne. Qu'ont produit depuis vingt
ans ceux qui ont prêché ces maximes ? Qu'à produit le dernier régime ? Le
désordre et la guerre. Le désordre, c'est lui qui nous a donné le socialisme.
La guerre, nous ne l'avons pas encore à l'étranger, cela viendra, mais nous
l'avons eue dans nos rues... Eh bien, j'aime mieux la guerre à l'étranger
qu'un 23 juin nouveau dans Paris... Je ne vous demande pas de lancer la
France sur l'Europe et, si une nouvelle insurrection éclate quelque part, de
nous mettre à son service. Ce n'est pas cela : je vous demande de veiller sur
nos intérêts, je vous demande de les connaître, je vous demande de les
étudier et c'est pour cela que vous me voyez provoquer des interpellations. Je
sais très bien qu'elles ne conviennent pas au pouvoir, mais à qui doit-on
s'en prendre ? Lorsque, comme en Angleterre, il y a un gouvernement plein
d'expérience et d'habileté, le pays peut se fier en lui ; et l'on se fie en
lui : mais quand, dans un pays comme le nôtre, il y a tous les deux ou trois
mois des pouvoirs nouveaux qui n'ont jamais rien exercé, qui n'ont jamais
rien su, qui n'ont jamais rien manié, est-ce que la défiance, non pas des
intentions, mais de l'habileté, n'est pas possible ?... Croyez-vous que si
l'affaire de Rome eût été prise autrement que comme un moyen d'agiter les
rues et de jeter la guerre dans la cité, croyez-vous qu'expliquée ici avec
calcul, avec modération, elle n'eût pas emporté toute l'Assemblée et ne l'eût
pas déterminée à admettre un autre système ? — Tocqueville répondait
dans le même sens que la veille. Il reconnaissait simplement que l'époque
était, en effet, grande, grosse d'événements, et que le pays aurait
peut-être, à une époque quelconque, prochaine ou
éloignée, un grand parti à prendre. Cavaignac tenait à s'expliquer au sujet du Schleswig. Il rappelait notre amitié avec le Danemark. Je ne crois pas, assurément, ajoutait-il, que la Diète de Francfort ait jamais pensé à réclamer l'Alsace et la Lorraine, mais ce que je sais, c'est qu'au centre même du gouvernement de la Diète, une carte géographique fut dressée, non pas émanant du gouvernement de Francfort, mais de la pensée de l'atmosphère qui l'environnait ; cette carte comprenait ces deux provinces françaises dans la puissance germanique. Et comme Odilon Barrot prononçait des paroles de dénégation : J'ai vu la carte, dit le général. — Il avait donné une assurance de sympathie au Danemark parce qu'il estimait mauvais que l'on trouvât nécessaire l'adjonction du Schleswig sur le simple motif que la langue allemande y était parlée. L'armistice fut déclaré. Cavaignac, une fois encore, venait plaider la cause de son inaction au pouvoir. Je le reconnais, dans cinq mois nous avons peu agi, mais il n'est pas donné dans quelques mois de temps à un gouvernement qui vient de naître, qui n'a pas l'avenir devant lui, qui est accepté avec répugnance, il ne lui est pas donné de pouvoir agir comme il pourrait le désirer s'il avait en lui-même le sentiment de vitalité, de confiance dans le bon vouloir des autres à son égard, car il ne trouve plus, en dehors de lui, le sentiment de réciprocité qui fait écouter ses paroles, qui fait qu'on les accepte. Par conséquent, il était dans notre condition de ne pas produire de grandes choses, trop heureux si nous ne faisions pas de mal et si nous faisions quelque bien. Selon lui et presque tous les diplomates, la France ne pouvait pas vivre dans l'isolement. La guerre, pour en sortir, serait nécessaire et même préférable. Mais avec qui s'allier ? A la Diète de Francfort, la Prusse avait manifesté des intérêts hostiles aux nôtres ; l'Autriche, à cause de la question lombardo-vénitienne, devait être écartée ; une seule grande puissance était avec nous, l'Angleterre ; mais il demeurait évident que l'Angleterre ne se fût pas alliée à nous si son intérêt n'avait trouvé son compte à cette alliance ; et il y avait aussi erreur, d'autre part, à déclarer les intérêts français subordonnés aux intérêts anglais. En s'interrogeant face à l'horizon européen actuel, Cavaignac continuait à se déclarer pour la paix ; il prévoyait dangereuse la promesse de faire respecter le principe des nationalités et pensait que la modération dont avait fait preuve la nouvelle république lui constituait une situation énorme, très avantageuse, et dont elle aurait de nouveaux bénéfices à retirer. La guerre en février eût dressé toute l'Europe contre nous, ce qui eût arrêté, prétendait-il peut-être inexactement, le mouvement de la liberté. En 1792 toute l'Europe était soulevée contre nous... Vous avez vu les nations de l'Europe obéir à la volonté, à l'impulsion des gouvernements monarchiques qui les lançaient contre nous. En 1813, il a fallu leur promettre quelques libertés. En 1830, quelques nations ont commencé à se remuer sous ce qu'on appelle si éloquemment le rayonnement de la liberté française. En 1848, vous voyez que l'Europe est soulevée tout entière. Eh bien, est-ce la guerre qui a produit tout cela ? Je crois que c'est la paix. Eh bien, pourquoi voulez-vous arrêter ce mouvement ? Pourquoi ne voulez-vous pas le laisser se développer ? Avec des alliés puissants, la France peut affronter toutes espèces de complications et de difficultés. Pierre Leroux achevait ces divers points de vue
diplomatiques par le sien propre en portant la question sur ce terrain à la
fois idéal et matériel qui, tout personnel, tout particulier qu'il fût,
présentait des indications curieuses en plusieurs endroits. — Il reprochait à
l'Assemblée d'aller souvent trop vite, comme si elle avait hâte d'en finir,
sur ces grandes questions de politique générale ; il se félicitait néanmoins
que cette politique générale eût soulevé des débats, car, à la Constituante,
elle n'avait vu traiter que les cas particuliers ; et il ramenait la
discussion aux affaires italiennes qu'on avait voulu traiter incidemment et
qui, selon lui, demeuraient le fonds de la question, comprenant même en elles
la question d'Allemagne. Les Assemblées s'avancèrent
à l'aventure, en quelque sorte, sans système, or le système seul permet
d'aborder les questions particulières, de les examiner ; isolément toutes les
grandes périodes ont eu leur système, ainsi que les véritables politiques.
Il fallait d'abord se poser la question en ces termes : Qu'est-ce que la France et que veut-elle, et qu'est-elle
au milieu des nations ? Le présent, engendré du passé, est gros de l'avenir.
Qu'est-ce que la France en vertu de son passé ? Qu'est-ce que la France doit
être dans l'avenir ? Voilà la question. Que des hommes qui s'appellent de
pratique et qui dédaignent beaucoup la théorie, c'est-à-dire qui dédaignent
ce qui, dans la pratique, doit les guider, que ces hommes prennent une
question séparément, isolément, et la pèsent dans je ne sais quelle balance,
qui n'est pas juste, voilà, alors, comment l'incertitude vient et comment
aucune question ne peut être décidée et comment la nation se trouve sans
gouvernail et sans principe politique, et comment, enfin, les ministres sont
abandonnés et forcés d'avouer leur ignorance comme l'a fait hier M. le
ministre des Affaires étrangères, en nous faisant l'aveu le plus formel de
l'absence de principe dans la politique qui gouverne aujourd'hui. Leroux
n'admettait pas que l'artifice fastidieux de redouter le socialisme et de le
montrer dangereusement imminent pût faire parvenir à emporter un vote. Deux
données politiques émanaient du manifeste russe au long duquel le czar se
représentait comme le champion de toutes les idées saines en face de
l'Occident producteur de démagogie anarchique. Tocqueville avait aussi posé la
question dans ce sens. Or, est-il vrai que ce qui
pourrait donner la puissance d'exciter, d'être et de se manifester aux
nations méditerranéennes, aux nations sorties de la langue romane, à la
France et à toute la grande Europe occidentale, que Louis XIV et Napoléon
embrassaient dans le système d'action de la France, est-il vrai que ce socialisme,
c'est-à-dire cette religion nouvelle qui est dans la force des choses, soit
désorganisatrice et destructive de l'humanité, de la patrie, de la famille et
de la propriété ? Non, citoyens, et vous voyez que j'avais raison de demander
la parole pour protester contre cela ; car avec le système de M. de
Tocqueville et le système qui a été si souvent émis à la tribune sous la
Constituante, la majorité aurait raison de dire qu'il faut que la France se
rapetisse et se fasse humble vis-à-vis des grands, pour se liguer avec eux,
papes, rois et empereurs, contre l'ennemi de l'intérieur. Ne
s'arrêtant pas au rire général qui répondait à son exposé, il avançait que si
ceux qui parlaient ainsi avaient tort, si le socialisme venait pour perfectionner toutes choses comme l'humanité le
demande, la presse, la famille, la société en général, le pouvoir et même la
papauté (et les rires
recommençaient), il n'y avait plus alors à avoir peur, ni à
écouter le conseiller précédemment obéi ; à ce faux
prophète, vous pouvez répondre que la France sera victorieuse ; par
conséquent, c'est elle qui est l'étoile de l'humanité et l'initiation de ce
monde... C'est faute de foi, comme a dit l'autocrate russe, c'est par excès
de scepticisme, c'est donc par incrédulité sur tous les points que nous
sommes réduits à cette misère, non seulement de n'avoir pas de politique à
l'extérieur, mais, je le disais du même coup, de n'en avoir pas à
l'intérieur. Véritablement il y a similitude complète entre le système des
lois de compression, d'arrêt, de destruction de l'esprit humain dont on est
venu nous apporter un échantillon et dont on nous apportera bientôt sans
doute les développements, et cette politique extérieure également de crainte,
de terreur, de compression et d'anéantissement. Oui, ces deux systèmes sont
frères. M. Thiers l'a dit un jour à la tribune de la Constituante ; il est
venu, avec cette mobilité et cette force d'esprit qui le caractérisent,
établir ce système qui est tout simplement la conservation de tous les vieux
langes d'où l'humanité aspire à sortir. Dans la politique extérieure,
alliance avec tout ce qui existe, c'est-à-dire avec tout ce qui n'est pas la
république, alliance avec tout ce qui est la compression, et la destruction,
et la négation dans le monde de la république. La politique de
Cavaignac avait recommencé celle de ses devanciers. L'assistance riait de
plus belle, et comme l'orateur se récriait qu'il demeurait dans la question,
les rires devenaient insultants. Ce n'était pas
vainement que je rappelais tout à l'heure une pensée d'un génie qui
appartient à la France et à l'Allemagne, du plus grand philosophe moderne,
Leibnitz. Leibnitz disait : Le présent, engendré du passé, est gros de
l'avenir. D'où vient la France, citoyens, et qu'a-t-elle fait dans les
siècles précédents ? Si vous voulez sonder cette question, vous sonderez en
même temps la question de l'Europe et, alors, vous pourrez avoir une opinion,
une politique, parce que vous aurez un principe. La question de l'Allemagne
et celle de l'Italie soulèvent cette grande question. La France,
selon lui, vivait du christianisme le plus avancé, tout
prêt à se développer et à se transfigurer (exclamations à droite), et elle était en même temps
attachée à la forme la plus décrépite de ce
christianisme et à la première phase de son développement. L'Assemblée
entière riait. Leroux persévérait, non sans un certain orgueil modeste, en
montrant l'embarras de la France, depuis février, dans son rôle
d'initiatrice. La politique s'est faite papiste ; la
politique a suivi un mouvement qu'elle ne devait pas suivre et, par là, la
France manqua à son rôle vis-à-vis de l'Allemagne. La France est une nation
intermédiaire ; elle est la nation avancée, la fille aînée des nations
romanes ; elle a derrière elle l'Espagne et l'Italie, cela est vrai. Mais
quel a été le rôle de la France, son rôle religieux dans le monde, depuis
trois ou quatre siècles, je pourrais dire depuis plus longtemps ? (On rit.)
Citoyens, je n'entrerai pas dans le fonds religieux, mais j'ai le droit de
dire que, pour moi, le développement du christianisme s'est fait par une
suite de phases successives et que la phase catholique est la plus animée.
Oui, j'aurai le droit de le dire, sans nier, en aucune façon, la vérité
essentielle et le fonds religieux auquel je crois profondément... Je crois au
développement progressif de la même essence religieuse. Il résumait
vite le mouvement religieux et concluait que la France, en vertu même de sa
tendance philosophique, que j'aurais pu indiquer
aussi dans les rois, depuis Philippe le Bel jusqu'à Louis XIV, qui a voulu
fonder une église qui était une sorte de protestantisme, comme tous les
ultramontains vous le démontrent, représentait dans le monde la
philosophie et avait infiltré ses principes dans toute l'Europe. Il est donc monstrueux que la France, arrivant à la
limite de ses destinées actuelles, après qu'elle a fait son XVIe, son XVIIe
et son XVIIIe siècle, après sa Révolution de 89, après l'immense conquête
napoléonienne qui a répandu toutes ses idées dans le monde, après la révolution
de février, il est monstrueux que la politique française, au lieu de se
tourner vers l'esprit philosophique, vers la Réforme et tout ce qui est sorti
du mouvement de l'humanité moderne, se soit enchaînée à ce qu'il y a de plus
vieux, de plus aristocratique, de plus antirépublicain, au principe même de
la souveraineté incarnée dans un homme contre tous les autres hommes. La
France, depuis trois siècles, par tous les hommes de génie, combat contre ce
que vous avez soutenu dans votre politique italienne, contre le papisme et la
papauté. Oui, il est monstrueux que vous ayez adopté une pareille politique
et envoyé ses enfants détruire des républiques pour rétablir des monarchies...
La question, au surplus, n'avait jamais été traitée en elle-même, et c'est pour ne pas avoir voulu la traiter, c'est pour ne
pas avoir voulu appeler l'attention sur cette question profonde qui faisait
des séparations et des distinctions, séparant la question d'Italie de la
question d'Allemagne, de la question générale de l'Europe, de la question du
rôle spécial de la France, prenant le mot vague d'influence française, qu'on
est arrivé à marcher précisément contre le principe le plus direct, le plus
évident que l'esprit républicain puisse avoir. Et tenant toujours,
malgré les efforts tentés pour l'interrompre : Il y
a trois siècles que la France, non pas seulement par ses philosophes et ses
penseurs, mais même par ses évêques, par son grand Bossuet, que
l'ultramontanisme a flétri tant qu'il a pu, je dis encore par ses rois, — et
il faut véritablement ignorer l'histoire pour le nier, — il y a longtemps que
la France est sortie de ce régime passé du christianisme premier à son
développement. — Un député protestait au nom du christianisme et
Leroux rappelait : M. Barrot, dans une phrase que je
n'approuve pas pour mon compte, parce que je ne la prononcerais qu'avec un
immense regret, a dit : La loi doit être athée. — Barrot se
levait pour rappeler que le mot n'était pas de lui, qui s'était contenté de
poser le principe de la loi dominant toutes les religions, mais de Lamennais.
— Leroux trouvait la conception fausse, parce que ce
sont toujours les religions qui ont inspiré les législateurs, et je
dirai que dans tous les siècles religieux et de civilisation véritable, et
non pas de civilisation sans principe, la religion a été le principe de la
loi. Le rôle de la France en Europe n'était ni
papiste, ni catholique, et, vis-à-vis de l'Allemagne, il était grave pour
elle d'avoir manqué à sa tâche. L'Allemagne tout entière se meut avec
un esprit tout nouveau, prophétique, et vous repoussez cet esprit parce que
vous craignez l'esprit moderne, l'esprit de l'humanité... Toutes les fois
qu'on vous trouble dans votre petit système compressif, compressif de toutes
façons, à l'intérieur, à l'extérieur, partout, dans ce système de terreur qui
a engendré tous nos maux et qui engendrera apparemment des calamités nouvelles,
lorsqu'on vient vous dire : il faut que l'esprit
sorte et transforme la vieille société, vous, au nom des vieilles formes, de
ces formes stériles, qui détruisent l'esprit, vous vous armez et vous nous
dites à nous, socialistes, à nous qui suivons l'esprit du XVIIIe siècle et
des siècles antérieurs, à nous qui suivons les principes du christianisme, à
nous les disciples du Christ... — Un député : Ne mêlez donc pas le christianisme et la philosophie !...
— : Vous êtes des barbares, vous voulez détruire
l'humanité votre mère, vous voulez détruire la famille, la patrie, la
propriété, et nous vous montrons que toutes ces choses sont progressives et
que, lorsqu'elles ne suivent pas les développements de l'humanité, alors
elles deviennent des fléaux au lieu d'être des bienfaits. Nous vous disons et
nous vous prouvons que la volonté divine a fait la volonté progressive, et
vous voulez vous arrêtez, vous immobiliser ; et l'Europe tout entière
s'agite, et cette Allemagne religieuse et chrétienne, plus religieuse que
nous, plus sceptique que nous, cette Allemagne vient précisément, au nom de
la philosophie, invoquer la France, et la France, loin de répondre à son
appel, comprime ce mouvement ! Arnaud, de l'Ariège, abordait ainsi le problème italien : Les hommes d'État qui ont inspiré cette expédition romaine
se sont-ils bien rendu compte de la gravité du problème qui s'agitait en
Italie ? Ont-ils compris que le problème résumait en lui tous les droits,
tous les intérêts, toutes les espérances de la société moderne ?... Toutes
les questions qui s'agitent chez les divers peuples, qui ont été résolues
partiellement sur les divers points de l'Europe semblaient s'être donné
rendez-vous en Italie, au centre de la catholicité. La question de la
souveraineté du peuple, la question de l'unité politique, la question de la
nationalité, et, enfin, cette question qui domine toutes les autres, la
question des rapports qui doivent s'établir entre l'élément religieux et la
société temporelle, c'était l'esprit des temps modernes, l'esprit
démocratique qui venait comparaître devant l'autorité catholique. Ces deux
puissances allaient-elles se reconnaître, s'embrasser et se réunir pour
asseoir la société sur cette double et indestructible base, ou bien ces deux
puissances, ennemies irréconciliables, allaient-elles se séparer et se
combattre ?... Messieurs, ce but bien arrêté, la pensée constante du
gouvernement était, suivant moi, le renversement de la République de Rome,
l'établissement de la souveraineté temporelle du pape. On se serait bien
gardé, lorsque cette affaire a été engagée, de manifester clairement ce but,
cette pensée. Toute la France se serait alors levée avec indignation. Nous
n'avions pas à intervenir à Rome et c'était un danger, disait-il aussi, à son
tour, que de permettre à une nation d'intervenir dans les affaires
intérieures d'une autre nation. Il était bien clair qu'on n'avait pas agi
sincèrement, puisqu'on n'avait pas interrogé l'opinion romaine. Un
gouvernement républicain avait menti à ses principes et avait détruit au
dehors ce qu'il servait à l'intérieur. Le motif de cette contradiction était
religieux ; toute la question était religieuse. Je
veux savoir, demandait l'orateur à Montalembert, si vous inscrivez sur votre drapeau que j'ai suivi
longtemps : catholicisme, souveraineté, liberté du peuple, ou bien :
catholicisme, absolutisme, compression. On ne pouvait répondre, et la
réponse n'eût rien signifié. Il faut toujours un
principe d'autorité, disait Arnaud, seulement c'est une autorité morale,
spirituelle, au lieu d'être un principe despotique. Aucune concession
ne serait obtenue de Pie IX, et à cause de notre intervention même. Ainsi vous aurez compromis le principe du gouvernement
républicain, vous aurez méconnu le principe de la souveraineté nationale.
Vous êtes allés protéger les intérêts de l'Eglise ; vous aurez compromis son
influence. Je vous demande quel est le résultat que vous voulez obtenir. Je
ne sais quelles espérances vous allez faire concevoir à l'Assemblée qui
attend votre réponse. Pour moi, je n'en conserve aucune. Je crois que la
souveraineté temporelle du pape va être rétablie dans son absolutisme et
qu'alors vous serez réduit à ce triste rôle d'avoir été les complices de
l'absolutisme. Républicain convaincu d'extrême gauche, et catholique, sa
fervente conception politique religieuse différait de celle de Leroux. Il
voyait dans l'union de ce catholicisme, — car il était plus catholique, au
moins par la pensée, que chrétien, — et de la république sociale la garantie
du bonheur du genre humain. L'affaire de Rome démolissait son rêve ; elle lui
prouvait que le Saint-Siège avait des vues toutes différentes de celles que
sa' générosité personnelle et quelques-uns de ses amis lui avaient
attribuées. Je suis de ceux, disait-il
encore, à qui l'expédition de Rome a causé une
douleur profonde, douleur catholique ; j'y vis un coup funeste porté à
l'influence de l'Église ; démocrate, j'y vis un attentat contre les droits
les plus sacrés d'un peuple... On dit que là souveraineté temporelle du pape
est indispensable pour garantir l'indépendance du Saint-Siège... Est-ce que
vous ne craignez pas de calomnier l'Église quand vous supposez qu'elle ne peut
pas accomplir sa mission sans condamner un peuple à la servitude éternelle ?
Eh bien, moi, qui suis à la fois catholique et partisan du principe de la
souveraineté nationale, je suis convaincu que le catholicisme n' a pas besoin
de la violation d'un droit quelconque, qu'il se conciliera avec tous les
droits des peuples. La séparation des deux pouvoirs peut désormais
s'accomplir sans inconvénients. L'émotion à laquelle l'orateur était
en proie renouvelait le sourire de ses collègues. Ce n'était pas seulement,
cependant, le sort de la papauté qu'il indiquait, c'était, sans qu'il s'en
doutât, celui de la France et de deux provinces ; il indiquait aussi le
véritable point de vue chrétien. Mais qui, dans ce Parlement nivelé par la
réaction — qui a eu si constamment et si exclusivement le monopole des
nivelages sans excuse — qui donc était à même de comprendre un aussi haut
langage ? Qui, dans cette Chambre si peu française, qui avait accueilli par
des applaudissements furieux la nouvelle de la chute du Parlement romain et
de la prise de la Ville Éternelle ? Tocqueville, insuffisamment armé sur un
pareil terrain, déclara simplement que l'Assemblée n'était pas un concile.
Puis il parla de l'influence à maintenir en Italie,
de rendre à la papauté cette situation indépendante
et libre dont le monde catholique a besoin, tout en assurant les États
romains contre le retour des abus de l'ancien régime... Lui était sûr
du pontife : Je ne doute pas que Sa Sainteté, qui a
donné tant de gages éclatants de ses goûts bienveillants et libéraux, ne
comprenne la nécessité de notre position à cet égard. La France républicaine
a donné au Saint-Père des preuves éclatantes de sympathie. En retour de ses
témoignages, pour prix des sacrifices qui ont été déjà faits, la France a le
droit de s'attendre à ce que les conditions nécessaires à l'existence d'un
gouvernement libéral et digne des lumières du siècle ne soient pas refusées.
Il défendait la guerre. La gauche, si nous n'avions
pas agi, nous l'aurait également reproché, disait-il en substance. Il
cherchait en vain dans l'histoire un spectacle plus
singulier et plus grand que celui qu'a présenté le siège de Rome.
Enfin ce siège avait été le seul moyen de rendre le pape indépendant. Avec le système contraire, vous en arriverez toujours à ce
que, directement ou indirectement, une puissance étrangère exercera sur la
volonté du Saint-Père une pression dont la France en particulier et le monde
catholique en général peuvent avoir à se plaindre. Un membre de la
gauche s'écria : Il fallait nous le dire dès le
principe : vous nous avez trompés. Le ministre ne retint pas
ceci : Je n'y étais pas ! — Il donnait
ensuite du régime abattu une description à laquelle — comme le lui criait la
gauche — il ne pouvait croire lui-même ; mais Rayneval lui en avait fourni la
matière. Il ajoutait, par précaution peut-être : Je
suis convaincu et je ne crains pas de risquer cette prédiction à la tribune,
que si le Saint-Siège n'apporte pas dans les conditions des États romains,
dans leurs lois, dans leurs habitudes judiciaires et administratives des
réformes considérables, s'il n'y joint pas des institutions libérales
compatibles avec la condition actuelle des peuples, je suis convaincu, dis-je,
que, quelle que soit la puissance des mains qui s'étendront d'un bout de l'Europe
à l'autre pour le soutenir, ce pouvoir sera bientôt en grand péril. J'admire
aussi cette Église catholique, dont vous avez entendu tout à l'heure un si
vrai et si éloquent représentant. Comme lui, j'admire cette immense
association catholique qui couvre le monde, ces cent cinquante millions
d'hommes répandus sur toute la surface de la terre et qui, à travers la
différence des races, des climats, des habitudes, du langage, ont partout le
droit de se traiter de frères. J'ai une admiration profonde, plus grande que
je ne pourrais le dire, pour cette puissance morale, la plus grande qu'on vit
jamais, et qu'on appelle l'Église catholique ! Je suis convaincu que les
sociétés qui sont sorties d'elles ne vivront pas longtemps paisibles sans
elle. Je désire ardemment, non seulement son maintien, mais qu'elle conserve
son pouvoir de gouvernement et d'expansion dans le monde. Il suppliait
le Saint-Père d'entendre son appel, et cette simplicité donnait la mesure de
son espoir. Quel homme de bien pourrait douter de la
parole de Pie IX ? C'est appuyé sur sa ferme volonté que notre expédition
d'Italie n'aboutirait pas à une restauration aveugle et implacable. Ce
discours si modéré dans ses critiques, si déférent, si exagéré même en
soumission vis-à-vis de la papauté, ne put cependant être admis de Falloux à
cause des suites qu'il risquait de comporter, et bien qu'il le reconnut en
effet, irréfutable, si on le lisait de bonne foi et
de sang-froid[12]. J'eus, dit-il, le
pressentiment qu'il serait dénaturé à Gaëte et exploité contre nous[13]. Il fit donc
part de cette impression à son collègue, qui consentit à retrancher quelques
lignes[14]. Jules Favre lui répliqua en renouvelant les critiques
précédentes, justifiées par les faits. Le voile
s'est enfin déchiré, disait-il ; la moralité
de l'expédition de Rome peut être jugée par l'aveu du cabinet. Plus
durement qu'Arnaud de l'Ariège, et sans ses réticences en faveur de la
papauté, Favre prouvait la perfidie souterraine qui avait permis une pareille
supercherie, alors que le devoir des ministres, tout tracé, était d'exécuter
le vote de l'Assemblée constituante. Il expliquait pourquoi la réaction
progressive avait marché contre l'intérêt de la France qui avait toujours
été, à toutes les époques, sous tous les régimes, dans toutes les politiques,
l'indépendance de l'Italie ; cette indépendance était une des conditions essentielles de la grandeur, de la sécurité, du
libre développement des intérêts français. Il rappelait l'absence de
parti pris de la gauche, en dépit de ses avertissements trop justifiés, le
crédit fait au ministre, la créance accordée un certain temps à ses paroles
malgré certaine influence qui existait déjà dans le
ministère et qui y était parfaitement connue, qui y transpirait, qui s'y
déguisait mal. La gauche redoutait alors qu'on utilisât l'ordre du
jour adopté afin de le dépasser. Le scrupule,
Messieurs, fut soumis aux deux honorables membres du cabinet qui étaient dans
le sein du comité, et ils s'élevèrent avec une vertueuse indignation contre
toute espèce de pensée semblable ; ils nous donnèrent l'assurance que rien de
pareil n'était alors préparé. Il récapitulait le mensonge des
déclarations successives faites par le président du Conseil, et au milieu des
vociférations grossières de la droite, il constatait : Vous avez trompé la France ! Au 7 mai, blâmé par le
vote de la Chambre, le ministère aurait dû, en réalité, se retirer. Est-ce que nous ne devons pas, Messieurs, nous élever
au-dessus de ces tristes questions de personnes pour aborder enfin la théorie
et les principes, c'est-à-dire ce qui conserve et ce qui sauve les États ? (Rumeurs à droite.) Que diriez-vous si demain, sur une question vitale pour
l'honneur et pour la dignité de la France, vous infligiez un blâme direct au
cabinet et que le cabinet restât aux affaires ? Vous prendriez cet acte comme
un acte d'insurrection contre la majorité, et vous auriez raison. Vous
pourriez dire que ce jour-là les institutions constitutionnelles sont
faussées, et vous pourriez ajouter que tous les hommes d'État qui acceptent
une pareille position font un tel sacrifice à leur dignité qu'il faut qu'il y
ait derrière une bien grande compensation pour l'expliquer. Mais on
était décidé à tout pour faire les élections et s'emparer de Rome afin d'y
rétablir le pape. Il y avait dans le sein du cabinet et ailleurs cette même
volonté persévérante, persistante, qui ralliait l'Assemblée constituante et
qui assurait qu'elle serait plus forte qu'elle, plus forte que le pays... La
France était subordonnée à la restauration papale. Votre
parole d'honneur dix fois donnée, la constitution de votre pays, que vous
avez jurée probablement, et que vous devez faire défendre, le vote souverain
de l'Assemblée, votre humiliation devant ce vote, l'envoi de votre argent,
tout cela, vous le foulez aux pieds, vous le tenez comme non avenu et,
persévérant dans ce but que vous voulez audacieusement attendre... ce but
vous y marchez à travers tous les obstacles... Cet ordre d'attaquer, je viens
de le prouver, violait tout ce qu'il y a de plus sacré chez les hommes ; la
loi fondamentale, l'honneur civil, l'honneur militaire, la volonté de la
souveraineté nationale, tout cela est mis sous les pieds. Voulez-vous que je
vous dégage de l'étreinte de toute cette responsabilité, que, pour un
instant, je vous suppose investis dans ce pays de la puissance souveraine :
est-ce que je ne serais pas encore en droit de vous demander au nom de quel
principe vous avez agi, quel est l'intérêt que vous avez sauvegardé et
pourquoi, chez un peuple ami, vous avez déclaré la guerre ? Répondez-moi non
pas par des subterfuges et de grandes paroles, mais par un droit qui me
console, qui relève la diplomatie française de l'abaissement où elle a été
jetée malgré notre victoire. Quoi ! est-ce que c'est un rêve dans lequel nous
sommes ? Est-ce que tous les principes sont bouleversés ? Est-ce que toutes
les notions du droit des hommes sont effacées ? Notre intervention fut faite
non seulement contre Rome, mais contre la France même. L'ordre fatal du 29
mai a été pour la liberté française une occasion de chute éclatante ; si ce
pays s'est arrêté dans la marche qu'il poursuivait, si des insurrections y
ont éclaté, si nous sommes en état de siège, si la liberté est violée, c'est
le 29 mai qui est seul coupable... Les renseignements de Lesseps étaient
exacts, et la résistance romaine fut bien une résistance nationale. Nous ne
nous sommes d'ailleurs pas contentés de prendre Rome, nous avons forcé la
Constituante romaine à se dissoudre. Voilà le premier acte, et laissez-moi
vous dire qu'il sera jugé plus sévèrement que l'attentat du 18 brumaire. Ensuite
nous suspendons la liberté de la presse, nous établissons l'état de siège,
nous donnons les places, non pas même aux hommes de Pie IX, mais à ceux de
Grégoire XVI. Nous rétablissons le gouvernement des prêtres dont Oudinot
avait remarqué lui-même que personne ne voulait plus. Ordre est donné par
nous que tous les emblèmes républicains soient remplacés par les armes
papales... Il était trop tard pour revenir sur ce qui avait été fait, mais il
était encore temps, peut-être, de réparer une partie du mal. Favre demandait
qu'on fît appel à l'opinion nationale des Romains, afin que nous ne
restaurions pas le pouvoir clérical sans les avoir consultés. Mais si le vœu national déclare que le gouvernement papal
a vécu, que tous les abus du pouvoir sacerdotal ne peuvent pas être rétablis
dans cette malheureuse Italie, ayez donc au moins le courage de votre
honnêteté, suivez les exemples puisés dans votre famille ; souvenez-vous
qu'en 1809 l'empereur Napoléon, dont vous citez quelquefois les leçons — et
il faut les suivre quand elles sont glorieuses et nationales[15] (à gauche : Très bien !)
— rencontre aussi la résistance du pape et qu'il
déclarait que la puissance temporelle du pape était incompatible avec une
bonne et saine administration, et qu'elle devait cesser. Et à la parole de
l'empereur, quelle est celle qu'il faut joindre ? Celle de son neveu, celle
du président actuel de la République qui, en 1831, écrivait à Grégoire XVI
que les populations, fatiguées du joug clérical, voulaient définitivement le
briser, et il suppliait le Saint-Père de renoncer au pouvoir temporel. Falloux se chargea de répondre. Selon lui, la première
moitié du discours de Favre ne contenait que des injures, la seconde que des
arguments rétrospectifs, entremêlés d'autres rares, plus directs ; à ces injures le ministre de l'Instruction publique
répondait de la façon la plus grossière et la plus pauvre en attaquant la
personnalité de Favre, auquel il reprochait d'avoir changé d'avis. Quant à la passion des arguments empruntés à l'Assemblée
constituante, les souvenirs de cette Assemblée elle-même sont trop présents
pour que j'y revienne. J'aurais d'ailleurs une réponse qui pourrait me
dispenser de toutes les autres : c'est que la politique de l'Assemblée
constituante n'engage en aucune façon la politique de celle-ci. Et sur
l'action d'Oudinot : J'arrête ici le ministre et le
somme de nous répondre : ou le général a dépassé les instructions, ou il
avait des instructions secrètes ; ces instructions émanaient de cette
influence à laquelle il a fait si souvent allusion, mais que, malgré ces
allusions si nombreuses, je n'ai pas reconnue ; influence secrète,
souterraine, qui a été si persévérante, si opiniâtre dans un dessein dont il
ne nous a pas encore déroulé toute la trame. Je reprends le dilemme : ou le
général Oudinot a dépassé ses instructions, ou il avait des instructions
secrètes. Je poserai à mon tour un dilemme à l'honorable M. Jules Favre : ou
le général Oudinot se croyait appelé à Rome au 30 avril, ou il se croyait
repoussé ; s'il se croyait appelé, il a été dans le sens de nos déclarations,
de nos discours, de nos engagements, dans le sens de nos informations ; s'il
se croyait repoussé et qu'il ait obéi à ses instructions secrètes, ces instructions
pouvaient-elles lui ordonner d'aller au-devant de l'attaque d'une ville
fortifiée avec 3.500 hommes et de laisser derrière lui son parc d'artillerie
et le reste de l'expédition qui devait le suivre deux heures après ? Voilà le
dilemme que je pose à M. Jules Favre. (On
rit.) Ou le général Oudinot n'avait pas
d'instructions secrètes et il a été sur la foi de renseignements qu'il avait
lieu de croire certains et qui l'étaient, en effet, car cela a tenu à
vingt-quatre heures à l'entrée de Garibaldi. Tout le discours était de
cette vérité et de cette sincérité. Quant à Lesseps : Quel est celui auquel M. Jules Favre veut bien prêter une si grande
autorité dans ce débat ? Est-ce à M. de Lesseps, que le National a
publiquement accusé d'aliénation mentale, ou celui dont il a fait huit jours
après un des grands citoyens de cette époque ?... (Hilarité.)
Avant d'apporter de telles autorités à la tribune et d'essayer d'en foudroyer
ses adversaires, il faudrait que M. Jules Favre se fût mis d'accord avec l'un
des deux M. Lesseps, ou qu'il les eût mis d'accord entre eux. (Rires prolongés.) Falloux soutenait avec
tranquillité que nous avions été réaliser à Rome le désir des populations et
le prouvait d'après les dépêches de M. de Corcelles, que ce passage suffit à
faire saisir : Personne ici ne doute que cette
résistance, si bien préparée par la politique de M. de Lesseps, ne soit
étrangère à la très grande majorité de la population romaine. Nous n'avons à
faire qu'aux débris de toutes les révolutions, italiennes, polonaises, à des
réfugiés de tous les pays qui considèrent Rome comme leur dernière forteresse.
Falloux assurait : Rome a béni sa délivrance, et je
me serais étonné prodigieusement qu'il en eût été autrement chez les Romains.
Comment en aurait-il pu être autrement ? Les
révolutionnaires se contentaient de la République romaine, les catholiques et
la France l'avaient voulue la capitale de la République universelle
chrétienne... La première ville du monde, la seconde patrie de tout le monde,
le pays dans lequel, après le sien, tout le monde vit par l'intelligence, par
le cœur, par les sympathies, où, depuis dix-huit siècles, tout le monde est
venu apporter sa pierre, son respect, où la poussière même est imprégnée de
vénération, du sang des saints, des héros, des martyrs... Le catholicisme
était indispensable à l'Italie... Est-ce que ce n'était pas au temps qu'elle
était la plus catholique qu'elle était la plus brillante ? Est-ce que le
catholicisme, est-ce que le pouvoir temporel ont abruti le Dante et le Tasse
? Ces arguments portaient. Notre mission avait été de rendre au Saint-Siège l'indépendance dont tous les
catholiques ont besoin... Pie IX était de plus un pape adorable.
Napoléon avait été surtout pour la papauté, et les pages différentes de son histoire
à ce sujet n'étaient ni les plus belles, ni les plus
utiles. Au surplus : ne pas servir le
catholicisme eût équivalu à ne pas servir la France. Le procès était
donc fait, une fois de plus, à tout l'idéal révolutionnaire. Je sais bien, ajoutait-il, que
vous avez à cela une grande réponse, car là où je crois voir un grand tort,
je cherche toujours une grande excuse, c'est de dire : Nous versons beaucoup
de sang, mais nous arriverons à un règne magnifique, à la paix universelle, à
l'unité entre les peuples... Est-ce que l'unité a jamais été un gage de paix
? Est-ce que l'Europe n'a pas été unitaire ? Est-ce que l'Europe n'a pas été,
pendant plusieurs siècles, entièrement féodale ? Est-ce que jamais nous avons
vu répandre plus de sang qu'à cette époque ? Est-ce que l'Europe, sous Louis
XIV, n'a pas été entièrement monarchique ?... Est-ce que l'unité monarchique
n'a pas régné plusieurs siècles en Europe ? Est-ce que ces siècles ont été
exempts de bataille et de sang répandu ? Non, cette paix universelle n'a pas
existé, elle n'existera pas parce qu'il faudrait, pour cela, détruire les
lois primitives de l'espèce humaine. Voilà à quoi votre politique se heurte
toujours... Et cependant que vous rêvez ces impossibilités, vous laissez
tomber votre pays dans les abîmes... Vous vous attaquez aux lois primordiales
de l'espèce humaine et du cœur humain... Or, tant que vous n'aurez pas changé
la configuration du globe, tant que vous n'aurez pas effacé les intérêts
opposés des peuples et les avantages que les nations s'y disputent, tant que
vous n'aurez pas changé la loi des climats et des races, vous n'aurez rien
fait avec votre système d'unité. Il se refusait, quant à lui, à cette lutte surhumaine contre les traditions et les
caractères du pays... Après quelques nouvelles discussions, l'ordre du
jour pur et simple était adopté. Falloux, chaudement félicité, gardait une
attitude modeste. Tous pensaient le débat définitivement clos ; pourtant, il était à peine ouvert sur l'avenir et sur les
conséquences futures de notre intervention ; personne ne se doutait alors
quelles énormes difficultés cette affaire de Rome renfermait encore dans ses
flancs et combien de crises elle avait à traverser avant d'arriver à une
conclusion définitive[16]. La réaction seule pouvait s'en étonner. Avant l'ordre du
jour, Quinet s'était efforcé de faire comprendre, à la suite de Ledru-Rollin,
de Jules Favre et des précédents montagnards, en prenant des exemples dans
les règnes de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe, que le devoir
pour la France était de se libérer de la Sainte-Alliance. La Restauration a eu son expédition en 1823, par laquelle
elle a étouffé le libéralisme constitutionnel de l'Espagne ; elle l'a expié
en 1830. Le gouvernement de Louis-Philippe a eu, en 1847, son expédition de
Portugal, par laquelle il a détruit la révolution portugaise ; il l'a expié
en 1848. De l'une de ces entreprises à l'autre, il y eut cet étrange progrès
que, dans la première, le gouvernement de la Restauration était au moins
conforme à son principe en restaurant la légitimité et que, dans l'autre, le
gouvernement de la Révolution se détruisait lui-même en détruisant à Lisbonne
le principe de la Révolution française. Telle a été, depuis Waterloo, la
politique de la Sainte-Alliance : faire servir la France d'instrument contre
les amis de la France. Par cela, deux buts étaient poursuivis à la fois :
premièrement, détruire par nos mains les gouvernements libres ; secondement,
nous déshonorer par nos propres succès. Car, tandis que les gouvernements
absolus restaient conformes à leurs doctrines, ils obligeaient la France de
s'armer contre les siennes ; ils la forçaient de combattre contre ses
convictions et ses lois, sachant bien qu'ils n'avaient rien fait s'ils ne
réussissaient à la dégrader par ses apostasies et à tourner son épée contre
elle-même. Les gouvernements précédents ont subi cette loi de l'étranger ;
ils sont tombés pour l'avoir acceptée. 1830 et 1848 sont l'un et l'autre un
effort de la nationalité française pour échapper aux fourches caudines de la
Sainte-Alliance. Quand la révolution de 1848 a éclaté, il n'est pas un homme
dans l'étendue de ce territoire qui n'ait cru que la France allait sortir du
cercle de servitude où elle tournait depuis 1815. Oui, tous crurent que la
politique de l'invasion avait disparu, que la patrie renaissait, que le joug
de la conquête se brisait, que nous sortions enfin de l'enceinte maudite de
Waterloo[17].
Dans la petite brochure où il expliquait le sens des paroles qui avaient
passé peu remarquées et presque incomprises, Quinet montrait cette expédition
romaine préparée en silence, proposée d'une manière sournoise à la
Constituante et menant la France — pourtant républicaine — à renouer
elle-même cette chaîne à peine rompue des traités de 1815, servant
d'exécuteur à la réaction. Et il expliquait ainsi la nécessité, pour notre
patrie, de la résurrection italienne : Il suffit
d'ouvrir les yeux pour voir que le danger qui menace la France n'est plus
seulement une coalition de rois, mais un changement dans l'équilibre de
l'Europe. Deux races d'hommes se lèvent et se constituent en face de nous, la
nationalité slave et la nationalité germanique ; par le seul poids de leur
masse, elles menacent de nous écraser si l'équilibre ne se rétablit pas d'un
autre côté. Dans ce danger qui tient non aux passions, mais à la nature même
des choses, le salut de la France est d'aider à constituer des nationalités
nécessairement amies dont l'alliance soit fondée sur la communauté du sang,
sur les rapports d'origine et de langue. Pendant que la Prusse évoque la race
germanique, la Russie la race slave, qui ne voit que la France, en frappant
de mort un membre de la race romane, se frappe elle-même ? A ce point de vue,
la nationalité italienne est pour nous une des premières conditions de vie
dans le nouveau travail des races en Europe. C'est pour ainsi dire un de nos
propres membres ; quand vous le livrez ou que vous aidez vous-mêmes à
l'anéantir, il est évident que vous livrez la France elle-même ; le meurtre
est à la fois un suicide[18]. Il rappelait
avoir montré déjà l'esprit prêtre s'ébattant
sur la France à la place de l'esprit religieux,
mais sans succès, les politiques à grande vue
ayant déclaré ne rien voir de semblable ; et il
arrivait que, dès la première expédition de la République hors de ses
frontières, la France, enfroquée dans une croisade du Saint-Office, s'en
allait glorieusement dérouler à travers le monde, sous le ciel d'Arcole et de
Rivoli, la bannière de Loyola[19]. Comment
expliquer un phénomène aussi déconcertant ? — La France, qui a réalisé cinq
ou six révolutions politiques, ne s'est jamais décidée à faire une révolution
religieuse, au point même d'avoir conservé la forme du système religieux du
moyen âge. De là ses contradictions. Courant d'une
extrémité de la liberté à l'extrémité de la servitude, elle s'élance par
bonds dans l'avenir, elle plane avec ravissement sur l'horizon social.
Soudain une petite chaîne bénie, qu'on avait oubliée et qui la tient par le
pied, se tend sous une main inconnue[20]. Et il évoquait
les arbres de la liberté baptisés par les prêtres. Il ne désespérait
d'ailleurs pas de l'esprit révolutionnaire. Hommes
de bonne foi, dites-moi comment vous entendez établir l'ordre en bouleversant
toutes les notions de la conscience humaine et sauver la société en
l'appuyant sur la négation même du droit social : la nationalité détruite, la
religion prise pour masque, le chemin frayé à l'invasion, une Assemblée
nationale librement élue et dispersée par le sabre, une guerre religieuse
sans foi, une croisade sans Christ... Vous voulez réparer le désordre moral ?
Mais où est-il, s'il n'est dans ce que vous faites ?... Si je n'avais fait
partie d'une grande Assemblée, je ne me serais jamais douté de la légèreté
d'esprit, feinte ou réelle, avec laquelle les hommes décident ces immolations
de peuples, qui excitent de siècle en siècle des frémissements d'indignation
dans la conscience humaine[21]. Il craignait
que sa patrie n'eût à expier cette mauvaise action d'avoir été tuer la
liberté dans une nation qu'elle avait appelée à la liberté. Nous traînons encore aujourd'hui après nous la solidarité
du partage de la Pologne... Jusqu'à quelle génération s'étendra la solidarité
du meurtre de l'Italie ?... Belle question, vraiment, pour nos hommes d'État
! Le premier châtiment de ceux que ces questions font sourire est l'aveu que leur
conscience est morte, l'extinction de la conscience étant le vrai signe d'un
ordre de choses qui finit. C'est, du reste, une vue bien misérable de
s'imaginer qu'un peuple échappe à ce que la Providence veut faire de lui ; on
croit que tout se débat dans les urnes, et l'on ne voit pas qu'une force
supérieure aux fantaisies des peuples fait souvent sortir de l'urne le
contraire de ce qu'ils y ont déposé. Depuis Louis XVI, que d'efforts la
France n'a-t-elle pas faits pour se soustraire à la République ! Deux fois
elle s'est refaite de ses mains une dynastie pour tromper l'avenir ; elle a
cru d'abord s'arrêter dans la gloire avec la dynastie des Napoléon. Cette
dynastie lui ayant manqué, elle a accepté la Charte de la branche aînée.
Cette branche rompue, elle s'est rattachée au trône des d'Orléans et, malgré
tant d'efforts pour s'abuser, se tromper, s'arrêter sur la pente, une heure a
suffi pour établir la République. La journée du 24 février 1848 est grande,
parce que, dans ce moment, la France entière a eu conscience d'un fait déjà
consommé chez elle depuis un demi-siècle, à savoir que la monarchie est morte
depuis la mort de Louis XVI. Elle a reconnu distinctement, ce jour-là, que
ceux qu'elle avait salués du nom de roi depuis cinquante ans n'avaient eu
qu'un règne d'emprunt, en sorte que tous ses efforts pour se rattacher à la
monarchie n'ont servi qu'à la précipiter vers la République. Plus que jamais
on peut donner à l'histoire de France le titre de l'ancienne chronique : Gesta
Deiper Francos, les actions de Dieu par la main des Français. La main
aveugle travaille et ne connaît pas son œuvre ; le plus souvent elle fait le
contraire de ce qu'elle croit faire. Ce peuple peut bien se frapper lui-même
et donner un jour la direction des affaires à tous ses ennemis ; il peut
ébaucher la servitude, c'est la liberté qui sort de l'ébauche. Encore une
fois la main aveugle touchera un but qu'elle ne connaissait pas : Gesta
Dei per Francos. Au 24 février, ils croyaient saisir la monarchie ; ils
ont rencontré la république ; aujourd'hui, ils croient combattre le XIXe
siècle, ils le précipitent dans l'inconnu[22]. — Que pensait
de ce langage, dans son for intérieur, le prince-président, lui qui, en 1844,
écrivait de Ham à Edgar Quinet : Il n'y a rien à
craindre pour la liberté, tant que la France possède dans son sein des hommes
tels que vous, qui rappellent aux peuples leurs droits et leurs devoirs[23]... * * *Face à ces paroles il y avait l'Europe qui les suscitait, en partie, il y avait la réalité du présent et de l'avenir dont les discours n'exprimaient souvent que d'assez loin les données exactes. Ces députés et ces ministres, sincères ou attachés à une idée, n'intéressaient la France et l'Europe et ne la servaient véritablement que dans la mesure où ils répondaient aux besoins nationaux et européens qui demandaient à être satisfaits ; interprètes et serviteurs de nécessités, divisés dans leurs appréciations, ils ne pouvaient être mis d'accord que par la réalité. Efforçons-nous d'en tracer un tableau rapide, mais net, à l'aide des témoignages contemporains et des faits. Tocqueville ne possédait probablement pas la sérénité dont
il avait fait preuve à la tribune. Au milieu de
l'Europe, a-t-il dit, la situation de la
France était embarrassée et faible[24]. Nulle part la révolution n'avait réussi à fonder une
liberté régulière et stable : partout les anciens pouvoirs étaient en voie de
se relever du milieu des ruines qu'elle avait faites, non pas, il est vrai,
tels qu'ils étaient tombés, mais fort semblables. Nous ne pouvions aider
ceux-ci à se raffermir, ni assurer leur victoire, car le régime qu'ils
rétablissaient était antipathique, je ne dis pas seulement aux institutions
que la révolution de Février avait créées, mais au fond même de nos idées, à
ce qu'il y a de plus permanent et de plus invincible dans nos nouvelles
mœurs. De leur côté, ils se défiaient de nous, et avec raison. Le grand rôle
des restaurateurs de l'ordre général en Europe était donc interdit ; ce rôle
était d'ailleurs déjà pris par la Russie et le second seul nous fût resté.
Quant à placer la France à la tête des novateurs, il fallait encore moins y
songer pour deux raisons : La première, c'est qu'il eût été absolument
impossible de conseiller ceux-ci et de se flatter de les conduire à cause de
leur extravagance et de leur détestable impéritie, la seconde, qu'on ne
pouvait les soutenir au dehors sans tomber sous leurs coups au dedans. Le
contact de leurs passions et de leurs doctrines eût bientôt mis la France en
feu, les questions de révolution dominant alors toutes les autres. Ainsi,
nous ne pouvions nous unir aux peuples qui nous accusaient de les avoir
soulevés et trahis, ni aux princes qui nous reprochaient de les avoir
ébranlés. Nous en étions réduits au bon vouloir stérile des Anglais : c'était
ce même isolement qu'avant février, avec le continent plus ennemi et
l'Angleterre plus tiède[25]. — Pour
revendiquer la cause des peuples, il était trop tard ; la France ne le
pouvait plus et son gouvernement n'y aurait pas consenti ; les peuples, en
outre, n'avaient jamais répondu franchement à notre appel. Le ministre en
écrivant cette page, qui dépassait la seule signification qu'il entendait lui
donner, reconnaissait, en quelque sorte, que la Révolution avait avorté à
l'intérieur comme à l'extérieur et que cet échec nous avait diminués. Il
paraît même un peu gêné de la politique modérée qu'il préconise,
indispensable, pourtant, comme si, malgré lui, son intuition se rendait
compte de celle qui aurait pu et dû précéder. La
nation française qui avait fait, et qui faisait encore, à certains égards,
une si grande figure dans le monde, regimbait contre cette nécessité du temps
; elle était restée superbe en cessant d'être prépondérante ; elle craignait
d'agir et voulait parler haut et demandait aussi à son gouvernement d'être
fier, sans pourtant lui permettre les hasards d'un pareil rôle[26]. Et une
constatation plus importante encore achève ici[27] de prouver
combien la France s'était restreinte en circonscrivant la Révolution née chez
elle à ses seules frontières : Jamais les regards
n'avaient été attachés avec plus d'anxiété sur la France qu'au moment où le
cabinet venait de se former. La victoire si facile et si complète que nous
remportâmes le 13 juin dans Paris eut des contre-coups extraordinaires dans toute
l'Europe. Les révolutionnaires à moitié détruits, ne comptaient plus sur cet
événement pour se rétablir, et ils redoublaient d'efforts afin d'être en état
d'en profiter. Les gouvernements, à demi vainqueurs, craignant d'être surpris
par cette crise, s'arrêtaient avant de frapper leurs derniers coups. — La
journée du 13 juin fit pousser des cris de douleur et de joie d'un bout du
continent à l'autre. Elle décida tout à coup la fortune et la précipita du
côté du Rhin[28]. La politique conservatrice
s'était prouvée une fois de plus anti-nationale[29]. C'est elle qui
aida, dès le début, à la progression croissante de cette Prusse dont l'étoile
scintillait à travers une brume épaisse vers l'Allemagne incertaine, mais vouée
d'avance à la soumission[30]. Saint-René Taillandier avait été frappé, en 1840, que les deux traits les plus saillants de la Prusse fussent une ardeur de destruction inouïe dans le domaine de la pensée et, en politique, une haine implacable de la France[31]. Il y distinguait aussi déjà une tendance à l'unité, mais en s'interrogeant sur le danger qui menaçait son pays du côté du Rhin, il s'assurait que l'unité, en elle-même, n'était pas inquiétante ; seule restait la manière dont elle serait accomplie[32]. Les rapports avaient été sérieusement tendus sous le roi-citoyen et il est superflu de rappeler les strophes de Bekker auxquelles avait répondu Musset. L'incident, vite oublié en France, avait laissé par delà la frontière un durable souvenir, habilement exploité au surplus[33]. — En 1833 déjà, un rédacteur de la Revue des Deux Mondes, Lerminier[34], avait écrit : La Prusse a commencé de tramer la solidarité des intérêts matériels ; elle impose à l'Allemagne, qu'elle isole de l'Autriche, la législation de ses douanes et de son commerce... Le joug est préparé : il sera de fer et de gloire, il sera brillant et dur ; ils peuvent passer la tête. Mais si, avec plus de confiance dans son génie et la volonté de Dieu, l'Allemagne demande au temps le développement d'elle-même et de ses destinées, si, fidèle à sa propre nature, elle ne veut arriver à l'unité que par la liberté, elle méritera d'être un exemple au monde[35]. — En 1830, la révolution à Paris effrayait tellement Niebuhr qu'il en mourait de douleur. Le roi de Prusse, qui devait risquer les premières tentatives d'unité, confiait de son côté des angoisses presque similaires à son pieux ami Bunsen. La haine de la France emplissait le cœur mystique de ce prince indécis et, par moments, résolu. Une colère profonde, gardée secrète, l'avait secoué sur le passage des fils de Louis-Philippe fêtés en Allemagne, au point qu'il avait eu de la peine à retenir des larmes de rage. Au moment des affaires du Sonderbund, fort imaginatif, il avait cru assister aux premiers engagements d'une grande bataille ; aussi joua-t-il un rôle plus dramatique que celui de Metternich, si bien mis en lumière par Guizot dans ses Mémoires. Il combattait avec persévérance le radicalisme, c'est-à-dire, écrivait-il à Bunsen, la secte qui a scientifiquement rompu avec le christianisme, avec Dieu, avec tout droit établi[36] et, champion déjà de la réaction européenne, il jetait un appel à tous les souverains au nom de l'ordre ; dans la manière même dont il revendiquait alors son fief de Neufchâtel, il y avait l'accent d'un homme du moyen âge[37]. Tel était le prince contre lequel grondait la révolution de 1848 et qu'elle allait servir, au moins quant à son pays et à sa maison, et ne songeons-nous pas à Charles-Albert ? Tel se présentait l'homme insuffisamment renseigné, intelligent, mais engourdi par un rêve trop peu discuté, que la révolution allait extraire de tant de songe afin d'en faire le pivot d'une action indispensable[38]. Les fidèles s'en réjouissaient, persuadés qu'un mouvement populaire à Berlin, loin de détruire un Hohenzollern[39], le hisserait sur le pavois. En Allemagne, en Prusse, — comme dans l'Italie, comme dans
le Piémont, — le mouvement datait aussi de loin. Depuis Iéna, Berlin était
devenu le centre intellectuel où se préparait la mission de la Prusse[40]. La bourgeoisie
cherchait avec impatience à participer au gouvernement. La haute
aristocratie, fort atteinte par les annexions et les médiatisations, se
confinait dans ses terres ou se serrait autour de la monarchie, toute à son
grand mépris des tendances modernes. La petite noblesse, hobereaux, officiers
et fonctionnaires, se contentait de chercher pitance aux râteliers de l'État.
La vie véritable de l'Allemagne se réalisait surtout dans la classe moyenne,
professeurs, magistrats, industriels et banquiers. Les idées s'y étaient
modifiées ; dans toutes les branches de l'activité, science, philosophie,
négoce, ou même théologie, elles avaient pris un caractère pratique. Ces
nouvelles couches rêvaient d'ailleurs de prendre la direction de la pensée
allemande pour l'orienter vers une donnée constitutionnelle modérée en
groupant toutes les forces vives des divers États ; le gouvernement prussien
serait amené, de la sorte, à faire l'unité, mais dans l'intérêt général, au
plus grand bénéfice des intérêts allemands et non pas en faisant passer
l'intérêt de la Prusse avant l'intérêt national, comme il en advint plus
tard. Tout concourait à ce but, la presse, les professeurs, les salons. Les
sociétés secrètes, dont la jeune Allemagne,
agissaient également, certains groupes aussi, tel celui de Louis Borne, dont les ramifications, nombreuses et cachées, de la
brasserie à la caserne, du village à la cour, possédaient une influence
mystérieuse, profonde, encore mal étudiée[41]. — Le Zollverein
et l'université de Berlin firent l'unité pour la finance et l'intelligence
allemandes. Le Zollverein permettait à la Prusse
d'avoir l'œil et la main partout. Pas un mouvement, pas une pensée sur un
point de la confédération ne lui échappait, pas un acte sur lequel elle
n'influât ouvertement ou secrètement. Ses agents couraient l'Allemagne, ils
pénétraient dans le conseil des gouvernements ; sous prétexte de régler des
questions de douane et de commerce, ils influençaient leurs déterminations
politiques, forçaient leurs confidences. Si quelque État faisait mine de
résister, ses ministres, son souverain même, étaient violemment pris à partie
par une presse à gages savamment organisée. — Liés par l'union douanière,
enchaînés par des arrangements militaires, par des conventions d'étapes, de
postes et de chemins de fer, ils perdaient peu à peu toute indépendance, en
attendant que le sol lui-même devînt prussien[42]. La révolution en Allemagne, comme en Italie, n'avait pas procédé d'une cause simple, ainsi qu'en France. Elle n'était pas que politique et sociale ; une minorité la faisait politique, une autre minorité la faisait sociale ; la majorité y grandissait en quelque sorte consciencieusement, mais profondément, vers un autre but[43]. A travers l'idéal révolutionnaire apparu au premier plan, la révolution avait été produite par la tendance à l'unité ; la révolution et l'unité se confondaient ; la révolution aiguisait, en quelque sorte, la pointe du glaive, l'unité en formait la lame, la tradition la poignée ; la révolution une fois enfoncée au cœur de la marqueterie confédérale, la lame surtout resplendissait sur la scène, dressant à sa nouvelle cime la tradition comme signe de ralliement[44]. Les besoins, les souvenirs, les passions, étaient la matière transformatrice que le roi allait s'approprier, dont il pétrissait les bases de la nouvelle conception monarchique. — Une partie de l'équivoque prussienne, — comme de l'équivoque sarde, — fait mieux saisir, à mesure que nous avançons dans l'étude des faits, les contradictions au milieu desquelles persévérait Louis Bonaparte ; elles aussi remontaient loin ; nous les avons examinées sous Louis-Philippe ; l'heure sonnait où elles devaient mûrir leurs fruits. Tocqueville, quoique véridique en partie, semble avoir été sévère pour Frédéric-Guillaume[45]. Ce chimérique acquérait, paraît-il, peu à peu, sur certains points, le sentiment des réalités[46]. Sa situation, — comme pour Charles-Albert, comme pour Napoléon III, — servit aussi à le faire mal juger. Il luttait contre la peur que lui causait la révolution, afin d'en mieux tirer parti ; adversaire de l'esprit libéral et démocratique du siècle, il s'en servait pour les restreindre et favoriser l'esprit unitaire. Il n'y a pas là simplement, un jeu de brouillon dans lequel, s'il eût osé aller jusqu'au bout de ses désirs, il eût risqué sa couronne et sa vie[47] ; il y a plutôt l'effort désespéré, variable et tâtonnant, mais fatal, commandé par les circonstances, d'une politique utilisant les seuls moyens d'action que son époque lui propose. D'ailleurs, ces moyens, dont il pesa plus exactement qu'on ne le pense l'emploi, l'empêchèrent d'aller jusqu'au bout de l'entreprise, redevenue assez vite impraticable, car, pour briser les résistances qui ne pouvaient manquer d'opposer à l'établissement d'un pouvoir central les institutions existantes et l'intérêt des princes, il eût fallu appeler à son aide ces passions révolutionnaires des peuples dont Frédéric-Guillaume n'aurait pu se servir sans être bientôt détruit par elles[48]. Autre part, par suite des circonstances différentes aussi, l'utilisation en fut cependant possible ; Bismarck et surtout Cavour le démontrèrent. Napoléon III n'avait pas d'unité à réaliser quant à lui, et ce fut peut-être sa faiblesse ; à la tête d'une nation fort en avance sur les autres — la mère des nations, dira plus tard Meredith, — il avait comme mission principale d'organiser la démocratie, issue brusquement de la monarchie censitaire ; son erreur, à laquelle contribuèrent tous les partis de droite, le centre, au début de la révolution, le peuple même et la nation, fut d'estimer que cette démocratie ne s'organiserait jamais sans une autorité de forme encore monarchique,— la seule selon lui, — et les événements lui donnaient raison, — qui pût empêcher la victoire de la réaction grandissante en même temps que la perte totale de la révolution abattue. Nous comprenons ainsi la faute, — mais la faute presque fatale, — que fut la reconstruction de l'Empire, le divorce qui en résulta, et nous voyons poindre, presque, la guerre de 1870[49] ; nous reconnaissons qu'en face des deux monarchies prêtes à étendre leur pouvoir, au point de créer deux mondes nouveaux, il devenait indispensable que la France fût une république. Elle ne pouvait être un empire qu'à la condition de dominer ses deux voisins, et, comme elle ne le voulait pas, — Napoléon III ne le voulut jamais non plus, à aucun moment, — une sorte de force inutile, provocatrice, pourtant plus apparente que réelle, semblait émaner de cet empire idéaliste, protecteur désintéressé de peuples qui refusaient énergiquement de croire en lui en dépit de ses bienfaits. Napoléon III était sincère, mais lui aussi, comme le pays, trop en avance sur son temps et la moralité politique ; grand maître abstrait d'États-Unis d'Europe lointains dans une Europe, qui repoussant cet horizon et s'affirmant chaque jour, au moins par ses dirigeants, dépourvue du plus minime idéalisme, acharnée dans des luttes personnelles implacables et brutales, niait violemment la possibilité d'un avenir meilleur afin de se limiter au seul présent, il se perdait d'avance, de par sa sincérité et son idéalisme mêmes, basés néanmoins l'un et l'autre sur la nécessité, — sur une nécessité dont les princes, dressés contre les peuples, ne voulaient pas prendre conscience, — et, de bonne foi, égarait la France. La force était nécessaire pour imposer l'idée napoléonienne et, trop confiant dans la facilité de persuader ce que tout prouvait juste et bon, il n'avait ni ne recherchait cette force indispensable, ni ne pouvait l'obtenir d'un pays trop divisé, trop peu d'accord pour agir extérieurement comme en 1792, bientôt trop matériellement heureux, trop exclusivement industriel, pour ne pas refuser une guerre qui aurait nécessité la refonte du système militaire, la conscription générale. Le catholicisme avait éployé partout sa chape de plomb. La seule armée révolutionnaire sur laquelle la France aurait pu s'appuyer avait été décimée presque de suite par les conservateurs, maîtres rapides et progressifs de la deuxième république. La révolution allemande de 1848 devrait être pour la
France une école de réalisme. Son idéalisme est si grand, si spontané, si
exagéré même, quelquefois, qu'il n'aurait pas à en souffrir ; loin de
diminuer, il se fortifierait en s'équilibrant davantage avec la réalité ;
l'exemple du voisin lui vaudrait non pas une leçon, mais de pouvoir mieux
délimiter la base solide qui lui fit défaut souvent. L'étude de cette Prusse,
destructrice des États-Unis européens, lui montrerait quelles différences
foncières séparent plusieurs nations entre elles, par la faute de leurs
gouvernements, et comme, à certaines heures, pour la révolution même que la
France représente, la guerre risque de devenir, malgré toute notre volonté
pacificatrice, un douloureux devoir. Notre projet de
constitution, écrivit Bunsen à Henri Reeve, en mai 1848, le premier fruit de l'effort politique de l'Allemagne
n'est pas une Déclaration des Droits de l'homme. Ce n'est pas une de
ces nombreuses copies où la Magna Charta, tracée sur le parchemin de
l'Angleterre, est reproduite sur le papier brouillard du continent. Ce n'est
pas davantage une contrefaçon de la constitution américaine ou de la
constitution belge ; c'est une œuvre originale comme la nation qui l'a
créée... Je vous abandonne le comité des cinquante, le comité des dix-sept et
toute la Diète par-dessus le marché, mais les cinquante et les dix-sept et la
Diète s'évanouiront comme se sont évanouis les corps francs d'Hecker, tandis
que le roc sur lequel ils ont essayé de bâtir demeure. Quel est ce roc ?
L'Allemagne, la nation allemande[50]. Et que disait
l'héritier du grand Frédéric, le 18 mars 1848, à l'émeute assiégeant son
palais ? Je serai le roi allemand ![51] Cette foule
houleuse, indécise, mais violente, contre une demeure royale, ne l'avons-nous
pas déjà vue à Turin ? La comparaison va devenir si frappante que nous
n'aurons plus besoin de la souligner. Le Parlement de Francfort, d'abord
assez puissant, fut soutenu tant qu'il conserva son prestige, quoique à
contre-cœur, par Frédéric-Guillaume ; il le ménagea même et chercha à se
faire mettre par lui à la tête de l'empire. Le Parlement et le ministère
central avaient d'ailleurs déjà pensé à lui pour la fondation de l'unité à un
moment où il paraissait plutôt enclin à les combattre. — Il existait en
Prusse quelque irritation contre l'Assemblée. Le roi, de son côté, même au
moment de ses avances, savait ce qu'il voulait du Parlement, comme ce qu'il n'en
admettrait à aucun prix. Les démocrates,
disait-il à Sans-Souci, le 2 août 1848, veulent la
souveraineté du peuple, c'est-à-dire la République. Aucune puissance humaine
ne m'obligera d'y consentir. Si on en vient là, je tirerai mon épée. Les
aristocrates, les hommes que je considérais comme les soutiens du trône oui,
ces mêmes hommes qui parlent ici de légitimité, ont prononcé ailleurs le mot
de déchéance[52]. Le roi, par le
reste de sa conversation, avait fait comprendre qu'il n'admettrait jamais un
gouvernement constitutionnel s'il était contraire aux principes de la
monarchie selon le grand Frédéric, ni même l'unité allemande, si elle était
conforme aux idées révolutionnaires du Parlement de Francfort. De son côté,
le Parlement savait ce qu'il voulait et il était bien difficile que, malgré
d'excellents rapports de surface, la lutte ne demeurât pas au fond de la
situation. On le vit à Cologne, à la curieuse cérémonie qui célébra
l'achèvement de la cathédrale, quand le roi dit à Henri de Gagera, président
du Parlement : N'oubliez pas qu'il y a des princes
en Allemagne et que je suis un de ces princes. L'aristocratie aurait
peut-être créé la véritable confédération germanique, — à la faveur de
certains désaccords, sous une forme même républicaine, — celle qui eût placé
la Prusse à son rang normal, mais quelques rois et, surtout, le roi prussien,
veillaient. L'équivoque s'implantait. Francfort
voulait que la Prusse disparût au sein de l'Allemagne ; la Prusse voulait que
l'Allemagne vînt s'adjoindre à la Prusse[53]. A ce moment, il
semblait que la réaction dût en résulter. Un état d'esprit semblable à celui
du passé, bien qu'il eût déjà fait le malheur du pays à Iéna, se faisait jour
en Prusse, violemment particulariste. Néanmoins, les gens clairvoyants
comprenaient que l'Allemagne monarchique et l'Allemagne démocratique devaient
arriver à s'entendre. La haine commune de la France leur fournissait un
terrain facile. Le Parlement de Francfort avait rejeté l'Autriche[54] en décidant
qu'elle ne ferait plus partie de l'Allemagne, préparation, à distance, de
Sadowa, précaution jugée très politique par la Grande-Bretagne, qui redoutait
Schwarzenberg pour l'équilibre européen. Ce prince si curieux, s'il n'avait
été usé déjà physiquement, aurait peut-être fait jouer à sa patrie, malgré
toutes les impossibilités prévues, fort nombreuses, le rôle qui fut celui de
la Prusse. Il annonçait le dessein de faire entrer
dans la commune patrie allemande l'Autriche entière, l'Autriche non allemande
qui ne faisait point partie de la Confédération, l'Autriche slave et
hongroise, l'Autriche des Magyars, des Tchèques, des Polonais, des Galiciens,
des Croates, aussi bien que celle de Vienne et de l'archiduché. Cette masse
de peuples eût pesé d'un terrible poids dans la balance de l'unité ; le
nouvel empire eût été entraîné dans les voies de la réaction autrichienne et
Félix de Schwarzenberg, Bismarck d'il y a vingt-cinq ans, aurait établi au
centre de l'Europe un empire de soixante-dix millions d'âmes[55]. Là encore un
terrain se présentait à exploiter pour la Prusse. Puisque Schwarzenberg
voulait confisquer l'Allemagne au profit d'une monarchie absolutiste que
l'Europe ne tolérait pas, la Prusse s'entendrait avec les souverainetés
allemandes. Afin de leur fournir un garant de sa bonne volonté,
Frédéric-Guillaume n'avait-il pas répondu à Henri de Gagera, venu le supplier
d'accepter la couronne que le Parlement voulait lui offrir, de manière à bien
spécifier que seuls les princes avaient le droit de le nommer ? Il avait
refusé par scrupule religieux et historique[56], par sentiment
réactionnaire, alors qu'il aurait pu[57] réussir dès
cette date un premier essai d'unité. Le roi, si les princes ne répondaient
pas à ses vues — car sa réponse comportait la mort du Parlement — ne
craignait pas de se retrouver seul ; il comptait s'adresser au moins pour un
temps et en apparence, en ce cas, à la Révolution ; et le passage d'une
lettre de Bunsen montre combien la question de la Prusse dominait la question
allemande : Si la Bavière à laquelle le Hanovre
semble vouloir se joindre prétend faire opposition, alors c'est le second
acte de la révolution allemande qui commence : l'Allemagne y succombera pour
longtemps, mais les princes y succomberont aussi[58]. Il résumait ainsi
ses arguments : L'Autriche a mis la couronne de
l'Empire aux pieds de Napoléon. Napoléon a été vaincu. Notre droit, non pas
un droit d'hier, un droit de mille années, exigeait et exige encore la
reconstitution de l'Empire. C'est ce que voulait la Prusse en 1815 ; mais
l'Autriche refusa de ressaisir la couronne impériale, la Bavière et le
Wurtemberg refusèrent de renoncer à ce droit de pleine souveraineté, de
pleine existence à part qu'ils avaient reçu des mains de Napoléon. Napoléon
revint de l'île d'Elbe. Alors, en toute hâte, on construisit une hutte pour
abriter l'Allemagne pendant l'orage, misérable abri que les princes eux-mêmes
ont considéré comme détruit le 26 juin 1848. Puis la révolution est venue, la
nation a eu ses représentants et ceux-ci ont adressé à l'Autriche une
question qu'il était impossible d'écarter. L'Autriche a répondu qu'elle ne
peut ni ne veut faire partie de l'union restreinte — union purement
germanique, dont ne feraient pas partie les possessions non allemandes de la
monarchie autrichienne —. Nous donc, aujourd'hui,
nous voulons placer la Prusse à la tête d'une confédération puissante.
Et revenant à son idée initiale : Le roi acceptera
la couronne si les princes y consentent. S'ils n'y consentent pas, eh bien !
il ne nous restera plus qu'une ressource : l'agitation. Et alors bonsoir le
Palatinat du Rhin ! bonsoir Anspach et Bayreuth ! Tous suivront la bannière
allemande et il n'y aura plus de Bavière[59]. L'homme qui
tenait ce langage était un conservateur absolu, ennemi constant de la
révolution ; mais le sentiment de la nécessité et une certaine compréhension
du patriotisme empêchaient chez lui le parti pris. — Le roi résistait à la
pensée de se séparer entièrement de l'Autriche. Après avoir cédé un moment
sur la pression de son ami, il se reprenait. Quand, le 2 avril, une
députation était venue lui annoncer que l'Assemblée de Francfort l'avait
nommé empereur d'Allemagne, il n'avait pas refusé, mais ajourné sa décision
jusqu'à l'heure où les souverains allemands, régulièrement consultés,
auraient exprimé leur avis. — Une crise sérieuse en résulta, favorisant à la
fois le jeu de l'Autriche et celui des partis extrêmes. Frédéric-Guillaume,
le Parlement ainsi ébranlé, prononça la dissolution de la seconde Chambre et
prorogea la première. Il n'abandonnait pas, cependant, la cause de l'unité
germanique ; insistant sur ses indications précédentes, il invitait les
princes allemands à se réunir en congrès afin de refaire l'œuvre de
Francfort. La crise augmenta. — Frédéric-Guillaume s'efforça de devenir
l'héritier de l'Assemblée et, en changeant de tactique sans changer de
desseins[60],
se promit de combattre la révolution en réalisant l'unité, empruntant aux
révolutionnaires, afin d'agrandir et de consolider sa couronne, l'arme même à
l'aide de laquelle ils avaient espéré la détruire. Il semblait qu'il n'y
avait plus place désormais que pour les mouvements révolutionnaires ou les
coups d'État ; mais le roi de Prusse comptait toujours que les princes
s'entendraient avec lui pour former une confédération nouvelle, plus serrée
que celle de 1815, et dont il serait le centre. Ne demeurait-il pas le
représentant, en quelque sorte inévitable, des volontés de l'Allemagne dans
l'ordre de la légitimité comme par-dessus le monde de la révolution ? Les
princes détestaient la Prusse, mais la préféraient encore à la révolution et,
placés entre la Prusse qui les écrasait de sa
protection et la révolution, il ne leur restait d'autre choix que celui du
genre de mort[61]. — La Prusse
était l'arbitre et l'ouvrière de l'avenir ; elle
avait substitué, en apparence du moins, les procédés légitimistes aux
procédés révolutionnaires ; elle préparait son agrandissement sans sortir des
sphères mystiques du droit divin ; elle s'insinuait doucement, discrètement ;
elle avançait toujours ; elle allait toucher le but[62]... Les princes durent capituler. La Bavière et le Wurtemberg,
seuls, résistèrent ; le nord et le centre entrèrent dans la Confédération. La
Prusse dominait sur cette vaste contrée qui va de Memel à Bâle ; elle voyait
déjà respirer sous son sceptre vingt-sept millions d'hommes. Tableau neuf,
qui renversait une des bases de la diplomatie européenne et suscitait partout
de nouvelles considérations. Je confesse qu'à la vue
de ce singulier spectacle, dit Tocqueville, d'étranges
idées me traversèrent l'esprit et que je fus un moment tenté de croire que le
président n'était pas aussi fou dans sa politique étrangère qu'il m'avait
paru l'être d'abord. Cette union des grandes cours du Nord, qui avait si
longtemps pesé sur nous, était brisée. Deux grandes monarchies du continent,
la Prusse et l'Autriche, étaient en querelle et en guerre. Le moment
n'était-il pas venu pour nous de contracter une de ces alliances intimes et
puissantes qui, depuis soixante ans, nous manquaient et peut-être de réparer en
partie nos désastres de 1815[63] ? La France, aidant froidement Guillaume dans ses
entreprises, que l'Angleterre ne contrariait pas, pouvait départager l'Europe
et susciter une de ces grandes crises qui amènent le remaniement des
territoires[64]. Ne pense-t-on
pas ici aux futures négociations, mais dans un horizon alors restreint, au
sujet du Luxembourg ? Le temps, ajoute le
ministre des Affaires étrangères, semblait si bien
se prêter à de telles idées qu'elles remplissaient l'imagination de plusieurs
des princes allemands eux-mêmes. Les plus puissants ne rêvaient que
changement de frontières et accroissement de pouvoir aux dépens de leurs
voisins. La maladie révolutionnaire des peuples semblait avoir gagné les
gouvernements. — Il n'y avait plus de
confédération possible avec trente-huit États, disait le ministre de Bavière,
M. Van der Pfordten, à notre ambassadeur. Il est nécessaire d'en médiatiser
un grand nombre. Comment, par exemple, espérer de jamais rétablir l'ordre
dans un pays comme le grand-duché de Bade, à moins de le partager entre des
souverains assez forts pour s'y faire obéir ? Le cas échéant, la vallée du
Neckar nous reviendrait naturellement[65]. — La France ne
pouvait cependant pas songer à intervenir pour traiter avec la Prusse ; en dehors
même de la haine qu'elle inspirait, elle savait qu'une pareille alliée ne lui
donnerait rien de réel en échange de ses bons offices. En dépit de cette
certitude, la France valait à la Prusse une sorte d'appui moral[66]. M. de Hatzfeld,
possédant une grande situation à Paris, et dont la femme était la fille du
maréchal de Castellane, se montrait partisan convaincu d'une entente entre
les deux pays ; il assurait des sympathies de son gouvernement pour Louis
Bonaparte. On peut se demander, toutefois, s'il était sincère. Comme les
rapports entre les deux pays laissaient souvent à désirer, il en rejetait la
faute sur notre ministre, le comte de Ludre, et laissait à entendre qu'un
autre représentant de l'Elysée recevrait un accueil chaleureux ; il parlait
de voir les deux cabinets s'associer pour une commune politique et décida,
dans une bonne part, du voyage de Persigny. Le jour vint où Frédéric-Guillaume, partisan des moyens nouveaux pour atteindre à l'unité, remplaça Bunsen dans son rôle de confident par un officier de Westphalie, qui commandait une batterie française à Leipsick, et décoré de la Légion d'honneur, M. de Radowitz. Fort près du roi par ses sentiments religieux, encore qu'il fût catholique, le nouveau favori rêvait également d'un monde qui aurait réuni ensemble les grandes traditions monarchiques et religieuses de l'Allemagne afin de réaliser l'état germanique chrétien, entrevu par le moyen âge, ébauché par le Saint-Empire[67]. En un mot, il prétendait emprunter à l'Autriche le dépôt des principes d'autorité, à la Prusse son intelligence hardie et sa vitalité robuste ; de ce mélange, pensait-il, naîtrait une Allemagne nouvelle dont la monarchie des Hohenzollern deviendrait le centre et posséderait l'Empire. Cet étrange système, avec les contradictions dont il était plein, répondait parfaitement aux mystiques pensées de Frédéric-Guillaume IV. Les deux amis, s'exaltant l'un l'autre dans leurs conceptions idéales, y mêlaient intrépidement le vrai et le faux. Les études qu'ils faisaient en commun sur l'Allemagne et le XIXe siècle les ramenaient toujours à cette conclusion : L'esprit moderne a de justes exigences, mais il a tort de s'adresser à la révolution pour obtenir gain de cause, car la révolution flétrit tout ce qu'elle touche. C'est à la monarchie légitime de faire ce que la révolution essaie vainement d'accomplir. Partout où la révolution agirait en pure perte, la monarchie légitime, c'est-à-dire l'État germanique et chrétien, agira efficacement. Examinée à la lumière de ce principe, la question de l'unité allemande leur paraissait tout à coup simplifiée[68]. Ainsi Radowitz poussait à la naissance croissante de cette révolution dont Bunsen disait différemment au roi : Pourquoi vous méfier de ce qu'elle vous apporte ? Ceci n'achève-t-il pas de nous montrer définitivement, en
nous ramenant un moment à Napoléon III, les pensées instinctives, confuses et
changeantes qui font se ressembler entre eux, en dépit de leurs différences,
les souverains d'alors ? Louis-Napoléon aussi plongeait, par delà son oncle,
dans le passé plus lointain. Il semble y avoir une certaine part de vérité,
au moins après l'affaire de Rome, dans les singulières affirmations
suivantes, encore qu'elles nous paraissent très sujettes à caution : Le prince dans lequel on s'accoutumait, par paresse
d'esprit, à voir uniquement le servile imitateur de l'idée de Napoléon Ier,
remontait jusque dans les profondeurs du moyen âge pour y chercher un modèle
ou un maître. Cette pensée, qui n'est jamais arrivée jusqu'aux oreilles de la
presse, s'est produite sous mille formes pendant près de quatre ans au Palais
de l'Elysée... A la grande surprise de ceux qui liront ces lignes, c'est dans
son patron saint Louis que le prince Louis-Napoléon allait chercher l'objet
de sa plus vive émulation. Prince chrétien et catholique, il voulait, comme
saint Louis, devenir la colonne de l'Église au XIXe siècle... L'expédition
romaine achevée, Pie IX rétabli sur le trône pontifical, Louis-Napoléon
Bonaparte eût accepté, en matière de croisade, une campagne à Jérusalem. Son
oncle aimait à se décorer du titre de protecteur de la confédération
germanique. Il eût préféré, lui, le titre de protecteur du Saint-Sépulcre et
des Lieux Saints. La conquête de Tunis le poursuivait dans ses rêves, comme
elle poursuivait saint Louis. L'épanouissement de la race latine était le
couronnement de l'édifice religieux et politique qu'il construisait dans sa
pensée. Poussant plus avant dans les déductions de ce vaste plan, il peuplait
l'ancienne ligue des États barbaresques, depuis Tripoli jusqu'à Tanger, d'une
colonie italo-hispano-française, de telle sorte qu'en face de la France,
qu'en face de l'Espagne, qu'en face de l'Italie, une autre France, une autre
Espagne, une autre Italie se fussent contemplées, comme un reflet magique,
renvoyé par le miroir de la Méditerranée. Ainsi se résolvait en Europe le
problème de l'équilibre des races ; ainsi se trouvaient contrebalancées les
influences gréco-slave et anglo-saxonne[69]. Ainsi l'Église
dominait-elle, réapparue éclatante et maîtresse de l'horizon, le nuage
révolutionnaire derrière lequel elle n'avait que mieux et plus secrètement pu
agir, évanoui, possédant désormais en plus de Rome reconquise, et encore que
l'un fût protestant, les deux princes des deux pays européens les plus forts
après la Russie, leur suggérant les mêmes rêves, par certains côtés les plus
saugrenus. Ainsi l'ancien carbonaro, combattant de Forli, mêlait-il à ses
plans l'adversaire d'autrefois devenu un allié. — Toute la réalité européenne
véritable se trouvait brouillée d'autant plus par une étrange lumière,
créatrice de faux mirages. La confusion née de 1848 les favorisait, et nous
nous rappelons que Tocqueville a noté les espérances infinies, les plans
nombreux qui s'élaboraient partout. Si l'on continue de croire Castille, celui
de Louis-Napoléon s'éployait déjà[70] jusqu'à l'autre
continent : Il poursuivait cette pensée
d'épanouissement de race latine jusqu'au Mexique et dans les États du Sud,
rétablissant là, comme en Europe, l'équilibre entre cette race et la race
anglo-saxonne. Puis, revenant vers la France à travers les mille spirales de
cette vision flamboyante, il déterminait la dernière période de son règne par
l'œuvre de la réconciliation des intérêts et la solution régulière de la
question sociale[71]. Nous mesurons
ici de plus près la différence, précédemment signalée, et des trois actions
italienne, allemande et française, et la place moindre, ou du moins
subordonnée, que tient l'idée strictement nationale, — l'unité territoriale
existant, l'union morale restant une œuvre politique progressive, — dans la
pensée napoléonienne. La France y est à certains moments, avant tout,
semble-t-il, l'instrument de la future fusion européenne, la créatrice des
nouvelles valeurs et, sur ce point, encore que dévoyée par la force
catholique, un temps même cachée par elle, une partie de l'idée
révolutionnaire subsiste. La montée réactionnaire de la Prusse, placée à
côté, le fait ressortir davantage. Schwarzenberg, voluptueux méthodique, dominateur continu, marqué lui aussi de l'empreinte romantique, mais de la plus réaliste, dressait contre l'idéalisme de Radowitz son matérialisme renseigné. Diplomate à vingt-quatre ans, il avait assisté en Angleterre à de véritables révolutions législatives, assidu à suivre les luttes qui précédèrent l'émancipation des catholiques, la réforme parlementaire et la dispersion du vieux parti tory. Il avait vu la révolution de 1830, les premiers embarras de la monarchie orléaniste, et la leçon des faits lui avait appris à ne rien examiner en doctrinaire, mais en praticien. Exempt de tout préjugé de caste, libre de toute irritation, n'ayant aucune idée de revanche pour tel ou tel parti, il ne cherchait que la solution du problème proposé à tous les États de l'Europe : l'accord du principe d'autorité avec les principes et les intérêts nouveaux introduits dans le monde par la révolution... Il avait ses principes généraux, il n'avait pas de parti pris. Ce n'est pas par entêtement absolutiste qu'il conservait, au milieu de ses concessions libérales, une foi si entière dans le principe d'autorité ; à force d'observer le mouvement des choses humaines sur les différents points du globe, il s'était formé cette conviction que, plus il y a de libertés légitimes dans un pays, plus il faut que l'autorité soit forte. Le gouvernement, à ses yeux, devait être avant tout le rempart des libertés publiques ; à mesure que ces libertés s'accroissent, il était nécessaire de consolider le rempart et de l'armer de toutes pièces. Il disait que le premier devoir des États est de concentrer les forces que la révolution est occupée à disjoindre[72]. Il ne mêlait aucune conception religieuse à ses combinaisons politiques, et l'on s'est demandé s'il avait été chrétien ; sans doute son silence à ce sujet venait-il d'une pudeur hautaine, entretenue par les conditions catholiques de son pays ; une sorte de mépris faisait le reste[73]. C'est en face d'hommes comme Schwarzenberg, Radowitz, Bunsen, Frédéric-Guillaume et, encore dans l'ombre, bientôt actif, Bismarck, c'est sur la situation européenne dont nous venons d'esquisser les grandes lignes que pesèrent la réaction victorieuse du 13 juin, puis la chute de Rome, qui l'appuyait[74]. Nous avons indiqué précédemment son importance ; au point où nous en sommes, elle s'impose d'elle-même ; et plus nous avancerons dans l'étude de cette époque, plus les faits démontrent ce que la France perdit en rejetant la révolution nouvelle qui l'avait rendue, une seconde fois, l'arbitre de l'Europe. Le recul révolutionnaire permit les expéditions victorieuses de Frédéric-Guillaume contre Bade et le Palatinat que l'Autriche, occupée contre les magyars avec l'aide de la Russie, ne vint pas soutenir ; certaines répressions furent terribles. — La faute de l'insouciance française ne petit d'ailleurs pas être attribuée aux hommes qui interprétèrent la révolution de 1848. Si la France n'a pas vu le péril, c'est que les hommes d'État, dominés par le mauvais vouloir des Chambres, se sont refusés à s'y arrêter. Il ne dépendait que de vos gouvernements, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, de le conjurer en faisant entrer dans l'orbite de votre politique, par tout un réseau de conventions postales et commerciales, le midi de l'Allemagne et de la Belgique. Malheureusement, ils n'eurent pas, comme la Prusse, la vision de l'avenir ; ils éconduisirent Bade, la Bavière, le Wurtemberg et le cabinet de Bruxelles, qui ne demandaient qu'à associer leurs destinées économiques aux nôtres[75]. Nous suivions la trace indiquée par nos diplomates passés et comme il nous semblait nécessaire de demander pardon à l'Europe de notre nouvelle révolution, nous nous efforcions de renier le plus possible nos principes. Adam Mickiewicz, qui ne pouvait comprendre notre attitude au moment dé l'élection de l'empereur d'Allemagne, expliquait ainsi la pénible surprise de nos alliés : Tout cela s'est fait à l'insu de la France officielle. Le gouvernement le plus révolutionnaire de l'Europe, celui de la France, a pris dans cette question l'attitude la moins offensante pour la vieille diplomatie... La seule chose que les ministres français gardent avec une habileté universellement reconnue, c'est leur gravité silencieuse qui continue à couvrir leur nullité réelle. La France est-elle décidée à favoriser l'établissement de ce nouvel empire, ou bien osera-t-elle le combattre ? Un tel fait, il y a quelques années de cela, aurait bouleversé l'Europe entière. Napoléon dut gagner vingt batailles pour faire accepter à l'Europe son titre nouveau d'empereur de la République française. Le monde a marché. Le nouvel empereur d'Allemagne ne rencontrera pas d'opposition systématique de la part des monarchies, et pas même de la part du gouvernement quasi républicain de la France[76]. Nos diplomates ne paraissent, en effet, pas s'être rendu compte du sens exact des événements qui préparaient une nouvelle Europe. Persigny, envoyé en mission à la fin d'août, n'avait pas ce qu'il fallait pour parer aux erreurs déjà commises ; prédestiné par sa nature à ne voir qu'un côté des choses, il n'était ni assez froid, ni assez renseigné pour observer réellement, abstraction faite de ses idées personnelles. Son rapport au ministre[77] le livre tout entier à ce sujet, par ce simple passage : Le mouvement des esprits vers l'unité de l'Allemagne est un produit de l'idée révolutionnaire, bien plus que d'un sentiment de nationalité. Au fond des chants patriotiques en faveur de l'unité, on retrouve les idées et les passions de la Révolution française. Que demain le roi de Prusse, se mettant ouvertement à la tête du mouvement unitaire, promette à l'Allemagne de la débarrasser de tous les petits princes pour ne faire qu'une seule nation des États germaniques, mais à condition de ne donner à l'empire ni constitutions, ni chambres, personne ne le suivra. La fureur des discours, des parlements et de toutes les institutions de de la liberté moderne, la haine qu'inspirent les princes, les nobles, les supériorités sociales, voilà la passion du jour. L'unité, c'est le moyen de satisfaire la passion ; c'est aussi une de ces grandes idées qu'on trouve toujours au fond des sentiments révolutionnaires ; c'est, surtout, dans l'imagination mystique des Allemands, l'espérance de grandeurs futures, mêlées aux souvenirs poétiques du passé ; mais ce n'est pas la fermentation d'un grand peuple en train de constituer sa nationalité[78]. Il ne lui semblait pas que l'histoire de l'Allemagne permit de croire à une unité possible, il ne distinguait pas une véritable nationalité allemande[79] ; il remarquait, au contraire, la dispersion des efforts individuels par suite de l'élection de la couronne impériale qui déplaçait sans cesse le centre politique. Tandis qu'en France le sentiment des masses a toujours été disposée favoriser le pouvoir central, il n'a cessé en Allemagne de conspirer pour l'affaiblir[80]. La chute du Parlement de Francfort découlait, selon lui, du fait que les passions révolutionnaires n'avaient pu vaincre la résistance des petites nationalités germaniques. Il réservait cette question de l'unité mais sans y croire. On jugerait mal l'Allemagne si l'on supposait qu'elle renonce à ses idées. Elle a trop peu conscience de son inaptitude pratique pour ne pas renouveler ses tentatives... Presque toute la population, en dépit de l'expérience de Francfort, désire le triomphe de l'unité, mais comme l'esprit allemand désire toute chose, d'une manière vague, théorique, et sans comprendre les conditions politiques de ses aspirations[81]. Il paraît avoir prévu, néanmoins, d'où se glisserait le danger. Après un jugement curieux sur le roi[82], il disait : Ce que je viens de dire des apparentes contradictions du roi s'applique également à son frère, le prince de Prusse, et à toute sa famille, parce que le même intérêt explique tout. Le prince de Prusse, brave et loyal militaire, avec moins d'esprit que son frère, est resté longtemps à comprendre que la révolution était l'alliée nécessaire, indispensable, de l'ambition de sa maison... Mais, depuis qu'il s'est rendu compte de la situation politique de la Prusse, il s'est jeté ouvertement dans le parti libéral et dépasse de beaucoup, en concessions révolutionnaires, tout ce que son frère a jamais accordé[83]. Depuis, surtout, que le roi de Prusse avait fait signer au roi de Hanovre et au roi de Saxe un traité qui associait les trois royaumes (26 mai 1849), noyau de l'unité future, la question semblait posée désormais — la révolution et les princes de plus en plus vaincus — entre la Prusse et l'Autriche ; et il l'apparut plus encore, quand l'Autriche eut maîtrisé la Hongrie. Schwarzenberg, fort renseigné sur ses adversaires, savait utiliser leurs sentiments. Frédéric-Guillaume ayant réservé autrefois le Saint-Empire à l'Autriche et la royauté allemande à la Prusse, il amena peu à peu, à la suite d'un échange de courrier inouï, continuel, à la conclusion d'un traité qui mettait lin aux pouvoirs du vicaire de l'Empire ; un intérim se continuant jusqu'à ce que l'autorité centrale fût réorganisée (30 septembre 1849). La Prusse et l'Autriche convenaient donc de créer un pouvoir intérimaire chargé d'exercer l'autorité centrale pour la confédération germanique, au nom de tous les États, jusqu'au 1er mai 1850. Une commission fédérale, composée de quatre membres, deux pour l'Autriche, deux pour la Prusse, et près de laquelle les autres États pourraient se faire représenter par des plénipotentiaires, exercerait le pouvoir ; durant l'intérim, la question de la constitution allemande était abandonnée à la libre entente des États particuliers. Au cas où rien de décisif ne serait arrêté encore au 1er mai 1850, la convention serait prolongée. Ces clauses si simples contenaient une menace envers la Prusse. L'Autriche avait le temps de tout mettre en œuvre pour reconquérir son ancien pouvoir, restaurer la force fédérale, rétablir la diète de 1815[84]. La Prusse le sentit et, poursuivant son jeu tout en paraissant ne pas comprendre, elle fit proposer, le 5 octobre, de convoquer le Parlement d'Erfurt, c'est-à-dire le Parlement qui, d'après le traité du 26 mai, devait reprendre la question de l'unité allemande et recommencer avec les princes l'œuvre du Parlement de Francfort. Le Hanovre, sans doute mis en défiance par Schwarzenberg, déclara aussitôt que la Prusse interprétait d'une manière inexacte le traité du 26 mai, son roi s'étant uni à celui de Prusse pour combattre la démagogie, mais non pas pour transformer l'Allemagne en État unitaire ; la démagogie étant vaincue, le but de l'alliance atteint, le traité du 26 mai n'avait plus de raison d'être, et le Hanovre s'en targua pour s'en dégager. La Saxe, sans aller si loin, s'en tira également. Maintenir le traité du 26 mai comme une alliance contre la démagogie en refusant d'y voir le premier acte d'une politique concentrée en vue de l'unité allemande équivalait à faire, sous des formes plus respectueuses ou plus timides, ce que le Hanovre avait fait nettement et résolument. Le traité du 26 mai — l'alliance des trois rois — n'existait plus. L'Autriche, toujours conduite par Schwarzenberg, se relevait de ses ruines. Elle dominait, et les petits souverains de l'Allemagne du Sud, devant le recul de la Prusse, se montraient plus empressés à protester contre. Dès le début de 1850, ils allaient s'entendre et se grouper. Le 27 février, tandis que se préparaient les élections du Parlement d'Erfurt convoqué pour le 20 mars, le roi de Wurtemberg et le roi de Bavière, auxquels se joignait le roi de Saxe, signèrent une convention servant à préserver les droits des souverains et des États particuliers dans la constitution future de l'Allemagne. Quinze jours après, le roi de Wurtemberg, à l'ouverture de la Chambre des députés à Stuttgart, prononçait un discours qui semblait donner raison au rapport de Persigny et tranquilliser, au moins momentanément, l'Europe : Messieurs, l'Etat militaire allemand est une chimère et la plus dangereuse de toutes les chimères, aussi bien au point de vue de l'Allemagne qu'au point de vue de l'Europe... Toute fusion violente des races allemandes, toute subordination absolue d'une des races principales à une autre, porterait en elle le germe de notre dissolution intérieure et serait le tombeau de notre existence nationale... Le maintien de l'ancien droit, c'est-à-dire du droit positif et de la fidélité aux traditions historiques qu'on ne peut méconnaître et qui finissent toujours par avoir le dessus, peut seul nous assurer force, durée et salut dans les orages de notre époque. Moi et les gouvernements qui sont mes alliés dans cette question, nous voulons que la nation conserve son droit naturel à la représentation de l'ensemble. Nous ne voulons pas élever un nouvel édifice politique des débris de notre ancien droit ; nous voulons, au contraire, donner à la confédération une forme nouvelle qui soit en harmonie avec l'esprit et l'époque. Nous voulons accorder les justes prétentions de la Prusse avec les intérêts généraux de l'Allemagne. Si nous sacrifions nos intérêts particuliers, ce n'est pas à telle ou telle puissance que nous faisons ce sacrifice ; c'est à l'ensemble, c'est à la patrie. Nous ne voulons être ni Autrichiens, ni Prussiens, nous voulons, par le Wurtemberg, rester allemands. Le souverain esquissait le plan de la Confédération, telle que l'avait conçue la plupart des politiques, telle que notre parti révolutionnaire l'avait envisagée, — telle que rêvait d'y aider Louis-Napoléon. La France avait donc peut-être eu raison, en 1849, de ne proposer aucune alliance à la Prusse, décidée qu'était celle-ci à maintenir et à ne jamais reconnaître le service rendu. Louis-Napoléon semble avoir raisonné sur ce point comme son ministre, comme l'Europe, ralliée à la nécessité de cette confédération germanique dont la question se posait. — Et est-ce que l'aventure de Sébastopol ne s'explique pas ici déjà ? Devons-nous désirer, se demandait Tocqueville, que l'Allemagne devienne à certains égards une seule nation ou reste une agrégation mal jointe de peuples et de principes désunis ? C'est une ancienne tradition de notre diplomatie qu'il faut tendre à ce que l'Allemagne reste divisée entre un grand nombre de puissances indépendantes, et cela était évident quand, derrière l'Allemagne, ne se trouvaient encore que la Pologne et une Russie à moitié barbare ; mais en est-il de même de nos jours ? La réponse qu'on fera à cette question dépend de la réponse qu'on fera à cette autre : Quel est, au vrai, de nos jours, le péril que fait courir la Russie à l'indépendance de l'Europe ? Quant à moi qui pense que notre Occident est menacé de tomber, tôt ou tard, sous le joug ou, du moins, sous l'influence inévitable des czars[85], je juge que notre premier intérêt est de favoriser l'union de toutes les races germaniques afin de s'opposer à ceux-ci... Il nous faut changer nos vieilles maximes et ne pas craindre de fortifier nos voisins pour qu'ils soient en état de repousser un jour avec nous l'ennemi commun[86]. Ce passage fait mesurer à la fois le danger qu'il y a de rompre absolument avec une tradition et la difficulté d'évaluer la mesure dans laquelle il convient pourtant de changer celle-ci, de la briser, au besoin, ou encore d'y mêler la nécessité nouvelle, tout en abandonnant cette nécessité elle-même peu à peu au fur et à mesure que ce qui la remplace, en se réalisant, la détruit. Ne devrait-on pas, en effet, se servir de la tradition tant qu'on ne peut l'abattre, l'utiliser justement afin de mieux la détruire, le moment venu, en se faisant porter par elle selon le degré où elle peut conduire l'action révolutionnaire ? — Il fallait favoriser l'éclosion italienne comme l'éclosion germanique, mais aujourd'hui, quand nous pouvons distinguer de quelle manière progressive, d'autant plus douce et d'autant plus sûre, pour ces pays comme pour l'Europe et pour nous, nous voyons en même temps combien une rupture absolue avec, tout au moins, l'esprit, ou l'indication, d'une tradition plusieurs fois séculaires, risque de se retourner contre les idées que ce renouvellement semblait servir d'abord. La Révolution, afin de mieux se réaliser, — car réussir ne suffit pas, — gagne à s'appuyer sur la série des expériences précédentes dont la somme, en général, conserve une sorte de protection momentanée à l'abri de laquelle il est plus salutaire et plus sûr de chercher l'avenir que dans une plaine faite de ruines fraîches éparpillées ; le total du passé lointain, moyen ou proche, demeure fatalement le terrain où germe, puis grandit la racine du lendemain, c'est-à-dire du gouvernement, même politiquement nouveau, qui succède, — en les résumant, — aux efforts multiples de ses prédécesseurs. Le czar paraissait plus sincère, plus justement et
équitablement intéressé au sort de la France que ne le pensait Tocqueville quand
il disait à Lamoricière : Si l'unité de l'Allemagne,
que vous ne désirez sans doute pas plus que moi, venait à se faire, il
faudrait encore pour la manier un homme capable de ce que Napoléon lui-même
n'a pu exécuter, et si cet homme se rencontrait, si cette masse en armes
devenait menaçante, ce serait notre affaire à vous et à moi[87]. — Cette parole
justifiait l'intuition de Lamartine[88], d'autant plus
intéressante qu'au début de la révolution de 1848 le czar pensait tout
différemment quant à la France. Morny ne s'en souvint-il pas lorsqu'il essaya
d'esquisser, vers la fin de sa vie, l'alliance que devait réaliser seulement
la troisième République ? — Pour Tocqueville, le czar représentait seul la
vieille société, l'ancien principe traditionnel de l'autorité en Europe. Il n'en était pas seulement le représentant, il s'en
considérait comme le champion. Ses théories politiques, ses croyances
religieuses, son ambition, sa conscience le poussaient également à prendre ce
rôle. Il s'était donc fait de la cause de l'autorité dans le monde comme un
second empire, plus vaste encore que le premier[89]. On le voyait
bien dans sa manière d'apprécier notre action à Rome : Nous autres, nous ne concevons rien à ces fonctions
temporelles remplies à Rome par des ecclésiastiques, mais peu nous importe la
manière dont ces calotins s'arrangent, pourvu qu'on fasse là quelque chose
qui tienne et que vous y constituiez le pouvoir de manière qu'il puisse se
maintenir[90]. Le pouvoir de
l'autocrate était redoutable, fondé sur les volontés
et les ardentes sympathies des Russes, car le principe de la souveraineté du
peuple réside au fond de tous les gouvernements, quoiqu'on en dise, et se
cache sous les institutions les moins libres[91]. Le peuple, sans
éducation, dans un État souvent voisin de la barbarie, voyait dans son maître
l'envoyé de Dieu et presque Dieu lui-même[92]. Nicolas était
plus imposant à cette date et plus adulé que ne le furent Alexandre et
Metternich. L'axe du monde politique ne se trouvait
plus à Paris, à Londres ou à Vienne ; il avait été transféré à
Saint-Pétersbourg. Il semblait qu'on allait assister à une troisième
réaction, semblable à celle de 1819 et de 1832, ou même pire[93]. Et parlant un
peu comme Barrot, Emile Ollivier ajoutait : Mais
deux différences considérables distinguaient 1849 de 1829 et de 1832. En 1829
et en 1832, les idées libérales sombrèrent en même temps que les idées
révolutionnaires. En 1849, les idées libérales surnagèrent au naufrage des
révolutionnaires[94]. Insistant sur la
comparaison, il ajoutait : En 1829 et en 1832,
personne n'avait l'autorité ni la volonté de s'opposer à Alexandre ou à
Metternich. En 1849, au contraire, est entré en scène un personnage puissant
et résolu, qui va braver le czar réputé invincible, lui résister, l'abattre,
relever les causes vaincues[95]... Toutes les velléités que nous venons de passer rapidement en revue n'étaient et ne pouvaient être, surtout en Allemagne, que des indications de l'avenir prochain. Le triomphe momentané de la Prusse sur les révolutionnaires était de ceux qui nuisent à qui les remporte, et Frédéric-Guillaume était loin, maintenant, de la position privilégiée qu'il avait occupée. Si l'on en croit Tocqueville, il ne restait plus en Allemagne, de tout le grand mouvement de 1848, que deux traces invisibles : une dépendance plus grande des petits États à l'égard des grandes monarchies, une atteinte irréparable portée à tout ce qui restait des institutions féodales, dont la ruine, en effet, consommée par les peuples, avait été sanctionnée par les princes. D'un bout de l'Allemagne à l'autre, la perpétuité des rentes foncières, les dîmes seigneuriales, les corvées, les droits de mutations, de chasse, de justice, qui constituaient une grande partie de la richesse des nobles, restèrent abolis. Les rois étaient restaurés, mais les aristocrates ne se relevèrent pas[96]. La progression de l'autorité centrale, la doctrine de l'État dans sa toute-puissance, rendue plus facile grâce à un peuple sans organisation démocratique et par suite de l'impossibilité républicaine, le passé rude et discipliné de la Prusse, d'autre part son effort constant, son orgueil, le sens strict des réalités que possédaient la plupart de ses fils, puis, bientôt, l'isolement des petits rois allemands revenus à leurs seuls intérêts personnels une fois la lutte contre la révolution finie, la mort de Schwarzenberg, le coup porté enfin à l'Autriche par nos victoires italiennes, allaient toutefois soutenir, aider, puis précipiter la concentration. La Prusse semblait véritablement occuper une situation privilégiée ; elle seule n'était pas disqualifiée et demeurait la carte forcée de tous ceux qui ne se résignaient pas à la prolongation indéfinie de l'anarchie fédérable[97]. En face de la Russie, bloc formidable en face de l'Autriche, hésitante entre l'Italie et l'Allemagne en formation, deux nations dressaient leurs forces en paraissant l'une et l'autre révolutionnaires et en l'étant aussi, quoique avec les procédés les plus différents, la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne, une fois de plus, fidèle à sa tradition de prudence internationale qu'elle base sur un nationalisme profond, mais raisonné et réformateur, avait agi à travers tous les événements avec un égoïsme adroit et discret[98], avec une tranquillité froide et savante[99]. La diplomatie s'était montrée pleine de promesses, puis de retenue, dès que l'appui moral effectif devenait nécessaire à seconder la simple assistance diplomatique[100] ; et cette tactique avait continué de réussir, notamment auprès des Piémontais persuadés que seule l'Angleterre les avait soutenus alors que nous avions tout fait, car les nations sont comme les hommes, elles aiment encore mieux ce qui flatte leurs passions que ce qui sert leurs intérêts[101]. Au contraire, fidèle elle aussi à sa tradition de sincérité généreuse, restant elle-même parmi ses calculs, mais craintive d'elle-même, désorientée dans sa tradition révolutionnaire autant que dans sa tradition monarchique, comme diminuée en face d'une Europe qu'elle orientait d'abord, de par sa révolution même, la France continuait de faire prévaloir sa politique pacificatrice de services européens. Tocqueville s'en était félicité à la tribune et avait avoué une partie de ses inquiétudes dans ses Souvenirs. Odilon Barrot se félicite simplement, et durant son ministère et dans ses Mémoires : Par un mélange de fermeté et de modération dans nos rapports avec les gouvernements étrangers, nous avons pu maintenir la paix sans rien sacrifier de notre dignité et en montrant qu'au besoin, et lorsque l'honneur et les intérêts de la France seraient engagés, nous saurions tirer l'épée. Déjà nous n'avions plus à redouter d'être seuls contre tous ; le cercle de fer dans lequel avait été enfermé le gouvernement de Louis-Philippe était brisé[102]. Et son illusion, si naïvement confiante, lui faisait dire encore : Il était permis d'entrevoir qu'à la vieille Sainte-Alliance de 1814 et de 1815 allait se substituer une nouvelle alliance plus vraiment sainte, celle des nations les plus avancées dans les voies de la liberté et de la civilisation[103]. — Le président du Conseil oubliait la mort de Venise (24 août 1849), citadelle de sang, de pierre et de feu démantelée au ras de la lagune[104], symbole héroïque qui semblait consacrer la défaite définitive de la révolution universellement abattue. Les chutes successives des trois villes que nous avions indiquées[105] comme celles où flottait encore le drapeau révolutionnaire fermaient le cycle au centre duquel César, diminué dans son rôle essentiel, quoique réservant en secret une partie de l'idée révolutionnaire, malgré lui, apparaissait désormais le contraire de ce qu'il avait semblé figurer à la fin de l'année précédente, — le moyen et l'ouvrier, cette fois, de la réaction. La révolution atteinte avait reflué vers lui peu à peu et il n'avait pu ou osé répondre à son appel diminué ; la réaction grandissante, incapable de se mettre d'accord sur les personnalités diverses qui la soutenaient ou qu'elle poussait en avant, venait, à son tour, lui demander d'être son chef. Cependant, tandis même que le ministère s'applaudissait de la paix conservée à tout prix, une dernière fois encore la révolution vint tenter la France. Elle lui offrait de briser la Sainte-Alliance, vite, pendant qu'elle était encore républicaine. La Hongrie défaite sous les forces combinées de l'Autriche et de la Russie, quelques officiers de son armée, dont plusieurs Polonais, avaient cherché refuge sur le territoire ottoman. La Russie et l'Autriche, au mépris de tous les droits, sommèrent la Turquie de livrer les fugitifs et la manière dont la sommation était faite, comme les notes menaçantes qui l'encadraient, laissaient entendre que le refus entraînerait la guerre. La Porte, indignée, protesta, puis, pour se couvrir, demanda protection à la France et à l'Angleterre. L'Angleterre se montrait bien disposée en faveur de la Turquie, mais ne se souciait pas d'agir seule ; elle sollicita l'entente avec la France qui se déclara, sans hésitation, prête à appuyer la Turquie par les armes. Ordre fut même donné à la flotte, alors à Messine, de faire voile vers le Bosphore afin de combiner ses mouvements avec l'escadre anglaise. M. Thiers, affolé à cette nouvelle, exhorta vainement le président de la République, dans un langage très vif ; il nous déclarait perdus si nous ne revenions pas sur une aussi folle témérité. La Russie et l'Autriche, malheureusement pour nous, reculèrent. Sans leur prudence, nous eussions vu les forces réunies de l'Angleterre et de la France faire sous la République ce qu'elles ont fait plus tard sous l'Empire, mais, cette fois, avec des conséquences plus étendues, l'Autriche étant engagée directement dans la lutte[106]. L'occasion était belle, unique. — Nous reconnaissons mieux encore que la guerre de Crimée, comme celle d'Italie — comme celle, même, du Mexique — comme celle de 1870, se trouvaient posées en tant que questions, tout au moins, et autrement déjà en 1849 qu'en 1848. * * *Les ministres, surtout le président du conseil et ses premiers collègues, étaient fatigués. Avant les vacances, ils devaient, toutefois, demander quelques votes, comme celui du budget. La situation financière réclamait une certaine attention. Les recettes, sous le gouvernement précédent, avaient diminué de cent quatre-vingt-huit millions en même temps que les dépenses avaient augmenté de deux cent soixante-cinq millions, malgré la consolidation d'une partie considérable de la dette flottante, au moyen de l'inscription au Grand Livre d'une rente de vingt-cinq millions ; le déficit pour 1850 se montait donc à 320.378.228 francs. Bien des systèmes furent naturellement agités à ce sujet. On repoussa l'impôt progressif comme se rapprochant trop des projets socialistes et, pour cela même, susceptible d'alarmer les capitalistes et les propriétaires, que nous avions, dit Barrot, tant d'intérêt à rassurer[107] ; les difficultés de sa perception arrêtaient aussi. Les moyens ordinaires prévalurent : deux cents millions de la dette flottante furent convertis en obligations dont le montant serait affecté à pourvoir aux travaux extraordinaires ; soixante-cinq millions pris sur l'amortissement et soixante-dix-neuf millions obtenus au moyen de l'accroissement de quelques impôts anciens et de l'établissement d'impôts nouveaux permit de présenter un budget en équilibre, ainsi que d'offrir un excédent de sept millions, excédent dont les réductions projetées dans l'armée et l'accroissement dans les revenus des impôts indirects devaient nécessairement élever le chiffre. L'État avait repris aussi les concessions de chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Marseille ; mais la situation embarrassée de ces grandes compagnies réagissait d'une manière fâcheuse sur le crédit public. Les travaux déjà faits sur la ligne de Paris-Lyon furent abandonnés à une nouvelle compagnie ; ils représentaient une valeur de cents quatre-vingt millions ; vingt-quatre millions furent accordés en sus pour la traversée de Lyon ainsi qu'une subvention de quinze millions. Aux termes de la constitution, une constitution nouvelle devait être donnée à la magistrature, mais il ne restait qu'une simple formalité à remplir, puisque la loi votée par Crémieux avait été rejetée et que le maintien des cours et des tribunaux, tels qu'ils existaient, avec tout leur personnel, avait été décrété, après réserve de quelques réformes ultérieures. Il était donc évident que l'inamovibilité de la nouvelle magistrature française avait reçu une nouvelle force de la révolution de Février. Au milieu de toutes les destructions, seul l'ordre judiciaire était demeuré debout, comme en 1830 ; le cas était, toutefois, différent, car, en 1830, — Barrot le fait lui-même observer — il était à peu près convenu, parmi ceux qui avaient donné le signal de la révolution et qui la dirigeaient, que cette révolution devait se borner au changement de la dynastie[108] ; au contraire, en 1848, où tout avait été bouleversé et renouvelé radicalement, le maintien de la magistrature ne pouvait plus s'expliquer que par la force vitale de l'institution elle-même[109]. La centralisation gouvernementale semblait excessive et défectueuse aux ministres qui voulaient la restreindre. Dufaure avait saisi les conseils généraux d'une suite de programmes renfermant une série de questions sur le sujet, de manière à ce que l'administration même fût en mesure d'établir ses vues sur sa propre décentralisation ; mais il se heurtait à l'indifférence, toujours si puissante, des gens satisfaits ou sans idées, des administrés auxquels leur besogne quotidienne paraissait déjà trop lourde, des citoyens peu désireux de risquer le moindre sacrifice de temps ou d'argent. On redoutait aussi, sans doute, dans certaines sphères du pouvoir, dont la prudence restait légitime, nécessaire, que plusieurs conseils départementaux ne fussent tentés d'abuser, dans un but politique opposé à celui du gouvernement, du pouvoir nouveau qui leur serait conféré. Les principales questions posées par Dufaure — nous sommes contraints dans un exposé si général d'abréger — se réduisaient à celles-ci : Chaque conseil général doit-il vérifier lui-même ses pouvoirs et prononcer, avec ou sans appel, sur les difficultés qui naîtront à l'élection ? — Les conseils généraux auront-ils la faculté de se réunir à volonté, ou ne le pourront-ils, comme dans la législation actuelle, que sous convocation expresse du préfet ? — Des commissions permanentes, directement élues par les conseils généraux, seront-elles appelées à fonctionner sous la direction des préfets, dans l'intervalle des sessions ? — Y a-t-il lieu de modifier la distribution faite par les lois existantes des charges entre l'État et les départements ?... Maintiendra-t-on la nécessité de l'approbation du budget départemental par le ministre ou suffira-t-il d'ouvrir un recours au conseil d'État à exercer par le préfet ou les parties lésées ? Dufaure désirait savoir si l'on estimait que les élections municipales dussent se faire par quartiers ou par professions, ou bien par l'universalité des habitants au moyen d'un scrutin de liste. Ces questions répondaient à ce grand et difficile problème de la décentralisation dont la solution importe tant à la liberté, à la moralité du pays, et même à la stabilité des institutions, solution difficile car elle rencontre non seulement la résistance aveugle et obstinée des gouvernants, mais aussi une opposition dans les mœurs et les habitudes invétérées des gouvernés qu'il est bien difficile de surmonter[110]. — Rien ne fut réalisé d'efficace ni de durable. Le mouvement s'orientait si peu dans ce sens que les ministres eux aussi, ayant à réorganiser l'Assistance publique, y introduisirent l'unité et l'uniformité qui dominent dans toutes les autres branches de l'administration[111]. Louis-Napoléon secondait de son mieux son ministère, cependant, pour toutes les lois qui traitaient de réforme ; et, sur la voie de la charité légale, il se montrait fort avancé ; il n'aurait même pas craint de se rapprocher de certaines vues de la secte socialiste[112]. L'entente, qui n'avait jamais été très réelle, se préparait, d'ailleurs, à cesser. Le prince-président occupait toujours plus l'opinion publique que le Parlement ou que le ministère et cela eût suffit à renouveler la méfiance qui n'avait pas désarmé à son égard. Le ministère orléaniste était conséquent avec lui-même en s'efforçant à ce que le prince*président ne fût rien ; il se plaçait dans la vraie lignée constitutionnelle : le roi règne et ne gouverne pas. De même Louis Bonaparte, sentant la nécessité de son action, de plus en plus poussé à celle-ci, d'autre part, par sa propre impatience, contrarié et même humilié par ce ministère, était entraîné à ne pas le subir sans le combattre[113]. Dans un gouvernement vraiment représentatif, disait le président du conseil, c'est-à-dire avec un ministère solidaire et responsable, alors surtout que la représentation nationale est permanente et toujours présente, la partie importante de l'action gouvernementale est tout entière dans les rapports incessants entre le ministère qui parle pour le gouvernement et en répond et l'Assemblée représentative ; le gouvernement est forcément transporté à la tribune ; c'est de là que partent toutes les impulsions, là que se décident les grandes affaires, là que s'exercent les influences : est-il surprenant, dès lors, que Louis-Napoléon, qui n'avait et ne pouvait avoir accès à cette tribune, éprouvât une sorte de malaise à se voir, en quelque sorte, effacé de cette scène où se débattaient les grands intérêts du pays et sur laquelle tous les yeux étaient constamment fixés[114]. Les gens un peu attentifs, à même de se renseigner, pressentaient bien que le prince-président et ses ministres, poursuivant des vues différentes, finiraient par se heurter. Ses ministres l'accusaient de rechercher les conflits, de les faire naître au besoin, et lui, continuellement suspecté, d'une manière trop apparente, blessé, devenait susceptible, bien que ce penchant ne fut pas dans sa nature, de peur qu'on lui manquât d'égards. Il s'émut ainsi de ce fait que les ministres se concertaient d'avance avant de se réunir dans le conseil[115], et les ministres, qui s'étonnaient de sa surprise, oubliaient que la réciproque les eut également alarmés. Barrot sentit bien d'ailleurs la justice de la réclamation, douce et ferme à la fois, qui lui fut adressée en ces termes : Je vous ferai remarquer que les deux conseils chez vous et chez moi ont des inconvénients, car non seulement cela multiplie les discussions et fait perdre du temps, mais cela conduit tout naturellement à prendre des décisions sans moi. Ainsi je trouve irrégulier qu'on ait parlé au général Oudinot de la possibilité de lui donner l'expédition de Civita-Vecchia, avant même que nous ayons décidé dans quelles circonstances nous la ferions[116]. Ce que je veux éviter, c'est l'inconvénient qui arrive, presque tous les jours, de décisions prises sans moi et que j'apprends par la voix publique ; car lorsque cela arrive pour des faits même insignifiants, cela nuit à ma considération et à celle du ministère... Les torts ne semblaient pas du côté de la présidence. Ici, dit Odilon Barrot[117], les susceptibilités du président n'étaient pas tout à fait dénuées de fondement ; d'un autre côté, la constitution ayant fait du ministère un être collectif et responsable, et l'ayant placé entre les deux pouvoirs pour les modeler et les concilier, il fallait bien que cet être eut sa pensée, sa politique à lui, et que parfois, il concertât ses résolutions. Les deux responsabilités distinctes du président et de son ministère étaient la plus grande difficulté de cette constitution ; il nous était bien difficile de la faire disparaître entièrement, nous ne pouvions que l'atténuer à force de ménagements et de bonne conduite, et c'est à quoi j'appliquais tous mes efforts. Tout prouve ainsi, et du témoignage même de la partie qui fut la plus accusatrice, que la situation, déjà signalée comme provisoire, touchait de plus en plus à son échéance. Le président manifestait de l'impatience à s'affranchir de son ministère ; le Parlement, d'un autre côté, tendait à la prééminence, et le ministère, pris entre les deux, devait sauter le premier. Voyant toutes ses avances rejetées, le prince s'était rejeté dans une affabilité imperturbable mais froide et opposa à ses ministres ce regard terne dont a parlé Tocqueville, ce silence, dont il a dit : Les paroles qu'on lui adressait étaient comme les pierres qu'on jette dans un puits, on en entendait le bruit, mais on ne savait jamais ce qu'elles devenaient[118]. Au moment des vacances parlementaires, le ministère certifia qu'en l'absence des députés la constitution, comme la liberté, ne couraient aucun risque, mais l'assurance parut une simple formalité et tout le monde se reprit à parler de coup d'État. Prorogation signifie tranquillité et sécurité, disait le député d'Avrincourt, et cette sécurité, est-elle bien garantie ? Et comme Dufaure répondait : De bonne foi le pouvoir ministériel n'est pas dans des mains qui aient donné lieu de croire qu'elles se porteraient à un coup d'État, on lui répliqua : On le fera pour vous ! A ce moment l'Assemblée voulait encore se servir du Ministère pour se garantir contre le prince-président et, si possible même, le juguler ; ce fut dans cet esprit que M. Levet proposa, par amendement, de faire cesser la prorogation de plein droit le jour où le ministère serait changé. C'était dur et le ministère n'osa pas ; de plus il en voulait peut-être, secrètement, sans se le dire non plus, à ceux qui l'avaient mis ainsi brutalement face à face avec la pente même de son destin[119]. La commission de prorogation, composée de membres insignifiants de la majorité, montrait d'ailleurs ainsi que ces bruits de coups d'État répondaient, surtout, en même temps, à une crainte vague ou à une sorte d'attente, imposée par la situation, et qu'ils n'étaient pas réellement redoutés. Cette perspective n'effrayait qu'une partie du monde politique ; le pays n'était pas inquiet dans sa grande majorité. A la Bourse, on se plaisait à voir les finances demeurer dans la condition normale de l'équilibre des recettes et des dépenses ; les manufactures reprenaient toute leur activité et l'essor industriel suivait une marche ascendante, considérable. Épuré, le personnel gouvernemental se montrait tel que le voulait le pouvoir ; la population restait soumise, apathique. La capitale avait affirmé sa confiance aux élections des onze députés qu'elle avait à élire en assurant le triomphe du parti conservateur. L'exposition industrielle présidait aux fêtes du même genre dont le second Empire allait si bien permettre, soutenir et répandre les effets. La détente semblait sérieuse à la plupart, et le 13 juin était déjà comme un mauvais rêve. L'Assemblée se sépara en criant une fois encore : Vive la République ! Peu de cris manquèrent autant de sincérité. A part ce qui subsistait de la gauche et quelques rares conservateurs républicains, les députés acclamaient le maintien du rempart parlementaire qui empêcherait l'empire, ou, en attendant, la dictature, qui, cette besogne accomplie, devait dans leurs plans s'écrouler de lui-même afin de laisser la place à la royauté. — La simple lecture des journaux renseignait, cependant, sur le chemin parcouru par Louis Bonaparte. Au lieu de laisser agir ses amis, il se mettait en scène lui-même, maintenant, et devenait son meilleur agent de propagande. Avant de mourir, le 10 juin, le maréchal Bugeaud avait dit au prince venu lui faire visite : Je suis bien aise de vous voir ; vous avez une grande mission à remplir, vous sauverez la France avec l'union et le concours de tous les gens de bien. Dieu ne m'a pas jugé digne de me laisser ici-bas pour vous aider. Ces paroles, répandues partout, avaient produit l'effet d'une nouvelle consécration. Le président continuait, de plus, ses visites dans les hôpitaux, et les feuilles rapportaient aussi ses paroles aux malades : Nous avons vu, assurait le Moniteur, des larmes de reconnaissance couler des yeux de plusieurs d'entre eux, et il a quitté les salles au milieu des bénédictions de tous. Le même Moniteur publiait une adresse du conseil général de la Seine-Inférieure sur les événements du 13 juin qui fait connaître l'état d'esprit le plus général : Pendant que la France, encore émue des dernières tentatives des factieux, nous voyait d'un œil plus calme marcher avec fermeté et prudence à la réalisation des espérances que l'élection du 10 décembre a fait naître, l'insurrection la plus audacieuse est venue tout à coup menacer la propriété, la famille, la religion, la civilisation tout entière... Le 13 juin, vous en triomphez avec une résolution et un courage dignes du grand homme qui vous a laissé son nom et son exemple. Grâces vous soient rendues... Poursuivez, monsieur le président, la mission presque divine qui vous est confiée. Vous avez déjà conquis l'estime et la reconnaissance de la France ; les six millions de suffrages qu'elle a donnés à votre nom, dans lequel elle voyait un symbole d'ordre et de paix, elle vous les donne aujourd'hui à vous-même. Persévérez, vous êtes dans la voie des grandes choses. On ne parlait, cependant, pas d'empire : Vous pouvez, suivant vos desseins, fonder la république sur des bases inébranlables... — Et la même question que précédemment se pose ici encore : Pensait-il à l'empire quant à lui ? Le voulait-il réellement ? Fausse, en effet, et pleine de casuistique en apparence, cette question demeure, étant donnée une personnalité que nous avons déjà reconnue si complexe, souvent si incertaine d'elle-même, de sa propre direction. Au milieu des ambitions réactionnaires qui montaient à l'assaut du pays sous la bannière républicaine et d'autant mieux qu'il les avait favorisées par son alliance avec Falloux, l'élu de décembre croyait vérifier de plus en plus la nécessité du pouvoir fort qui répondait, au surplus, à ses instincts personnels ; il avait le sentiment que, sans ce point de défense centrale, il ne parviendrait pas à empêcher la France, — car il s'en faisait sans effort l'arbitre, — de s'épuiser en luttes intestines ; de plus, la république lui paraissant aussi impossible que la monarchie, dans ce sens, et de fait, il préparait l'empire, répondant ainsi aux vœux de la majorité à laquelle il devait l'Elysée. La république véritable, la république sociale ou, du moins, à tendances sociales une fois tombée par suite de la complicité générale, le même genre de complicité lui avait valu le poste suprême ; or elle l'y maintenait de jour en jour davantage. Tous les hommes politiques qui subsistaient aspiraient sans se l'avouer à être départagés et trompés. Au 10 décembre 48, nous avons récapitulé de quelle longue suite d'efforts et de capitulations révolutionnaires, d'autre part, il était la suite, le résultat, l'aboutissant ; de même, à cette date de 49 où il sentait, mieux que tout autre, et en dépassant quelquefois la réalité, que ce mouvement, chaque jour accru par les faits et la situation, le poussait à l'empire, le lui imposait, — étant donné le caractère si peu éduqué de la nation, — en quelque sorte. Il ne réservait ni ne possédait de sentiment assez profondément moral, ou suffisamment idéaliste, pour saisir ce à quoi il s'était engagé vis-à-vis du pays futur comme du pays présent, et que la fondation d'une république vraiment républicaine était le devoir le plus essentiel comme le plus clair, le seul, du second Bonaparte. Il ne trouva pas non plus en lui-même, sans doute, suffisamment de décision pour aller au bout de ses raisonnements et, les poussant dans la partie féconde de leur logique, découvrir avec exactitude la part du nécessaire et de l'inutile. Le tâtonnement, inévitable en politique, l'indécision continue, peuvent, trop prolongés, devenir une faute, principalement après une révolution et chez un chef ; or, Louis-Napoléon, désormais en face des difficultés immédiates, renseigné sur ces difficultés du gouvernement dont les simples spectateurs ne peuvent pas, en général, se faire idée, n'était plus du tout l'ancien conspirateur de Boulogne ou de Strasbourg ; il ne savait pas se décider, devait faire un effort qui lui coûtait pour y parvenir. Enfin, dans le sentiment particulier du devoir qui était sien, il n'avait pas puisé ce détachement supérieur si nécessaire à quiconque veut faire entrer dans la réalité les tendances heureuses de l'extrême gauche montagnarde, détachement à défaut duquel la bonne volonté tombe par suite de tout ce que certaines idées et certaines troupes conservent presque volontairement, avec une méfiance quelquefois sans justice, toujours hostile, jamais reconnaissante, d'inachevé, de brutal, ou même, à certains moments, d'absurde. Il faut reconnaître, de plus, que ces partis, — et ils ne pouvaient agir autrement après leurs premières invites, — l'avaient récusé. Il repoussait, en outre, — car il ne l'ignorait pas sous cette forme souple, qui permit son succès et dont bien peu se fussent préservés, — cette force particulière venant d'une conscience sévère, d'une discussion intime rigoureuse et d'une sorte de sentiment religieux qui mène à dépasser la réalité immédiate au bénéfice de la réalité prochaine quand celle-ci a été reconnue nécessaire en même temps que bonne et possible. Il perdait peu à peu le sentiment de sa mission et, quoique jeune, touchait à l'étape où la réussite diminue celui qu'elle consacre. Le côté d'épicurien, signalé par Tocqueville, encore que très naturel, devait d'autant plus se développer que Louis-Napoléon restait seul, moralement, et qu'une solitude continuelle, dépourvue d'aucune possibilité de confidence dans une atmosphère de famille ou d'amitié sûre, réclame des détentes brutales. Il réalisait son but à un âge trop avancé pour ne pas ressentir une désillusion profonde, trop jeune, d'autre part, pour savoir d'un coup dépasser celle-ci. Le plaisir lui redonnait le goût chaud de la vie, accentuait ses sentiments, ravivait momentanément son cœur isolé. — Tout cet ensemble devait l'amener à une sorte de rêve qui, quoique méthodique et très raisonné, demeurait, en partie, du rêve. Le terrain solide des faits qui avait manqué aux hommes de Février, théoriciens et non praticiens, lui faisait également défaut, car le rêve n'est possible, en politique, que venu de la réalité, discipliné, dominé par elle, ou par cette réalité prochaine dont nous parlions quelques lignes plus haut, subordonné à elle ; le rêve de Louis-Napoléon subordonnait, au contraire, fréquemment, la réalité à des desseins, à des sentiments personnels insuffisamment discutés, confus parfois, et l'intérêt rétrospectif qui, de ce fait, auréole sa physionomie romantique, fait mieux soupeser ce qu'elle condensait de redoutable pour les contemporains nécessairement préoccupés de réalité immédiate. Une croyance invincible en soi-même, que les événements justifiaient sans cesse, augmentait à la fois cette confiance, les calculs auxquels elle se plaisait et la reconnaissance de la fatalité qui le conduisait à l'empire ; mystique très spontanément, il distinguait là une raison impérieuse et, par cette suite de raisonnements — car il était trop honnête homme, encore que d'une manière élastique, pour n'avoir pas besoin de se sentir absous, — il en arrivait à la nécessité de la conclusion impériale. Il lui semblait encore ainsi réaliser cette idée saint-simonienne qui l'avait toujours intéressé et dont l'empire industriel manifesta de nombreuses tendances. La certitude absolue, sans cesse démontrée, que la France, plus qu'à aucun moment peut-être, avait besoin d'une autorité centrale et le sentiment, — légitime en partie par suite des essais précédents — que cette autorité demeurait impossible alors dans la République, le poussaient à cette restauration. Au milieu des exagérations et des dangers de tout ordre, un peu comme Cavaignac se cramponna, encore que d'une manière toute différente, avec une souplesse qui fut son salut, se laissant aller sur le courant favorable, s'y livrant avec confiance, il serra simplement le gouvernail de la barque qui portait sa fortune, correct, parfait, impénétrable, séduisant et mystérieux. S'il y eut de sa part parti pris, ce fut celui-là. Montrez-moi la maison de Bourbon réunie, disait-il à Falloux, vous me trouverez alors tout prêt à prendre ma canne et mon chapeau[120]. L'aurait-il dit, cependant, si l'accord eût existé ? La discussion sur ce point reste largement ouverte. Il eût peut-être, en ce cas, été uniquement républicain ; pour le moment, en n'étant que cela, il se fût montré contre cette majorité qui étayait sa fortune.— L'équivoque résidait en elle autant qu'en lui, sinon plus[121] ; elle ignorait ce qu'elle voulait au juste, et elle voulait cependant autre chose ; lasse de la république, elle redoutait la monarchie et elle se persuadait, à la suite de son coup de tête, que la monarchie constitutionnelle, encore qu'elle la regrettât un peu, doucement, ne suffisait plus, étant donné ce qui s'était passé depuis sa chute ; elle disait au neveu de l'Empereur de vouloir à sa place. — Il ne vit pas que son devoir était de profiter de l'autorité afin de rendre la République possible, d'abord, durable ensuite, sociale enfin, — mais le pouvait-il ? Car les questions de temps et de réélections pesaient, pressantes bien tôt. — En résumé, résultat de la situation, il était le résultat de toutes les diverses oppositions qui avaient combattu le règne de Louis-Philippe, de toutes les espérances, de toutes les désillusions, qui l'avaient suivi comme de l'impossibilité de construire quoi que ce fût de durable, impossibilité qui se poursuivait tout en démontrant que tant d'instabilité ne pouvait se prolonger. Enfin, pour achever la contradiction, il était encore l'héritier de Louis-Philippe et, même, de l'orléanisme. * * *Il fit une série de voyages, une sorte de tour de France politique. Le 6 juillet, il assistait à l'inauguration du chemin de fer de Paris à Chartres et répondait au toast du maire : ... C'est à Chartres que saint Bernard vint prêcher la deuxième croisade ; magnifique idée du moyen âge qui arracha la France aux luttes intestines et éleva les luttes de la foi au-dessus du culte des intérêts matériels. C'est aussi à Chartres que fut sacré Henri IV, c'est ici qu'il marqua le terme de dix années de guerre civile en venant demander à la religion de venir bénir le retour à la paix et à la concorde. Eh bien, aujourd'hui, c'est encore à la foi et à la conciliation qu'il faut faire appel : à la foi qui nous soutient et nous permet de supporter toutes les difficultés du jour, à la conciliation qui augmente nos forces et nous fait espérer un meilleur avenir. L'invitation au clergé ne se déguisait plus, s'affirmait, presque gênante. Venait-elle de la constatation désespérée que la France n'était pas encore prête pour se libérer de l'étouffante emprise cléricale ou de sa seule ambition ? Tout ce que nous avons examiné précédemment au sujet des affaires romaines nous a fait voir de quelle manière le prince-président se trouvait acculé. Nous avons alors démêlé les parts de sincérité, d'ambition et de duplicité vague qui s'amalgamaient en lui. — Sur le chemin de Chartres, en passant par Rambouillet, il avait entendu le préfet lui parler dans son allocution du wagon qui porte César et sa fortune[122]. Le 16 juillet, il présidait à Amiens une distribution de drapeaux aux gardes nationales de la Somme. Cent cinquante mille personnes étrangères à la ville étaient venu assister à cette réception, et certains avaient fait plus de quinze lieues. Le défilé comprenait tous les costumes, même les plus inattendus, toutes les armes, le vieux casque du sapeur pompier comme le shako des recrues du 1792 et de 1813, la pique et le mousquet. Des cris incessants de Vive le Président de la République ! Vive Napoléon ! acclamaient le voyageur ; il faudrait[123] y joindre ceux de : Vive Napoléon II ! Vive l'Empereur ! et même cet appel impérieux, pathétique, indice de profonde lassitude, de paresse et d'inéducation, à l'autorité : Vive l'Empereur absolu ! Chaque garde national portait dans le canon de son fusil un petit drapeau tricolore frappé de l'effigie du président et levait son shako en passant devant lui. Après la revue, Louis-Napoléon, après une ovation continuelle, inouïe, délirante, gagna la cathédrale. Le soir, il fut accompagné à l'embarcadère par toute la population ; les rues où il passa étaient jonchées de fleurs. Ce fut à Amiens que, pendant la revue de la garde nationale, Changarnier, alors encore dévoué au prince et à l'idée d'empire, tandis qu'il chevauchait à côté du président, se retourna vers Persigny, qui se tenait derrière, recula et se penchant vers lui avec émotion, tandis que les acclamations faisaient rage : Que le prince en finisse, lui dit-il, s'il veut se faire proclamer empereur et répondre aux aspirations populaires, il peut compter sur moi ; qu'il me parle franchement, qu'il s'entende avec moi et nous en aurons bientôt fini avec la République[124]. Persigny transmit évidemment ce langage au prince. Il avait appuyé le prochain voyage où l'on devait s'efforcer de faire des avances aux légitimistes, et il acceptait quant à lui leur alliance, quitte à la rompre après le succès[125] ; mais Louis-Napoléon n'était pas homme à se laisser séduire par des ouvertures de ce genre[126], et l'ancien rédacteur des Lettres de Londres, revenant à la comparaison qui lui était chère, ajoutait : Comme Octave arrivait de Grèce, après la mort de César, il se sentait encore mal à l'aise au milieu de tant d'éléments inconnus. Encore privé, à cette époque, de l'autorité morale que donne seul, dans le monde politique, l'avantage d'avoir fait ses preuves de capacité, il éprouvait une sorte d'embarras vis-à-vis des réputations établies[127]. Les voyages le renseignaient, en tout cas, sur la France, qu'il ne connaissait pas, ou par des rapports toujours faussés, naturellement dans un but de complaisance. Le 22 juillet, il était à Ham, au milieu d’un enthousiasme plus grand encore qu'à Amiens[128]. Il assistait à un Te Deum. Au banquet le maire tint ce discours : La ville de Ham se rappelle avec reconnaissance votre bonté inépuisable à laquelle les malheureux n'ont jamais fait appel en vain. Après l'éloge, déjà classique, au restaurateur de l'ordre, il indiquait les œuvres de bienfaisance de l'ancien détenu et concluait : Les habitants saluent en vous l'élu de la divine Providence qui veille sur notre belle patrie. Louis-Napoléon fut adroit, encore qu'il déçut peut-être quelques-uns : Aujourd'hui que, élu par la France entière, je suis devenu le chef légitime d'une grande nation, je ne saurais me glorifier d'une captivité qui avait pour cause l'attaque contre un gouvernement régulier. Quand on a vu combien les révolutions les plus justes entraînent de maux après elles, on comprend à peine l'audace d'avoir voulu assumer sur soi la terrible responsabilité d'un changement. Je ne me plains donc pas d'avoir expié ici par un emprisonnement de six années ma témérité contre les lois de ma patrie et c'est avec bonheur que, dans les lieux mêmes où j'ai souffert, je vous propose un toast en l'honneur des hommes qui sont déterminés, malgré leurs convictions, à respecter les institutions de leur pays. Les orléanistes ne pouvaient qu'applaudir cette amende si honorable à laquelle ils n'osaient croire, au moins sous une forme aussi complète. L'effet produit par le discours de Ham est immense, disait le Dix-Décembre. Tous les doutes sont aujourd'hui dissipés... L'histoire a rarement fourni de tels exemples de noble sincérité. Les conservateurs de tout ordre étaient tranquillisés ; le prince-président semblait avoir renié tout ce qui subsistait en lui de la donnée révolutionnaire napoléonienne, grâce à laquelle tant de suffrages lui avaient été acquis. Néanmoins la droite absolue n'aimait pas lui voir jouer un rôle qu'elle réservait au roi. La Gazette de France enregistrait des bruits de coup d'État, de 18 brumaire, d'aigle venant d'Alsace et volant, comme au 20 mars, de clocher en clocher. Elle se demandait si un parti n'existait pas dont l'idéal serait la reconstitution de l'Empire, au point, disait-elle, que l'Assemblée ne peut plus contenir le pouvoir exécutif dans les rails d'une constitution décrétée, et, la pensée et le talent en moins, la Gazette parlait un peu comme Proudhon avant le 10 décembre : L'Empereur fera des levées d'hommes et d'argent par décret... Les conscriptions seront sans frein et sans limites... Il aura une garde nationale de 400.000 hommes et des mameluks... Il fera même la conscription des filles les plus belles et les mieux dotées de son empire pour les donner en mariage à ses officiers... D'autres journaux se montraient inquiets. La Liberté fournissait une note différente, intéressante par rapport à l'avenir : Qui donc aurait intérêt aujourd'hui à désirer l'Empire ? L'Empire avec les Falloux, avec les Thiers, avec les Fould ! L'Empire avec les boursicotiers de Louis-Philippe ! Taillé sur le patron du dernier règne, l'Empire deviendrait épicier. Il ne manquerait que ce dernier outrage au grand nom de Napoléon ! Et le discours de Ham révolte le rédacteur : Avant d'être au pouvoir, faire de l'opposition, invoquer les grands et nobles sentiments qui font vibrer le cœur du peuple, et puis, une fois au pouvoir, condamner son passé, poursuivre ses amis, trahir les principes et ses propres intérêts et se déclarer coupable !... A cinq ans de distance il sera permis d'appeler régulier un gouvernement contre lequel on a fait trois volumes et deux insurrections. A cinq ans de distance, il sera permis de se précipiter aveuglément dans les bras des mêmes hommes qu'on livrait à la risée de la France et de l'Europe... Il sera permis de retourner humblement au lieu même où l'on a écrit ces pages étincelantes de vérité et de les désavouer publiquement... L'ordre, c'est ce que tout conspirateur demande quand il est arrivé au pouvoir... Les journaux anglais parlaient également du coup d'État. Et Louis Blanc résumait la situation dans le Nouveau-Monde : Entre deux grands pouvoirs de grande origine et de nature diverse, il est impossible que tôt ou tard la lutte ne s'engage pas... Lorsque le pouvoir flotte au hasard entre un homme et une assemblée, on peut tenir pour certain que cette assemblée porte avec elle un 10 août et que cet homme a derrière lui un 18 brumaire. Sans évoquer cette perspective, Lamartine continuait avoir dans Louis Bonaparte un homme à la hauteur de ses devoirs envers le pays, un homme d'État d'un coup d'œil juste et serein, un bon cœur, un grand bon sens, une sincère honnêteté d'esprit, une modestie qui voile l'éclat, non la lumière. Le président ne ménageait pas que le clergé ; il faisait toutes les avances possibles aux légitimistes[129]. On le remarqua notamment au cours de son voyage dans l'Ouest. Il s'y montra aussi plein de prévenances pour la presse[130]. Son voyage s'annonça dès le début sous les plus heureux
auspices. Place Beauveau on cria : Vive l'Empereur !
tandis qu'il quittait l'Elysée[131]. Après s'être
arrêté à Étampes, afin d'y passer en revue la garde nationale, il a perçut,
le long de son trajet, une population immense accourue pour le voir ou, à
défaut, le train qui l'emportait ; d'Orléans à Angers, la voie était bordée
par deux haies humaines. A Orléans, il s'agenouilla dans la cathédrale pleine
de monde et gagna Saumur pour y coucher. Il voulut
entrer dans cette ville à cheval, afin de se trouver en contact avec les
populations accourues de toutes parts et pour accueillir plus directement les
placets. Sa prévision ne fut point déçue. Ni les pétitions, ni les
acclamations ne lui manquèrent. Le lendemain matin, il assista à un brillant
carrousel de l'école de cavalerie et partit pour Angers[132]. A la gare,
l'attendaient l'évêque, Mgr Angebault, et le préfet, M. Bordillon. L'évêque
bénit les locomotives — ce qui se faisait beaucoup alors — puis lui adressa
une allocution assez spéciale, qui porta, peut-être, le prince à réfléchir : En ce moment, sur une autre terre, votre nom encore est
béni et, aux accents de tout un peuple arraché à l'oppression, se mêle la
voix auguste du pontife vénéré que la Ville Éternelle réclame. Le
préfet, quant à lui, républicain de vieille date, conduisit le prince poser
la première pierre d'un hôpital situé assez loin hors de la ville, et le
prince-président trouva la course d'autant plus démesurée que des visages et des cris fort divers[133]
l'accueillirent. De plus M. Bordillon, très simple dans sa mise, donna une
fête à la préfecture le soir où le prince lui sut mauvais gré des hommes en
redingote et des femmes qui n'étaient point en toilette de bal ; il fit le
tour des salons et se retira vite. Il lui fallait déjà, semblait-il, la
soumission et la cour. Au banquet, il n'avait remarqué que le maire au toast
duquel il avait répondu : Vos acclamations
s'expliquent parce que je représente ce système de modération et de
conciliation inauguré par la république, ce système qui consiste non à
implanter cette liberté sauvage permettant à chacun de faire ce qu'il veut,
mais la liberté des peuples civilisés permettant à chacun de faire ce qui ne
peut pas nuire à la communauté. Sous tous les régimes, il y aura, je le sais,
des oppresseurs et des opprimés : mais tant que je serai président de la
République, il n'y aura pas de parti opprimé. La magistrature aussi
lui plut, qui avait salué son élection comme une
inspiration providentielle des comices populaires. Sur le bateau à
vapeur qui emportait, le lendemain, le prince vers Nantes, il reprochait à
Falloux de ne pas l'avoir averti au sujet du préfet. Mais,
Monsieur le Président, c'est un de nos adversaires les plus prononcés, et il
a combattu mon élection avec acharnement. Devais-je rendre hostilité pour
hostilité ? C'est un homme d'esprit, je le croyais homme de meilleur goût.
Le préfet fut destitué après que Falloux eut quitté le ministère et envoyé à
Grenoble. L'embarquement avait eu lieu au milieu d'une affluence
considérable au cri de : Vive Louis-Napoléon !
Les populations riveraines de la Maine et de la Loire accouraient sur le
passage du bateau à la longue cheminée mince et aux larges roues. A chaque
bourg, à chaque village, c'étaient des volées de coups de cloche et des
décharges de mousqueterie. A Saint-Florent, où la population stationnait, le
président fit arrêter et salua plusieurs fois la foule et le monument de Bonchamps[134]. Je me tenais silencieux derrière lui, a raconté
Falloux, contemplant ce beau spectacle, mais
regardant aussi plus loin. Derrière Saint-Florent, je voyais la Vendée tout
entière. A Saint-Florent même, j'apercevais le monument de Bonchamps et
j'avais comme l'apparition de cette épouvantable traversée de la Loire qui
fut le coup suprême porté aux luttes et aux espérances de la Vendée. Mes yeux
se remplirent de larmes. M. de Heeckeren s'en aperçut et vint me serrer la
main. Nous ne prononçâmes un mot ni l'un ni l'autre ; nous n'en avions pas
besoin pour nous comprendre. Le tableau n'est pas sans grandeur. Il
montre, une fois de plus, la solitude de Louis-Napoléon, combien l'idée
républicaine était exclue. A Nantes, les acclamations furent frénétiques. On
cria : Vive l'Empereur ![135] Le prince eut
grand'peine à se frayer un passage à travers la foule, en dépit d'une pluie
torrentielle. Une tente magnifique avait été dressée sur la place Graslin. Le
banquet y fut donné. Le bal eut lieu dans la salle de spectacle. Louis-Napoléon
parla encore : Le voyage que j'ai fait ici restera
gravé profondément dans mon cœur, car il a été fertile en souvenirs et en
espoirs. Ce n'est pas sans émotion que j'ai vu ce grand fleuve derrière
lequel se sont réfugiés les derniers bataillons de notre grande armée ; ce
n'est pas sans émotion que je me suis arrêté devant le tombeau de Bonchamps ;
ce n'est pas sans émotion qu'aujourd'hui, assis au milieu de vous, je me
trouve en face de la statue de Cambronne. Tous ces souvenirs, si noblement
appréciés par vous, me prouvent que, si le sort le voulait, nous serions
encore la grande nation par les armes. Mais il y a une gloire tout aussi grande
aujourd'hui, c'est de nous opposer à toute guerre civile, comme à toute
guerre étrangère et à grandir par le développement progressif de notre
industrie et de notre commerce... Soyons unis, oublions toute cause de
discussion... et, bientôt, nous serons encore la grande nation par les arts,
par l'industrie, par le commerce. Ce Napoléon saint-simonien ne
pouvait que plaire aux grands chefs de l'industrie. Le lendemain, le prince revint en poste directement à la gare d'Angers avec Dupin et Falloux. Le président de la République, raconte celui-ci[136], n'aimait pas le président de l'Assemblée, qui le lui rendit jusqu'au 2 décembre exclusivement. La conversation fut donc dirigée principalement de mon côté. Je me suis bien amusé hier soir, en vous voyant danser en face de moi, me dit le président. Vous aviez l'air de danser pour votre compte. Le prince, après quelques plaisanteries sur les danseurs et les danseuses, avoua emporter de Nantes le regret d'avoir injustement affligé un honnête homme. Avant de me présenter les maires de la Loire-Inférieure, racontait-il, le préfet m'avait demandé la croix pour l'un d'eux dont il m'avait fait le plus grand éloge. Je voulus m'accorder le plaisir de l'annoncer moi-même à ce brave homme. Mais, au lieu de me remercier, celui-ci entama l'histoire d'un arriéré de pension militaire et en sollicita la restitution. Cette réclamation, en ce moment, me parut déplacée, et je le lui fis sentir durement. Le préfet, qui en fui témoin, m'apprit plus tard que ce maire avait promis son arriéré à la commune pour une œuvre de charité, que, n'ambitionnant pas la croix, il n'avait songé qu'à son but très désintéressé, et n'avait manqué de convenances que par un sentiment supérieur aux convenances mêmes. Je fis courir après lui, mais trop tard ; il avait déjà quitté Nantes, fort désolé de mon accueil que je réparerai de Paris, car j'en ai pris bonne note[137]. La route continua, Dupin sommeillant la plupart du temps, en passant par Saumur. Les voyageurs s'arrêtèrent aussi au château de Serrant, non loin d'Angers, que Napoléon avait trouvé le plus beau de la France. Il appartenait au comte Alfred Walsch, qui avait préparé une réception splendide. Le président fut traité en souverain, selon toutes les règles de l'ancienne étiquette. Le maître de la maison lui céda sa place à table et ne réclama ses droits que pour porter debout, avec l'excellent vin de la coulée de Serrant, un toast au président. L'hôte auguste répondit en termes fort aristocratiques, puis nous traversâmes rapidement Angers où nous prîmes le chemin de fer[138]. A Tours, l'affluence est aussi considérable. Il y parla
d'une manière importante et qui est à retenir pour l'étude de son caractère. Les acclamations dont je suis l'objet me touchent bien
plus qu'elles ne m'enorgueillissent. J'ai trop bien connu le malheur pour ne
pas être à l'abri des entraînements de la prospérité. Je ne suis pas venu au
milieu de vous avec une arrière-pensée, mais pour me montrer tel que je suis,
et non tel que la calomnie veut me faire. On a prétendu, on prétend encore
aujourd'hui, à Paris, que le gouvernement médite quelque entreprise semblable
au 18 brumaire. Mais sommes-nous donc dans les mêmes circonstances ? Les
armées étrangères ont-elles envahi notre territoire ? La France est-elle
déchirée par la guerre civile ? Y a-t-il 80.000 familles en émigration ?...
Nous ne sommes pas dans des conditions qui nécessitent de si héroïques
remèdes... A mes yeux la France peut être comparée à un vaisseau qui, après
avoir été ballotté par les tempêtes, a trouvé enfin une rade plus ou moins
bonne, mais où il a jeté l'ancre. Eh bien, dans ce cas, il faut radouber le
navire, refaire son lest, rétablir ses mâts et sa voilure, avant de se
hasarder encore dans la pleine mer. Les lois que nous avons peuvent être plus
ou moins défectueuses, mais elles sont susceptibles de perfectionnements.
Confiez-vous donc à l'avenir sans songer ni aux coups d'État, ni aux
insurrections. Ces coups d'État n'ont aucun prétexte, les insurrections n'ont
aucune chance de succès... Ayez confiance dans l'Assemblée nationale et dans
nos premiers magistrats qui sont les élus de la nation, et surtout comptez
sur la protection de l'Être suprême. Cet Être suprême, en 1849, était
tout un programme. Le discours enchantait Lamartine, qui l'appelait un coup d'État de loyauté et de patriotisme contre le coup
d'État d'usurpation dont se poursuivait la crédulité publique. Selon lui,
le président avait ainsi renouvelé à la face du pays
le serment prêté à la République devant l'Assemblée constituante. — Il
avait surtout pénétré au cœur de la question politique et tenu à dire,
loyalement, que la France, à ses yeux, n'avait pas besoin d'un 18 brumaire.
Il faisait même appel à la conciliation afin d'éviter les complications qui
avaient rendu le 18 brumaire nécessaire. Il faut insister,
dit Maupas, sur cette déclaration de Tours, et en
préciser encore la valeur, car elle renferme toute la politique de
Louis-Napoléon ; elle permet de pénétrer absolument sa pensée. Pour qui
voulait lire entre les lignes, le prince disait ainsi : Je me donne entièrement à vous pour gouverner avec la
constitution, mais à la condition d'une révision qui rende à la France la
libre disposition de sa volonté, qui lui permette de choisir son chef comme
elle le voudra, là ou elle le voudra, et qui ne violente pas ses préférences
par une exclusion inique, un ostracisme prémédité. C'était un avertissement. Et pour qui donc eût-il songé à
un coup d'État, à cette date de 1849 quand tous les procédés légaux
s'ouvraient encore naturellement devant lui ? Mais la constitution
n'était-elle pas révisable. L'article 131 ne stipulait-il pas ce droit
expressément ? Pouvait-on croire que, sous la pression si manifeste de
l'opinion, l'Assemblée oserait jamais se dérober à cette nécessité ? Et si la
constitution pouvait être ainsi légalement révisée, si aucune limite n'avait
été tracée par le législateur, si toutes ses dispositions pouvaient être
remises en question, tous ne pouvaient-ils pas sortir d'une modification
légale du parti fondamental ? Le président ne pouvait-il pas être proclamé
rééligible ? Ne pouvait-il pas recevoir un pouvoir prolongé ? La présidence à
vie n'était-elle pas une forme permise et compatible avec la doctrine
républicaine ? Et si même le pays, si l'Assemblée l'eussent voulu, où était
donc l'obstacle pour aller plus loin, pour rétablir l'Empire sans secousses,
sans coup d'État ? La logique était ainsi d'accord avec la vérité. Pour qui a
connu l'empereur et pénétré, si peu que ce soit, dans sa confiance, il est
certain que les moyens légaux avaient toutes les préférences de son esprit[139]... — A peine
revenu, il reprenait une autre tournée. A Blois, il avait été pour l'évêque l'élu providentiel. A Rennes, l'adjoint au maire lui demanda sur un ton pathétique de continuer à défendre le pays contre les fureurs des partis anarchiques. Pour aller à Rouen, il se fit accompagner de Changarnier. Sur la route, aux environs de Poissy, les gardes nationaux font la haie sur un si long par cours que le président fait arrêter le train et les passe en revue. Tout le monde crie : Vive Napoléon ! et les musiques jouent l'air : Veillons au salut de l'Empire ! En arrivant à Rouen, il se rend à la cathédrale afin d'y entendre la messe, et l'archevêque le félicite de voir ses premiers pas se diriger vers la maison du Seigneur. Il ajoute : C'est un gage des pieux sentiments qui vous animent et qu'on aime à trouver dans le chef d'un grand peuple. Vous avez rendu la paix à la patrie en associant heureusement l'ordre et la liberté. Vous avez rendu la joie à l'Église en relevant par l'effort de vos armes l'autorité temporelle de son saint et bien-aimé pontife. Que de motifs pour faire éclater notre reconnaissance ! La foule, partout, se presse sur son passage. Le soir, à l'hôtel de ville, le maire, après un éloge sans mesure du premier Empire, termine son toast : A Napoléon, à son neveu appelé aussi pour sauver la France et la civilisation, et qui justifie si bien les espérances de la patrie... Le président, infatigable, explique : Ce qui empêche notre prospérité de se développer, c'est que le propre de notre époque est de nous laisser séduire par des chimères au lieu de nous attacher à la réalité... Plus les maux de la société sont patents, et plus certains esprits sont enclins à se jeter dans le mysticisme des théories ... Il s'agit de donner à la société plus de calme et de stabilité. Vous avez bien jugé en pensant que le neveu de l'homme qui a tant fait pour asseoir la société sur ses bases naturelles ne pouvait pas avoir la pensée de jeter une société dans le vague des théories. C'est à Rouen qu'un soldat du 4e léger, qui recevait la croix de ses mains voulait se mettre à genoux devant lui et qu'il l'en empêcha en lui disant : Un soldat ne doit se mettre à genoux que devant Dieu ou dans les feux de peloton. Ces paroles sont de celles qui sonnent faux, plus tard, dans l'histoire, et qui, sur le moment même, ne pouvaient que faire sourire. On affectait d'y croire et d'admirer. Il y avait, réellement, pour que cette affectation fût possible, une sorte de diminution de l'énergie et de la pensée, de la vie même, en dépit de tant de décors chatoyants. En se rendant au Havre, sur toute la ligne du chemin de fer, il est encore salué par des populations enthousiastes. A Granville, le curé évoque lui aussi la Providence, qui nous a donné la grâce de contempler et de féliciter aujourd'hui le protecteur de la religion et le libérateur de l'auguste chef de l'Église ! Il monte en voiture, et tout le long de la route, la foule des gardes nationaux porte au bout de ses fusils des petits drapeaux sur lesquels est imprimé le portrait de l'Empereur. A Bolbec, plus de sept cents hommes sont sous les armes. A Ingouville, le clergé l'attend sous un dais et à son arrivée un cantique pieux appelle sur lui les bénédictions du ciel. A la sortie de la commune, il passe sous un arc de triomphe. Au Havre, cinquante mille personnes l'acclament toute la journée, à la revue, dans les rues, aux régates ; les femmes agitent leurs mouchoirs et lui jettent des fleurs ; toutes les fenêtres sont garnies de drapeaux ; le maire reconnaît au neveu de l'Empereur toutes les vertus. A Elbeuf, avant d'entrer en ville, il traverse une haie formée par une centaine de sœurs agenouillées le long de la route, les mains jointes. Tandis qu'il passe ensuite en revue les gardes nationaux, quatorze mille ouvriers des fabriques environnantes l'entourent de leurs acclamations. Il visite la fabrique de Victor Grandin, — dont nous nous souvenons en 1848, — et un de ses ouvriers lui dit : Au 10 décembre, nos ateliers étaient déserts, nos souffrances inouïes. La volonté nationale vous place à la tête de l'État, et cette heureuse inspiration ramène, avec l'ordre et la confiance, l'activité de l'industrie qui nous fait vivre... Acceptez notre profonde reconnaissance, comptez sur nos bras et sur nos cœurs. A Louviers, d'anciens combattants de l'Empire assistaient à la revue. Le Moniteur, en racontant la réception, ajoute : Ce qui n'a pu passer inaperçu c'est que le portrait de Louis-Napoléon est dans chaque atelier. Les feuilles dévouées à la présidence commencent à avouer certaines vues ; elles se demandent pourquoi celui qui est acclamé comme un sauveur et reçu partout en triomphe cesserait, après quatre ans, d'être le chef de l'État ; elles ne comprennent pas pourquoi la constitution ne serait pas révisée ; et toujours est mis en avant l'homme providentiel. La thèse soutenue se résume à celle-ci : L'idée de tout remettre en question de quatre ans en quatre ans est une idée ruineuse, anarchique... N'est-il pas clair que la clause portant qu'il ne peut pas être réélu, indépendamment de l'ingratitude monstrueuse qu'elle consacre, rejette la France dans tous les hasards révolutionnaires dont elle a tant de peine à sortir... Pense-t-on que ce soit inutilement que, de 1813 à 1848, les armées impériales avaient envoyé ces infatigables missionnaires qu'on appelle les vieux soldats et qui prêchent nos campagnes pendant ces longues veillées de l'hiver ou les loisirs de la moisson ... A côté du légionnaire de Marengo, d'Austerlitz, qui conduit la charrue, mettez donc le chevalier de Saint-Louis... Napoléon est présent parmi nous... A défaut de sa personne, sa mémoire combat pour nous et nous protège[140]. Un incident qui se passa pendant le voyage de Tours
montre, à la fois, la sottise ministérielle et l'état d'esprit de l'époque ;
il prouve comme le ministère cherchait la moindre occasion d'être désagréable
au président auquel il reprochait, tout bas, de n'être pas, la plupart du
temps, en faute. Une sorte de plaisir rétrospectif anime encore ces lignes de
Barrot : Puisque je parle du voyage de Tours, je
dirai un mot d'un petit incident qui se reporte au séjour du président dans
cette ville, incident qui, tout léger qu'il paraît, caractérise cependant
assez bien la manière dont le chef de l'État comprenait les notions les plus
vulgaires de la morale privée[141]... A Paris, le
prince-président avait logé miss Howard, près de l'Elysée ; en voyage, il
l'emmenait avec lui. A Tours, la personne qui s'occupait de distribuer des
logements plaça miss Howard dans la maison du receveur général, un M. André,
absent, avec sa femme aux eaux des Pyrénées. M. et
Mme André appartenaient à cette secte de puritains qui portent très loin la
sévérité des mœurs ; ils se sentaient profondément blessés de ce que leur
foyer, espèce de sanctuaire qui n'avait jusqu'alors été témoin que des pratiques
religieuses et des actes de charité les plus ardents, fût devenu le séjour de
ce qu'ils appelaient une prostituée[142]... Aussi M.
André exhala-t-il sa plainte indignée par une lettre violente et même excessive[143], au président
du conseil. Fort embarrassé, partagé entre deux sentiments, l'ennui de
transformer l'incident en une affaire d'État qui le rendrait ridicule, le
plaisir de faire entendre à Louis Bonaparte que dans
la position à laquelle il avait été élevé, il ne lui était plus permis de
vivre de cette vie libre dont il avait vécu à Londres[144], celui-ci
chargea son frère Ferdinand Barrot de faire en sorte que la lettre tombât comme par accident sous les yeux de Louis Napoléon[145]. — Le prince la
lut, s'en étonna et écrivit à son ministre : Votre
frère m'a montré une lettre d'un M. André à laquelle j'aurais dédaigné de
répondre si elle ne contenait des faits faux qu'il est bon de réfuter. Une
dame à laquelle je porte le plus vif intérêt, accompagnée d'une de ses amies et
de deux personnes de ma maison, désira voir le carrousel de Saumur ; de là
elle vint à Tours ; mais, craignant de ne pas y trouver de logement, elle me
fit prier de faire en sorte de lui en procurer un. Lorsque j'arrivai à Tours,
je dis à un conseiller de préfecture qu'il me ferait plaisir de chercher un
appartement pour le comte Bacciocchi et pour des dames de ma connaissance. Le
hasard et leur mauvaise étoile les conduisirent, à ce qu'il paraît, chez M.
André où, je ne sais pourquoi, l'on s'imagina que l'une d'elles s'appelait
Bacciocchi. Jamais elle n'a pris ce nom ; si l'erreur a été commise, c'est
par des étrangers, indépendamment de ma volonté et de celle de la dame en
question. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi M. André, sans prendre la
peine de rechercher la vérité, veut me rendre responsable et de la
désignation faite de sa maison et du faux nom attribué à une personne. Le
propriétaire dont le premier soin est de scruter la vie passée de celui qu'il
reçoit, pour le décrier, fait-il un noble usage de l'hospitalité ?... Combien
de femmes cent fois moins pures, cent fois moins dévouées, cent fois moins
excusables que celle qui a logé chez M. André eussent été accueillies avec
tous les honneurs possibles parce M. André, parce qu'elles auraient eu le nom
de leur mari pour cacher leurs liaisons coupables. Je déteste ce rigorisme
pédant, qui déguise toujours mal une âme sèche, indulgente pour soi,
inexorable pour les autres. La vraie religion n'est pas intolérante ; elle ne
cherche pas à soulever les tempêtes dans un verre d'eau, à faire du scandale
pour rien et à changer en crime un simple accident ou une méprise excusable.
M. André qu'on me dit puritain, n'a pas encore assez médité sur ce passage de
l'Évangile où Jésus-Christ, s'adressant à des âmes aussi peu charitables que
celle de M. André, dit, au sujet d'une femme qu'on voulait lapider : Que
celui etc.. Qu'il pratique cette parole : quant à moi, je n'accuse personne
et je m'avoue coupable de chercher dans les liens illégitimes une affection
dont mon cœur a besoin. Cependant, comme jusqu'à présent ma position m'a
empêché de me marier, comme, au milieu des soucis du gouvernement, je n'ai,
hélas ! dans mon pays, dont j'ai été si longtemps absent, ni amis intimes, ni
liaisons d'enfance, ni parents qui me donnent la douceur de la famille, on
peut bien me pardonner, je crois, une affection qui ne fait de mal à
personne, et que je ne cherche pas à afficher... Le ministre fut très
choqué de cette lettre. L'incident transpira et tout le monde donna raison au
président. Louis-Napoléon jouait, au surplus, sur le velours. L'esprit public, sans idéal, sans véritable intelligence, et sans culture assez étendue, exaspéré par surcroît, ne comprenant pas les faits, était prêt à tout subir. Le seul parti de l'avenir, l'unique parti à peu près sincère ou, du moins, forcé à la sincérité par une partie de son programme et l'adversité même, étant exclu, tous les autres partis, décidés à une trêve, et cette trêve étant, d'autre part, la seule réalisation alors possible, représentant bien démontré d'une puissance toute de recul ou d'immobilité, le prince, candidat fatal, résultat de cette trêve et enjeu de toutes les compromissions, de tous les doutes, de tout le brouillard voulu et maintenu tel, s'adaptait parfaitement. Ainsi s'expliquent ces entrées triomphales, ces décors nombreux, ces spectacles quelquefois puérils, cet accord, cette unanimité d'éloges et d'acclamations. Tous s'entendaient autour du président de la République, malgré leurs réserves, parce qu'il donnait des gages à chacun, sauf à ce parti éliminé de la révolution qu'il aurait dû, cependant, surtout au milieu d'une réaction si générale, représenter plus que tout autre. Dès qu'il s'en souviendrait, dès qu'il essayerait d'en sauver une petite étincelle, la troupe la plus puissante parmi ceux qui auraient aidé jusqu'au bout à la nouvelle restauration conservatrice, avouerait aussitôt son avidité, son despotisme, ses prétentions infinies ; de suite elle réclamerait le prix extraordinairement abusif qu'elle avait mis, comme toujours, à ses services. En face de cette force si puissante et si corruptrice, parce que formidablement armée afin de corrompre impunément[146], exploitant les plus nobles sentiments de l'âme humaine, notamment le sentiment religieux, dans un sens opposé à ses tendances véritables et sachant le détourner sans répit à son usage en le guidant vers ses fins, nous avons déjà vu le peu qu'était le prince, son manque de force et de puissance. Il dépendait tant de l'adversaire qu'il devait commencer sa décadence le jour où, sans même oser pourtant l'attaquer, il ne suivrait plus l'orientation que l'on exigerait de lui. L'armée, — on l'avait vu à Rome, — dépendait beaucoup du prêtre. Les seuls soutiens sérieux dans la lutte contre le clergé avaient été écartés peu à peu en 1848 par les républicains modérés, en 1849 par les conservateurs réactionnaires et la molle complaisance de Louis-Napoléon, forcé de céder. Il ne restait au président de la République que des amis personnels dont nous avons apprécié déjà le dévouement, en même temps que, souvent, l'insuffisance[147]. Il sentait sa solitude et y nourrissait selon toute vraisemblance un plan. En août, époque vers laquelle les journaux et même les Débats annoncent une réédition de l'Histoire de l'empereur Napoléon, de Laurent de l'Ardèche, dédiée au président de la République, il habite les petits appartements de Saint-Cloud, et, d'après Castellane[148], n'y reçoit personne. En septembre, le président du conseil et Persigny fréquentent chez le comte Molé à Champlatreux, où Barrot avait été faire l'ouverture de la chasse en compagnie de lord Normanby[149] ; on y jugeait excellent le ton conservateur du chef des ministres. Le 2 septembre, à l'inauguration du chemin de fer de Paris à Épernay, les Débats, en relatant l'accueil enthousiaste, remarquent que les cris de Vive Napoléon ! sont frénétiques et sont contraints de signaler ceux de Vive l'Empereur ![150] : Il y a eu à Épernay une entrée triomphale. Nous ne changerons point la phrase consacrée, et nous dirons que le soleil lui-même semblait être de la fête. Toute la population des environs avait fait irruption dans la ville d'Épernay, et elle a fait à l'homme qui porte le grand nom de Napoléon une véritable ovation. Il est impossible de ne pas convenir que ce nom est le plus facile de tous à prononcer et qu'il vient tout naturellement à la bouche du peuple. Ce n'est pas notre faute, mais c'est un fait... A travers les flots d'une population pleine d'empressement et de joie, à travers les cris de : Vive Napoléon ! et cet autre cri que nous ne voulons pas répéter, le président a passé la revue de la garde nationale et s'est dirigé vers le lieu du banquet[151]... L'évêque de Châlons était venu bénir la locomotive. Avant d'arriver à Épernay, à Noisy-le Sec, à Villemomble, à Gagny, à Chelles, à Lagny, à Esbly, à Meaux, à la Ferté-sous-Jouarre, à Château-Thierry, l'accueil avait été semblable. Les bruits de coup d'État recommençaient de plus belle ; le maréchal de Castellane pensait que le prince, très préoccupé[152], se rendait compte de la nécessité qu'il y avait pour lui à se faire proclamer empereur promptement. Peut-être balance-t-il sur les moyens à prendre ; sûrement il aimerait mieux l'être par la Chambre, mais cela est difficile. Un coup d'État ne l'est pas moins. Le président se croit sûr de deux régiments, mais avec cela on ne fait pas une révolution. Cette idée le préoccupe. Une modification ministérielle est imminente[153]. — Le 27, comme il avait été à Saint-Germain, et, après un déjeuner chez la maréchale Ney, avait passé en revue le 11e bataillon de la garde nationale, puis un régiment de cuirassiers, le bruit se répandit qu'il allait revenir à Paris à la tête de ces cuirassiers avec le titre d'empereur[154]. Des événements importants soutenaient cette nouvelle effervescence de l'opinion publique. |