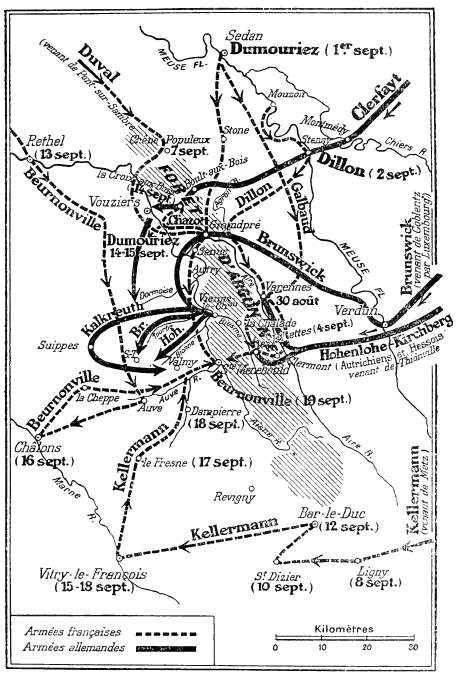HISTOIRE DE FRANCE CONTEMPORAINE
LIVRE V. — L'AVÈNEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA RÉPUBLIQUE (10 AOÛT-21 SEPT. 1792).
CHAPITRE II. — L'INVASION. VALMY.
|
I. — L'ARMÉE FRANÇAISE. L'ARMÉE française se composait de l'ancienne armée royale, qui en formait le noyau ; des volontaires de 1791 et de 1792 ; enfin des vétérans et des corps francs. L'ancienne armée était complètement désorganisée par l'indiscipline et la révolte. Beaucoup d'officiers l'avaient quittée. Du 15 septembre au 1er décembre 1791, après l'acceptation de la Constitution par le Roi et les décrets contre les émigrés et les prêtres réfractaires, 2.100 officiers avaient émigrés. En pleine guerre, du 27 avril au 15 juillet 1792, nouvel exode : 398 officiers d'infanterie, 144 de cavalerie. Il manquait 2.500 à 3.000 officiers d'infanterie, un tiers environ de l'effectif. La proportion des émigrants était moindre dans le génie et l'artillerie. Les officiers de ces armes, sortant des écoles, plus instruits que ceux d'infanterie, et ne fréquentant point la Cour, étaient très attachés à leur métier. Beaucoup étaient roturiers : parmi eux Lazare Carnot ; mais il se trouvait dans les armes savantes des nobles : Chasseloup-Laubat, Éblé, Lariboisière, Sénarmont, Marescot, Dejean, n'émigrèrent pas. Au régiment d'artillerie de Valence, la plupart des capitaines et les lieutenants Bonaparte et d'Anthouard tenaient pour la Révolution, Ce régiment-ci, écrivait Bonaparte, est très sûr en soldats, sergents et la moitié des officiers. Bonaparte était alors secrétaire du club jacobin de Valence. L'émigration donna à nombre de sous-officiers un avancement inespéré. Parmi eux se trouvaient des jeunes gens instruits que leur roture ou le manque de quelque quartier de noblesse avait empêchés d'avancer. Alors devinrent officiers de petits nobles, écartés des grades ; des bourgeois, tels que Ney, fils d'un tonnelier de Sarrelouis, Pichegru, d'Arbois en Franche-Comté. Dans le cadre des sous-officiers était encore, en 1792, Hoche, sergent de vingt-deux ans, fils d'un palefrenier des écuries royales, et Lefebvre, fils d'un meunier de Rouffach, dans le Haut-Rhin, sergent instructeur des gardes nationales, âgé de trente-sept ans. Dans les hauts degrés de la hiérarchie militaire, l'émigration amena des avancements. Plusieurs maréchaux de camp, députés à la Constituante, Biron, Menou, Custine, Montesquiou, sont devenus généraux à la fin de cette Assemblée ; une seconde promotion est faite en janvier 179. ; elle comprend Kellermann, et Dumouriez. qui, après l'émigration de la Fayette, reçoit le commandement en chef de l'armée du Nord. Les généraux d'ancien régime disparaissent : Rochambeau, la Fayette, Luckner, braves officiers, mais habitués aux vieilles méthodes, incapables de faire la guerre avec l'audace que réclame Danton et qu'exigent les circonstances. A un patriote qui s'inquiétait de l'émigration des officiers en 1792, le colonel Duchâtelet fit, pour le rassurer, cette déclaration : Il y a entre les anciens officiers et les nouveaux la même différence qu'entre les amateurs et les artistes. Quand tous les anciens officiers nous auraient quittés, nous n'en serions pas plus mal. Nous aurions plus d'émulation dans l'année, et il se trouvera des généraux parmi nos soldats. L'infanterie et la cavalerie comptaient, au 10 août, 82.000 hommes, au lieu des 300.000 que l'on avait espérés à la suite de l'appel des volontaires. Aucun bataillon n'était au complet ; il manquait à tous de 50 à 60 hommes en moyenne. L'effectif était plus faible que dans les armées étrangères. Officiers et soldats étaient moins instruits et beaucoup moins disciplinés que ceux de l'armée prussienne. Le matériel était bon ; depuis 1777 l'infanterie avait un excellent fusil. Au contraire, l'artillerie, depuis les ordonnances de l'inspecteur général Gribeauval, qui la dirigea dès 1776, était la première de l'Europe. Elle possédait un excellent matériel, solide et mobile, distinct pour les services de campagne, de siège, de place, de côtes. Les officiers étaient de premier ordre ; tous les talents, a écrit Jomini, y étaient enfouis. Le génie, régénéré depuis le règne de Louis XVI, possédait, lui aussi, un personnel instruit, travailleur et bien exercé ; il s'y trouvait des savants, comme Carnot, célèbre par son Essai sur les machines, où il exposait un principe nouveau et fécond sur l'énergie. Mais le matériel était défectueux et les munitions manquaient. Dumouriez et les commissaires de l'Assemblée ne cessaient de déplorer cette négligence qu'ils imputaient à la Cour et à ses ministres. Les places fortes étaient mal défendues : Metz, Thionville, Longwy. Montmédy, Verdun, étaient hors d'état d'arrêter longtemps l'ennemi, et les manufactures d'armes, si actives avant la Révolution. ne travaillaient plus qu'avec une lenteur désespérante. Le service de l'intendance était admirable. Les places des frontières — Longwy. Sedan, Verdun — étaient remplies d'approvisionnements. Les convois étaient aussi réguliers que le permettaient alors les routes. Même dans la campagne de l'Argonne, par la pluie et les chemins fangeux. malgré les mouvements imprévus et ceux qu'il fallait cacher à l'ennemi, si parfois le pain n'arriva pas de deux jours, le riz, la farine et le lard ne manquèrent point, et les régisseurs des vivres, par leur zèle, entretinrent chez le soldat la bonne santé et la gaîté. Les volontaires nationaux vinrent renforcer l'armée de ligne. La levée de 1791 devait donner 169 bataillons d'infanterie ; mais les corps administratifs, chargés du recrutement et de l'équipement, et le ministère furent très lents au travail ; 83 bataillons seulement étaient organisés au moment de l'invasion prussienne. Un décret ordonna la levée de 1792, quand celle de 1791 était loin d'être terminée ; d'autres décrets ordonnèrent le complètement de l'armée de ligne ; toutes ces opérations se nuisirent les unes aux autres. Les assemblées avaient rendu une foule de décrets militaires ; mais l'argent, les fusils, l'habillement manquaient. Puis, le pays n'avait pas fait l'effort, nécessaire ; les enrôlements de 1791, surtout dans les campagnes du Centre, (le l'Ouest et du Midi, avaient été, on l'a vu, insuffisants. Il fallut la violente secousse de juillet et d'août pour réveiller le pays de la torpeur à laquelle il menaçait de s'abandonner. Alors les enrôlements reprirent, à Paris, aux frontières, dans le Nord, dans les Vosges, où, sur 227.000 habitants, 14.500 partirent, et dans les départements foncièrement patriotes, comme les Bouches-du-Rhône, la Gironde, etc. Les volontaires de 91 prirent part à la campagne de l'Argonne ; ceux de 92 restèrent en arrière, sauf quelques bataillons, comme le premier bataillon de la section parisienne des Gravilliers qui fit la campagne de Valmy. Les ministres — Narbonne, en janvier, Lajard, en juillet — avaient demandé à l'Assemblée d'incorporer les volontaires dans les troupes de ligne dont le complètement était nécessaire. Mais l'Assemblée s'y refusa toujours. Elle craignait qu'ils ne s'attachassent avec idolâtrie à des chefs dont elle redoutait l'ambition ; elle ne voulait pas les soumettre à une discipline qui pût affaiblir leur patriotisme ; elle désirait les garder comme des appuis éventuels contre un coup d'état militaire et aristocratique : en effet, de ces volontaires sortirent les fédérés qui prirent part à la journée du 10 août. D'ailleurs, les volontaires ne tenaient pas à entrer clans l'armée ; ils avaient une solde plus forte, environ 15 sous par jour ; ils élisaient leurs officiers ; la discipline pour eux se faisait beaucoup plus douce ; ils pouvaient se retirer au 1er décembre, et s'absenter, en cas d'Urgence. Bourgeois, paysans, ouvriers composèrent les bataillons de volontaires. Beaucoup d'anciens soldats y entrèrent aussi. Ceux-ci devinrent officiers, puisque les officiers ne pouvaient être élus par les volontaires que parmi les anciens soldats ou officiers des régiments ou des troupes provinciales. Parmi les nouveaux commandants se trouvaient : Jourdan, enrôlé à seize ans, revenu, après la guerre d'Amérique, s'installer comme mercier à Limoges, maintenant chef du 2e bataillon de la Haute-Vienne ; Lecourbe, ancien soldat du régiment d'Angoulême, chef du 7e bataillon du Jura ; Oudinot, ancien sergent du régiment de Médoc, chef du 3e bataillon de la Mense ; Pérignon, ancien sous-lieutenant des grenadiers royaux de Guyenne, chef de la légion des Pyrénées ; Victor, ancien artilleur du régiment de Valence, chef du 5e bataillon du Rhône ; Championnet, ancien soldat des gardes wallonnes, chef du 6e bataillon de la Drôme ; Davout, ancien officier de Royal-Champagne, chef glu 3e bataillon de l'Yonne. D'autres sortaient des milices provinciales, comme Pille, organisateur de la garde nationale de Dijon. Dans le cadre des capitaines on rencontrait : Gouvion-Saint-Cyr (1er bataillon de volontaires parisiens) ; Maison (9e bataillon des gardes nationaux appelés en juillet fédérés) ; Molitor (4e bataillon de la Moselle) ; Mortier (1er bataillon du Nord) ; Souk (1er bataillon du Haut-Rhin), etc. ; les adjudants-majors Brune et Leclerc (2e bataillon de Seine-et-Oise) ; Mouton (9e bataillon de la Meurthe) ; Lannes (2e bataillon du Gers), et Massena, ancien mousse (2e bataillon du Var). Parmi la foule des autres officiers élus par les volontaires, se faisaient remarquer : Marceau, de l'Eure-et-Loir ; Moreau, de l'Ille-et-Vilaine ; Bessières, du Lot ; Suchet, de l'Ardèche ; Valhubert, de la Manche ; Laharpe, de Seine-et-Oise ; Friant, du bataillon de l'Arsenal, et Lefebvre, commandant du bataillon de Molière, à Paris. Ils ont abandonné leurs occupations : Moreau, son cabinet d'avocat, à Rennes ; Brune, son imprimerie, à Paris ; Suchet, sa fabrique de soie, à Lyon ; Jourdan, sa boutique de mercier, à Limoges ; ils ne quitteront plus l'armée. C'est tout l'état-major de la Révolution et de l'Empire. Dans le rang étaient alors perdus Lobau, soldat au 9e bataillon de la Meurthe ; Barbanègre, au 5e des Basses-Pyrénées ; le Périgourdin Daumesnil, cavalier au 22e chasseurs ; Duperré, matelot ; Gérard, etc. A côté d'eux combattaient une foule de héros obscurs, fils de paysans, les Fricasse et les Bricard, qui sauveront la France et la Révolution. Ces soldats volontaires — les habits bleus, qu'ils soient de la levée de 91 ou de celle de 92, excités par les clubs et les journaux patriotes, font des arrestations illégales, commettent parfois sur leur passage et dans leurs garnisons des actes de brigandage, vont jusqu'à massacrer des détenus à Meaux et à Reims, en viennent aux mains avec les troupes de ligne — les habits blancs, — se défient parfois de leurs chefs, et leur désobéissent, clans les circonstances les plus graves. Mais ils sont animés d'une telle exaltation patriotique qu'après le baptême du feu, dans l'Argonne, puis en Belgique, ils formeront des corps excellents à l'attaque. Malheureusement ils ne furent armés et équipés que très lentement ; les munitions étaient insuffisantes et l'armement défectueux. A l'armée de ligne et aux volontaires s'ajouta un appoint qui était loin d'être négligeable : les corps francs et légions étrangères organisés en juillet et août 1792. Les étrangers préféraient entrer dans ces corps, où ils se retrouvaient, au lieu de faire partie des bataillons de volontaires, où beaucoup avaient été déjà admis. Il y avait une légion des Allobroges, commandée par le Savoyard Dessaix ; une légion batave ; une légion des Belges et Liégeois unis, formée de patriotes des Pays-Bas émigrés ; une légion germanique, créée par Cloots et le saxon Saiffert ; une légion franche étraugi.re, où entrèrent nombre de Hollandais, de Luxembourgeois et de réfugiés de toutes nations. Ces étrangers combattaient pour les idées de la Révolution et l'affranchissement de leur patrie. De ces éléments très différents se constitua l'armée de la Révolution. Il fallait l'organiser. Il était nécessaire de réformer d'abord l'organe central, le ministère. C'est ce qu'avait réclamé Dumouriez, qui fut ministre de la Guerre pendant quatre jours ; il dévoila, le 13 juin, à l'Assemblée, les abus des bureaux de la Guerre, lents, désordonnés, coupables même de marchés frauduleux, et encombrés de commis sans valeur. Mais, sous le ministre Lajard, les vieux errements continuèrent. Il fallut attendre le 10 août et Servan, qui s'appliqua à mettre plus d'ordre dans l'administration. La direction venait du Comité militaire de l'Assemblée et des généraux en chef. Le Comité militaire était composé d'officiers et d'anciens officiers de grande valeur, parmi lesquels Carnot et Pérignon. Il se réunissait au moins trois fois par semaine. Il prépara les nombreux décrets qui réglèrent jusque dans le détail la composition et l'armement des troupes. H renoua les traditions qu'avait laissées le Conseil de la Guerre créé en 1786, étudia les documents, cartes et plans du Dépôt de la Guerre, mit en honneur l'Essai de lactique de Guibert, qui fut le bréviaire de tous les officiers, traça des plans d'opérations. Carnot était l'âme du Comité ; c'était la science mise au service de la défense nationale. Dans les camps du Nord, les généraux exerçaient et s'efforçaient de discipliner les troupes de ligne et les volontaires, et de les amalgamer. A Sedan, la Fayette ; à Pont-sur-Sambre, Dillon ; à Maubeuge, Lanoue, et, dans son camp de Maulde, près de Saint-Amand, Dumouriez avaient travaillé, depuis le mois de juin, à aguerrir leurs troupes en harcelant l'ennemi par petits détachements. C'était la petite guerre, qui préparait à la grande. Dumouriez, tous les huit jours, changeait les officiers et les soldats, excepté l'état-major. Chaque commandant de détachement recevait du général une instruction et une carte du pays à parcourir, sur laquelle étaient marqués les routes, les ponts, les bois, les villages, les moulins, par où il devait passer en allant et revenant, et les points d'attaque. Les détachements ramenaient souvent au camp des prisonniers et des chevaux, mais il leur était enjoint de ménager les habitants ; tous les objets volés étaient restitués. En même temps, les soldats s'exerçaient à palissader les redoutes, à jeter des ponts sur la Scarpe, à creuser des tranchées. Pas d'offensive. Même quand l'ennemi aura envahi la Lorraine et la Champagne, l'armée restera sur la défensive ; elle fuira les grandes batailles, mais, comme elle faisait dans le Nord, elle livrera sur un terrain accidenté, raviné, boisé, propre aux embuscades et aux mouvements imprévus, de petits combats, qui, même perdus, ne compromettront rien, et la tiendront en haleine. L'esprit militaire se développe. Le soldat commence à oublier les factions politiques, les clubs et les journaux, et à ne plus penser qu'à la défense du pays. Le 16 septembre, un volontaire de l'armée de Kellermann écrivait à ses amis de Paris : Notre armée ne s'occupe pas beaucoup de l'intérieur, et nous ne voyons que les Prussiens. — En même temps, l'armée prend de plus en plus confiance en ses chefs, surtout en Dumouriez, qui tâche à devenir populaire, se montre sans cesse à ses soldats, leur expose ses plans et leur donne la certitude de la victoire. Animée d'un esprit national et démocratique, l'armée combat comme pour une religion nouvelle. Je pense, écrivait le grenadier Gazin à son fils, que la guerre d'un peuple qui veut être libre contre les tyrans ne peut durer longtemps, car le peuple a pour lui la raison, sa force et sa bravoure ; il est debout ; il n'a qu'a dire : Je veux être libre, — et il le sera. Ce soldat traduisait le sentiment de tous. L'armée française a des effectifs trop réduits, un armement insuffisant, des places mal défendues, une préparation hâtive, et encore trop d'indiscipline et de penchant à la panique ; mais elle possède des qualités et des avantages de premier ordre : une excellente organisation des armes spéciales ; la vigueur dans le haut commandement ; un chef si confiant en lui-même et si riche en projets qu'il passe pour un fanfaron, mais qui prend sa confiance dans une intelligence très nette des situations, fait entrer dans ses calculs les forces morales sans lesquelles il n'est pas d'armée, e t les porte à leur plus haute puissance ; enfin l'exaltation patriotique et la foi dans la liberté qui double la force combative de soldats-citoyens. II. — LES ARMÉES ÉTRANGÈRES. LES armées prussienne et autrichienne étaient coalisées contre la France. L'armée prussienne comptait 42.000 hommes. Elle gardait encore beaucoup de la valeur que lui avaient donnée Frédéric Ier et Frédéric II. Mais elle n'était pas une armée nationale comme l'armée française, qui se recrutait pour la plus grande partie dans une bourgeoisie éclairée et une démocratie rurale résolue à défendre ses droits et ses propriétés ; puis elle comprenait un tiers d'étrangers, déserteurs et mauvais sujets. L'infanterie et la cavalerie étaient excellentes dans leur personnel et leur matériel, et tenues en haleine par des manœuvres continuelles. Là résidait la force de l'armée prussienne. L'artillerie, le génie, l'intendance, tous les services auxiliaires étaient, au contraire, très inférieurs à ceux de l'armée française. Le canon était médiocre ; les places, mal fortifiées ; le personnel, ignorant. Les lenteurs, les malversations et les gaspillages étaient la règle dans l'intendance et le service sanitaire. Cette armée est condamnée à attendre son pain et à ne pas marcher trop vite ; obligée de regarder sans cesse derrière elle, vers ses approvisionnements, — le jour de Valmy, le pain viendra de Trèves, — retardée aussi par un train d'équipages énorme, une nuée de domestiques et de blanchisseuses, elle ne peut songer à pousser une pointe hardie, à la Frédéric. Malgré tous ses défauts, c'est encore une belle armée, astreinte à une discipline très forte. Frédéric-Guillaume II aime la guerre, mais gaspille son temps avec ses illuminés et ses maîtresses, et l'État se décompose peu à peu. Frédéric II n'a pas laissé de généraux dignes de lui. Les vieux chefs sont indolents ; ceux qui s'illustreront un jour, comme Blücher, qui a déjà cinquante ans, sont encore dans des postes de second ordre et n'arrivent pas à en sortir. Il n'y a pas là cet afflux de sang jeune qui vivifie l'armée française. La discipline, pendant la campagne, va se relâcher ; dès leur entrée en France, les troupes se livreront au pillage. Les officiers discutent les ordres. Beaucoup lisent avec passion les anciens et les modernes, Homère, Tacite et Virgile, Voltaire et Montesquieu, Kant et Klopstock ; soumis par un règlement de 1790 à une discipline adoucie, ils n'aiment pas la guerre, et sont entraînés par le cosmopolitisme littéraire et social issu de Rousseau, de Kant et de Lessing. Plusieurs sont sentimentaux ; le major Massenbach, voyant expirer sur le champ (le bataille de Valmy un paysan, père de onze enfants, qui avait été son guide, saute de cheval pour lui porter secours, et le pleure comme un frère. Jamais, écrit-il, je ne versai de telles larmes ; je crus que la douleur me rendrait fou, et je maudis ma destinée et la guerre, qui est, comme dit Klopstock, la flétrissure du genre humain. En campagne, ils auront, avant le bombardement d'une ville, des entretiens fréquents et courtois avec les officiers français, afin d'épargner le plus possible de vies humaines ; ils feront à Verdun des sommations réitérées. Ils répugnent aux moyens violents, aux entreprises hasardeuses. Frédéric II, suivant eux, a gagné des batailles en dépit des règles ; avec le prince de Brunswick, ils tiennent pour une tactique de temporisation, méthodique et réglée. En réalité, l'initiative a disparu ; il semble que le grand Frédéric en ait à jamais emporté le secret. Cependant la tactique de Frédéric, l'offensive rapide, trouve un défenseur décidé dans Frédéric-Guillaume. Tandis que Brunswick manque de résolution, et le sait, se défie de lui-même, évite les grandes batailles, auxquelles il préfère les longs sièges, attend tout du temps, des discordes intérieures de la France et de la banqueroute, le roi recherche des succès rapides, ordonne tout à coup, après de longs moments d'inaction, des mouvements qui bouleversent tout. Si Brunswick avait pris sur le roi l'ascendant qu'eût dû lui donner sa renommée européenne, il aurait sauvegardé l'unité de commandement, qui fatalement allait manquer ; mais il n'osa pas ; il garda pour le roi le respect germanique, ce respect profond, silencieux et humble ; le souverain du petit duché de Brunswick ne sut qu'obéir à son puissant suzerain, le roi de Prusse. En somme, l'armée prussienne a une infanterie et une cavalerie de premier ordre ; mais les armes spéciales, dont l'importance va grandir, sont médiocres. — Le commandement est partagé, les deux chefs ordonnent tour à tour. — L'armée, formée en partie d'étrangers, commandée par des officiers qui ne font la guerre qu'à contrecœur, n'est point animée par un puissant ressort moral ; elle combat loin de ses foyers, pour une cause politique, et non, comme l'armée française, pour une cause nationale. L'armée autrichienne comprend le corps de Hohenlohe-Kirchberg, 15.000 hommes, celui de Clerfayt, 15.000 hommes, celui du duc de Saxe-Teschen, 15.000 hommes, qui opérera de son côté en Flandre, vers Lille ; en tout 45.000 hommes. Comme toujours, les Autrichiens sont en retard ; ils avaient promis près de 100.000 soldats et ils n'en envoient que la moitié. C'est qu'ils sont accablés par l'effort qu'ils ont dû faire contre les Turcs ; de 1788 à 1790, particulièrement au siège de Belgrade et à la sanglante bataille de Temesvar, où ils furent battus, ils ont subi des pertes énormes ; aussi ne veulent-ils pas s'engager dans une grande guerre. Les Hessois, — 5.500 hommes, — envoyés par le landgrave de Hesse-Cassel, forment une armée bien exercée qui marche avec les Prussiens. Enfin 4.500 émigrés français suivent les Prussiens. Brunswick les a placés sur les derrières de son armée pour ne pas déchaîner l'indignation des populations. Ils manquent d'argent, et sont mal équipés. C'est une cohue indisciplinée, fanfaronne et vaine, sans valeur militaire, suivie d'un train nombreux, de femmes, d'enfants, de maîtresses et de domestiques ; détestée de lotis les généraux et des officiers prussiens. Entre Autrichiens et Prussiens aucune entente, plutôt l'hostilité. Les généraux prussiens, Brunswick, Kalkreuth, Manstein, Courbière, réprouvent l'alliance austro-prussienne ; pour eux, l'Autriche est la véritable adversaire, en Allemagne, en Pologne, même en Turquie. Ils ont peur qu'elle n'ait de trop grands succès dans la campagne de France. Il existe même à Berlin un parti francophile, qui comprend des réfugiés protestants français, les savants Borrelly et Chanvier, et aussi des Allemands, comme Archenholz, directeur de la Minerva, et le poète Klopstock, qui prévoient le triomphe de la nation française combattant pour sa liberté. Ces sentiments francophiles, ou du moins hostiles à l'Autriche, expliquent les suspicions, les incohérences de la campagne, les négociations nouées avec les Français — il y aura, dans la campagne, presque autant de diplomatie que de guerre, — et la retraite finale des Prussiens. III. — L'INVASION PRUSSIENNE. VALMY. A LA fin du mois d'août, l'armée française, placée à la frontière, de Dunkerque à Huningue, comprenait 82.000 hommes 22.000 en Alsace, sous Biron, et à Wissembourg, sous Custine ; 18.000 à Metz, sous Luckner, remplacé peu après par Kellermann ; 23.000 à Sedan, sous Dumouriez, qui commandait en chef ; 10.000 dans les garnisons ou les camps de Pont-sur-Sambre, Maubeuge, Valenciennes, Maulde, Douai, Lille et Dunkerque, placés sous les ordres de Dumouriez. En laissant dans les places les troupes nécessaires, les Français pouvaient disposer de 55.000 hommes. Deux armées autrichiennes s'avançaient vers la Lorraine : l'une, sous les ordres de Clerfayt, par la Belgique ; l'autre, celle de Hohenlohe, par l'Allemagne du Sud et le Palatinat. L'armée prussienne, commandée par Brunswick, réunie à Coblentz, marchait par les plateaux de l'Eifel et du Luxembourg, afin de passer en Lorraine entre la Moselle et la Meuse, et de séparer Kellermann et Dumouriez ; elle se proposait, après sa jonction avec les Autrichiens de Clerfayt et de Hohenlohe, de franchir la Meuse et de gagner par Châlons la route de Paris. La marche des Prussiens, à travers le plateau accidenté et chaud de l'Eifel, fut très pénible. L'armée était déjà harassée de fatigue, quand elle entra en France, sous une pluie fine et froide, qui ne devait pas cesser ; elle était sans manteaux ; le roi lui-même n'en avait pas. Les officiers et les soldats qui, sur la foi des émigrés, s'attendaient à un accueil enthousiaste, ne rencontrant que de l'hostilité, ennuyés par la persistance du mauvais temps, s'irritaient, pillaient les villages, surexcitaient ainsi le patriotisme des populations. Le 19 août, à Fontoy, où se fit la première rencontre, les chasseurs à cheval de Dumouriez se battirent bravement. Comment, s'écriait un émigré, ces gueux-là osent se défendre ! Les Prussiens, qui pensaient trouver devant eux des lâches et des fuyards, n'en croyaient pas leurs yeux. Cependant arrivaient sur la Moselle les Autrichiens de Hohenlohe. Convaincus que les chefs suivraient l'exemple de la Fayette, ils crurent qu'il leur serait aisé de se créer des intelligences clans l'armée de Metz, et d'y provoquer de nouvelles désertions. Hohenlohe écrivit à Luckner ; Luckner envoya la lettre au ministre de la Guerre. Hohenlohe eut avec le maréchal de camp Deprez-Crassier une entrevue qui fut très courtoise, comme entre frères d'armes ; il employa tour à tour les conseils, la douceur et les menaces ; mais il rencontra une résistance très ferme, qui lui révéla la force morale de l'armée française. Les Prussiens assiégèrent Longwy, défendu par 2.600 hommes et 71 canons, et bien approvisionné. Dès que le bombardement commença, le 22 août, les bourgeois, les membres de la municipalité proposèrent la capitulation, finirent par ébranler le commandant Lavergne, et la garnison déposa armes et drapeaux, le 23. Ce succès facile encouragea les Prussiens. Déjà ils pensaient ne faire qu'une promenade militaire ; ils traitaient les Français de lâches ; ils vivaient en partie sur le pays ; ils ne faisaient pas de réquisitions, écrit Gœthe, témoin oculaire, mais des emprunts forcés, que Louis XVI, disaient-ils, rembourserait. Cette façon d'agir, ajoute Gœthe, est peut-être ce qui a le plus exaspéré le peuple contre la royauté. L'armée prussienne installa son camp à l'est de Longwy, à Brocourt. Le sol humide, effondré, arrêtait chevaux et voitures. On vivait sous la Lente, par un temps effroyable, au milieu des immondices apportées par l'inondation que causa la rupture d'une digue, sans manteaux et sans couvertures de laine. Le 29 août, l'armée arriva devant Verdun. La place était défendue par une garnison de 4 500 hommes, composée surtout de bataillons de volontaires, et par 2.000 gardes nationaux. La ville était patriote ; mais il y avait un fort parti royaliste qui s'était montré hostile à la révolution du 10 août. De Sedan, Dumouriez se hala d'envoyer un de ses lieutenants, Galbaud, mais celui-ci ne put entrer dans la place investie et dut se retirer, le 30, vers l'Argonne. Brunswick somma la ville de se rendre, la bombarda le 31 août, à onze heures du soir, jusqu'au lendemain matin à huit heures. Au conseil de défense, présidé par le commandant Beaurepaire, les commerçants Ribière et Philibert Périn, membres de la municipalité, et le commissaire des guerres Pichon, royalistes, demandaient à capituler. Le maire et le procureur de la commune proposaient, au contraire, une sortie désespérée. Brunswick somme de nouveau Verdun de se rendre et accorde vingt-quatre heures pour la réponse. La municipalité insiste pour la capitulation ; les officiers, Beaurepaire, Lemoine et Marceau s'y opposent. Rien n'était décidé, lorsque, le 2 septembre au matin, Beaurepaire fut trouvé mort à l'Hôtel de Ville. Sur sa table était un billet, qui n'était pas de sa main et qui ne portait aucune signature, demandant que, en cas de capitulation, les bataillons de Mayenne-et-Loire et de Charcute conservassent leurs quatre pièces de campagne. Peut-être, ne pouvant faire prévaloir son avis, Beaurepaire s'était-il suicidé pour ne pas survivre au déshonneur ; peut-être et cela parait aussi probable — Beaurepaire fut-il assassiné. Tous, Français, Prussiens, émigrés, crurent au suicide et glorifièrent le héros. Sa mort, écrit l'émigré Dampmartin, prouva aux alliés jusqu'à quel degré d'exaltation pouvaient atteindre les Français. La capitulation fut aussitôt votée par le conseil de défense et signée de tous les officiers supérieurs, sauf Marceau. La garnison française partit avec ses armes, en criant : Au revoir aux champs de Châlons ! Les aristocrates de Verdun, comme Grimoard, et les gros bourgeois, Périr', Ca Loire, reçurent les Prussiens avec empressement et arborèrent la cocarde blanche. L'accueil de la population ne fut pas celui qu'attendaient les Prussiens. Quelques jeunes femmes visitèrent le camp prussien, mais elles n'osèrent pas offrir au roi et aux officiers les dragées qu'elles avaient apportées. Cela n'empêcha pas les émigrés de répandre la légende des vierges de Verdun allant saluer le roi de Prusse comme un libérateur. Le gouverneur prussien, le général Courbière, descendant de huguenots français, fit peser sur Verdun un régime de terreur. La population était agitée d'une violente indignation et la ville résistait aux réquisitions qui pleuvaient dru sur elle. Les alliés occupaient la vallée de la Meuse, — Brunswick à Verdun, et Clerfayt à Stenay, séparant ainsi Dumouriez de Kellermann, — et les Autrichiens de Hohenlohe, sur la Moselle, contenaient Kellermann. Dumouriez qui, malgré les avertissements réitérés de Servan, n'avait pas abandonné le projet d'offensive en Belgique qu'il avait déjà exposé en avril, décidait tout à coup, le ter septembre, de quitter Sedan, où il n'était plus en sûreté, et de se porter sur Grandpré, pour mettre l'Argonne entre lui et les ennemis. L'Argonne est un pays très boisé, d :une longueur de treize lieues, entre Sedan et Sainte-Menehould, et d'une largeur de une à trois ou quatre lieues, entre l'Aire et l'Aisne, coupé de ravins, et, sans être élevé de plus de 200 mètres, difficile à escalader pour des armées qui, ignorant l'ordre dispersé, hésitaient à monter à l'assaut de la moindre position. C'était une barrière. Mais elle est traversée par cinq défilés : le Chêne-Populeux, conduisant de Sedan à Rethel ; la Croix-aux-Bois, où passe la route de Stenay à Vouziers ; le défilé de Grandpré. menant de Stenay à Reims ; la Chalade, route de Varennes à Sainte-Menehould ; les Islettes, route de Verdun et Clermont à Sainte-Menehould, Châlons et Paris. Dumouriez a une infanterie de 18.000 hommes, composée pour moitié de régiments de ligne, et, pour le reste, de bataillons de gardes nationaux exercés et aguerris, une cavalerie de 5.000 hommes, tirée des meilleurs régiments, une excellente artillerie, de soixante pièces, sans compter les canons des bataillons. Il lui faut garder tous les défilés de l'Argonne, et il ne le peut avec ses seules forces. Il détache d'abord le corps de Dillon, qui va occuper les défilés du sud, les Islettes et la Chalade. Au nord, à la Croix-aux-Bois, il envoie seulement deux bataillons et deux escadrons, avec ordre de rompre le chemin depuis Boux-au-Bois. Pour garder le Chêne-Populeux, il appelle de Maubeuge et de Pont-sur-Sambre Duval qui devra s'y porter à marches forcées. Ayant, affaibli son armée par le détachement de Dillon dans l'Argonne et celui de Galbaud sur Verdun, il ordonne à Beurnonville de quitter le camp de Maulde, près de Valenciennes, avec ses 10.000 hommes bien exercés, et de se trouver le 13 septembre à Rethel, au débouché du Chêne-Populeux. En arrière, Chalons et Reims seront les points de concentration des bataillons et des vivres et fourrages qui arriveront de l'intérieur ; dans ces villes, et aussi à Sainte-Menehould, à Vouziers, à Rethel, seront construits des fours pour cuire le pain. Dumouriez part de Sedan le 1er septembre, y laissant 9.000 hommes tirés des garnisons de Givet, de Philippeville, de Marienbourg, et de Rocroi. II prend la route la plus courte, mais la plus dangereuse, par Stonne, sous les yeux mêmes de Clerfayt, masque sa marche, use de stratagèmes, jette de l'infanterie dans les bois de Neuville et sur les bords de la Meuse à Monzon et Stenay, et réussit à passer et à s'établir à Grandpré, sur les bords de l'Aire, le 4 septembre. Et le 5, il écrit à Servan : Verdun est pris, j'attends les Prussiens. Le camp de Grandpré et celui des Islettes sont les Thermopyles, mais je serai plus heureux que Léonidas. Il lui fait part de ses ordres de jonction à Duval et à Beurnonville, et aux commandants du département du Nord, Moreton et Malus ; il lui demande d'envoyer des secours à Grandpré, où il espère tenir assez longtemps pour les recevoir et l'invite à détacher 5.000 à 6.000 hommes de l'armée du Rhin. qui n'a pas d'ennemi devant elle, pour renforcer l'armée de Metz, qui devra se porter au sud de l'Argonne, à la trouée de Revigny, et couvrir le Barrois et la Marne. Toujours hanté par sou idée d'envahir la Belgique, Dumouriez regarde la campagne de l'Argonne comme une diversion à celle des Pays-Bas, et assure Serval qu' il ne doute pas de faire encore cette expédition dans la même année, si on le seconde. Le Conseil exécutif, qui redoutait l'investissement de Paris et ne demandait qu'à être délivré des Prussiens, prenait Dumouriez pour un fanfaron. Mais le général devait, tenir parole. De Grandpré il établit une chaîne de postes sur l'Aire, pour communiquer avec Dillon, et aussi avec Galbaud qui s'est replié de Verdun sur les Islettes, pendant que le Chêne-Populeux est occupé, le 7, par Duval, ponctuellement exact, et il ordonne aux paysans de faire des abatis sur toute la lisière de la forêt et de gâter les chemins. Alors seulement les troupes prussiennes, très lentes depuis la prise de Verdun, se montrèrent ; repoussées aux avant-postes, elles ne pensèrent pas à tourner l'Argonne par Rethel et Vouziers où la défense était faible. Dumouriez fit descendre de son camp des canons et des bataillons qui se portèrent derrière la montagne de Bessieu, en masquant leurs mouvements à l'ennemi. Les Prussiens trouvaient toujours devant eux 5.000 à 6.000 hommes, et, voyant sur la hauteur le camp français dans le même état, s'imaginaient que Dumouriez avait beaucoup plus de 20.000 hommes. Il était solidement établi à Grandpré, attendant avec confiance Beurnonville à Rethel pour le 13, et Kellermann à Bar-le-Duc et Revigny pour le 18, lorsqu'il apprend, le 13, que le défilé de la Croix-aux-Rois, trop négligé par lui, a été pris le 12 par les Autrichiens de Clerfayt. Aussitôt il dépêche Chazot, qui arrive à Vouziers à marches forcées, prend le défilé le lendemain, puis le perd deux heures après, et se trouve forcé à la retraite. La perte de la Croix-aux-Bois entratîe celle du Chêne. Alors Dumouriez, menacé d'être tourné au nord par les Prussiens, décide de reporter la défense au sud, vers Sainte-Menehould sur la route de Clichons, de laisser passer les Prussiens et de se placer derrière eux. Après avoir averti Beurnonville à Rethel, il quitte son camp de Grandpré, par une nuit obscure, le 15 septembre, à trois heures du matin, laisse les feux de bivouac allumés pour tromper l'ennemi, et fait accorder par Duval une entrevue au major prussien Massenbach, afin de laisser croire qu'il est toujours à Grandpré. Avec une hardiesse et un sang-froid imperturbables, il traverse l'Argonne par la vallée de l'Aire et arrive sur les bords de l'Aisne, à Autry, à huit heures. Il peut gagner Sainte-Menehould et la route de Paris. Chazot, parti de Vouziers trop tard dans la matinée du 15, trouve, après Autrv, à Montcheutin, la route barrée par 1.500 hussards prussiens, qui mettent son armée en déroute et lui prennent 275 soldats, 8 officiers et 4 canons. Des fuyards arrivent à Rethel et à Châlons. jetant partout le désarroi, répandant le bruit de la défaite de l'armée tout entière. Mais l'arrière-garde de Dumouriez, commandée par Duval et Stengel, force les Prussiens à se replier sur Grandpré. Le 16, la panique gagne l'armée, qui ne se sent pas en sûreté au nord de la Bionne ; mais Dumouriez n'a qu'à paraître de l'autre côté de la rivière pour rétablir aussitôt la discipline par sa fermeté paternelle, sa confiance et sa gaîté. Il établit son camp à Sainte-Menehould, sur un plateau en forme d'S, de trois quarts de lieue. Il s'appuie, à gauche, à l'Étang-le-Roi et à la route de Paris, et s'étend à droite, le long de l'Aisne, vers la Neuville ; il est couvert par des hauteurs entre la Bionne et l'Auve et par des marécages le long de l'Auve. Il est bien approvisionné en eau, en bois et en vivres. Et il a le temps de tout disposer avant l'arrivée des Prussiens Malgré l'irritation du roi Frédéric-Guillaume, qui, apprenant la retraite de Dumouriez, s'était écrié en colère : Maintenant l'ennemi va m'échapper, les Prussiens marchent très lentement, à cause des difficultés de ravitaillement ; ils sont restés inactifs du 15 au 17, dans leur camp de Landres, le camp de la Crotte (Drecklager), près de Grand pré, où ils ont souffert effroyablement de la dysenterie. La lenteur de l'armée prussienne favorise aussi la jonction de Beurnonville et de Kellermann. Beurnonville, qui était déjà arrivé à Auve, apprenant la déroute de Chazot, s'était retiré, le 16, sur Châlons. Averti par Dumouriez, il repart, le 18, et arrive le 19 à Sainte-Menehould. Kellermann, commandant d'armée, indépendant de Dumouriez, avait fatigué ses 18.000 hommes par une marche très hésitante. A Toul le 5, à Ligny le 8, à Saint-Dizier le 10, il poussait une pointe sur Bar-le-Duc le 12, se repliait à la nouvelle du désastre de Chazot jusqu'à Vitry, les 15 et 16. Il ne pensait qu'à la Lorraine, tandis que tout le danger était sur la Marne et l'Aisne ; mais il finit par céder aux demandes réitérées et pressantes de Dumouriez, que secondaient les ordres formels de Servan et de Danton. Il remonte vers le nord, et arrive, le 18, à Dampierre, sur l'Auve. La jonction est faite. Dumouriez devient tout à fait confiant. Notre affaire est sûre, écrit-il, le 18, à Servan.... Les Prussiens sont accablés de maladies, exténués de fatigue et mourants de faim ; leur armée achèvera de se fondre dans la Champagne pouilleuse.... C'est à présent mon tour. Son plan est de ruiner l'adversaire sans se battre. En vain Servan et le Conseil exécutif le conjurent de ne pas rester sur les derrières de l'ennemi et de couper aux Prussiens la route de Paris ; Dumouriez reste solidement établi dans son camp, pensant que les Prussiens n'oseront pas, loin de leurs communications, se porter sur Paris, avec l'armée française sur leur flanc gauche. Les Prussiens arrivaient. Mais au moment où dans l'armée française tous les chefs s'unissaient enfin, l'unité de direction faisait défaut plus que jamais dans l'armée prussienne. Brunswick voulait s'emparer de la Chalade et des Islettes, menacées à l'ouest par ses troupes, et à l'est par les Autrichiens de Hohenlohe, et forcer Dumouriez à abandonner son camp. Mais l'intervention capricieuse du roi changea tout. Un rapport du général Kohler avant signalé un mouvement dans l'armée française prés de Sainte-Menehould, Frédéric-Guillaume craignit que Dumouriez ne déguerpit encore sans bruit ; et, au moment même où l'avant-garde de Hohenlohe allait entrer en contact avec Duval, à Vienne-le-Château, il bouleversa le plan de Brunswick et donna l'ordre de pousser une pointe hardie vers Châlons, afin de couper la route de Paris et de contraindre Dumouriez à la bataille. Les Prussiens s'avancent alors par les vallées de la Tourbe et de la Bionne, et, le 19, occupent la ligne Suippes, Somme-Tourbe et Somme-Bionne. Dumouriez a gardé sa position ; Kellermann est posté le long de la route de Châlons, d'Orbeval à l'Étang-le-Roi, avec son quartier général à Dommartin, ayant derrière lui la marécageuse vallée de l'Auve. Les Prussiens, qui, dans leur hâte, ont dépassé les positions des Français, opèrent un mouvement de conversion, et s'établissent, le 20, entre la Bionne et la route de Châlons, en face de l'armée française, placée sur leurs derrières, si bien qu'ils se trouvent, contre leur attente, obligés de combattre sur un terrain qu'ils n'ont pas choisi. Kellermann, qui d'abord hésitait à accepter la bataille, change, lui aussi, ses positions qui ne lui permettaient pas d'assurer sa retraite. Il se place en face des Prussiens et se prépare à occuper les trois buttes qui, au-dessus de la plaine champenoise, s'élèvent du nord au sud : l'Yvron, la butte du Moulin, près du village de Valmy, et la hauteur de la Lune. Dès le matin le Moulin, au centre, est occupé par le duc de Chartres, fils du duc d'Orléans, le futur roi Louis-Philippe. Mais l'armée de Kellermann est trop massée sur la hutte du Moulin et risque d'être tournée. Dumouriez, qui l'observe de son camp, et qui dirige toute la stratégie, se hâte de fortifier la droite et la gauche de Kellermann. A droite, il envoie Stengel occuper l'Yvron, d'où le feu est ouvert sur les Prussiens ; plus à droite encore, vers la Bionne, Beurnonville, et enfin le Veneur, chargé de pousser une pointe sur la Tourbe et de désorganiser les convois. A gauche, il dépêche Dillon et Chazot vers la butte de la Lune : c'est une lutte de vitesse entre Prussiens et Français ; mais Chazot arrive trop tard, et Massenbach s'empare de la hauteur et y installe son artillerie.
LA MANŒUVRE DE VALMYCarte schématique montrant la marche des armées,
dans la région de l'Argonne, du 1er au 26 septembre 1792. Les flèches
indiquent la direction des mouvements qui aboutissent au champ de bataille de
Valmy. Lorsque le brouillard intense, qui avait duré toute la matinée, se dissipa, vers une heure de l'après-midi, les Prussiens virent avec étonnement l'armée française clans de très fortes positions. Le duc de Brunswick, parti en reconnaissance, revint en disant : Ils sont bien du monde là-haut ! Les Français, impassibles, attendaient l'ennemi. Quand Kellermann aperçut les Prussiens, il leva en l'air son épée, surmontée de son chapeau au panache tricolore, et s'écria : Vive la Nation ! Tous ses soldats l'imitèrent, et des masses profondes de l'armée, les Prussiens, étonnés, entendaient monter les cris de Vive la Nation, vive la France ! La clef des positions françaises était la butte du Moulin-de-Valmy. Brunswick ordonne l'assaut. Mais, sous le feu terrible des trente-six pièces d'artillerie de Kellermann, l'infanterie prussienne plie ; elle reçoit l'ordre de s'arrêter. Cependant les canons prussiens, des hauteurs de la Lune, faisaient rage sur la butte du Moulin-de-Valmy, sans ébranler le courage des Français, ni celui de Kellermann, qui restait à cheval, immobile, sous une pluie de fer. Un caisson français ayant fait explosion, les Prussiens purent croire un moment qu'ils avaient réduit au silence l'artillerie française, mais, quelques instants après, le feu redoublait. Alors Brunswick dit : Hier schlagen mir nicht (Ici nous ne les battrons pas), et donna l'ordre de la retraite. Les Prussiens étaient 34.000 ; les Français engagés dans la bataille 36000. Les pertes ne furent pas très élevées : 300 morts du côté français, qui souffrit beaucoup du tir de la butte de la Lune, 184 du côté prussien ; mais il y avait un grand nombre de blessés. Le 21 septembre, dans l'attente d'un nouveau combat, Kellermann changeait ses positions, assurait sa ligne de retraite, et se repliait derrière l'Auve et l'Yèvre, en maintenant ses communications avec Dumouriez. Mais les Prussiens, extrêmement fatigués, cruellement décimés par la maladie, surpris de la résistance d'une nation qu'ils s'attendaient à trouver accueillante, étaient déjà disposés à la retraite. Profitant de ces nouvelles dispositions, la diplomatie de Danton et de Dumouriez les amènera à reprendre la route du Rhin. La bataille de Valmy avait été en elle-même peu importante ; c'était une victoire surtout morale : l'infanterie prussienne, si renommée depuis le grand Frédéric, avait reculé devant les fortes positions de Dumouriez, l'excellence du tir français, l'enthousiasme et la fermeté patriotique de l'armée française. La retraite des Prussiens hors de France fit du 20 septembre 1792 une des journées décisives de l'histoire. Elle préserva la France d'un retour à l'ancien régime, auquel le Roi, appuyé par l'étranger, voulait la ramener. La France de la Révolution avait triomphé des plus puissantes monarchies du continent. D'ici et de ce jour, dit Gœthe, commence une ère nouvelle dans l'histoire du monde. IV. — L'ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE À LA FIN DE SEPTEMBRE. AU moment où l'Assemblée législative cédait la place à la Convention, l'ancien régime était définitivement vaincu, et, sous les auspices de la victoire de Valmy, la République pouvait s'établir. Le 21 septembre, le président de l'Assemblée, François (de Neufchâteau), saluant la Convention nationale constituée, exprima le vœu le plus formel de maintenir, entre toutes les parties d'un vaste empire, l'unité dont cette auguste Assemblée était désormais le centre commun et le lien conservateur. L'unité, l'indivisibilité, était, en effet, la condition nécessaire de la défense nationale. Ce fut alors la pensée de tous les Français. La guerre faisait évanouir le rêve de ceux qui, comme Billaud-Varenne, inspirés par Rousseau et par l'exemple des États-Unis, avaient désiré une France fédérative. D'ailleurs, en renforçant l'unité, la Révolution ne faisait que suivre les anciennes traditions, et achever, avec une puissance inespérée, l'œuvre de la Royauté. En même temps se fortifiait l'esprit d'égalité. Sans doute, la haute bourgeoisie restait, au fond du cœur, hostile à la démocratie ; le club des Jacobins lui-même, le 19 août, avait refusé de changer son nom de Société des Amis de la Constitution en celui de Société des Amis de l'égalité et de la liberté. Mais la masse de la Nation voulait l'égalité politique, même le suffrage universel direct. Elle repoussait, il est vrai, l'égalité sociale, que rêvaient quelques membres de la Commune de Paris, et qui lui semblait être une utopie pleine de danger ; elle dictera à la Convention un de ses premiers décrets, par lequel seront sauvegardées les propriétés territoriales. L'esprit laïque et anticlérical faisait de nouveaux progrès : les patriotes haïssaient les prêtres réfractaires, amis des émigrés, des Prussiens et des Autrichiens ; les prêtres constitutionnels eux-mêmes commençaient à être atteints par le soupçon qui pesait sur tout le clergé. Thomas Lindet, évêque constitutionnel de l'Eure, écrivait : Il est difficile que la Nation pardonne aux prêtres. Je le sens, je le crois, leur règne est fini... Le clergé périra par la famine. Enfin, sans la nommer encore, la Nation aspirait à la République, à la seule forme de gouvernement qui restât possible. Elle attendait de ses représentants une décision souveraine et l'expression définitive de ce qu'il y avait encore de vague dans ses aspirations et ses désirs. Liberté, égalité politique, république unitaire, tel était l'avenir qui se préparait. Cette République ferait, pensait-on, le bonheur de la France et de tous les peuples. Ce serait la République universelle. Le 13 août, pendant que les Alliés s'avançaient en Champagne, la Commune de Paris, confiante en la victoire, disait : En renonçant à tous projets de conquête, la Nation n'a point renoncé à fournir des secours aux puissances voisines qui désireraient se soustraire à l'esclavage. Le 26 août, l'Assemblée législative, sollicitée d'accorder le titre de citoyen français à tous les philosophes étrangers qui avaient soutenu avec courage la cause de la liberté et qui avaient bien mérité de l'humanité, décernait cet honneur à George Washington et à Thomas Paine, libérateurs des États-Unis, à l'illustre savant et démocrate anglais Joseph Priestley, à l'apôtre de l'abolition de l'esclavage William Wilberforce, au Prussien Anacharsis Cloots, l'orateur du genre humain, aux grands poètes allemands Klopstock et Schiller, qui avaient glorifié la Révolution dans leurs chants immortels. La Nation s'enrichissait de tous les hommes qui, par delà le Rhin et les mers, communiaient dans les mêmes pensées et la même foi. Déjà une plus grande France se formait, abattant les frontières, dissociant les Étais. Le rêve de Camille Desmoulins et d'Anacharsis Cloots, naguère utopie folle, hantait l'esprit de tous les Français, s'exprimait, se précisait, devenait un motif d'action et toute une politique. Ce n'était plus la République pacifique, mais une République casquée comme Minerve, prête à porter partout, avec les couleurs nationales, la liberté et l'égalité, toute la religion d'un grand peuple debout contre les rois envahisseurs. Comme en 1789, une immense espérance, une foi nouvelle exaltait les âmes. Maintenant l'heure de la délivrance et du bonheur apparaissait toute proche. Et, au delà du champ de bataille de Valmy, les Français entrevoyaient à l'horizon les peuples s'embrassant, le genre humain régénéré par la liberté et la fraternité, le Paradis réalisé sur la Terre. FIN DU PREMIER VOLUME |