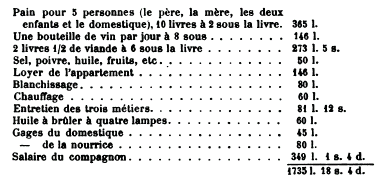HISTOIRE DE FRANCE
LIVRE III. — LA VIE
SOCIALE.
CHAPITRE VI. — LE TIERS ÉTAT.
|
I. — LES BOURGEOIS[1]. PAR l'activité économique, la bourgeoisie s'est fort
enrichie au cours du dernier siècle de la monarchie. Le nombre des rentiers
n'a cessé d'augmenter. En 1784, Necker estime à Dans la richesse mobilière, le prix des charges et des
offices entre pour une grande part. Il y en avait environ 300.000, dont un
peu plus de 4.000, au dire de Necker dans son Administration des Finances, conféraient la noblesse héréditaire
: le reste étaient des charges roturières. Beaucoup étaient très médiocres ;
une charge qui ne coûtait que Les bourgeois, riches ou simplement aisés, divisaient à l'ordinaire leur fortune en mobilière et immobilière. De la terre et des titres de rentes leur paraissent les éléments inséparables d'une fortune bien assise. Par cette combinaison, ils se protègent soit contre les mauvaises récoltes, soit contre les réductions de rentes. Aussi, bien que les impôts qui pèsent sur la terre soient très lourds, sa valeur vénale ne cesse pas d’augmenter. L'argent est abondant ; les emprunts d'État ne suffisent pas à l'absorber ; il ne s'aventure pas sans inquiétude dans l'industrie et le commerce, il se place à l'agriculture, pourvu quelle ne soit pas une mauvaise affaire. Les fermes les plus considérables de Lorraine, écrivait en 1790 un bénéficier, sont possédées par des habitants de Paris ; plusieurs ont été achetées depuis peu par des capitalistes ; ils ont tourné leurs spéculations sur cette province, parce que c'est celle où les fonds sont à meilleur marché à proportion de leurs revenus. Outre le profit, il y a d'ailleurs la considération attachée à la possession de la terre. Le mot : Nul seigneur sans terre est toujours vrai. Le moyen de se décorer d'une particule est d'avoir un nom de terre à mettre derrière. Un emploi considérable de capitaux est fait par la grande
indus-rie. Les constructions d'une petite fabrique de toiles de coton sont estimées
Dès qu'il y a un homme de trop dans la campagne, dit Messance dans le Traité de la population, paru en 1766, il va dans les villes et devient ouvrier, artisan, fabricant ou marchand ; s'il est actif, économe, intelligent, s'il est enfin ce qu'on appelle un heureux, il est bientôt riche. Ainsi se forme une grande bourgeoisie industrielle ; à côté des noms depuis longtemps connus, des Van Robais, des Montgolfier, apparaissent ceux des Périer, Réveillon, Oberkampf, Decrelot, etc. En même temps a grandi la bourgeoisie commerçante, surtout celle qui pratique le commerce maritime et colonial, qui exige aussi de grands capitaux. Les financiers sont les plus hauts bourgeois. On a vu que
cette condition s'était moralement relevée au cours du siècle. Ceux desquels
on avait tant médit, ces parvenus, les ci-devant laquais, que l’on louait de
leur adresse à sauter des derrières de la voiture au
dedans, en évitant la roue, cette truandaille
de finance introduite par En même temps que ces gens de fortune, une autre condition, comme dit Duclos, a plus de relations avec la société et surtout avec les gens du monde, quelle n'en avait autrefois : ce sont les gens de lettres. Leur condition est nouvelle en effet ; ils sont devenus puissance, et c'est une grande force pour la bourgeoisie que philosophes, économistes, auteurs dramatiques, critiques de lettres et d'art, écrivains de toutes sortes, soient en si grande majorité des bourgeois. De même les artistes, architectes, peintres, sculpteurs, tant admirés. Ecrivains et artistes reçoivent encore des bienfaits du Roi, mais surtout des riches particuliers, et ceci est déjà une sorte d'indépendance ; mais de jour en jour ils s'affranchissent. L'écrivain, à la fin du siècle, commence, comme on verra plus loin, à vivre de sa plume. Le progrès de la bourgeoisie se manifeste par la beauté des villes. Arthur Young, en août 1787, fut surpris de la richesse et de la magnificence de Bordeaux : La place Royale, avec une statue de Louis XV au centre, est très belle, les maisons qui l'encadrent ont de la régularité et un grand air. Mais le quartier du Chapeau-Rouge est réellement magnifique, composé de beaux hôtels construits comme le reste de la ville, en pierres de taille blanches. Il confine au Château-Trompette, qui occupe près d'un demi-mille du rivage ; ce fort a été acheté au Roi par une compagnie de spéculateurs, qui sont en train de le Jeter bas, dans l'intention d'y tracer une belle place et plusieurs rues, avec dix-huit cents maisons ; j'ai vu les plans... et, si on les exécute, ce sera un des plus beaux agrandissements qu'ait reçu aucune ville en Europe. La ville semble en croissance indéfinie : Les extrémités sont toutes composées de nouvelles rues, avec d'autres encore plus nouvelles, tracées et en partie bâties. Young, qui préfère, et de beaucoup, Londres à Paris, convient qu’on ne pourrait mettre Liverpool en comparaison avec Bordeaux. Il admire aussi le théâtre de Bordeaux, le plus magnifique de France. On y donne la comédie,
la tragédie, l'opéra, et l’on fait venir de Paris des artistes en renom. On a
assuré à Young qu'une actrice de Paris est payée de 30 à 50 louis par soirée,
et Larive, le premier tragédien de la capitale,
Même admiration pour le Havre : Il n'est pas besoin
d'informations, dit-il, pour s'apercevoir de la prospérité de cette ville ;
impossible de s'y méprendre, il y a plus de mouvement, de vie, d'activité,
que n'importe où j'aie été en France. On a loué dernièrement pour trois ans,
à raison de Même admiration encore pour Nantes : La ville de Nantes présente un
signe de prospérité qui ne trompe jamais : des maisons neuves. Le quartier de
Les deux négociants nantais à qui Young a affaire sont des
gens de bonne compagnie. Chez l'un, M. Riedy, il entend parler de la situation commerciale respective de Il serait vain de chercher l'uniformité dans la vie de la
classe la vie de bourgeoise, composée de tant de catégories sociales, de gens
très-riches ou simplement aisés. En général, la vie était simple et peu
coûteuse, du moins hors des grandes villes marchandes. Des marchands
protestants du Rouergue, revenant de la foire de Beaucaire, qui rencontrèrent
Arthur Young à Saint-Hippolyte-du-Fort, lui assurèrent qu'il pourrait trouver à Milhau un logement garni, composé de quatre
pièces ordinaires de plain-pied, pour 12 louis par an et vivre là avec
sa famille, s'il la faisait venir, dans la plus
grande abondance pour 100 louis. Avec Les scènes d'intérieur que peint Chardin, les sentiments et les opinions que Sedaine et les autres auteurs du drame bourgeois prêtent à leurs personnages, donnent l'idée d'une vie de famille très unie, de cœurs tendres, de caractères francs et droits. Et si ce n'est pas la réalité, c'est tout au moins l'idéal où se complaisait la société bourgeoise. Même dans les villes maritimes, dont la corruption fut de tout temps un thème à déclamations philosophiques, il y avait beaucoup de commerçants de mœurs rigides et durs au travail. Marivaux a donné dans une jolie lettre une esquisse du bourgeois de Paris qui, dans ses ameublements ou maisons et sa dépense est souvent aussi magnifique que les gens de qualité ; mais la manière dont il produit sa magnificence a toujours un certain air subalterne qui le met au-dessous de ce qu'il possède. On trouve en lui de la franchise et de l'amitié ; mais il ne faut pas le tâter sur sa bourse : une froideur subite et l'éloignement succéderont aux marques d'affection que vous en aurez reçues. Marivaux loue l'adresse des marchands et des marchandes : Il y a à Paris un certain esprit de pratique parmi les marchands. Rien n'est plus adroit, plus souples plus spirituel que leur façon d'offrir à qui vient acheter... Je les compare aux chirurgiens qui, avant de vous percer la veine, passent longtemps la main sur votre bras pour l'endormir. Les marchandes, pour tirer l'argent de votre bourse, endorment ainsi votre intérêt à force d'empressement et de discours flatteurs... La boutique de ces marchands est un vrai coupe-gorge pour les bonnes gens qui n'ont pas la force de dire non. Enfin il conclut : Tous les plaisirs, tous les délices de la vie sont, à Paris, tellement à portée de celui qui les peut prendre, qu'il faut être d'un tempérament bien heureux pour ne point abuser de la possibilité de les goûter. Les riches marchands ici ne se les refusent guère. Le grand nombre de collèges à cette époque prouve que les classes moyennes avaient le goût de la culture. Les femmes aussi s'instruisaient. Young a confessé les surprises qui l'enchantèrent au cours de son voyage en France. A Mareuil-sur-Marne, en Brie, il dîne chez M. Leblanc, éleveur de moutons d'Espagne et de vaches suisses : Si l'on ne fait que passer, Mareuil semble un hameau de petits fermiers entouré des chaumières de leurs ouvriers, et la première idée qui vienne, c'est la tristesse qu'il y aurait à y être exilé pour la vie. Qui croirait y rencontrer deux familles aisées, trouver dans l'une Mlle Leblanc chantant en s'accompagnant sur le sistre ; dans l'autre, la jeune et belle Mme B... (nièce de M. Leblanc), jouant sur un excellent piano-forte anglais ? Chez M. Decrelot, riche manufacturier du Pont-de-l'Arche,
dont les draps de vigogne, d'une qualité incomparable, se vendaient Cette dame nous accompagna dans une promenade aux environs, et je fus enchanté de la trouver excellente fermière, très habile dans la culture.... La naïveté de ce caractère et l'agréable conversation de cette personne avaient un charme qui m'aurait rendu délicieux un plus long séjour ici. Il y avait certainement beaucoup de femmes nobles qui n'avaient ni les connaissances ni l'agrément de Mmes Cheinet et Picardet. Et une autre roturière distinguée, Mme Roland, faisait la même comparaison à son avantage : Je ne pouvais me dissimuler, écrivait-elle, que je valais mieux que Mlle d'Hannaches, dont les soixante ans et la généalogie ne lui donnaient pas la faculté de faire une lettre qui eût le sens commun ou qui fût lisible. La bourgeoisie vivait dans le cadre ancien des municipalités, à l'égard desquelles le Gouvernement, au XVIIIe siècle, a continué de pratiquer une politique fiscale et malhonnête. Louis XIV avait érigé en offices des fonctions municipales électives, pour les mettre en vente. En 1715, le Régent avait autorisé les villes à reprendre possession de ces offices en les rachetant ; en 1724, de nouveau, les offices avaient été remis en vente. En 1764 et 1765 par un règlement et un édit, la liberté est rendue aux villes d'élire les magistrats et officiers municipaux ; mais en 1770, au moment de la grande pénurie financière, le Roi veut tirer quelques ressources de la vente des offices. Encore une fois, il essaye de se justifier par un prétexte ; il accuse le régime de la liberté d'être, dans toutes les villes, une source d'inimitiés et de divisions, par le désir que des gens souvent incapables avaient de participer à l'administration, et parla cabale et les brigues qui s'introduisaient dans les élections, et encore une fois, il érige en titres d'offices perpétuels les charges municipales, et il en augmente notablement le nombre. Au moment où l'opinion publique réclamait et obtenait une participation des citoyens aux affaires dans les Assemblées provinciales, il était impossible que les municipalités ne fussent pas réformées. La réforme aurait été certainement faite, si la révolution n'était survenue ; mais dans quel esprit ? On peut le conjecturer d'après un arrêt du conseil d'août 1787, portant règlement pour la ville de Meaux. Le Roi y renonçait implicitement au droit de nomination. Le corps de ville serait composé d'un maire, de quatre échevins, d'un procureur du Roi, d'un receveur et d'un secrétaire greffier, ces trois derniers n'ayant que voix consultative. Le maire et les échevins seraient élus au scrutin secret dans une assemblée générale et ils ne seraient rééligibles qu'une fois. Mais le corps municipal et l'assemblée seraient recrutés exclusivement dans les hautes classes. Les maires ne pourraient être élus que parmi les anciens maires et les échevins, ou parmi les gentilshommes, officiers militaires ou officiers de judicature ; les échevins, que parmi les anciens échevins et parmi les gentilshommes, officiers militaires, officiers de judicature, avocats, procureurs, notaires, médecins, chirurgiens, principaux négociants ou bourgeois vivant noblement ; quant à l'assemblée générale, elle comprendrait, outre les membres du corps municipal, les deux plus anciens de ceux qui auront exercé les places de maires et échevins, un député de chaque paroisse de la ville, un député du chapitre de l'église cathédrale, un de l'église collégiale, un député des curés de la ville, tous les gentilshommes et officiers militaires demeurant dans ladite ville depuis dix ans, un député du baillage, un de l'élection, un du grenier à sel, l'ancien des avocats, l'ancien des procureurs, l'ancien des notaires, l'ancien des chirurgiens et les quatre plus anciens négociants et principaux marchands, ayant rempli ou remplissant actuellement les charges de leur communauté, et payant au moins cent livres d'impositions. Abstraction faite des députés des paroisses, le Tiers n'était représenté que par des officiers du Roi et des notables. A ce corps électoral, les élus devaient une fois par an,
le second dimanche de janvier, rendre compte de
l'état des affaires et de ce qui s'y sera passé (dans le corps municipal) dans le cours de l'année précédente. Mais c'était
la seule fois qu'une assemblée générale pouvait se réunir sans l'autorisation
de l'intendant, de peur évidemment qu'elle ne fût tentée de se substituer à
ses mandataires, et d'intervenir toutes les fois qu'elle le jugerait bon dans
les affaires de la ville. C'est donc encore la municipalité archaïque, un
corps de privilégiés et de notables, en retard sur les idées, les sentiments
et les faits. Il serait bien difficile de définir les opinions politiques de la bourgeoisie. Elles devaient varier de pays à autre. Il y avait dans le royaume quantité de villes mortes, où l'on ne devait point penser comme dans les grandes villes actives, Paris, Lyon, et les riches ports de mer. Généralement parlant, on croit pouvoir dire que le bourgeois était anticlérical, sans être irréligieux, libéral sans être révolutionnaire. Lui aussi, il est un privilégié. Il a le droit de bourgeoisie, qu’il n'acquiert qu'après élection de domicile, un certain temps de séjour et certaines conditions. Ce droit le rend apte aux fonctions municipales et aux grades dans la milice de la ville. C'est aussi un privilège que le régime des maîtrises et jurandes. Enfin, dans la plupart des villes, le bourgeois est exempt de la taille, et même il en est où les magistrats municipaux acquièrent et transmettent la noblesse à charge de posséder leurs offices pendant vingt ans ou d'en décéder revêtus. Il n'a donc point de raison pour être démocrate, et il ne l'est pas, pas plus d'ailleurs que la plupart des écrivains, encyclopédistes ou autres, dont il est le disciple, et qui ont si durement parlé du populaire. Mais il a des raisons d'être mécontent, et il l'est. Il voit les défauts et la décadence des vieux ordres privilégiés. Il sait sa propre valeur, et son importance. Or, le gouvernement s'avise de demander quatre quartiers de noblesse aux futurs officiers, et l'aristocratie parlementaire se constitue en caste, fermée même aux riches roturiers. Et plus encore que ces barrières, les froissements d'amour-propre devaient exaspérer les bourgeois. A l'occasion, on leur faisait sentir qu'ils étaient d'un monde inférieur. Au château de Fonteney, Mme Roland, alors jeune fille, et sa mère, retenues à dîner, étaient servies à l'office. Chez le duc de Penthièvre, ce bon duc si aimable et si accueillant, les nobles mangent avec le maître de la maison, les roturiers dînent chez son premier gentilhomme, et ne viennent au salon que pour le café. Tous les griefs de la bourgeoisie ont été résumés par un aristocrate : Les bourgeois, reconnaît le marquis de Bouille dans ses Mémoires, avaient reçu en général une éducation qui leur devenait plus nécessaire qu'aux gentilshommes, dont les uns, par leur naissance et par leur richesse, obtenaient les premières places de l'État sans mérite et sans talents, tandis que les autres étaient destinés à languir dans les emplois subalternes de l'armée. Ainsi à Paris, et dans les grandes villes, la bourgeoisie était supérieure en richesses, en talent et en mérite personnel. Elle avait dans les villes de province la même supériorité sur la noblesse des campagnes ; elle sentait cette supériorité, cependant elle était partout humiliée, elle se voyait exclue, par les règlements militaires des emplois dans l'armée ; elle l'était, en quelque manière, du haut clergé, par le choix des évêques parmi la haute noblesse, et des grands vicaires en général parmi les nobles... La haute magistrature la rejetait également, et la plupart des cours souveraines n'admettaient que des nobles dans leur compagnie. Même pour être reçu maître des requêtes... on exigeait dans les derniers temps des preuves de noblesse. C'est pourquoi la bourgeoisie, éclairée par les Philosophes, qui sont des bourgeois, conduite souvent par des hommes de professions libérales, avocats ou médecins, qui lui appartiennent aussi, est gagnée par les idées nouvelles. Nantes, écrit Young en septembre 1788, est plus enflammée de l'amour de la liberté qu'aucune ville de France ; les conversations que j'entendis ici prouvent le grand changement qui s'est opéré dans l'esprit des Français, et je ne crois pas qu'il soit possible pour le gouvernement actuel de durer encore un demi-siècle, à moins qu'il n'y ait à la tête des affaires des gens d'un mérite reconnu et d'un caractère ferme. A ce moment, les vieilles municipalités joignaient, comme
on verra, leur coalition à celles qui dans toute II. — LES OUVRIERS[2]. LE plus important phénomène de l'histoire de la classe ouvrière à la fin du XVIIIe siècle est le développement, de plus en plus rapide, de la grande industrie. Le plus grand nombre des artisans, il est vrai, travaille encore à domicile. En Picardie, par exemple, 50.000 personnes, hommes, femmes et enfants, vivent du tissage de la toile par 9000 métiers. Souvent, dans cette province, des cultivateurs sont en même temps tisserands ; ils tissent quand les travaux de la campagne leur laissent du loisir. En Bretagne, en Normandie, en Dauphiné, en Auvergne, même combinaison du travail agricole et industriel[3]. Mais ces artisans, et aussi les petits patrons urbains, qui travaillaient dans l'atelier de famille avec quelques compagnons et apprentis, selon les us et coutumes des jurandes et maîtrises, incapables de produire à aussi bon marché que les grandes fabriques, étaient réduits à végéter. Les classes inférieures en France, dit Arthur Young, ont beaucoup de ces manufactures domestiques ; elles sont misérables. Aussi les ouvriers affluent-ils aux manufactures. Les vieilles manufactures privilégiées continuent, d'être
recherchées. On y a gardé un régime de discipline monastique. Les ouvriers de
Nous soussignés ouvriers employés en la manufacture royale des glaces de Saint-Gobain, promettons et nous obligeons volontairement de bien fidèlement servir MM. les Associés en la manufacture royale des glaces, tant en qualité de paraissonniers qu'à tel autre ouvrage qu'il leur plaira, dans ladite manufacture, pendant le temps et espace de quatre années consécutives, sans pouvoir nous absenter ni quitter le service pendant ledit temps, sans permission ou congé par écrit de mesdits sieurs les Associés ou de leur Directeur, tant en Picardie qu'en Normandie, que partout ailleurs où il leur plaira, et ce pour leur témoigner le zèle et affection avec laquelle nous prétendons les servir... Les ouvriers sont logés dans des maisons bâties sur les terrains appartenant aux manufactures. Ils ne peuvent jamais s'en éloigner de plus d'une lieue sans permission, sous peine d'une amende de vingt sous. Il est défendu de vendre dans les maisons du vin, de la bière ou du cidre. La journée commence à cinq heures et finit à sept, il y a deux heures d'interruption pour les repas. Les portes ferment à 8 heures en hiver et à 10 en été ; le portier remet les clés au Directeur ; quiconque n'est pas rentré un quart d'heure avant la fermeture couche dehors et paye une amende de trente sous. Jusqu'en 1778, la manufacture chômait les dimanches et
fêtes : à cette date, le directeur de Saint-Gobain entreprit de supprimer ce
chômage. Des Associés eurent un scrupule de conscience ; le Directeur alla
trouver son évêque, le cardinal de Rochechouart, à Laon. Il lui représenta
qu'il n'avait pas trouvé d'autre moyen d'empêcher
ses ouvriers de se saouler les fêtes et dimanches que de les faire travailler.
D'ailleurs, dans une manufacture de feu, il
fallait, même ce jour-là, garder un grand nombre d'ouvriers pour donner
secours, SI le feu venait à prendre, et puis ces ouvriers entendaient la
messe du chapelain de la manufacture. Le cardinal,
homme très prudent et très sensé, ne me répondit point, raconte ce
Directeur ; il ne pouvait m'approuver comme évêque,
et il ne pouvait pas non plus me désapprouver comme homme sensé et ami de
l'ordre. Le silence fut pris pour un acquiescement ; dès lors on n'eut plus d'égard ni aux dimanches ni aux
fêtes ; quand le verre était fondu, on le coulait, et on recommençait
à fondre ; il n'y avait pas un moment de perdu. Le Directeur de la
manufacture de Paris demanda au lieutenant de police la permission de faire
comme à Saint-Gobain. Le lieutenant de police permit le travail les jours de fête, à l'exception de celles annuelles et de
Les salaires de ces ouvriers, variant suivant la nature du
travail, étaient au maximum, à la fin du siècle, de 10 liv. 10 s. et ne
descendaient pas au-dessous de Ces mesures humanitaires, la sécurité du travail, les
privilèges dont jouissaient les ouvriers de Il n'en va pas ainsi dans le plus grand nombre des manufactures libres, ni même dans toutes les manufactures privilégiées. Les désaccords entre employeurs et employés, entre le capital et le travail sont fréquents : désaccords à propos des contrats de louage, que rompent souvent les patrons ou les ouvriers ; conflits à propos des chômages, causés soit par la surproduction, conséquence de la grande industrie, soit par des crises économiques. On voit, dans tous ces cas, agir les associations ouvrières, depuis longtemps constituées. Elles organisent des grèves, mettent les patrons à l’index, prétendent les empêcher de choisir tels ouvriers qu'ils veulent, et leur en imposer de leur choix. Les papetiers continuent à se signaler. Les ouvriers de la
fabrique établie au hameau de Courtalin. près Faremoutiers-en-Brie, par
Réveillon, le marchand papetier de Paris prononcent des amendes tant contre les maîtres qui ont des démêlés avec leurs
ouvriers que contre les ouvriers qui n'abandonnent pas les fabriques où ces
démêlés ont eu lieu. Des lettres patentes du 26 février 1777
constatent que les ouvriers des manufactures de
papiers du royaume se sont liés par une association générale, au moyen de
laquelle ils arrêtent ou favorisent à leur volonté l'exploitation des
papeteries, et par là se rendent maîtres du succès ou de la ruine des entrepreneurs.
A Thiers, en 1784, les ouvriers prononcent l’excommunication
contre un de leurs compagnons qui, malgré le privilège de la profession, a
tiré au sort pour la milice, et qui, pour ne pas payer d'amende, a quitté la
ville et cherché du travail ailleurs. Reconnu et repentant, il paie une
seconde amende pour avoir le droit de rentrer à l'atelier. L'argent, dont le
patron avait fait l'avance, fut dépensé en un repas. A Castres, en 1786, les
garçons papetiers quittent l'atelier, se plaignant que leur salaire est
insuffisant, et frappent d'une amende de Le Gouvernement intervient dans les conflits par des actes
répétés. Par lettres patentes de janvier 1749, il a été interdit aux artisans
de quitter l'atelier sans congé exprès et par écrit de leurs maîtres, sauf au
cas où ils seraient maltraités et non payés, auquel cas ils devraient se pourvoir par-devant les juges de police des lieux pour
en obtenir... un billet de congé. Il
leur a été défendu également de s'assembler en
corps, sous prétexte de confrérie ou autrement, de cabaler entre eux pour se
placer les uns les autres chez des maîtres ou pour en sortir, ni d'empêcher
de quelque manière que ce soit lesdits maîtres de choisir eux-mêmes leurs
ouvriers, sous peine de Il est impossible de déterminer avec quelque exactitude le
salaire des ouvriers dans les diverses régions et les diverses professions, et
aux diverses dates du siècle[5]. Les moyennes
données ne sont qu'approximatives, et peuvent faire tomber en de graves
erreurs, si l'on ne tient pas compte de circonstances diverses. Par exemple,
dans certaines manufactures, les ouvriers recevaient, outre le salaire, la
nourriture. Chez les frères Montgolfier, la nappe
est mise trois fois par jour pour les ouvriers,
et ils font de bons repas[6]. Ailleurs, comme
on a vu pour les ouvriers des manufactures de glaces, se faisaient des
prestations en nature. La faiblesse de certains salaires peut s'expliquer
sans doute parce que les ouvriers dont il est fait mention sont des paysans,
qui travaillent à leurs champs ; dès lors il faudrait pouvoir additionner les
deux gains pour évaluer leurs moyens de vivre. Les plaintes sur
l'insuffisance des salaires sont souvent répétées. Dans l’Encyclopédie méthodique, Roland de On suit, dans l'histoire de l'industrie des soieries de Lyon au XVIIIe siècle, les effets de la transformation industrielle. Les maîtres-ouvriers, travaillant pour leur compte et vendant eux-mêmes leurs produits, ne purent résister à la concurrence des maîtres-marchands, qui étaient de gros capitalistes, et ils tombèrent peu à peu dans la condition d'ouvriers à façon. En 1731, on n'en comptait plus que 750 contre 8.000 ouvriers à façon travaillant pour le compte des maîtres-marchands. Pour achever leur ruine, les maîtres-marchands obtinrent du Conseil un arrêt qui les obligea à opter entre la qualité d'ouvrier à façon et celle de marchand ; mais les intéressés réclamèrent, et le Roi annula l’arrêt en 1737, De nouveau en 1744, le conflit recommença ; une émeute se produisit, qui obligea l'intendant à faire entrer une armée à Lyon, et l'arrêt lut remis en vigueur ; 24 ouvriers furent poursuivis pour fait de grève, et 2 furent pendus. Cependant l'agitation continua. Beaucoup d'ouvriers allèrent fonder des fabriques à l'étranger. En 1745, on avait recensé 11.300 métiers ; un tiers fut vendu deux ans après, un autre ne travaillait que par secousses, et le reste ne faisait rien. En 1786, année où les affaires vont tout à fait mal, les
maîtres-ouvriers publient un tableau parallèle de leurs dépenses et de leurs
recettes. Ils supposent un ménage ayant trois métiers chargés des meilleurs genres d'étoffes, dont la femme occupe
constamment l'un, le mari et un compagnon les deux autres, avec l'aide d'un
seul domestique pour faire les dehors, les cannettes
et dévider. Il s'agit de vivre, de nourrir deux enfants dont un en
nourrice, d'entretenir le domestique et de payer le compagnon. Déduction
faite des 52 dimanches, de 17 fêtes chômées et de 24 jours employés à monter
les pièces, il reste 272 jours ouvrables, qui, à raison de 2 aunes 3/4 sur
chaque métier, ce qui sans contredit est la journée
d'un bon ouvrier, produisent 748 aunes pour
chaque métier, et rapportent En regard, voici les dépenses :
Voilà un déficit de Enfin il faut compter les couches de la mère, les jours perdus,
l'entretien du mobilier et des lits, les frais de barbier, le tabac, la
capitation, les six jours perdus par le maria monter la garde, quelques
autres dépenses pour le pliage des étoffes, etc. On arrive ainsi pour l'année
à Mais comment dans ces conditions les maîtres-ouvriers ne sont-ils pas tous détruits ? C'est que, disent-ils, renchérissement de toutes choses est venu peu à peu ; des maîtres, les uns ont sacrifié le bien dont ils avaient hérité ; ceux qui n'avaient rien ont été forcés de se passer du nécessaire à la vie el à l'entretien, de faire des dettes, de recourir aux aumônes, d'abandonner leurs enfants, de surcharger les hôpitaux dans leurs maladies et leur vieillesse. Les maîtres-ouvriers pourraient vivre sans s'endetter, si le prix des façons était augmenté de 4 sous 6 d. par aune. Ils demandent donc au Roi d'imposer aux maîtres-marchands-fabricants ce tarif obligatoire. Le contrat à prix débattu, disent-ils, n'est possible qu'entre gens égaux en moyens et en pouvoirs ; mais à l'égard des ouvriers en soie, destitués de tous moyens, dont la subsistance journalière dépend tout entière de leur travail journalier, cette liberté (du contrat de travail) les livre totalement à la merci du fabricant qui peut, sans se nuire, suspendre sa fabrication, et par là réduire l'ouvrier au salaire qu'il lui plaît de fixer, bien instruit que celui-ci, forcé par la loi supérieure du besoin, sera bientôt obligé de se soumettre à la loi qu'il veut lui imposer. Et s'il était vrai, comme le prétendent les maîtres-marchands, que la fabrique ne peut subvenir à ses frais sans réduire à rien le prix des façons et rendre misérables les ouvriers qu'exige sa main-d'œuvre, il faudrait l'extirper, celte fabrique, comme un vice dans l'État. La conclusion des ouvriers est que c'est le Gouvernement, et non pas la loi de l'offre et de la demande, qui doit régler les conditions du travail. Un peu partout sont exprimés les griefs contre la fabrique, ou, comme on commence à dire, contre l'usine, un mot que Roland de Vaste laboratoire, immense atelier où les machines en grand sont communément mues par l'eau. Une grosse forge, une forge d'ancres, une refonderie de fer, l’ensemble des martinets et des grands travaux sur cuivre, des fils de fer, etc., sont des usines. Les machines, on commence à les briser dans les émeutes ;
mais elles ne cesseront pas de se multiplier, parce qu'elles fabriquent à
meilleur marché et que la concurrence oblige à produire à bas prix : Partout où la matière première est chère, dit un
inspecteur des manufactures, il faut suppléer par des machines ; il n'est que
ce moyen de se mettre au niveau de ceux chez qui elle est à plus bas prix...
Les Anglais l'apprennent à l'Europe. Avec les
usines se multiplieront les agglomérations, et les phénomènes de la lutte
entre le capital et le travail. On vient de voir les ouvriers pratiquer la
grève, l'interdit des ateliers, le débauchage ; ces faits n'étaient pas
nouveaux ; mais ils se produisirent plus souvent au XVIIIe siècle
qu'auparavant. C'est une plainte générale des maîtres, au témoignage de
Mercier dans le Tableau de Paris,
que leurs ouvriers leur font la loi et se coalisent
pour leur résister. Propos insolents, lettres injurieuses, ils se permettent
tout. Et puis ces ouvriers, dans les villes surtout, surtout à Paris,
causent, entendent causer, lisent. Ils vont au théâtre, où les dramaturges,
parmi lesquels Mercier lui-même, exaltent les vertus des petites gens. Restif
de III. — LES PAYSANS[7]. Il est très difficile d'apprécier la condition des paysans
à l'approche de Il est certain que la propriété est de plus en plus
morcelée. Les petites propriétés, dit Arthur Young, se
trouvent partout à un point que nous nous refuserions à croire en Angleterre.
Le nombre en est si grand, que je penche à croire qu'elles forment le tiers
du royaume. Et il cite, parmi les pays où la petite propriété
prédomine, le Quercy, le Languedoc, les Pyrénées, le Béarn, Si tout le monde est d'accord sur le morcellement de la propriété, les opinions diffèrent sur la condition des propriétaires. Les possesseurs de biens roturiers étaient-ils propriétaires, au sens complet du mot, ou simplement tenanciers héréditaires, astreints par conséquent à payer des cens et redevances, grands ou petits, au véritable propriétaire[8] ? Au reste, le droit d'occupation des censitaires était aussi solide que celui des propriétaires. Après trente ans de concession, le droit de rachat du seigneur était prescrit. Beaucoup de ces censitaires étaient des occupants séculaires. Les propriétaires qui ne cultivaient pas eux-mêmes
louaient leurs terres à rentes fixes à des fermiers, ou bien les faisaient
cultiver par des métayers avec qui ils partageaient les récoltes, ou bien ils
employaient des ouvriers, les brassiers. On a
vu que le fermage est surtout en usage dans les provinces du Nord de Le mode d'exploitation le plus ordinaire était le
métayage. Il prévalait presque partout, dit Arthur Young, en Sologne, dans le
Berry, Le contrat de métayage varie d'une province à l'autre ; d'ordinaire le propriétaire fournit la moitié du bétail et delà semence ; le métayer, les outils, et il paye les impôts ; la récolte est partagée également. Ce mode d'exploitation associe le capital et le travail ; il est la ressource des populations pauvres ; mais il a le grave défaut de confier la terre à un colon, qui n’a qu'un médiocre intérêt à la bien cultiver et à l'amender, puisqu'il est congédiable à la volonté du propriétaire, et qu'il risque d'être frustré du résultat de ses efforts et de ses améliorations. Il n'est pas plus avantageux au propriétaire qu'au métayer. A Vatan, en Berry, on m'assura, dit Arthur Young, que presque tous les ans les métayers empruntent au propriétaire du pain qui leur permette d'attendre la moisson. Ce pain est un mélange d'orge et d'avoine, dont je goûtai assez pour plaindre ces pauvres gens ; du reste le peuple ne connaît pas le pain de froment. Turgot estime que le métayer est toujours réduit à ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim, et l'Assemblée provinciale du Berry que les métayers sont de véritables esclaves vendus aux propriétaires. Mais la classe la plus misérable est celle des journaliers, dont les uns, n'ayant qu'un lopin de terre, cherchent au service d'autrui un supplément de ressources, dont les autres n'ont que leurs bras pour vivre. Employés par les grands propriétaires ou par les petits, exposés plus encore que les ouvriers des villes au retour périodique du chômage, mal payés, ils ont rudement pâti du partage des communaux et de la clôture des terrains vagues. Voltaire en prenait allègrement son parti : Le manœuvre (journalier, brassier), l'ouvrier, doit être réduit au nécessaire pour travailler. Le philosophe ajoute, il est vrai, humainement : Il faut que ce grand nombre d'hommes soit pauvre, mais il ne faut pas qu'il soit misérable. Cependant les propriétaires cultivateurs, et même les journaliers, ne cessent pas d’acheter de la terre pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, quand les grandes guerres ont cessé et que le prix du blé monte. Peut-être y a-t-il eu, à partir de 1780, un ralentissement dans les achats, coïncidant avec la baisse qui se produisit dans le prix du blé ; mais les mutations de propriétés sont fréquentes dans les dix années qui précèdent. Le partage des communaux, les dessèchements de marais, les défrichements ont contribué aussi à étendre la petite propriété. Probablement la demande était supérieure à l'offre. La population des campagnes a sûrement augmenté depuis la fin du règne de Louis XIV ; l'industrie n'était pas assez développée pour absorber cet excédent, c'était à !a terre à y pourvoir. J'ai vu plus d'une fois, dit Arthur Young, les partages en arriver à ce point qu'un arbre fruitier avec dix perches de terrain constituait une ferme, dont la possession enchaînait au sol une famille. Ce n'était pas assez pour vivre. On a souvent répété, dit encore Young, que les petites fermes entretiennent une plus nombreuse population ; c'est vrai et c'est souvent le mal ; car elles n'engendrent que des êtres misérables sans fournir les moyens de les nourrir. En France, le grand excès de population est un mal national. On imagine avec quelle convoitise ces pauvres gens
regardaient ces immenses domaines des grands seigneurs, qui n'étaient pour la
plupart que bruyères, landes, déserts, fougeraies, et forêts peuplées de
cerfs, de sangliers, de loups. En considérant tout ce bien perdu, l'écrivain
anglais s'est écrié : Ah ! si pour un jour j'étais
le législateur de Les paysans doivent les impôts au Roi, la dîme à l'Église,
et, s'ils ne sont pas propriétaires libres, des redevances au seigneur. Les
nobles, les ecclésiastiques, les magistrats des cours souveraines, les
bourgeois des grandes villes et, à vrai dire, presque tous, sinon tous les
gens riches, étant dispensés de la taille, cet impôt retombait sur les
habitants des campagnes ; aussi s'appelait-il l’impôt des paysans. Or le
montant de la taille pour tout le royaume en 1789 était de On a plus d'une fois relevé dans cette histoire, en particulier
pour le temps de Colbert, les abus de la répartition et de la levée des
tailles : corruption, partialité et ignorance des collecteurs, friponneries
du subdélégué, des élus et des receveurs. Le Gouvernement s'était efforcé d'y
remédier ; il avait donné aux intendants le pouvoir de dresser ou de faire
dresser par des commissaires de leur choix les rôles de la taille, et, par
une Déclaration du 3 janvier 1775, aboli la contrainte solidaire. Il s'était
imposé en Les fermiers sont pauvres ou se font passer pour tels du moment que la taxe menace de s'élever en proportion de leurs revenus ; de là de pauvres bestiaux, de misérables outils et des fumiers mal tenus, même chez ceux qui pourraient en avoir d'autres. Le Gouvernement, depuis la fin du règne de Louis XIV, a
établi de nouveaux impôts : capitation, dixième, cinquantième, vingtièmes. Si
cette expérience avait été honnêtement et sérieusement faite, on fût arrivé à
établir, ou à peu près, l'égalité des charges. Mais les privilégiés ont
réussi à rejeter tout ou partie des contributions nouvelles sur les
taillables. On a calculé qu'à la veille de Les réformes mêmes ajoutaient au poids de la taille. Quand
la corvée fut supprimée, elle fut remplacée par un accessoire à cette
contribution. Si l'on met ensemble, conclut
Taine, Les impôts indirects lui ôtaient une bonne partie du reste. Il faudrait répéter ici les méfaits de la gabelle, de plus en plus odieuse, des aides qui entravent la circulation et ruinent le producteur, et aussi du recrutement militaire, et de la milice, à propos de laquelle on disait que le milicien était si mal nourri et assujetti à une si rude discipline, qu'il serait trop cruel de prendre (pour en faire un milicien) un autre homme qu'un homme du bas peuple. Après le Gouvernement du Roi, il fallait payer le service du culte, et c'était un nouveau prélèvement, estimé par les plus modérés à cent millions, à opérer sur les fruits de la terre. Restait à pourvoir le seigneur, héritier ou successeur des anciens maîtres et propriétaires du sol. Le seigneur, à la fin de l'ancien régime, a gardé une part d'autorité, il jouit de privilèges, et il prélève des redevances sur des propriétés qui ne sont plus siennes ; c'est la constatation qu'autrefois ses ancêtres, ou les ancêtres de celui dont il a acquis les biens et les titres, administraient le pays et en possédaient les terres. Il continue à percevoir les droits de guet et de garde, des péages, des droits de minage et d'aunage sur les marchés, et de leyde sur les foires, les lods et ventes, qui sont en moyenne du dixième ou du douzième de la valeur de toute terre vendue et même quelquefois du huitième ; le droit de rachat ou relief, équivalant à une année de revenu, et qu'il touche sur les héritages revenant à des collatéraux. Il a droit à des corvées, dont le nombre, il est vrai, au XVIIIe siècle, ne dépasse nulle part douze journées par an. Autrefois il a bâti pour la communauté et pour lui un four, un pressoir, un moulin, une boucherie. Tous les habitants sont obligés de s'en servir moyennant rétribution. Il s'est réservé, en souvenir de sa qualité de
propriétaire, d'avantageuses servitudes sur les terres qu'il a données ou aliénées.
En vertu du droit de banvin, il est le
premier et unique vendeur de vin pendant les trente ou quarante jours qui
suivent la récolte. Seul, il a le droit de chasse et le droit de colombier ;
ses pigeons se nourrissent sur les terres voisines, et il est défendu de les
tuer ou de les prendre. Par une autre suite de la qualité de propriétaire, il perçoit des redevances sur tous les biens que jadis il
a donnés à bail perpétuel, et, sous les noms de cens, censives, carpot, champart,
agrier, terrage, parcière[10], ces perceptions en argent ou en nature sont aussi
diverses que les situations, les accidents, les transactions locales ont pu
l'être. Une des plus onéreuses est le champart qui prélève le plus
souvent une gerbe sur 12 et même une gerbe sur 10,
sur 8 ou même sur 6. Ce sont là les principaux droits féodaux en usage encore au XVIIIe siècle ; mais il ne faut pas croire que tout seigneur possédât tous ces droits, ni même la plupart d'entre eux, et il faut tenir compte de ce que ces droits s'étaient, au cours du temps, transformés et allégés, et qu'il y en avait d'insignifiants. Presque partout les redevances personnelles avaient fait place aux redevances réelles. Quand le cens était payé en espèces, comme il était, de sa nature, immuable, les paysans profitaient de l'avilissement du prix de l'argent depuis l'origine de la tenure ; ils continuaient à payer la même somme, mais qui n'avait plus la même valeur. Malgré ces atténuations, l'injustice des droits féodaux était trop évidente. Les uns avaient été le salaire de la protection et de la sécurité qu'autrefois le seigneur, administrateur, juge, voyer ou gendarme, avait assurées aux habitants ; mais cette fonction, il ne l'exerçait plus, et il continuait à se faire payer pour des services que le Roi l'avait dispensé ou même lui avait défendu de rendre. Les paysans étaient obligés de verser des droits de mutation au Roi et des lods et ventes au seigneur et d'entretenir deux gouvernements, dont l'un ne gouvernait plus ; d'autre part, tenanciers héréditaires, établis de temps immémorial sur la terre qu'ils cultivaient, ils se considéraient comme les propriétaires et s'étonnaient d'avoir à verser des redevances à un prétendu propriétaire primitif. Il est impossible d'estimer exactement quelle part les droits seigneuriaux enlevaient au revenu du paysan. Elle variait beaucoup suivant les régions. D'ailleurs, les droits étaient généralement aggravés par les vexations qui accompagnaient la perception. Dans certains pays, le seigneur exigeait des corvées extraordinaires pour les réparations du moulin banal ou de son château ; les fermiers de ses droits se faisaient payer rigoureusement au terme et imposaient pour tout retard de fortes amendes. Il exigeait d'un seul coup des redevances arriérées, qu'à cause de leur modicité ou par négligence, il avait cessé de percevoir et que les tenanciers s'étaient habitués à regarder comme prescrites. Quand, par suite de retards, le censitaire devait acquitter en argent une redevance en nature, le seigneur calculait souvent son dû arbitrairement, ou, comme on dit, à l’appréci, d'après le prix le plus élevé des marchés précédents. Quand il s'agissait de livraisons en nature, il n'acceptait que le plus beau grain. Le droit de mouture était généralement fixé au seizième du blé moulu ; mais le meunier prenait davantage ; il se servait de fausses mesures ; il mêlait à la farine du sable ou de la chaux. Le fermier du four banal, au dire de Lavoisier, fait manger une nourriture de mauvaise qualité à plus des trois quarts du royaume. Mais le caractère le plus pénible des droits féodaux,
c'est qu'ils n'étaient pas rachetables, du moins dans les campagnes. Les gens
des villes avaient été autorisés, par arrêt du Conseil du 29 juin 1739 et
divers arrêts de Parlements, à racheter les cens et redevances, mais les
propriétés paysannes restaient grevées à perpétuité de cette servitude. Elle
était gênante et pouvait à l'occasion être lourde. Le cens, il est vrai,
s'était fractionné en autant de parts que les censives elles-mêmes, si bien
que, de divisions en divisions, la redevance en argent ou en nature des
co-censitaires était réduite à des infiniment petits. Sur la terre des
Brosses, 83 arpents sont divisés en 112 parcelles aux mains de 20
censitaires, qui doivent tous ensemble En ces sortes d'affaires, le seigneur justicier était juge et partie. Il avait ou pouvait avoir son tribunal et ses officiers chargés de prononcer sur les contestations relatives aux cens et redevances, du moins jusqu'à une certaine somme. C'était, de tous les droits de justice, hauts, bas et moyens, celui qu'il avait le mieux défendu. Sa justice criminelle était réduite le plus souvent à un droit de police analogue à celui d'un maire et d'un juge de paix, et il avait presque partout laissé tomber en ruines les fourches patibulaires ; mais il avait conservé la justice censuelle. Les Ordonnances lui défendaient de la rendre lui-même, et l'obligeaient à choisir ses officiers parmi les gradués en droit, ayant fait un stage dans une Cour souveraine. Mais, comme ces juges seigneuriaux, pour avoir les moyens de vivre, étaient souvent attachés à plusieurs seigneuries, baillis dans un lieu, majeurs ou maires dans un autre, prévôts dans un troisième, lieutenants dans un quatrième, ils se faisaient suppléer pour l'expédition des affaires courantes par des praticiens de village, rustres mal dégrossis, dont l'ignorance et la corruption étaient proverbiales. Les uns et les autres, dans un litige entre le seigneur et ses paysans, étaient nécessairement pour qui les nommait et les payait. Quand le seigneur avait manifestement tort, ils éternisaient la procédure. Dans les petites seigneuries, l'honneur d'avoir justice
était coûteux. Le seigneur de Blet et des Brosses, en Bourbonnais, un domaine
d'environ 2.000 arpents, paie Le paysan avait fort à souffrir du droit de chasse du seigneur. La chasse lui était interdite, sous les peines les plus sévères : amende, prison, même les galères en cas de récidive. Il devait laisser pulluler le gibier ravageur, tolérer la foulée de ses terres par les veneurs. Mais le droit de chasse du Roi était plus redoutable encore. Les rois, seigneurs des seigneurs, s'étaient réservé, autour de Paris et de leurs châteaux, 400 lieues de terres gardées ; c'étaient les capitaineries royales, où le gros gibier, cerfs, biches, chevreuils et sangliers, pâturait et vaguait à l'aise. Chasseurs et gibier étaient de dangereux voisins pour les propriétaires enclavés ; tel jour de grandes chasses royales, la poursuite d'un cerf pouvait priver un territoire d'une année de subsistance. La pire condition paysanne était celle des mainmortables,
véritables serfs que l'on trouvait dans différentes parties du royaume. La
personne mainmortable ne pouvait ni tester, ni même, sans l'approbation de
son maître, se marier hors de sa seigneurie et de sa condition. Les enfants
du mainmortable n’héritaient de lui que sils vivaient continuellement avec
lui, ayant même pot et même table ; s'il n'avait pour héritiers que des
collatéraux, ses biens revenaient au seigneur. Dans certains pays, où Il y avait des mainmortables — peut-être au nombre de 1.500.000,
— en Champagne, en Bourgogne, en Bourbonnais, dans Voltaire, leur voisin de Ferney, se dévoua à leur
libération. De 1770 jusqu'à sa mort, aidé par un jeune avocat de
Saint-Claude, Pierre Christin, il présenta leur cause au Conseil du Roi, aux
ministres, aux parlements et à l'opinion publique ; il la gagna devant ce
dernier tribunal. Un an après sa mort, le Roi, par un édit d'août 1779, qui
visiblement s'inspirait du dernier Mémoire
du philosophe, abolit la mainmorte, ces vestiges,
disait-il, d'une féodalité rigoureuse, dans
toutes les terres de Cet appel ne fut pas entendu. Le Parlement de Besançon
refusa jusqu'en 1788 d'enregistrer l'Édit. Seuls, quatre seigneurs laïques de
Franche-Comté, le prince de Bauffremont, les présidents de Vezet, de
Chamolle, de Chaillon et une petite communauté de missionnaires dépendante de
l'abbaye des Bernardins réformés de Notre-Dame de Beaupré-sur-Meurthe, dans
le diocèse de Toul, consentirent à libérer leurs mainmortables. Les seigneurs
du Charolais, écrivait en Il est impossible — un mot qu'il faut souvent répéter,
quand on parle de l'état social en France au XVIIIe siècle, état si mal connu
encore — de donner une conclusion générale sur la situation des paysans. On
est porté sans doute à la pousser au noir et à croire, sans plus ample
examen, des mots comme celui-ci, qui est de Mme Roland : Nos paysans pour la plupart sont misérables cent fois plus
que les Caraïbes, les Groenlandais ou les Esquimaux. Mais d'autres
témoignages s'opposent à ceux de cette sorte. L'économiste Moheau a constaté
en 1774 que, depuis quelques années, le paysan français était mieux logé,
mieux vêtu, mieux nourri. Young ne fait pas que des tableaux sombres. Il
signale la pauvreté des pays vignobles, victimes des obstacles mis à la
circulation ; vigneron et misérable, dit-il, sont synonymes. Il a de
terribles descriptions de Mais le même Young, entrant d’Espagne en France, s'émerveille : Ici, sans passer une ville, une
barrière, ou même une muraille, on entre dans un nouveau monde. Des pauvres
et misérables routes de En Béarn, près de Moneins, c'est une succession de chaumières de fermiers bien construites, propres et confortables, bâties en pierre, couvertes de tuiles, chacune ayant son petit jardin enclos de haies taillées, avec des pêchers et autres arbres fruitiers en abondance, et de jeunes arbres entretenus avec tant de soin qu'il n'y avait que la main nourricière du propriétaire qui pût effectuer rien de semblable... Ce pays appartient entièrement à de petits propriétaires, sans que les fermes soient trop petites. En d'autres régions, mêmes constatations. Vers Alençon, le pays fait contraste avec celui qu’il a traversé la veille ; il voit un bon terrain bien enclos, bien bâti, passablement cultivé et bien marné. Près d'Aiguillon : une riche vallée bien cultivée ; beaucoup de chanvre et toutes les femmes du pays occupées de ce travail ; plusieurs fermes propres et bien bâties sur de petites propriétés, et tout ce pays bien peuplé. D'autre part, d'autres Anglais que Young, qui ont voyagé en France, comme Horace Walpole en 1765 et Rigby en 1789, ont célébré les belles cultures et l'air de prospérité des villages. Il faut donc distinguer entre les époques, et même pour une époque, entre les divers pays du royaume et les diverses catégories de paysans. Dans un temps où de si lourdes charges pesèrent sur les ruraux, la vie assurément ne pouvait pas être bonne, mais il semble bien, d'après des témoignages dignes de foi, qu'elle fut plus tolérable pour les paysans dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cependant le paysan paraît se sentir plus misérable que jamais. Peut-être l'allégement même de sa misère lui fait-il paraître plus lourd le poids de ce qui reste ; peut-être est-il dégoûté du présent par les idées et les espoirs nouveaux qui pénètrent dans les campagnes. Il faut tenir compte aussi d'un changement depuis longtemps commencé, mais qui va s'aggravant, dans les relations entre les seigneurs et les paysans. En quelques endroits, ces relations entre les châtelains
et les villageois restèrent, jusqu'au bout, bonnes et cordiales. Dans le Bocage,
raconte Mme de L'abbé de Un des principaux avantages que nous devons attendre des Assemblées provinciales, ce sera sans doute de rappeler plus souvent les seigneurs dans leurs terres. Ainsi, plus rapprochés de cette classe infortunée qui arrose les champs de ses sueurs, ils ne pourront être témoins de tant de souffrances et de privations, sans travailler à les adoucir.... Si les champs étaient plus souvent habités par ceux qui en dévorent les fruits... on trouverait à peine des malheureux. Mais il était bien tard pour rappeler Cependant, le Roi fit, au dernier moment, une réforme considérable. L'immense majorité de la population agricole était groupée en communautés ou paroisses, qui n'avaient qu'une organisation municipale embryonnaire. L'Assemblée générale des habitants, composée de tous les domiciliés, se réunissait pour délibérer sur les affaires communes et choisir un procureur ou syndic chargé de défendre ses intérêts. C'était l'unique agent d'exécution de ces petites démocraties rurales, sauf dans les pays d'États et dans quelques provinces, où les paroisses, comme les grandes villes, avaient une municipalité constituée. L'intendant convoquait les Assemblées, confirmait le choix du syndic et même s'était arrogé le droit de le nommer. Comme ces Assemblées étaient ou inertes ou tumultueuses, on a vu que des intendants s'étaient avisés de consulter les notables du lieu sur les affaires de la communauté ; c'étaient naturellement des Assemblées soumises et qui n'avaient d'autre pouvoir que d'éclairer l'intendant. La réforme de 1787 eut une tout autre portée ; elle donna aux villes et aux paroisses qui ne la possédaient pas, une organisation municipale complète et indépendante. Des assemblées de paroisses seraient établies dans les villes et villages où il n'en existait pas ; elles seraient composées du seigneur, du curé, de trois, six ou neuf membres électifs suivant le nombre de feux, et d'un agent exécutif, le syndic, élu lui aussi. Seraient électeurs les habitants payant dix livres au moins d'imposition foncière ou personnelle dans la paroisse ; seraient éligibles, ceux qui en payaient 30 et avaient 25 ans d’âge et un an de domicile. L'assemblée serait élue pour trois ans, le syndic pour trois ans ; l’une et l'autre, trois fois rééligibles. L'Assemblée, présidée par le seigneur et, en son absence, par le syndic, répartirait toutes les impositions et levées de deniers qui incombaient à la communauté. Elle délibérerait sur les affaires intéressant la communauté et sous réserve de l'approbation de l’autorité supérieure, arrêterait, par exemple, la réparation ou la construction des églises et presbytères, contracterait les emprunts et signerait les baux. L'intendant n'avait plus que le pouvoir de vérifier et de déclarer exécutoires les rôles de l'impôt et d'autoriser les dépenses, les emprunts et les actions en justice. Il n'avait aucune prise sur l'Assemblée, élue librement et présidée par le seigneur ou par un syndic élu. Même les conditions de cens exigées des électeurs et des éligibles assuraient les lumières et l'indépendance du corps municipal. Ainsi, l'œuvre de décentralisation, commencée par les provinces, était étendue aux moindres parties du pays. Ce fut un de ces changements considérables, par lesquels on voit la monarchie s'efforcer de créer des conditions nouvelles de la vie politique, et dont les conséquences auraient pu être très heureuses, s'ils étaient venues plus tôt. Dans la population des campagnes, il faut faire une place à part, et considérable, aux mendiants, braconniers, contrebandiers, faux sauniers alors si nombreux. Les mendiants encombrent les villes, terrorisent les campagnes, maraudent et au besoin assassinent. Ils se montrent si audacieux, qu'en 1767 le gouvernement en fit arrêter d'un coup cinquante mille. Les grands chemins, écrivait l'intendant de Bretagne, le 17 août 1785, sont infestés de vagabonds dangereux, de gens sans aveu et de véritables mendiants, que la maréchaussée n'arrête pas, soit par négligence, soit parce que son ministère n'est pas provoqué par des sollicitations particulières. Les environs des grands domaines et des capitaineries générales étaient infestés de braconniers, en état de guerre continuelle avec les gardes-chasse. Tous les ans, dans chaque grande forêt, il y a des meurtres d'hommes. Dans les pays de grande gabelle et dans les provinces des cinq grosses fermes, à quatre lieues de part et d'autre, le long de la ligne de défense, la culture est abandonnée, tout le monde est douanier ou fraudeur. Il faut 50.000 hommes pour surveiller la multitude des contrebandiers. En Bretagne, pays exempt, limitrophe de pays de grande gabelle, les faux sauniers pullulent. La douane arrête, année commune, sur les grands chemins ou dans les lieux de passage et principalement dans les directions de Laval et d'Angers, 2.300 hommes, 1.800 femmes, 6.600 enfants. Le nombre d'hommes envoyés annuellement aux galères pour la contrebande du sel et du tabac passe 300. Voleurs, galériens, mauvais sujets de toute espèce, ce sont eux, dit Taine, qui, dans les insurrections feront l’avant-garde, et pousseront le paysan aux dernières violences. IV. — L'ASSISTANCE[12]. DEPUIS longtemps, le Gouvernement, l'Église et les particuliers se préoccupaient de l'assistance due aux misérables ; mais, au XVIIIe siècle, le zèle redoubla, surtout dans les dernières années. L'assistance est devenue un devoir d'État, établi sur des principes qui dirigent la politique charitable. Le soulagement des hommes qui souffrent, dit l'intendant Turgot en 1770, est le devoir de tous, et toutes les autorités se réuniront pour y concourir ; et Necker écrit dans son Administration des finances : C'est au Gouvernement de faire,
pour la classe nombreuse et déshéritée, tout ce que Tordre et la justice lui
permettent... L'Administration saura découvrir les devoirs de Les mêmes sentiments sont souvent exprimés par des
écrivains, par des autorités, et par des Assemblées provinciales : La société, dit l’Assemblée de l’Île-de-France, doit assistance, et protection à tous ses membres ;
et l'Assemblée de l'Orléanais : Les lois doivent
protéger le faible, l’indigent, l'infirme, l'homme en un mot qui manque de
subsistance, dans quelque état qu'il soit ; toutes les ressources dont
dispose la société doivent être concentrées par l'administration, qui peut
faire justice à tous. Le duc de Cette assistance fut offerte tantôt par des particuliers
riches, qui ouvrirent des fabriques pour donner du
travail aux malheureux, comme, par exemple, le marquis d'Hervilly, une
fabrique de toiles, et la marquise de Choiseul-Gouffier, une papeterie ;
tantôt par une de ces sociétés si nombreuses, qui s'appelaient bureaux de charité, bureaux
des pauvres, maisons de charité, sociétés philanthropiques : mais surtout par des
ateliers publics, les ateliers de charité.
Les premiers datent de 1740 environ, et on voit dès lors des intendants les
diriger. En 1770, au temps du Contrôleur général Terray, les ateliers se
multiplient dans toute Ce n'est pas toujours la plus grande utilité des chemins à réparer qui a déterminé la distribution que j'ai faite des fonds (de charité) ; souvent je n'ai consulté que la misère d'une province ; il en fallait faire vivre les pauvres, et je leur en fournissais le moyen par le travail[13]. Mais le nombre des sans-travail était trop grand pour
qu'on pût les occuper tous dans les ateliers de charité, alors même qu'ils
eussent voulu y entrer ; et, sans doute, la plupart ne s'en souciaient pas ;
ils préféraient la vie errante. On vient de voir qu'ils étaient un fléau pour
les villes et les campagnes. Les mesures répétées contre le vagabondage ne
servaient de rien ; l'Assemblée de l'Ile-de-France s'en plaignait : Malgré les précautions prises jusqu'à présent, le nombre
des mendiants qui parcourent les villes et les campagnes effraye
l'imagination la moins sensible. Depuis longtemps, on enfermait ces
misérables dans les hôpitaux généraux, mais ils les encombraient ; le Gouvernement
se résolut à créer des dépôts de mendicité.
Après avoir essayé ces dépôts dans quelques villes, il en établit dans toute Suivant une formule de Necker, Cet horrible régime provoqua un mouvement d'opinion. L'Académie de Châlons ayant, en 1777, ouvert un concours sur les meilleurs moyens de remédier au paupérisme, la plupart des concurrents demandèrent le remplacement des hôpitaux par l'assistance à domicile, des pensions pour les pauvres honteux, l'hospitalisation des vieillards dans les monastères, et des enfants trouvés à la campagne dans des vacheries, et, à la ville, dans des laiteries. Toutes les ressources de l'assistance seraient centralisées ; elles comprendraient les revenus des hôpitaux supprimés, les aumônes, les quêtes, le produit d'une taxe générale et proportionnelle, levée sur les cultivateurs et les fermiers aisés des paroisses. L'idée de l'assistance à domicile fit du chemin. Dupont de Nemours, dans ses Idées pour les secours à donner aux pauvres malades dans une grande ville, écrivait : Toutes les fois qu'en secourant les pauvres malades on peut leur épargner la fatigue du transport, le déchirement des séparations, l'effroi qu'inspire l'entrée d'une grande maison publique où ils ne connaissent personne, et qu'ils ne sauraient s'empêcher de regarder comme le temple de la mort, on a déjà commencé un grand acte de charité. Mais ce grand remède était inapplicable ; il l'est encore aujourd'hui. Du moins, on s'efforça de décentraliser les services hospitaliers. L'Académie des Sciences demande en 1761 que quatre hôpitaux remplacent l'immense Hôtel-Dieu ; quelques hôpitaux de quartiers sont en effet fondés à Paris, en 1789, où les malades se sentaient plus près de leurs familles et recevaient des amis. Il y avait en tout, à Paris, à cette date, 48 hôpitaux ou maisons de charité soignant par an 6.200 malades, 14.000 vieillards ou infirmes, 15.000 enfants trouvés. Un des plus tristes témoignages de la misère est le très grand nombre des enfants abandonnés. Comme il ne se trouvait d'asiles que dans les grandes villes, on les y apportait. Du 1er janvier 1772 au 31 décembre 1776, sur 32 222 enfants entrés à l’hôpital des Enfants-Trouvés de Paris, 10.068 venaient des provinces. En 1772, le Contrôleur général Terray rappela aux intendants que, d'après les anciens règlements, les paroisses et les seigneurs haut-justiciers ont la charge de recueillir les enfants-trouvés ; à quoi un intendant, celui d'Alençon, répondit que les paroisses n'aimaient pas à s'imposer pour subvenir à l'entretien des enfants de cette espèce : elles voudraient rechercher la mère pour la forcer à soigner son enfant ; or, une malheureuse fille qui craint que sa faute ne soit découverte, préférerait faire périr son enfant. Malgré les efforts du Gouvernement, l’afflux des enfants abandonnés vers les grandes villes, et surtout vers Paris, continua donc. C'étaient les seigneurs haut-justiciers qui faisaient transporter les enfants ; mais les modes de transport étaient barbares, et beaucoup mouraient en route. Il est dit dans un arrêt du Conseil de janvier 1779 : Sa Majesté est informée qu'il vient tous les ans à la maison des Enfants-Trouvés de Paris plus de 2.000 enfants nés dans des provinces très éloignées de la capitale... Les enfants sont remis, sans précautions et dans toutes les saisons, à des voituriers publics, distraits par d'autres intérêts et obligés d'être longtemps en route ; de manière que ces malheureuses victimes de l'insensibilité de leurs parents souffrent tellement d'un pareil transport, que les neuf dixièmes périssent avant l'âge de trois mois. Souvent les enfants étaient transportés par le meneur, Mercier décrit ainsi dans le Tableau de Paris : C'est un homme qui apporte sur son dos les enfants nouveau-nés dans une boîte matelassée qui peut en contenir trois. Ils sont debout dans leur maillot, respirant l'air par en haut. L'homme ne s'arrête que pour prendre ses repas, et leur faire sucer un peu de lait. Quand il ouvre sa boîte il en trouve souvent un de mort ; il achève le voyage avec les deux autres, impatient de se débarrasser du dépôt. Arrivés aux Enfants-Trouvés, les enfants étaient quelquefois des semaines, des mois entiers sans nourrices, réunis en grand nombre dans les mêmes salles. Le muguet faisait parmi eux des ravages continuels. Confiés enfin à des nourrices — que l'hôpital avait grand'peine à trouver en nombre suffisant, — les enfants étaient emmenés à la campagne ; car, en raison de la mauvaise hygiène des hôpitaux de Paris, on avait renoncé à l'allaitement sur place. Ils y demeuraient jusqu'à leur sixième année. On voulut même les y faire rester après cet âge, en les plaçant chez des laboureurs, qui recevaient une indemnité, variable avec l’âge des enfants, et qui étaient exemptés de la milice. Mais les religieuses de l'Hôpital voulaient reprendre les pupilles ; en 1790 le Comité de mendicité constate : Les sœurs tendaient naturellement à ramener dans leurs maisons tout ce qui pouvait augmenter leur autorité et agrandir leur administration. Aussi le très petit nombre d'enfants qui survivaient étaient bientôt arrachés au service des champs. En les y conservant on aurait pu leur assurer des mœurs pures, une constitution robuste et saine ; on ne sait quel préjugé, qui leur faisait croire que, sous leurs yeux, ils seraient mieux instruits des principes de la religion, portait les administrateurs à les entasser dans les hôpitaux où, languissants, bientôt ils devenaient la proie de tous les genres de dépravations et d'infirmités. Beaucoup d'enfants continuèrent donc à revenir à Paris ;
les filles étaient réunies à Malgré toutes les mesures prises, la mortalité des enfants
était effroyable. Le duc de Les philanthropes, au temps de Louis XVI, se félicitèrent
du remède apporté à de grandes infirmités. L'abbé de l'Épée, s'il n'inventa
pas, propagea et perfectionna la méthode d'instruction des sourds-muets. Par
un arrêt du Conseil de novembre 1778, une partie des bâtiments de l'ancien
couvent des Célestins lui fut attribuée pour y installer un établissement,
qui devint, à partir de 1785, hospice permanent
d'éducation et d'enseignement pour les sourds-muets, et reçut une
dotation annuelle de Le devoir d'assistance fut donc compris, aimé et pratiqué
par les dernières générations de l'ancien régime. Les particuliers et le
Gouvernement se sont appliqués à le remplir. Le Gouvernement, si obéré qu'il
fût, fît une part assez considérable aux dépenses pour l'assistance publique.
En 1789, il dépensa |