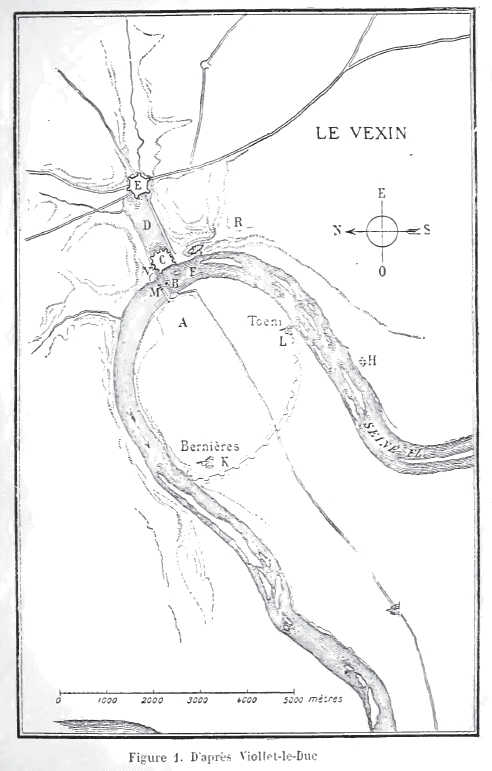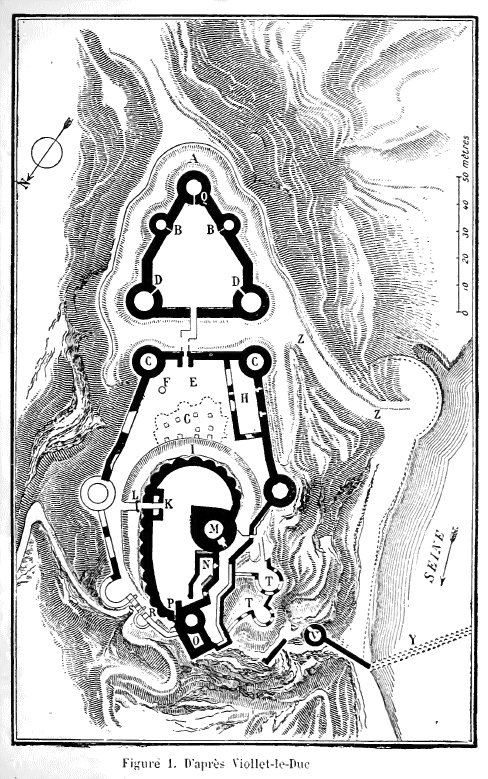HISTOIRE DU MOYEN-ÂGE
395-1270
CHAPITRE XI. — LA ROYAUTÉ FRANÇAISE.
|
PROGRAMME. — Les premiers rois capétiens. Le roi, sa cour, son domaine ; les grands vassaux. Louis VI. Louis VII et Philippe Auguste. Progrès du pouvoir royal ; extension du domaine. Le règne de saint Louis. BIBLIOGRAPHIE.L'histoire des premiers rois capétiens et des institutions monarchiques en France au XIe et au XIIe siècle a été faite d'une manière définitive par M. A. Luchaire : Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, 987-1180, Paris, 1891, 2e éd. — M. Luchaire a poussé l'histoire des institutions françaises jusqu'à la fin du XIIIe siècle dans son Manuel des institutions françaises. Période des Capétiens directs, Paris, 1892, in-8°. — Enfin il a publié une courte histoire de Philippe Auguste (Paris, s. d., in-16).Le règne capital de Philippe Auguste n'a pas encore été l'objet d'une monographie définitive, quoique l'histoire en soit aujourd'hui facile à faire. Les opuscules de MM. Williston Walker (On the increase of royal power in France under Philip Augustus, Leipzig, 1888, in-8°), R. Davidsohn (Philip II August von Frankreich und Ingeborg, Stuttgart, 1888. in-8°) et A. Cartellieri (L'avènement de Philippe Auguste, dans la Revue historique, 1893 et 1894), sont estimables.Sur le règne de Louis XIII : Ch. Petit-Dutaillis, Étude sur la vie et le règne de Louis VIII, Paris, 1895, in-8°.L'histoire du règne de Louis IX a été écrite par deux historiens consciencieux : F. Faure, Histoire de saint Louis, Paris, 1865, 2 vol. in-8° ; — H. Wallon, Saint Louis et son temps, Paris, 1875, 2 vol. in-8°. — Mais les derniers résultats de la science se trouvent dans des monographies, dont les plus recommandables sont : E. Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, Paris, 1870, in-8° — A. Molinier, Étude sur l'administration de Louis IX et d'Alphonse de Poitiers (1226-1271), dans l'Histoire générale de Languedoc (éd. Privat), VII, p. 462 ; — E. Boutaric, Marguerite de Provence, femme de saint Louis, Paris, 1868, in-8°, extr. de la Revue des questions historiques, t. III ; — R. Sternfeld, Karl von Anjou als Graf des Provence, Berlin, 1888, in-8° ; — P. Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, Paris, 1891, in-8° — É. Berger, Saint Louis et Innocent IV, étude sur les rapports de la France et du Saint-Siège, Paris, 1895, in-8° ; — le même, Histoire de Blanche de Castille, reine de France, Paris, 1895, in-8°.M. A. Lecoq de la Marche est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages de vulgarisation sur le règne de Louis IX : Saint Louis, son gouvernement et sa politique, Paris, 1887, in-8° ; — La France sous saint Louis, Paris [1894], in-8e ; — etc.***** I. — LOUIS LE GROS ET SA COUR. LES GARLANDE. — RAOUL DE VERMANDOIS. — SUGER.Louis VI, dont Suger vante la belle figure et la prestance élégante, tenait de son père sa haute taille et la forte corpulence à laquelle il doit son surnom de Gros, déjà populaire au XIIe siècle. Sa tendance à l'obésité, entretenue par un formidable appétit de chasseur, était sensible dès 1119, époque où Orderic Vital vit au concile de Reims ce grand et gros homme au teint blême, à la parole facile. Un chroniqueur anglais, fort malveillant du reste, raille cruellement Philippe et Louis, qui, dit-il, ont fait de leur ventre un dieu, et le plus funeste de tous. Le père et le fils ont tellement dévoré que la graisse les a perdus. Philippe en est mort, et Louis, quoique fort peu figé, n'est pas loin de subir le même sort. L'obésité devint en effet pour Louis, comme elle l'avait été pour Philippe, une insupportable maladie. À l'âge de quarante-six ans, il ne pouvait plus monter à cheval. Les excès de table contribuèrent peut-être, autant que les chaleurs torrides de l'été de 1137, à provoquer la dysenterie qui l'emporta. Il ne voulut se marier qu'à trente-cinq ans. Encore fallut-il que ses amis lui adressassent, pour l'amener à changer de vie et à s'engager dans des liens réguliers, les objurgations les plus pressantes. L'autorité du grave Ives de Chartres ne fut pas de trop pour le décider[1]. Tout en le félicitant d'avoir fixé son choix sur Adélaïde de Maurienne, le prélat l'invite, avec une certaine insistance, à mettre son projet à exécution. Gardez-vous bien, lui dit-il, de différer encore le moment de nouer le lien conjugal, pour que vos ennemis ne continuent pas de rire d'un dessein si souvent conçu et si souvent abandonné. Hâtez-vous ! qu'il naisse bientôt, celui qui doit rendre vaines les espérances des ambitieux et fixer sur une seule tête l'affection changeante de vos sujets. Louis donna pleine satisfaction à ce sage conseiller. La reine Adélaïde le rendit en peu de temps père de six fils et d'une fille. L'avenir de la dynastie était assuré. Louis le Gros aimait l'argent et subordonna trop souvent les intérêts de sa politique au désir de s'en procurer. Son avidité lui fit commettre, en 1106, alors qu'il n'était que roi désigné, une lourde faute politique qu'il dut regretter bien amèrement par la suite. Gagné par l'or du roi anglais, Henri Beauclerc, il le laissa réunir tranquillement le duché de Normandie à son royaume ; grave imprévoyance contre laquelle Philippe Ier, mieux avisé, essaya vainement de le mettre en garde. Plus d'une fois, sous son règne, on vit l'action de la justice royale suspendue, les coupables ayant trouvé le moyen de corrompre les palatins et le souverain lui-même. Mais rien n'égale le cynisme avec lequel, dans l'affaire de la charte communale de Laon, Louis le Gros, également sollicité par la commune et par l'évêque, vendit au dernier enchérisseur l'appui de l'autorité royale. Cette âpreté au gain s'explique peut-être par la disproportion fâcheuse qui commençait à exister entre les revenus domaniaux et le chiffre toujours croissant des dépenses d'ordre administratif et politique. On sait que Louis fut obligé de laisser en gage pendant dix ans un des plus précieux joyaux de la couronne, vendu plus tard à l'abbaye de Saint-Denis. Quoi qu'il en soit, la vénalité de la curie était un fait notoire, et Guibert de Nogent, tout en prodiguant l'éloge à Louis le Gros, n'hésitait point à le condamner sur. cet article. Excellent à tous autres points de vue, dit-il, ce prince avait le tort grave d'accorder sa confiance à des gens de basse condition et d'une cupidité sordide, ce qui nuisit beaucoup à ses intérêts comme à sa réputation et causa la perte de maintes personnes. Le chroniqueur Geoffroi de Courlon se faisait encore, à la fin du XIIIe siècle, l'écho de ces bruits défavorables : La même année, dit-il, mourut le roi Louis VI, connu pour sa cupidité ; il fit une tour à Paris et amassa de grands trésors. Il faut reconnaître néanmoins que, dans les jugements portés sur Louis par les contemporains, la somme du bien l'emporte sensiblement sur celle du mal. Ils sont unanimes à vanter sa douceur, son humanité, son affabilité pour tous et une sorte de candeur ou de bonhomie naturelle qu'ils appellent sa simplicité. Telle est l'expression dont se servent, comme par l'effet d'une entente préalable, ceux qui l'ont connu de plus près, Suger, Ives de Chartres et le chroniqueur de Morigni. Suger a même dit quelque part qu'il était débonnaire au delà de toute imagination. Aussi ce gros homme sans malice se laissa-t-il jouer quelquefois par des ennemis retors, comme Hugue du Puiset, à qui les perfidies et les parjures ne coûtaient rien. D'ordinaire la bonté va de pair avec la droiture. L'histoire a bien rarement signalé chez Louis cette tendance, fort commune au moyen âge, qui consiste à employer la ruse et la perfidie là où la force ouverte n'a plus chance de réussir. Sa simplicité naturelle le portait plutôt à frapper en face et à dédaigner les petits moyens. Il y avait en lui une loyauté instinctive qui fut particulièrement mise en lumière dans sa longue et pénible lutte avec la féodalité de l'Ile-de-France. On doit remarquer, en effet, qu'il n'y a pas une seule de ces campagnes dirigées souvent contre des ennemis dangereux et capables des plus noires trahisons, où Louis ne se soit astreint à observer les règles du droit féodal alors en vigueur, ce que Suger appelle la coutume des Français ou la loi salique. Ce représentant du principe et des intérêts monarchiques, plus respectueux des lois de la- féodalité que certains de ses grands vassaux, n'a jamais manqué, avant d'entreprendre une expédition, de sommer à plusieurs reprises, devant la cour de son père ou devant la sienne, le baron dont il fallait punir les méfaits. Toutes les guerres de Louis le Gros ont été ainsi précédées d'une action judiciaire ; pure question de forme, si l'on veut, en bien des cas, mais, avec des bandits comme lingue du Puiset ou Thomas de Marie, on pouvait savoir gré au roi de ne pas oublier les formes. Lorsque, en l'année 1109, Louis, sur le point d'en venir aux mains avec le roi d'Angleterre, envoya un héraut à son, rival pour lui reprocher d'avoir violé le droit et l'inviter à donner la satisfaction exigée par la coutume, le représentant du roi de France exprima fidèlement la pensée et les sentiments de son maitre, en ajoutant : Il est honteux, pour un roi, de transgresser la loi, parce que le roi et la loi puisent leur autorité à la même source. Louis le Gros eut la conscience d'avoir conformé ses actes à ses principes dans toutes les circonstances où il se trouva l'adversaire de la féodalité. Il attachait une telle importance à cette règle de conduite qu'en 1155, se croyant à la veille de sa mort, il se contenta de faire à son fils cette double recommandation qui comprenait sans doute toute sa morale et résumait pour lui les devoirs multiples de la royauté : protéger les clercs, les pauvres et les orphelins, en gardant à chacun son droit ; n'arrêter jamais un accusé dans la cour où on l'a sommé, à moins de flagrant délit commis en ce lieu même. Le premier précepte était essentiellement d'ordre monarchique, la royauté pouvant se définir un sacerdoce de justice et de paix exercé au profit du faible. Le second était d'ordre féodal ; il restreignait l'action du souverain, au bénéfice du vassal, en garantissant le baron coupable contre l'atteinte immédiate de la justice de son seigneur. Le roi qui, comme Louis le Gros, proclamait hautement ce principe et s'en inspirait, devait passer, aux yeux des contemporains, pour le type même de la loyauté et la vivante image du droit. Mais le trait le plus saillant de ce caractère chevaleresque, celui que Suger, dans son histoire, a mis en relief avec une préférence évidente et une singulière vigueur, c'est l'activité infatigable, la valeur bouillante que rien n'arrête, parfois aussi la folle témérité du soldat. Louis le Gros, en effet, fut, avant tout, un homme de guerre. Son rôle militaire l'absorba tout entier jusqu'au jour où. la victoire lui ayant laissé peu de chose à faire et les infirmités le saisissant, il se vit obligé de prendre enfin le repos qu'il n'avait jamais connu. Encore ne cessa-t-il de combattre que peu de temps avant sa mort ; c'est seulement en 1155 qu'il alla brûler son dernier château. Depuis longtemps déjà ses forces le trahissaient ; son embonpoint, nous l'avons dit, lui interdisait l'usage du cheval, mais il mettait une énergie incroyable à vouloir conduire en personne les expéditions les plus fatigantes. Vainement ses amis l'engageaient à rester tranquille, à faire simplement son devoir de chef d'État. Il ne pouvait s'y résigner et affrontait, au grand préjudice de sa santé, des intempéries et des obstacles qui faisaient reculer les jeunes gens. Envahi par l'obésité, presque incapable de se mouvoir, désespéré de ne plus satisfaire au besoin d'activité qui le dévorait, il disait, en gémissant, à ses intimes : Ah ! quelle misérable condition que la nôtre ; ne pouvoir jamais jouir en même temps de l'expérience et de la force ! Si j'avais su, étant jeune, si je pouvais, maintenant que je suis vieux, j'aurais dompté bien des empires. Ce regret peint l'homme tout entier. Jamais souverain du moyen âge ne paya plus directement et plus souvent de sa personne sur les champs de bataille. Louis le Gros, athlète incomparable et gladiateur éminent, comme dit Suger, avait l'orgueil de la force corporelle et de la valeur sûre de ses coups. Il aimait la guerre pour elle-même et y prenait une part aussi active que le dernier de ses soldats. Ses amis le blâmèrent plus d'une fois de sacrifier au plaisir de se battre son devoir de chef d'armée et le souci de la majesté royale. On le vit, au siège du château de Mouchi, emporté par l'ardeur de la lutte, pénétrer dans le donjon qui brûlait, au risque de périr dans le brasier, et en revenir, comme par miracle, avec une extinction de voix dont il ne guérit que longtemps après. Au passage de l'Indre, dans la campagne de 1108, c'est lui qui, le premier, se jeta dans la rivière, où il eut de l'eau jusqu'au casque, pour donner l'exemple à ses soldats et les lancer contre l'ennemi. Dans les guerres du Puiset, il combat toujours plus en soldat qu'en roi, s'enfonçant dans les rangs de ses adversaires, au mépris de toute prudence, et se prenant corps à corps avec ceux qui lui tombent sous la main. Ce hardi batailleur poussa un jour la naïveté jusqu'à proposer au roi d'Angleterre, Henri Ier, de vider leurs différends par un combat singulier. Le duel devait avoir lieu, en vue des deux armées, sur le pont vermoulu de l'Epte, qui sépare la France de la Normandie. L'Anglais ne répondit que par une raillerie à cette proposition trop chevaleresque. Tel était Louis le Gros, nature généreuse et sympathique, caractère essentiellement français, bien fait pour donner à la royauté capétienne le prestige moral qui lui avait fait défaut jusqu'ici. Cette mâle et vigoureuse figure de soldat se détache avec un relief saisissant à côté des physionomies indécises, à peine dessinées, des quatre premiers Capétiens. ***Au commencement du XIIe siècle, la puissance gouvernementale resta partagée, comme auparavant, entre les membres de la famille royale, les conseillers intimes ou palatins et l'assemblée des grands du royaume. Mais ce dernier organe allait, sous le règne de Louis le Gros, devenir de moins en moins important. C'est à cette époque, en effet, que l'autorité de fait, dans le gouvernement, tendit à être dévolue tout entière aux personnes de l'entourage immédiat du prince, à ses parents, à la haute domesticité investie des charges de la couronne, au cénacle obscur des clercs et des chevaliers qui constituaient la partie permanente de la curie. Les conseillers intimes qui entouraient le prince royal pendant sa désignation sont les mêmes qui ont souscrit pendant bien des années les diplômes émanés de Louis, roi titulaire : son précepteur, Hellouin de Paris ; des chambellans : Froger de Châlons, Ferri de Paris, Barthélemi de Montreuil, Henri le Lorrain ; des clercs : Aigrin d'Étampes, et, à la fin du règne, Thierri Galeran ; des chevaliers : Nivard de Poissi, Raoul le Délié, Barthélemi de Fourqueux. Mais les plus influents étaient sans contredit les frères de Garlande. La faveur de la famille de Garlande, son influence sur la personne royale et sur les affaires publiques, devait durer, avec certaines vicissitudes, jusqu'à la fin de ce règne si bien rempli. Elle fut entière et ne cessa de s'accroître pendant les vingt premières années. Ce fait s'explique par le caractère du prince, comme par les nécessités de sa situation. A peine avait-il commencé son règne définitif, qu'il se trouva en butte aux attaques d'une foule d'ennemis conjurés pour sa perte. Il lui fallut se défendre à la fois contre les membres de sa propre famille qui aspiraient, toujours à le remplacer, contre les rancunes de la maison de Rochefort, l'intraitable turbulence des seigneurs du Puiset, la haine persévérante du comte de Blois ; enfin contre l'inimitié traditionnelle du souverain anglo-normand. Au milieu de ces guerres presque quotidiennes, de ces périls sans cesse renaissants, la valeur guerrière d'Anseau et de Guillaume de Garlande, l'intelligence de leur frère Étienne lui rendirent d'inestimables services. Par intérêt, par reconnaissance et un peu aussi par faiblesse, il leur abandonna la direction suprême de la curie. Anseau conserva le commandement de l'armée jusqu'au jour où il périt glorieusement pour le service du roi, au troisième siège du Puiset, en 1118. Ce fut alors son frère. Guillaume qui le remplaça. Il était à la tête des troupes royales, en 1119, lors de la défaite de Brémule. Quant à Étienne, il avait reçu la charge de chancelier, qui pouvait seule convenir à un personnage ecclésiastique. A ce titre, il ne disposait pas seulement du sceau royal, il était encore le directeur du clergé attaché à la chapelle, et participait, dans une certaine mesure, à l'exercice de la puissance judiciaire. Tout s'abaissa bientôt devant le crédit des Garlande. Les autres familles de palatins qui avaient partagé la fortune du prince pendant la période de sa désignation durent céder à cette faveur sans précédents, quand elles n'eurent pas à en souffrir. La maison de Chaumont, en Vexin, touchait de fort près à Louis le Gros ; un de ses membres épousa même la fille naturelle de ce roi, nommée Isabelle. Aussi lingue de Chaumont demeura-t-il jusqu'à la fin du règne en possession de l'office de connétable. La famille de la Tour ou de Senlis, moins appuyée, fut moins heureuse. Elle perdit la bouteillerie en 1112, lorsque Gui de Senlis fut remplacé par Gilbert de Garlande. Trois des grands offices sur cinq se trouvèrent alors dévolus en même temps à la même maison, fait unique dans l'histoire du palais capétien. En 1120, il se passa quelque chose de plus extraordinaire encore. La mort de Guillaume de Garlande amena la vacance du dapiférat. Pour empêcher que cette charge importante ne sortit de la famille, le chancelier Etienne se fit nommer lui-même sénéchal et cumula les deux fonctions, ce qui ne s'était jamais vu, ce qu'on ne revit plus après lui. Un homme d'Église devenu le chef suprême de l'armée ! Cette étrange situation, prolongée pendant sept ans, donna la mesure de la faiblesse du roi et de l'audace du favori. L'ambition et la cupidité d'Étienne de Garlande ne connurent bientôt plus de limites. Comme chancelier et chapelain en chef, il se fit investir d'un grand nombre de bénéfices ecclésiastiques dans les églises et les abbayes qui dépendaient immédiatement de la couronne. On le vit, à la fois, chanoine d'Etampes, archidiacre de Notre-Dame de Paris, doyen de l'abbaye de Sainte-Geneviève, doyen de Saint-Samson et de Saint-Avit d'Orléans. Il voulut encore le décanat de l'église cathédrale d'Orléans ; pour le satisfaire, on donna l'évêché. de Laon au doyen Hugue. Il essaya même plusieurs fois d'arriver à l'épiscopat. Le gouvernement capétien soutint pendant deux ans une lutte des plus vives contre le pape et les partisans de la réforme pour lui assurer le siège de Beauvais. Étienne fit aussi une tentative infructueuse sur celui de Paris. En 1114, à la mort de Geoffroi, évêque de Beauvais, il osa demander qu'on transférât dans cet évêché l'évêque de Paris, Galon, afin de se faire nommer à sa place. Encore prétendait-il, une fois investi de la dignité épiscopale, rester en possession de ses nombreux bénéfices. Cette fois, la mesure était comble ; le pape Pascal II refusa d'accueillir sa requête. Étienne n'en restait pas moins le second personnage du royaume, celui dont la volonté régissait la France entière et qui paraissait moins servir le roi que le gouverner, suivant l'expression décisive du chroniqueur de Morigni. Cette fortune insolente ne pouvait manquer d'exciter l'envie et de soulever la haine. Étienne s'était fait de nombreux ennemis au palais, dans l'entourage même du roi, comme au dehors, parmi les évêques et lès abbés que scandalisait sa conduite. Mais les plus dangereux pour lui se trouvaient dans la famille royale. Elle ne pouvait lui pardonner l'influence sans bornes dont il jouissait auprès de Louis le Gros. Lorsque le roi eut épousé, en 1115, Adélaïde de Maurienne, le crédit du chancelier cessa d'être aussi solide qu'auparavant. Il avait maintenant une rivale. La reine ne tarda pas à prendre sur son mari l'ascendant que lui assurèrent sa conduite, toujours irréprochable, et son heureuse fécondité. Son pouvoir augmenta encore en 1119, lorsque l'avènement de l'archevêque de Vienne, Gui, au trône pontifical fit d'elle la propre nièce du pape. Étienne de Garlande n'eut pas la souplesse et la prévoyance nécessaires pour se concilier les bonnes grâces d'une personne que sa situation rendait impossible à écarter. Loin de ménager la reine, il se plut, au contraire, à l'irriter par des tracasseries multipliées. Les occasions de conflit entre ces deux puissances rivales durent être nombreuses, bien que l'histoire soit restée muette sur ces incidents. L'inimitié d'une partie du clergé rendait sa situation encore plus difficile. Comme archidiacre de Notre-Dame, il se trouvait sans cesse en conflit avec l'évêque de Paris, Étienne de Senlis, membre de cette même famille de palatins qui avait été une des premières victimes de l'avènement des Garlande. A cette époque, l'état de guerre tendait à devenir presque normal entre les archidiacres et les chefs des diocèses. Bien que le nom d'Étienne de Garlande ne soit pas mentionné dans les documents relatifs à la querelle de l'évêque de Paris avec l'archidiacre Thibaud Notier, nul doute que le tout-puissant chancelier n'ait joué un rôle prépondérant dans cette affaire, comme dans toutes les circonstances où il s'agissait de diminuer l'autorité épiscopale. C'est lui qui soutint contre l'évêque les prétentions de Galon, le maitre des écoles parisiennes ; c'est lui qui, en s'opposant à l'introduction des principes réformistes dans le diocèse et des chanoines de Saint-Victor dans la cathédrale, amena la crise aiguë d'où sortirent l'expulsion d'Étienne de Senlis, l'interdit jeté sur l'évêché de Paris et la menace d'excommunication lancée contre Louis le Gros. Sous son influence, la politique ecclésiastique du prince se dessina nettement dans un sens anti-réformiste. Étienne devint le défenseur naturel de tous ceux qui, se disant opprimés par les doctrines nouvelles, essayaient de se soustraire à la règle. Lorsqu'en 1122 Abailard voulut abandonner l'abbaye de Saint-Denis, où ses supérieurs entendaient le retenir contre sa volonté, il n'eut rien de plus pressé que de s'adresser au roi et à son conseil. Étienne de Garlande représenta à Suger qu'en essayant de garder malgré lui un homme tel qu'Abailard, il s'exposait à un scandale, sans aucun profit pour sa communauté. Une transaction fut conclue en présence du roi et de son ministre. Abailard obtint le droit de choisir le lieu de sa retraite. mais sous la promesse de rester attaché à Saint-Denis et de n'appartenir à aucun autre monastère. L'attitude du chancelier devait lui attirer. on le conçoit, les malédictions et les colères de tous ceux, évêques et abbés, qui dirigeaient le mouvement réformiste. Dès l'année 1101, Ives de Chartres, voulant l'empêcher d'arriver à l'évêché de Beauvais, dépeignait à Pascal II, sous les couleurs les plus noires, ce clerc illettré, joueur, coureur de femmes, qui n'avait pas même le grade de sous-diacre et qui, jadis, s'était vu excommunier par l'archevêque de Lyon pour adultère notoire. Le portrait était sans doute un peu chargé, car Ives lui-même se crut obligé, quelque temps après, dans une nouvelle lettre au pape, de recommander le candidat qu'il avait si violemment attaqué. Mais saint Bernard était plus logique. Son éloquente indignation, qui ne ménageait ni rois ni papes, dénonça à la chrétienté le spectacle scandaleux donné par cet archidiacre-sénéchal, antithèse vivante, personnage à double face, qui sert à la fois Dieu et le diable, revêt en même temps l'armure et l'étole, porte les mets à la table du roi et célèbre les saints offices, convoque les soldats au son du clairon et transmet au peuple les ordres de l'évêque. Ce qui révolte surtout l'abbé de Clairvaux, c'est que ce diacre, plus chargé d'honneurs ecclésiastiques que ne le tolèrent les canons, est infiniment moins attaché à ses fonctions spirituelles qu'à son service de cour, aux choses du ciel qu'aux choses de la terre. Il se glorifie avant tout de son titre de sénéchal ; mais ce qui lui plaît dans cette charge, ce n'est pas la besogne du soldat, c'est la pompe du commandement ; de même que ce qui lui tient le plus au cœur dans ses fonctions ecclésiastiques, ce sont les profits qu'il en retire. Peut-on comprendre que le roi garde ce clerc efféminé dans la curie, et que l'Église ne rejette pas de son sein ce soldat qui la déshonore ? Le mécontentement du parti réformiste n'aurait sans doute pas suffi pour rompre les liens d'amitié et de longue habitude qui unissaient le roi à son favori. Une grave imprudence d'Étienne de Garlande amena la révolution de palais que préparait depuis longtemps la reine Adélaïde et que semblait avoir prévue saint Bernard (1127). Comme tous les sénéchaux de France, ses prédécesseurs, comme tous les grands officiers de la couronne, en général, Étienne, qui avait reçu le dapiférat des mains de ses deux frères, ne songeait qu'à retenir cette charge dans sa famille. Ne pouvant avoir lui-même d'héritier, il donna sa nièce en mariage à Amauri IV, seigneur de Montfort et comte d'Évreux, un des barons qui avaient rendu le plus de services à Louis le Gros dans ses dernières guerres avec les Anglo-Normands. Le neveu du chancelier reçut, avec le château de Rochefort, que lui apportait sa femme, l'assurance de la future succession au dapiférat. Le roi ne fut évidemment pas consulté. La situation était des plus graves. Louis VI pouvait-il admettre qu'on disposât ainsi, sans son assentiment, de la plus haute dignité de la couronne, et laisserait-il consacrer bénévolement le principe de la transmission héréditaire des grands offices ? N'était-il pas temps de réagir contre une tendance qui devait aboutir à rendre la royauté esclave de ses hauts fonctionnaires et à faire des palatins les maitres absolus du palais ? Inquiet de l'ambition de son favori, poussé par la reine et par le clergé, Louis le Gros se décida cette fois à déployer une énergie dont il n'était pas coutumier quand il s'agissait des affaires de sa cour. Il lit un véritable coup d'État. Dépouillé de ses fonctions de sénéchal et de chancelier, Étienne fut chassé du palais. On le remplaça presque aussitôt à la chancellerie, mais non au dapiférat, qui devait rester vacant pendant plusieurs années. Son frère Gilbert partagea son sort, et la famille de Senlis rentra en possession de la bouteillerie. lin ordre de la reine prescrivit la destruction de toutes les maisons qu'Étienne avait fait bâtir à Paris avec grand luxe. Ses vignes furent arrachées. On le traitait en ennemi public. Cependant, Étienne de Garlande n'était pas homme à tomber en silence, avec la résignation du sage. Le coup d'État de Louis le Gros eut pour résultat la guerre civile, guerre obscure et mal connue, qui dura au moins trois ans, de 1128 à 1130. Étienne et Amauri de Montfort n'avaient pas hésité à conclure alliance avec les pires ennemis du roi, Henri Ter et Thibaud IV Louis, soutenu seulement par son cousin, le comte de Vermandois, Raoul, vint assiéger en personne une des forteresses de la maison de Garlande, Livri en Brie. Grâce à de fréquents assauts et à la supériorité de ses machines de guerre, il finit par emporter la place, qu'il détruisit de fond en comble. Mais il paya cher sa victoire. Raoul de Vermandois y perdit un œil et lui-même eut la jambe percée d'un trait d'arbalète, blessure qu'il supporta avec ce courage stoïque dont il avait déjà tant de fois donné la preuve. La crise que traversait la royauté était alors d'autant plus grave que, tout en faisant la guerre à son sénéchal, le roi se trouvait également au plus fort de sa lutte avec l'évêque de Paris et avec le clergé réformiste. Aussi jugea-t-il nécessaire de profiter d'un moment d'accalmie pour consolider son trône ébranlé par tant de secousses et assurer sa dynastie contre les dangers qu'il prévoyait encore. Le jour de Pâques 1129, son fils aîné, Philippe, âgé de treize ans, jeune homme de haute mine et de grande espérance, fut sacré à Reims et associé à la couronne. C'était la meilleure réponse que put faire Louis le Gros aux attaques de toute nature dont son pouvoir était l'objet. Étienne de Garlande ne tarda pas à perdre l'espoir, dont il s'était flatté, d'intéresser la nation entière à sa fortune. Il fut obligé de s'humilier, et, pour rentrer en grâce auprès du souverain, de recourir à l'intervention de cette même reine qui avait tant contribué à sa chute. Mais il lui fallut abandonner toute prétention au dapiférat et à la propriété héréditaire de cet office. Son complice, Amauri de Montfort, devait continuer plus longtemps la résistance. Lorsque, par l'entremise d'Adélaïde et du jeune roi Philippe, la réconciliation d'Étienne avec Louis le Gros fut un fait accompli, le roi, en qui survivait une affection mal éteinte pour la famille de Garlande, montra à l'égard de son ex-ministre une mansuétude peut-être excessive. Ne pouvant lui restituer le titre de sénéchal, il ne craignit pas de le rétablir dans sa fonction de chancelier (1132) et la lui conserva jusqu'à la fin de son règne. Il est vrai qu'à partir de cette époque Etienne n'apparaît plus guère dans l'histoire que comme signataire des diplômes royaux. Son rôle politique est fini ; l'influence et le pouvoir ont passé à d'autres mains. A la mort de Louis le Gros, le sceau royal lui sera enlevé pour être donné au vice-chancelier Aigrin. Le tout-puissant favori, l'homme qui avait tenu tête au roi et 'a l'Église, disparaîtra complètement de la scène, où il avait occupé la première place. La révolution de palais qui mit fin à la domination d'Étienne de Garlande marque une date décisive dans l'histoire intérieure du règne. D'une part, on ne verra plus se renouveler les convulsions politiques et, les luttes intestines auxquelles avait donné lieu jusqu'ici la question toujours brûlante de l'hérédité des grands offices. L'esprit féodal était vaincu sur ce terrain, comme il l'était aussi, d'une autre manière, par l'activité militaire de Louis VI. La royauté, désormais maîtresse de son palais, ne sera plus obligée de confier à des châtelains, plus ou moins ennemis de ses intérêts, les hautes charges de la couronne. Elle ne luttera plus avec eux pour en conserver la propriété. Si elle laisse ces offices se perpétuer dans la même famille, c'est qu'elle le voudra bien, et que les détenteurs ne lui causeront aucune inquiétude ; mais elle le voudra rarement. Tantôt l'office restera vacant ; tantôt il sera dépouillé des pouvoirs effectifs qui y sont joints pour être conféré, à titre purement honorifique, aux grands vassaux de la couronne. A cet égard, Louis le Gros fonda les traditions monarchiques que devaient suivre ses successeurs. Le plus dangereux de ces grands offices, le dapiférat, resta vacant pendant quatre ans, de 1127 à 1151. Ce n'est pas seulement l'organisation du palais qui fut modifiée au profit du pouvoir royal. De nouvelles influences se firent jour ; le personnel dirigeant se renouvela et la politique du souverain prit une orientation- un peu différente. Pendant les dix dernières années du règne, le gouvernement de Louis V1 se montre sensiblement mieux pondéré ; ses actes sont plus réfléchis et plus logiques ; il ne cède plus aussi souvent aux suggestions de la colère ou à l'appât du gain. Les mesures qui sont prises durant cette période portent la marque d'une volonté plus maîtresse d'elle-même et de ses instruments, mieux éclairée sur les véritables intérêts de la monarchie et aussi plus soucieuse de la morale et de la dignité du trône. Ce changement est dû en partie, sans aucun doute, à l'effet naturel de l'âge sur le tempérament et le caractère du prince. Mais il est certain aussi qu'il fut l'œuvre des conseillers et des collaborateurs que Louis le Gros s'adjoignit après la crise où sombra l'ambition des Garlande. A partir de 1128, la haute direction de la politique royale appartint surtout à deux personnages qui n'avaient jusqu'ici figuré qu'au second rang, le comte de Vermandois, Raoul, et l'abbé de Saint-Denis, Suger. L'influence du premier se manifesta en tout ce qui concernait les affaires militaires. Bien que le génie politique du second se soit surtout donné carrière sous le règne de Louis VII, on sait qu'il a pris une part considérable aux événements des dernières années de Louis le Gros. ***Raoul de Vermandois, qui remplaça Étienne de Garlande comme chef de l'armée, était, ce qu'on appellera plus tard e un prince du sang e, le propre cousin du roi. Il avait donné depuis longtemps des preuves de son dévouement à la cause royale. Jeune encore, il était venu combattre à côté de son cousin pendant la seconde guerre du Puiset. Quand l'invasion allemande menaça le territoire français, il accourut avec les contingents aguerris que fournissait le territoire de Saint-Quentin, et commanda le corps d'armée où se trouvaient les chevaliers du Ponthieu, de l'Amiénois et du Beauvaisis. Ce Capétien de la branche cadette était, par l'importance de son fief comme par son intrépidité personnelle, un des plus fermes soutiens de la dynastie. Par la situation même de son fief, il était l'ennemi naturel des maisons de Champagne et de Couci ; or, c'est précisément contre ces deux familles que se portèrent les derniers efforts de Louis le Gros. Au dire de Suger, ce fut l'influence prépondérante de Raoul qui détermina le roi à aller forcer dans son repaire le trop fameux Thomas de Marie (1130). Le comte de Vermandois se donna le plaisir de porter le coup mortel à l'ennemi héréditaire de sa maison et de le jeter enchaîné aux pieds du souverain. Deux ans après, une nouvelle expédition, décidée sans doute aussi sur le conseil de Raoul, menaçait le fils de Thomas de Marie, Enguerran de Couci. Louis assiégea la Fère pendant plus de deux mois sans pouvoir s'en rendre maître. A la fin, le comte de Vermandois consentit à un accord qui rétablissait la paix dans ce pays si longtemps troublé. La guerre de 1132 se termina par le mariage d'Enguerran de Couci avec la nièce du sénéchal, singulière issue d'une entreprise militaire qui semblait destinée à satisfaire les intérêts du Vermandois autant que ceux de la monarchie. ***Les services que Suger rendit à Louis le Gros pendant la majeure partie de son règne étaient plus désintéressés. L'homme d'État, que deux rois de France honorèrent du nom d'ami et qui gouverna seul le royaume pendant la seconde croisade, a été naturellement l'objet d'un grand nombre de biographies. Mais ce sont moins des biographies que des éloges composés sans critique et chargés de détails de fantaisie. Il reste à écrire un livre digne de cette grande figure dans laquelle semblent s'être incarnés les qualités séduisantes et le bon sens de notre génie national. On trouve en Suger le plus frappant exemple de ce que peut obtenir une volonté persévérante mise au service d'une intelligence supérieure. Ce petit homme au corps malingre et chétif, d'une santé toujours fragile, était issu de basse extraction, et ne dut sa fortune qu'à lui-même. Il avait l'esprit vif, la parole imagée et prompte, une mémoire extraordinaire qui lui permettait de recueillir sans effort les souvenirs littéraires, les faits historiques, les anecdotes, en même temps que les mille détails des affaires confiées à ses soins. Mais il jouissait d'une faculté précieuse, celle de discerner sur-le-champ les idées et les faits qu'il pouvait lui être utile de retenir, et de s'en servir avec précision au moment voulu. Les contemporains ont surtout admiré la facilité de sa parole, cette faconde intarissable et brillante qui le faisait assimiler à Cicéron. Causeur infatigable, il lui arrivait parfois de garder ses auditeurs jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il était par excellence l'avocat de la cour de Louis le Gros, c'est le titre que lui donne la chronique de Morigni. Chargé d'exposer au roi les plaintes des églises, de lui présenter les suppliques des pauvres, des veuves et des orphelins, il semble avoir joué au palais le double rôle de maitre des requêtes et de procureur du roi, magistratures qui n'apparaîtront formellement que plus tard dans les institutions capétiennes. Il écrivait d'ailleurs, parait-il, presque aussi facilement qu'il parlait, et ceux qui Font connu ne tarissent pas d'éloges sur sa science littéraire et sur l'éclat de son style. A vrai dire, le latin de la Vie de Louis le Gros, moins banal et moins plat que celui de la plupart des écrivains monastiques, se distingue surtout par l'obscurité, le mauvais goût et l'incorrection. On y sent cependant une certaine vigueur d'esprit, et je ne sais quelle flamme intérieure qui n'est point le fait d'une âme vulgaire. Les qualités maîtresses de Suger, celles qui firent de lui le ministre nécessaire et considéré même de ses ennemis, sont précisément celles que vantent le moins ses contemporains : une grande capacité de travail, la connaissance intime des hommes et des choses, le sens pratique, une fermeté inébranlable jointe à une judicieuse modération. Il est assez difficile de mesurer avec exactitude l'influence exercée par le célèbre abbé sur le gouvernement de Louis le Gros. Le moine Guillaume, biographe, ou plutôt panégyriste de Suger, ne retrace avec quelque détail la vie politique de son héros que lorsqu'il s'agit du règne de Louis le Jeune et surtout de l'époque de la régence. Il faut donc recourir à Suger lui-même et à sa principale œuvre historique. Mais on sait que l'auteur de la Vie de Louis le Gros a choisi, parmi les événements du règne, ceux qui étaient le plus propres à mettre en relief le courage et la magnanimité du roi. Il est fort incomplet en ce qui concerne l'histoire intérieure de la curie, et les détails les plus intéressants qu'il donne sur son rôle personnel se rapportent justement à la période des guerres du Puiset, pendant laquelle il ne faisait pas encore partie, à titre permanent, du conseil royal. C'est surtout à dater de la chute des Garlande qu'il importerait de connaître la part prise par l'abbé de Saint-Denis aux affaires publiques. Mais c'est alors qu'il s'efface le plus et se confond à dessein, par une modestie sans doute exagérée, dans le groupe des amis et familiers à qui le souverain venait demander ses meilleures inspirations. Quant aux autres chroniqueurs, français ou étrangers, ils sont muets sur le rôle politique de Suger et semblent le connaître encore moins qu'Étienne de Garlande. On chercherait vainement le nom de l'abbé de Saint-Denis dans l'histoire d'Orderic Vital. Les premiers rapports de Louis le Gros et de Suger datent probablement de l'époque où tous deux vivaient, comme écoliers, dans la grande abbaye capétienne. Aucun texte ne nous renseigne, d'ailleurs, sur leur intimité d'enfance, et tout ce qu'on a dit de Suger à la cour de Philippe Ier est fondé sur l'unique passage où il affirme avoir entendu le souverain maudire devant son fils le donjon de Montlhéry. S'il assista en 1106 au concile de Poitiers, en 1107 à la dédicace de l'église de la Charité et à l'assemblée de Châlons, présidée par Pascal II, ce fut comme orateur de l'abbaye de Saint-Denis, comme assesseur de son abbé, Adam, et nullement comme chargé d'affaires de la royauté. Ses fonctions de prévôt de Berneval, terre abbatiale relevant du roi d'Angleterre, puis de prévôt de Touri, en Beauce, le tenaient éloigné du palais, où son nom n'apparait jamais à cette époque parmi ceux des souscripteurs ou des témoins des diplômes royaux. Le rôle qu'il joua auprès du roi pendant les guerres du Puiset s'explique naturellement par sa situation d'administrateur et de défenseur des territoires que l'abbaye possédait. en Beauce. Ce n'est qu'en 1118 que Suger paraît avoir été pour la première fois chargé d'une mission diplomatique par le gouvernement de Louis le Gros. Il reçut l'ordre de se rendre à Maguelone pour souhaiter la bienvenue au pape Gélase II. Le roi l'employa dès lors constamment dans toutes les circonstances où il fallut entrer en rapport avec les différents pontifes qui se succédèrent sur le trône de saint Pierre. Mais il faut noter que ce rôle de négociateur des affaires ecclésiastiques et d'ambassadeur auprès du Saint-Siège ne fut pas dévolu exclusivement à l'abbé de Saint-Denis. Louis le Gros délégua aussi dans cet office les chefs des grandes communautés parisiennes, les abbés de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor, de Saint-Magloire, le prieur de Saint-Martin-des-Champs. Lorsqu'en 1122 Suger eut été élu comme abbé sans que les électeurs eussent requis au préalable l'agrément du roi, le nouveau dignitaire put craindre que ce procédé n'attirât sur lui-même et sur l'abbaye les persécutions du pouvoir laïque. Il en fut quitte pour la peur ; l'amitié, ici, fut plus forte que les nécessités de la politique. En venant prendre l'oriflamme sur l'autel de Saint-Denis, pour aller ensuite repousser l'invasion allemande (1124), le roi eut soin d'indiquer, dans l'acte solennel dressé à cette occasion, qu'il avait reçu l'étendard sacré des mains de Suger, son familier et son fidèle conseiller. C'est le premier témoignage direct et officiel qui nous soit connu de la part faite à l'abbé de Saint-Denis dans l'amitié du roi et le maniement de la chose publique. Il n'en résulte pas qu'il occupât dès lors au palais le rang auquel devaient l'appeler par la suite son expérience des affaires et la confiance particulière qu'il inspirait au souverain. La direction de la curie appartenait encore pour quelques années à Étienne de Garlande. Quoiqu'il y eût peu de ressemblance entre ces deux hommes, il faut bien admettre, sur la foi de saint Bernard, que Suger était depuis longtemps l'ami du sénéchal-archidiacre. Cette amitié ne lui était pas seulement commandée par le souci de sa carrière politique. L'abbé de Saint-Denis partageait les idées de Louis et d'Étienne sur la nécessité de maintenir le clergé capétien dans la dépendance de l'autorité royale. Sa modération d'esprit et son attachement au principe monarchique l'empêchaient d'accepter, au moins dans leurs conséquences extrêmes, les doctrines du parti réformiste. C'est ce que prouvent les attaques assez vives dont il fut l'objet de la part de saint Bernard et le retard qu'il mit à introduire la réforme dans la communauté de Saint-Denis. Il céda, sans enthousiasme, au mouvement que dirigeait la papauté et que favorisait l'opinion. Quand le panégyriste de Suger affirme qu'il n'y avait rien de caché pour lui dans le gouvernement, que le roi ne prenait aucune décision sans l'avoir consulté et qu'en son absence le palais semblait être vide, ces paroles ne peuvent s'appliquer qu'à la période finale du règne de Louis le Gros (1130-1137). C'est alors seulement, en effet, que la présence continue de Suger au palais est attestée par les souscriptions des chartes royales. Lui-même, d'ailleurs, se met en scène — mais toujours en compagnie des autres conseillers intimes — dans les circonstances importantes de la vie de son héros. En 1151, après la mort du jeune prince Philippe, il engage le roi à faire couronner par anticipation son second fils Louis, âgé de onze ans. Quatre ans après, on le voit pleurant au chevet de son royal ami, qui, épuisé par une cruelle maladie, croyait être à son dernier jour, et lui adressait ses recommandations suprêmes. L'influence prépondérante de l'abbé de Saint-Denis fut surtout marquée, pendant cette période, par la réconciliation de Louis le Gros avec le comte Thibaud de Champagne. Ce dernier, jusqu'ici ennemi acharné de la dynastie régnante, venait de perdre son meilleur soutien en la personne de son oncle, le roi d'Angleterre, Henri Ier. Comme il aspirait à le remplacer sur le trône ducal de Normandie, il lui fallait l'appui du roi de France. Suger, pour qui le roi anglais et son neveu avaient toujours professé une considération particulière, facilita le rapprochement, et crut faire acte de sage prévoyance en ramenant le grand fief de Blois-Champagne dans le cercle de l'alliance capétienne. C'était un événement politique de la plus haute importance, car il garantissait à Louis le Gros la tranquillité de ses dernières années et lui permit d'accomplir en paix l'acte qui était le digne couronnement de sa glorieuse carrière, l'union du duché d'Aquitaine au domaine royal. Lorsqu'en juillet 1157 Louis le Jeune s'achemina, avec un brillant cortège, vers les rives de la Garonne où l'attendait l'héritière des pays aquitains, les meilleurs amis de Louis le Gros et les plus influents des palatins faisaient partie de l'expédition : le sénéchal Raoul de Vermandois, Guillaume Ier, comte de Nevers ; Rotrou, comte du Perche ; le comte palatin, Thibaud de Champagne ; Suger lui-même, et son ami, Geoffroi de Lèves, évêque de Chartres. C'était le conseil royal qui se déplaçait dans la personne des plus éminents de ses membres pour faire honneur aux populations du Midi et les amener à subir sans secousses et sans amertume la domination du roi du Nord. Louis le Gros, resté presque seul au palais, fit ses adieux à ce fils qui ne devait plus le revoir : Que le Dieu tout-puissant, par qui règnent les rois, te protège, mon cher enfant, car, si la fatalité voulait que vous me fussiez enlevés, toi et les compagnons bue je t'ai donnés, rien ne me rattacherait plus à la royauté ni à la vie. Le vieux souverain avait raison. Pour la première fois, depuis la fondation de la dynastie, on avait vu se former et se grouper autour du prince un personnel de serviteurs- intelligents, actifs et dévoués aux institutions monarchiques. Louis le Gros léguait à son fils, en même temps que Suger et Raoul de Vermandois, des clercs expérimentés, déjà au courant des affaires de justice et de finances, et des chevaliers toujours prêts à se ranger sous la bannière du maitre. Les grands offices étaient entre les mains de familles paisibles, dont la fidélité et l'obéissance ne faisaient plus doute. La curie, débarrassée dès éléments féodaux qui la troublaient, offrait enfin à la royauté l'instrument de pouvoir qui lui avait fait défaut jusqu'ici. On peut dire que le gouvernement capétien était fondé. A. LUCHAIRE, Loris VI le Gros. Annales de sa vie et de son règne, Paris, A. Picard, 1889, in-8°. Introduction, passim. II. — GUERRES DE PHILIPPE AUGUSTE. I. -- LE SIÈGE DU CHÂTEAU GAILLARD.Bâti par Richard Cœur de Lion, après que ce prince eut reconnu la faute qu'il avait faite, par le traité d'Issoudun, en laissant à Philippe Auguste le Vexin et la ville de Gisors, le château Gaillard, près les Andelys, conserve encore, malgré son état de ruine, l'empreinte du génie militaire du roi anglo-normand. Grâce à l'excellent travail de M. A. Deville[2], chacun peut se rendre un compte exact des circonstances qui déterminèrent la construction de cette forteresse, la clé de la Normandie, place frontière capable d'arrêter longtemps l'exécution des projets ambitieux du roi français.... De Bonnières à Gaillon, la Seine descend presque en ligne droite vers le nord-nord-ouest. Près de Gaillon, elle se détourne brusquement vers le nord-est jusqu'aux Andelys, puis revient sur elle-même et forme une presqu'île dont la gorge n'a guère que 9.600 mètres d'ouverture. Les Français, par le traité qui suivit la conférence d'Issoudun, possédaient sur la rive gauche Vernon, Gaillon, Pacy-sur-Eure ; sur la rive droite, Gisors, qui était une des places les plus fortes de cette partie de la France. Une armée dont les corps, réunis à Evreux, à Vernon et à Gisors, se seraient simultanément portés sur Rouen, le long de la Seine, en se faisant suivre d'une flottille, pouvait, en deux jours de marche, investir la capitale de la Normandie et s'approvisionner de toutes choses par la Seine. Planter une forteresse à cheval sur le fleuve, entre les deux places de Vernon et de Gisors, en face d'une presqu'île facile à garder, c'était intercepter la navigation du fleuve, couper les deux corps d'invasion.... La position était donc, dans des circonstances aussi défavorables que celle où se trouvait Richard, parfaitement choisie....
Voici comment le roi anglo-normand disposa l'ensemble des défenses de ce point stratégique (fig. ci-dessus). A l'extrémité de la presqu'île de Bernières, du côté de la rive droite, la Seine côtoie des escarpements de roches crayeuses fort élevées qui dominent toute la plaine d'alluvion. Sur un îlot B qui divise le fleuve, Richard éleva d'abord un fort octogone muni de tours, de fossés et de palissades ; un pont de bois passant à travers ce châtelet unit les deux rives. A l'extrémité de ce pont, en C, sur la rive droite, il bâtit une enceinte, large tête de pont qui fi ; bientôt remplie d'habitations et prit le nom de Petit-Andely. Un étang, formé par la retenue des eaux de deux ruisseaux en D, isola complètement cette tête de pont. Le grand Andely E, qui existait déjà avant ces travaux, fut également fortifié, enclos de fossés que l'on voit encore et qui sont remplis par les eaux des deux ruisseaux. Sur un promontoire élevé de plus de cent mètres au-dessus du niveau de la Seine, et qui ne se relie à la chaine crayeuse que par une mince langue de terre du côté sud, la forteresse principale fut assise en profitant de toutes les saillies du rocher. En bas de l'escarpement, et enfilée par le château, une estacade F, composée de trois rangées de pieux. vint barrer le cours de la Seine. Cette estacade était en outre protégée par des ouvrages palissadés établis sur le bord de la rive droite et par un mur descendant d'une tour bâtie à mi-côte jusqu'au fleuve ; de plus, en amont, et comme une vedette du côté de la France, un fort fut bâti sur le bord de la Seine en H, et prit le nom de Boutavant. La presqu'ile retranchée à la gorge et gardée, il était impossible à une armée ennemie de trouver l'assiette d'un campement sur un terrain raviné, couvert de roches énormes. Le val situé entre les deux Andelys, rempli par les eaux abondantes des ruisseaux, commandé par les fortifications des deux bourgs situés à chacune de ses extrémités, dominé par la forteresse, ne pouvait être occupé, non plus que les rampes des coteaux environnants. Ces dispositions générales prises avec autant d'habileté que de promptitude, Richard apporta tous ses soins à la construction de la forteresse principale qui devait commander l'ensemble des défenses. Placée, comme nous l'avons dit, à l'extrémité d'un promontoire dont les escarpements sont très abrupts, elle n'était accessible que par cette langue de terre qui réunit le plateau extrême à la chaîne crayeuse ; toute l'attention de Richard se porta d'abord de ce côté attaquable.
Voici quelle fut la disposition de ses défenses. En A (fig. ci-dessus), en face de la langue de terre qui réunit l'assiette du château à la hauteur voisine, il fit creuser un fossé profond dans le roc vif et bâtit une forte et haute tour dont les parapets atteignaient le niveau du plateau dominant, afin de commander le sommet du coteau. Cette tour fut flanquée de deux autres plus petites B ; les courtines AD vont en dévalant et suivent la pente naturelle du rocher ; la tour A commandait donc tout l'ouvrage avancé ADD. Un second fossé, également creusé dans le roc, sépare cet ouvrage avancé du corps de la place. L'ennemi ne pouvait songer à se loger dans ce second fossé qui était enfilé et dominé par les quatre tours DDCC. Les deux tours CC commandaient certainement les deux tours DD. On observera que l'ouvrage avancé ne communiquait pas avec les dehors, mais seulement avec la basse-cour du château. C'était là une disposition toute normande que nous retrouvons à la Roche-Guyon. La première enceinte E du château, en arrière de l'ouvrage avancé et ne communiquant avec lui que par un pont de bois, contenait les écuries, des communs et la chapelle H ; c'était la basse-cour. Un puits était creusé en F ; sous l'aire de la cour, en G, sont taillées dans le roc de vastes caves, dont le plafond est soutenu par des piliers de réserve ; ces caves prennent jour dans le fossé I du château et communiquent, par deux boyaux creusés dans la craie, avec les dehors. En K s'ouvre la porte du château ; son seuil est élevé de plus de deux mètres au-dessus de la contrescarpe du fossé L. Cette porte est masquée pour l'ennemi qui se serait emparé de la première porte E, et il ne pouvait venir l'attaquer qu'en prêtant le flanc à la courtine IL et le dos à la tour plantée devant cette porte. De plus, du temps de Richard, un ouvrage posé sur un massif réservé dans le roc, au milieu du fossé, couvrait la porte K, qui était encore fermée par une herse, des vantaux et protégée par deux réduits ou postes. Le donjon M s'élevait en face de l'entrée K et l'enfilait. Les appartements du commandant étaient disposés du côté de l'escarpement, en N, c'est-à-dire vers la partie du château où l'on pouvait négliger la défense rapprochée et ouvrir des fenêtres. En P est une poterne de secours, bien masquée et protégée par une forte défense O. Cette poterne ne s'ouvre pas directement sur les dehors, mais sur le chemin de ronde R percé d'une seconde poterne en S qui était la seule entrée du château. Du côté du fleuve, en T, s'étagent des tours et flancs taillés dans le roc et munis de parapets. Une tour V, accolée au rocher, à pic sur ce point, se relie à la muraille X qui barrait le pied de l'escarpement et les rives de la Seine, en se reliant à l'estacade Y destinée à intercepter la navigation. Le grand fossé Z descend jusqu'en bas de l'escarpement et est creusé à main d'homme ; il était destiné à empêcher l'ennemi de filer le long de la rivière, en se masquant à la faveur de la saillie du rocher pour venir rompre la muraille ou mettre le feu à l'estacade. Ce fossé pouvait aussi couvrir une sortie de la garnison vers le fleuve et était en communication avec les caves G au moyen des souterrains dont nous avons parlé. Une année avait suffi à Richard pour achever le château Gaillard et toutes les défenses qui s'y rattachaient. Qu'elle est belle, ma fille d'un an ! s'écria ce prince lorsqu'il vit son entreprise terminée.... ***Tant que vécut Richard, Philippe Auguste, malgré sa réputation bien acquise de grand preneur de forteresses, n'osa tenter de faire le siège du château Gaillard ; mais après la mort de ce prince et lorsque la Normandie fut tombée aux mains de Jean sans Terre, le roi français résolut de s'emparer de ce point militaire qui lui ouvrait les portes de Rouen. Le siège de cette place, raconté jusque dans les plus menus détails par le chapelain du roi, Guillaume le Breton, témoin oculaire, fut un des plus : grands faits militaires du règne de ce prince ; et si Richard avait montré un talent remarquable dans les dispositions générales et dans les détails de la défense de cette place, Philippe Auguste conduisit son entreprise en homme de guerre consommé. Le triste Jean sans Terre ne sut pas profiter des dispositions stratégiques de son prédécesseur. Philippe Auguste, en descendant la Seine, trouve la presqu'île de Rentières inoccupée ; les troupes normandes, trop peu nombreuses pour la défendre, se jettent dans le châtelet de File et dans le Petit-Andely, après avoir rompu le pont de bois qui mettait les deux rives du fleuve en communication. Le roi français commence par établir son campement dans la presqu'île, en face du château, appuyant sa gauche au village de Dernières et sa droite à Toëni, en réunissant ces deux postes par une ligne de circonvallation dont on aperçoit encore aujourd'hui la trace KL. Afin de pouvoir faire arriver la flottille destinée à l'approvisionnement du camp, Philippe fait rompre par d'habiles nageurs l'estacade qui barre le fleuve, et cela sous une prèle de projectiles lancés par l'ennemi. Aussitôt après, dit Guillaume le Breton, le roi ordonne d'amener de larges navires, tels que nous en voyons voguer sur le cours de la Seine, et qui transportent ordinairement les quadrupèdes et les chariots le long du fleuve. Le roi les fit enfoncer dans le milieu du fleuve, en les couchant sur le flanc, et les posant immédiatement l'un à la suite de l'autre, un peu au-dessous des remparts du château ; et afin que le courant rapide des eaux ne pût les entraîner, on les arrêta à l'aide de pieux enfoncés en terre et unis par des cordes et des crochets. Les pieux ainsi dressés, le roi fit établir un pont sur des poutres soigneusement travaillées, afin de pouvoir passer sur la rive droite... ; puis il fit élever sur quatre navires deux tours, construites avec des troncs d'arbres et de fortes pièces de chêne vert, liés ensemble par du fer et des chaînes bien tendues, pour en faire en même temps un point de défense pour le pont et un moyen d'attaque contre le châtelet. Puis les travaux, dirigés avec habileté sur ces navires, élevèrent les deux tours à une si grande hauteur que de leur sommet les chevaliers pouvaient faire plonger leurs traits sur les murailles ennemies — celles du châtelet situé au milieu de l'île. Cependant Jean sans Terre tenta de secourir la place : il envoya un corps d'armée composé de trois cents chevaliers et trois mille hommes à cheval, soutenus par quatre mille piétons et la bande du fameux Lupicar[3]. Cette troupe se jeta la nuit sur les circonvallations de Philippe Auguste, mit en déroute les ribauds, et eût certainement jeté dans le fleuve le camp des Français s'ils n'eussent été protégés par le retranchement, et si quelques chevaliers, faisant allumer partout de grands feux, n'eussent rallié un corps d'élite qui, reprenant l'offensive, rejeta l'ennemi en dehors des lignes. Une flottille normande qui devait opérer simultanément contre les Français arriva trop tard ; elle ne put détruire les deux grands beffrois de bois élevés au milieu de la Seine, et fut obligée de se retirer avec de grandes pertes. Un certain Galbert, très habile nageur, continue Guillaume le Breton, ayant rempli des vases avec des charbons ardents, les ferma et les frotta de bitume à l'extérieur avec une telle adresse, qu'il devenait impossible à l'eau de les pénétrer. Alors il attache autour de son corps la corde qui suspendait ces vases, et plongeant sous l'eau, sans être vu de personne, il va secrètement aborder aux palissades élevées, en bois et en chêne, qui enveloppaient d'une double enceinte les murailles du châtelet. Puis, sortant de l'eau, il va mettre le feu aux palissades, vers le côté de la roche Gaillard qui fait face au château, et qui n'était défendu par personne, les ennemis n'ayant nullement craint une attaque sur ce point.... Tout aussitôt le feu s'attache aux pièces de bois qui forment les retranchements et aux murailles qui enveloppent l'intérieur du châtelet. La petite garnison de ce poste ne pouvant combattre les progrès de l'incendie, activé par un vent d'est violent, dut se retirer comme elle put sur des bateaux. — Après ces désastres, les habitants du Petit-Andely n'osèrent tenir, et Philippe Auguste s'empara en même temps et du châtelet et du bourg, dont il fit réparer les défenses pendant qu'il rétablissait le pont. Ayant mis une troupe d'élite dans ces postes, il alla assiéger le château de Radepont, pour que ses fourrageurs ne fussent pas inquiétés par sa garnison, s'en empara au bout d'un mois, et revint au château Gaillard. Mais laissons encore parler Guillaume le Breton, car les détails qu'il nous donne des préparatifs de ce siège mémorable sont du plus grand intérêt. La roche Gaillard cependant n'avait point à redouter d'être prise à la suite d'un siège, tant à cause de ses remparts que parce qu'elle est environnée de toutes parts de vallons, de rochers taillés à pic, de collines dont les pentes sont rapides et couvertes de pierres, en sorte que, quand même elle n'aurait aucune autre espèce de fortification, sa position naturelle suffirait seule pour la défendre. Les habitants du voisinage s'étaient donc réfugiés en ce lieu, avec tous leurs effets, afin d'être plus en sûreté. Le roi, voyant bien que toutes les machines de guerre et tous les assauts ne pourraient le mettre en état de renverser d'une manière quelconque les murailles bâties sur le sommet du rocher, appliqua toute la force de son esprit à chercher d'autres artifices pour parvenir, à quelque prix que ce fût, et quelque peine qu'il dût lui en coûter, à s'emparer de ce nid dont la Normandie est si fière. Alors donc le roi donne l'ordre de creuser en terre un double fossé sur les pentes des collines et à travers les vallons — une ligne de contrevallation et de circonvallation —, de telle sorte que toute l'enceinte de son camp soit comme enveloppée d'une barrière qui ne puisse être franchie, faisant, à l'aide de plus grands travaux, conduire ces fossés depuis le fleuve jusqu'au sommet de la montagne, qui s'élève vers les cieux, comme en mépris des remparts abaissés sous elle[4], et plaçant ces fossés à une assez grande distance des murailles (du château ) pour qu'une flèche, lancée vigoureusement d'une double arbalète, ne puisse y atteindre qu'avec peine. Puis, entre ces deux fossés, le roi fait élever une tour de bois et quatorze autres ouvrages du même genre, tous tellement bien construits et d'une telle beauté que chacun d'eux pouvait servir d'ornement à une ville, et dispersés en outre de telle sorte qu'autant il y a de pieds de distance entre la première et la seconde tour, autant on en retrouve encore de la seconde à la troisième.... Après avoir garni toutes ces
tours de serviteurs et de nombreux chevaliers, le roi fait en outre occuper tous
les espaces vides par ses troupes, et, sur toute la circonférence, disposant
les sentinelles de telle sorte qu'elles veillent toujours, en alternant d'une
station à l'autre ; ceux qui se trouvaient ainsi en dehors s'appliquèrent
alors, selon l'usage des camps, à se construire des cabanes avec des branches
d'arbres et de la paille sèche, afin de se mettre à l'abri de la pluie, des
frimas et du froid, puisqu'ils (levaient demeurer longtemps en ces lieux. Et,
comme il n'y avait qu'un seul point par où l'on pût arriver vers les
murailles (du château), en suivant un sentier tracé obliquement et qui formait
diverses sinuosités[5], le roi voulut qu'une double garde veillât nuit et jour
et avec le plus grand soin à la défense de cc point, afin que nul ne pût pénétrer
du dehors dans le camp, et que personne n'osât faire ouvrir les portes du
château ou en sortir, sans être aussitôt ou frappé de mort, ou fait
prisonnier.... Pendant tout l'hiver de 1205 à 1204, l'armée française resta dans ses lignes. Roger de Lascy, qui commandait dans le château pour Jean sans Terre, fut obligé, afin de ménager ses vivres, de chasser les habitants du petit Andely qui s'étaient mis sous sa protection derrière les remparts de la forteresse. Ces malheureux, repoussés à la fois par les assiégés et les assiégeants, moururent de faim et de misère dans les fossés, au nombre de douze cents. Au mois de février 1204, Philippe Auguste qui sait que la garnison du château Gaillard conserve encore pour un an de vivres, impatient en son cœur, se décide à entreprendre un siège en règle. Il réunit la plus grande partie de ses forces sur le plateau dominant, marqué R sur notre figure. De là il fait taire une chaussée pour aplanir le sol jusqu'au fossé en avant de la tour A[6]. Voici donc que du sommet de la montagne jusqu'au fond de la vallée, et au bord des premiers fossés. la terre est enlevée à l'aide de petits hoyaux et reçoit l'ordre de se défaire de ses aspérités rocailleuses, afin que l'on puisse descendre du haut jusqu'en bas. Aussitôt un chemin, suffisamment large et promptement tracé à force de coups de hache, se forme à l'aide de poutres posées les unes à côté des autres et soutenues des deux côtés par de nombreux poteaux en chêne plantés en terre pour faire une palissade. Le long de ce chemin les hommes marchent en sûreté, transportent des pierres, des branches, des troncs d'arbres, de lourdes mottes de terre garnies d'un gazon verdoyant. et les rassemblent en monceau pour travailler à combler le fossé.... Bientôt s'élèvent sur divers points — résultat que nul n'eût osé espérer — de nombreux pierriers et des mangonneaux, dont les bois ont été en peu de temps coupés et dressés, et qui lancent contre les murailles des pierres et des quartiers de roc roulant dans les airs. Et afin que les dards, les traits et les flèches, lancés avec force du haut de ces mitrailles, ne viennent pas blesser sans cesse les ouvriers et manœuvres, qui, transportant des projectiles, sont exposés à l'atteinte de ceux des ennemis, on construit entre ceux-ci et les remparts une palissade de moyenne hauteur, formée de claies et de pieux unis par l'osier flexible, afin que cette palissade, protégeant les travailleurs, reçoive les premiers coups et repousse les traits trompés dans leur direction. D'un autre côté, on fabrique des tours, que l'on nomme aussi beffrois, à l'aide de beaucoup d'arbres et de chères tout verts que la doloire n'a point travaillés et dont la hache seule a grossièrement enlevé les branchages ; et ces tours, construites avec les plus grands efforts, s'élèvent dans les airs à une telle hauteur que la muraille opposée s'afflige de se trouver si fort au-dessous d'elles.... A l'extrémité de la Roche et dans
la direction de l'est (sud-est) était une tour élevée (la
tour A, fig. 2), flanquée des deux côtés par
un mur qui se terminait par un angle saillant au point de sa jonction. Cette
muraille se prolongeait sur une double ligne depuis le plus grand des ouvrages
avancés (la tour A) et enveloppait les deux flancs de l'ouvrage le moins
élevé[7]. Or voici par quel coup de vigueur nos gens parvinrent à
se rendre d'abord maîtres de cette tour (A). Lorsqu'ils virent le fossé à peu près comblé, ils v
établirent leurs échelles et y descendirent promptement. Impatientés de tout
retard, ils transportèrent alors leurs échelles vers l'autre bord du fossé,
au-dessous duquel se trouvait la tour fondée sur le roc. Mais nulle échelle,
quoiqu'elles fussent assez longues, ne se trouva suffisante pour atteindre au
pied de la muraille, non plus qu'au sommet du rocher, d'où partait le pied de
la tour. Remplis d'audace, nos gens se mirent à percer alors dans le roc,
avec leurs poignards ou leurs épées, pour y faire des trous où ils pussent
poser leur ; pieds et leurs mains, et, se glissant ainsi le long des
aspérités du rocher, ils se trouvèrent tout à coup arrivés au point où
commençaient les fondations de la tour[8]. Là, tendant les mains à ceux de leurs compagnons qui se
baillaient sur leurs traces, ils les appellent à participer à leur
entreprise, et employant des moyens qui leur sont connus, ils travaillent
alors à miner les flancs et les fondations de la tour, se couvrant toujours
de leurs boucliers, de peur que les traits lancés sur eux sans relâche ne les
forcent à reculer, et se mettent ainsi à l'abri jusqu'à ce qu'il leur soit
possible de se cacher dans les entrailles mêmes de la muraille, après avoir
creusé au-dessous. Mais ils remplissent ces creux de troncs d'arbres, de peur
que cette partie du mur, ainsi suspendue en l'air, ne croule sur eux et ne
leur fasse beaucoup de mal en s'affaissant ; puis, aussitôt qu'ils ont
agrandi cette ouverture, ils mettent le feu aux arbres et se retirent en un
lieu de sûreté. Les étançons brûlés, la tour s'écroule en partie.
Roger, désespérant alors de s'opposer à l'assaut, fait mettre le feu à
l'ouvrage avancé et se retire dans la seconde enceinte. Les Français se
précipitent sur les débris- fumants de la brèche, et un certain Cadoc,
chevalier, plante le premier sa bannière au sommet de la tour à demi
renversée. Le petit escalier de cette tour, visible dans notre plan, date de
la construction première ; il avait dû, à cause de sa position enclavée,
rester debout. C'est probablement par là que Cadoc put atteindre le parapet
resté debout. Mais les Normands s'étaient retirés dans le château séparé de l'ouvrage avancé par un profond et large fossé. Il fallait entreprendre un nouveau siège. Jean avait fait construire l'année précédente une certaine maison, contiguë à la muraille et placée du côté droit du château, en face du midi[9]. La partie inférieure de cette maison était destinée à un service qui veut toujours être fait dans le mystère du cabinet[10], et la partie supérieure, servant de chapelle, était consacrée à la célébration de la messe : là il n'y avait point de porte au dehors, mais en dedans (donnant sur la cour) il y en avait une par où l'on arrivait à l'étage supérieur et une autre qui conduisait à l'étage inférieur. Dans cette dernière partie de la maison était une fenêtre prenant jour sur la campagne et destinée à éclairer les latrines. Un certain Bogis[11], ayant avisé cette fenêtre, se glissa le long du fond du fossé, accompagné de quelques braves compagnons, et s'aidant mutuellement, tous parvinrent à pénétrer par cette ouverture dans le cabinet situé au rez-de-chaussée. Réunis dans cet étroit espace, ils brisent les portes ; l'alarme se répand parmi la garnison occupant la basse-cour, et croyant qu'une troupe nombreuse envahit le bâtiment de la chapelle, les défenseurs accumulent des fascines et y mettent le feu pour arrêter l'assaillant ; mais la flamme se répand dans la seconde enceinte du château, Bogis et ses compagnons passent travers le logis incendié et vont se réfugier dans les grottes marquées G sur notre plan. Roger de Lascy et les défenseurs, réduits au nombre de cent quatre-vingts, sont obligés de se réfugier dans la dernière enceinte, chassés par le feu. A peine cependant la fumée a-t-elle un peu diminué que Bogis, sortant de sa retraite et courant à travers les charbons ardents, aidé de ses compagnons, coupe les cordes et abat, en le faisant rouler sur son axe, le pont mobile qui était encore relevé[12], afin d'ouvrir un chemin aux Français pour sortir par la porte. Les Français donc s'avancent en hâte et se préparent à assaillir la haute citadelle dans laquelle l'ennemi venait de se retirer en fuyant devant Bogis. Au pied du rocher par lequel on arrivait à cette citadelle était un pont taillé dans le roc vif[13], que Richard avait fait ainsi couper autrefois, en même temps qu'il fit creuser les fossés. Ayant fait glisser une machine sur ce pont, les nôtres vont, sous sa protection, creuser au pied de la muraille. De son côté, l'ennemi travaille aussi à pratiquer une contre-mine, et avant fait une ouverture, il lance des traits contre nos mineurs et les force ainsi à se retirer. Les assiégés cependant n'avaient pas tellement entaillé leur muraille qu'elle fut menacée d'une chute ; mais bientôt une catapulte lance contre elle d'énormes blocs de pierre. Ne pouvant résister à ce choc, la muraille se fend de toutes parts, et, crevant par le milieu, une partie du mur s'écroule. Les Français s'emparent de la brèche, et la garnison, trop peu nombreuse désormais pour défendre la dernière enceinte, enveloppée, n'a même pas le temps de se réfugier dans le donjon et de s'y enfermer. C'était le 6 mars 1204. C'est ainsi que Philippe Auguste s'empara de ce château, que ses contemporains regardaient comme imprenable. Si nous avons donné à peu près en entier la description de ce siège mémorable écrit par Guillaume le Breton, c'est qu'elle met en évidence un fait curieux dans l'histoire de la fortification des châteaux. Le château Gaillard, malgré sa situation, malgré l'habileté déployée par Richard dans les détails de la défense, est trop resserré ; les obstacles accumulés sur tel petit espace devaient nuire aux défenseurs en les empêchant de se porter en masse sur le point attaqué. Richard avait abusé des retranchements, des fossés intérieurs ; les ouvrages amoncelés les uns sur les autres servaient d'abri aux assaillants qui s'en emparaient successivement ; il n'était plus possible de les déloger ; en se massant derrière ces défenses acquises, ils pouvaient s'élancer en force sur les points encore inattaqués. trop étroits pour être garnis de nombreux soldats. Contre une surprise, contre une attaque brusque tentée par un corps d'armée peu nombreux, le château Gaillard était excellent ; mais contre un siège en règle dirigé par un général habile et soutenu par une armée considérable et bien munie d'engins, ayant du temps pour prendre ses dispositions et des hommes en grand nombre pour les mettre à exécution sans relâche, il devait tomber promptement, du moment que la première défense était forcée ; c'est ce qui arriva. Il ne faut pas moins reconnaître que le château Gaillard n'était que la citadelle d'un vaste ensemble de fortifications étudié et tracé de main de maitre ; que Philippe Auguste armé de toute sa puissance avait dû employer huit mois pour le réduire, et qu'enfin Jean sans Terre n'avait fait qu'une tentative pour le secourir. Du vivant de Richard, l'armée française, harcelée du dehors, n'eût pas eu le loisir de disposer ses attaques avec cette méthode ; elle n'aurait pu conquérir cette forteresse importante, le boulevard de la Normandie, qu'au prix de bien plus grands sacrifices, et peut-être eût-elle été obligée de lever le siège du château Gaillard avant d'avoir pu entamer ses ouvrages extérieurs. Dès que Philippe se fut emparé de ce point stratégique si bien choisi par Richard, Jean sans Terre ne songea plus qu'à évacuer la Normandie, ce qu'il fit peu de temps après, sans même tenter de garder les autres forteresses qui lui restaient encore en grand nombre dans sa province, tant l'effet moral produit par la prise du château Gaillard fut décisif[14]. E. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du onzième au seizième siècle, t. III, Paris, in-8°, A. Morel, 1859. II. — LA BATAILLE DE BOUVINES.... L'ennemi avait le droit de compter sur la victoire. Otton, venu cura paucis militibus — une cinquantaine de chevaliers allemands —, n'avait sous ses ordres immédiats que quelques milliers d'hommes, cavaliers et fantassins de Lorraine, de Limbourg, de Namur et de Brabant ; mais Salisbury commandait à une trentaine de mille hommes. Quant à la Flandre, sans parler de ses cavaliers de fiefs et de communes, elle avait versé par les larges portes de ses cités de Gand, d'Ypres, de Bruges, d'Oudenarde, de Courtrai, etc., une fourmilière énorme de 40.000 fantassins. Au roi Philippe, la noblesse et les communes du domaine royal, les vassaux de France et leurs communes avaient donné environ 25.000 hommes. Nous allions combattre un contre trois. ***Philippe ne marcha pas sur Valenciennes où l'ennemi l'attendait, couvert par des forêts marécageuses. C'est par l'infanterie surtout que les coalisés l'emportaient sur le roi, et il savait combien était redoutable la milice flamande, quand elle se trouvait bien retranchée. Il avait mis tout son espoir en sa chevalerie et en sa cavalerie. Que les Teutons combattent à pied, dit un des poètes qui ont chanté la bataille ; toi, Français, combats toujours à cheval. Tu, Gallice, pugna, Semper eques... Au lieu de se diriger au sud-ouest, vers Valenciennes, il fait une pointe au nord-ouest, jusqu'à Tournai, comme s'il voulait passer l'Escaut et prendre ainsi les Impériaux à revers. Otton s'ébranle vers Tournai. Philippe aussitôt bat en retraite sur Péronne, sachant bien ce qu'il faisait, voulant attirer l'ennemi sur un champ favorable, car il avait résolu de se battre en plaine à plat, à découvert. L'ennemi le suit. Le 27 juillet, l'avant-garde française, composée surtout de milices que précédait l'oriflamme, avait franchi le pont de Bouvines, sur la Marque. La journée était belle et le soleil de midi flamboyait. Le roi se délassait un moment, et mangeait au pied d'un frêne. tout près d'une église dédiée à saint Pierre, quand des messagers accoururent, annonçant à grandes- clameurs que l'ennemi arrivait, et qu'il avait engagé l'action contre l'arrière-garde qui pliait. Philippe se lève, embrasse à grands bras les chevaliers de sa maison, Montmorency et Guillaume des Barres, et Michel de Harnes, et Mauvoisin, et Gérard la Truie, celui-ci venu de Lorraine tout exprès pour combattre les Allemands. Puis, le roi entre dans l'église. Il n'est pas vrai qu'il déposa sa couronne sur l'autel pour l'offrir au plus vaillant, car le roi de France était. par profession, le plus vaillant, et sa couronne ne lui appartenait pas. Dieu l'avait commise à Hugues de France et à la race qui sortirait des reins de ce prince jusqu'à la consommation des siècles. Aussi bien n'était-ce pas le temps de discourir. Le roi pria brièvement. Je voudrais bien qu'il eût dit la prière que lui prête un chantre français de la bataille, car elle est bien jolie : Seigneur, je ne suis qu'un homme, Mais je suis roi de France ! Vous devez me garder, sans manque. Gardez-moi et vous ferez bien. Car par moi vous ne perdrez rien. Or donc, chevauchez, je vous suivrai, et partout après vous j'irai.... Il sort de l'église, rayonnant de joie, comme si on l'eût invité à une noce. Il monte à cheval, et, haut sur son haut destrier, se précipite dans l'avant-garde ennemie, qu'il arrête par son choc. Après quoi, il retourne vers les siens, qui se mettent en bataille. Les deux armées s'allongent l'une en face de l'autre. On n'entend pas un mot : L'un est ne l'autre mot ne sonne.... Philippe adresse aux siens un petit sermon. Il leur dit que toute sa foi est en Dieu, qu'Otton, excommunié par le seigneur pape, ne peut manquer d'être vaincu : Nous, nous sommes chrétiens, nous jouissons de la communion et de la paix de Sainte Église... Dieu, malgré nos péchés, nous accordera la victoire sur ses ennemis et sur les nôtres. Les chevaliers lui demandent sa bénédiction. Le roi, élevant la main, les bénit. Les trompes sonnent à grans alaines et alonges. Le chapelain placé derrière Philippe entonne avec son clerc le psaume : Béni soit le Seigneur, qui est ma force et qui instruit mos mains au combat ; puis le : Seigneur, le roi se réjouira en votre force. Jusqu'à la fin, ils chantèrent comme ils purent, car les larmes s'échappaient de leurs yeux et les sanglots se mêlaient à leurs chants. Ainsi parle le propre chapelain de Philippe, Guillaume le Breton, qui nous a conté la bataille en prose et en vers. Mais quelles scènes à tenter les artistes de la commémoration de Bouvines ! Quel geste que celui de la bénédiction par un roi qui est à la fois prêtre et chevalier, Moïse et Aaron ! ***La bataille dura de midi jusqu'au soleil couché. Elle fut très belle. Les fronts adverses s'étendaient tout voisins l'un de l'autre, l'aile gauche française et l'aile droite ennemie vers la Marque, la première gardant le pont de Bouvines. A notre aile gauche étaient Dreux et son frère Philippe, évêque de Beauvais ; puis Nivelle et Saint-Waléry. A l'aile droite impériale, Boulogne et Boves, deux vassaux traîtres au roi de France, puis Audenarde et Salisbury. A notre droite. Champagne, Montmorency. Bourgogne, Saint-Pol, Beaumont, Melun et Guérin, l'évêque de Senlis ; en face, Flandre. Aux deux centres, Philippe et Otton. Sur tous les points, excepté à notre aile droite et à l'aile gauche ennemie, où il n'y avait que de la cavalerie, l'infanterie était rangée devant les chevaux, en masse trois fois plus profonde chez les Impériaux que chez les Français. Près de Philippe, Montigny, un chevalier pauvre mais vaillant — c'est la vaillance et la force corporelle qui importaient — levait la bannière rouge fleurdelisée. Près d'Otton. sur un char doré, se dressait un pal, autour duquel s'entortillait un dragon, ouvrant une large gueule et dont la queue et les ailes se gonflaient et s'agitaient au moindre souffle ; au-dessus du monstre planait l'aigle de l'empire aux ailes d'or. Otton apercevait la bannière rouge, et Philippe l'aigle d'or. Aucun obstacle entre les deux armées ; elles allaient se heurter poitrine contre poitrine, sous le grand soleil. Philippe avait le champ de bataille désiré ; c'était comme dit le bon chapelain, un bien bel endroit pour se tuer : dignus cæde locus. La journée fut commandée, non par le roi, mais, comme nous dirions aujourd'hui, par son chef d'état-major général, Guérin de Montaigu, un religieux, frère profès de l'Ordre du Temple, évêque de Senlis, une des meilleures tètes de France et le principal conseiller de la couronne. Guérin ne tira point l'épée, puisque l'Église défend de verser le sang ; mais il plaça les troupes, exhorta les chefs et les soldats, leur parlant de Dieu et du roi, de leur foi et de leur vaillance, et de l'honneur de la nation. Guérin était un vrai général, qui trouva un bon plan sur le terrain même : l'aile gauche et le- centre devaient tenir ferme, pendant que l'aile droite attaquerait Ferrand, et, après l'avoir défait, se précipiterait sur le centre ennemi. Otton, au contraire, cédant à la colère, qui conseille mal sur le champ de bataille, voulait jeter sur le centre français les plus grandes forces possibles empruntées à toute sa ligne, et s'y porter lui-même pour saisir le roi mort ou vif, car cet empereur d'Allemagne disait : Si le roi de France n'existait pas, nous n'aurions à redouter sur terre aucun ennemi. Notre armée était mieux commandée que la sienne et plus mobile. Elle était formée par sections qui se déplaçaient aisément et combinaient avec rapidité les troupes à pied et les troupes à cheval. Notre cavalerie échelonnée allait combattre à tour de rôle, pendant que celle de l'ennemi donnerait en masse toute la journée. Si peu nombreux que nous fussions, nous avions des troupes de soutien. Les nôtres enfin étaient plus adroits dans l'escrime à cheval. Ils avaient le coup d'œil plus prompt et la résolution plus claire. Pour la bravoure, les adversaires se valaient. Sur le fond de la grande mêlée se détachent des épisodes héroïques. A notre droite, Champagne arrête Flandre par une charge furieuse, au moment où celui-ci, pour obéir à l'ordre d'Otton, se porte contre le centre français. L'aile gauche ennemie, affaiblie par le départ de Ferrand, est assaillie par Bourgogne, Saint-Pol, Montmorency, Beaumont et Melun. Ici, Saint-Pol est le héros de la journée. Il traverse la chevalerie flamande, à fond de train, ne s'engage pas ; arrivé derrière les lignes, il forme en demi-cercle ses cavaliers, et charge à revers sur un autre point enveloppant dans cette courbe les ennemis qu'il culbute. Puis il se repose et recommence. Après une de ces charges, il aperçoit un de ses chevaliers retenu dans les rangs des Flamands. Il se penche sur son cheval dont il embrasse le cou à deux bras, presse la bête à grands coups d'éperon, rompt le cercle qui entoure son homme, se redresse, tire l'épée, frappe, dégage le chevalier et rejoint son poste de repos, accablé de coups, mais invulnérable sous son armure. Cependant, au centre, le roi de France est en grand péril. L'énorme masse des piétons flamands pénètre en coin à travers les milices françaises et s'approche de Philippe, que l'empereur s'apprête à charger. Alors, pendant que le roi, avec une partie des siens, tient tête aux communiers, Guillaume des Barres et d'autres chevaliers, traversant on tournant l'infanterie flamande vont se placer derrière elle, face à Otton qui la suit. Étrange mêlée ! Philippe avait devant lui les fantassins flamands, au delà Guillaume des Barres, qui lui tournait le dos et chargeait Otton. Le roi de France bouscule la piétaille pour rejoindre ses chevaliers, mais cette foule l'arrête. Avec ses lances, pointues comme une alène ou armées d'un crochet saillant, elle fait le siège de Philippe, — car un chevalier était une fortification qui marchait et combattait. Le roi tenait bon, solide en selle, n'inclinant ni à droite ni à gauche, frappant, tuant, avançant toujours. Mais le crochet d'une pique à pénétré sous le menton et s'est pris dans les mailles du haubert. Philippe, pour l'arracher, tire, se penche en avant ; une poussée le fait tomber sous son cheval. Les piques et toutes les armes s'abaissent sur lui. Ainsi, dit le chapelain qui sans doute ne chantait plus, le roi étendu sur une place indigne de lui, n'y pût même jouir du repos qu'on trouve à être couché. Heureusement l'étoffe de fer est très solide. Les pointes roturières ne trouvent pas le chemin de la vie du roi de France. L'escorte de Philippe fait un effort suprême ; Montigny agite la bannière. Tous appellent à la rescousse Guillaume des Barres par le cri : Aux Barres ! aux Barres ! Quand Guillaume des Barres oï tex paroles, il laissa une partie de ses chevaliers devant Otton, se jeta sur les Flamands qu'il prit à revers, et arriva auprès du roi. Philippe s'était relevé par la force qui lui était naturelle ; il se remit en selle. Dès lors, ce fut un immense massacre de cette infanterie débandée. Jusqu'au soir, Philippe et ses chevaliers tuèrent et tuèrent ces vilains, qui avaient osé s'attaquer à la personne sacrée du roi de France. Guillaume des Barres a regagné son poste devant Otton. Il s'acharne contre l'empereur avec Pierre Mauvoisin et Gérard la Truie. Pierre a saisi la bride du cheval impérial. Gérard la Truie frappe Otton en pleine poitrine d'un coup qui s'émousse ; il redouble, mais le cheval, qui fait un mouvement de tête, reçoit la pointe dans l'œil, se lève sur les pieds de derrière, dégage sa bride, tourne et s'emporte. Guillaume le suit à fond de train. Le cheval d'Otton s'abat, tué par sa blessure ; un des hommes de l'empereur lui donne le sien, mais Guillaume l'a rejoint. Déjà il avait saisi l'empereur par derrière, enfonçant ses doigts vigoureux entre le casque et le cou, quand un des Allemands frappe au flanc le cheval du Français, qui tombe à terre. Ainsi fut sauvé des mains du plus redoutable jouteur de la chrétienté Otton, l'empereur excommunié, mais le péril lui avait fait perdre l'esprit. Et s'en alla li empereires en Allemaigne, dit un chroniqueur. Otton continua de courir, en effet, et ne s'arrêta qu'à Valenciennes. Quant à Guillaume, presque seul en arrière des lignes ennemies, entouré, harcelé, il fait front partout, jusqu'à ce qu'il soit délivré par une charge du sire de Saint-Waléry. La fuite d'Otton n'arrêta point la lutte. Chevaliers d'Aile-manne et chevaliers de France s'embrassèrent en étreintes mortelles. Jetés lias par leurs chevaux éventrés, ils s'empoignaient. C'étaient des corps à corps sans nombre, car il n'y avait plus d'espace pour les coups d'épée. Un géant parmi les chevaliers de France, Étienne de Longchamp, homme aux membres immenses, qui ajoutait la vigueur à son immensité et l'audace à sa force, saisissait les Allemands par le cou ou par les reins et, sans blessure, les tuait. Un de ses adversaires, près d'expirer, enfonça son fer dans la petite fenêtre du heaume d'Étienne. Ils tombèrent l'un sur l'autre, morts à quelques pas du roi de France qui les regardait. Avant la fin de la journée, la plupart des Allemands étaient pris. Au centre de la bataille, l'ennemi, sans direction, combattait sans espoir. ***A notre gauche, la journée fut un moment compromise. Le comte de Dreux, qui était le plus proche du centre, fut assailli par le traître Boulogne. Celui-ci avait fait de son infanterie rangée en cercle une forteresse, qui s'ouvrait pour laisser passer ses charges, le recueillait au retour et se refermait, piques baissées. Plus loin, à notre extrême gauche, Ponthieu avait affaire à Salisbury et à son infanterie. Là se trouvaient les plus redoutables des fantassins, les Brabançons. Ponthieu s'usa contre leurs piques, qui éventrèrent ses chevaux. Salisbury le mit alors en tel désordre qu'il eût pu s'emparer du pont de Bouvines. C'est sans doute à ce moment que les sergents à masse, gardes du corps du roi, qui étaient chargés de la défense du pont, promirent à Notre-Dame de lui bâtir une belle église si elle daignait leur être secourable. Mais Salisbury laisse Ponthieu se défendre contre les Brabançons avec ses pieds et avec ses mains, l'épée des chevaliers démontés ne pouvant rien contre les piques. Ponthieu sera enfin délivré de ces communiers par ses propres communes. Quant à l'Anglais, il se tourne vers le comte de Dreux, qui est toujours aux prises avec Boulogne. Il va le prendre en flanc, mais l'évêque de Beauvais voit le péril du comte son frère. Ce prélat, à sa façon, observait les lois de Sainte Église. Comme Guérin de Senlis, il ne portait pas l'épée, qui verse le sang ; il tenait une masse d'armes et son bras était assez fort pour la lever, l'abaisser, la relever et l'abaisser encore. Chaque coup tombait comme un boulet, broyant un crâne ; la masse d'armes agissait comme le canon, un canon qui avait un mètre de portée. Le fort évêque cassa ainsi, selon le mot de l'Écriture, la tête de beaucoup, entre autres celle de Salisbury, qu'il envoya jeter sur la terre le dessin de son long corps. Après cette charge de l'évêque et de ses chevaliers, les Anglais ; affolés, disparurent. A notre gauche, Boulogne seul tenait encore dans sa tour vivante, d'où partaient ses sorties furieuses. La victoire enfin se décida, là où les Français avaient pris l'offensive, à l'aile droite. Saint-Pol et Montmorency, quand ils ont exterminé l'extrême aile gauche impériale, se joignent contre Ferrand à Champagne et à Bourgogne. Ferrand ne s'était pas reposé, pas une minute ! Criblé de coups, blessé, assailli par trois adversaires, il se rend hors de souffle, à force d'avoir combattu. Tous les siens furent tués ou pris, hormis ceux qui honteusement s'enfuirent. Ce fut alors, sur tout le champ de bataille, la débandade de l'ennemi. Guillaume, le chapelain, voit se confondre dans la panique Ardennais, Saxons, Allemands, Flamands et Anglais. Au centre demeurent sept cents piétons de Brabant, ferme épave de cette infanterie qui avait pénétré jusqu'au roi Philippe, reste d'un massacre qui avait duré tout le jour. Chargés par Saint-Waléry, ils sont tués jusqu'au dernier. Le soleil descendait vers l'Océan. Ses derniers rayons éclairèrent un spectacle superbe. De tous les ennemis de Philippe, un seul, les flancs découverts par la déroute, continuait à se battre : c'était Boulogne. Les Français, oubliant sa trahison, admiraient le héros désespéré dont la bravoure, innée attestait la naissance française. Le bon chapelain décrit ce personnage fantastique, qui se détachait sur ce fond de soleil couchant : Boulogne, dont l'épée avait été brisée, tenait un frêne dans sa main. Sur son heaume se dressaient deux noirs fanons de baleine. Le roi envoie contre lui trois mille cavaliers qui le coupent de sa retraite vers la tour vivante. Celle-ci est bientôt détruite. L'escorte de Boulogne, assaillie de toutes parts, se disperse. Dans le champ immense, bouillonnant de fuyards, le comte ne garde plus auprès de lui que cinq fidèles. Une idée folle lui passe par la tête. Il pique vers le roi, résolu à mourir en le tuant. Mais Pierre de La Tournelle se glisse sous son cheval, qu'il frappe d'un coup de poignard. Boulogne gît sur le dos, la cuisse droite sous son cheval mort. Plusieurs se précipitent pour le prendre ; il se débat. Un valet, du nom de Cornu, lui enlève son casque, lui laboure le visage de son couteau, dont il essaye ensuite de faire passer la pointe sous les pans du haubert. Mais l'évêque de Senlis survient, et Boulogne, qui le reconnait, se rend à lui. Ce n'est qu'une feinte : le prisonnier aperçoit un groupe de cavaliers, commandé par Audenarde, qui s'efforce de pénétrer jusqu'à lui. Pour atteindre son libérateur, il fait semblant de ne pouvoir se tenir debout ; mais ses gardiens l'accablent de coups, le forcent à monter sur un roussin et l'emmènent, pendant que Gérard la Truie met la main sur Audenarde. C'était fini, et le soleil pouvait se coucher. E. LAVISSE, La bataille de Bouvines, Paris, tvp. G. Née, s. d., in-12. II. — LOUIS IX ET L'ÉGLISE. On a longtemps attribué à Louis IX, sous le nom de Pragmatique, une soi-disant, ordonnance, datée du mois de mars 1269, qui aurait prohibé les collations irrégulières (art. 1), la simonie (art. 3), et interdit les tributs onéreux que percevait la cour de Rome sur le clergé du royaume (art. 5). Cet acte est faux : il a été fabriqué au XVe siècle, par des gens qui n'étaient pas au courant des formules en usage dans la chancellerie des Capétiens directs, en vue de donner à la Pragmatique Sanction de Charles VII un précédent vénérable. Mais, s'ils ont eu raison d'en contester, pour des raisons diplomatiques, l'authenticité, certains historiens ont eu tort d'y dénoncer, en outre, des invraisemblances historiques. La Pragmatique, disent-ils, est fausse, car elle suppose l'existence en 1269 des collations irrégulières et de la simonie, tandis que ces abus n'existaient pas encore à cette date ; elle est fausse, car il y est dit que des diocèses sont misérablement appauvris par les levées d'argent faites au profit de la cour de Rome, alors que ces collectes étaient inconnues au XIIIe siècle ; elle est fausse, enfin, car elle suppose chez son auteur une vigoureuse indépendance vis-à-vis du Saint-Siège qui répugne absolument au caractère de Louis IX. — Nous savons que le caractère de Louis IX n'était nullement celui que des modernes, mal informés, lui ont prêté, d'après les hagiographes. Il est très facile de montrer que les autres arguments des adversaires de la Pragmatique sont aussi ruinés par les faits. C'est, en effet, au XIIIe siècle que se posa clairement en Occident ce redoutable problème des droits du siège apostolique sur les biens des églises locales, qui était encore pendant sons Charles VII. — La propriété des biens ecclésiastiques, dont les églises locales avaient la jouissance, appartenait-elle au pape, à Dieu, à l'Église universelle, aux pauvres ? La théorie s'était formée à Rome que ces biens faisaient partie du patrimoine pontifical, et que le pape avait, par conséquent, le droit d'en disposer, d'en imposer les détenteurs. Au synode de Londres, en 1256, un collecteur pontifical déclara expressément que toutes les églises sont au pape, Omnes ecclesiæ sunt domini papæ. Par là se trouvaient lésés à la fois les clercs, menacés de charges pécuniaires, et les patrons laïques, les- seigneurs, les rois, qui. de leur côté, se considéraient, à titre de représentants des anciens fondateurs des églises, comme autorisés à profiter de leurs richesses, en cas de nécessité, et qui ne pouvaient voir, en tout cas, avec plaisir, l'argent des clercs émigrer dans les coffres des Romains. Clercs, rois et seigneurs avaient laissé cependant s'introduire, depuis le temps d'Innocent III, sans en accepter, il est vrai, le principe juridique, la coutume des exactions pontificales : les papes taxèrent d'abord les églises, avec le consentement des princes et des prélats, pour les besoins de la Terre Sainte, de la Croisade, des Latins de Constantinople ; ils les taxèrent ensuite pour les besoins de leur lutte contre les Hohenstauffen et de leur politique en général. En France, le clergé s'était d'abord prêté docilement à cette extension des droits du pape ; le cardinal de Palestrina, légat de Grégoire IX, lui avait extorqué de grosses sommes ; Innocent IV, dès son arrivée à Lyon, avait reçu des abbés de Cîteaux et de Cluny, d'Eudes Clément, abbé de Saint-Denis, et de l'archevêque de Rouen, des libéralités considérables. Le pape était dès lors si persuadé de ses droits de réquisition sur l'Église de France qu'en mai 1247 il avait écrit à l'archevêque de Narbonne, à l'abbé de Vendôme et sans doute à d'autres prélats, pour leur demander, non plus seulement de l'argent, mais des soldats, qui l'aidassent à repousser les agressions de l'empereur. Le clergé anglais, traité par Innocent IV de la même manière, protestait vivement. Un très précieux document, que Mathieu de Paris, en le transcrivant à la fin de sa Chronique, a préservé de la destruction, nous apprend ce que le gouvernement de Louis IX pensa de ces nouveautés. Six mois après la publication du manifeste des barons de France contre le clergé, le 2 mai 1247, les évêques de Soissons et de Troyes, au nom des prélats, l'archidiacre de Tours et le prévôt de la cathédrale de Rouen, .au nom dès chapitres et du clergé inférieur, et le maréchal de France Ferri Pasté, au nom du roi, exposèrent à Innocent IV, en présence de sa cour, les griefs suivants : le Saint-Siège usurpait la juridiction des ordinaires ; il inondait le royaume d'Italiens qu'il pourvoyait, au détriment des nationaux, de pensions et de bénéfices ; ses demandes d'argent, les exactions de ses agents ruinaient les églises locales. La réponse du pape fut vague : il était prêt à révoquer en temps et lieu les abus commis, s'il y avait eu de la part de l'Église de récentes usurpations, ce que toutefois il ne croyait pas, mais il ne changerait rien aux droits dont il était en possession vel quasi. C'était le temps où Louis IX s'apprêtait-à protéger la personne d'Innocent contre les entreprises de Frédéric II : on a conjecturé — car les archives du XIIIe siècle sont si mutilées que la chronologie des événements les plus importants est incertaine —, on a conjecturé qu'il profita de cette circonstance, où le pape était son obligé, pour lui adresser des représentations sévères. Mécontent de la réponse faite à Ferri Pasté, il envoya d'autres personnes, dont les noms sont inconnus, qui, probablement au mois de juin, réitérèrent en ces termes les plaintes du mois de mai : Le roi notre maitre, déclarèrent ces officiers, a longtemps supporté, à grand'peine, le tort qu'on fait à l'Église de France, et par conséquent à lui-même, à son royaume. De peur que son exemple ne poussât les autres souverains à prendre contre l'Église romaine une attitude hostile, il s'est tu, en prince chrétien et dévoué... mais, voyant aujourd'hui que sa patience reste sans effet, que chaque jour amène de nouveaux griefs, après en avoir longtemps délibéré, il nous a envoyés vous exposer ses droits et vous faire part de ses avis. Récemment, les barons, au colloque de Pontoise, ont reproché au roi de laisser détruire son royaume ; leur émotion a gagné toute la France, où le dévouement traditionnel à l'Église romaine est prêt de s'éteindre, et de faire place à la haine. Que se passera-t-il dans les autres pays, si le Saint-Siège perd l'affection de ce peuple, naguère fidèle entre tous ? Déjà les laïques n'obéissent à l'Église que par crainte du pouvoir royal. Quant aux clercs, Dieu sait, et chacun sait, de quel cœur ils portent le joug qu'on leur impose. Cet état si grave tient à ce que le pape donne au monde le spectacle de choses nouvelles, extraordinaires. — Ces choses, l'homme du roi les énumère dans un discours nourri de faits précis, semé de maximes générales et d'apophtegmes historiques : Il est inouï de voir le Saint-Siège, chaque fois qu'il se trouve dans le besoin, imposer à l'Église de France des subsides, des contributions prises sur le temporel, quand le temporel des églises, même si l'on s'en rapporte au droit canon, ne relève que du roi, ne peut être imposé que par lui. Il est inouï d'entendre par le monde cette parole : Donnez-moi tant, ou je vous excommunie.... L'Église [de Rome], qui n'a plus le souvenir de sa simplicité primitive, est étouffée par ses richesses, qui ont produit dans son sein l'avarice, 'avec toutes ses conséquences. Ces exactions se commettent aux frais de l'ordre sacerdotal, qui toujours, même chez les Égyptiens et les anciens Gaulois, a été exempt de toutes prestations. Ce système a été pour la première fois mis en pratique par le cardinal-évêque de Préneste, qui, lors de sa légation en France, a imposé des procurations pécuniaires à toutes les églises du royaume ; il faisait venir un à un les ecclésiastiques, et, après leur avoir arraché la promesse d'être discrets, il disait : Je vous ordonne de payer telle somme à l'ordre du pape, dans tel délai, à tel endroit, et sachez que faute de cela, vous serez excommunié. Le roi, qui en fut informé, le manda et lui fit promettre de renoncer à ces procédés.... Mais, depuis qu'Innocent est venu habiter Lyon, les abus ont recommencé[15]..... Alors que tous les membres du clergé français rivalisaient de zèle, comme c'était leur devoir, le pape a envoyé en France un nonce qui s'est mis à imiter en tout le cardinal de Préneste. Le roi s'est opposé à ces nouvelles exactions, puis il a engagé son clergé à se soumettre, par pure générosité, au subside pour l'Empire d'Orient et au dixième de Terre Sainte. Depuis lors les envoyés pontificaux sont revenus ; le pape a écrit au clergé de lui envoyer des troupes [pour l'aider contre l'Empereur][16].... En ce moment même, les frères Mineurs font, pour leur compte, une nouvelle collecte : en Bourgogne, ils ont été jusqu'à convoquer les chapitres des cathédrales et les évêques eux-mêmes, et à leur enjoindre de verser, dans la quinzaine de Pâques, le septième de tous leurs revenus ecclésiastiques... ailleurs, c'est le cinquième qu'on exige.... Le roi ne peut tolérer que l'on dépouille ainsi les églises de son royaume, fondées par ses ancêtres... il entend, en effet, se réserver, pro sua et regni sui necessitate, leurs trésors, dont il est libre d'user comme de ses propres biens[17]. — Voilà pour les exactions de Rome. Le mémoire insiste ensuite, avec autant de véhémence, sur l'avidité personnelle des envoyés pontificaux qui parcourent le royaume, et sur les collations de bénéfices que le Saint-Siège se permet : Les églises sont appauvries par une foule de provisions et de pensions.... Que le Saint-Siège use de modération ! Que la première de toutes les églises n'abuse pas de sa suprématie pour dépouiller les autres ! Innocent III, Honorius III, Grégoire IX ont distribué autour d'eux beaucoup de prébendes françaises, mais les prédécesseurs d'Innocent IV n'ont pas conféré tous ensemble autant de bénéfices que lui seul pendant les années encore peu nombreuses de son pontificat. Si le prochain pape suivait la même progression, le clergé de France n'aurait plus d'autre ressource que de le fuir ou de le mettre en fuite. Les choses en sont déjà venues à un tel point que les évêques ne peuvent plus pourvoir leurs clercs lettrés, ni les personnes honorables de leurs diocèses, et en cela on porte préjudice au roi, comme à tous les nobles du royaume, dont les fils et les amis étaient jusqu'à présent pourvus dans les églises, auxquelles ils apportaient en retour des avantages spirituels et temporels. Aujourd'hui on préfère des étrangers, des inconnus, qui ne résident même pas, aux gens du pays. Et c'est au nom de ces étrangers que les biens des églises sont emportés hors du royaume, sans qu'on songe à Fa volonté des fondateurs, d'où ne résultent pour l'Église romaine que la haine et le scandale. Le Mémoire du mois de, juin 1247 — dont l'authenticité n'est pas douteuse — démontre amplement que les abus condamnés par la fausse Pragmatique florissaient déjà au XIIIe siècle. Toutefois la différence est grande entre la Pragmatique et le Mémoire : celui-ci, quoiqu'il soit rédigé avec fermeté, n'est après tout qu'une requête ; il se termine par des protestations d'attachement et de condoléance : Le roi compatit fort aux embarras du pape ; mais, quelle que soit son affection, il doit travailler de tout son pouvoir à conserver intacts le bon état, les libertés et les coutumes du royaume que Dieu lui a confié ; la Pragmatique, au contraire, se présente comme une ordonnance royale pour la réformation de l'Église, faite sans l'approbation de l'Église. Le Mémoire demande l'atténuation, plutôt que la suppression, des maux qu'il dénonce ; la Pragmatique proclame des principes de droit public. Enfin, si Louis IX avait osé prendre des mesures aussi radicales que celles de la Pragmatique, elles auraient eu, sans doute, quelque efficacité ; pour le Mémoire, il produisit, dit Mathieu de Paris, une vive impression, mais l'émotion qu'il causa est restée, jusqu'à présent, sans résultat. Nous ne savons pas, dit le dernier historien d'Innocent IV[18], si les levées de subsides pour l'Église romaine ont été continuées en France après 1247. Quant aux provisions, le pape, après les avoir pratiquées avec quelque excès jusqu'en 1247, en diminua le nombre pendant un certain temps, mais, à la fin du pontificat, les nominations de clercs étrangers, dont s'était plaint saint. Louis, reparurent avec une nouvelle persistance. Sous les successeurs d'Innocent, la France et l'Europe furent sillonnées, plus que jamais, par les marchands et les banquiers du pape, chargés de recueillir, pour le compte de Rome, l'argent des centièmes et des dixièmes. Et les plaintes du clergé s'élevèrent, plus hautes d'année en année. Au mois d'août 1262, un synode de prélats français refusa d'accorder à Urbain IV le subside que son mandataire les priait de consentir : des Gaules gémissait depuis trop longtemps sous des charges trop pesantes ; elle avait versé des sommes énormes pour la croisade, pour le Saint-Siège : elle ne pensait pas que des sacrifices nouveaux fussent suffisamment motivés. Urbain IV passa outre, et en même ternis qu'il pressait la levée du centième pour la Terre Sainte, il imposa, l'année suivante, des décimes pour la croisade de Sicile, pour la croisade pontificale contre Manfred. On payait, alors, dit un chroniqueur limousin, la décime pour Charles d'Anjou et le centième pour la Terre Sainte. L'archevêque de Tyr était chargé de la levée du centième : Simon, cardinal de Sainte-Cécile, était le collecteur général de la décime. Bien que ce cardinal fût français de naissance et eût été chancelier du roi de France, quand il était trésorier de l'église de Tours, il connaissait parfaitement les usages de Rome pour ronger et dévorer les bourses, bene didicerat morem Romanorum ad bursarum corrosionem. Je ne saurais dire toutes les exactions et les violences qui furent commises à l'occasion de cette décime et dans l'intérêt des collecteurs. En 1265, c'est Clément IV qui demande de nouveau aux clercs de France des subsides, eu invoquant les nécessités de l'Église et le péril de son champion en Italie, Charles d'Anjou. Les décimas d'Urbain IV n'avaient pas suffi, et, quoique le produit du centième pour la Terre Sainte eût été détourné de sa destination, appliqué aux frais des guerres ultramontaines, il fallait de l'argent encore. Cette fois l'assemblée de la province de Reims protesta par un manifeste, oh, se disant accablée par les tributs précédemment imposés, elle parlait de sa servitude, et rappelait que le schisme de l'Église grecque avait eu pour cause l'avarice et l'avidité des Romains : plutôt que d'obtempérer aux ordres du pape, elle se déclarait prête à braver l'excommunication, car, elle en était persuadée, la rapacité de la Curie ne cesserait que le jour où cesseraient l'obéissance et le dévouement du clergé.... Si Louis IX l'avait voulu, il aurait certainement empêché Urbain IV et Clément IV, papes-français, dévoués à sa personne, de continuer, à l'égard de l'Église gallicane, les procédés d'Innocent. Mais il ne le voulut pas. La levée de la décime d'Urbain IV se fit, au contraire, avec son assentiment, et grâce .à son appui, per compulsionent regis. Comment expliquer cette complaisance, après ce qui s'était dit à Lyon en 1247 ? On le voit très clairement. En 1247 le roi avait blâmé d'autant plus sévèrement les exactions pontificales qu'elles étaient alors destinées à alimenter contre l'Empereur une guerre qu'il n'approuvait pas et qu'elles faisaient le plus grand tort aux perceptions pour la croisade. Urbain IV et Clément IV ont prodigué au roi les subsides qu'il sollicita d'eux en vue de l'expédition d'outre-mer, et leurs exactions étaient destinées à soutenir une entreprise, — celle de Charles d'Anjou, son frère, — qu'il n'avait pas encouragée, sans doute, mais qu'il ne lui appartenait pas d'entraver. D'ailleurs, même en 1247, il n'avait pas contesté formellement le droit pontifical d'imposer. Comme tous les princes de son temps, il le reconnut tacitement, à condition d'en surveiller l'exercice, et, parfois, d'en profiter. C'est plus tard que la redoutable question de la propriété des biens d'Église fut, pour la première fois, discutée et tranchée en principe : elle est au fond du premier Différend entre Philippe et Boniface. CH.-V. LANGLOIS. Extrait d'un ouvrage eu préparation (1895). IV. — LOUIS IX ET LES VILLES. LES PASTOUREAUX. Au XIIIe siècle, les Communes en décadence n'étaient plus assez turbulentes, assez puissantes, pour que la couronne dit à les craindre. Elles n'ont jamais causé d'embarras au gouvernement de Louis IX. C'est sous le règne de Louis IX, au contraire, que le pouvoir royal commença d'intervenir avec succès dans les affaires des communes. Vers 1256, une ordonnance royale imposa à toutes les villes de Normandie une constitution très analogue aux Établissements de Rouen : le maire serait choisi chaque année par le roi, sur une liste de trois candidats dressée par le maire sortant de charge et les prud'hommes du lieu ; les communes furent, en outre, obligées à soumettre, chaque année, en novembre, leurs comptes à des commissaires du roi ; elles furent invitées à ne passer aucun contrat, à ne consentir aucun don — sauf les pots de vin sans l'autorisation royale. Une autre ordonnance, sans doute un peu postérieure, disposant pour toute la France, généralisa le régime nouveau de tutelle administrative et financière et d'uniformité : Tous les maires de France seront faits, chaque année, le même jour, le lendemain de la Saint-Simon et Saint. Jude ; à l'octave de la Saint-Martin, l'ancien maire et quatre prud'hommes de la ville — dont quelques-uns choisis parmi ceux qui auront eu le maniement des deniers communaux —, viendront à Paris pour rendre compte à nos gens de leurs recettes et de leurs dépenses. On a conservé quelques-uns des comptes présentés aux gens du roi en exécution de ces règlements. Le rédacteur de l'Ordonnance se proposait certainement de prévenir les malversations, les dépenses somptuaires, les désordres qui avaient contribué à amener la ruine des villes libres, alors surchargées pour la plupart de dettes excessivement lourdes. Mais se rendait-il compte que les exigences des rois étaient aussi pour quelque chose dans la triste situation des finances communales ? Blanche de Castille avait souvent employé les milices des communes ; Louis IX s'en servit aussi ; les communes avaient pris l'habitude de prêter au roi, pour ses besoins, de l'argent que le gouvernement royal avait pris, de son côté, l'habitude de ne pas rendre. Quand le roi alla outre-mer, disait le magistrat de la ville de Noyon, le 7 avril 1260, nous lui donnâmes 1.500 livres, et, quand il fut outre-mer, la reine nous ayant fait entendre que le roi avait besoin de deniers, nous lui donnâmes 500 livres. Quand le roi revint d'outre-mer, nous lui prêtâmes 600 livres, mais nous n'en recouvrâmes que 100 et nous lui limes abandon du reste. Quand le roi fit sa paix avec le roi d'Angleterre, nous lui en donnâmes 1.200. Et, chaque année, nous devons au roi 200 livres tournois pour cause de la commune que nous tenons de lui, et nos présents aux allants et venants nous coûtent bien, bon an mal an, 100 livres ou plus. Et quand le comte d'Anjou, frère du roi, fut en Hainaut, on nous fit savoir qu'il avait besoin de vin ; nous lui en envoyâmes dix tonneaux, qui nous contèrent 100 livres, avec le transport. Après, il nous fit savoir qu'il avait besoin de sergents pour garder son fief ; nous lui en envoyâmes cinq cents qui nous coûtèrent au moins 500 livres. Quand ledit comte fut à Saint-Quentin. il manda la commune de Noyon, et elle y alla pour garder son corps, ce qui nous coûta bien 1.300 livres, et la ville de Noyon fit tout cela pour le comte en l'honneur du roi. Après, au départ de l'armée, on nous fit savoir que le comte avait besoin d'argent et qu'il aurait vilenie si nous ne lui aidions ; nous lui prêtâmes 1.200 livres, dont nous lui abandonnâmes 300 pour avoir le reçu scellé des 900 autres. — Ainsi, l'exploitation des villes, si fidèles, si soumises, par le roi ou en son nom était une des causes du déficit qui légitima leur mise en tutelle. Et les villes ne protestèrent pas : les doléances de Noyon sont bien timides ; on n'en connait pas de plus hardies. Au-dessous des prudentes aristocraties qui gouvernaient les communes, et dans les campagnes, il y avait une immense plèbe obscure, souffrante et barbare, qui ne comptait pas. Une seule fois, au temps de Louis IX, elle émerge en pleine lumière historique, bouleversée par un orage, dans un éclair. — A la nouvelle des malheurs du roi et des croisés en Égypte, vers Pâques .1251, un grand courant de compassion agita les populations mystiques, violentes, du nord de la France. Des bandes de misérables, hommes, femmes et enfants, errèrent de village en village : elles allaient délivrer le roi, conquérir Jérusalem. Bientôt, elles' se formèrent en horde. En chef surgit. Qui était-ce ? D'où venait-il ? les contemporains ne font pas su : ils disent que c'était un vieillard, de soixante ans ou environ, pâle, maigre, avec une longue barbe, qui parlait d'une manière entraînante en français, en tiois et en latin ; on l'appelait le maître de Hongrie ; il passait pour tenir, dans son poing constamment fermé, la charte de la Sainte Vierge qui lui avait confié sa mission. De Brabant, de Hainaut, de Flandre, de Picardie, une cohue de pastoureaux roula en quelques semaines jusqu'à Paris, grossie en chemin de vagabonds, de voleurs et de tilles. Le peuple de France, s'il faut en croire le franciscain Salimbene, était animé contre l'Église officielle qui, après avoir recommandé l'expédition d'Égypte, abandonnait les croisés à leur sort, des sentiments les plus hostiles : Les Français, dit Salimbene, blasphémaient en ce temps-là ; quand les frères prêcheurs et les frères mineurs demandaient l'aumône, les gens grinçaient des dents et, à leur vue, donnaient à d'autres pauvres, en disant : Prends cela, au nom de Mahomet, plus puissant que le Christ. Toujours est-il que les Pastoureaux, qui pourchassaient les clercs, furent d'abord bien accueillis. Ceux d'Amiens, les tenant pour de saintes gens, les avaient ravitaillés. Dans Paris, ils étaient soixante mille, avec armes et bannières. Leur chef, écrivait à ses frères d'Oxford le custos des franciscains de Paris, viole la dignité ecclésiastique ; il maudit les sacrements ; il bénit, le peuple, il prêche, il distribue des croix, il a inventé un nouveau baptême, il fait de faux miracles, il tue les gens d'église. Lors de son arrivée à Paris, telle a été l'émotion populaire contre les clercs que, en peu de jours, on en a tué, jeté à l'eau, blessé un grand nombre ; un curé qui disait sa messe a été dépouillé de sa chasuble, on l'a couronné de roses, par dérision.... Il paraît que le maitre de Hongrie, reçu par la reine Blanche soit à Maubuisson, soit dans une autre des résidences royales des environs, l'avait si bien enchantée que la reine et son conseil tenaient pour bon tout ce qu'il faisait. On dit qu'il monta dans la chaire de l'église Saint-Eustache et prêcha en costume d'évêque, mitre en tête : En quittant Paris, les Pastoureaux, enivrés de leur popularité et de leur force, se divisèrent en plusieurs corps. Les uns allèrent à Rouen ; ils pénétrèrent de force dans la cathédrale et dans la maison archiépiscopale dont ils expulsèrent les clercs. D'autres, sous la conduite du Maitre, firent leur entrée triomphale à Orléans, le 11 juin ; là, le Maitre prêcha encore ; il y eut une bagarre où furent assommés des clercs de l'Université ; comme à Paris, comme à Rouen, comme à Amiens, les bourgeois qui avaient ouvert les portes de leur ville, malgré les représentations de l'évêque, ne s'opposèrent point aux excès. A Tours, les franciscains et les dominicains eurent beaucoup à souffrir de la fureur des Pastoureaux, qui les traînèrent dans les rues, à moitié nus, pillèrent leurs églises et coupèrent, dit-on, le nez d'une statue de la Vierge. — C'est alors, mais alors seulement, que l'on réussit à persuader la reine de mettre la fin à de tels actes. Les clercs racontaient des choses terribles sur le compte du Maitre de Hongrie : c'était un moine apostat, un nécromancien, instruit aux écoles de Tolède, qui avait promis au sultan d'Égypte de lui livrer des chrétiens, les pauvres diables qu'il entraînait à sa suite ; il avait établi la polygamie dans son camp. D'un si dangereux personnage, il fallait se débarrasser. C'était facile : les Pastoureaux se dispersaient de plus en plus ; il y en avait maintenant en Normandie, en Anjou, en Bretagne, en Berry..... — Du jour où la protection tacite de Blanche ne les couvrit plus, les Pastoureaux furent perdus ; cette force aveugle ne pouvait rien contre la force organisée. D'ailleurs, ils se condamnaient eux-mêmes. A Bourges, tous les clercs s'étant retirés avant leur arrivée, ils s'attaquèrent aux Juifs, et même aux bourgeois qui, d'abord, les avaient bien traités. On leur courut sus, et le Maitre de Hongrie périt dans un combat, près de Villeneuve-sur-Cher. Ce qui restait de sa horde fut aussitôt traqué avec ardeur ; les malheureux s'enfuirent dans toutes les directions et on en pendit jusqu'à Aigues-Mortes, jusqu'à Marseille, jusqu'à Bordeaux, jusqu'en Angleterre. On dit, écrit le custos des franciscains de Paris, qu'ils avaient l'intention : 1° de détruire le clergé, 2° de supprimer les moines, 3° de s'attaquer aux chevaliers et aux nobles, afin que cette terre, ainsi privée de tous ses défenseurs, fut mieux préparée aux erreurs et aux invasions des païens. C'est vraisemblable, d'autant plus qu'une multitude de chevaliers inconnus, vêtus de blanc, est apparue en Allemagne..... Mathieu de Paris rapporte que, dans les bagages des Pastoureaux qui furent pris et exécutés en Gascogne, on trouva des poisons en poudre et des lettres du sultan. La mémoire des Pastoureaux fut écrasée sous le poids de ces légendes, vite acceptées par la crédulité publique. — Comme tous les mouvements du même genre, assez fréquents au moyen âge, cette jacquerie anti-cléricale fut absolument stérile. CH.-V. LANGLOIS. Extrait d'un ouvrage eu préparation (1895). |