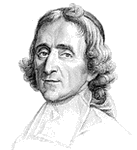FÉNELON
TROISIÈME PARTIE.
|
I. Cependant la condamnation du livre des Maximes n'arrivait pas. Rome hésitait. Le pape Innocent XII dissimulait mal sa conviction secrète de l'innocence de Fénelon, de la pureté de ses mœurs, du charme de sa vertu. Les cardinaux chargés d'examiner son livre se partageaient en égal nombre pour et contre. Bossuet et Louis XIV intervinrent, et dictèrent l'arrêt 'par une lettre impérative au souverain pontife. Je ne puis apprendre sans douleur,
disait le roi au pape, que ce jugement si nécessaire
soit retardé encore par l'artifice de ceux qui ont intérêt à le suspendre. On
ne peut attendre le repos que d'une décision, mais claire, nette, qui ne
puisse recevoir aucune interprétation ambiguë, pour arracher la racine du mal.
Je vous demande ce jugement pour votre propre gloire ; j'ajouterai à tous ces
grands motifs qui doivent vous déterminer la considération que je vous prie
de faire à mes instances, etc. Pendant que cette objurgation au pape partait accompagnée d'une plus sévère réprimande à la mollesse de l'ambassadeur du roi, Louis XIV, devançant la condamnation, se faisait apporter solennellement le tableau des officiers de la maison du duc de Bourgogne, effaçait de sa propre main le nom de Fénelon du rang de précepteur, supprimait ses appointements et faisait fermer sa chambre à Versailles. Proscrit de l'éducation et du palais, Fénelon ne tarda pas à apprendre que l'arrêt de l'Église allait le frapper jusque dans son caractère pontifical. Seigneur, sauvez-nous, nous périssons ! lui écrivait de Rome son fidèle ami l'abbé de Chantérac. Mais nos souffrances seront heureuses si elles servent à défendre le véritable amour de Dieu. Que j'ai de joie quand je pense qu'il nous tiendra unis pendant le temps et l'éternité ! Ah ! combien de fois me dis-je, dans ces jours de troubles et de ténèbres : ALLONS, MOURONS AVEC LUI ! Oui, mourons dans notre innocence ! lui répond Fénelon. Si Dieu ne veut plus se servir de moi dans mon ministère, je ne songerai qu'à l'aimer le reste de ma vie, n'étant plus en situation de le faire aimer des autres ! On lui annonça en même temps la mort de Mme Guyon à la Bastille. C'était un faux bruit, mais Fénelon le croyant vrai : On me mande, écrit-il, que Mme Guyon vient de mourir dans sa captivité. Je dois dire après sa mort ce que j'ai dit pendant sa vie, que je n'ai rien connu d'elle qui ne m'ait puissamment édifié. Fût-elle un ange de ténèbres incarné, je ne pourrais dire d'elle que ce qui m'en a paru sur la terre. Ce serait une lâcheté horrible que de parler ambigument là-dessus pour me tirer moi-même d'appréhension. Je n'ai plus rien à ménager pour elle. La vérité seule me retient. II. Enfin la condamnation obtenue avec tant de peine de la justice et de la bonté d'Innocent XII arriva à Paris avec un cri de joie des ennemis de Fénelon à Rome. Nous vous envoyons la peau du lion que nous avons eu tant de peine à arracher, écrivirent-ils ; du lion qui a étonné tout le monde par ses rugissements depuis tant de mois. Au moment où Fénelon reçut à Cambrai la première nouvelle de sa condamnation, il allait monter dans sa chaire pour parler au peuple sur un sujet sacré qu'il méditait depuis quelques jours. Il n'eut pas le temps d'échanger une seule parole avec son frère, qui lui avait apporté ce coup du sort pour l'adoucir. Les assistants ne le virent ni rougir ni pâlir à cette douleur. Il s'agenouilla seulement un moment le front dans ses mains pour changer le sujet et le plan de son discours, et, se relevant avec la sérénité de son inspiration ordinaire, il parla avec une onction pénétrante sur la soumission sans réserve due, dans toutes les conditions de la vie, à la légitime autorité des supérieurs. Le bruit de sa condamnation, répandu de bouche en bouche par des chuchotements dans sa cathédrale, attirait tous les regards sur lui, et sa résignation invitait aux larmes. Tout 'le troupeau semblait frappé dans le pasteur. Lui seul se sentait soulagé et guéri par la main même qui venait de le frapper ; car sa peine n'était pas dans son orgueil : elle était dans son incertitude de conscience. L'autorité qu'il reconnaissait, en le délivrant de cette incertitude, le délivrait en même temps de son angoisse. Il avait remis sa conscience à l'Église, elle avait prononcé ; il crut entendre la voix de Dieu, et il s'inclina sous l'arrêt. L'autorité a déchargé ma conscience, écrivait-il le soir même de ce jour ; il ne me reste plus qu'à me soumettre et me taire, et à porter en silence mon humiliation. Oserai-je vous dire que c'est un état qui porte avec soi sa consolation pour un homme droit qui ne tient pas au monde ? Il en coûte sans doute à s'humilier ; mais la moindre résistance coûterait cent fois davantage à mon cœur ! Le lendemain il publia une déclaration à ses diocésains, dans laquelle il s'accusa lui-même d'erreur dans son livre des Maximes des Saints. Nous nous consolerons, dit-il dans cette déclaration, l'acte le plus chrétien de sa vie, nous nous consolerons de ce qui nous humilie, pourvu que le ministère de la parole que nous avons reçu du Seigneur pour votre sanctification n'en soit pas affaibli, et que l'humiliation du pasteur profite en grâce et en fidélité au troupeau ! Ce grand acte et ces belles paroles ont été interprétés par les ennemis de Fénelon vivant en sacrifice de son orgueil d'évêque à son orgueil plus grand d'homme de cour. On y a vu la volonté habile d'enlever un prétexte d'éloignement à ses rivaux de faveur, une avance de réconciliation faite aux dépens de sa conscience à Louis XIV, un désaveu lâche et simulé d'opinions religieuses qu'il gardait intactes dans son âme, et qu'il ne condamnait que par politique. Tout homme impartial l'absout de ces calomnies adressées à sa mémoire. Si Fénelon avait eu assez d'ambition mondaine et de dissimulation pour désavouer une opinion qui déplaisait au roi et à la cour, il en aurait eu assez pour ne pas professer cette opinion devant le roi et devant la cour, au risque de la disgrâce et de l'exil qu'il avait volontairement encourus. Sa défaveur durait déjà depuis des années, et ce n'était pas à la fin de son martyre qu'il aurait apostasié sa foi. La vérité est qu'il souffrit pour sa philosophie transcendante et pour sa piété éthérée, tant que cette philosophie et cette piété ne furent réprouvées en lui et en ses amis que par le roi et par le monde ; niais que, le jour où l'autorité religieuse eut prononcé, il sacrifia «sans hésiter à son devoir ce qu'il avait refusé de sacrifier à son ambition. Sans doute l'arrêt officiel de Rome ne changea pas au fond de son cœur ses sublimes convictions sur l'amour désintéressé et absolu de Dieu : il ne crut pas s'être trompé dans ce qu'il sentait ; mais il crut 's'être égaré dans ce qu'il avait exprimé ; il crut surtout que l'Église voulait imposer le silence sur des subtilités qui peuvent troubler les âmes et embarrasser son gouvernement, et il acquiesça avec bonne foi et avec humilité à ce silence. III. Cette humilité et ce silence, qui édifièrent le monde, irritèrent davantage ses ennemis. Ils voulaient un hérésiarque à foudroyer, Fénelon ne leur livrait qu'une victime à admirer. On est très-étonné,
s'écrie Bossuet lui-même, que Fénelon, si sensible à
son humiliation, le soit si peu à son erreur. Il veut qu'on oublie tout, excepté
ce qui l'honore. Tout cela est d'un homme qui veut se mettre à couvert de
Rome, sans avoir aucune vue du bien ! Le génie de ce grand homme ne sert ici qu'à illustrer sa haine ; il l'emporta au tombeau. Sa mort suivit de près son triomphe. Je l'ai pleuré devant Dieu, et j'ai prié pour cet ancien manie de ma jeunesse, écrit alors Fénelon ; mais il est faux que j'aie fait célébrer ses obsèques dans ma cathédrale et que j'aie prononcé son oraison funèbre. De pareilles affectations, vous le savez, ne sont pas dans mon âme. La persécution de Bossuet contre le plus doux des disciples a entaché sa mémoire. Rien ne reste impuni, même sur la terre, des faiblesses du génie. L'ardeur du zèle pour l'unité de foi dans le pontife n'excuse pas la cruauté du polémiste dans la dispute. Bossuet était un prophète biblique, Fénelon un apôtre de l'Évangile : l'un tout terreur, l'autre tout charité. Tout le monde envie Bossuet comme écrivain ; qui voudrait lui ressembler comme homme ? C'est l'expiation des hommes supérieurs qui rie surent pas aimer, de n'être pas aimés après eux dans leur gloire. Mme Guyon, cause de toutes ces agitations, sortit de Vincennes après la mort de Bossuet, et vécut reléguée en Lorraine chez une de ses filles. Elle y mourut de longues années après, dans une renommée de piété et de vertu qui ne se démentit jamais, et qui justifie l'estime de Fénelon. IV. Tout semblait pacifié, et tout promettait à Fénelon un retour prochain auprès de son élève, le duc de Bourgogne, que les années rapprochaient du trône, quand l'infidélité d'un copiste, qui livra aux imprimeurs de Hollande un manuscrit de Télémaque, rejeta pour jamais l'auteur dans la disgrâce de la cour et dans la colère du roi. Télémaque, ainsi dérobé, éclata comme une révélation, et courut avec la rapidité de la flamme. Le temps l'appelait ; les chances de la gloire, de la tyrannie, de la servitude et des malheurs des peuples à la suite des guerres de Louis XIV, avaient soufflé dans toutes les âmes en Europe une sorte de pressentiment de ce livre. C'était la vengeance des peuples, la leçon des rois, l'inauguration de la philosophie et de la religion dans la politique. Une poésie éclatante et harmonieuse y servait d'organe à la vérité, et même à l'illusion. Tout fit écho à cette douce voix d'un pontife législateur et poète, qui venait instruire, consoler et 'charmer le monde. Les presses de la Hollande, de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, ne pouvaient suffire à multiplier les exemplaires du Télémaque au gré de l'avidité des lecteurs. Ce fut en peu de mois l'évangile de l'imagination moderne : il fut classique en naissant. Le bruit en vint à Louis XIV. Ses courtisans, en lui montrant son image dans le faible et dur Idoménée, fléau de ses peuples, lui dirent qu'il fallait être son ennemi pour avoir peint un pareil portrait. On vit une satire sanglante des princes et du gouvernement dans les récits et dans les théories du païen. La malignité publique se complut à donner la figure du roi, des princes, des ministres, des favoris et des favorites, sur tous les personnages dont Fénelon avait composé ses tableaux. Ces portraits, composés ainsi dans le palais de Versailles, sous les auspices de la confiance que le roi avait placée dans le précepteur de son héritier, parurent une trahison domestique. Les beaux rêves de Fénelon, en contraste avec les sombres réalités de la cour et avec les tristesses d'un règne à son déclin, se levèrent comme autant d'accusations contre le monarque. La témérité, la noirceur et l'ingratitude furent imputées à l'imagination d'un poète qui n'avait d'autre tort que d'avoir rêvé et peint plus beau que nature. L'antipathie naturelle de Louis XIV contre Fénelon devint de l'indignation et du ressentiment. Quand on compare le règne et le poème, on ne peut ni s'étonner, ni accuser le roi d'injustice. Un tel livre, composé à l'ombre d'un palais, et publié à l'insu du prince, paraissait en effet la plus sanglante satire et le plus cruel outrage à la confiance intime comme à la majesté du souverain. Fénelon n'avait jamais eu dans l'âme, en l'écrivant, les sinistres allusions et les ingrates dénonciations qu'on lui supposait. Il s'était innocemment livré à sa belle imagination qui colorait tout, et les gouvernements même, de sa perfection morale, de sa candeur et de son amour de l'humanité. Il avait voulu préparer en silence pour son royal élève un modèle de prince et de législation. Ce n'était ni son intention ni sa faute si la splendeur même de la vertu éclatant sur ses interlocuteurs et sur ses personnages rejetait une ombre plus forte sur le règne arbitraire, superbe et persécuteur du roi. La crainte même de ces allusions lui avait fait cacher son poème comme un mystère entre son élève et lui. Il ne comptait jamais en tirer éclat pour sa propre gloire ; il le réservait pour l'instruction et pour la gloire d'un règne futur. Il n'avait jamais recherché la publicité littéraire de ses écrits ; il les avait tous composés pour de petits cercles d'amitié ou de sainteté, dont ils n'étaient sortis que par leur propre rayonnement. C'était ainsi qu'il avait écrit Télémaque. Ce poème, qui, dans sa pensée, ne devait voir le jour qu'après la mort de Louis XIV, avait été écrit dans son cabinet de sa propre main, et plus tard copié par une main dont il se croyait sûr. Il était, après sa mort, légué à sa famille pour en faire l'usage que le temps comporterait. Pour lui, dans sa conscience, la publication de son poème lui causa autant de trouble que de douleur. Il y vit sa condamnation certaine à un éternel exil, et sa situation d'ennemi public dans une cour qui ne lui pardonnerait jamais. V. Il ne se trompait pas. Le soulèvement de la cour contre lui fut soudain. Elle eut le pressentiment du tort que ce livre lui ferait dans la postérité. Elle déguisa mal la terreur sous le dédain. Le livre de Fénelon, dit Bossuet, qui vivait encore à l'époque de son premier bruit, est un roman. Ce livre partage les esprits : la cabale l'admire ; le reste du monde le trouve peu sérieux et peu digne d'un prêtre. Je ne me soucie aucunement de lire Télémaque, écrit Mme de Maintenon. Le roi, qui lisait peu, dédaigna de le lire ; on affecta de l'étouffer sous le silence. Il fut convenu à Versailles qu'on n'en prononcerait pas le titre devant le roi : il le crut oublié, parce qu'il l'oubliait lui-même. Seize ans après que Télémaque, imprimé sous toutes les formes et traduit dans toutes les langues, inondait l'Europe, les orateurs à l'Académie française, en parlant des œuvres littéraires du temps, se taisaient sur le livre en possession du siècle et de la postérité. Cette colère de la cour consterna l'âme du duc de Bourgogne, que la séparation, l'injustice el l'adversité attachaient davantage à son maitre. Ce prince, pour échapper à la jalouse tyrannie de son grand-père, était obligé de faire un mystère de son attachement à Fénelon, et de. cacher comme un crime d'État sa rare correspondance avec son ami. Enfin, lui écrit le jeune
prince, je trouve une occasion de rompre le silence
que je suis contraint de garder depuis quatre ans. J'ai souffert bien des
maux ; mais un des plus grands était de ne pouvoir vous dire ce que je
sentais pour vous pendant ce temps, et que mon amitié augmentait par vos
malheurs, au lieu d'en être refroidie. Je pense avec bonheur au temps où je
pourrai vous revoir ; mais je crains que ce temps ne soit encore bien loin !...
Je continue toujours à étudier seul, et j'y ai plus
de goût que jamais. Rien ne me charme plus que la philosophie et la morale,
et je ne me lasse pas d'y travailler. J'en ai fait quelques petits ouvrages
que je voudrais bien vous envoyer pour être corrigés par vous !... Je ne vous dirai pas ici combien je suis révolté contre tout
ce qu'on fait à votre égard ; mais il faut se soumettre !... Ne montrez cette lettre à personne au monde, excepté à
l'abbé de Langeron, car je suis sûr de son secret... Ne me faites pas de réponse... Fénelon répondait de loin en loin par des lettres où les conseils de l'homme de piété et de l'homme d'État étaient pénétrés de l'onction d'une tendresse paternelle. Sa consolation était dans ce coin retiré du palais de Versailles où il avait laissé son âme, et où il la retrouvait dans son élève qui devait la faire régner un jour. Je ne vous parle que de Dieu et de vous, écrivait-il ; il n'est pas question de moi. Dieu merci, j'ai le cœur en paix. Ma plus rude croix est de ne plus vous voir ; mais je vous porte sans cesse devant Dieu dans, une présence plus intime que celle des sens. Je donnerais mille vies comme une goutte d'eau pour vous voir tel que Dieu vous veut. Amen, amen ! Le duc de Bourgogne, en allant prendre le commandement de l'armée de Flandre dans la campagne de 1708, passa par Cambrai. Le roi était moins préoccupé, dit Saint-Simon, de la décoration de son petit-fils que de la nécessité de son passage par Cambrai, qui ne se pouvait éviter sans affectation. Il eut de sévères défenses, non-seulement d'y coucher, mais de s'y arrêter même pour manger ; et, pour éviter le plus léger particulier avec l'archevêque, le roi lui défendit, de plus, de sortir de sa chaise. Saumery eut ordre de veiller de près à l'exécution de cet ordre ; il s'en acquitta en Argus, avec un air d'autorité qui scandalisa tout le monde. L'archevêque se trouva à la poste ; il s'approcha de la chaise de son pupille dès qu'il arriva, et Saumery, qui venait de mettre pied à terre et lui avait signifié les ordres du roi, fut toujours à son coude. Le jeune prince attendrit la foule qui l'environnait par le transport de joie qui lui échappa, à travers toute sa contrainte, en apercevant 'son précepteur. Il l'embrassa à plusieurs reprises, et le feu de ses regards, lancé dans les yeux de l'archevêque, regards qui suppléèrent à tout ce que le roi avait interdit, eurent une éloquence qui enleva fous les spectateurs. On ne fit que relayer, mais sans se presser ; nouvelles embrassades, et on partit. La scène avait été trop publique et trop curieusement remarquée pour n'être pas rendue de toutes parts. Comme le roi avait été exactement obéi, il ne put trouver mauvais ce qui s'était pu dérober parmi les étreintes ou les regards du prince et de l'archevêque. La cour y fit grande attention, et encore plus celle de l'armée. La considération de l'archevêque qui, malgré sa disgrâce, avait su s'en attirer dans son diocèse et même dans les Pays-Bas, se communiqua à l'armée, et les gens qui songeaient à l'avenir prirent depuis leur chemin par Cambrai plus volontiers qu'ailleurs pour aller eu revenir de Flandre. VI. C'est ici, c'est à Cambrai, pendant les tristes années où l'Europe liguée faisait expier à Louis XIV l'éclat dominateur, les longues prospérités, la gloire hautaine de tout son règne, qu'il faut surtout admirer Fénelon. En se retournant vers le passé, la postérité ne rencontre rien de plus beau, de plus simple, de plus dévoué, de plus sage et de plus respectable ni de plus respecté que cet homme souverainement, aimable, s'appliquant aux devoirs de sa charge. Le prêtre, l'évêque, l'administrateur, rami, le citoyen, l'homme, et, dans chacun, tous les nobles sentiments qui parent la nature humaine, prennent sur cette figure un éclat singulier. C'est surtout au milieu des complications de la guerre malheureuse dont son diocèse est le théâtre et la victime, qu'elle devient la plus touchante personnification de la charité. Des traits charmants, ramenés chaque jour par les misères qui les multiplient en se multipliant, font bénir le nom de Fénelon et surtout sa présence. On se les redit avec amour autour de lui, comme pour en prendre sa part et s'entraider à supporter le malheur des temps. Les imaginations en sont émues, et ajoutent encore à la vérité mille détails qui s'y joignent si naturellement, qu'ils semblent l'idéaliser pour la mieux peindre. Une sorte de légende naît ainsi sous les pas du bon archevêque, et le suit comme la douce odeur de ses vertus. Ces récits ou ces fictions de la charité sont dans toutes les mémoires. Pendant l'hiver et pendant la disette de 1709, cette charité s'exerça avec un zèle plus actif et sous les formes les plus diverses, pour répondre à la triple épreuve de la guerre : du froid et de la famine. Les désastres s'étaient accumulés. Les places fortifiées avec tant de soin par la prudence du roi étaient au pouvoir de l'ennemi. Les troupes, mal payées, désapprenaient l'obéissance et. la discipline, comme elles avaient désappris la victoire. Le trésor était vide. L'inépuisable imagination du fisc était elle-même épuisée, et ne savait plus sous quel prétexte ou par quel appât vénal arracher au pays un dernier écu. La rigueur de l'hiver avait partout stérilisé les semences confiées à la terre. Les hommes mouraient de froid. L'été venu en vit mourir de faim, une poignée d'herbe à la bouche. Dans un grand nombre de villes et de provinces, des séditions étonnèrent ce règne, qui trouvait tout prosterné devant lui. Les exécutions répondirent aux égarements de la misère. La paix, qu'il n'avait jamais su garder, fuyait maintenant les sollicitations humiliées de Louis XIV. L'ambition du prince Eugène et l'avarice de Marlborough prolongeaient la guerre, qui les servait eux et leur gloire. Après Hochstedt et Ramillies, Oudenarde, Lille et Malplaquet semblaient sonner à grands coups rheure de la France. Elle conserva longtemps la cruelle impression et frémit encore au souvenir de cette année où Dieu sembla punir les hommes de leurs discordes, en comblant d'une main sévère la mesure des maux dont ils s'accablaient eux-mêmes. Mais au-dessus de ce triste souvenir, et dans cette impression même, se retrouve le souvenir et l'impression de l'homme divin que la Providence montre et donne comme exemple et consolation, lorsqu'elle frappe. C'est une loi historique. Aux époques de déchirement, les grands hommes et les grandes vertus ; aux désastres., les héros de la charité : aux massacres des Indiens, Las-Casas ; aux guerres de religion, L'Hôpital ; aux vices de son siècle, saint Vincent de Paul ; saint Charles Borromée à Man ; Belzunce à Marseille ; aux bourreaux de la Terreur, leurs victimes. L'année 1709 et la Flandre eurent Fénelon. A ces signes de rédemption, on reconnaît la main qui châtie pour enseigner. Le palais épiscopal de Cambrai fut l'asile de tous les malheurs. Quand il devint trop étroit, Fénelon leur ouvrit son séminaire et loua des maisons dans la ville. Des villages entiers, ruinés par les gens de guerre, venaient se réfugier auprès de lui. Ces pauvres gens étaient reçus comme des enfants, dont les plus malheureux avaient droit aux premiers soins. D'un autre côté, généraux, officiers, soldats malades ou blessés, étaient apportés à cette vaillante charité qui ne compta jamais les misères devant elle. C'est encore Saint-Simon qu'il faut écouter ici. Sa louange est rare et lui fait violence ; mais, quand il s'agit de Fénelon, il est contraint d'essuyer tout le fiel de sa plume : Sa maison ouverte, et sa table de
même, avait l'air de celle d'un gouverneur de Flandre, et tout à la fois d'un
palais vraiment épiscopal, et toujours beaucoup de gens de guerre distingués,
et beaucoup d'officiers particuliers, sains, malades, blessés, logés chez
lui, défrayés et servis, comme s'il n'y en eût eu qu'un seul, et lui
ordinairement présent aux consultations des médecins et des chirurgiens ; il
faisait, d'ailleurs, auprès des malades et des blessés les fonctions du
pasteur le plus charitable, et souvent il allait exercer le même ministère
dans les maisons et les hôpitaux où l'on avait dispersé les soldats, et tout
cela sans oubli, sans petitesse, et toujours prévenant avec les mains
ouvertes. Une libéralité bien entendue, une magnificence qui n'insultait
point et qui se versait sur les. officiers et les soldats, qui embrassait une
vaste hospitalité, et qui, pour la table, les meubles et les équipages,
demeurait dans les justes bornes de sa place ; également officieux et modeste,
secret dans les assis-tances qui pouvaient se cacher, et qui étaient sans
nombre ; leste et délié sur les autres jusqu'à devenir l'obligé de ceux à qui
il les donnait, et à le persuader ; jamais empressé, jamais de compliments,
mais d'une politesse qui, en embrassant tout, était toujours mesurée et
proportionnée, en sorte qu'il semblait à chacun qu'elle n'était que pour lui,
avec cette précision dans laquelle il excellait singulièrement ; aussi
était-il adoré de tous. L'admiration et le dévouement pour lui étaient dans
le cœur de tous les habitants des Pays-Bas, quels qu'ils fussent, et de
toutes les dominations qui les partageaient, dont il était l'amour et la
vénération. VII. Voilà donc Fénelon à l'œuvre. Il se donne aux malheureux ; il fait mieux que les secourir et les soigner, il vit avec eux. Chez lui, dans les hôpitaux, par la ville, il est partout où sa présence est bonne. Ni misères rebutantes, ni maladies infectes ne l'arrêtent. Après ce que lui inspire le plus ardent désir de soulager ceux qui souffrent, il a mieux que le remède ou l'aumône, il a son regard, un mot tendre, un soupir, une larme. Il pense à tout, il pourvoit à tout, il descend au plus petit détail. Rien ne lui semble au-dessous de ses soins, mais rien ne le surcharge. Ce n'est là que l'exercice naturel de son cœur. Il conserve une entière liberté d'esprit. Il prie, il médite comme un solitaire derrière le cloître. Comme un homme qui occupe ses loisirs, il entretient une correspondance étendue, officieuse et serviable, ou sérieuse, appliquée, pleine de lumières, avec les hommes les plus considérables, et souvent sur les affaires les plus épineuses ou les questions les plus ardues. Évêque et théologien, il compose plusieurs ouvrages, instructions et mémoires sur les sujets difficiles qui, en ce moment même, occupent l'Église de France. Ses forces et ses ressources semblent intarissables, comme s'il n'avait qu'à les puiser dans son âme. Sévère et retranché pour lui-même, il mange seul et ne vit que de légumes. Il ne partage même pas ce qu'il offre ; il ne s'accorde rien de ce qu'il peut s'ôter pour les autres. VIII. Le culte et la vénération que son nom inspirait traversaient ces lignes ennemies que nos armes ne savaient plus rompre. Seul et sans protection, il pouvait parcourir son diocèse. On vit la plus décriée de toutes les troupes, les hussards impériaux, l'accompagner et s'improviser en escorte pour lui dans une de ses courses pastorales. Les terres qui lui appartenaient, respectées par ordre d'Eugène et de Marlborough, devenaient un refuge pour les paysans du voisinage qui, à l'approche des gens de guerre, y couraient avec leurs familles et tout ce qu'ils pouvaient emporter. Souvent, pour mieux protéger ses grains, ses bois, ses prairies contre les maraudeurs, les généraux ennemis prirent le soin d'y mettre des gardes. Un jour même des chariots chargés de blé arrivèrent sur la place d'armes de Cambrai, escortés par les troupes de Marlborough. Craignant que la rareté des subsistances ne lui permit pas de faire respecter plus longtemps ces blés dans la petite ville de Cateau-Cambrésis, où Fénelon les avait déposés, le général anglais les avait fait enlever et conduire dans la ville française, en vue de son propre camp. C'est le privilège des belles âmes, de monter ainsi les autres à leur diapason, et d'inspirer comme de faire les nobles actions. Le saint archevêque honorait jusqu'aux ennemis de son pays par le respect qu'ils avaient pour lui. IX. Le dévouement de Fénelon ne se borna pas à des actes particuliers : il put s'élever au noble rôle d'assistance publique. Il porta secours à son pays. Les témoignages d'admiration dont il était l'objet servirent la France. Au moment où notre armée sans subsistances allait mourir de faim, il eut la gloire (il n'y en eut jamais de plus pure ni de plus personnelle), il eut la gloire de la sauver. Il livra ses magasins aux ministres de la guerre et des finances ; et quand le contrôleur général l'invita à fixer lui-même le prix du blé que la nécessité rendait si précieux : Je vous ai abandonné mes blés monsieur, répondit-il ; ordonnez ce qu'il vous plaira ; tout sera bon. Il écrivait en même temps au duc de Chevreuse : Si on manquait d'argent pour de si pressants besoins, j'offre ma vaisselle d'argent et tous mes autres effets, ainsi que le peu qui me reste de blé. Je voudrais servir de mon argent et de mon sang, et non faire ma cour. Et quand tous les efforts et tous les sacrifices ne suffisaient plus à subvenir aux nécessités les plus urgentes de l'armée et des habitants de la Flandre, il adressait à l'intendant de l'armée cette lettre qui peint au vif les misères avec lesquelles était aux prises : Monsieur, je ne puis m'empêcher
de faire ce que notre ville et notre pays désolé me pressent d'exécuter. Il
s'agit de vous supplier instamment d'avoir la bonté de nous procurer les
secours que vous nous avez promis de la part du roi. Ce pays et cette ville
n'ont pour cette année d'autre ressource que celle de l'avoine, le blé ayant
absolument manqué. Vous jugez bien, monsieur, que les armées qui sont presque
à nos portes, et qui ne peuvent subsister que par les derrières, enlèvent une
grande partie de l'avoine qui est sur la campagne. Il en périt beaucoup plus
par le dégât et par le ravage que par les fourrages réglés... Il ne s'agit plus de froment, qui est monté jusqu'à un
prix énorme où les familles même les plus honnêtes ne peuvent plus en acheter
; sa rareté est extrême. L'orge nous manque entièrement. Le peu d'avoine qui
nous restera peut-être ne saurait suffire aux hommes et aux chevaux. Il
faudra que les peuples périssent ; et l'on doit craindre une contagion qui
passera bientôt d'ici jusqu'à Paris... De
plus, vous comprenez, monsieur, mieux que personne, que si les peuples ne
peuvent ni semer ni vivre, vos troupes ne pourront pas subsister sur cette
frontière sans habitants qui leur fournissent les choses nécessaires. Vous
voyez bien aussi que, l'année prochaine, la guerre deviendrait impossible à
soutenir dans un pays détruit. Le pays où nous sommes se trouve tout auprès
de cette dernière extrémité : nous ne pouvons plus nourrir nos pauvres, et
les riches tombent en pauvreté. Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire que le
roi aurait la bonté de faire venir dans ce pays beaucoup de grains de mars,
c'est-à-dire d'orge et d'avoine : c'est l'unique moyen de sauver une
frontière si voisine de Paris et si importante pour la France. Je croirais
manquer à Dieu et au roi, si je ne vous représentais pas fidèlement notre
état. Nous attendons tout de la compassion de Sa Majesté pour des peuples qui
ne lui montrent pas moins de fidélité et d'affection que les sujets de
l'ancien royaume... X. Cependant le roi vieillissait ; une maladie rapide enleva à Meudon le père du duc de Bourgogne, fils de Louis XIV, qui devait régner avant le disciple de Fénelon. Les courtisans, qui ne voyaient plus de degrés entre le trône et le duc de Bourgogne, commencèrent à tourner leurs regards vers le soleil levant, et à apercevoir de nouveau Fénelon derrière lui. Le tableau que Saint-Simon, ce lynx des cours, trace de cette mort du grand dauphin, père au duc de. Bourgogne, fait entrer le jour vrai jusque dans les cœurs les plus ténébreux. Jamais le voile des intérêts, des égoïsmes, des douleurs simulées, des joies secrètes, des espérances retournées du couchant au levant, de la tombe au trône, ne fut si impitoyablement déchiré par la plume du grand satiriste. Tandis que Meudon était rempli d'horreur, tout était tranquille à Versailles, sans en avoir le moindre soupçon. Nous avions soupé. La compagnie, quelques heures après, s'était retirée, et je causais avec Mme de Saint-Simon, prête à se mettre au lit, lorsqu'un valet de chambre de Mme la duchesse de Berri entra tout effarouché ; il nous dit qu'il y avait de mauvaises nouvelles de Meudon. Je courus chez Mme la duchesse de Berri aussitôt ; il n'y avait plus personne ; ils étaient tous allés chez Mme la duchesse de Bourgogne : j'y poussai tout de suite. J'y trouvai tout Versailles rassemblé ou y arrivant ; toutes les dames en déshabillé, la plupart prêtes à se mettre au lit, toutes les portes ouvertes, et tout en trouble. J'appris que Monseigneur avait reçu l'extrême-onction, qu'il était sans connaissance et hors de toute espérance, et que le roi avait mandé à Mme la duchesse de Bourgogne qu'il s'en allait à Marly, et de le venir attendre dans l'avenue entre les deux écuries pour le voir en passant. Ce spectacle attira toute
l'attention que j'y pus donner par les divers mouvements de mon âme et ce qui
tout à la fois se présenta à mon esprit. Les deux princes et les deux
princesses étaient dans le petit cabinet derrière la ruelle du lit. La
toilette pour le coucher était à l'ordinaire dans la chambre de Mme la
duchesse de Bourgogne, remplie de toute la cour en confusion. Elle allait et
venait du cabinet dans la chambre, en attendant le moment d'aller au passage
du roi ; et son maintien, toujours avec ses mêmes grâces, était un maintien
de trouble et de compassion que celui de chacun semblait prendre pour sa
douleur. Elle disait ou répondait en passant devant les uns et les autres
quelques mots rares. Tous les assistants étaient des personnages vraiment expressifs
; il ne fallait qu'avoir des yeux sans aucune connaissance de la cour pour
distinguer les intérêts peints sur les visages, ou le néant de ceux qui n'étaient
de rien : ceux-ci tranquilles à eux-mêmes, les autres pénétrés de douleur ou
de gravité et d'attention sur eux-mêmes pour cacher leur élargissement et
leur joie. Mon premier mouvement fut de
m'informer à plus d'une fois, de ne croire qu'a peine au spectacle, et aux
paroles ; ensuite de craindre trop peu de cause pour tant d'alarme ; enfin,
de retour sur moi-même par la considération de la misère commune à tous les
hommes, et que moi-même je me trouverais un jour aux portes de la mort. La
joie néanmoins perçait à travers les réflexions momentanées de religion et
d'humanité par lesquelles j'essayais de me rappeler. Ma délivrance
particulière me semblait si grande et si inespérée, qu'il me semblait, avec
une évidence encore plus parfaite que la vérité, que l'État gagnait tout en
une telle perte. Parmi ces pensées, je sentais malgré moi un reste de crainte
que le malade en réchappât, et j'en avais une extrême honte. Enfoncé de la sorte en moi-même, je ne laissai pas de mander à Mme de Saint-Simon qu'il était à propos qu'elle vint, et de percer de mes regards clandestins chaque visage, chaque maintien ; chaque mouvement ; d'y délecter ma curiosité, d'y nourrir les idées que je m'étais formées de chaque personnage, qui ne m'ont guère trompé, et de tirer de justes conjectures de la vérité de ces premiers élans dont on est si rarement maitre, et qui par là à qui connaît la carte et les gens, deviennent des inductions sûres des liaisons et des sentiments les moins visibles en tout autre temps rassis. Je vis arriver Mme la duchesse d'Orléans, dont la contenance majestueuse et compassée ne disait rien ; quelques moments après passa M. le duc de Bourgogne, avec un air fort ému et peiné ; mais le coup d'œil que j'assénai vivement, sur lui ne m'y rendit rien de tendre, et ne me rendit que l'occupation profonde d'un esprit saisi. Valets et femmes de chambre
criaient déjà indiscrètement, et leur douleur prouva bien tout ce que cette
espèce de gens allait perdre. Vers minuit et demi, on eut des nouvelles du
roi ; et aussitôt je vis Mme la duchesse de Bourgogne sortir du petit cabinet
avec Mgr le duc de Bourgogne, l'air alors plus touché qu'il ne m'avait paru
la première fois, et qui rentra aussitôt dans le cabinet. La princesse prit à
sa toilette son écharpe et ses coiffes ; debout et d'un air délibéré,
traversa la' chambre, les yeux à peine mouillés, mais trahie par de curieux
regards lancés de part et d'autre à la dérobée, et suivie seulement de ses
dames, gagna son carrosse par le grand escalier. Comme elle sortait de sa chambre, je pris mon temps pour aller chez Mme la duchesse d'Orléans, avec qui je grillais d'être. Entrant chez elle, j'appris qu'ils étaient chez Madame. Je poussai jusque là à travers leurs appartements. Je trouvai chez elle Mme la duchesse d'Orléans avec. cinq ou six de ses dames familières. Je pétillais cependant de tant de compagnie ; Mme la duchesse d'Orléans, qui n'en était pas moins importunée, prit une bougie.et passa derrière sa chambre. J'allai alors dire un mot à l'oreille à la duchesse de Villeroy ; elle et moi pensions de même sur l'événement présent. Elle me poussa, et nie dit tout bas de me contenir. J'étouffais de silence parmi les plaintes et les surprises narratives de ces dames, lorsque M. le duc d'Orléans parut à la porte du cabinet et m'appela. Je le suivis dans son arrière-cabinet
en bas sur la galerie, lui près de se trouver mal, et moi les jambes
tremblantes de tout ce qui se passait sous mes yeux et au dedans de moi. Nous
nous assîmes par hasard vis-à-vis l'un de l'autre ; mais quel fut mon
étonnement lorsque, incontinent après, je vis les larmes lui tomber des yeux
: Monsieur ! m'écriai-je en me levant dans l'excès de ma surprise. Il
me comprit aussitôt, et me répondit d'une voix coupée et pleurant véritablement
: Vous avez raison d'être surpris, et je le suis moi-même ; mais le
spectacle touche. C'est un bon homme avec qui j'ai passé ma vie ; il m'a bien
traité et avec amitié, tant qu'on l'a laissé faire et qu'il a agi lui-même. Je
sens bien que l'affliction ne peut être longue : dans quelques jours je
trouverai tous les motifs de me consoler dans l'état où l'on m'avait mis avec
lui ; niais présentement le sang, la proximité, l'humanité, tout touche, et
les entrailles s'émeuvent. Je louai ce sentiment, et le prince se leva,
se mit la tête dans un coin, le nez dedans, et pleura amèrement et à sanglots
: chose que, si je n'avais vue, je n'eusse jamais crue. Je l'exhortai à se
calmer ; il y travaillait, lorsqu'il fut averti que Mme la duchesse de
Bourgogne arrivait : il la fut joindre, et je le suivis. Mme la duchesse de Bourgogne,
arrêtée dans l'avenue entre les deux écuries, n'avait attendu le roi que fort
peu de temps. Dès qu'il approcha, elle mit pied à terre et courut à sa
portière. Mme de Maintenon, qui était de ce même côté, lui cria : Où allez
vous, madame ? N'approchez pas ; nous sommes pestiférés. Je n'ai point su
quel mouvement fit le roi, qui ne l'embrassa pas à cause du mauvais air. La
princesse à l'instant regagna son carrosse et s'en revint. La princesse, à son retour, trouva les deux princes et Mme la duchesse de Berri avec le duc de Beauvilliers qu'elle avait fait appeler. Les deux princes, ayant chacun sa princesse à son côté, étaient assis sur un même canapé près des fenêtres, le dos à la galerie ; tout le monde épars, assis et debout, et en confusion dans ce salon, et-les darnes les plus familières par terre, aux pieds ou proche du canapé des princes. Là dans la chambre et par tout l'appartement, on lisait apertement sur les visages. Monseigneur n'était plus ; on le savait, on le disait ; nulle contrainte ne retenait plus à son égard, et ces premiers moments étaient ceux des premiers mouvements peints au naturel, et pour lors affranchis de toute politique, quoique avec sagesse, par le trouble, l'agitation, la surprise, la foule, le spectacle confus de cette nuit si rassemblée. Les premières pièces offraient
les mugissements continus des valets ; plus avant commençait la foule des
courtisans de toute espèce. Le plus grand nombre, c'est-à-dire les sots,
tiraient des soupirs de leurs talons, et, avec des yeux égarés et secs,
louaient Monseigneur, mais toujours de la même louange, c'est-à-dire de
bonté, et plaignaient le roi de la perte d'un si bon fils. Les plus fins
d'entre eux, ou les plus considérables, s'inquiétaient déjà de la santé du
roi ; ils se savaient bon gré de conserver tant de jugement parmi ce trouble,
et n'en laissaient pas douter par la fréquence de leurs répétitions.
D'autres, vraiment affligés et de cabale frappée, pleuraient amèrement ou se
contenaient avec un effort aussi aisé à remarquer que les sanglots. Parmi ces
diverses sortes d'affligés, point ou peu de propos, de conversation nulle,
quelque exclamation parfois échappée à la douleur et parfois répondue par une
douleur voisine ; un mot en un quart d'heure, des yeux sombres ou hagards,
des mouvements de mains moins rares qu'involontaires, immobilité du reste
presque entière. Les simples curieux et peu soucieux presque nuls, hors les
sots, qui avaient en partage le caquet, les questions, le redoublement du
désespoir et l'importunité pour les autres. Ceux qui déjà regardaient cet
événement comme favorable avaient beau pousser la gravité jusqu'au maintien
chagrin et austère, le tout n'était qu'un voile clair qui n'empêchait pas de
bons yeux de remarquer et de distinguer tous leurs traits. Ceux-ci se tenaient
aussi tenaces que les plus touchés ; mais leurs yeux suppléaient au peu
d'agitation de leurs corps. Des changements de posture, comme des gens peu
assis ou mal debout, un certain soin de s'éviter les uns les autres, même de
se rencontrer des yeux ; les accidents momentanés qui arrivaient à ces
rencontres ; un je ne sais quoi de plus libre en toute la personne, à travers
le soin de se tenir et de se composer ; vit, une sorte d'étincelant autour
d'eux, les distinguaient malgré qu'ils en eussent. Les deux princes et les deux
princesses assises à leurs côtés, prenant soin d'eux, étaient les plus exposés
à la pleine vue. Mgr le duc de Bourgogne pleurait d'attendrissement et de
bonne foi, avec un air de douceur, des larmes de nature, de religion, de
patience. M. le duc de Berri, tout d'aussi bonne foi, en versait en
abondance, mais des larmes pour ainsi dire sanglantes, tant l'amertume en
paraissait grande, et poussait, non des sanglots, mais des cris, des
hurlements. Cela lut au point qu'il fallut le déshabiller là même et se précautionner
de remèdes et de gens de la faculté. Mme la duchesse de Berri était hors
d'elle le désespoir le plus amer était peint avec horreur sur son visage ; on
y voyait comme écrite une rage de douleur, non d'amitié, mais d'intérêt.
Souvent réveillée par les cris de son époux, prompte à le secourir, à le
soutenir, on voyait un soin vif de lui, mais tôt après une chute profonde en
elle-même. Mme la duchesse de Bourgogne consolait aussi son époux, et y avait
moins de peine qu'à acquérir le besoin d'être elle-même consolée. Quelques
larmes amenées du spectacle, et souvent entretenues avec soin, fournissaient
à l'art du mouchoir pour rougir et grossir les yeux et barbouiller le visage
; et cependant le coup d'œil fréquemment dérobé se promenait sur l'assistance
et sur la contenance de chacun. Le duc de Beauvilliers, debout auprès d'eux, l'air tranquille et froid, donnait ses ordres pour le soulagement des princes. Madame, rhabillée en grand habit, arriva hurlante, ne sachant bonnement ni l'un ni l'autre, les inonda tous de ses larmes en les embrassant, lit retentir le château d'un renouvellement de cris, et fournit un spectacle bizarre d'une princesse qui se remet en cérémonie en pleine nuit pour venir pleurer et crier parmi une foule de femmes en déshabillé de nuit, presque en mascarade. Mme la duchesse d'Orléans, quelques-unes de ses dames, affectées de même à l'égard de l'événement, s'étaient retirées dans le petit cabinet. Elles y étaient quand j'arrivai. Je voulais douter encore, quoique
tout me montrât ce qui était ; mais je ne pus me résoudre à m'abandonner à le
croire que le mot ne m'en fût prononcé par quelqu'un à qui on pût ajouter
foi. Le hasard me fit rencontrer M. d'O, à qui je le demandai, et qui me le
dit nettement. Cela su, je tâchai de n'en être pas bien aise ; je ne sais pas
trop si je réussis bien, mais au moins est-il vrai que ni joie ni douleur
n'émoussèrent ma curiosité, et qu'en prenant bien garde de conserver toute
bienséance, je ne me crus pas engagé par rien au personnage douloureux. Je ne
craignais plus le retour du feu de la citadelle de Meudon, ni les cruelles
courses de son implacable garnison, et je me contraignis moins qu'avant le
passage du roi pour Marly de considérer plus librement toute cette nombreuse
compagnie, d'arrêter mes yeux sur les plus touchés et sur ceux qui l'étaient
moins, de suivre les uns et les autres de mes regards et de les en percer
tous à la dérobée. Il faut avouer que pour qui est bien au fait de la carte
intime d'une cour, les premiers spectacles d'événements rares de cette
nature, si intéressante à tant de divers égards, sont d'une satisfaction
extrême. Chaque visage vous rappelle les soins, les intrigues, les sueurs
employés à l'avancement des fortunes, à la formation, à la force des cabales
; les adresses à se maintenir et en écarter d'autres, les moyens de toute
espèce mis en œuvre pour cela ; les liaisons plus ou moins avancées, les
éloignements, les froideurs, les haines, les mauvais offices, les manèges,
les avances, les ménagements, les
petitesses, les bassesses de chacun ; les déconcertements des uns au milieu
de leur chemin, au milieu ou au comble de leurs espérances ; la stupeur de
ceux qui en jouissaient en plein, le poids donné du même coup à leurs contraires
et à la cabale opposée ; la vertu de ressort qui pousse dans cet instant
leurs menées et leurs concerts à bien ; la satisfaction extrême et inespérée
de ceux-là (et j'en étais
des plus avant), la rage qu'en conçoivent les
autres, leurs embarras et leur dépit à le cacher. La promptitude des yeux à
voler partout en sondant les âmes, à la faveur de ce premier trouble de
surprise et de dérangement subit, la combinaison de tout ce qu'on y remarque,
l'étonnement de ne pas trouver ce qu'on avait cru de quelques-uns, faute de
cœur ou d'esprit en eux, et plus en d'autres qu'on n'avait pensé ; tout cet
amas d'objets vifs et de choses si importantes forme un plaisir à qui le sait
prendre, qui, tout peu solide qu'il devient, est un des plus grands. dont on
puisse jouir dans une cour. Mais celui de tous,
continue Saint-Simon, à qui cet événement fut le
plus sensible, fut Fénelon. Quelle longue préparation de son esprit à cette
mort ! Quelle approche d'un triomphe sûr et complet ! Quel puissant rayon de
lumière vint à percer tout à coup une demeure de ténèbres ! Confiné depuis
douze ans dans son diocèse, ce prélat y vieillissait sous le poids inutile de
ses espérances, et voyait les années s'écouler dans une uniformité qui ne
pouvait que le désespérer. Toujours odieux au roi, à qui personne n'osait
prononcer son nom, même en choses indifférentes ; plus odieux encore à Mme de
Maintenon, parce qu'elle l'avait perdu !... plus
en butte que tout autre à la' terrible cabale qui disposait du dauphin mort,
il n'avait de ressource que dans l'inaltérable amitié de son pupille, devenu
lui-même victime de cette cabale, et qui, selon le cours ordinaire de la
nature, devait l'être trop longtemps pour que son précepteur pût se flatter
d'y survivre.... En un clin d'œil ce pupille
devient dauphin, en un autre clin d'œil il parvient à une sorte d'avant-règne. XI. La cour tout entière eut l'arrière-pensée de Fénelon à cet événement ; son nom se présenta comme un remords ou comme une espérance à tous. On crut le voir régner dans un lointain qu'une mort si soudaine et si inattendue rapprochait des imaginations. La conduite du roi envers son petit-fils tenu jusque-là dans l'ombre par son grand-père, redoubla l'inquiétude chez les uns, l'espoir chez les autres. Louis XIV retint un matin le jeune prince dans son cabinet au moment du conseil, et ordonna à tous les ministres d'aller travailler chez le duc de Bourgogne toutes les fois que ce prince les appellerait, et, dans le cas où il ne les appellerait pas, d'aller d'eux-mêmes lui rendre compte des affaires de l'État comme au roi lui-même. Ce fut, dit l'historien des Mystères du Palais, le coup de foudre pour les ministres, presque tous ennemis du prince et de Fénelon. Quelle chute pour de tels hommes, ajoute-t-il, que d'avoir à compter avec un prince qui n'avait plus rien entre le trône et lui., qui était capable, éclairé, d'un esprit juste et supérieur ; qui pesait tout au poids de sa conscience, et qui, de plus, était secrètement en confidence d'âme et de cœur avec Fénelon ! Ce changement était l'œuvre de Mme de Maintenon, à qui le jeune prince, conseillé par Fénelon, avait témoigné une déférence flatteuse pour son amour-propre et rassurante pour son avenir. Elle avait senti, à travers la mort du dauphin, le frisson d'un règne futur. Pour s'assurer éventuellement une prolongation d'influence, elle voulait acheter la reconnaissance du successeur. Elle avait passé, le lendemain des funérailles du dauphin, dans le parti qu'elle avait tenu jusque-là écarté de la faveur. Le roi, qui ne pensait plus que par elle, sembla préparer lui-même la transition de sa tombe au trône de son petit-fils. XII. Fénelon, relevé de son découragement par cette main de la mort qu'il prit pour la main de Dieu, jeta un cri de délivrance et de joie sévère vers son élève. Dieu, lui écrivait-il, vient de frapper un grand coup ! mais sa main est souvent miséricordieuse jusque dans ses coups les plus rigoureux. Ce spectacle affligeant est donné au monde pour montrer aux hommes éblouis combien les princes, si grands en apparence, sont petits en réalité. Heureux ceux qui n'ont jamais regardé leur autorité que comme un dépôt qui leur est confié pour le seul bien des peuples ! Il est temps de se faire aimer, craindre, estimer ! Il faut de plus en plus tacher de plaire au roi, de s'insinuer dans son cœur, de lui faire sentir un attachement sans bornes, de le ménager, de le soulager par des assiduités et des complaisances convenables. Il faut devenir le conseil du roi, le père des peuples, la consolation des opprimés, la ressource des malheureux, l'appui de la nation.... Écarter les flatteurs, distinguer le mérite, le chercher, le prévenir, apprendre à le mettre en œuvre ; se rendre supérieur à tous.... Il faut vouloir être le père, et non le maitre ; il ne faut pas que tous soient à un seul, mais un seul à tous pour faire leur bonheur. Ces conseils directs de Fénelon étaient commentés tous les jours par les avis plus intimes qu'il faisait parvenir au prince par ses deux amis, le duc de Beauvilliers et le duc de Chevreuse. Qu'il détrompe le public, leur écrit Fénelon, sur les petitesses de piété scrupuleuse qu'on lui impute ; qu'il soit sévère pour lui-même en son particulier, mais qu'il ne fasse point craindre à la cour une réforme sévère dont le monde n'est pas capable. ne doit dire que ce qu'on peut porter : point de puérilités ni de minuties en religion.... On apprend plus à gouverner les hommes en les étudiant qu'en étudiant les livres ! XIII. Le palais jusque-là désert de Fénelon à Cambrai devint le vestibule de la faveur. Les courtisans et les ambitieux, qui s'étaient écartés douze ans, comme d'une contagion, de la disgrâce de Fénelon, y accoururent sous tous les prétextes. Chacun voulait prendre les gages du crédit futur. Il reçut tout le monde avec cette grâce naturelle qui le faisait régner par anticipation sur les cœurs : il régnait en effet déjà dans ses pensées. Les mémoires sur le gouvernement qu'il adressait par le duc de Chevreuse au dauphin, étaient une constitution tout entière de la monarchie. Ses réformes politiques avaient passé de la poésie dans la réalité ; mais elles s'y étaient dépouillées des chimères qui les décréditaient dans le Télémaque, et elles y portaient l'empreinte de la maturité, de la réflexion et de la pratique. Le saint était devenu ministre, et le porte homme d'État. On y trouve tout ce qui s'est accompli, tenté ou préparé depuis pour l'amélioration du sort des peuples : Le service militaire réduit à cinq ans de présence sous les drapeaux ; Les pensions aux invalides servies dans leurs familles pour être dépensées dans leurs villages ; au lieu d'être dilapidées dans l'oisiveté et dans la débauche du palais des Invalides dans la capitale ; Jamais de guerre générale contre toute l'Europe ; Un système d'alliances variant avec les intérêts légitimes de la patrie ; Un état régulier et public des recettes et des dépenses de l'État ; Une assiette fixe et cadastrée des impôts, le vote et la répartition de ces subsides par les représentants des provinces ; Des assemblées provinciales ; La suppression de la survivance et de l'hérédité des fonctions ; Lee états généraux du royaume convertis en assemblées nationales ; La noblesse dépouillée de tout privilège et de toute autorité féodale, réduite à une illustration consacrée par le titre de la famille ; La justice gratuite et non héréditaire ; La liberté réglée de commercer ; L'encouragement aux manufactures ; Les monts-de-piété, les caisses d'épargne ; Le sol français ouvert de plein droit à tous les étrangers qui voudraient s'y naturaliser ; Les propriétés de l'Église imposées au profit de l'État ; Les évêques et les ministres du culte élus par leurs pairs ou par leur peuple ; La liberté des cultes ; L'abstention du pouvoir civil dans la conscience du citoyen, etc. Tels étaient les plans tout prêts de Fénelon pour. le moment qui l'appellerait au ministère. Si le duc de Bourgogne avait vécu, et si Fénelon avait conservé sur lui l'ascendant que tant d'années d'absence avaient respecté, 1789 aurait commencé en 1715, et la monarchie, réformée, n'eût été que la république chrétienne avec une tête. Mais il n'est jamais donné à un seul homme de devancer un peuple. La Providence allait renverser dans la tombe prématurée du pince les idées, les plans, les vertus, les rêves, l'ambition, l'espoir et la vie du philosophe. XIV. Un vent de mort soufflait sur la famille royale ; tout tombait d'avance autour de Louis XIV, prêt à tomber. La duchesse de Bourgogne, les délices de la cour et la passion de son mari, inopinément frappée, entraina son mari au tombeau. Le coup fut aussi prompt que terrible. Fénelon n'eut pas le temps d'y préparer son cœur ; il apprit presque en même temps la maladie et la mort de son élève. Cet élève était devenu la perspective de la France ; elle attendait son règne comme celui de la vertu et de la félicité publique. Fénelon avait corrigé et achevé dans cette âme l'œuvre ébauchée par la nature d'un prince accompli. Quel amour du bien s'écrie le
moins adulateur des historiens ; quel dépouillement de soi-même ! quelle
pureté d'intention ! quels effets de la divinité dans cette âme candide,
simple et forte, qui, autant qu'il est donné à l'homme ici-bas, en avait
conservé l'empreinte ! quels vifs élans d'actions de grâce dans l'agonie,
d'être préservé du sceptre et des comptes qu'il en faut rendre ! quel ardent
amour de Dieu ! quel perçant regard sur son néant ! quelle magnifique idée de
l'infinie miséricorde ! quelle confiance tempérée ! quelle sage paix ! quelle
invincible patience ! quelle douceur ! quelle charité pure qui le pressait
d'aller à Dieu !... La France enfin tombe
sous ce dernier châtiment ; Dieu lui montra un prince qu'elle ne méritait pas
: la terre n'en était pas digne !... Or, ce prince, ces vertus, ces saintetés, ces espérances montrées et perdues, c'était Fénelon qui les avait faites ! C'était le maitre qui disparaissait dans le disciple ; c'était Fénelon qui mourait avec le duc de Bourgogne. Il ne laissa échapper qu'un mot : Tous mes liens sont rompus... rien ne n'attache plus à la terre !... Sa vie, en effet, était désormais sans mobile, il en avait perdu le but. Ce règne qu'il avait rêvé pour le genre humain était enseveli avec le Germanicus de la France : Il l'a montré au monde, et il l'a détruit, écrit-il quelques semaines après au duc de Chevreuse, confident de ses larmes. Je suis frappé d'horreur, et malade sans maladie, de saisissement. En pleurant le prince mort, je m'alarme pour les vivants. Il faut que le roi fasse la paix. Si nous allions tomber dans les orages d'une minorité ! Sans mère, sans régent, avec une guerre malheureuse au dehors, tout épuisé au dedans !... Je donnerais ma vie, non-seulement pour l'État, mais encore pour les enfants de notre cher prince, qui vit plus en moi encore que pendant sa vie. Il conseillait avec passion au duc de Beauvilliers d'aller entretenir Mme de Maintenon de la nécessité urgente pour le roi de former un conseil de gouvernement à la tête duquel seraient ses vertueux amis. J'espère peu, dit-il, de cette favorite surannée, pleine des ombrages, des jalousies, des petitesses, des aversions, des dépits et des finesses de femmes ; mais enfin Dieu se sert de tout ! Il conjure le duc de Chevreuse de ne pas refuser, par une funeste modestie, d'entrer dans le conseil de régence. Ce gouvernement, composé de ceux qu'il inspirait depuis tant d'années, aurait été encore celui du duc de Bourgogne. Fénelon poursuivait le rêve de sa vie pour le bonheur des peuples jusque dans le Sépulcre du prince pour lequel il avait rêvé ; il voulait le faire régner après sa mort. Dans cette pensée qui le travailla jusqu'à la fin, il tremblait que le roi ne découvrit dans les papiers du duc de Bourgogne un écrit qui aurait paru à ce prince un crime plus impardonnable que le Télémaque : c'était la Direction pour la conscience d'un roi ; code de piété, de tolérance, de devoir envers les peuples, dont chaque ligne était une accusation contre l'égoïsme, l'intolérance, la gloire onéreuse et personnelle de Louis XIV. Les amis de Fénelon avaient fait disparaître ce manuscrit des papiers de son petit-fils. XV. biais la mort des deux amis de Fénelon, le duc de
Chevreuse et le duc de Beauvilliers, fit écrouler cette dernière chimère du
bien public. La sainte ambition de leur ami mourut enfin avec eux. Fénelon
détourna ses regards des décadences et des calamités du règne qui finissait,
et il se tourna tout entier aux pensées immortelles. Ses écrits et ses
correspondances de cette époque portent tous l'empreinte de cette mélancolie
qui, dans les hommes du siècle, n'est que le découragement d'une vie trompée,
qui, dans les hommes de foi, n'est que le déplacement de leurs espérances
d'ici-bas là-haut. Il écrivit, comme Socrate discourut à sa dernière heure,
sur l'immortalité de l'âme. L'amitié du moins lui restait : il en perdit la
meilleure part avec l'abbé de Langeron, le disciple, le confident, le soutien
de son cœur dans toutes les fortunes. L'abbé de Langeron expira dans les bras
de son maitre. Ah ! je n'ai pas la force que vous me
supposez, écrivait Fénelon à un ami commun qui le félicitait de ne pas
sentir à travers sa piété les tristesses des séparations humaines ; j'avoue que je me suis pleuré moi-même en pleurant mon
ami. Il me reste une espèce de langueur intérieure ; je ne me console que par
la lassitude de la douleur. Au reste, ce cher ami est mort avec une vue de sa
fin si claire et si douce, que vous en auriez été attendri. Lors même que ses
idées se brouillaient un peu, ses sentiments étaient tous d'espérance, de
patience, d'abandon entre les mains de Dieu. Je vous raconte tout ceci pour
ne pas vous affliger de ma tristesse sans vous représenter en même temps cette
joie de la foi, dans la douleur dont parle saint Augustin, et que Dieu m'a
fait sentir dans cette occasion. Dieu a fait sa volonté, il a préféré le
bonheur de mon ami à ce qui était ici-bas ma consolation ! Je lui offrais
celui que je tremblais de perdre !... Je ne vis plus que d'amitié, s'écrie-t-il ailleurs en revenant sur cette perte, et ce sera l'amitié qui me fera mourir ! Mais nous retrouverons bientôt tout ce que nous semblons perdre ; encore un peu de temps, et il n'y aura plus à pleurer ! XVI. Une fièvre dont la cause était dans l'âme le saisit le premier jour de l'année 1715 ; elle consuma en six jours le peu de vie que les années, le travail et la douleur avaient épargné dans ce cœur qui avait tout prodigué aux hommes. Il mourut en saint et en poète, en se faisant lire dans les cantiques sacrés les hymnes les plus sublimes et les plus douces, qui emportaient à la fois son âme et son imagination au ciel. Répétez-moi encore ce passage, disait-il, en savourant ces chants de l'espérance, à son lecteur ! Encore, encore ! Jamais assez de ces divines paroles ! reprenait-il quand on se taisait, parce qu'on le croyait endormi. Il était insatiable de cet avant-goût d'immortalité. Seigneur, s'écria-t-il une fois, si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse point le travail du reste du jour ; faites votre volonté ! Ces paroles affligèrent les assistants, et l'abbé de Chanterac, son premier et son dernier ami, lui dit : Mais pourquoi nous quittez-vous ? dans cette désolation, à qui nous laissez-vous ? Peut-être que les bêtes féroces vont venir ravager votre petit troupeau ! Il ne répondit que par un regard tendre et par un soupir. Il expira doucement le matin de la nuit suivante, dans une résignation semblable à la, dans la prière et dans l'amitié. L'abbé de Chantérac, comme s'il n'eût eu plus rien à faire sur la terre après la mort de celui pour lequel il avait uniquement vécu, expira de douleur après les funérailles de son ami. La France entière porta dans son âme le deuil de son poète et de son saint. Louis XIV lui-même sembla s'apercevoir à la fin, mais trop tard, qu'une grande âme manquait à son empire, et une grande force à sa vieillesse. Voilà, s'écria-t-il, un homme gui aurait pu être bien nécessaire dans les désastres dont mon royaume va être frappé ! Vain regret posthume, qui n'apprécie lé génie qu'éteint, et la vertu que dans la tombe ! XVII. Ainsi vécut et mourut Fénelon. Son nom est resté populaire et plus immortel encore que ses œuvres, parce qu'il répandit plus d'aine, encore que de génie dans ses ouvrages et dans son siècle. Ce qu'on adore en lui, c'est lui-même. Son nom est son immortalité. Les hommes sont plus justes qu'on ne croit dans leur rétribution, Fénelon aima, ce fut son génie ; il fut aimé, ce sera sa gloire. De tous les grands hommes de ce grand siècle de Louis XIV, aucun n'a laissé une mission si douce à regarder : il y a de la tendresse dans l'accent de tout homme qui parle de cet homme. Sa poésie enchante notre enfance, sa religion respire la douceur de l'agneau, symbole du Christ ; sa politique même n'a que les erreurs et les illusions de l'amour trompé ; sa vie tout entière est le poème de l'homme de bien aux prises avec les impossibilités des temps. Il n'a rien opéré, dit-on, des biens qu'il méditait de faire. Il a fait plus : il en a donné l'idée ; il a appliqué dans sa pensée son évangile à la société ; il a voulu le règne de Dieu sur la terre ; il a enseigné aux mis les droits sacrés de l'homme en enseignant aux peuples les devoirs du citoyen. Il a eu la soif de l'égalité chrétienne, de la liberté réglée, de la justice, de la morale, de la charité dans les rapports des gouvernants avec les peuples, des peuples avec les gouvernants ; il a été le tribun de la vertu, le prophète de l'amélioration sociale. Qu'a-t-il fait ainsi, dit-on encore ? Il a versé son âme dans l'âme de deux siècles. Il a adouci et christianisé le génie de la France. Quelquefois le poète de la chimère, mais toujours le poète de la charité. La conscience lui doit une vertu de plus, la tolérance ; les trônes un devoir de plus, l'amour des peuples ; les républiques une gloire de plus, l'humanité. La France a eu des génies plus mâles, elle n'en a eu aucun d'aussi tendre. Si le génie avait un sexe, on dirait que Fénelon a eu l'imagination d'une femme pour rêver le ciel, et son âme pour aimer la terre. Quand on prononce son nom ou quand on ouvre son livre, chacun croit voir sa figure ; on croit entendre la voix d'un ami. Y a-t-il une gloire qui surpasse en élévation et en solidité tant d'amour ? Quand on voudra faire son épitaphe, on pourra l'écrire en ces mots : Quelques hommes ont fait craindre ou briller davantage la France ; aucun ne la fit plus aimer des nations. FIN DE L'OUVRAGE |