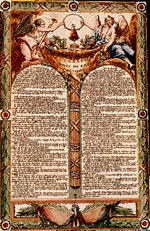HISTOIRE DES CONSTITUANTS
TOME TROISIÈME
LIVRE DOUZIÈME.
|
I. La
pénurie croissante du trésor et le patriotisme qui pressait les citoyens de
concourir au salut public et au triomphe régulier de la constitution
multipliaient les offrandes volontaires à l'État reçues par la municipalité à
l'hôtel de ville. Les femmes apportaient leurs boucles d'oreilles, leurs
colliers, leurs bracelets ; les hommes, leur argenterie et les agrafes
d'argent de leurs chaussures. Mais ces dons patriotiques, épuisés aussitôt
qu'offerts, étaient surtout le tribut des classes les moins riches au succès
de la Révolution. Ainsi qu'on le vit en 1848, dans les premiers besoins de la
seconde république française, c'étaient ceux qui possédaient le moins qui
donnaient le plus. Le peuple semblait porter le prix de sa rançon à la
liberté. Ces sommes, quelque considérables qu'elles fussent en 1789, ne
pouvaient être qu'un secours momentané au trésor. L'esprit public surtout,
dans les classes opulentes et commerciales, reculait déjà devant les
sacrifices que la liberté demandait à la nation. Les uns présentaient pour
ressource la banqueroute aux créanciers de l’État, jubilé cruel qui aurait
fondé la propriété de tous sur la ruine de quelques-uns. Les autres,
convaincus que l'iniquité creuse toujours plus profond le gouffre qu'elle
semble fermer et que la morale et la richesse publiques sont gouvernées par
la même loi, rejetaient cette odieuse libération par l'injustice et
présentaient le crédit public comme le seul alchimiste capable de recréer
l'or évanoui. Tous les moyens que nous avons vu employer depuis dans des
circonstances extrêmes, en 1815, en 1847, en 1852, étaient déjà discutés dans
les écrits des économistes et dans les motions des législateurs : le
papier-monnaie, portant intérêt entre les mains des détenteurs de ce papier
et servant à la fois de moyen d'échange et de capital productif ; les
assignats, autre sorte de papier-monnaie ne portant point intérêt, mais ayant
pour gage les propriétés de l'Etat retirées au clergé, sorte d'hypothèque
circulante où chaque feuille de papier représentait une portion de terre ;
une caisse d'amortissement, sorte d'économie incessante absorbant chaque
année la dette par la puissance accumulée de l'intérêt composé ; des caisses
nationales de crédit et de secours autorisées par l'Etat, comme nous les
voyons aujourd'hui, à frapper une monnaie de confiance hypothéquée sur les
revenus des provinces, des municipalités, des particuliers qui leur feraient
appel, et mobiliseraient ainsi, comme par enchantement, les richesses
immobilisées de la nation ; une banque nationale d'escompte prêtant à
l'industrie et au commerce, à de courtes échéances, les sommes nécessaires à
leur activité en billets équivalents à l'or ; des ateliers nationaux et
provinciaux pour fournir aux ouvriers sans ouvrage le travail et le salaire
indispensables à l'existence de leurs familles, institution difficile à
-organiser et à contenir dans de justes limites, mais commandée par la
prudence comme par l'humanité à une nation de prolétaires qu'une révolution
jette de la misère dans l'insurrection. L'avocat
Linguet, publiciste aventureux et écrivain verbeux, donnait dans un écrit
populaire le bruit et le mouvement à ces idées. D'autres proposaient pour les
départements des compagnies de Crédit foncier, modèles de celles qui sont
aujourd'hui fondées et prêtant aux propriétaires endettés jusqu'à concurrence
des deux tiers de la valeur des propriétés ; d'autres, enfin, une banque
nationale au capital de plusieurs milliards, centralisée dans les mains de
l'Etat, ayant pour la sécurité de chaque citoyen la garantie de b nation tout
entière et faisant au profit des corps et des particuliers l'office des
banques individuelles. Mirabeau,
à qui tous les inventeurs d'idées apportaient nuit et jour leurs systèmes
pour qu'il leur prêtât son âme et sa voix, traita magnifiquement ces
matières, dans un discours médité, à la séance du 6 novembre. Dépôt
intarissable d'idées et d'études depuis sa jeunesse, habitui, par ses travaux
sur les finances, sur les caisses d'escompte, sur l'agiotage, sur la banque,
à sonder les mystères de l'économie politique et du crédit, il n'avait qu'à
recueillir sa pensée et à ouvrir ses lèvres pour en laisser découler les
véritables théories sur la richesse des nations : caractère distinctif de
cette éloquence qui pensait toujours en parlant, et qui jetait dans ses
auditoires autant de lumière que d'éblouissement. L'économie politique et la
théorie des finances n'ont pas fait un pas au delà des vérités promulguées
dans ses discours par Mirabeau. « Une
nation habituée à l'usage des numéraires métalliques, » dit-il en
commençant, « une nation que de grandes calamités rendent timide et
défiante, ne peut pas être longtemps privée de ce numéraire sans que la gêne
et le trouble s'introduisent dans toutes ses transactions. Elles s'approchent
à grands pas, ces calamités... Nous touchons à une crise redoutable.
Observez, messieurs, que non-seulement le numéraire suffisant ne circule
plus, mais encore que chacun est fortement sollicité par sa terreur de l'avenir
et par la prévoyance de sa sécurité à thésauriser autant que les
circonstances le lui permettent. Observez que les causes qui tardent à faire
sortir le numéraire du royaume, loin de s'atténuer, deviennent chaque jour
plus actives, et que cependant le service des subsistances à l'intérieur et
l'approvisionnement des subsistances à l'étranger ne peuvent pas se faire
sans numéraire en espèces. » Les
causes de cette pénurie des espèces ne sont pas, selon Mirabeau, dans la
révolution elle-même — et ici il trompait son auditoire sciemment pour ne pas
dépopulariser la révolution, car toute révolution effraie les esprits, et
tout effroi resserre et crispe les mains qui tiennent le numéraire —.
« Ces causes », poursuivait Mirabeau, « sont dans les vices de
la caisse d'escompte — institution de M. Necker, qui avait remis le seul
crédit existant dans l'État à une seule compagnie privilégiée d'agioteurs —. Ce
papier, dont le remboursement n'est pas exigible à présentation, est sans
valeur sur les marchés étrangers. Il faut donc payer l'étranger au comptant
ce qu'il refuse de recevoir en papier de crédit de cette caisse. » Il
demandait, en conséquence, une série de mesures propres à assurer
l'importation des subsistances ; il demandait, de plus, la création d'une
banque nationale de crédit chargée d'appliquer, à la dette, au service de
l'État, aux transactions entre particuliers, à l'économie entière des finances,
les moyens de remplacer le numéraire manquant, et de le recréer sous une
autre forme. Préface de la création des assignats, dont Mirabeau méditait
l'institution, dans son laboratoire d'idées, avec Dumont, du Roveray,
Pellenc, Clavières, son conseil privé et ses rédacteurs, il voulait
hypothéquer les assignats par politique, plus encore que par mesure de
crédit, sur les biens de l'Église, afin de rendre l'expropriation du clergé
irrévocable, en mettant forcément dans la main de tous les Français un gage
et une portion de ses dépouilles. L'Assemblée vota l’examen de cette motion. II. Necker,
rudement froissé par Mirabeau, à la séance du 6 novembre, dans son accusation
contre la caisse d'escompte, vint exposer, le 14, les plans qu'il avait
conçus lui-même pour suppléer à la rareté du numéraire. Ses paroles
respiraient le découragement et la résignation d'un homme qui croit moins en
lui-même depuis que les autres ont cessé d'y croire. « C'est
une pénible situation pour moi, » dit-il en paraissant à la tribune,
« que d'avoir si souvent à vous entretenir de l'embarras des finances.
Je n'ai eu que des inquiétudes et des déplaisirs depuis que j'ai repris cette
administration. Le contribuable politique n'est qu'une ressource graduelle,
et le crédit n'en offre plus aucune. Un déficit plus considérable nous
menace. Dans tous les cas, il faut trouver un secours immédiat de cent
soixante-dix millions... » Après
avoir justifié la caisse d'escompte, accusée par Mirabeau, Necker convient de
la nécessité de remplacer le numéraire ; puis, revenant sur lui-même, il
chercha à apitoyer l'Assemblée sur la situation des ministres. « Leur
grand malheur, » dit-il avec amertume, « dans ces temps difficiles,
c'est d'avoir toujours à employer leur temps et leurs moyens à adoucir les
maux, à remédier aux circonstances urgentes. Les ministres n'en retirent
jamais d'aventages pour eux. On leur demande la perfection. On ne leur rend
pas justice, car on ne prend pas de peine pour louer autrui. » Après
ce naïf aveu d'impuissance et cette plainte d'un orgueil souffrant de la
pénurie des louanges, Necker, adoptant en partie le plan de Linguet et de
Mirabeau, proposait de fondre la caisse d'escompte dans une banque nationale
privilégiée, autorisée à créer deux cent quarante millions de billets
garantis par la nation, et -reçus comme numéraire dans les transactions.
Puis, faisant de nouveau un retour sur lui-même, il terminait par cette
invocation déplacée à la confiance et presque à la compassion de l’Assemblée : « A
mes propres yeux, » dit le ministre, « tout se ressent dans ce plan
de la désolante nature des circonstances. Seul je suis confident de ce qu'il
m'en coûte pour vous éloigner des principes ordinaires d'administration. Je
demande qu'on en considère le résultat comme une simple opinion. Jugez, discutez...
Je n'adopterais point que vous vous en rapportassiez à moi de confiance. Je
n'ai pas décliné cette détermination lorsqu'il s'agissait d'un simple projet
de contribution... Je ne dois pas rester le seul à répondre des événements :
c'est assez de vivre d'inquiétudes pour chercher le bien ; c'est assez d'user
de sa pensée pour soulager les maux de l'Etat ; c'est assez d'aller en
dépérissant sous l'immense fardeau dont je suis continuellement chargé sans
aucune distraction... Pardonnez si, en vous parlant d'affaires, je vous offre
l'hommage de mes sentiments et de mes pensées. Je me réduirais à vous parler
le simple langage de la raison ; mais il est incomplet sans le sentiment,
parce que le sentiment seul peut réunir les idées qui échappent aux effets et
aux atteintes de l'esprit. » Le
président répondit par quelques mots d'encouragement et d'estime. L'opinion
ne vit qu'un palliatif insuffisant et un privilège d'agiotage dans une banque
ainsi réduite aux proportions d'un comptoir. On demanda à plus grands cris le
papier-monnaie, seul supplément suffisant à l'évanouissement des milliards de
la monnaie métallique. « Eh
quoi ! » s'écria le lendemain Marat dans l'Ami du peuple,
qui jouissait déjà d'un vaste retentissement par l'énergie de ses motions,
devenues le soir la clameur des rues, « toujours des spéculations
d'agiotage ! toujours des emprunts accumulés sur des impôts ! — l'impôt
du quart du revenu — toujours des anticipations ! toujours des opérations
désastreuses ! toujours la masse de la dette royale rendue plus lourde,
et l’Etat toujours plus écrasé sous le poids qui l'accable ! « C'en
est fait ! les derniers plans que le ministre des finances a proposés à
l'Assemblée nationale fixeront irrévocablement sa réputation, aux yeux mêmes
de ces aveugles partisans qui n'ont aucun intérêt à le prôner. En le voyant
sans cesse tourner dans un cercle étroit de spéculations de banque, l'homme
d'Etat s'éclipsera pour ne plus laisser paraître que l'agioteur. Et quel
agioteur ! un dilapidateur audacieux, un ennemi mortel de la régénération des
finances, un dépréciateur de putes Les opérations qui offrent à l'État des
ressources assurées. Il connaissait le plan d'une caisse nationale de 300
millions à 1 pour 100 — il est de M. Chantoiseau — : ce plan si ingénieux, si
simple, si propre à opérer le soulagement du peuple, la sureté des effets de
commerce, l'accroissement de l'agri- culture, la circulation du numéraire, la
liquidation d'une partie de la dette royale, et cela sans emprunt, sans
contrainte, et sans aggraver les charges de l'État. « Que
fait M. Necker ? Il le repousse avec mépris, et il vous annonce gravement
qu'il préfère le sien, ce qu'on n'a pas de peine à croire. » III. Mirabeau,
de son côté, ne négligeait rien pour saper la renommée ébranlée et les plana
méticuleux de l'ancien favori de la nation, que Lafayette, son ancien ami,
soutenait mal. Un
lumineux rapport du comité des finances, tableau détaillé et raisonné de la
situation financière du royaume, présenté par le marquis de Montesquiou,
occupa les séances suivantes. Le marquis de Montesquiou, après avoir énoncé
les maximes fondamentales de la probité, de l'honneur et de l'économie
politique sur ces matières, démontrait que les dépenses en 1789, loyalement
couvertes par les impôts, le crédit et les ressources extraordinaires qu'il
offrait au gouvernement, la nation aurait un excédent de près de quarante
millions, en 1790, de recettes sur les dépenses. Il avouait une dette
générale de près de neuf cents millions. Il concluait, d'accord en cela arec
le ministre des finances, à la création d'une banque nationale, dont la
caisse d'escompte serait la base, et qui émettrait trois cent
quatre-vingt-dix millions de billets servant de numéraire. Il écartait ou il
éloignait la vente des biens du clergé, et proposait d'en laisser du moins
l'administration à ce corps, concurremment avec une commission de l'Assemblée
nationale. Il proposait d'exiger seulement de cette administration des biens
du clergé par lui - même, quatre cents millions en quatre ans, attribués à la
caisse nationale, et le service de cinq millions aux hôpitaux et aux
établissements charitables. Il instituait enfin une caisse d'amortissement
dotée de trente-cinq millions, restés libres à la fin de 1790, et chargée de
rembourser intégralement les emprunts dont le remboursement était arriéré. Il
présentait en résultat une perspective de sécurité et de prospérité qui ne
coûterait pas à la nation de trop pénibles sacrifices et surtout aucune
honte. Le rapport exprimait parfaitement l'opinion moyenne de la nation, de
M. Necker et de l'Assemblée sur la régénération des finances. Il rendait le
calme aux imaginations des contribuables et des créanciers de l'État. Mirabeau
attaqua le lendemain, avec une intrépide énergie, dans sa base insuffisante,
fragile et privilégiée, la caisse d'escompte posée, par M. Necker et par M.
de Montesquiou, comme la pierre fondamentale des finances de l'État. Il avait
juré dès longtemps haine aux agiotages privilégiés, mensonges de crédit selon
lui et selon la vérité, qui ne profitent qu'à leurs exploitateurs. Il ne
voulait, avec raison, d'autres privilèges de crédit dans l'État que l'État lui-même.
Il voulait l'assignat, monnaie de papier émise par l'Etat seul, plus facile à
multiplier que le métal. Il voulait de plus, non comme économiste, mais comme
philosophe, l'émancipation du sol des mains du clergé. Il s'alarmait de ces
temporisations et de ces ajournements à la vente des biens de l'Eglise, que
M. Necker et le comité des finances semblaient présenter comme un subterfuge
qui tromperait le vote consommé de l'Assemblée sur ces biens. Tous ces motifs
l'élevèrent au-dessus de lui—même dans le discours du 10 novembre sur la
caisse d'escompte. IV. Après
avoir foulé dédaigneusement sous ses pieds en débutant les diatribes publiées
par les agioteurs et leurs stipendiés contre ses idées, il attaqua à la fois
le plan de Necker et celui du comité des finances. « Ce
plan, » dit-il, « s'adapte si peu à nos besoins, les dispositions
qu'il renferme sont si contraires à son but, l'effroi qu'il inspire à ceux
mêmes qu'il prétend sauver est un phénomène si nouveau, les deux classes
d'hommes que l'on s'attend si peu à rencontrer dans les mêmes principes, les
agioteurs et les propriétaires, les financiers et les citoyens, le repoussent
tellement à l'envi, qu'il importe avant tout de fixer les principes et de
chercher au milieu des passions et des alarmes l'immuable vérité. « M.
Necker est venu nous déclarer que les finances de l'Etat ont un besoin
pressant de cent soixante- dix millions. Il nous annonce que les objets sur
lesquels le trésor royal peut les assigner d'après nos décrets sont assujettis
à une rentrée lente et incertaine ; qu'il faut, par conséquent, user de
quelque moyen extraordinaire qui mette incessamment dans ses mains la
représentation de ces cent soixante-dix millions. « Voilà,
si nous en croyons le ministre, ce qui nous commande impérieusement de
transformer la caisse d'escompte en une banque nationale, et d'accorder la
garantie de la nation aux transactions que cette banque sera destinée à
consommer. « Cependant,
si nous trouvions convenable de créer une banque nationale, pourrions - nous
faire un choix plus imprudent, plus contradictoire avec nos plus beaux
décrets, moins propre à déterminer la confiance publique, qu'en fondant cette
banque sur la caisse d'escompte ? « Et
quel don la caisse d'escompte offre-t-elle en échange des sacrifices immenses
qu'on nous demande pour elle ?... Aucun.... Nous avons besoin de numéraire et
de crédit ; pour que la caisse puisse nous aider dans l'un ou l'autre de ces
besoins, il faut que le crédit de la nation fasse pour la banque ce qu'il a
paru au ministre que la nation ne pourrait pas faire pour elle-même. « Oui,
messieurs, par le contrat que M. Necker nous propose de passer avec la caisse
d'escompte, la ressource que la banque nous offrirait porte tout entière sur
une supposition qui détruit nécessairement celle dont le ministre a fait la
base de son Mémoire. Si la nation ne méritait pas encore aujourd'hui un très
grand crédit, nulle espèce de succès né pourrait accompagner les mesures que
ce Mémoire développe. En effet, M. Necker nous propose, pour suppléer la
lenteur des recettes sur lesquelles le trésor royal a compté, de lui faire
prêter par la banque nationale cent soixante-dix millions en billets de
banque. Mais quelle sera la contre-valeur de ces billets ? où se trouveront
les fonds représentatifs de cette somme ? « 1°
Vous créerez un receveur extraordinaire. « 2°
Vous ferez verser dans la caisse les fonds qui proviendront, soit de la
contribution patriotique, soit des biens-fonds du domaine royal et du clergé,
dont la revente serait déterminée, soit enfin de la partie des droits
attachés à ces deux propriétés, et dont l'aliénation et le rachat seraient
pareillement prescrits. « 3°
Le trésor royal fournirait sur ces objets des rescriptions en échange de cent
soixante-dix millions de billets. « 4°
Elles seraient livrées à raison de dix millions par mois, â commencer de
janvier 1791 jusqu'en mai 1792. « Et
quels seraient, dans la circulation, le passeport de ces billets de banque,
le motif de la confiance que la capitale et les provinces pourraient placer
dans l'usage de ce papier ? Le crédit de la nation. Un décret spécial de
votre part, sanctionné par le roi, la rendrait caution de ces billets. Ils
seraient revêtus d'un timbre aux armes de France, ayant pour légende :
Garantie nationale. « Respirons,
messieurs, tout n'est pas perdu : M. Necker n'a pas désespéré du crédit de la
France. Vous le voyez ; dans treize mois le nouveau receveur extraordinaire
sera en état, par les divers objets que vous assignerez à sa caisse,
d'acquitter de mois en mois les rescriptions que le trésor royal aura
fournies sur lui à la banque nationale, en échange des cent soixante-dix
millions qu'elle lui aura livrés en billets. « C'est
donc nous qui nous confierons à nous-mêmes les soi-disant billets. Uniquement
fondée sur notre crédit, la banque daignera nous rendre le service essentiel
de nous prêter, sur le nantissement de nos rescriptions, les mêmes billets
auxquels notre timbre aura donné la vie et le mouvement. « Nous
érigerons donc en banque nationale privilégiée une caisse d'escompte que
quatre arrêts de surséance ont irrévocablement flétrie ; nous garantirons ses
engagements — et je montrerai bientôt jusqu'où va cette garantie —, nous
laisserons étendre sur le royaume entier ses racines parasites et voraces. « Nous
avons aboli les privilèges, et nous en créerons un en sa faveur, du genre le
moins nécessaire ; nous lui livrerons nos recettes, notre commerce, notre
industrie, notre argent, nos dépôts judiciaires, notre crédit public et
particulier ; mous ferons plus encore, tant nous craindrons de ne pas être
assez généreux. Nous avons partagé le royaume en quatre-vingts départements ;
nous les vivifions par le régime le plus sage et le plus fécond que l'esprit
humain ait pu concevoir (les assemblées provinciales) ; mais comme si l'argent et le
crédit n'étaient pas nécessaires partout à l'industrie, nous rendons
impossible à chaque province les secours d'une banque sociale qui soit avec
son commerce ou ses manufactures dans un rapport aussi immédiat que son administration
; car enfin, messieurs, le privilège de la nouvelle banque limité à la
capitale — ce qu'on ne nous dit pas —, quelle banque particulière
subsisterait ou tenterait de s'établir à côté de celle qui verserait dans la
circulation des billets garantis par la société entière ? « Osons,
messieurs, osons sentir enfin que notre nation peut s'élever jusqu'à se
passer, dans l’usage de son crédit, d'inutiles intermédiaires. Osons croire
que toute économie qui provient de la vente qu'on nous fait de ce que nous
donnons n'est qu'un secret d'empirique. Osons nous persuader que, quelque bon
marché qu'on nous fasse des ressources que nous créons pour ceux qui nous les
vendent, nous pouvons prétendre à des expédients préférables, et conserver à
nos provinces, à tous les sujets de l'empire des facultés inappréciables dans
le système d'une libre concurrence. « Qu'est-ce
qui fait le crédit des billets de banque ? La certitude qu'ils seront payés
en argent à présentation. Toute autre doctrine est trompeuse. Le public
laisse aux banques le soin de leurs combinaisons, et, en cela, il est très
sage. S'il ralentissait ses besoins par égard pour les fautes ou convenances
des banques, si l'on voulait qu'il modifiât ses demandes d'après les calculs
sur lesquels le bénéfice des banques est fondé, on le mènerait où il ne veut
pas aller, où il ne faut pas qu'il aille. Il lui importe de ne pas confondre
son intérêt avec celui de quelques particuliers. » Après
avoir énuméré une à une toutes les petitesses du plan de M. Necker et du
comité, « La France », s'écrie-t-il en exagérant à la fois la
pensée morale et la pensée révolutionnaire devant l'Assemblée, « la
France nous demande ce que nous avons voulu favoriser ainsi, ou la dette
publique ou le commerce. Les villes de province nous diraient qu'une
administration exclusive de tout autre objet et indépendante des ministres
est enfin devenue absolument nécessaire pour que cet incommode fardeau
tende invariablement à diminuer. « Elles
nous diraient que cette administration est la seule qui puisse mériter leur
confiance, parce que d'elle seule peut sortir cette suite indéfinie de
mesures utiles, de procédés salutaires que les circonstances feront naître
successivement ; parce que rien ne la distrayant de son objet, elle y
appliquerait toutes ses forces physiques et morales ; parce que la
surveillance nationale ne permettrait pas qu'on y troublât un instant l'ordre
et la régularité, sauvegardes sans lesquelles les débiteurs embarrassés
succombent enfin, quelles que soient leurs richesses. A ce prix seulement,
les villes et les provinces peuvent espérer le retour de leurs sacrifices et
les supporter sans inquiétude et sans murmure. » Elles
nous diraient que des billets de crédit sortis du sein d'une caisse nationale
uniquement appropriée au service de la dette sont l'institution, la plus
propre à ramener la confiance ; elles nous diraient que ces billets, faits
avec discernement et hypothéqués sur des propriétés disponibles, auraient
dans les provinces un crédit d'autant plus grand, que leur remboursement
pourrait se lier à des dispositions locales dont un établissement particulier
et circonscrit dans son objet est seul susceptible. « S'agit-il
de favoriser le commerce ? Les villes et les provinces nous demanderaient
pourquoi nous voulons les enchaîner éternellement à la capitale, par une
banque privilégiée, par une banque placée au milieu de toutes les
corruptions. Que leur répondrions-nous pour justifier l'empire de cette
banque, pour leur en garantir l'heureuse influence sur tout le royaume ? « Eh
bien ! dira-t-on, laisserez-vous donc périr la caisse d'escompte, malgré
son intime connexité avec les finances et les affaires publiques, malgré le
souvenir des services qu'on en a tirés ? « Certes,
cette ironie est trop longue et trop déplacée. Ah ! cessez de parler de ces
services ! C'est par eux que notre foi publique a été violée ; c'est par eux
que notre crédit, perdu au dehors, nous laisse en proie à toutes les
attaques, ou de la concurrence étrangère, ou de cette industrie plus fatale
qui méconnait tout esprit public ; c'est par ces prétendus services que
toutes nos affaires d'argent sont bouleversées ; c'est par eux que nos
échanges, depuis que je vous en ai prédit la continuelle dégradation,
s'altèrent chaque jour à un degré que personne n'eût osé prévoir ! et
cependant l'on ne doute pas maintenant que nous ne voulions acquitter notre
dette. Non, ne parlez pas de ces services, ils sont autant de pièges ! » L'orateur
conclut 4 sommer le ministre de présenter le plan général qu'il a annoncé, et
de décréter, en attendant, que les fonds destinés à l'acquittement des dettes
de l'État seront séparés des autres dépenses et soumis à une administration
particulière. Ce discours discrédita d'avance les timides expédients du
comité, et acheva de ruiner l'infaillibilité de Necker. Il donna à
l'influence de Mirabeau dans l'opinion deux nouvelles et fortes racines : la
clientèle des créanciers de l'État et la faveur des adversaires d'un clergé
propriétaire. Les
royalistes et l'abbé Maury lui-même, par ressentiment contre Necker,
livrèrent le ministre aux morsures de Mirabeau ; ils profitèrent du moment où
le ministre était absorbé, pour lui porter d'autres atteintes. Carnot et
Fréteau dévoilèrent, le premier, l'abus des pensions de cour servies
complaisamment par ce ministre, qui n'avait de puritain que les maximes ; le
second, les subterfuges de crédit au moyen desquels Necker avait remboursé un
emprunt par un autre. La presse, par l'organe de Camille Desmoulins, se joua
à loisir de ces illusions couvertes du manteau de Necker. La
séance du samedi 28 fut une des plus intéressantes, et M. Camus ne s'arrêta
pas en si beau chemin. Il fit une excursion sur les pensionnaires. « On
serait tenté de croire, » dit-il, « que ceux qui obtenaient deux ou
trois pensions avaient prévu ce qui vient d'arriver, tant ils ont pris des
mesures pour rompre la trame et donner le change à l'Assemblée nationale et
au comité des finances chargé de nettoyer ces étables d'Augias. Ils plaçaient
dans les emprunts royaux le capital de la pension, et au moyen de cette
fiction, ils avaient l'air d'être les créanciers, les soutiens de l'Etat,
lorsqu'ils en étaient le fardeau, ce qui est tellement vrai, dit l'honorable
membre, qu'il y avait dans les bureaux un livre ad hoc qu'on appelait
le livre rouge. « Ce
livre rouge était si volumineux, que dans l'emprunt de 1770, 40 à 50 millions
avaient été ainsi prêtés fictivement à l'État avec ces pensions. Jusqu'où
n'avait-on pas poussé l'art d'inventer des pensions ! L'incomparable Pierre
Lenoir s'était créé des pensions sur les huiles et sur les suifs, sur les
boues et sur les latrines. Toutes les compagnies d'escrocs, tous les vices et
toutes les ordures étaient tributaires de notre lieutenant de police, qui par
sa place aurait dû être magister l'ionien, le gardien des mœurs. « Enfin
il avait su mettre la lune à contribution et assigner à une de ses femmes une
pension sous le nom de pension de la lune. Je sais un ministre qui a assigné
à sa traitresse une pension de 12.000 livres, dont elle jouit encore, sur
l'entreprise du pain des galériens. « Dans
la liste des pensions, je vois un prince allemand qui en a quatre : la
première pour ses services comme colonel, la seconde pour ses servis ces
comme colonel, la troisième pour ses services comme colonel. « M.
Claverie de Banière, quatre pensions : la première et la seconde parce qu'il
était en même temps secrétaire interprète de deux régiments étrangers qui
n'avaient pas besoin d'interprète, et qui étaient en garnison l'un au levant,
l'autre au couchant ; la troisième parce qu'il était commis au bureau de la
guerre, la quatrième parce qu'il avait été commis au bureau de la guerre. Total
23.479 livres, dont 4.750 sont réversibles à sa s femme et à ses enfants. « Desgalois
de la Tour, 22.720 livres en trois pensions : la première comme premier
président et intendant la seconde comme intendant et premier président, la
troisième par les mêmes considérations que ci-dessus. Je copie fidèlement le
texte. « Madame
Isarn, 24.980 livres, six pensions peur favoriser sen mariage, et en considération
de ses services, etc. « Il
y avait, en effet, du scandale à tirer de ce tableau, où l'on voyait entre
autres, attaché an nom .de Broglie, 90.000 livres ; d'Amelot, 52.000 livres ;
de Bertin, 69.000 livres ; de Contades, 93.000 livres ; de Fronsac, 40.000
livres ; de Coigny, 52.000 livres ; de Miromesnil, 67.680 livres ; de Joli de
Fleury, 65.701 livres ; de Breteuil, 91.729 livres ; de Mirepoix, 78.000
livres ; de Montbarrey, 64.000 livres ; de Ségur, 83.000 livres, faveurs de
cour qui semblaient des larcins à la nation. » V. Pendant
ces luttes de tribune et de partis dans l'Assemblée, la commune de Paris,
usurpant de plus en plus sans obstacle le rôle de pouvoir national, recevait
des adresses congratulatoires des provinces et ouvrait au public l'enceinte,
de la salle de ses délibérations : tribune contre tribune, police contre
police, gouvernement contre gouvernement. M. Agier, rapporteur de son comité
des recherches, plus actif que celui de l'Assemblée, lut, le 30 novembre, le
rapport accusateur de ce comité contre les fauteurs du rassemblement des
troupes à Versailles au 14 juillet, c'est-à-dire contre les ministres, les
généraux et le roi lui-même. Le rapporteur glorifiait, dans ce rapport, le
rôle jusque—là déshonoré des délateurs, et faisait, pour la première fois, de
la délation la vertu des patriotes. Le baron de Bezenval, le prince de
Lambesc, le ministre de la guerre de Puységur, tous les hommes suspects ou
convaincus d'avoir poussé la cour aux projets liberticides, y étaient
dénoncés à la vengeance des tribunaux. Marat
dénonçait à son tour ce comité des recherches à la municipalité elle-même. « J'ai
dénoncé, » écrivait-il du fond de son souterrain, « Bailly comme
indigne de la confiance de la nation, pour avoir sourdement attiré à lui seul
toute l'autorité municipale. « J'ai
dénoncé le bureau à la municipalité comme indigne de la confiance publique,
pour avoir usurpé sur les vœux libres et sur les choix des districts. « J'ai
dénoncé l'Assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique,
pour s'être érigée en cour de justice contre tout droit. « J'ai
dénoncé l'Assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique,
pour s'être opposée aux assemblées du Palais-Royal, et avoir attenté aux
droits des citoyens de s'assembler partout où bon leur semble, etc. « Maintenant
(n°
33) je les dénonce
comme coupables d'avoir cherché à écarter l'Assemblée nationale de Paris. Je
les dénonce comme coupables d'avoir jeté sur les boulangers tout le blâme de
l'incapacité du comité des subsistances, d'avoir tenu sur le sein de ces
malheureux le poignard dont se serait armé le bras de ceux qui viendraient à
manquer de pain, et d'avoir été les premiers auteurs des scènes sanglantes
dont quelques-uns ont été l'objet. « Je
les dénonce convie auteurs de tous les désastres qu'a occasionnés l'affreuse
loi martiale qu'ils viennent d'arracher au législateur. « Je
les dénonce pour avoir violé à mon égard le droit de citoyen, en faisant
enlever de force de chez mon imprimeur la minute, les feuilles et les
planches d'un écrit patriotique. « Je
les dénonce pour avoir usurpé les droits de leurs commettants, en s'arrogeant
celui de faire des règlements sans consulter les districts. « Je
les dénonce pour avoir attenté aux droits inaliénables des districts, en les
dépouillant de celui de pouvoir révoquer à volonté leurs mandataires, etc.,
etc. « Après
tant d'inculpations, ai-je eu tort de les suspecter de connivence avec le
ministre favori, auquel ils ont voté une statue par acclamation ? Ai-je eu
tort de les regarder comme la cheville ouvrière de la conjuration qui a
éclaté, et qui aurait remis le peuple aux fers si quelques citoyens
déterminés n'avaient forcé les chefs à marcher droit à Versailles ? » VI. Loustalot,
aussi radical mais moins acerbe que Marat, jetait aussi le cri du défi et du
désespoir à la fois à la Commune et à l'Assemblée nationale dans son journal.
La Révolution était avortée pour lui du jour où l'Assemblée avait substitué
aux droits absolus de l'homme la cote matérielle des contributions comme
signe des droits civiques. « Ô
Louis XVI ! ô restaurateur de la liberté française ! »
s'écriait-il, « vois les trois quarts de la nation exclus du corps
législatif par le décret du marc d'argent ; vois la nation dépouillée
du droit de voter les lois ; vois les communes avilies sous la tutelle d'un
conseil municipal ! Sauve les Français... purifie le veto suspensif...
Conservateur des droits du peuple, défends-le contre l’insouciance,
l'inattention, l'erreur ou le crime de ses représentants ; dis-leur,
lorsqu'ils te demanderont la sanction de ces injurieux décrets : « La nation
est le souverain ; je suis son chef ; vous n'êtes que ses commissaires
; et vous n'êtes ni ses maîtres ni les miens ! » On voit
que Loustalot raisonnait contre l'Assemblée nationale avec la doctrine du
Contrat social, de J.-J. Rousseau. « Il
n'y a qu'une voix dans la capitale, » s'écrie ù son tour Camille
Desmoulins ; « bientôt il n'y en aura qu'une dans les provinces contre
le décret du marc d'argent. Il vient de constituer la France en
gouvernement aristocratique, et c'est la plus grande victoire que les mauvais
citoyens aient remportée à l'Assemblée nationale. Pour faire sentir toute
l'absurdité de ce décret, il suffit de dire que J.-J. Rousseau, Corneille,
Mably, n'auraient pas été éligibles. Un journaliste a publié que, dans le
clergé, le cardinal de Rohan seul a voté contre le décret ; mais il est
impossible que les Grégaire, Massieu, Fillon, Jallet, Joubert, Gouttes, et un
certain moine qui est des meilleurs citoyens, se soient déshonorés à la fin
de la campagne, après s'être signalés par tant d'exploits. Le journaliste se
trompe... « Mais
que voulez-vous dire avec le mot de citoyens actifs tant répété ? Les
citoyens actifs, ce sont ceux qui ont pris la Bastille, ce sont ceux qui
défrichent les champs, tandis que les fainéants, malgré l'immensité de leurs
domaines, ne sont que des plantes végétatives, pareils à cet arbre de votre
Évangile qui ne porte point de fruits et qu'il faut jeter au feu. Les
champions de ce décret étaient Renaud de Saintes, Maury, Cazalès, Virieu,
Richier, Mongis, de Roquefort, Malouet. C'est tout dire. « Basile »,
s’écrie Figaro, « c'est un de ces hommes à qui on ne peut rien dire de
pis que son nom. » On connaît mon profond respect pour les saints décrets de
l'Assemblée nationale. Je ne parle librement de celui-ci que parce que je ne
le regarde pas comme un décret. Je l'ai déjà observé dans la Lanterne, et on
ne saurait trop le répéter. Il y n dans l'Assemblée nationale six cents
membres qui n'ont pas plus de droit d'y voter que moi. Sans doute, il faut
que le clergé et la noblesse aient le même nombre de représentants que le
reste des citoyens : un pour vingt mille. Le dénombrement du clergé et de la
noblesse s'élève à trois cent mille individus. C'est donc quinze
représentants à choisir parmi les six cents. Il me paraît plus clair que le
jour que tout le reste est sans qualité pour opiner, et qu'il faut le
renvoyer dans la galerie : ils ne peuvent avoir tout au plus que voix
consultative. C'est parmi ces six cents que se trouvent presque tous ceux qui
ont fait passer le décret du marc d'argent. Il en est donc de ce décret comme
de celui qui établit un culte exclusif : il faut le regarder comme non avenu
; et puisque la minorité apparente est en effet la majorité, et même la
presque unanimité, il est vrai de dire que le décret que je dois
respecter, c'est celui qui a été rejeté ! « Je
n'ai plus qu'un mot à dire : Lorsqu'à l'approche de Xerxès, Cyrsilus s'opposa
au décret de Thémistocle, que les Athéniens abandonneraient la ville,
Cyrsilus fut lapidé par le peuple, à qui Démosthène remarque que cette
lapidation fit infiniment d'honneur. « Ici
la comparaison serait entièrement à l'avantage de Cyrsilus ; et si, au sortir
de la séance, les dix millions de Français non éligibles et leurs
représentants à Paris, les gens du faubourg Saint-Antoine, etc., s'étaient
jetés sur les sieurs Renaud de Saintes, Maury, Malouet et compagnie ; s'ils
leur avaient dit : Vous venez de nous retrancher de la société, parce que
vous étiez les plus forts dans la salle ; nous vous retranchons, à notre
tour, du nombre des vivants, parce que nous sommes les plus forts dans la rue
; vous nous avez tués civilement, nous vous tuons physiquement, je le demande
à Maury, qui ne raisonne pas mal quand il veut, le peuple eût-il fait une
injustice ? Et si Maury ne répond pas que la représaille était juste, il ment
à lui-même. Quand il n'y a plus d'équité, quand le petit nombre opprime le
grand, je ne connais plus qu'une loi sur la terre, celle du talion !...
» VII. Le 10
décembre, Target annonça à l'Assemblée que la partie politique administrative
de la constitution était terminée. L'Assemblée, par un applaudissement
unanime, salua son propre ouvrage. Les uns applaudissaient de bonne foi dans
la constitution future les nouvelles destinées de l'Etat ; les autres
applaudissaient, avec une joie néfaste et maligne, les désordres et les
calamités inévitables qui allaient convaincre plus vite la constitution
d'impuissance et d'anarchie et ramener, selon eux, par une voie détournée,
mais sanglante, le peuple au despotisme et à l'aristocratie. Mirabeau,
cette fois, prit la parole dans un esprit de sagesse et de prévoyance, qui
avait évidemment pour objet de corriger la démocratie de son vice naturel,
l'excès de mobilité et d'incapacité politiques, en établissant une aorte de
hiérarchie dans toutes les fonctions décernées par le peuple, même dans la
représentation nationale. « Il
s'agit de savoir, » dit-il, « s'il faut asservir à une marche
graduelle la députation aux assemblées administratives et nationales. C'est
dans les anciens gouvernements que j'ai trouvé cette idée ; elle s'adapte
merveilleusement à la constitution que nous avons établie sur une égalité qui
doit en être le principe indestructible. « Il
faut que les institutions se rapportent aux lois, comme les lois à la nature
des choses ; si nous ne mettons pas les hommes en harmonie avec les lois,
nous aurons fait un beau songe philosophique, et non une constitution. Enchaîner
l'homme à la loi, tel doit être le but du législateur... « Cette
loi vous présente un second moyen bien puissant. Vous répandez dans les
municipalités l'émulation de la vertu et de l'honneur ; vous rehaussez le
prix des suffrages du peuple, lors même qu'ils ne confèrent que des emplois
subalternes ; vous n'avez plus à craindre de voir les municipalités
abandonnées à un petit nombre de concurrents. Les places ne valent souvent
aux yeux des hommes que par ceux qui les sollicitent ou les occupent. Si les
Romains n'avaient tout concentré dans Rome, s'ils avaient attaché plus
d'éclat aux administrations municipales, s'ils en avaient fait des échelons
pour arriver aux honneurs, ils auraient prévenu les révoltes nombreuses qui
éclataient dans toutes les parties de leur empire. Ce qui servit cependant à
entretenir l'émulation et à mettre dans cette république fameuse les talents
à leur place, c'est que dans les emplois importants, il fallait avoir passé
par des offices subalternes. Pour être consul, il fallait avoir été questeur.
Dans le système graduel, les fonctions les plus obscures s'ennoblissent lors-
qu'il faut les traverser pour arriver aux premiers emplois. « La
politique est une science ; l'administration est une science et un art. La
science qui fait les destinées des Etats est une seconde religion, et par son
importance et par sa profondeur. La nature et la raison veulent qu'on marche
des fonctions simples à des fonctions compliquées ; qu'on passe par
l'exécution des lois avant de concourir à leur confection, et que par cette
épreuve la chose publique soit à l'abri des dangers de l'incapacité des
agents. Si vous décrétez qu'il faudra avoir réuni deux fois les suffrages du
peuple pour être éligible à l'Assemblée nationale, vous donnerez une double
valeur aux élections : vous établirez l'heureuse nécessité de la probité ;
vous opérerez une révolution tant désirée dans une jeunesse qui passe de la
frivolité à la corruption, de la corruption à la nullité ; vous direz aux
jeunes citoyens qu'à chaque pas ils seront obligés de justifier la confiance,
qu'ils seront pesés dans la balance de l'expérience, qu'ils seront comparés à
leurs rivaux. Ainsi, en accordant tout au mérite et aux vertus, cette loi
serait un noble moyen de parvenir à la régénération d'une classe qui semble
s'abaisser dans l'ordre moral à proportion qu'elle s'élève dans l'ordre de la
société. « Évitons
les fautes, cultivons les provinces, anéantissons cet ancien préjugé qui, sur
les débris des classes et des ordres, créerait de nouvelles classes et de
nouveaux ordres. Nous mettrons de la fraternité entre toutes les fonctions
publiques, si la plus subalterne est nécessaire pour s'élever, si la plus
haute tient par des liens nécessaires à la plus subordonnée. Les honneurs
publics sont comme une eau pure coulant dans des canaux différents, mais
toujours limpide, mais toujours la même... « Que
le législateur est puissant, quand il a su montrer aux citoyens leurs
intérêts dans la probité. Vous avez fait de sages décrets pour assurer la responsabilité
; mais vous savez trop bien que réprimer et punir, c'est peu de chose ; ïl
faut que le bien se fasse par d'autres moyens... « Nous
allons, dira-t-on, restreindre la confiance. Vous la restreindrez en exigeant
telle quotité de fortune, tel degré de naissance ; vous déshériterez d'un
droit naturel ceux qui seraient hors de ces conditions. Mais prescrire des
règles les mêmes pour tous ; mais accorder les mêmes droits ; mais attaquer
les exceptions en faveur de l'égalité, ce n'est pas blesser le principe,
c'est le reconnaître. « Je
vous prie de faire sur la confiance une observation particulière à un
gouvernement représentatif tel que le vôtre. « Le
député élu par une partie d'un département représente la totalité de la
nation. La puissance dont jouira le corps législatif sera précaire si elle
n'est doublée en quelque sorte. Et voyez quel est l'effet du système graduel.
Un plus grand nombre de citoyens aura intérêt aux élections. Les électeurs
diront : — Nous ne vous donnons pas un homme inconnu, nommé par l'intrigue,
par la cabale, par le caprice, par les passions : il arrive précédé de ses
services. « Les
provinces seront plus calmes sous la foi de la raison publique ; les
représentants seront plus respectés. On ne peut donc faire une objection d'un
aussi grand avantage. « Cet
ordre serait, dans ce moment, difficile à établir ; mais, dans dix ans, il y
aurait un fonds d'hommes suffisant pour fournir aux élections. « Je
propose de décréter les articles suivants : A compter du 1er janvier 1797,
nul ne pourra être élu membre de l'Assemblée nationale s'il n'a réuni au
moins deux fois les suffrages du peuple, comme membre des assemblées
administratives du département, ou de district, ou de municipalité, ou s'il
n'a rempli trois ans une place judiciaire, ou enfin s'il n'a été membre de
l'Assemblée nationale. » VIII. Cette
condition de noviciat, de lumière et d'hiérarchie au moins élective, dans la
représentation et dans l'administration d'une démocratie, était une pensée
d'homme d'État. Comme toutes les institutions humaines, la démocratie ne peut
vivre que d'intelligence et d'expérience. L'intelligence et l'expérience,
dans la souveraineté nationale et dans les fonctions publiques, trouvaient
leur garantie dans le vœu de Mirabeau. Cette
pensée mûre et modératrice offensa la jeunesse et l'impatience du parti de
l'Assemblée qui croyait qu'une vérité n'a jamais d'excès, et que la
démocratie sans limites devait être aussi sans condition dans l'exercice de
son propre principe. Barnave, l'orateur de ce parti, qui cherchait toutes les
occasions de précéder en popularité celui qu'il ne 'sauvait égaler en génie,
combattit, par des considérations étroites et par la vaine lettre des
décrets, la proposition de son rival. « Si
pour anéantir la constitution, » répondit Barnave, « il suffisait
d'envelopper des principes contraires de quelque idée morale et de quelques
preuves d'érudition, le préopinant pourrait se flatter de produire de l'effet
sur vous ; mais heureusement il vous a aguerris contre le prestige de son éloquence,
et plusieurs fois nous avons eu l'occasion de chercher la raison et le bien
parmi les traits élégants dont il avait embelli ses opinions. Cette occasion
se présente aujourd'hui d'une manière plus éclatante. « Le
bon sens le plus ordinaire suffit pour démontrer que tes pouvoirs doivent
tire répartis entre nous ; le mémo bon sens prouve que, sans cette égale
répartition, l'égalité sociale ne peut exister. La déclaration des droits a
consacré ces principes. La motion de M. de Mirabeau tend à réunir dans un
petit nombre de personnes les pouvoirs municipaux, administratifs et
législatifs, et l'on prétend qu'elle doit établir l'égalité et la liberté. « Elle
est contraire aux décrets. La majorité pour les municipalités est fixée à
vingt-cinq ans ; l'auteur de la motion la réduit à vingt et tin ; il l'étend
à trente-cinq pour l'Assemblée nationale. En effet, on devrait avoir occupé
deux fois les places dont les fonctions durent quatre ans : il faut au m'oins
deux années d'intervalle ; ainsi voilà dix années ajoutées à la majorité de
vingt-cinq ans. « Cette
motion étant opposée aux précédents décrets, aux termes du règlement on
pouvait l'attaquer par la question préalable. « Elle
est de plus contraire à la nature des choses, aux convenances et à l'intérêt
public. « C'est
dans les assemblées administratives qu'il faut porter une expérience qui ne
s'acquiert qu'avec le temps. Ces assemblées sont moins nombreuses que les
assemblées nationales, et l'effet d'un petit nombre de jeunes gens
inexpérimentés y serait bien plus fâcheux. Les hommes qui se seront, par
leurs études, destinés à l'Assemblée nationale, se verront forcés de passer
par des places auxquelles ils ne seront pas propres. Il faudra qu'ils
renoncent à leur fortune pour se livrer à un noviciat d'une aussi longue
durée, et les gens riches, seuls capables de ce sacrifice, concourront seuls
à la représentation nationale. » L'homme
d'Etat se sentit vaincu par le légiste, aux applaudissements que l'Assemblée
donnait à son adversaire. Il le fut en effet. Mais se relevant avec
l'imperturbable majesté d'un génie méconnu par le temps et qui s'ajourne à
l'avenir, « Le
préopinant, » dit-il fièrement, « parait oublier que si les
rhéteurs parlent pour vingt-quatre heures, les législateurs parlent pour Te
temps. Je demande à lui répondre ; mais comme un comité dont je suis membre
m'appelle, je prie l'Assemblée d'ajourner la discussion. » C'était
la sage coutume de Mirabeau, quand il avait à répliquer sur des matières
importantes, de se donner à lui-même le loisir de la réflexion. Il appelait
avec raison la réflexion la plus grande puissance de l'homme. Il se gardait
bien de la négliger. Plus penseur encore qu'improvisateur, il ne parlait
jamais sans avoir écrit ou dicté ses discours. Semblable en cela à Cicéron et
à Démosthène, il les relisait, les polissait, les solidifiait le plus
longtemps passible d'arguments, les illuminait de traits d'éloquence, les
repassait dans sa mémoire, les lisait quelquefois, plus souvent les
prononçait, en ajoutant à ce qu'il avait médité le feu, la soudaineté,
l'imprévu de l'inspiration. Aux séances où il devait parler, il se faisait
suivre toujours par ses secrétaires et ses rédacteurs, tels que Dumont,
Durouvray, Pellenc et Camps. Il les tenait renfermés, à sa disposition, dans
un cabinet attenant à la tribune publique, derrière le bureau du président.
Ces confidents de sa pensée étaient chargés de suivre de là la discussion
quand il y prenait part, et de noter toutes les idées et toutes les
réfutations que leur suggéraient la circonstance et les débats, S'il y avait
à remonter à la tribune pour la réplique, même la plus courte, il allait
préalablement consulter ce conseil intime ; il leur dictait les phrases qu'il
se proposait de répondre à ses adversaires ; il écoutait leurs observations,
il notait leurs arguments, il rédigeait sa réplique, il la lisait devant eux,
il faisait pour ainsi dire l'épreuve de son inspiration devant ce conseil
avant de la faire sur son auditoire. Il respectait trop la tribune pour s'y
présenter, comme un rhéteur, seulement avec des paroles. Le sens lui
importait plus que la vaine facilité d'enchaîner des mots. C'est de ce
cénacle qu'il sortait toujours chargé d'idées pour ses improvisations comme
pour ses discours. L'homme d'Etat et l'homme d'éloquence ne livrait rien au
hasard de ce qu'il pouvait lui enlever par la réflexion. Il se sentait parler
devant la postérité, et il veillait de loin sur sa mémoire. IX. On
délibéra le 14 sur la question de savoir si l'on présenterait les soixante
articles de la constitution votés à la sanction ou à la simple acceptation du
roi. C'était délibérer si le roi faisait encore partie de la souveraineté, ou
s'il en était retranché définitivement, et réduit au rôle subalterne
d'exécuteur des lois qu'il n'aurait pas sanctionnées. Une imperceptible
majorité respecta encore en lui la prérogative royale en n'exigeant
préalablement qu'une simple acceptation des articles. Le 15,
Malouet, révolté des empiétements des municipalités, qui substituaient leur
comité de police au pouvoir central et au pouvoir judiciaire, demanda qu'il
leur fût interdit par un décret de s'immiscer dans le attributions de la
haute police. Charles de Lameth réfuta ce discours, qui aurait détrôné
l'anarchie fomentée par Barnave et par les Lameth. Le 22,
Thouret lut le rapport sur la constitution du pouvoir judiciaire. Ce rapport
était digne de servir de préambule aux codes d'un peuple libre. Justice
uniforme, gratuite et rapprochée des justiciables. Juges
élus. Attributions
des juges exclusives de toute action administrative après leur jugement
prononcé. Un juge
de paix, justice conciliatoire, dans chaque canton, élu par le canton. Tribunaux
de districts élus par un corps électoral spécial, élevé, capable d'apprécier
la moralité et l’aptitude des juges parmi des candidats hommes de loi. Tribunaux
de département élus par des électeurs spéciaux et après des candidatures
analogues. Tribunaux
supérieurs appelés cours, élus parmi les juges éprouvés par des fonctions
exercées dans les tribunaux secondaires. Tribunal
suprême de révision élu par le roi parmi des candidats désignés à son choix
dans les tribunaux supérieurs. Système
complet d'une justice égale, indépendante, considérée, où Napoléon n'a eu
qu'à effacer les conditions d'éligibilité pour en effacer l'indépendance.
L'élection est une condition de liberté incompatible avec le despotisme. X. Le 23,
Clermont-Tonnerre, abordant pour la première fois, par un article accessoire,
la question fondamentale de la liberté et de légalité des consciences,
proposa d'admettre sans distinction autre que la capacité, à tous les emplois
civils, les citoyens de toutes les professions et de tous les cultes. L'abbé
Maury, organe obligé de l'intolérance et du privilège des cultes, confondant
dans le même ostracisme les juifs, les comédiens et le bourreau, combattit
Clermont-Tonnerre soutenu par Robespierre et par Duport. La proposition de
Clermont-Tonnerre ne Tut votée qu'à trois voix de majorité. L'Assemblée, si
hardie contre le roi et contre la noblesse, était timide devant le culte
national. Les hésitations, les faiblesses et les violences qu'elle montrait
tour à tour dans les rapports de la constitution et de l'Eglise, rapports
qu'ils n'avaient pas le courage de régler d'un seul mot, par la liberté,
attestent celte timidité des législateurs de 89. Barnave
lui-même, en prenant la parole le lendemain pour la motion de Clermont
-Tonnerre, ne revendiqua l'égalité du droit civil que pour une secte de la
foi nationale, les protestants. Baumetz
et Mirabeau combattirent l'absurde préjugé de l'infamie des comédiens,
profession placée, par l'inconséquence des mœurs et par la proscription de
l'Église seulement en France, entre les enthousiasmes et les outrages. Ils
ajournèrent l'égalité d'admission des juifs aux fonctions civiles, tant les
législateurs éprouvent de résistance â restaurer une vérité dans les mœurs,
même en révolution. Dubois
de Crancé, théoricien militaire d'une pensée vaste et d'une parole hardie,
présenta le 2 un plan de constitution militaire dans lequel il prononça, pour
la première fois, le mot de conscription nationale. Pénétré prophétiquement
du danger pour la liberté des armées permanentes et des recrutements
volontaires stipendiés, il demanda d'incorporer des bataillons de milice
civique dans l'armée existante, pour eu corriger l'esprit. Son plan, le seul
sir pour une nation qui veut être armée en restant libre, consistait â armer
comme garde national tout citoyen actif, et à inscrire dans l'armée active
tout citoyen de dix-huit â quarante ans, à organiser les bataillons
provinciaux de manière à défendre l'ordre en temps de paix, les frontières en
temps de guerre. C'est le même plan que les mêmes pensées faisaient présenter
à l'Assemblée constituante de 1848 par le gouvernement provisoire à la
seconde république, plan qui renaîtra de toutes les circonstances où la
nation voudra être année sans être opprimée. XI. Le
comité des affaires ecclésiastiques, dont le long silence étonnait l'opinion
publique, pressé d'un côté par le grand nombre de religieux qui demandaient à
quitter leur couvent, de l'autre par la nécessité de pourvoir à leur
existence, présenta le 25, par l'organe de Treilhard, un plan provisoire et
gradué d'extinction des ordres monastiques, débris d'une autre époque
incompatible, par la nature et par la perpétuité des vœux, avec le clergé
régulier et avec la liberté légale des consciences. Le plan du comité portait
: « Que
tout citoyen religieux qui a fait des vœux solennels fût tenu de déclarer,
dans trois mois, s'il veut rester dans le cloître ou rentrer dans le monde. « 2°
Que ceux qui sortiront des monastères seront tenus de porter l'habit
clérical, pour n'être plus soumis qu'à la juridiction de l'évêque. « 3°
Qu'il sera fourni à tous les religieux sortis des cloîtres une pension. « 4°
Qu'aux abbés réguliers qui sortiront du couvent il sera assigné un revenu de
deux mille livres. « 5°
Que les religieux pourront être employés comme vicaires et curés, mais
qu'alors ils ne percevront que la moitié de leur pension. « 6°
Que les religieux qui voudront vivre dans la règle seront placés
préférablement dans les maisons situées à la campagne ou dans les petites
villes. « 7°
Que dans les grandes villes on pourra conserver ceux des religieux qui
voudront se consacrer aux soins des malades, à l'éducation publique ou aux
progrès des sciences et des arts. « 8°
Qu'à dater de leur sortie, les religieux seront capables de succession et
donation. « 9°
Que le nombre des religieux réunis devra être » de quinze au moins : faute de
quoi ils seront obligés de se réunir à une autre maison. « 10°
Que tout privilège est anéanti les religieux seront désormais soumis à la
juridiction de l'ordinaire. « 11°
Les maisons qui seront conservées comme utiles aulx sciences, à l'éducation
publique et au soulagement des malades, pourront seules se perpétuer ; mais
les effets civils de la solennité des vœux sont abrogés. En conséquence, les
postulants qui seront admis demeureront toujours libres de quitter leur
ordre, et capables de succession et donation entre-vifs et testamentaires. « 12°
Il sera désigné, pour chaque ordre qui aura des maisons destinées à se
perpétuer en conséquence de l'article précédent, une maison d'épreuve dans
laquelle les postulants passeront le temps prescrit par les statuts avant
leur admission. « 13°
Lorsqu'une maison aura cessé d'être habitée pendant trois ans par le nombre
des sujets fixé par l'article 10, elle sera supprimée et les religieux en
seront répartis aussitôt dans les autres maisons du même ordre. « 14°
Qu'à chaque maison religieuse il sera assigné 800 livres pour chaque
religieux ; mais chaque maison restera chargée des réparations d'édifice, de
l'entretien du culte, etc., etc. » Le même
comité, par le même rapporteur Treilhard, annonça que la nation peut vendre
immédiatement pour quatre cents millions des biens du clergé sans que les
possesseurs actuels subissent aucune réduction sur leurs revenus. Ces quatre
cents millions seront produits, selon le comité, par la seule vente des
maisons dont les religieux demandaient à être sécularisés. Tant l'esprit du
siècle avait pénétré à travers les murailles des cloîtres, et tant
l'institution monacale s'affaissait sous son propre abus. Le comité estimait,
d'après les documents qu'il avait reçus, que los maisons monacales à vendre
dans la seule ville de Paris s'élevaient à cent cinquante millions. Des
appréciateurs plus rigoureux évaluaient l'espace seul occupé dans Paris par
tes couvents à cent dix-sept millions. Le comité évaluait la totalité des
biens de mainmorte du clergé propriétaire à quatre milliards. L'agitation
des provinces, moins contenue que celle de Paris depuis le 14 juillet par
Lafayette, éclatait tous les jours par de nouvelles séditions. A Toulon, les
ouvriers de la marine, admis malgré le commandant de la marine, Albert de
Riom, dans la garde nationale, jetaient le commandant de Toulon dans les
cachots, embauchaient et insurgeaient les arsenaux et les vaisseaux. Sur les
deux rives du Rhône, provinces ardentes où toute idée devient passion et
toute passion fureur, une réunion populaire de douze mille hommes, véritable
armée prélude de l'armée des Marseillais, se concentrait à Montélimar, jurait
la fédération solidaire des peuples des deux provinces, et se préparait à
marcher partout où la Révolution entravée les appellerait. L'Assemblée,
flattée d'un côté, intimidée de l'autre, applaudissait à ce serment. La
Bourgogne imitait cet exemple. La Bretagne le dépassait, à Quimper, le 30
novembre, en s'organisant d'elle-même en armée de la jeunesse, prête à voler
au secours de l'Assemblée contre l'Eglise, la noblesse et les parlements
conspirateurs. Cette armée se fédéralisait, à Lisieux, avec les gardes
nationales de la Normandie. Nantes, dénonçant à la vindicte nationale les
parlementaires de Bretagne et ces ennemis publics, déclarait « que
les citoyens qui s'étaient élevés à la hauteur de la liberté périraient plutôt
que d'en redescendre. » Ces
menaces de la ville de Nantes étaient imprimées et répandues par l'ordre de
l'Assemblée nationale. Rennes, capitale du parlement de Bretagne, parlait
avec la même énergie : Chapelier, son député, demanda que le parlement fût
remplacé sur-le-champ par un tribunal provisoire. Le vicomte de Mirabeau,
frère du grand tribun, mais qui prenait avec affectation le rôle opposé de
champion de l'aristocratie, donna un démenti à Robespierre. Excusé par sa
fougue et son intempérance, le vicomte de Mirabeau fut rappelé simplement à
la décence. L'Assemblée,
sans détruire encore en fait l'institution des parlements, détruite en
principe, décréta que le parlement de Bretagne serait mandé à sa barre, et
que le roi serait prié de nommer à sa place un tribunal provisoire. La
Champagne ne se gouvernait plus que par ses pouvoirs municipaux et ne
reconnaissait aucune juridiction intermédiaire entre elle et l'Assemblée. A
Amiens, la garde nationale instituait dans son sein un comité militaire qui
absorbait toutes les autorités. A Metz, la municipalité dominait tout. A
Senlis, aux portes de Paris, le commandant de la garde nationale était
assassiné par un frénétique qui faisait sauter sa maison et son quartier pour
s'ensevelir, impuni, sous les décombres. A Paris même, les insurrections
morales des districts contre l'Assemblée remplissaient la ville de partis et
de rumeurs contraires. On accusait Mirabeau d'inspirer contre Bailly et
Lafayette les motions de Danton et les diatribes de Camille Desmoulins, ses
amis. Danton
régnait déjà par la virilité du caractère et par la véhémence des discours
sur le district des Cordeliers et sur les agitateurs subalternes des autres
districts. Camille Desmoulins tenait d'une main légère le stylet antique,
pour cicatriser déjà ceux qu'il poignarderait plus tard. Ses liaisons sourdes
avec Danton, Thuriot, Mirabeau rendaient le grand orateur suspect de
connivence avec Desmoulins. « M.
Bailly », disait dans une de ses feuilles Camille Desmoulins, « a
osé donner des brevets de capitaine qui ne doivent être que la récompense des
services, et que le mérite mène ne doit obtenir que du suffrage des citoyens.
Le district des Cordeliers a lait éclater son improbation. Ce district, ainsi
que celui des Grands-Augustins, indignés de voir le maire ainsi disposer des
grades de la milice nationale et préparer cette proie à ses flagorneurs, a invité
les officiers du bataillon à rapporter sur le bureau leurs brevets signés ;
et ceux-ci, honteux de pareilles provisions, se sont empressés de rendre
hommage au peuple, seul souverain, en remettant leurs brevets au district. « Il
est encore d'autres reproches que font à M. Bailly les philosophes et les
patriotes. Pourquoi, devant sa voiture, ces gardes à cheval, et derrière ces
laquais à livrée, profanateurs de la cocarde nationale, et aux couleurs de la
liberté sur leurs chapeaux, alliant sur toutes les coutures de leur habit les
couleurs honteuses de la servitude ? Pourquoi encore ce traitement de cent
dix mille livres que s'est appliqué le maire de la capitale ? Je lui sais gré
de la noble fierté avec laquelle il a demandé au ministre de Paris l'hôtel de
la Police. Mais pourquoi les murs de cet hôtel ne s'aperçoivent-ils pas
qu'ils ont changé de maître ? Pourquoi le même faste des meubles et la même
somptuosité de table ? Laissez, monsieur Bailly, laissez au Satrape
Pharnabaze ces riches tapis. Agésilas s'assied par terre, et il dicte des
lois au grand roi de Perse. Laissez cette pompe extérieure aux rois et aux
pontifes... Je suis encore au nombre de ceux qui vous chérissent. Je sais le
respect que je dois à votre place et les ménagements que méritent vos talents
et vos services ; mais c'est parce que vous êtes re- LES
CONSTITUANTS. 269 téta de
cette grande place, que je ne souffrirai point que vous vous avilissiez. » Quand
vous serez redevenu simple citoyen, étalez alors votre luxe asiatique,
scandalisez la nation par votre livrée et votre luxe, déshonorez-vous, peu
m'importe, mais cette belle, cette glorieuse révolution de France
qu'aujourd'hui vous ternissez ! Je ne suis pas si ridicule que de prétendre
que M. le maire vive de brouet noir comme Agésilas, ou que, comme Curtius, il
reçoive les ambassadeurs dans une chaumière, mais je lui recommande plus de
simplicité. « Parmi
la multitude des griefs qu'on reproche à M. Bailly, je ne me suis arrêté qu'à
trois : s'être donné une livrée, c'est une petitesse et une puérilité qui a
dû provoquer notre ministère correctionnel ; s'être appliqué cent dix mille
livres d'appointements, c'est une concussion et un vol horrible ; d'avoir
donné des brevets de capitaine, c'est un crime de lèse-nation. » XIII. Quelques
écrits royalistes, mais rares, anonymes et impopulaires, répondaient par des
invectives à ces invectives. Une adresse aux provinces disait au peuple : « Vos
idées étaient claires sur la liberté... Mais... aviez-vous ordonné qu'on abusât
du nom du roi pour envoyer de prétendus ordres de sa part, ou de piller et
brûler les maisons des seigneurs et dei religieux ?... Aviez-vous ordonné
qu'on mit à mort des citoyens sans aucune forme de procédure ?... Leur
aviez-vous donné la première idée du feu de la lanterne ?... Aviez-vous
ordonné à un petit N. Barnave de dire, au milieu de l'Assemblée, qu'il ne
fallait pas s'occuper des fureurs du peuple, parce que le sang qu'il versait
n'était pas pur ?... Aviez-vous ordonné qu'on fit de votre roi un roi de
théâtre ?... Aviez-vous ordonné qu'on lui enlevât jusqu'à sa garde et qu'on
en fit la fable de toutes les nations ?... Aviez-vous ordonné de tenir votre
roi dans les fers ? Aviez-vous ordonné de retrancher à ce malheureux prince
ses amusements les plus innocents (la chasse), de ne lui donner d'autre garde
que ses bourreaux (la garde nationale), et d'autre occupation que celle des crimes qu'il
a à redouter ?... etc. « Voilà
cependant ce qu'on a fait, voilà l'ouvrage de vos députés, et, grâce à leurs
soins, il n'est pas un citoyen dont la liberté et la vie ne soient à
discrétion... « Oui,
vos demandes sont raisonnables ; mais cette sagesse qui les dicta n'a pas
présidé au choix des députés. Quels hommes, j'ose vous le demander, avez-vous
choisis ? Tout ce que vous méprisiez peu d'années auparavant. Des jeunes gens
à qui vous ne connaissiez pour talent que des fureurs, et pour expérience que
de l'intrigue ; des magistrats déshonorés par leur conduite ; des officiers
de justice subalternes qui veulent détruire les parlements pour profiter de
leurs dépouilles ; des propriétaires qui fatiguent les campagnes de leurs
prétentions, et qui, occupés à rivaliser avec leur seigneur, ne le sont
presque jamais de secourir le peuple ; des prêtres crapuleux et d'une sale
ignorance ; des nobles toujours prêts à se tourner vers le puissant et qui
n'ont vu dans votre confiance que des moyens de fortune. Quel sentiment
d'honneur, quelle fidélité à leur devoir, pouviez-vous espérer de pareils
choix ? « Qu'est-ce,
je vous le demande, qu'un petit Robespierre, qui n'était connu à Arras que
par son ingratitude pour l'évêque qui l'avait fait élever ? « Un
Mirabeau, échappé à la corde, mais jamais à et dont le nom seul est une
grosse injure ? « Un
Pétion de Villeneuve, chez qui vous n'aviez pu distinguer que la confiance de
la sottise, et qui, vil instrument des factieux, est comme ces crieurs de la
foire que l'on fait aboyer à la porte des théâtres, pendant que dans
l'intérieur on joue la pièce ? « Un
Barnave, insolent, fat, ignorant, à qui l'esprit Lient lieu de principe et de
morale ; en un mot, ce qu'on appelle un drôle ? « Deux
Lameth, cette famille jadis si intrigante et si basse à la cour, plats valets
dans les temps de la servitude et insolents dans les temps d'audace ? Vous
les verrez à la tête des furieux, tant que les fureurs mèneront à la fortune
; vous les retrouverez dans les antichambres, si elles sont encore la source
de grâces, et, toujours intrigants par essence, se payer du mépris par les
places et l'argent. « Un
Castellane ? un Duport dégoûtant de mauvaise foi, de subtilité et d'intrigue
? Un Goupil du Préfelo ? « Un
curé Grégoire, qui, avec un autre curé, Dillon, dispute de propos séditieux,
et au lieu d'un ministère de paix qui exige des talents et de la vertu, ne
remplit et ne pourra jamais remplir que le rôle de factieux ? « Un
Ballin ? un Glezen ? un abbé Sieyès, que vous avez vu se déshonorer à
l'assemblée d'Orléans, et qui, après avoir tenté en vain tous les moyens de
faire fortune, est venu confondre les conditions pour voler et piller dans le
désordre ? « Un
Clermont-Tonnerre, esprit sublime pour les petites choses, et mince pour les
grandes ; envieux de tous, mais qui, n'ayant que les petits moyens de
médiocrité, ne connaît l'ambition que comme les impuissants connaissent
l'amour, par des inquiétudes et par la jalousie ? Un Laborde,
riche de quarante millions volés à l’Etat ; le financier de l'archevêque de
Sens, alors le plus fidèle suppôt du despotisme, et qui, après s'être enrichi
du sang des malheureux, veut encore qu'on détruise pour lui les rangs où
l'argent seul ne pouvait pas atteindre ? « Un
Gouy d'Arcy, qui, dans cette vile assemblée, n'a pu même éviter le mépris ? « Un
marquis de Cote, vil intrigant, incapable de se montrer au grand jour ;
n'ayant pour esprit que la fausseté, pour physionomie qu'un rire mais, pour
talent que l'art de se taire, pour courage que celui des machines dans les
ténèbres ? Sa force est celle du basilic de la Fable, dont les poisons
étaient mortels lorsqu'on ne l'apercevait pas, mais qu'il suffisait de
regarder pour le terrasser et le détruire. « Un
comte de Crillon, dont l'esprit de travers est presque passé en proverbe ?...
Champion maladroit de M. Necker, sa pesante amitié ignore qu'on ne sert pas
ses amis par l'ennui qu'on en donne, et que le seul point d'honneur des sots
est d'adorer dans le respect et dans le silence. « Des
Noailles ?... Un chapelier, maudit par son père, méprisé au barreau, sans
talents, sans principes, faisant le mal parce qu'il est l'opposé du bien, et
obligé de cacher sa médiocrité. » XIV. Bailly
et Lafayette cherchaient en vain à refréner les excès de cette presse par des
arrêtés arbitraires de la Commune. La presse leur échappait par tous les
pores. Marat
racontait ainsi à ses nombreux sectaires l'hégyre et le martyre de ses
propres persécutions, dont il accusait Lafayette et Bailly : « La
nuit, je fus assailli par une bande nombreuse d'assassins. C'en était fait de
moi s'ils fussent parvenus à forcer la porte, qu'on refusa de leur ouvrir. « Les
ennemis publics me regardaient comme le premier moteur de l'insurrection qui
venait de sauver la patrie. « J'avais
informé deux districts des dangers que je courais. L'un fit faire de
fréquentes patrouilles devant ma porte ; l'autre m'envoya quelques officiers
pour me mettre en sûreté. Plusieurs amis m'enlevèrent de cher moi et me
conduisirent à Versailles... J'appris que le Châtelet venait de lancer contre
moi un décret de prise de corps... L'attentat du comité de police m'avait
enlevé mes presses. « A
peine eus-je passé huit jouis dans ma retraite, que ce genre de vie parut
suspect au traiteur qui me servait : il alla me dénoncer à la garde
nationale... Deux officiers sans armes entrèrent dans ma chambre. « Nous
venons savoir qui vous êtes. — Je suis l’ami du peuple. — L'ami du peuple !
il est en sûreté parmi nous, qu'il y reste ; tous ses concitoyens sont prêts
à le défendre... — Vous frémissez à l'idée de livrer l'ami du peuple ; et
vous, généreux Lecointre, le modèle des vrais patriotes, vous vous chargiez
de leur reconnaissance. « Je
désirais me rapprocher de Paris. Je trouvai un » asile dans une rave. » XV. Les
rumeurs extérieures commençaient à se mêler à ces tumultes du dedans pour
distraire l'Assemblée de ses travaux ; mais la force d'impulsion qu'elle
avait reçue de la volonté nationale à son origine lui donnait la confiance de
triompher de ses ennemis, comme elle triompherait de ces factions. Les
patriotes du Brabant, aristocrates et démocrates, unis dans un même sentiment
de nationalité, venaient de vaincre le général Dalton, qui commandait l'armée
de l'empereur Joseph II. Ils s'étaient emparés de Bruxelles, ils avaient
constitué un gouvernement et proclamé le patriote Vandernot tribun ou
régulateur de leur insurrection. D'un
autre côté, les princes allemands vassaux de l'Empire qui possédaient des
fiefs privés en France, et que la nuit du dl août venait de déposséder de leurs
droits féodaux de ce côté du Rhin, se refusaient, en qualité de princes
étrangers et indépendants, à reconnaître la loi française ; ils réclamaient
leurs privilèges, criaient à la spoliation, à la viol ;- fion du droit des
gens dans leur personne et menaçaient l'Assemblée des vengeances de l'Empire,
forcé à soutenir par les armes leurs droits. XVI. Ces
convulsions du dedans, ces menaces, quoique lointaines, du dehors, cet
interrègne trop longtemps prolongé de tout autre ordre que de l'ordre armé de
Lafayette, les alarmes qu'inspirait aux citoyens prévoyants une dictature si
absolue et si irrégulière entre les mains d'un général qui pouvait devenir un
Cromwell contre la liberté et contre la cour, commençaient à rapprocher du
roi les membres mêmes les plus populaires de l'Assemblée. Ils étaient pressés
de lui rendre dans la constitution, bientôt achevée, la place dont il était
descendu le 6 octobre ; de le réconcilier lui-même avec la constitution, par
la force exécutive dont elle allait l'investir au nom de son peuple, et de
lui témoigner une confiance et des respects, réparation des outrages et des avilissements
soufferts. Ce prince, à cette époque, était encore aimé, sinon comme roi au
moins comme homme, par la nation : on peut dire même qu'il le fut jusqu'à son
supplice. En 1789, c'était se populariser dans l'opinion de la masse de la
capitale et des provinces, que d'honorer dans le roi les intentions, les
concessions, la bonté et même la faiblesse de sa nature. Il y avait de la
piété dans la réhabilitation que l'Assemblée désirait lui décerner à la fin
de la constitution. S'il eût été un tyran, on l'aurait déposé dès le premier
jour de la lutte entre l'aristocratie et la nation ; on le couronnait de
nouveau avec complaisance parce qu'on le jugeait incapable d'abuser du
sceptre. Ces
sentiments se manifestèrent avec solennité le 1er janvier 1790, dans les
hommages-que l'Assemblée lui porta par son président des Meuniers et par une
députation de soixante membres. L'Assemblée lui parla, ainsi qu'à la reine,
des consolations qu'un prochain avenir apporterait à ses peines. L'accent du
cœur se fit entendre dans cette entrevue du roi, de la reine et des députés.
Cinq jours après, une députation de l'Assemblée vint supplier le roi de fixer
lui-même, sous le nom de liste civile, le revenu sans limite qu'il jugeait
convenable à l'entretien de sa maison et à la juste splendeur du trône ; le
président lui parla de la modestie de ses mœurs, de son économie personnelle,
et le prémunit, non contre sa prodigalité, mais contre ses vertus. « Sire, »
lui dit des Meuniers au nom de l'Assemblée, « l'Assemblée nationale nous
a députés vers Votre Majesté pour vouloir bien fixer elle-même la portion des
revenus publics que la nation désire consacrer à l'entretien de votre maison,
à celle de votre auguste famille et à vos jouissances personnelles. Mais en
demandant à Votre Majesté cette marque de bonté, l'Assemblée nationale n'a pu
se défendre d'un sentiment d'inquiétude que vos vertus ont fait naître. Nous
connaissons, sire, cette économie sévère qui prend sa source dans l'amour de
vos peuples et dans la crainte d'ajouter à leurs besoins ; mais qu'il serait
déchirant pour vos sujets le sentiment qui vous empêcherait de recevoir le
témoignage de leur amour ! Vous avez cherché votre bonheur dans celui de vos
peuples ; permettez qu'à leur tour ils placent leur première jouissance dans
celles qu'ils viennent vous offrir. Mais si nous ne pouvons vaincre par nos
désirs la touchante sévérité de vos mœurs, vous daignerez du moins accorder à
la dignité de votre couronne l'éclat et la pompe qui, en ajoutant à la
majesté des lois, deviennent pour vos peuples un moyen de bonheur. Vous le
savez, sire, ils ne peuvent être heureux que par le respect des lois, et la
majesté du trône en est inséparable. La classe la plus infortunée jouira
surtout de la majesté du trône, car la plus voisine de l'oppression est la
plus intéressée au maintien des lois. Ainsi, c'est pour le bonheur de vos
peuples que nous venons contrarier ces goûts simples et ces mœurs
patriarcales qui vous ont mérité leur amour, et qui montrent aux nations
l'homme le plus vertueux dans le meilleur des rois. » Le roi
se refusa à taxer lui-même la situation et la munificence de son peuple. « J'aurai
toujours assez, » répondit-il, « si les créanciers de l'État sont
payés et si les services publics sont assurés. » Camille
Desmoulins et les journaux démagogues raillèrent cette noblesse de
l'Assemblée et cette dignité du monarque. « Pour
mettre le comble à la joie du prince, » écrivit le lendemain l'amer
journaliste, « M. le marquis de Montesquiou a proposé de lui accorder
pour lui, sa femme, ses hoirs et leur maison, un revenu de vingt millions !
On trouvera assez civile cette pension du premier bourgeois du royaume !... » L'Assemblée
consuma le mois de janvier tout entier au travail nécessaire mais
consciencieux de la division du royaume en quatre-vingt-trois départements, de
l'organisation de l'armée, toujours urgente, toujours ajournée, et à la
révision des pensions, question pleine de scandale qui nourrissait
l'indignation du peuple contre l'aristocratie vénale des dilapidateurs de
cour. Elle décréta le serment civique en trois mots qui traçaient les trois
devoirs des citoyens : FIDÉLITÉ A LA NATION, A LA LOI, AU ROI. XVII. Le
parlement de Bretagne, cité précédemment à la barre de l'Assemblée, y
comparut le 10 janvier. D'Espréménil, devenu aussi fougueux défenseur des privilèges
des parlements qu'il avait été factieux parlementaire contre la couronne,
voulut faire appel au peuple en faveur de ces magistrats révoltés. Chapelier
l'écrasa sous des arguments, Mirabeau sous des accents qui firent trembler le
privilège judiciaire comme ils avaient fait trembler le trône. « Eh
quoi ! c'est une poignée de magistrats sans titre et sans caractère qui
viennent dire au souverain : Nous avons désobéi, et la postérité nous
admirera ! Il n'y aura que leur démence qui passera à la postérité, si
toutefois elle peut y être transmise ; mais ils n'empêcheront pas cette
grande révolution qui va changer la face du globe et le sort de l'espèce
humaine. « D'où
vient l'audace de ces magistrats ? quelle puissance auxiliaire leur a inspiré
tant de confiance ? Ils viennent demander que des privilèges oppressifs
soient rétablis. La Bretagne a soixante- six représentants dans cette
assemblée, et l'on vous dit qu'elle n'est pas représentée ! Onze magistrats
bretons viennent dire qu'ils ne peuvent pas consentir que vous soyez les
régénérateurs de cet empire ! Ce n'est pas dans de vieilles chartes, où la
ruse, combinée avec la force, a trouvé les moyens d'opprimer le peuple, qu'il
faut chercher les droits de la nation, c'est dans la raison : ses droits sont
anciens comme le temps et sacrés comme la nature. « Le
discours qui a été prononcé cache des desseins coupables. On cherche à
rallier tout ce qui peut y avoir d'espérances odieuses. Leur fierté
sénatoriale veut empêcher les Bretons d'être libres ; ils voudraient que les
abus fussent éternels et que le régime féodal fit immuable. Qu'ils apprennent
qu'il n'y a d'immuable que la raison, et qu'elle détruira bientôt toutes les
institutions vicieuses. Vainement on cherche à séparer le monarque de sa
nation : il sera toujours uni avec elle ; il triomphera de ceux qui veulent
faire de lui un instrument d'oppression. Les magistrats ne réclament les
anciens privilèges que pour asservir leur province. Ils parlent de leur
conscience ! Elle est le résultat de leurs anciennes habitudes, elle les
porte à conserver leurs usurpations. » Après
ces paroles, suffisantes, selon lui, pour montrer l'irrésistible volonté
d'une révolution qui ne s'arrêterait pas devant une toge quand elle avait
brisé un sceptre, Mirabeau vota le dédain comme peine unique Infligée à ces
magistrats aussi impuissants devant le peuple qu'ils avaient été insolents
devant le roi. XVIII. Cazalès
les défendit au nom du droit historique et de ces indépendances fédératives
des provinces que la nation ne pouvait méconnaître, mais qu'elle avait juré
d'absorber dans la fédération plus légale et plus forte de tous les Français. Barrère,
qui débutait à la tribune, fit valoir, contre les arguments vrais mais
rétrospectifs de Cazalès, ce droit souverain d'une nation qui prend sa propre
dictature aux époques de régénération et de crise, et qui retire à elle tous
les pouvoirs légaux jusque-là, pour ne reconnaître d'autre légalité que celle
du salut commun. Clermont-Tonnerre,
de plus en plus rallié à la cause de la constitution modérée mais
victorieuse, seconda Mirabeau, et revendiqua le droit de la nation contre le
vain droit des parlements, qui voulaient se faire les tribuns des provinces
après en avoir été les tyrans. L'Assemblée,
pour toute peine, condamna les parlements à prêter serment à la nation et à
la loi. Le 16,
l'Assemblée accorda deux mois de sursis aux ecclésiastiques pour faire la
déclaration de leurs biens. Le 25,
Robespierre s'éleva, à l'Assemblée, dans un discours sans réplique, contre
l'iniquité de l'article de la constitution qui imposait un cens pour
condition au droit d'élire et d'être élu ; il démontra que dans les provinces
de la Flandre et du Nord de la France, l'augmentation des biens
ecclésiastiques avait tellement réduit le nombre des familles propriétaires
et imposées, qu'il n'y avait pas quatre citoyens actifs sur cent habitants,
et que le droit d'élire et d'être élu devenait un privilège plus exclusif des
droits civiques que les privilèges abolis. « Voulez-vous
donc, » dit-il, « qu'un citoyen signe avec mépris par le nom sacré
de peuple ?... Voulez-vous qu'un citoyen soit parmi nous un être rare, par
cela seul que les propriétés appartiennent à des moines, à des bénéficiers,
et que les contributions directes ne sont pas en usage dans nos provinces ?
Voulez-vous que nous portions à ceux qui nous ont confié leurs droits des
droits moindres que ceux dont ils jouissaient ? Que répondre quand ils nous
diront : Vous parlez de liberté et de constitution, il n'en existe plus pour
nous. La liberté consiste, dites-vous, dans la volonté générale, et notre
voix ne sera pas comptée dans le recensement général des voix de la nation.
La liberté consiste dans la nomination libre des magistrats auxquels on doit
obéir, et nous ne choisissons plus nos magistrats. Autrefois nous les
nommions, nous pouvions parvenir aux fonctions publiques. Nous ne le pourrons
plus quand les anciennes contributions subsisteront... Dans la France esclave,
nous étions distingués par quelque reste de liberté ; dans la France devenue
libre, nous serons distingués par l'esclavage. « Si
nous pouvons vous proposer un parti qui, loin de compromettre vos décrets et
vos principes, les cimente et les consacre ; s'il n'a d'autre effet que de
fortifier vos décrets et de vous assurer de plus en plus la confiance et
l'amour de la nation, quelle objection pouvez-vous faire ? « L'Assemblée
nationale, considérant que les contributions maintenant établies dans
diverses parties du royaume ne sont ni assez uniformes ni assez sagement
combinées pour permettre une application juste et universelle des décrets
relatifs aux conditions d'éligibilité ; voulant maintenir l'égalité politique
entre toutes les parties du royaume, déclare l'exécution des dispositions
concernant la nature et la quotité des contributions nécessaires pour être
citoyen actif, électeur et éligible, différées jusqu'à l'époque où un nouveau
mode d'imposition sera établi ; que jusqu'à cette époque, tous les Français,
c'est-à-dire tous les citoyens domiciliés, nés Français ou naturalisés
Français, seront admissibles à tous les emplois publics, sans autre
distinction que celle des vertus et des talents. » Ce
discours fit de Robespierre le vengeur d'une vérité : situation puissante,
quoique souvent effacée, dans le sein d'une assemblée et dans le dernier
repli du cœur du peuple. Il ne triompha pas, mais il protesta. Les
protestations sont les triomphes de l'avenir. XIX. L'incompatibilité
des fonctions publiques et des fonctions de représentant, principe vrai si on
en excepte les ministres, organes nécessaires du pouvoir royal auprès de la
représentation nationale, prévalut le jour suivant à la voix de Duport. Les
troubles de Marseille rappelèrent à la tribune Mirabeau, député de Provence.
Il prit avec force le parti des séditieux contre la garde nationale,
sacrifiant la bourgeoisie au peuple, pour y conserver son rôle de tribun. « Le
19 août, » dit-il, « cette garde nationale tua sur la place de la
Tourette un habitant, sous le prétexte frivole d'un attroupement. Elle fut
huée par le peuple et obligée de cacher en fuyant la honte de cet horrible
attentat. Le corps du malheureux assassiné fut promené par le peuple le
lendemain dans les rues de la ville. Au milieu de ce spectacle, si capable de
causer l'effervescence, la maison de M. Laflèche, consul, lut pillée, ses
meubles incendiés. La troupe soldée entra alors dans la ville et saisit
vingt-trois brigands flétris, dans la maison même du consul. Le prévôt ne les
a point encore jugés, tandis qu'il poursuit avec une rigueur inouïe une
multitude de citoyens qui n'ont fait d'autre crime que de déplaire au
parlement et à l'intendant de la province, dont ce juge cruel s'est déclaré
bassement le vengeur. » On
ajourna encore le jugement de ces troubles, jugement qui pouvait amener des
troubles plus sanglants. Le 20
janvier, Sieyès, qui paraissait rarement à la tribune, de peur de détruire
par sa parole le prestige de son silence, lut le rapport sur la liberté de la
presse, vérité de principe sans cesse démentie 'depuis ou modifiée par les
circonstances. Ce rapport, empreint d'une métaphysique doctorale mais
sophistique, faisait de la presse un droit imprescriptible conféré à l'homme
en naissant par la nature. Les sociétés chez lesquelles l'imprimerie n'était
pas inventée auraient été bien étonnées d'un tel axiome ; mais distinguant
aussitôt le droit et l'usage, Sieyès, en déclarant le droit inviolable et
illimité, réprimait sévèrement l’usage. Puis, reprenant la thèse de la
liberté absolue, « Dans
ses rapports avec le gouvernement, » disait Sieyès, « la même cause
se change en une source féconde de prospérité nationale : elle devient la
sentinelle et la véritable sauvegarde de la liberté publique. C'est bien la
faute des gouvernements s'ils n'ont pas su, s'ils n'ont pas voulu en tirer
tout le fruit qu'elle leur promettait. Voulez-vous réformer des abus ? Elle
vous préparera les voies, balayera, pour ainsi dire, devant vous cette multitude
d'obstacles que l'ignorance, l'intérêt personnel et la mauvaise foi
s'efforcent d'élever sur votre route. Au flambeau de l'opinion publique, tous
les ennemis de la nation et de l'égalité, qui doivent être aussi des
lumières, se hâtent de retirer leurs honteux desseins. Avez-vous besoin d'une
» bonne institution ? Laissez la presse vous servir de précurseur ; laissez
les écrits des citoyens éclairés disposer les esprits il sentir le besoin du
bien que vous voulez leur faire. Et, qu'on y fasse attention, c'est ainsi
qu'on prépare les bonnes lois ; c'est ainsi qu'elles produisent tout leur
effet, et que l'on épargne aux hommes, qui, hélas ! ne jouissent jamais trop
tôt, le long apprentissage des siècles. « L'imprimerie
a changé le sort de l'Europe ; elle changera la face du monde. Je la
considère comme une nouvelle faculté ajoutée aux plus belles facultés de
l'homme. Par elle, la liberté cesse d'être resserrée dans de petites
agrégations républicaines : elle se répand sur les royaumes, sur les empires.
L'imprimerie est, pour l'immensité de l'espace, ce qu'était la voix de
l'orateur sur la place publique d'Athènes et de Rome : par elle, la pensée de
l'homme de génie se porte à la fois dans tous les lieux ; elle frappe, pour
ainsi dire, l'oreille de l’espèce humaine entière. Partout, le désir secret
de la liberté, qui jamais ne s'éteint entièrement dans le cœur de l'homme, la
recueille, cette pensée, avec amour, et l'embrasse quelquefois avec fureur ;
elle se mêle, elle se confond dans tous ses sentiments. « Et
que ne peut pas un tel mobile agissant à la fois sur des millions d'âmes !
Les philosophes et les publicistes se sont trop hâtés de nous décourager, en
prononçant que la liberté ne pouvait appartenir qu'à de petits peuples. Ils
n'ont su lire l'avenir que dans le passé, et lorsqu'une nouvelle cause de
perfectibilité, jetée sur la terre, leur présageait des changements
prodigieux parmi les hommes, ce n'est jamais que dans ce qui a été qu'ils ont
voulu regarder ce qui pouvait être, ce qui devait être. Élevons-nous à de
plus hautes espérances. Sachons que le territoire le plus vaste, que la plus
nombreuse population, que tout se prête à la liberté. Pourquoi, en effet, un
instrument qui saura mettre le genre humain en communauté d'opinion,
l'émouvoir et l'animer d'un sentiment, l'unir du lien d'une constitution
vraiment sociale, ne serait-il pas appelé à agrandir indéfiniment le domaine
de la liberté, et prêter un jour à la nature même des moyens plus sûrs pour
remplir son véritable dessein ? Car sans doute la nature entend que tous les
hommes soient également libres et heureux. « Tous
ne réduirez donc pas, messieurs, les moyens de communication entre les
hommes. L'instruction et les vérités nouvelles ressemblent à tous les genres
de produits : elles sont dues au travail. Or, on sait que dans toute espèce
de travail, c'est la liberté de faire et la facilité du débit qui
soutiennent, excitent et multiplient la production. Ainsi, gêner mal à propos
la liberté de la presse, ce serait attaquer le fruit du génie jusque dans son
germe, ce serait anéantir une partie des lumières qui doivent faire la gloire
et la richesse de votre postérité. « Combien
il serait plus naturel, au contraire, sur- tout lorsqu'on montre avec raison
beaucoup d'intérêt aux progrès du commerce, de favoriser de toutes ses forces
celui qui vous importe le plus, le commerce de la pensée ! » XX. Une loi
sévère et minutieuse en quarante-quatre articles corrigeait ces doctrines de
l'anarchie de la pensée écrite par l'arbitraire des peines portées. Le
jugement par jury des délits de la presse présentait seul, aux esprits
inexpérimentés du temps, une garantie d'impartialité aux écrivains. Mais
l'expérience devait bientôt apprendre aux législateurs que la passion est la
partialité des jurés comme l'esprit de servitude est la partialité du juge ;
que l'opinion seule était la véritable justice et la souveraine pénalité de
la presse, et que ce sens nouveau, prêté à l'homme par l'imprimerie, après
avoir renversé des autels et des trônes, renverserait des assemblées, et
n'était compressible que par lui-même. Dans ce long et terrible conflit entre
la presse et la société, la victoire, après bien des ruines, ne restera
qu'aux plus hardis. Le plus hardi sera celui qui, ayant la foi la plus
constante dans la raison publique, défiera hardiment la presse d'offusquer
longtemps la vérité. Cet organe, comme le soleil moral, crée l'erreur sans
doute ; mais il crée lui-même la lumière destinée à faire évanouir ses
illusions, ses sophismes et ses mensonges, excepté pendant les courtes
dictatures, où la société, malade ou troublée, impose momentanément le repos
et le silence à ses organes. Éteindre la presse, c'est éteindre la conscience
humaine. Les ténèbres ne profitent qu'aux malfaiteurs. Toute politique morale
rendra le jour au peuple pour reconnaître le juste et sanctionner sa propre
loi. Sieyès
et l'Assemblée avaient l'instinct de ou vérités, mais ils les faussaient en
les exagérant, comme Lafayette l'avait fait dans la déclaration des droits de
l'homme. Il n'y a de droits en société que ceux que la société reconnaît
compatibles avec l'existence de la société elle-même. La nature n'avait pas
fait naître l'homme avec un terrain enclos sous ses pieds ou avec une
imprimerie à sa porte. En exagérant ce sophisme de droits naturels, Sieyès,
Lafayette et l'Assemblée étaient forcés d'exagérer les mesures répressives
contre leurs axiomes : l'un prenait la dictature d'une milice armée et
soldée, contre son droit naturel et illimité d'insurrection proclamé le plus
sacré des devoirs ; l'autre, après avoir proclamé la liberté illimitée de la
presse un droit naturel, rivait une chaîne en quarante-quatre anneaux pour enchaîner
l'usage ou l'abus de son principe. Mais qu'importaient des lois contre la
presse à une époque où il n'y avait personne pour appliquer les lois,
personne pour y obéir ? XXI. Les
émeutes, un moment assoupies, couvaient de nouveau dans la capitale. Elles
embauchaient même les anciens gardes-françaises, devenus les janissaires
soldés de l'ordre. Les agitateurs réunirent une nuit douze à quinze cents de
ces soldats dans un banquet aux Champs-Elysées, sous prétexte d'aller
demander, sans armes, eux magistrats les têtes des conspirateurs jugés per le
Châtelet. Lafayette, prévenu à temps du complot, les fit cerner dans les
Champs-Elysées par sa cavalerie et par de nombreux bataillons de la garde
nationale ; les soldats embauchés reconnurent leur erreur à la voix de leur
général et rentrèrent dans la discipline. Les
magistrats du Châtelet, encouragés par cette fermeté de Lafayette et par
cette déroute des séditieux, osèrent citer Marat, le chef des agitateurs,
devant leur tribunal. Marat s'évada de nouveau et remplit la France de ses
gémissements et de ses invectives. « Un
bon citoyen, » dit-il dans son pamphlet du lendemain, « vint
m'avertir qu'on allait m'enlever. Je passai chez un voisin, et vingt minutes
après, je vis d'une croisée toute l'expédition. « A
onze heures et demie s'avancèrent au petit pas, dans la rue de
l'Ancienne-Comédie, par celle Saint-André, plusieurs détachements de huit
hommes très peu éloignés. Après le mot d'ordre donné à l'officier qui
commandait le corps de garde qui est à ma porte, ces détachements s'y
rassemblèrent, et lorsque le dernier fut arrivé, ils en sortirent, se firent
ouvrir la porte cochère, se répandirent dans la cour, silencieusement et sur
la pointe du pied, et se présentèrent à la porte de mon appartement, qu'ils trouvèrent
fermée ; puis ils descendirent à mon imprimerie, demandèrent à mes ouvriers
où j'étais, prirent des renseignements sur ma personne, sur les endroits où
je pourrais me trouver, et enlevèrent plusieurs exemplaires de mon journal et
d'une dénonciation en règle contre le ministre des finances, prête à paraître.
Ils avaient certainement à leur tête quelque espion bien au fait des
personnes qui sont à mon service et des chambres qu'elles habitent. En
montant l'escalier jusqu'au grenier, ils arrivèrent à la porte de ma
retraite, et je les aperçus par le trou de la serrure. Ensuite ils entrèrent
dans plusieurs pièces, firent d'exactes mais d'inutiles recherches, et
redescendirent dans la cour. Une demoiselle qui se trouvait chez le portier
leur dit que j'étais sans doute dans mon ancien appartement, rue du
Vieux-Colombier. Ils s'y rendirent tous à la fois sans laisser un seul homme
en arrière. Dès qu'ils furent éloignés, je descendis dans la cour, et
j'appris qu'ils avaient présenté au corps de garde un décret du Châtelet,
portant l'ordre de m'enlever partout où je serais. Cet ordre était écrit sur
un chiffon de papier non timbré. Je quittai la maison et j'allai chercher un
asile chez un ami de cœur. Le lendemain matin, plusieurs témoins dignes de
foi vinrent m'avertir de ce qui s'était passé rue du Vieux-Colombier. Ils
avaient forcé la porte. Le pauvre ami du peuple, » ajoutait-il, « est
si excédé de persécutions et de fatigues qu'il demande indulgence pour le
désordre de sa publication d'aujourd’hui » Danton
était le patron avoué de Marat, qu'il méprisait, mais qu'il affectait
d'applaudir comme un fou qui disait impunément des vérités fort. Il invoqua
pour son client l'appui du district des Cordeliers. Ce district, devenu en même
temps le club le plus dominateur de Paris, prit Marat sous sa protection.
Marat insulta plus haut le tribunal ; il écrivit une lettre à l'Assemblée,
une autre à Lafayette pour réclamer la garantie du pouvoir révolutionnaire
contre l'existence posthume du Châtelet. « Anathème
! » s’écriait-il, « contre ce tribunal de sang, d'où le puissant
échappe toujours impuni, et où le coupable est expédié clandestinement quand
il a des complices d'un rang élevé ! » Allusion à Favras, qui
vivait encore, et qu'on accusait le comte de Provence de vouloir faire
égorger dans sa prison par des émeutes factices, pour fermer la bouche aux
révélations. XXII. La
Commune alors, par un rapport de Boucher d'Argis, un de ses membres les plus
outragés dans la feuille de Marat, ordonna des poursuites par devant le
Châtelet contre l'agitateur du peuple, Les Cordeliers et Danton s'insurgèrent
contre la Commune et nommèrent cinq commissaires, conservateurs de la
liberté. Ces commissaires posèrent des sentinelles à la porte de Marat,
qui logeait dans une maison attenante au district des Cordeliers, rue de
l'École-de-Médecine. La Commune envoya une petite armée composée de bataillons
d'autres districts et de quatre escadrons d cavalerie, pour prêter force à
ses décrets. Ce corps d'armée cerna vainement le quartier : le district,
convoqué par Danton, refusa de livrer le coupable ; il envoya une députation
à l'Assemblée pour accuser la municipalité d'usurpation sur les droits des
districts et de sévices contre les citoyens. L'Assemblée réprimanda
timidement les Cordeliers, et les conjura de se prêter à l'exécution du
décret contre un de leurs membres. Pendant
ces appels à l'Assemblée et ces résistances de la Commune, le peuple, au
nombre de cent mille., hommes, femmes et enfants, armés, désarmés,
suppliants, menaçants, s'était jeté, dans le quartier des Cordeliers, entre
l'ami du peuple et l'armée mobile. Carle, commandant de bataillon, résolu et
intrépide, échoua contre la mollesse de ses soldats. L'armée se retira
d'elle-meure, débondée devant l'attroupement et les vociférations du peuple.
Marat, vainqueur, disparut de nouveau pour fomenter des séditions plus
décisives. Un
autre pamphlétaire, nommé Rutledge, publia contre M. Necker une accusation
incendiaire qui souleva également la colère du peuple, les sévérités de la
Commune, le patronage des Cordeliers. Necker y était traîné dans la fange des
calomnies, le mieux accueillies par ce même peuple qui avait arboré, quelques
mois auparavant, son buste pour idole. Comme
homme politique, Rutledge lui reprochait ses hésitations à reconnaître les
droits représentatifs des plébéiens ; comme financier, sa faveur pour
l'agiotage, dont il l'accusait d'avoir partagé les usures sur la nation ;
comme administrateur des subsistances, il lui reprochait son incapacité et
ses collusions avec les prétendus accapareurs. Il évaluait à quinze millions
sa fortune, preuve, selon lui, de sa cupidité et de ses gains dans la banque.
Sa fortune était grande, mais honorable et pure. « J'ai
fait ma tâche, » disait Rutledge ; « que M. Necker fasse la sienne.
Monsieur l'administrateur des finances, justifiez-vous sans délai aux yeux de
la nation... Garder le silence sur un tel point, ce serait passer
condamnation. « Ne
donnez pas non plus le change au public, en soudoyant des plumes vénales pour
me diffamer : il ne s'agit pas ici de moi, mais de votre justification... Je
vous traduis devant la nation, comme un écrivain public ; il faut vous laver
complètement ou encourir les suites de sa juste indignation. « Les
faits que j'ai allégués contre vous sont de notoriété publique ; ils forment
la preuve de vos attentats. Si cette preuve est jugée illusoire, j'ai tort
sans doute de m'être abusé ; et si, pour expier ma faute, il faut que je
périsse, je périrai. « Si
elle est jugée victorieuse, je périrai encore par les nuées d'ennemis publics
attachés à votre char : j'en ai trop dit pour pouvoir échapper. « Peuple
ingrat et frivole, qui accuses les tyrans et abandonnes tes défenseurs ! je
me suis dévoué pour toi ; je t'ai sacrifié mes veilles, mon repos, ma santé,
ma liberté !... Et aujourd'hui tu me vois en silence poursuivi par tes
ennemis, et forcé de fuir pour échapper à leur fureur... Mais non, je ne te
fais point de reproches : ma vertu serait-elle si pure si j'avais compté sur
ton amour ? » XXIII. Rutledge,
menacé d'arrestation par la Commune, où siégeaient les amis de Necker,
recourut comme Marat à la protection toute-puissante des Cordeliers. Le
district, rassemblé et composé des amis de Danton, Paré, Fabre d'Eglantine,
Duplaix, Audotte, répondit que, sur la demande de Rutledge, qui requérait la
protection des Cordeliers, l'assemblée générale, unanimement convoquée,
plaçait Rutledge sous la sauvegarde de la loi. Ainsi s'élevait, de quartier à
quartier, de club à club, puissance contre puissance, sous les yeux du roi,
de l'Assemblée, de la Commune, et sous l'épée de Lafayette. XXIV. Les
royalistes de l'Assemblée voulurent organiser aussi, en faveur de leur
principe, cette puissance anarchique des clubs, dont les Jacobins et les
Cordeliers leur donnaient le modèle, en concentrant en eux une puissance
d'agitation supérieure à toute loi. Ils ignoraient que les clubs, qui sont la
représentation de la passion populaire, n'ont de force que pour les
majorités, et n'attestent des minorités que l'impopularité et la faiblesse.
Le club des Grands-Augustins ou des Malouetistes, du nom de l'orateur
principal de cette réunion, afficha l'impartialité pour attirer à lui les
hommes d'ordre et de modération. Mais l'impartialité est le crime contre tous
les partis dans les temps de factions. La prétention d'imposer des digues à
l'exagération des principes irritait les fanatiques d'opinion, plus que le
courage de nier ces principes et de les combattre en &te. Malouet,
linteau, l'évêque de Nancy, la Fare, Bouffiers Rédon, composèrent le noyau de
cette réunion. la droite entière de l'Assemblée s'y affilia, à l'exception
des membres du parti de la cour trop signalés par leur opposition violente
aux principes populaires, tels que Maury, d'Espréménil, Cazalès, dont la
présence aurait pu démentir le caractère d'impartialité de la réunion. Les
membres publièrent leurs principes et leur règlement dans un avis au public
dont chaque mot justifiait leur but. « Nous, »
disaient-ils, « membres de l'Assemblée nationale, ennemis de toute
mesure exagérée ou violente, dévoués à la cause de la liberté et du salut
public, attachés aux intérêts du peuple, nous ne cesserons de nous opposer à
tout projet qui tendrait à l'égarer, soit en le portant au désordre, soit en
l'excitant au mépris de la constitution et des lois. « Tout
citoyen, selon nous, doit se soumettre à la constitution : le temps et
l'expérience manifesteront et corrigeront légalement ce qu'elle pourrait
avoir de défectueux. Il est plus que temps de ramener l'ordre et la sécurité,
de rendre au roi le pouvoir exécutif suprême, conformément aux principes de
la constitution. « Nous
défendrons les droits de l'homme et des citoyens. Les titres étant abolis, le
seul titre de citoyen doit réunir tous les Français. « Nous
voulons la liberté de la presse, en réprimant par les lois sa licence... » Deux
articles seuls de cette déclaration contrastaient avec l'esprit de la
Révolution qui respirait dans tout le reste : c'étaient les articles sur la
liberté pleine et sincère de conscience, premier but de la Révolution. Le
club des Impartiaux demandait que la religion catholique eût seule dans le
royaume le privilège du culte public et du titre politique de religion
nationale. Partant de ce privilège, la déclaration demandait une dotation
territoriale inaliénable pour l'Église. La
presse, vendue presque tout entière aux Jacobins et aux Cordeliers, s'indigna
de l'audace des députés royalistes ou impartiaux. Leur crime était de vouloir
user en faveur de leurs opinions de cette liberté d'association dont les
Jacobins poussaient la licence jusqu'aux écrits les plus impunis. Ils se
déchaînaient contre le club rival et contre le manifeste des Impartiaux. Le
peuple, soulevé par ces feuilles, ne tarda pas à s'émeuter et à insulter les
orateurs et les spectateurs du club. Toute tentative pour modérer la
Révolution lui paraissait un complot contre la liberté. Les portes du couvent
des Théatins devinrent le théâtre d'un attroupement permanent, et ne
tardèrent pas à être fermées par les menaces et par les violences des autres
clubs. XXV. Le roi,
cependant, ouvrait son cœur aux hommages et aux augures de paix qu'il venait
de recevoir de l'Assemblée, à l'occasion de la nouvelle année. Il voulut,
d'après les conseils de M. Necker et de Lafayette, reporter lui-même à
l'Assemblée un gage de concorde et de bonne foi à son peuple : il se rendit,
accompagné seulement de ses ministres, au milieu des députés prêts à clore le
travail de la constitution, et prononça un discours propre à rallier les
opinions et les cœurs. « Que
les vrais citoyens, » dit-il, « y réfléchissent, ainsi que je l'ai fait,
en fixant uniquement leur attention sur le bien de l'Etat, et ils verront
que, même avec des opinions différentes, un intérêt imminent doit les réunir
tous aujourd'hui. Le temps réformera ce qui peut rester de défectueux dans la
collection des lois qui auront été l'ouvrage de cette Assemblée. Mais tout
principe qui tendrait à ébranler les principes de la constitution même, tout
concert qui aurait pour but de la renverser ou d'en affaiblir l'heureuse
influence, ne serviraient qu'à introduire au milieu de nous les maux
effrayants de la discorde ; et, en supposant le succès partiel ou momentané
d'une semblable tentative contre mon peuple et moi, le résultat nous
priverait, sans remplacement, de divers biens dont le nouvel ordre de choses
nous offre la perspective. « Livrons-nous
donc de bonne foi aux espérances que nous pouvons concevoir, et ne songeons
qu'à les réaliser par un accord unanime. Que partout on sache que le monarque
et les représentants de la nation sont unis d'un même intérêt et d'un même
vœu, afin que cette opinion, cette ferme croyance, répandent dans les
provinces un esprit de bonne volonté et de paix... Un jour, j'aime à le
croire, tous les Français indistinctement reconnaîtront l'avantage de
l'entière suppression des différences d'ordres de l'Etat, lorsqu'il est
question de travailler en commun au bien public, à cette prospérité de la
patrie qui intéresse également tous les citoyens ; et chacun doit voir sans
peine que, pour être appelé dorénavant à servir l'Etat de quelque manière, Il
suffira de s'être rendu remarquable » par ses talents et ses vertus... » Après
avoir parlé de la noblesse et du clergé, il disait : « J'aurais bien
aussi des pertes à compter si, au milieu des plus grands intérêts de l'Etat,
je m'arrêtais à des calculs personnels ; mais je trouve une compensation qui
me suffit, une compensation pleine et entière dans l'accroissement du bonheur
de la nation, et c'est du fond de mon cœur que j'exprime Ici ces sentiments.
Je descendrai donc, je maintiendrai la liberté constitutionnelle dont le vœu
général, d'accord avec le mien, a consacré les principes. Je fais davantage :
et, de concert avec la reine, qui partage mes sentiments, je préparerai de
bonne heure l'esprit et le cœur de mon fils au nouvel ordre de choses que les
circonstances ont amenées. « Puisse
cette journée, où votre monarque vient ' s'unir à vous de la manière la plus
franche et la plus entière, être une époque mémorable dans l’histoire de cet
empire ! « Elle
le sera, je l'espère, si mes vœux ardents, si les instantes exhortations
peuvent être un signal de paix et de rapprochement entre vous. » XXVI. Celle
touchante adjuration au Keur et à la raison des représentants de la France,
dans la bouche d'un roi qui ne pouvait plus vaincre et qu'on savait incapable
de tromper, surprit à l'Assemblée tout entière une de ces émotions qui
seraient des traités de paix si elles pouvaient être permanentes. Les membres
de la gauche, du centre, de la droite, se confondirent dans une acclamation
d'autant plus significative qu'elle était plus irréfléchie. Robespierre
lui-même applaudit ; Pétition ne retint pas ses larmes. Un député jacobin
modéré. Goupil de Préfeln, demanda avec enthousiasme que l'Assemblée fixât
cette émotion fugitive et lui donnât le caractère d'un acte éternel, en
prêtant individuellement à haute voix le serment de fidélité à ce roi qui se
confondait ainsi avec la loi et avec la nation. Cette proposition fut votée
d'ivresse, Bureaux de Pm, qui présidait ce jour-là, honnête homme qui ne
savait mentir ni au roi ni au peuple et qui unissait tous ses devoirs dans un
sérieux patriotisme, s'avança le premier à la tribune pour prêter le serment.
Tous les membres de l'Assemblée, appelés lentement par leurs noms, montèrent
successivement à la tribune, et prenant par leurs gestes le ciel et la France
à témoin, jurèrent à leur tour, au bruit des applaudissements. L'explosion du
cœur de la France avait répondu à un mot du roi. On était las de se défier,
de se haïr, impatient de se réconcilier et de s'aimer. Le roi,
reconduit jusqu'aux portes de son palais par l'Assemblée, dans le touchant
désordre de l'enthousiasme, rentra plein de reconnaissant pour un tel peuple.
Il fit pénétrer l'espérance et l'attendrissement dans le cœur de la reine. Le
peuple, entraîné par l'exemple de l'Assemblée, lut à travers ses larmes le
discours du roi, répandu à milliers d'exemplaires dans les rues de Paris. Un vent
de sérénité et de joie poussa la population de Paris autour de l'hôtel de
ville pour y répéter à la face du ciel la scène et le serment de l'Assemblée.
Les cris d'une multitude innombrable forcèrent Bailly à sortir de l'hôtel de
ville et à prononcer solennellement sur le balcon, au nom du peuple, le
serment mutuel prononcé par les représentants à la France. Bailly jura au nom
de Paris. Le peuple entier éleva, en le répétant, son serment jusqu'au ciel.
Soixante membres du conseil de la Commune, traversant à pied la capitale à la
suite de Bailly, allèrent reporter au roi la reconnaissance et la joie du
peuple. A leur retour, ils trouvèrent Paris spontanément illuminé, comme pour
prolonger un jour qui semblait trop court à la félicité publique. Le serment,
renouvelé le dimanche suivant par les députés dans la cathédrale de Paris,
reçut la consécration d'un acte religieux et le caractère d'un sentiment
éternel. XXVII. Le même
jour, la jeunesse de Bretagne se confédérait à Pontivy pour défendre la
constitution démocratique contre les complots du clergé et de l'aristocratie
dans les provinces. Le
comte d'Artois envoyait de Turin des émissaires dans le Midi de la France
pour insurger l'aristocratie, le clergé et les paysans contre la
constitution. L'insurrection
des campagnes contre les châteaux, les incendies, le pillage, les meurtres,
un moment réprimés, se renouvelaient dans les provinces reculées, sous
prétexte d'arracher aux seigneurs leurs titres de rentes féodales. Le
tocsin sonnait à chaque instant dans les villes pour appeler les gardes
nationales et les troupes au secours des villages menacés. Dans le Quercy, de
généreux citoyens perdaient la vie en s'efforçant de disperser ces
attroupements. Dans le Languedoc, des familles nobles arrachées à leurs
demeures et emprisonnées par les paysans insurgés n'étaient délivrées qu'après
avoir payé la rançon de leur délivrance en donnant quittance de leurs revenus
arriérés. En Champagne, le peuple, considérant toutes les redevances en
nature comme une féodalité abolie, refusait, les armes à la main, de payer le
prix de ses fermages. Le Rouergue, le Périgord, le Limousin, la basse
Bretagne, étaient sillonnés par des bandes incendiaires qui rappelaient la
jacquerie. Le rapport de l'abbé Grégoire, au nom du comité des recherches de
l'Assemblée, sur ces excès, signalait, le 9 février, pour cause de ces
calamités, l'ignorance de la langue, la fausse interprétation des décrets, de
l'Assemblée, les instigations des ennemis de la Révolution pensent aux
exagérations peur décréditer les principes ; il montrait la Lorraine prête à
se déchirer dans une guerre civile sanglante ; il demandait à l'Assemblée des
décrets explicatifs de ses premiers décrets aux municipalités des
instructions, au roi des troupes pour éclairer, réprimer, embattre les
perturbateurs de l'empire. « Que
demandez-voua ? » lui répandit l’abbé Maury, déguisant mal sous un
découragement affecté sa tristesse du triomphe des ennemis de la Révolution.
« Ces excès ne sont pas l'ouvrage des hommes qu'on aurait crus
contraires à la Révolution ; ils ne sont que l'affreux commencement d'une
guerre civile !... « Et
que proposez-vous ? L'action du pouvoir exécutif ? Mais ses tribunaux sont suspendus
ou vacants par suite de vos propres décrets. Des troupes ? Mais les troupes
soldées, d'après vos décrets, ne peuvent marcher contre les citoyens que sur
l'ordre des municipaux ; et les municipaux, effrayés de la multitude des
brigands, n'osent invoquer contre eux la force armée ! Les milices nationales
? Mais elles ne sont pas aux ordres du pouvoir exécutif ! Le second moyen que
vous proposez consiste à écrire aux provinces pour les engager à la paix, au
respect dit à la propriété ; mais est-ce à des invitations que nous devons
nous arrêter ? Quand on incendie les châteaux, quand on massacre les
citoyens, quand le prétexte hypocrite de la constitution tend à la renverser,
est-ce par des invitations que le corps législatif doit traiter avec des
scélérats ? Non ! C'est par des décrets supposés qu'on a commis de crimes,
c'est par des décrets qu'il faut dire anathème aux brigands. Pourquoi des
palliatifs, tandis que la force publique est entre nos mains ? Si nous
n'avons pas cette force, l'État est dissous. « L'influence
des curés est le troisième moyen proposé. Je loue ce système de charité
sacerdotale ; mais en 1775 M. Turgot usa de ce moyen. Le remède, insuffisant
alors, serait insuffisant aujourd'hui. Ce n'est pas à des hommes soumis à la
religion que vous avez affaire : vous n'auriez pas besoin de tous ces moyens.
Eh ! quand celui-ci pourrait être efficace, le serait-il sur un peuple
que les ennemis de la nation ont égaré ? L'influence des curés serait donc
absolument inutile. « Sans
tribunaux, sans armée, sans maréchaussée, vous ne rétablirez donc jamais
l'ordre ; plus vous mettrez de rigueur pour prévenir le crime, moins il
faudra de sévérité pour le punir. « Le
seul moyen est donc de déclarer coupable toute insurrection contre l'ordre
public ; de livrer aux tribunaux les porteurs de décrets et d'ordres supposés
et de les rendre responsables ; d'ordonner à l'armée soldée de déployer toute
sa force contre les brigands attroupés, sans qu'il soit aucunement besoin de
la réquisition des officiers municipaux. » Un cri
d'indignation s'élève à ces mots de l'orateur, qui se raffermit contre le
murmure. « C'est
dans vos propres décrets, » dit-il, « que je puise la doctrine qui
paraît si difficilement obtenir votre suffrage. Permettez-moi de vous
rappeler aux principes : vous avez décrété la loi martiale ; vous avez
ordonné que jamais les troupes soldées ne pourraient marcher contre les
citoyens que sur la réquisition des officiers municipaux ; vous avez ordonné
des précautions pour les villes, et jamais vous n'en avez fait l'application
aux campagnes. « Quand
vous avez voulu que le ministre de la loi ordonnât au peuple attroupé de se
retirer, et qu'on ne pût user de la force des armes que sur son refus,
avez-vous entendu prendre sous votre protection des armées de douze cents
brigands ? « Pourquoi
craignez-vous d'autoriser le pouvoir militaire de marcher dans les champs où
les municipalités n'existent pas encore ? Il n'est pas un commandant
militaire qui ait l'imprudence d’empêcher le plus grand crime dans les
campagnes... (On murmure.) « Il
est infiniment facile de contredire ; il est plus facile encore de
désapprouver. Mais si vous voulez des preuves que les municipalités n'ont pas
osé se servir de leur pouvoir, bientôt il vous en viendra de quatre provinces
à la fois. « Qui
oserait dire à un officier municipal d'aller, votre décret à la main, arrêter
une armée de douze cents brigands ? Voilà cependant, si l'on s'en tient aux
expressions littérales de votre loi, la formalité qui doit d'abord être
remplie : on désobéit, si on l'élude. » XXVIII. Cazalès,
succédant à Maury, raconta avec une impassibilité stoïque l'incendie de sa
propre demeure dans le bas Quercy. « Les
braves habitants, » dit-il, « ont éteint le feu et dispersé les
brigands. Les dispositions du peuple sont bonnes ; les malheurs viennent seulement
de l'anéantissement du pouvoir exécutif. » Robespierre,
sans excuser ces crimes, demanda que le gouvernement éclairât au lieu de
sévir. « N'oubliez pas, » dit-il, « que des hommes aigris par
l'excès de leurs malheurs ne sont pas des criminels endurcis, et que des
exhortations peuvent sur eux plus que des armées. « Craignons, »
ajoute-t-il, « craignons que cet amour de la tranquillité ne soit la
source d'un moyen propre à détruire la liberté ; craignons que ces désordres
ne servent de prétextes pour mettre des armes terribles dans les mains qui
pourraient les tourner contre la liberté ; craignons que ces armes ne soient
dirigées par des hommes qui ne seraient pas les meilleurs amis de la
Révolution. « L'Assemblée,
à peine de manquer à la cause populaire, qu'il est de son devoir de défendre,
doit ordonner que les municipalités useront de tous les moyens de
conciliation, d'exhortation et d’instruction avant que la force militaire
puisse être employée. » L'Assemblée,
attristée surtout de son impuissance, mais résolue à ne pas armer ses
ennemis, rota les conclusions dilatoires et molles de son comité. Elle
rédigea une adresse au peuple français, digne de la raison d'un grand peuple
appelé à son propre conseil par ses législateurs. Toute l'âme de la France
civique et philosophique respire dans ce beau commentaire de la Révolution ;
un y sent l'empreinte de la main de Mirabeau : son esprit avait passé dans
ses collègues. Pour
rendre justice à l'Assemblée constituante, il faut lire les principales pages
de ce témoignage qu'elle porte elfe-mime en sa faveur, témoignage qui ne
pouvait être contredit alors par personne. « L'Assemblée
nationale, s'avançant dans la carrière de ses travaux, reçoit de toutes parts
les félicitations des provinces, des villes, des communautés, les témoignages
de la joie publique, les acclamations de la reconnaissance ; mais elle entend
aussi les murmures de ceux que blessent ou qu'affligent les coups portés à
tant d'abus, à tant d'intérêts, à tant de préjugés. En s'occupant du bonheur
de tous, elle s'inquiète des maux particuliers. Elle pardonne à la
prévention, à l'aigreur, à l'injustice ; mais elle regarde comme un de ses
devoirs de vous prémunir contre les influences de la calomnie, et de détruire
les vaines terreurs dont on cherchait vainement à voua surprendre. « Et
que n'a-t-on pas tenté pour vous égarer, pour ébranler votre courage ! On a
feint d'ignorer quel » bien avait fait l'Assemblée nationale : nous allons vous
le rappeler. On a élevé des difficultés contre ce qu'elle a fait : nous
allons y répondre. On a répandu des doutes, on a fait naître des inquiétudes
sur ce qu'elle fera : nous allons vous l'apprendre. « Qu'a
fait l'Assemblée ? Elle a tracé d'une main ferme, au milieu des orages, les
principes de la constitution qui assure à jamais votre liberté. « Les
droits des hommes étaient méconnus, insultés depuis des siècles : ils ont été
rétablis pour l'humanité entière, dans cette déclaration qui sera le cri
éternel de guerre contre les oppresseurs et la loi des législateurs
eux-mêmes. « La
nation avait perdu le droit de décréter et les lois et les impôts : ce droit
lui a été restitué ; et en même temps ont été consacrés les vrais principes
de la monarchie, l'inviolabilité du chef auguste de la nation, et l'hérédité
du trône dans une famille aussi chère à tous les Français. « Nous
n'avions que des états généraux : vous avez maintenant une Assemblée
nationale ; elle ne peut plus vous être ravie. « Des
ordres nécessairement divisés et asservis à d'antiques prétentions y
dictaient les décrets et pouvaient y arrêter l'essor de la volonté nationale.
Ces ordres n'existent plus ; tout a disparu devant l'honorable qualité de
citoyen. « Tout
étant devenu citoyen, il vous fallait des défenseurs citoyens ; et au premier
signal on a vu cette garde nationale qui, rassemblée par le patriotisme,
commandée par l'honneur, partout maintient ou ramène l'ordre, et veille avec
un zèle infatigable à la sûreté de chacun pour l'intérêt de tous. « Des
privilèges sans nombre., ennemis irréconciliables de tout bien, composaient
tout notre droit public : ils sont détruits, et à la voix de cette Assemblée,
les provinces les plus jalouses des leurs ont applaudi à leur chine ; elles
ont senti qu'elles s'enrichissaient de leur perte. « Une
féodalité vexatoire, si puissante encore dans ses derniers débris, couvrait
la France entière ; elle a disparu sans retour. « Vous
étiez soumis dans les provinces au régime d'une administration inquiétante :
vous en êtes affranchis. Des ordres arbitraires attentaient à la » liberté
des citoyens : ils sont anéantis. « Vous
vouliez une organisation complète des municipalités : elle vient de vous être
donnée ; et la création de tous ces corps formés par vos suffrages présente
en ce moment, dans toute la France, le spectacle le plus imposant. « En
même temps, l'Assemblée nationale a consommé l'ouvrage de la nouvelle
division du royaume, qui, seule, pouvait effacer jusqu'aux dernières traces
des anciens préjugés ; substituer à l'amour-propre de province l'amour
véritable de la patrie ; asseoir les bases d'une bonne représentation et
fixer à la fois les droits de chaque homme et de chaque canton, en raison de
leurs rapports avec la chose publique. Problème difficile dont la solution
est restée inconnue jusqu'à nos jours. « Dès
longtemps vous désiriez l'abolition de la vénalité des charges de
magistrature : elle a été prononcée. « Vous
éprouviez le besoin d'une réforme, du moins provisoire, des principaux vices
du code criminel : elle a été décrétée en attendant une réforme générale. « De
toutes les parties du royaume flous ont été adressées des plaintes, des
demandes, de réclamations : nous y ayons satisfait autant qu'il était en
notre pouvoir. « La
multitude des engagements publics effrayait : nous en avons consacré les
principes sur la foi qui leur est due. « Vous
redoutiez le pouvoir des ministres : nous leur avons imposé la loi rassurante
de la responsabilité. « L'impôt
de la gabelle vous était insupportable : nous l'avons adouci d'abord, et nous
en avons assuré l'entière et prochaine destruction ; car il tut que les
impôts, indispensables pour les besoins publics, soient encore justifiés par
leur égalité, leur sagesse, leur douceur. « Des
pensions immodérées, prodiguées souvent à l'insu de votre roi, vous
ravissaient le fruit de vos labeurs : nous avons jeté sur elles un premier
regard sévère, et nous allons les renfermer dans les limites étroites d'une
stricte justice. « Enfin,
les finances demandaient d'immenses formes : secondés par le ministre qui a
obtenu votre confiance, nous y avons travaillé sans rebelle, et bientôt vous
allez en jouir. « Voilà
notre ouvrage, Français, ou plutôt voilà le vôtre, car nous ne sommes que vos
organes, et c'est vous qui nous avez éclairés, encouragés, soutenus dans nos
travaux. Quelle époque que celle à laquelle nous sommes enfin parvenus ! « Quel
honorable héritage vous avez à transmettre à votre postérité ! Elevés au rang
de citoyens, admissibles à tous les emplois, censeurs éclairés de
l'administration quand vous n'en serez pas les dépositaires, sers que tout se
fait et par vous et pour vous, égaux, devant la loi, libres d'agir, de
parler, d'écrire, ne devant jamais compte aux hommes, toujours à la volonté
commune, quelle plus belle condition « Pourrait-il
être encore un seul citoyen vraiment digne de ce nom, qui osât tourner se
regards en arrière, qui voulût relever les débris dont nous sommes
environnés, pour en contempler l'ancien édifice ? « Et
pourtant que n'a-t-on pas dit, que n'a-t-on pas fait pour affaiblir en vous
l'impression naturelle que tant de biens doivent produire ? « Nous
avons tout détruit, a-t-on dit. C'est fallait tout reconstruire. Et qui donc
tant à regretter ? Veut-on le savoir ? « Que,
sur tous les objets réformés ou détruits, l'on interroge les hommes qui n'en
profitaient pas ; qu'on écarte ceux—là qui, pour ennoblir les affections de
l'intérêt personnel, prennent aujourd'hui pour objet de leur commisération le
sort de ceux qui, dans d'autres temps, leur furent si indifférents, et l'on
verra si la réforme de chacun de ces objets ne réunit pas tous les suffrages
faits pour être comptés. « Nous
avons agi avec trop de précipitation et tant d'autres nous ont reproché
d'agir avec trop de lenteur ! Trop de précipitation ! Ignore-t-on que c'est
en attaquant, en renversant tous les abus à la fois qu'on peut espérer s'en
voir délivré sans retour ?... « Il
est impossible, a-t-on dit, de régénérer une nation vieillie et corrompue...
Que l'on apprenne qu'il n'y a de corrompu que ceux qui veulent perpétuer des
abus corrupteurs, et qu'une nation rajeunit le jour où elle a résolu de renaître
à la liberté. Voyez la génération nouvelle ! comme déjà son cœur palpite de
joie et d'espérance ! comme ses sentiments sont purs, nobles, patriotiques !
avec quel enthousiasme on la voit chaque jour briguer l'honneur d'être admise
à prêter le serment de citoyen ! « Mais
pourquoi s'arrêter à un aussi misérable reproche ? L'Assemblée nationale
serait-elle donc réduite à s'excuser de n'avoir pas désespéré du peuple
français ? » Puis
l'Assemblée, se justifiant avec une énergique fierté des crimes sur les
malheurs du temps justement rejetés au passé et au temps lui-même, terminait
ainsi : « Voyez,
Français ! la perspective de bonheur et de gloire qui s'ouvre devant vous. Il
reste encore quelques pas à faire, et c'est où vous attendent les détracteurs
de la Révolution. « Déliez-vous
d'une impétueuse vivacité ; redoutez surtout les violences, car tout désordre
peut devenir funeste à la liberté. Vous chérissez cette liberté ; vous la
possédez maintenant. Montrez-vous dignes de la conserver ; soyez fidèles à
l'esprit, à la lettre des décrets de vos représentants, sanctionnés ou
acceptés par le roi ; distinguez soigneusement les droits abolis sans rachat
et les droits rachetables, mais encore existants. Que les premiers ne soient
plus exigés, mais que les seconds ne soient point refusés. Songez aux trois
mots sacrés qui garantissent ces décrets : la nation, la loi, le roi. « La
nation, c'est vous ; la loi, c'est encore vous, car c'est votre volonté ; le
roi, c'est le gardien de la loi. Quels que soient les mensonges qu'on
prodigue, comptez sur cette union. C'est le roi qu'on trompait ; c'est vous
qu'on trompe maintenant, et la bonté du roi s'en afflige ; il veut préserver
son peuple des flatteurs qu'il a éloignés du trône. « Il
en défendra le berceau de son fils, car, au milieu de vos représentants, il e
déclaré qu'il faisait de l'héritier de la couronne le gardien de la
constitution. « Qu'on
ne vous parle plus de deux partis : il n'en est qu'un, nous l'avons tous
juré, c'est celui de la liberté. Sa victoire est sûre, attestée par les
conquêtes qui se multiplient tous les jours. « Laisses
d'obscurs blasphémateurs prodiguer contre nous les injures, les calomnies ;
penses seulement que, s'ils nous louaient, la France serait perdue. « Gardez-vous
surtout de réveiller leurs espérances par des fautes, par des désordres, par
l'oubli de la loi, Voyez comme ils triomphent de quelques délais dans la
perception de l'impôt ! Ah ! ne leur préparez pas une joie cruelle !
Songez que cette dette... Non, ce n'est plus une dette, c'est un tribut
sacré, et c'est la patrie maintenant qui le reçoit pour vous, pour vos
enfants. Elle ne le laissera plus prodiguer aux déprédateurs qui voudraient
voir tarir pour l'Etat le trésor public maintenant tari pour eux. Ils
aspiraient à des malheurs qu'a prévenus, qu'a rendus impossibles la bonté
magnanime du roi. « Français,
secondez votre roi par un saint et immuable respect pour la loi ; défendez
contre eux son bonheur, ses vertus, sa mémoire ; montrez qu'il n'eut jamais
d'autres ennemis que ceux de la liberté ; montrez que pour elle et pour lui
votre constance égalera votre courage ; que, pour la liberté dont il est le
garant, on ne se lasse point, on est infatigable. Votre lassitude était le
dernier espoir des ennemis de la Révolution ; ils le perdent ; pardonnez-leur
d'en gémir, et déplorez, sans les haïr, ce reste de faiblesse, toutes ces
misères de l'humanité. « Cherchons,
disons même ce qui les excuse, Voyez quel concours de causes a dû prolonger,
entretenir, presque éterniser leur illusion ! Eh ! ne faut-il pas quelque
temps pour chasser de sa mémoire les fantômes d'un long rêve, les rêves d'une
longue vie ? Qui peut triompher en un moment des habitudes de l'esprit, des
opinions inculquées dans l'enfance, entretenues par les formes extérieures de
la société, longtemps favorisées par la servitude publique, qu'on croyait
éternelle, chères à un genre d'orgueil qu'on imposait comme un devoir, enfin
mises sous la protection de l'intérêt personnel, qu'elles nattaient de tant
de manières ? Perdre à la fois ses illusions, ses espérances, ses idées les
plus chères, une partie de sa fortune, est-il donné à beaucoup d'hommes de le
pouvoir sans quelques regrets, sans des efforts, sans des résistances d'abord
naturelles, et qu'ensuite un faux point d'honneur s'impose quelquefois à
lui-même ? « Eh !
si, dans cette classe naguère si favorisée, il s'en trouve quelques-uns qui
ne peuvent se faire à tant de pertes à la fois, soyez généreux, songez que
dans cette même classe il s'est trouvé des hommes qui ont osé s'élever à la
dignité de citoyens, intrépides défenseurs de vos droits, et, dans le sein
même de leur famille, opposant à leurs sentiments les plus tendres le noble
enthousiasme de la liberté. « Plaignez,
Français, les victimes aveugles de tant de déplorables préjugés, mais, sous
l'empire des lois, que le mot de vengeance ne soit plus prononcé. Courage,
persévérance, générosité, les vertus de la liberté ! nous vous le demandons
au nom de cette liberté sacrée, seule conquête digne de l'homme, digne de
vous, par les efforts, par les sacrifices que vous avez faits pour elle, par
les vertus qui se sont mêlées aux malheurs inséparables d'une grande
révolution. Ne retardez point, ne déshonorez point le plus bel ouvrage dont
les annales du monde nous aient transmis la mémoire. « Qu'avez-vous
à craindre ? Rien, non, rien qu'une funeste impatience. Encore quelques
moments... c'est pour la liberté ! « Vous
avez donné tant de siècles au despotisme ! Amis, citoyens, une patience
généreuse au lieu d'une patience servile, au nom de la patrie, vous en avez
une maintenant ; au nom de votre roi, vous avez un roi, il est à vous, non
plus le roi de quelques milliers d'hommes, mais le roi des Français, de tous
les Français ! « Qu'il
doit mépriser maintenant le despotisme ! qu'il doit le haïr ! Roi d'un peuple
libre, comme il doit reconnaître l'erreur de ces illusions mensongères
qu'entretenait sa cour, qui se disait son peuple ! Prestige répandu autour de
son berceau, enfermé comme à dessein dans l'éducation royale, et dont on a
cherché, dans tous les temps, à composer l'entendement des rois, pour faire
de leurs erreurs le patrimoine des cours. « Il
est à vous. Qu'il nous est cher ! Ah ! depuis que son peuple est devenu sa
cour, lui refuserez-vous la tranquillité, le bonheur qu'il mérite ?
Désormais, qu'il n'apprenne plus aucune de ces scènes violentes qui ont tant
affligé son cœur ; qu'il apprenne au contraire que l'ordre renaît, que
partout les propriétés sont respectées, défendues, que vous recevez, vous
placés sous l'égide des lois, l'ami, l'ennemi de votre cause, l'innocent, le
coupable... « De
coupables, il n'en est point, si la loi ne l'a prononcé. Ou plutôt qu'il
apprenne encore de votre vertueux monarque quelques-uns de ces traits
généreux, de ces nobles exemples qui déjà ont illustré le berceau de la
liberté française, vos adversaires protégés, défendus par vous-mêmes,
couverts de votre personne... « Étonnez-le
de vos vertus, pour lui donner plus tôt le prix des siennes, en avançant pour
lui le moment de la tranquillité publique et le spectacle de votre félicité. « Pour
nous, poursuivant notre tâche laborieuse, voués, consacrés au grand travail
de la constitution, votre ouvrage, autant que le nôtre, nous le terminerons
aidés de toutes les lumières de la France ; et vainqueurs de tous les
obstacles, satisfaits de notre conscience, convaincus, et d'avance heureux,
de votre prochain bonheur, nous placerons entre vos mains ce dépôt sacré de
la constitution, sous la garde des vertus nouvelles dont le germe, enfermé
dans vos âmes, vient d'éclore aux premiers jours de la liberté. » XXIX. Un
mémoire sur les troubles fut envoyé par le ministre et lu à l'Assemblée. « Les
désordres qui règnent dans les provinces affectent douloureusement le cœur de
Sa Majesté. Si ces alarmantes insurrections n'avaient pas un terme prochain,
toutes les propriétés seraient bientôt violées. Rien n'est sacré pour les
brigands. Sa Majesté, en sanctionnant le décret relatif ik l'organisation des
nouvelles municipalités, était dans la confiance que les officiers civils et
municipaux emploieraient, avec autant de courage que de succès, tous les
moyens possibles d'arrêter les troubles qui se propagent. « Cependant,
ces troubles subsistent encore dans les provinces méridionales, et Sa
Majesté, voulant donner à son peuple l'exemple du respect qu'on doit à la
loi, communique b l'Assemblée l'exposé des malheurs dont la ville de Béziers
particulièrement vient d'être le théâtre. « L'Assemblée
nationale devra prendre à ce sujet le parti qui lui parera convenable, et
qu'elle ra instantanément dans sa sagesse. « Des
paysans, faisant la contrebande du sel, furent arrêtés aux portes de Béziers
par les commis chargés du recouvrement des deniers royaux. Un nombre
considérable de Bretons s'arma pour attaquer les commis. M. de Vadre,
colonel, commandant du régiment de Médoc, en garnison dans cette ville, fit
lui-même, et sans l'autorisation de la municipalité, de vains efforts pour arrêter
les brigands. Quelques commis se réfugièrent à l'hôtel de ville. M. de Vadre
insista inutilement pour qu'un consul au moins y passât la nuit. Le peuple
demandait à grands cris que le nominé Bernard et les autres commis lui
fussent livrés. M. de Vadre prévint ces malheureux menacés de mort, et se
flatta d'empêcher le peuple d'entrer pendant une heure. Les portes furent
fermées et bientôt enfoncées. Les séditieux poursuivirent leur proie. Les
malheureux commis furent mutilés : cinq d'entre eux furent pendus, et le
secours de la garde nationale vainement imploré. » XXX. Mais
pendant que l'Assemblée constituante protestait ainsi de ses lumières, de ses
intentions et de ses bienfaits dans l'ordre constitutionnel et législatif,
les événements protestaient plus haut qu'elle contre l'anéantissement du
pouvoir exécutif. Il y avait des législateurs ; il n'y avait pas de
gouvernement. Les séances, le lendemain même du manifeste, n'étaient plus que
le procès-verbal des désordres et des calamités du royaume. Chaque député,
chaque rapporteur montait à la tribune pour dérouler un plus sinistre tableau
des troubles de sa province, de l'impunité des agitateurs, de la mollesse ou
de la complicité des municipalités. La loi ne doit pas compter sur l'héroïsme
des magistrats. Celle qui remettait le commandement de la force armée et la
répression des troubles aux municipalités des villes était une loi illusoire.
L'esprit de localité désarmait l'esprit d'ordre ; le magistrat se taisait
quand il fallait sévir contre ses proches ; la garde nationale jetait ses
armes quand on lui ordonnait de les tourner contre ses concitoyens.
L'Assemblée cherchait un moyen d'armer la répression sans rendre au roi la
disposition de la force publique contre les troubles civils ; elle sommait
son comité de constitution de lui présenter d'urgence ce moyen. Le comité se
taisait. Le marquis de Foucaud, ardent et courageux royaliste, faisait, à
défaut du comité, le rapport véhément et passionné des incendies et des
meurtres du Périgord. « On y éclaire les châteaux, » s'écriait-il, « c'est-à-dire,
dans la langue des incendiaires, qu'on les brûle. Les brigands se
prétendent autorisés à leurs crimes par des décrets de l'Assemblée nationale
et du roi. Ils plantent sur les cendres de nos demeures des arbres de liberté
; ils suspendent aux branches des écriteaux avec cette légende : « De par le
roi et l'Assemblée nationale ! » Tout cède, ou fuit, ou tolère devant eux. Il
faut de prompts remèdes. Il faut renforcer la gendarmerie, placer les troupes
dans les villes, les tenir en correspondance et en communication avec les
points menacés. Cela vaudrait mieux que des adresses qu'on ne comprend pas et
qu'on ne comprendra pas de sitôt. Car je ne crois pas à la prophétie qu'on a
faite, que dans dix ans tous les Français sauront lire ! » Lafayette
lui-même, succédant à M. de Foucaud, confessait « que de violents
désordres régnaient, à la douleur des amis de la liberté, parce qu'ils y
voyaient un danger pour elle ; au grand regret de ce peuple, »
ajoutait-il, « qu'il faut défendre contre certaines inculpations qui le
calomnient, contre certaines justifications qui l'accusent. L'ordre ! Le
peuple l'attend des municipalités ; il l'attend aussi du pouvoir exécutif,
qu'il ne faut plus chercher sous des ruines. Mais cet ordre, il est dans la
constitution, et il existe par elle et pour elle ! » Ces
vaines paroles ne ressuscitaient pas le pouvoir exécutif, ne donnaient pas
aux municipalités l'énergie et la responsabilité qu'elles ne pouvaient pas
avoir, n'éteignaient pas une étincelle des flammes qui dévoraient les
provinces. Lafayette lui-même avait vu par son propre exemple l'impuissance
de la municipalité de Paris et de celle de Versailles le 5 octobre. Il ne
maintenait lui-même en ce moment un ordre précaire dans Paris qu'avec les
troupes soldées, nerf de son armée, dont il disposait avec une autorité toute
militaire. Mirabeau
le sentait ; il demanda qu'on présentât une loi pour contraindre les
municipalités à défendre l'ordre public, ou pour suppléer à des municipalités
inertes par une intervention énergique du pouvoir exécutif. « La
guerre civile ensanglante une partie de la France ! » s'écria un député du
Quercy ; « il est instant d'employer la force militaire et le canon. » Charles
Lameth, dont le château venait d'être incendié dans sa province, protesta
contre l'emploi de la force, remit ce crime au peuple égaré, et soutint que
les incendiaires étaient plus malheureux que coupables. Le parti qui flattait
tout du peuple, jusqu'à ses excès, était décidé à acheter la popularité au
prix même de l'anarchie. Les Lameth, les Barnave, les Duport, les Péthion,
les Robespierre et leurs amis oubliaient que la liberté ne sort jamais des
criminelles complaisances des législateurs pour la licence et pour les
délires de la multitude, et que les prétextes donnés aux réactions sont des
armes prêtées au despotisme. XXXI. Barnave,
l'orateur de ce parti, fut chargé de combattre par des sophismes de factions
la loi présentée le 20 février pour armer l'ordre public contre les excès
populaires. Toutes les raisons paraissent bonnes aux sophistes pour soutenir
leurs intérêts contre la raison et la nécessité. Barnave
parla en complaisant de la multitude. Chapelier lui répliqua en citoyen.
Lafayette éluda la question par quelques phrases qui laissaient sa pensée en
suspens entre les deux partis. Mirabeau
demanda de plus amples réflexions, dans la crainte de paraître moins
indulgent au désordre que ses émules en patriotisme. Cazalès seul proposa
avec énergie la dictature momentanée du pouvoir exécutif, consacrée dans tous
les gouvernements libres, comme en Angleterre, par une loi contre les
séditions, 'qui supprime, en cas de trouble, toutes les lois. « Il la
faut, » dit-il avec l'accent d'une conviction impartiale, « aussi protectrice
de la liberté elle-même que de la société. Il faut protéger, assurer les
propriétés et la vie des citoyens. Si la société négligeait ou était
impuissante à remplir ce devoir sacré, les hommes se trouveraient bientôt
ramenés à leur état primitif : il n'y aurait plus de patrie. « Depuis
six mois un grand nombre de citoyens ont été attaqués, les propriétés ont été
violées ; elles le sont aujourd'hui, elles le seront peut-être encore.
Pensez-vous que les propriétaires puissent le supporter plus longtemps ? Non,
sans doute : ils s'armeront pour leur défense, et de là la guerre la plus
destructive de toutes les sociétés civiles, la guerre de ceux qui n'ont rien
contre ceux qui ont quelque chose. Sans doute est instant de parer à tous ces
maux, et le projet de loi qui vient de vous être présenté par votre comité
est peut-être propre à défendre les villes ; mais il est sans force pour la
sûreté des campagnes ; en général même je ne pense pas que l'effet qu'il
peut avoir soit assez prompt pour le moment dans lequel » nous nous trouvons. « Profitons
des exemples de nos voisins ; voyons si la constitution anglaise ne nous
offre pas des remèdes plus sûrs contre les insurrections et les émeutes.
Voyons quelle est la conduite de cette nation qui a le plus opposé de
barrières au despotisme du trône ; de cette nation qui a le mieux assuré la
tranquillité civile. « En
Angleterre, on e établi contre les séditieux le bill de mutinerie, qui, à
très peu de choses près, est notre loi martiale. Mais quand les provinces
sont ravagées, quand l'insurrection est générale, le corps législatif emploie
de plus grands moyens : alors il a recours au pouvoir exécutif. Il lui donne,
par un acte parlementaire et pour un temps limité, le droit d'employer tous
les moyens qui lui pareront convenables pour ramener le calme et la paix ;
et, dans ce cas, les ministres ne sont responsables que de l'exécution des
ordres du roi. « Tel
est le moyen que je veux proposer en France. Je sais bien qu'on me dira que
c'est s'exposer au risque de donner trop de force au pouvoir exécutif. Je ne
répondrai à cette objection qu'en interrogeant la bonne foi de l'Assemblée.
Je demanderai si elle ne croit pas que la bonté du roi, que l'opinion
générale, que les forces citoyennes ne puissent et ne doivent faire évanouir
ces alarmes, surtout lorsqu'on voudra bien observer que ce pouvoir ne sera
accordé au roi que pour un temps limité, pour un temps court. Non, messieurs,
la constitution n'a plus rien à craindre que de nous-mêmes ; il n'y a que l'exagération
des principes, il n'y a que la ligue de la folie et de la mauvaise foi qui
puissent y porter quelque atteinte. Hâtons-nous d'affermir le grand œuvre de
la liberté ! que les ennemis de la constitution, qui, n'en doutez pas, sont
les instigateurs des désordres, soient forcés à perdre l'espérance de
détruire notre ouvrage. »- XXXII. Mirabeau,
affectant de voir le despotisme dans la loi contre les séditions de
l'Angleterre et de l'Amérique elle-même, s'écria, pour détourner la question,
qu'il s'agissait de savoir si on accorderait ou non au roi la dictature, si
la France avait besoin ou non de la dictature. Dans le cas où l'on poserait
ainsi la question, ajouta-t-il, je demanderais la parole pour combattre la
dictature. Ce
subterfuge semblait indiquer dans Mirabeau le regret d'avoir demandé
lui-même, la veille, la loi répressive. Cazalès comprit l'embarras de
Mirabeau ; il jouit de l'accroître en le provoquant lui-même à parler.
Mirabeau se tut. Maury fut amer et servit, comme toujours, la cause du
désordre en désespérant de l’ordre. Malouet parla en homme politique
sincèrement préoccupé de concilier la sécurité publique avec les institutions
représentatives. « Il ne
faut pas confondre, » dit-il, avec une sage distinction, qui réfutait
d'avance l'apostrophe de Mirabeau sur la prétendue dictature du roi, « il ne
faut pas confondre l'autorité royale avec le pouvoir exécutif. L'un est la
souveraineté ; l'autre n'en est que l'instrument. Tout ce qui tient à
l'exécution des lois compose le pouvoir exécutif ; la réunion de toutes les
forces constitue le pouvoir monarchique. Ainsi la liberté nationale ne peut
consister dans l'atténuement de l'autorité royale ni dans celui du pouvoir
exécutif... Il faut donner au pouvoir exécutif l'unité et l'activité, en
statuant que tous les corps administratifs et militaires obéiront aux ordres
du monarque. C'est au corps administratif à faire en sorte que les lois
constitutionnelles ne soient pas attaquées. Si l'on ne prend pas ce parti, il
y aura autant de puissances souveraines que de divisions partielles du
royaume ; les villes s'armeront les unes contre les autres ; bientôt la
disparition complète du numéraire et la famine naîtront de ces troubles
intestins ; le pouvoir législatif sera moins respecté, et nous verrons
paraitre de loin en loin les effets désastreux de l'anarchie. Tout ce qui ne
concourt pas à l'ordre dans un gouvernement l'altère et finit par le
désorganiser. Lorsqu'une nation reconnaît un chef suprême, s'il ne peut rien
pour son bonheur, il peut tout contre sa liberté. Si, au contraire, il est
entouré d'une grande puissance, sur un trône brillant de gloire et de
félicité, regrettera-t-il le despotisme et la tyrannie ? Je propose de
décréter ce qui suit : « Tous
les corps administratifs et militaires sont dans la dépendance immédiate du
pouvoir exécutif, et doivent obéir au monarque. Toute résistance des corps
administratifs serait une forfaiture ; tout acte d'insubordination dans
l'armée serait une désobéissance. II appartient au roi de prévenir par la
force publique tous les désordres et de veiller à ce que la vie des citoyens
ne soit en danger, à ce que leurs propriétés ne soient violées, à ce que la
perception des impôts ne soit troublée. Tous les ordres qui seront donnés par
le roi seront signés par un secrétaire d'Etat qui sera responsable de leur
exécution. Si dans une convulsion violente le salut public exige des for- mes
contraires aux formes légales, les ministres seront tenus d'en rendre compte
au pouvoir législatif, qui, pour ce cas seulement, pourra les absoudre. » Cette
motion sage et forte par sa sagesse même avait l'assentiment intime de toute
l'Assemblée, les partis ne s'y gouvernant pas par des convictions, mais par
des tactiques. Robespierre
la combattit à l'exemple de Barnave, dans la séance du 22 février, par un
discours où il dépassa Barnave en déclarations logiques de tribune et
Mirabeau en force d'idées. Il y dit le dernier mot de la Révolution, pour lui
la victoire ! « A
quoi tendent ces accusations ? » dit Robespierre. « Ne
voyez-vous pas le royaume divisé ? ne voyez-vous pas deux partis, celui du
peuple et celui de l'aristocratie et du despotisme ? Espérons que la
constitution sera solidement affermie ; mais reconnaissons qu'il reste encore
de grandes choses à faire. Grâce au zèle avec lequel on a égaré le peuple par
des libelles et déguisé les décrets, l'esprit public n'a pas encore pris
l'ascendant si nécessaire. Ne voyez-vous pas qu'on cherche à énerver les
sentiments généreux du peuple pour le porter à préférer un paisible esclavage
à une liberté achetée au prix de quelques agitations et de quelques
sacrifices ? Ce qui formera l'esprit public, ce qui déterminera s'il doit
pencher vers la liberté ou se reporter vers le despotisme, ce sera
l'établissement des assemblées administratives ; mais si l'intrigue
s'introduisait dans les élections, si la législature suivante pouvait ainsi
se trouver composée des ennemis de la Révolution, la liberté ne serait plus
qu'une vaine espérance que nous aurions présentée à l'Europe. Les nations
n'ont qu'un moment pour devenir libres, c'est celui où l'excès de la tyrannie
doit faire rougir de défendre le despotisme. Ce moment passé, les cris des
bons citoyens sont dénoncés comme des actes séditieux, la servitude reste, la
liberté disparaît. « En
Angleterre, une loi sage ne permet pas aux troupes d'approcher des lieux où
se font chaque année les élections, et dans les agitations incertaines d'une
révolution, on nous propose de dire au pouvoir exécutif : Envoyez des troupes
où vous voudrez, effrayez les peuples, gênez les suffrages, faites pencher la
balance dans les élections. « Dans
ce moment même, des villes ont reçu des garnisons extraordinaires qui ont,
par la terreur, servi à violer la liberté du peuple, à élever aux places
municipales des ennemis cachés de la Révolution. Ce malheur est certain, je
le prouverai, et je demande pour cet objet une séance extraordinaire.
Prévenons ce malheur ; réparons-le par une loi que la liberté et la raison
commandent à tout peuple qui veut être libre ; qu'elle a une nation qui s'en
sert avec une respectueuse constance pour maintenir une constitution à
laquelle elle reconnaît des vices ; mais ne proclamons pas une loi martiale
contre un peuple qui défend ses droits, qui recouvre sa liberté. Devons-nous
déshonorer le patriotisme en l'appelant esprit séditieux et turbulent, et
honorer l'esclavage par le nom d'amour de l'ordre et de la paix ? Non : il
faut prévenir les troubles par des moyens plus analogues à la liberté. Si
l'on aime véritablement la paix, ce ne sont point les lois martiales qu'il
faut présenter au peuple : elles donneraient de nouveaux moyens d'amener des
troubles. Tout cet empire est couvert de citoyens armés par la liberté ; ils
repousseront les brigands pour défendre leurs foyers. Rendons au peuple ses
véritables droits ; protégeons les principes patriotiques attaqués dans tant
d'en- droits divers ; ne souffrons pas que des soldats armés aillent opprimer
les bons citoyens sous le prétexte de les défendre ; ne remettons pas le sort
de la Révolution dans les mains des chefs militaires ; faisons sortir des
villes ces soldats armés qui effrayent le patriotisme pour détruire la
liberté ! » Le
fanatisme éclairait Robespierre et l'éblouissait à la fois dans ce discours
pour le triomphe de sa cause. Dans la lutte ouverte entre l'ancien régime et
le nouveau, il craignait plus l'ordre préservé par la main d'un roi que les
excès commis par la main du peuple. Entre ces deux dangers, il avait fait son
choix ; décidé à tout, et même au crime, pour faire prévaloir et régner la
démocratie absolue, il était aussi coupable mais plus conséquent que Barnave,
qui voulait un roi sans royauté et une paix publique sans force pour la
maintenir. XXXIII. Clermont-Tonnerre
le réfuta avec l'autorité de la conscience, de la =fraie et de la politique.
Pur d'adulation aux rois quand ils avaient des courtisans, l'orateur du
centre déteste éloquemment les adulateurs du peuple. « Que craignez-vous ? »
s'écria-t-il en finissant. « Que la force publique soit toujours plus
puissante que les scélérats ! Elle ne sera jamais plus forte que nous, plus
puissante que l'opinion. » Péthion,
aussi téméraire que Barnave, mais moins amer que Robespierre, soutint que la
loi martiale était suffisante, bien que la loi martiale, sous l'empire de
laquelle tous ces excès se continuaient, ne donnât ni énergie aux magistrats
municipaux ni force armée aux répressions. Mirabeau
réfléchissait depuis huit jours sur l'expédient qu'il saisirait pour
retremper, dans cette discussion, son patriotisme compromis le premier jour. Il
feignit de voir la dictature dans les mesures d'ordre et de force réclamées
par la liberté elle-même. II
prépara un projet mixte et illusoire qui donnait aux troupes l'autorisation
de marcher en cas d'attroupements et de violences, mais qui donnait en même
temps aux municipalités le droit d'arrêter leur marche et de leur interdire
le territoire de leurs commun, prétexte de parole qui n'était utile qu'à sa
popularité. « On
a voulu, » dit-il, « entraîner une assemblée législative dans la plus
étrange des erreurs. De quoi s'agit-il ? De faits mal expliqués, mal
éclaircis. On soupçonne, plus qu'on ne sait, que l'ancienne municipalité de
Béziers n'a pas rempli ses devoirs. En fait d'attroupements, toutes les
circonstances méritent votre attention ; il vous était facile de prévoir que,
par la loi martiale, vous avez donné lieu à un délit de grande importance, si
cette loi n'était pas exactement, pas fidèlement exécutée. « En
effet, une municipalité qui n'use pas des pouvoirs qui lui sont donnés dans
une circonstance importante commet un grand crime. Il fallait qualifier le
crime, indiquer la peine et le tribunal ; il ne fallait que cela. Au lieu de
se réduire à une question aussi simple, on nous a dit que la république est
en danger. J'entends, et je serai entendu par tout homme qui écoutera avec
réflexion, j'entends la chose publique. On nous fait un tableau effrayant des
malheurs de la France ; on a prétendu que l'Etat était bouleversé, que la
monarchie était tellement en péril, qu'il fallait recourir à de grandes
ressources : on a demandé la dictature. La dictature, dans un pays de
vingt-quatre millions d'âmes ! la dictature à un seul, dans un pays qui
travaille à sa constitution ! dans un pays dont les représentants sont
assemblés, la dictature d'un seul ! Le plus ou moins de sang qui doit couler
ne doit pas être mis en ligne de compte. Lisez, lisez ces lignes de sang dans
les lettres du général d'Alton à l'empereur, voilà le code des dictateurs ;
voilà ce qu'on n'a pas rougi de proposer. On a voulu renouveler les proclamations
dictatoriales des mois de juin et de juillet. Enfin, on enlumine les
propositions des 'mots tant de fois répétés, des vertus d'un monarque
vraiment vertueux, ces mots tant de fois répétés, mais répétés avec justice. « Je
regarde déjà la monarchie comme dissoute. La dictature passe les forces d'un
seul, quels que soient son caractère, ses vertus, son talent, son génie. Le
désordre règne, dit-on ; je le veux croire un moment. On l'attribue à l'oubli
d'achever le pouvoir exécutif, comme si tout l'ouvrage de l'organisation
sociale n'y tendait pas ! Je voudrais qu'on se demandât à soi-même ce que
c'est que le pouvoir exécutif, Vous ne faites rien qui n'y ait rapport. Que
ceux qui veulent empiéter sur vos travaux répondent à ce dilemme bien simple
: ou quelque partie de la constitution blesse le pouvoir exécutif : alors
qu'on nous déclare en quoi ; ou il faut achever le pouvoir exécutif : alors
que reste-ka à faire ? Dites-le, et vous verrez s'il ne tient pas à tout ce
que vous devez faire encore. Si vous me dites : Le pouvoir militaire manque
au pouvoir exécutif, je vous répondrai : Laissez-nous donc achever
l'organisation du pouvoir militaire ; le pouvoir judiciaire : Laissez-nous
donc achever l'organisation du pouvoir judiciaire. Ainsi donc ne nous
demandez pas ce que nous devons faire, si nous avons fait ce que nous avons
pu. Il me semble qu'il est aisé de revenir à la question, dont nous n'avons
pu nous écarter. Vous avez fait une loi martiale ; vous en avez confié l'exécution
aux officiers municipaux. Il reste à établir le mode de leur responsabilité.
Il manque encore quelques dispositions. Eh bien ! il faut fixer le modo
des proclamations. Il existe des brigands : il faut faire une addition
provisoire pour ce cas seulement ; mais il ne fallait pas empiéter sur notre
travail ; il ne fallait pas proposer une exécrable dictature. Je n'ajouterai
rien à ce qui a été dit ; mais peut-être résumerai-je mieux les diverses
opinions des préopinants. J'ai rédigé le projet d'une loi additionnelle à la
lui martiale. » Il lut
ce plan. XXXIV. Le duc
d’Aiguillon, du parti de Barnave et de Lameth, jura que les bons citoyens
aimaient mieux voir périr toutes les propriétés que de voir la liberté en
péril. « Je dois cependant convenir, » ajouta-t-il pour faire
contre-poids à son propre sophisme, « que les désordres de l'anarchie
amèneraient infailliblement le despotisme. » Il conclut qu'il fallait
persuader la justice et la vertu aux dévastateurs. Lafayette,
aussi embarrassé que Mirabeau dans une question où il fallait opter entre la
sédition et le pouvoir exécutif, remonta comme Mirabeau à la tribune pour
atténuer le peu qu'il avait dit en faveur de la force à rendre au
gouvernement. « Parmi
les discussions intéressantes que j'ai entendues, » dit-il avec une
naïveté d'homme d'Etat qui fit sourire l'auditoire, « une grande idée
m'a frappé. Le peuple est trompé, il faut dissiper son erreur ; il faut lui
apprendre jusqu'où s'étendent les promesses qui lui ont été faites, et lui
montrer les bornes de ses espérances. Mais en même temps que je pense avec M.
d'Aiguillon qu'il faut s'occuper incessamment du rapport du comité féodal, je
crois aussi qu'il est à propos de terminer la discussion en statuant sur le
projet de loi qui nous a été présenté. » Cazalès
réfuta avec modération, mais avec l'âme de la France même, les mollesses et
les astuces de ces orateurs ou trop francs ou trop hypocrites. « Avant
de rentrer dans la question, » dit-il, « je rétablirai des faits
qui n'ont pas été bien exactement exposés par un préopinant : 1° depuis la
révolution anglaise, en 1688, l'habeas corpus a été suspendu neuf fois ; 2°
ce qu'il lui plaît d'appeler dictature a été accordé au roi d'Angleterre dans
des moments d'insurrection, et assurément, dans les circonstances présentes,
nous avons tout lieu de craindre une insurrection. M. le duc d'Aiguillon a
exprimé des sentiments dignes de tous les éloges. Ce qui constitue la
véritable générosité, c'est d'être peu affecté des pertes personnelles ; mais
la liberté qui donne cette vertu ne permet pas de croire que tous les
citoyens pourront faire des sacrifices aussi généreux. « Les
principes des préopinants sont les miens ; les conséquences que j'en tire
diffèrent essentiellement de celles qu'ils vous ont présentées. Le comité
vous a offert des moyens qui pourraient être utiles si le mal n'était pas à
son comble. Je ne puis me dissimuler que les excès ne sont point partiels, et
qu'il est évident que s'ils n'étaient point réprimés, ils se changeraient en
une guerre funeste de ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont quelque chose.
L'expérience nous a déjà prouvé combien la loi martiale est insuffisante. Il
faut donc, si nous voulons arrêter les malheurs qui affligent le royaume,
recourir au pouvoir exécutif, et l'armer de toute la force nécessaire pour
qu'il agisse avec succès. Je n'ai cependant pas pensé qu'il fallût investir
le souverain d'un pouvoir trop durable. Eh ! qu'on me dise quel danger y
aurait à confier au roi une autorité momentanée, que l'Assemblée nationale,
toujours existante, pourrait suspendre ou retirer à son gré ; qu'on me dise
ce qu'elle peut avoir de dangereux dans les mains d'un roi dont les vertus
sont connues ; qu'ils me disent, ces prétendus apôtres de la liberté, ce
qu'ils craignent de ce prince entouré de son peuple, de ce prince qui est
venu se confier aux habitants de la capitale, et dont les intentions sont
intimement liées avec celles des représentants de la nation Mais, diront-ils,
les ministres abuseront de cette autorité d'un moment. Que pourraient des
ministres contre l'opinion publique, contre un peuple qui, d'une voix
unanime, a juré qu'il voulait être libre ? lion, je ne crois pas qu'il y ait
un seul citoyen qui ne soit partisan de la liberté. Ce n'est qu'au milieu des
désordres de l'anarchie que le despotisme peut lever sa tête hideuse. La loi
martiale est insuffisante ; nul autre moyen ne se présente, si ce n'est celui
d'autoriser la force armée à obéir au pouvoir exécutif. Il faut donc adopter
ce moyen. » L'Assemblée,
partageant la timidité de ses orateurs, n'osa ni rejeter ni admettre encore
ces projets de force légale. Les propositions furent ajournées, discutées de
nouveau sous l'impression de nouveaux excès. Dans les séances suivantes,
elles furent éloquemment soutenues par M. de Montlosier, qui déplora le rôle
subalterne que les projets assignaient au roi, subordonné dans son action,
pour la répression des troubles, aux municipalités. Barnave, Mirabeau,
Robespierre, les Lameth reprirent la parole. On se borna à déclarer les
municipalités responsables des dévastations contre lesquelles elles
n'auraient pas invoqué les forces du pouvoir exécutif. Lanjuinais
fit éclater en deux mots le néant de l'iniquité de cette solution. « Qui
commet le désordre ? » dit-il. « C'est celui qui n'a rien !
Qui le payera ? celui qui possède ! Ce sont les infirmes, les enfants,
les veuves, les vieillards, les innocents ! » L'Assemblée,
impatiente de sortir du dilemme où elle était jetée par la crainte de
l'anarchie d'un côté, et par la crainte plus grande du pouvoir exécutif de
l'autre, ne s'arrêta pas à l'objection de Lanjuinais, et vota cet impuissant
palliatif aux excès populaires. Elle
apprit, le soir même, un accès de guerre intestine à Lyon. La jeunesse riche
et commerçante de la ville, formant tin corps distinct et aristocratique dans
la garde nationale, sous le nom de garde d'honneur du premier magistrat
municipal de la ville, Imbert Calomès, occupait les principaux postes de sûreté,
et, entre autres, l'Arsenal. Le peuple et les confédérés des provinces
limitrophes, jaloux et inquiets de ces prérogatives, s'étaient levés en armes
pour arracher ces postes à la jeunesse privilégiée. Quarante mille hommes
s'étaient emparés de l'Arsenal, et avaient distribué cinquante mille fusils.
La jeunesse, vaincue aux portes, désarmée, insultée, traînée au Rhône,
n'avait obtenu la vie qu'en s'humiliant devant les vainqueurs. La
municipalité, opprimée ou démissionnaire, était remplacée par un comité
insurrectionnel. Imbert Calomès, suspect de royalisme ou de modération,
s'était enfui en Suisse. Lyon donnait à tout le cours du Rhône, au midi, à
l'est et au centre, le signal et l'exemple de l'insurrection contre les
municipalités et contre la garde nationale. La guerre, qui n'était à Paris
que du peuple au roi, devenait, dans une ville d'ouvriers, une guerre de
classe à classe et des pauvres contre les riches. On égorgeait à Lyon au nom
de la richesse ; à Montauban, à Mmes, à Arles, au nom de la religion. Le roi
ne pouvait rien ; l'Assemblée n'osait ni lui rendre la force nécessaire à la
paix publique, ni saisir elle-même l'autorité. Tout croulait ; pressée
d'achever son œuvre législative, afin de retrouver dans la constitution les
éléments d'un ordre nouveau, elle feignait d'entendre à peine le bruit de ces
écroulements. XXXV. Dubois-Crancé,
Charles Lameth, Menou, Mathieu de Montmorency, de Broglie, lui présentèrent,
dans le courant de février, des plans de constitutions militaires, qu'elle
discuta avec réflexion et qu'elle vota avec unanimité. Nul n'y contesta au
roi le titre de chef suprême de l'armée. L'admission des corps étrangers,
milice stipendiée des rois absolus, qui n'ont ni les opinions ni les
responsabilités de la patrie, n'y fut autorisée qu'en vertu du consentement
du pouvoir législatif. L'égalité d'admission des citoyens à tous les grades y
dépouilla la noblesse du monopole du commandement ; la vénalité des emplois
militaires fut supprimée ; le roi fut chargé de présenter un plan
d'organisation de l'armée conforme dans ses détails à ces grands principes
généraux. L'Assemblée,
reprenant ensuite la question du clergé, décréta, sans résistance même des
ecclésiastiques, l'abolition des vœux monastiques. Le sort des cinquante
mille religieux et religieuses qui peuplaient encore les couvents et les
monastères fut fixé dans les termes suivants. « Art.
Ier. L'Assemblée nationale décrète, comme articles constitutionnels, que la
loi ne reconnaîtra plus les vœux monastiques et solennels des personnes de
l'un et l'autre sexe ; déclare, en conséquence, que les ordres et
congrégations de l'un et l'autre sexe sont et demeureront supprimés, en
France, sans qu'on puisse à l'avenir en établir d'autres. « Art.
II. Les individus de l'un et l'autre sexe existant dans des monastères
pourront en sortir en faisant leur déclaration à la municipalité du lieu. « Il
sera pareillement indiqué des maisons pour ceux ou celles qui préféreront ne
pas profiter des dispositions du décret. « Art.
III. Déclare, en outre, l'Assemblée nationale, qu'il ne sera rien changé,
quant à présent, à l'égard des ordres ou congrégations chargés de l'éducation
publique ou du soulagement des malades, jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris
un parti à ce sujet. « Art.
IV. Les religieuses pourront rester dans les maisons où elles sont
aujourd'hui, l'Assemblée les exceptant expressément des dispositions sur les
ordres monastiques. » Cette
discussion, préparée par la presque unanimité de l'opinion de toutes les
classes qui réprouvaient celles des institutions monacales qui ne servaient
ni aux malades ni à l'instruction, survivantes d'un autre temps et dans un
autre ordre social, ne fut signalée que par la timidité des orateurs
populaires à se prononcer sur l'existence ou la non-existence d'un culte
d'État, au lieu d'un culte individuel et libre de conscience. Charles Lameth
osa seul proclamer le principe de la séparation de l'État et de l'Église, et
de la neutralité des gouvernements dans les matières de foi. Ce fut le plus courageux et le plus éloquent de ses discours ; il y fit enfin hommage de la liberté à Dieu, son premier auteur. L'Assemblée recula devant son principe, et prépara le schisme d'une Eglise constitutionnelle, germe de division dans l'Église et de mort dans la Révolution. |