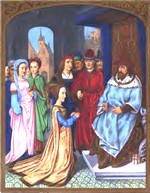LES CORPORATIONS OUVRIÈRES AU MOYEN-ÂGE

GODEFROID KURTH
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
BRUXELLES - SOCIÉTÉ BELGE DE LIBRAIRIE - 1898
|
APERÇU HISTORIQUE Les
corporations ouvrières sont l'un des plus grands besoins de la classe
laborieuse. L'homme n'est pas fait pour vivre isolé : dans les mille
difficultés de la vie, il a besoin de l'appui de ses semblables, et lui-même
est tenu de tendre une main secourable à ceux de ses frères qui se trouvent
dans la détresse. Cela est vrai surtout des travailleurs. Abandonnés à
eux-mêmes, ils sont sans défense et sans force. Unis fraternellement à leurs
camarades, ils peuvent former des sociétés puissantes, doit ils tireront sans
cesse secours et protection. L'Église
catholique, cette mère si pleine de sollicitude pour tous ses enfants, mais
surtout pour les pauvres et les faibles, avait admirablement pourvu à ce
besoin social. Sous son influence et avec son aide, toute l'Europe chrétienne
s'était couverte d'une magnifique floraison de corporations ouvrières. Ces
belles associations ont fait la gloire et la force des pauvres travailleurs,
et elles ont brillé d'un éclat admirable pendant le moyen-âge. Elles
participaient alors du respect dont l'Église elle-même était entourée. A
mesure que les sentiments religieux s'affaiblirent au sein des peuples, elles
perdirent une partie de leur ancienne prospérité. Néanmoins, elles sont
tellement nécessaires au monde qu'elles ont traversé tous les âges, depuis
les origines de la société chrétienne, et qu'elles n'ont cessé de faire
partie intégrante de la civilisation. Tous
les siècles ont joui de leurs bienfaits : un seul fait exception, et c'est le
nôtre. Seul, le XIXe siècle a vu les ouvriers isolés les uns des autres, sans
lien entre eux, réduits à l'état de grains de poussière que le vent disperse
dans le vide, tomber enfin dans une condition d'infortune et de misère
imméritées. Pourquoi ? Parce que la Révolution française, dans sa haine
aveugle pour la religion, a voulu détruire tout ce que la religion avait
créé, et que les corporations ont été ses premières victimes. Tous les
ouvriers doivent connaître, pour la maudire, la loi Chapelier du 14-27 juin
1791, dont voici l'article ter « L'anéantissement
de toute espèce de colorations de citoyens de même état ou profession étant l’une
des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les
rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. » On peut
dire que cette loi constitue le crime le plus abominable qui ait été commis
contre les intérêts populaires, depuis dix-neuf cents ans que nous sommes
chrétiens. Presque tous les malheurs de l'ouvrier moderne sont venus de ce
qu'il s'est trouvé, au moment où naissait la grande industrie, privé des
ressources innombrables que lui aurait fournies l'organisation corporative
pour conjurer sa déchéance économique. Qu'il
lise donc attentivement cette brochure écrite pour lui. 11 y verra la
situation enviable à laquelle la corporation l'avait élevé dans le passé il y
apprendra aussi à quelles conditions il reconquerra, s’il le veut, son rang
social perdu. IDÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION Définition
de la corporation.
Qu'était-ce qu'une corporation ouvrière au moyen âge ? C'était
une société composée de gens de même profession, qui s'unissaient dans un
sentiment de charité fraternelle pour pratiquer honnêtement leur métier, pour
veiller aux intérêts de leurs membres, et pour servir loyalement le public. Place
de la religion dans la corporation. Filles de la religion, les corporations ouvrières
gardèrent toujours l'empreinte de leur origine. On n'y pouvait entrer qu'a`
condition d'être bon catholique, et de remplir tous les devoirs religieux et
moraux exigés par ce titre. Chacune était sous la protection d'un saint dont
elle célébrait la fête avec grand éclat, et auquel elle dédiait, selon ses
moyens, une chapelle ou tout au moins un autel dans l'église paroissiale,
Toutes se faisaient un honneur de figurer en corps dans Les grandes fêtes
religieuses, notamment dans les processions, ou elles déployaient leurs
bannières, et où elles avaient leur rang marqué par une tradition invariable.
La fête du patron, d'ordinaire, ne se terminait pas sans qu'un joyeux banquet
réunît tous les confrères dans de fraternelles agapes d'où la licence était
bannie, mais où la gaieté ne manquait jamais. Les
membres observaient les uns vis à vis des autres les obligations de la
charité fraternelle. Dans toutes les grandes circonstances de la vie, le
travailleur trouvait ses confrères autour de lui, soit pour prendre part à
son bonheur au jour du mariage, en assistant à. sa noce, soit pour lui rendre
les derniers devoirs au jour de la mort. Les joies et les peines étaient en
commun ; on priait les uns pour les autres ; la religion mettait de la
dignité dans la réjouissance et de la consolation dans le deuil. Secours
mutuels. La
plupart des corporations avaient organisé les secours mutuels parmi leurs
membres, et venaient avec une active charité à l’aide de ceux qui étaient
tombés dans l'infortune. Souvent, elles dotaient les filles des confrères
pauvres, ou elles faisaient les frais de l'éducation de leurs orphelins.
Grâce à une cotisation modique, le confrère malade touchait, pendant tout le
temps qu'il était empêché de travailler, un secours qui le mettait à l'abri
de la misère. Enfin, plus d'une corporation trouvait encore le moyen de
soulager, en dehors de son propre sein, les souffrances les plus cruelles, et
versait d'abondantes aumônes aux léproseries et aux hôpitaux. Personnification
civile des corporations. Les corporations étaient reconnues par l'autorité comme des
institutions d'utilité publique, et jouissaient de tous les avantages de la
personnification civile. Elles avaient leur caisse. leur local, leurs
armoiries, leurs bannières, leurs archives, leur sceau, leurs revenus, en un
mot, tout' ce que peut posséder une personne riche et influente. Avant tout,
elles avaient leur règlement qui était pour elles une véritable constitution,
et qu'elles élaboraient elles-mêmes. Elles devaient, sans doute, le faire
approuver soie par la commune, soit par le prince : mais l'intervention de
l'autorité supérieure se bornait d'ordinaire à un simple contrôle, qui avait
pour but d'empêcher le conflit des divers métiers entre eux, ou avec
l'intérêt général. A part cela, l'autonomie des corporations était absolue,
et elles statuaient souverainement sur tout ce qui les concernait. Leur
gouvernement.
Elles étaient gouvernées par des confrères librement élus, d'après un mode
d'élection qui variait jusqu'à l'infini de métier à métier, de ville à ville.
Chose curieuse ! quand on étudie leur régime électoral, on découvre que ces
braves ouvriers d'autrefois avaient prévu et écarté la plupart des abus que
nous essayons de détruire aujourd'hui. Il faut ajouter que le vote était
obligatoire, et que nul ne pouvait, sauf pour les motifs les plus graves,
refuser la charge à laquelle il était appelé par l'élection. D'autre part,
les statuts défendaient généralement de confier deux fois de suite les mimes
fonctions au même homme. Les
chefs électifs de la corporation étaient les gouverneurs ou doyens, au nombre
de deux ou quatre ; ils étaient assistés de plusieurs assesseurs ou jurés,
d'un greffier ou secrétaire, d'un rentier ou trésorier, et ils avaient à
leurs ordres un ou plusieurs valets. Leurs attributions étaient nombreuses.
Ils convoquaient le métier, présidaient les séances, veillaient à l'exécution
des règlements, percevaient les cotisations et amendes, géraient le trésor,
représentaient la corporation à l'extérieur, et défendaient ses droits contre
toutes les atteintes. Quand il s'agissait d'affaires importantes, ils
convoquaient une assemblée générale, à laquelle tous les membres étaient
tenus d'assister. Tout le monde pouvait y émettre son avis, et le secret des
délibérations était rigoureusement gardé. S'il arrivait qu'il fût trahi par
la femme d'un confrère, c'est celui-ci qui était puni on supposait avec
raison qu'elle n'aurait pas parlé s'il n'avait commencé par être bavard. Quand
les résolutions du métier touchaient aux intérêts généraux, elles devaient,
de même que ses statuts, être soumises à la ratification de l'autorité
supérieure. Celle-ci, tout en abandonnant aux corporations le soin de
réglementer le travail, veillait de la manière la plus scrupuleuse à ce que
les mesures prises par un métier ne fussent pas contraires au droit de tous. Rôle
politique des corporations. Les corporations étaient plus que des personnes civiles ;
c'étaient aussi des personnes politiques, c'est-à-dire qu'elles avaient leur
mot à dire dans les affaires communales, et leur part très considérable dans
l'élection des magistrats communaux. Dans beaucoup de villes, cette part
était la part du lion, et il fallait être inscrit dans une corporation pour
avoir le droit de vote. Mais ce régime de démocratie exclusive était loin
d'être le meilleur, parce qu'il ne tenait nul compte des autres éléments
sociaux qui avaient droit à être représentés dans le conseil de la commune,
et aussi parce qu'il mettait sur le même pied des métiers d'une importance
fort diverse. Il faut donner la préférence au régime qui divisait les
électeurs en catégories dont chacune avait dans l'élection une place
proportionnée à son importance. Tel était, notamment, celui de Dinant, qui
groupait toute la population électorale en trois classes les bourgeois
proprement dits, les batteurs de cuivre, qui formaient la corporation la plus
importante de la ville, et, enfin, l'ensemble des autres métiers. Les deux
premiers groupes nommaient chacun neuf conseillers et le troisième douze ; il
en résultait un conseil de trente membres qui réalisait vraiment ce qu'on
appellerait aujourd'hui la représentation proportionnelle des intérêts. Bref,
dans aucune commune du moyen âge, l'ouvrier n'était éloigné des urnes ou
privé du droit d'intervenir dans les affaires publiques. Le plus humble travailleur
y était intéressé comme le plus fier patricien, et la vie politique n'était
pas un domaine fermé à l'homme qui vit du travail de ses mains. Le
service militaire des corporations. Des hommes qui avaient de tels droits devaient
avoir plaisir à remplir leurs devoirs. Aussi les ouvriers étaient-ils, en
général, d'excellents soldats, qui portaient avec joie les armes pour la
défense de la patrie. Chaque corporation formait une compagnie à part, et
jusque dans les rangs, les confrères restaient groupés, combattant côte à
côte et se sentant les coudes. Beaucoup de glorieuses victoires ont été
remportées par ces braves gens, que les chevaliers regardaient de haut et
qu'ils appelaient avec mépris la piétaille. C'est la piétaille flamande qui a
gagné, en 1302, la grande bataille des Éperons d'or sur toute la chevalerie
française. Et la piétaille wallonne ne le cédait pas à la flamande. En 1213,
à la bataille de la Warde de Steppes, ce sont les bouchers de Liège qui ont
décidé le succès de la journée, et taillé en pièces la noblesse brabançonne. Rang
social des corporations. Ainsi, grâce à leur union et à leur entente, les ouvriers
étaient parvenus à un rang social éminent dans nos villes. Ils en étaient
l'élément le plus important. Ils n'étaient pas, alors, refoulés en dessous de
la bourgeoisie dans un niveau social inférieur ; ils étaient eux-mêmes la
bourgeoisie, et la distinction qu'on fait aujourd'hui entre bourgeois et
ouvriers leur était inconnue. Loin de rougir de leur travail, ils en étaient
fiers, et ils avaient un point d'honneur professionnel singulièrement
délicat. Quiconque, par sa conduite ou par ses relations, souillait le noble
blason du métier, en était sévèrement
exclu. Les honorables insignes de la profession étaient exhibés avec orgueil
sur les bannières, et partout, dans les cortèges pacifiques ou dans les
expéditions militaires, on voyait les étendards chargés de pics de bouilleur
ou de scies de charpentier flotter fièrement à côté des pennonceaux qui
portaient les lions héraldiques de la chevalerie, Encore aujourd'hui, dans plus
d'une chapelle de nos grandes églises, ces armoiries du travail ornent les
verrières où les ont fait placer les corporations et quand le soleil brille à
travers leurs couleurs qu'il fait flamboyer, il semble que ce soit la classe
ouvrière elle-même, transfigurée par la religion, qu'on voit resplendir dans
la gloire impérissable du travail chrétien. LA HIÉRARCHIE OUVRIÈRE Dignité
du travail. Ce qui vient d'être dit montre la haute idée que les corporations
se faisaient du travail. Tout métier était considéré comme un art, auquel on
devait en conscience apporter tous ses soins. De même qu'on ne faisait pas de
différence entre l'ouvrier et le bourgeois, de même on n'en connaissait pas
entre l'artisan et l'artiste. Les deux mots étaient synonymes, et plus d'un
des merveilleux chefs-d’œuvre du moyen lige est sorti des mains d'un modeste
homme de métier. On disait proverbialement, quand on voulait parler d'un
produit irréprochable, qu'il était fait de main d'ouvrier. Nous allons voir à
quel prix les travailleurs d'autrefois atteignaient ce degré de supériorité
technique. L'apprenti. D'abord, c'était leur principe
que pour pratiquer un métier, il fallait le savoir, et-que pour le savoir il
était nécessaire de l'avoir appris. Aussi quiconque se destinait à une
profession commençait-il par aller en faire l'apprentissage chez un maitre.
L'apprenti devait être de religion catholique, et, en général, de naissance
légitime ; on voulait aussi qu'il eût un certain âge, qui d'ordinaire ne
descendait pas en dessous de douze à treize ans. Au surplus, le patron ne se
chargeait pas de l'apprenti et les parents ne lui livraient pas leur enfant
sans que de part et d'autre on exigeât des garanties. H intervenait donc un
véritable contrat, revêtu de formalités solennelles qui en attestaient
l'importance. Le contrat d'apprentissage était passé parfois devant
l'assemblée du métier, parfois même à l'hôtel-de-ville, devant les échevins,
toujours, devant des témoins choisis par les deux parties. Les engagements
réciproques étaient mis par écrit, et garantis par la corporation elle-même
ainsi que par l'autorité publique. Le
contrat établissait entre le patron et l'apprenti les mêmes relations
qu'entre un père et son fils. Le patron s'engageait à prendre l'apprenti chez
lui, à l'entretenir et à l'élever comme son propre enfant, à veiller avec le
plus grand soin sur sa vie morale et religieuse, à le garder par porte et
par verrou, et tout particulièrement à lui bien apprendre le métier.
L'apprenti, de son côté, devait considérer le patron comme son père, le
respecter, lui obéir, remplir fidèlement les clauses de son contrat, et,
enfin, ne pas le quitter avant le terme convenu. Telles étaient les
conditions principales de part et d'autre, mais on n'en finirait pas si-l'on
devait exposer, dans le détail, les précautions innombrables qui étaient
prises pour sauvegarder tous les droits de chacun. La
durée de l'apprentissage était généralement longue. Rares étaient les métiers
où il ne durait que deux ou trois ans ; il en fallait quatre à cinq dans la
plupart, et même, dans quelques industries particulièrement difficiles, comme
celle des orfèvres ou celle des tisserands, il pouvait aller jusqu'à huit et
même jusqu'à dix ans. Il y avait d'ailleurs une autre raison pour le
prolonger. En général, les apprentis ne payaient rien à' leur patron, pas
même la pension ; ils étaient donc pour lui, du moins pendant les premières
années, une source .de dépenses considérables, et la justice exigeait qu'ils
le dédommageassent en travaillant pour lui un peu au-delà du temps nécessaire
à leur formation. C'était
un grand bienfait pour l'apprenti que cet enseignement professionnel. Il y
avait droit, et le maître le lui devait en conscience. Aussi, pour que le
maître ne fût pas amené à négliger l'éducation de l'enfant, lui était-il
défendu d'avoir plus d'un certain nombre d'apprentis. Dans beaucoup de
métiers, ce nombre était limité à un, à deux ou à trois. S'il était constaté
que le maître négligeait d'instruire son apprenti, celui.ci avait le droit de
faire casser son contrat, ct, dans ce cas, les jurés du métier lui
procuraient un autre patron. Le
compagnon.
L'apprentissage terminé, on gravissait le second degré de l'échelle
corporative, et l'on devenait compagnon, ce qui signifie proprement
ouvrier. D'ordinaire, on couronnait ses années d'apprentissage par une ou
deux années de voyage à l'étranger, qui achevaient l'éducation technique du
jeune travailleur. C'est ce qu'on appelait, dans nos contrées, le tour de France.
Portant sur le dos un sac qui contenait son léger bagage, et égayant sa route
par mainte joyeuse chanson, le jeune compagnon s'en allait de ville en ville,
s'arrêtait là où il trouvait de l'ouvrage ou de l'agrément, puis repartait
pour visiter de nouvelles contrées, et faisait ainsi, en route, la
connaissance des hommes et des choses. Il y avait là, pour un travailleur
consciencieux et honnête, un fécond enseignement complémentaire, qui
l'initiait à tout ce que son art avait de plus varié et de moins connu. Il
était généralement sûr d'un bon accueil partout où il arrivait, des sociétés
de compagnons lui ouvraient leurs rangs, et s'employaient à lui trouver de
l'occupation. Et les maîtres ne haïs-scient pas d'employer l'ouvrier
étranger, quand il leur avait fourni la preuve de son éducation
professionnelle. Souvent il apportait dans leurs ateliers des procédés
nouveaux, et il rajeunissait la tradition du travail. De
retour au pays, le compagnon s'engageait au service d'un patron et prenait
place dans les cadres du métier. S'il était célibataire, le maitre,
généralement, le prenait chez lui, à son pain et à son pot, comme on
disait autrefois. Plusieurs métiers, toutefois, répugnaient à cette
cohabitation, qui leur semblait présenter des inconvénients pour la vie de
famille. Dans tous les cas, l'ouvrier célibataire était l'exception, et, dès
qu'il se mariait, il s'établissait à part et avait son ménage à lui. Beaucoup
se contentaient, leur vie entière, de l'existence calme et paisible du
compagnon. Elle leur assurait le pain quotidien, et, leur journée finie, ils
trouvaient auprès de leur foyer cette aisance modeste et cette indépendance
souveraine qui faisaient dire : Pauvre homme en sa maison est roi. Le
maitre. Ceux
qui avaient plus d'ambition briguaient le rang de maitre. La maîtrise ne
s'acquérait pas sans peine. Il fallait passer un examen, et subir une série
d'épreuves analogues à celles qu'on subit aujourd'hui dans nos universités.
Le travail manuel était honoré à l'égal des professions libérales, et un
diplôme de maître cordonnier devait se conquérir tout comme un diplôme
d'ingénieur ou d'avocat. L'examen
se passait devant un jury composé de maîtres du métier. Il comprenait une
partie théorique et une partie pratique. La partie théorique consistait en
questions posées par le jury sur les principaux_ points de la profession.
Certains questionnaires nous ont été conservés on y voit que les
interrogations étaient sérieuses. Ainsi, par exemple, l'imprimeur devait
prouver qu'il savait lire le grec, et être expert en langue latine. Mais la
partie pratique de l'examen était de beaucoup la plus importante. Elle se
résumait dans la confection d'un chef-d’œuvre que le récipiendaire devait
exécuter seul, soit sous la surveillance du jury, soit, tout au moins, dans
des conditions telles que le fraude était rendue impossible. C'était le jury
lui-même qui désignait le travail à exécuter, et on aura une idée du haut
degré de préparation technique des patrons du moyen fige par les quelques
exemples suivants. Le maçon devait faire un arc de maçonnerie et un quart
d'escalier tournant, Le peintre en bâtiments avait à peindre une statue de la
sainte Vierge. On demandait au tailleur de confectionner une étole de prêtre
et une robe de femme. Enfin, le cuisinier était tenu de préparer une grosse
pièce, deux potages, six entrées, cinq plats de rôt et neuf plats
d'entremets, Combien n'y a-t-il pas de patrons aujourd'hui qui échoueraient,
si on leur imposait des épreuves de ce genre ! Une
fois qu'on était passé maitre, on se faisait recevoir dans la corporation en
prêtant le serment d'observer fidèlement les statuts, et l'on avait alors,
comme disaient nos ancêtres, l'usage a la hantise du métier. On pouvait
ouvrir un atelier, prendre des compagnons et des apprentis, se livrer à
l'exercice de la profession avec tous les avantages qui y étaient attachés,
participer aux assemblées de la corporation. La maîtrise était le plus haut
degré de la hiérarchie ouvrière : celui qui l'avait atteint ne gardait
d'autre ambition que d'en paraître toujours digne. Résultats
de la hiérarchie ouvrière. Il n'est pas possible de le nier : toutes ces précautions
prises pour former de bons ouvriers et de bons patrons avaient des résultats
excellents. Les produits du moyen âge étaient presque toujours d'une facture
excellente. Aujourd'hui encore, les amateurs font la chasse aux vieux bahuts,
aux vieilles serrures, aux vieux manuscrits, aux dinanderies, en un mot, à
tout ce qui reste des arts industriels d'autrefois. On y trouve une sûreté de
main., un fini d'exécution qui stupéfient. Il est telle clef, telle penture
de porte, telle moulure de bois, telle miniature de manuscrit qui a coûté à
l'artisan un travail incroyable. Un ouvrage bien fait avait une durée
indéfinie. Des robes se léguaient par testament, et étaient portées par plusieurs
générations. Nous avons des livres d'il y a six cents ans qui sont aussi
intacts que s'ils sortaient des mains des copistes LE RÉGIME DU TRAVAIL Depuis
la Révolution française, grâce à l'affaiblissement de la foi religieuse et à
la suppression des corporations, les hommes ont pris l'habitude de considérer
la vie comme un grand champ de bataille où les plus faibles succombent
fatalement sous les plus forts. Ils appellent cela le combat pour
l'existence. Nulle part Ces idées funestes n'ont fait autant de ravages que
dans le domaine de l'industrie. La concurrence y est devenue le seul
principe, et chacun cherche à produire au meilleur prix pour pouvoir vendre
au meilleur marché, afin d'écraser ainsi tous les concurrents. Et qui ne voit
que pour arriver à, ce beau résultat, on est fatalement amené à réduire le
salaire des ouvriers ou à frauder le public sur la qualité des produits ? Au
moyen-âge, on avait d'autres idées. On croyait que les hommes sont faits pour
s’entraider et non pour s'entremanger. On voulait avant tout que l'ouvrier
pût vivre honorablement du fruit de son travail, et que le public fût
loyalement servi pour son argent. Dans ce but, on recourait à tous les moyens
nécessaires pour empêcher la concurrence effrénée qui permet à quelques-uns
de s'enrichir par des moyens injustes, en réduisant une multitude de leurs
semblables à la misère. Achat
des matières premières.
Beaucoup de corporations étaient organisées en sociétés coopératives pour
l'achat des matières premières, qu'elles distribuaient par parties égales aux
associés, ce qui diminuait dans une proportion souvent considérable pour
chacun d'eux le prix de revient. Celles qui abandonnaient à leurs membres le
soin de s'approvisionner eux-mêmes veillaient toutefois aussi à ce que
personne ne pût se faire accapareur. Si un confrère trouvait l'occasion de
faire une emplette à bon compte, il était tenu de le faire connaître aux
autres confrères pour qu'ils pussent participer aux mêmes avantages. Bien
plus, avait-il passé un, marché avantageux avec un fournisseur, tout confrère
avait le droit d'intervenir en tiers dans le marché aux mêmes conditions.
D'aucune manière on ne pouvait, en acquérant les matières premières à
meilleur compte, se donner vis à vis de ses confrères une avance redoutable
qu'on aurait conservée pendant toutes les phases de la production, et qui
aurait été une première source d'inégalité. Ateliers
communs. Là où
c'était nécessaire, la corporation mettait aussi à la disposition de ses
membres des instruments de travail commun. Ainsi, les tanneurs possédaient un
moulin à écorces où tous avaient le droit de faire moudre à leur tour. Ainsi,
les cordiers, les teinturiers et d'autres métiers encore possédaient des ateliers
communs où tous les confrères pouvaient se livrer à leur travail. Règles
de la fabrication.
Les ateliers privés étaient d'ailleurs la majorité. Seulement, on y
travaillait d'après des règlements minutieux, destinés à assurer la bonne
qualité des produits. En général, l'atelier devait se trouver au
rez-de-chaussée, donner sur la rue, être suffisamment éclairé, rester
toujours ouvert au contrôle des jurés du métier, qui venaient s'assurer si
tout se passait conformément aux prescriptions. On peut dire que le public
assistait lui-même à la confection des produits qu'il achetait, car,
d'ordinaire, la boutique se confondait avec Il
serait trop long d'entrer dans le détail des prescriptions réglementaires
spécifiant le mode de fabrication de chaque produit. La chasse était faite à.
toutes les fraudes, et les statuts de chaque métier poursuivaient les
contraventions avec une vigilance et une sévérité qui ne se laissaient pas
facilement mettre en défaut. On frappait non seulement la falsification ou
l'emploi de mauvaises matières premières, mais encore les procédés défectueux
de fabrication, et même ceux qui, sans être frauduleux, rendaient cependant
difficile la constatation de la fraude. Certains métiers étaient, sous ce
rapport, en possession d'un véritable code ainsi, par exemple, les drapiers
réglaient la longueur et la largeur des pièces d'étoffe, la quantité et la
qualité des fils, la nature (lus tissus, etc. Il en était de même chez les
tapissiers, chu/ les orfèvres et, en un mot, dans tous les métiers où la
fabrication est un peu compliquée, Une
fois le produit élaboré ainsi, sous les yeux du public, il fallait encore,
dans plusieurs métiers, le soumettre au contrôle des jurés avant qu'on pût le
mettre en vente. Était-il trouvé insuffisant, il était lacéré, ou détruit, ou
vendu comme rebut. C'est seulement s'il avait toutes les qualités requises
par les statuts que les jurés en autorisaient l'exposition, d'ordinaire en le
marquant du sceau de la corporation. La
vente. On
vendait généralement chez soi, dans son atelier. Cependant, beaucoup de
métiers possédaient aussi une halle, où chaque confrère, moyennant une légère
rétribution, avait son étal à lui. Enfin, les grandes foires annuelles des
villes voisines fournissaient à tout le monde l'occasion d'écouler l'excédent
de ses produits sur un marché international, dont l'animation et l'activité
étaient extraordinaires. Mais
avec quelle sollicitude le métier veillait à ce que le trafic se passât dans
des conditions de rigoureuse égalité ! Les heures de vente étaient
limitées. La dégradante réclame qui sévit aujourd'hui dans le commerce était
interdite. Nul n'avait le droit d'attirer chez lui l'acheteur qui stationnait
devant l'étalage d'un confrère. Encore moins lui était-il permis de vendre en
dessous du prix fixé par le métier. Les
garanties des acheteurs. Il ne faut pas croire cependant, d'après cette dernière
interdiction, que le public, à qui l'on garantissait de bons produits, fût
obligé de payer des prix arbitraires. Certes, si la corporation avait eu le
droit absolu de -fixer les prix, cet abus aurait pu se produire. Mais
elle-même avait à compter avec la concurrence de l'étranger, qui, étouffée en
temps ordinaire, retrouvait toute sa liberté pendant toute la durée de la
foire annuelle. Alors, l'arrivée des forains, qui mettaient tout en œuvre
pour allécher le client, aurait suffi pour rappeler la corporation à la juste
mesure, et pour maintenir les prix à un niveau équitable. D'ailleurs, les
maîtres de chaque métier avaient eux-mêmes le droit, pendant toute l'année,
de vendre les produits -de l'industrie étrangère, à condition de les
soumettre .au contrôle des jurés. La concurrence, contenue dans ces limites,
non seulement n'avait rien de ruineux pour la corporation, mais elle
empêchait les coalitions de producteurs pour dominer le marché, et elle
forçait l'industrie indigène d'être toujours à la hauteur de sa tâche pour
garder sa clientèle. LA CONDITION DES OUVRIERS Par ce
qui précède, on a déjà pu entrevoir que la condition des ouvriers était
meilleure-au moyen âge qu'aujourd'hui. En effet, dès que la concurrence
illimitée ne force pas le patron à abaisser indéfiniment le taux des
salaires, il y a toute chance que l'ouvrier touchera une juste rémunération
de son travail. D'autre
part, le régime de la petite industrie, conséquence des mesures prises pour
établir l'égalité entre les patrons, était aussi très favorable à l'ouvrier,
Il ne connaissait pas l'immense distance qui aujourd'hui le sépare du patron
dans un grand nombre de métiers. Le patron avait commencé d'ordinaire par
être ouvrier lui-même ; l'ouvrier avait toute chance de devenir patron un
jour. Patrons et ouvriers travaillaient ensemble aux mêmes tâches, dans le
même atelier, dans la même obéissance fraternelle à la loi sacrée du travail.
Ils mangeaient à la même table, souvent ils habitaient sous le même toit, et,
de toute manière, ils mettaient en commun la plus grande partie de
l'existence. Leur condition sociale n'était pas sensiblement différente. Le gain
du patron ne dépassait guère le double du salaire qu'il payait à un de ses
ouvriers ; encore faut-il comprendre, dans ce gain, ce qui lui revenait pour
son capital et ses frais d'établissement. Leurs intérêts étaient presque
toujours solidaires ; quant aux causes de conflit entre eux, elles étaient
infiniment plus rares qu'aujourd'hui. Enfin,
la religion était là qui voulait que l'ouvrier fût respecté comme une
créature humaine, et non pas utilisé comme une machine ou une bête de somme.
Toutes les dispositions que nous allons passer en revue étaient inspirées par
ce principe fondamental de la loi divine. Travail
des femmes et des enfants. On faisait aux femmes une situation réclamée par la dignité de
leur sexe et par leurs devoirs de mères de famille. Elles n'étaient pas
exclues du travail, et il y -avait même certaines corporations exclusivement
féminines, comme celle des modistes, De plus, la veuve pouvait continuer
l'industrie de son mari pour son propre compte, et, si elle se remariait avec
un compagnon du métier, celui-ci acquérait par le fait même la maîtrise sans
devoir passer l'examen. Mais la femme, dans tous ces cas, travaillait chez
elle, à des travaux compatibles avec son sexe et avec ses forces. A Valence,
en Espagne, il y avait un proverbe qui disait : La
femme au foyer L'homme
à l'atelier. La
honteuse promiscuité de l'usine, telle que plusieurs districts industriels la
tolèrent encore, eût fait horreur à nos ancêtres. Ils se seraient indignés de
voir les femmes et les jeunes filles descendre dans les fosses, qui sont les
tombeaux de l'honneur féminin, Celles qui étaient employées par les
houillères ne Travaillaient jamais que dans le dessus. Quant
aux enfants, ils n'étaient admis dans l’atelier qu'à partir d'un certain âge,
variant suivant la difficulté du travail. Il était bien rare qu'ils
travaillassent avant dix ou douze ans, et on leur réservait les taches les moins
fatigantes. Durée
de la journée de travail. On ne se croyait pas non plus le droit de surmener les ouvriers
adultes. D'abord, dans la plupart des métiers, tout travail de nuit était
formellement défendu. Quant au travail de jour, sa durée était d'ordinaire
proportionnée à celle de la journée du calendrier dans certains métiers, elle
allait de huit heures en hiver à seize heures en été. Toutefois, de ce
dernier chiffre, il faut défalquer une heure et demie pour le diner, et une
demi-heure pour le goûter. De plus, k samedi et la veille des grandes fêtes,
on fermait. l'après-midi. Enfin, on tenait largement compte de la difficulté
du travail pour en déterminer la durée. Notre Saint Père le pape Léon XIII
dit, dans son encyclique sur la condition des ouvriers, que le nombre
d'heures d'une journée de travail ne doit pas excéder la mesure des forces
des travailleurs, et il ajoute : « L'ouvrier qui arrache à la terre
ce qu'elle a de plus caché, la pierre, le fer et l'airain, a un labeur dont
la brièveté devra compenser la peine et la gravité, ainsi que le dommage
physique qui en peut être la conséquence. » Eh bien, ce précepte du Souverain
Pontife était réalisé au moyen-âge. La journée des ouvriers mineurs n'était
que de huit heures en Allemagne, et de six heures au pays de Liège. On a là
un exemple remarquable de l'ancienneté comme aussi de la continuité des
préceptes de l'Église, sur une matière qui touche de si près aux plus chers
intérêts de la classe ouvrière. Le
repos du dimanche.
Mais le travail quotidien, même modéré, finirait par épuiser et abrutir
l'homme, La science a démontré qu'il a besoin du repos du septième jour pour
réparer pleinement ses forces, et la religion lui enseigne que ce jour ne lui
est pas moins nécessaire pour remplir ses devoirs envers Dieu et envers les
siens. Aussi observait-on respectueusement le jour du Seigneur, comme fait
encore aujourd'hui l'Angleterre, qui est la nation la plus riche et la plus
industrielle du monde. La
religion et l'intérêt des ouvriers étaient d'accord ici comme en toute chose.
On n'apportait d'ailleurs aucun rigorisme dans l'obéissance au précepte
divin. Pour tenir compte des besoins imprévus, certains métiers autorisaient
un ou deux de leurs membres, à tour de rôle, à tenir leur boutique ouverte le
dimanche. C'est ce que faisaient notamment les orfèvres de Paris au temps de
saint Louis. Seulement, l'argent gagné ce jour-là était considéré comme sacré
: on le versait dans une caisse spéciale, qui était affectée exclusivement à
des œuvres de charité. Quel ne
devait pas être pour le travailleur le charme de ce jour de repos,
lorsqu'après l'avoir sanctifié par la pratique du devoir religieux, il en
consacrait le reste à la vie de famille ! Maitre de lui-même, secouant de ses
vêtements la poussière du travail et de son cœur le fardeau des soucis, en
communion plus intime avec Dieu, plongé dans le calme souverain qui semblait
descendre du ciel sur terre, il faisait provision de forces physiques pour le
reste de la semaine, et renouvelait à leur source tous les nobles sentiments
qui font battre le cœur humain. Voilà ce qu'ignorent les malheureux inventeurs
de ce dimanche laïc qu'on appelle le lundi bleu ; leur repos,
ruisselant d'alcool, n'est qu'une fatigue de plus, laissant derrière elle
l'opprobre et la misère ! Le
salaire des ouvriers.
On pense bien qu'une question aussi grave que celle du salaire n'était pas abandonnée
au caprice. D'ailleurs, la concurrence étant resserrée dans de justes
limites, la prétendue loi d'airain des salaires n'existait pas. Il
n'est pas facile, au surplus, de dire exactement ce que gagnaient les ouvriers
en monnaie d'aujourd'hui. D'une part, la valeur de l'argent a beaucoup varié
selon les diverses époques, et nous ne la connaissons pas exactement pour
chacune. D'autre part, un grand nombre d'ouvriers avaient leur pension chez
le patron, et elle venait naturellement en décompte du salaire. On ne lésinait
pas sur la nourriture. La table était bien mise ; on mangeait beaucoup de
viande, et on avait de la bière ou du vin aux deux repas. Nous avons des
comptes des mines du Forez en France pour le milieu du XVe siècle : on y voit
que les ouvriers étaient nourris d'une manière confortable, que leurs
couchettes étaient très bonnes, et qu'on faisait du feu en hiver dans leurs
dortoirs. Vers la même époque, en Allemagne, des patrons se plaignent que
leurs ouvriers réclament plus d'un plat de viande à souper. « Cela est
déraisonnable », disent-ils, et tout le monde conviendra qu'ils avaient bien
raison. Le
minimum de salaire. Personne ne se fût avisé de croire, au moyen âge, que le
salaire de l'ouvrier ne dût pas être suffisant pour le nourrir avec sa
famille. A la vérité, nul ne discutait sur le minimum de salaire, mais tout
le monde le payait. U était fixé, tantôt par le métier lui-même, tantôt par
la commune, tantôt enfin par le prince, c'est-à-dire, comme nous disons
aujourd'hui, par l'État. A Gand, le maitre en entrant en fonctions devait
prêter serment de ne jamais travailler ni faire travailler à prix réduit. En
1708, la commune de Tirlemont, en fixant le taux du salaire des maçons,
stipula que si l'entrepreneur réduisait les salaires de ses ouvriers, il
était tenu de compter d'autant moins au public. C'était là une précaution
ingénieuse pour l'empêcher de les diminuer, et sans doute elle aura été
efficace. Mais des règlements généraux édictés en cette matière par la
commune ou par l'État avaient trop peu de souplesse pour s'adapter à tous les
cas spéciaux que pouvait faire naitre, la différence des lieux et des temps.
Aussi était-ce le plus souvent le métier lui-même qui fixait le tarif des
salaires. Or, comme on l'a vu, le métier était composé d'ouvriers aussi bien
que de patrons. Les ouvriers avaient leur mot à dire dans l'élection des
jurés., et souvent ils en choisissaient une partie, pendant que le choix des
autres était abandonné aux patrons. La fixation du minimum de salaire était,
dans ce cas, le fait d'un accord entre patrons et ouvriers, ce qui est la
formule parfaite. Des
dissentiments, toutefois, restaient possibles on va voir un bel exemple de la
manière dont on les apaisait. En 1325, dans le métier des drapiers de Liège,
il y eut contestation, au sujet du salaire, entre les patrons et les
ouvriers. Que fit-on ? On convint de nommer une commission arbitrale de
quatre prudhommes, dont deux étaient choisis par les patrons et deux par les
ouvriers, et c'est cette commission mixte qui trancha souverainement le débat.
Et le métier fut tellement satisfait de cette solution que nous voyons la
commission arbitrale fonctionner encore à plusieurs reprises pendant le XIVe
et le XVe siècle. Ses sentences étaient sans appel, et protégées par des
pénalités sévères. Si, après en avoir été sommé, le patron n'avait pas, dans
les trois jours, payé à son ouvrier la déserte salaire légitime, la
commission pouvait défendre à tous les ouvriers du métier de travailler pour
lui : cela s'appelait fercommander le métier. Droit
de grève.
Partout d'ailleurs, on reconnaissait le droit de l'ouvrier de suspendre le
travail pour non-paiement de salaire. Les bouilleurs du pays de Liège
appelaient cela faire festoyer la fosse, et ils donnaient le signal de
la grève en mettant la main à la chaine. Les hommes étant partout les
mêmes, l’usage qu'ils faisaient de ce droit n’était pas toujours des plus
louables. Quand les têtes étaient un peu montées, la grève éclatait pour les
motifs les plus futiles, et elle se prolongeait parfois outre mesure. La
grève des ouvriers boulangers de Colmar, en 1405, dura dix ans. Défense
des coalitions.
Il ne faut pas croire, toutefois, que les patrons fussent à la merci de leurs
ouvriers, et obligés de passer par toutes leurs conditions, D'abord,
l'éducation professionnelle du métier faisait que les ouvriers étaient assez
éclairés sur les limites naturelles de leurs droits pour ne pas formuler des
demandes exagérées. Puis, il leur était défendu de se coaliser pour arracher
aux maîtres une augmentation de salaire ou une diminution de la journée de
travail. Bien plus, il était interdit au patron de payer un salaire supérieur
à celui qui avait été fixé par le métier ç'aurait été jeter le trouble dans
le travail et ruiner les confrères non en état de faire les frais de cette
augmentation. Jamais les règlements ne se préoccupaient de l'intérêt exclusif
d'une des deux parties : toujours, ils s'efforçaient de rendre une exacte
justice aux patrons aussi bien qu'aux ouvriers. Si les mesures prises en
faveur de ceux-ci sont plus nombreuses, c'est parce qu'étant plus faibles,
ils avaient besoin d'être plus protégés. Interdiction
du truck-system.
Parmi les abus, il y en a un qui crie vengeance au ciel c'est la détestable
pratique que les Anglais appellent le truck-system, et qui consiste à
payer l'ouvrier, au moins pour une partie, en marchandises sur laquelle le
patron réalise du bénéfice, Depuis la Révolution française, ce criminel usage
s'est répandu un peu partout. Nos ancêtres l'avaient flétri et sévèrement
condamné. Il faut entendre ici les généreuses paroles du prince-évêque de
Liège, Jean-Théodore de Bavière, dans son ordonnance du 4 septembre 1745 : « Un
abus si criant et si réprouvé par les lois divines et humaines, devant être
envisagé comme une défraudation effective du salaire mérité par le pauvre
ouvrier à la sueur de son front, qui seule peut attirer la colère de Dieu sur
ceux qui la pratiquent et sur ceux qui la dissimuleraient, nous déclarons et
voulons que les mandements émanés à ce sujet le 22 mai 1739 et le 8 février
1742 soient exactement mis à exécution, et qu’à l'avenir tous marchands d’armes,
de clous, drapiers et autres comme commerçants, de même que tous
fabricateurs, maîtres d’usines et de fosses à houille sans aucune exception,
aient à s'y conformer, en payant réellement le salaire des ouvriers qu'ils
emploient en argent comptant et point autrement. » Ainsi
parlait un évêque, à la veille du jour où la Révolution française s'apprêtait
à détruire sa principauté, jusqu'à la dernière heure, l'Église catholique est
restée fidèle à la cause de l'ouvrier, et les démolisseurs n'ont pu arriver
aux institutions protectrices de la liberté populaire qu'en lui passant sur
le corps ! CONCLUSION L’heure
est venue de réorganiser les forces du travail et d'appeler les ouvriers à la
défense de leurs intérêts, en les groupant, comme autrefois, dans de
fraternelles associations. Léon XIII nous le demande, et, partout, les
travailleurs répondent à son appel. Après le rude hiver qui a passé sur elles
pendant un siècle, voilà que les corporations se remettent à bourgeonner
partout comme les arbres à l'approche du printemps. Si Dieu leur prête vie,
elles rendront au monde de l'usine et de l'atelier le rang social qu'il a
perdu, elles renoueront la chaine d'or de la tradition catholique, et elles
imprimeront une allure nouvelle à la marche de la civilisation. Il ne
s'agit pas, bien entendu, d'une restauration pure et simple du passé. Les
conditions politiques et sociales ont changé. Des États centralisés existent
partout ; la grande industrie a pris, grâce à l'avènement des machines, la
place de la petite le marché est devenu international. Les corporations du
moyen avec leur organisation appropriée à un état de choses fort différent du
nôtre, ne nous rendraient donc plus les mêmes services qu'autrefois. Mais le
principe qui leur a donné le jour reste éternellement jeune et fécond. Et ce
qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des applications nouvelles du même
principe. Ces
applications, on les trouvera dans les syndicats chrétiens, qui sont les
corporations modernes. Adaptés aux besoins multiples de notre régime actuel,
inspirés par l'esprit de charité fraternelle et nourris par les enseignements
de la religion, ils deviendront la force qui ramènera l'ordre et la justice
dans le chaos du monde économique. Comment
cela ? Parce qu'ils y feront rentrer la notion chrétienne du travail. « Tu
mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Cette parole divine a une
double portée elle veut que l'homme travaille, et elle veut que le travail
nourrisse le travailleur. Tout sera changé, le jour où la société comprendra
que c'est à elle que s'adresse la seconde partie du précepte divin. Aucun des
abus qui déshonorent l'atelier moderne ne pourra plus subsister. On
reviendra, pour ne plus l'abandonner, à une organisation du travail qui n'est
pas une utopie, puisqu’elle a fonctionné pendant des siècles à la
satisfaction de tous. L'ouvrier honnête et laborieux ne saura plus ce que c’est
que le travail du dimanche, la journée excessive, le salaire insuffisant,
l'insécurité du lendemain, On rira des sophistes qui, pour la défense de tous
ces abus, allèguent des fatalités économiques. Les prétendues lois qui font à
l'industrie l'obligation d’être injuste ne prévaudront pas contre la loi de
Dieu, qui fait de la justice la pierre angulaire des sociétés. Religion
et corporation !
que ce soit donc lâ la devise de tous les ouvriers. Qu'ils l'inscrivent en
tête de leurs statuts et sur la soie de leurs étendards, mais surtout qu'ils
la gravent au fond de leurs cœurs. FIN DE L’OPUSCULE
|