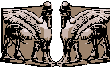LES ÉCOLES D’ANTIOCHE
ESSAI SUR LE SAVOIR ET L’ENSEIGNEMENT EN ORIENT AU IVe SIÈCLE (APRÈS J.-C.)
Par Albert HARRENT
PARIS — 1898
PRÉFACE.CHAPITRE PREMIER. — Régime des écoles.CHAPITRE DEUXIÈME. — Les programmes.CHAPITRE TROISIÈME. — Études spéciales.CHAPITRE QUATRIÈME. — La famille. Le pédagogue. L’étudiant.CHAPITRE CINQUIÈME. — Les maîtres.CHAPITRE SIXIÈME. — La rhétorique supérieure.PRÉFACECeux qui du haut de l’époque actuelle jettent de nouveaux regards sur les situations antérieures du genre humain, nous préparent le fil qui doit nous guider dans les routes incertaines de l’avenir. AUG. THIERRY, Dix ans d’Études, p. 271. Le lecteur aime dès l’abord pouvoir, en feuilletant quelques pages d’un nouvel ouvrage, saisir quel esprit général l’inspire, quel intérêt il présente, quel dessein il réalise. Souvent, une occasion sans importance apparente, a amené sous les yeux une page d’histoire qui séduit. Des problèmes se sont posés, des leçons précieuses ont été entrevues. Un nom, un peuple, une époque sont ainsi devenus les hôtes familiers de notre esprit, sont entrés en son intimité ; de curieuse, l’étude s’est faite attentive et bientôt cordiale. Le lecteur ignore cette importance et cet intérêt parfois subjectifs, si l’auteur ne lui révèle un peu de son âme et ne l’amène sinon à partager, du moins à comprendre les raisons de son étude. La préface laisse entrevoir les traits généraux de l’auteur et du livre, comme les yeux laissent deviner l’âme. Les Écoles, l’éternel problème, l’Orient, la plus fascinatrice des terres, le IVe siècle, un des plus curieux, un des plus étranges de l’histoire et le plus semblable au nôtre à bien des points de vue : ne sont-ce pas là des sujets susceptibles du plus grand intérêt pour notre génération curieuse d’histoire ? § I. Les ÉcolesQuelle place immense la question de renseignement a tenue depuis trente ans dans les préoccupations de tous ! Que de discussions, de conflits, d’efforts vigoureux, de résistances passionnées ! Quel ébranlement a causé le heurt du droit des familles, de l’Etat, des religions ! Des esprits distingués et subtils sont venus dans un esprit de pacification, tenter de neutraliser l’instruction et le savoir, de confondre avec eux l’éducation et le bien vivre ! Instruire c’est moraliser, disaient-ils. Leur désir de paix a été méconnu, et la guerre la plus acharnée en est résultée. Maintenant que le calme s’est fait, après quelques années d’expérience sortent de tous les rangs des aveux d’erreur auxquels se mêlent certaines inquiétudes, certaines hésitations légitimes chez ceux qui se soucient de la grandeur du pays et de son avenir. Lors de ces grandes tentatives qui, inachevées à l’heure actuelle, laissent sur la question de l’enseignement planer de redoutables incertitudes, nous avons entendu renouveler les théories de Sparte, l’enfant appartient à l’Etat théories toutes locales, peu conformes au libéralisme de toute l’antiquité. Nous avons vu aussi dans l’incessant remaniement de nos programmes un esprit utilitaire inconnu jusqu’à notre temps combattre l’éducation traditionnelle, essayer de détourner des sources où ont puisé tous les fils glorieux de la civilisation moderne et contemporaine, tenter d’éteindre le flambeau nourri de la sève de Rome et d’Athènes et que se passaient nos générations de penseurs et de poètes, d’orateurs et d’artistes. Peut-être tout cela vient-il de ce qu’on s’est trop soucié de réaliser les conclusions, en apparence logiques, d’une philosophie encore mal fixée, ou les exigences d’une lutte politique nécessaire, sans tenir compte suffisant des leçons de l’histoire. La pédagogie, le mécanisme de l’enseignement est en progrès et compte des maîtres éminents et des travaux de haute valeur ; on n’en peut dire autant de l’histoire des principes qui dominent dans la création des écoles, de l’âme de l’enseignement, de ce qui constitue sa vie intime et son influence féconde. Voici qu’à la fin du monde ancien, à l’heure où sur ses ruines va paraître le monde nouveau, dans ce lointain, perspective nécessaire de l’histoire, la question de l’enseignement agite aussi les esprits, soulevant les problèmes toujours les mêmes : h qui appartient l’enfant ? quel est le rôle de l’Etat ? quelle doit être l’influence religieuse ? quelle attitude l’Eglise chrétienne qui est au pouvoir maintenant, va-t elle prendre en face des écoles dont les programmes, les traditions, les maîtres sont païens ? comment se mêlent alors l’instruction et l’éducation ? quels y sont les éléments éducateurs, la situation du savoir ? On devine l’intérêt puissant de cette page historique, les salutaires leçons qu’on y peut puiser. En même temps, la question des programmes, les habitudes de la jeunesse, l’action des maîtres, leur influence, les tendances intellectuelles, ne laisseront pas indifférents les amis du savoir et des lettres. § II. L’Orient. Antioche.J’ai placé en Orient, à Antioche, mon centre d’études. Personne n’ignore l’action constante de l’Orient sur le monde civilisé, l’attrait qu’il exerce en particulier sur notre génération. Depuis l’heure de l’Eden jusqu’à nos jours, que de pages importantes de l’histoire du monde se sont écrites là ; pages d’un rayonnement toujours si intense que nombre d’autres peuples s’agitaient autour des événements survenus en cette nationalité mal définie. Là l’humanité persiste, à placer les premières frondaisons de la nature, les premiers éveils de l’esprit, les premières joies de l’amour ; pays de lumière et de fleurs. Les grandes étapes de l’humanité jusqu’à notre ère y sont marquées : la guerre de Troie, les guerres Médiques, la marche gigantesque d’Alexandre, le règne des Séleucides, le dernier fleuron que Rome ajoute à sa couronne de conquérante. Alors, dans son rôle effacée de sujette, elle exerce une influence prépondérante, et reproduit le triomphe de la Grèce vaincue : Omphale séductrice, elle amène à ses pieds dans la servitude de tous les plaisirs le puissant Hercule romain. En Orient naît l’hellénisme séducteur, resplendit et agit la culture intellectuelle ; en lui semble être revenue la sève ; de lui sortent les souffles nouveaux et ses influences s’exercent sur tout l’empire. A l’heure où Rome succombe sous l’inondation des Barbares[1] l’Orient subsiste affaibli, menacé, épuisé, comme une mère par ses gestations répétées. L’œuvre de Mahomet est un de ces retours de vie par lesquels l’Orient nous surprend et nous séduit. C’est là encore que l’Occident ira dans une volonté de conquête briser ses forces, fusionner ses castes, mêler ses nationalités, et, résultat plus important que les acquisitions, industrielles et commerciales, rendre possible l’éclosion des libertés, la ruine des féodalités. Enfin à l’heure de la chute de Constantinople, la ville dépositaire des trésors et des influences de l’Orient, voici qu’à nouveau dans le monde européen civilisé, semblable à celle qui suivit la conquête de la Grèce et de l’Asie, une envahissante sève intellectuelle se manifeste. — Le tronc déjà vieux de huit siècles n’a ni la vigueur, ni la floraison de la jeunesse. Mais de l’Orient viennent les vieux maîtres dont l’Occident jusque là n’avait guère connu que les noms, et quelques rares vestiges, et de son sommeil hivernal le vieux tronc européen s’éveille, le souffle vivifiant et printanier passe, les branches puissantes grandissent, et portent, dans une éclosion rapide, feuilles de printemps et fleurs d’été... La silencieuse terre d’Europe retentit d’accents dont on la croyait incapable... Art, musique, sculpture, peinture et les cathédrales et les épopées paraissent : c’est le siècle des Médicis, c’est le siècle de Louis XIV. Plus durables et plus précieux sont confiés à notre terre les germes du renouveau politique et social dont la lente croissance laisse espérer les fruits de justice et de liberté que le monde attend. Les violentes poussées de sève qu’on nomme la Réforme, la Révolution, ne seront pas les seules. Maintenant, d’année en année, se réveille plus aiguë que jamais la question d’Orient, de minime importance en apparence, mais peut être d’un intérêt suprême pour les générations qui viennent. A toutes les grandes heures de l’histoire, l’Orient pose quelque problème et exerce son influence. C’est pour cela qu’instinctivement notre génération va vers ce monde : le riche curieux y porte volontiers ses pas, les voyageurs y passent recueillant les leçons de l’histoire, l’archéologue y fouille plus profondément que le laboureur de Virgile dans ces champs, vaste plaine muette, et . . . .
. . . . . . sur le sillon courbé Trouve
un noir javelot qu’il croit des cieux tombé ; Puis
heurte pêle-mêle au fond du sol qu’il fouille Casques
vides, vieux dards qu’amalgame la rouille, Et
rouvrant des tombeaux pleins de débris humains Pâlit de la grandeur des ossements[2]... souvenirs d’Hector et d’Antiochus, de Cléopâtre et de Zénobie. Le penseur y va méditer sur les ruines ; l’amateur de la nature et de ses sensations intenses va remplir son oreille des voix du désert et ses yeux de son soleil pour en chant rythmé ou non nous charmer du poème qu’il en rapporte. Le fils de la vieille foi d’Abraham, de David, d’Isaïe, des Macchabées vient là resuivre les sentiers des ancêtres et redire avec les prophètes les malheurs de Sion ; le fils de l’Evangile y chante les victoires de son Christ : Crèche, Thabor et Golgotha ; l’incrédule lui-même y vient chercher dans son cadre l’histoire des religions, l’artiste en emporte des pages merveilleuses de pittoresque et de lumière. Antioche n’a pas toutes ces splendeurs, n’excite pas ces multiples curiosités. Au point de vue spécial et à l’époque qui nous occupent, elle est la plus intéressante. Rome est silencieuse depuis le départ de l’Empereur ; Alexandrie laisse échapper son sceptre intellectuel dans les ardeurs des luttes religieuses ; Constantinople est une ville de légistes et de guerriers où les jeux de l’amphithéâtre ont plus de fidèles que les exercices d’éloquence ; Athènes n’offre plus rien d’illustre que des noms, c’est la peau d’une victime qui témoigne que l’animal a vécu... Autrefois réputée pour ses philosophes, elle ne l’est aujourd’hui que pour ses fabricants de miel[3]. Antioche, grâce au séjour des empereurs, à son célèbre orateur Chrysostome et surtout à son illustre rhéteur Libanius, garde son prestige. Constantinople peut l’emporter par ses théâtres et ses plaisirs ; Antioche l’emporte par l’éclat de ses écoles[4]. Elle avait eu son grand rôle après Alexandre sous les Séleucides ; elle exerce une suprême prépondérance sous les successeurs d’Auguste. Elle est avec Jérusalem, Troie, Palmyre, Alexandrie, la ville auprès de laquelle l’historien ne peut passer indifférent. Hélas ! parce que l’Antioche d’autrefois n’eut pas la délicate beauté d’Athènes, ne fut pas chantée par la lyre géniale d’Homère, ne connut pas l’heure éblouissante de Palmyre et de Babylone ; parce que l’Antakieh d’aujourd’hui n’a rien gardé pas même la sublime mélancolie des ruines, et qu’au bord de l’Oronte demi-desséché s’est assise la peste, alors qu’un peuple de miséreux s’abrite sous ses toits, ni le voyageur, ni le poète, ni l’historien, oublieux ou dédaigneux de ses dix-huit siècles d’histoire glorieuse et féconde, ne s’y arrêtent. Elle est oubliée dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, à peine mentionnée dans les Relations des derniers voyages en Syrie. Il ne m’a pas déplu de m’intéresser à celle qu’on ignore et qu’on dédaigne, sous les auspices d’un grand méconnu, Libanius[5]. J’aurais aimé faire revivre cette Antioche telle qu’elle était sous Constantin, Julien, Théodose, alors que Libanius l’enthousiasmait dans l’école et Chrysostome dans le temple, à cette heure où Julien la raillait, où Théodose lui pardonnait, où les bois de Daphné n’avaient pas perdu leurs charmes, ni les monts du Piérus les agrestes ermitages des solitaires alors que assise en ses jardins de roses, Antioche la belle, ville des plus délicats plaisirs, regardait passer les flots d’or de l’Oronte. Les circonstances ont restreint mon étude et ce sont ses écoles, le plus beau rayon de sa gloire, qui ont retenu mon esprit. Les œuvres de Libanius qui, pendant un demi-siècle, enseigne en cette Antioche où il est né, sont la base de ce travail. Le lecteur comprendra que sous peine de laisser dans une imperfection regrettable cette étude, j’ai dû, ou puiser des renseignements chez des auteurs qui ne sont pas de la ville, ou leur demander la confirmation de ceux que j’y avais trouvés. On me pardonnera d’avoir voulu donner le caractère exact et complet de ces grandes écoles et autant que possible l’état du savoir dans l’Orient grec au IVe siècle. J’ai même sur nombre de points touchant le régime, les programmes, donné quelques brèves notions rétrospectives, soit qu’elles fussent nécessaires pour une intelligence plus exacte de mon travail, soit que n’ayant point trouvé ce point traité parles contemporains, j’ai pensé être agréable au lecteur en lui soumettant des faits qui lui sont peut être inconnus, des idées qu’il n’a pas entendu émettre encore. Je me rends compte de l’imperfection de ce travail, mais disposé à bien accueillir la critique sérieuse, je suis h un âge où l’on croit à l’indulgence. § III. Le IVe siècle.L’époque ne me parait ni moins intéressante, ni moins inconnue que la ville. Je n’ignore pas que, sur quelques points, des pages savantes ou dramatiques ne soient sorties de main d’ouvrier, mais ce sont des traits pris çà et là, des esquisses de figures qui s’imposent au regard. Sauf l’ouvrage de M. de Broglie, si remarquable mais incomplet et déjà vieilli, il n’y a pas d’étude générale sur ce siècle[6]. De plus c’est la partie la plus historique, le mouvement des idées qui a été la plus délaissée. Il est vrai que d’excellents esprits de notre temps se sont tournés avec curiosité vers cette période et des travaux vraiment nouveaux par la conception promettent une large moisson historique. Cependant, Français ou Allemands, tous se laissent attirer par la partie latine et abandonnent volontiers l’Orient à qui voudra. Sur celui-ci auquel j’essaie peut-être audacieusement de toucher, rien de nouveau n’a été dit : j’excepte l’étude érudite de Sievers sur Libanius[7] et celle de M. Petit de Julleville, digne de ce maître, sur Athènes[8]. M. Gaston Boissier a demandé aux auteurs latine leurs révélations sur les dernières luttes religieuses eu Occident[9] ; il s’y est renfermé ; nous ne nous en plaignons pas puisqu’il y a acquis une remarquable maîtrise. M. Moureaux essaie de compenser par le charme la profondeur d’érudition de son modèle et nous conduit agréablement chez les Africains[10]. Ebert et Denk nous offrent le multiple mais indigeste savoir allemand : Denk, nous donne la première histoire vraiment critique de nos écoles gauloises à cette époque[11]. Je ne doute pas que ces maîtres n’aient éprouvé comme moi le regret de ne pouvoir étudier que sous un jour restreint ces choses si intéressantes alors : idées, écoles, littérature, religions ; de ne pouvoir pas, dans l’union qui leur est naturelle, en Orient et en Occident à la fois, scruter les multiples éléments qui constituent la vie de l’époque, fruits du passé et germes d’avenir. Quand d’autres seront venus apporter laborieusement quelques pierres nouvelles, peut-être pourra-t-on tenter la reconstitution importante de l’âme de cette époque, de sa vie intime, celle qui est la mère des vrais progrès. Au reste, dit M. Guizot, ces époques de transition sont d’une grande importance et peut-être les plus instructives de toutes. Ce sont les seules où paraissent rapprochés et en présence certains faits, certains états de l’homme et du monde qui ne se montrent ordinairement qu’isolés et séparés par des siècles ; les seules par conséquent où il soit facile de les comparer, de les expliquer, de les lier entre eux. L’esprit humain n’est que trop disposé à marcher dans une seule route à ne voir les choses que sous un aspect partiel, étroit, exclusif, à se mettre lui-même en prison ; c’est donc pour lui une bonne fortune que d’être contraint par la nature même du spectacle placé sous ses yeux, à porter de tous côtés sa vue, à embrasser un vaste horizon, à contempler un grand nombre d’objets différents à étudier les grands problèmes du monde sous toutes leurs faces et dans leurs diverses solutions[12]. A quelle époque cette page s’applique-t-elle plus justement qu’au IVe siècle ? Il semble une énigme obscure, un chaos grandiose et lorsqu’on tente de pénétrer ses institutions et ses hommes, on retrouve en eux les mêmes traits incertains et confus. Cela peut légitimer dans une certaine mesure la note de décadence dont on l’a marqué, pourvu qu’on ne l’identifie pas avec celle du Bas-Empire. Ne confondons pas le temps d’hiver avec la saison des semailles... la plaine a perdu son charme d’été je le veux, mais malgré le/heurt des sillons et les cris du labeur, il y a une bonne odeur de fécondité et des chants d’espérance... Telle IVe siècle. Et quels ouvriers ! Quels semeurs ! Les fils de l’Evangile nouveau et ceux de l’antique culte : à l’Occident, la voix railleuse de Jérôme, le ferme et clair génie d’Hilaire et d’Ambroise, le sceptique Ausone, l’éloquent Symmaque. En Orient, les derniers maîtres d’Athènes, fils dégénérés de pères glorieux ; les maîtres de l’Orient grec, Himerius, Themistius, Libanius, esprits souples, charmants, dignes de l’âge d’or de la pensée et de Fart, avec auprès d’eux Chrysostome, l’apôtre qui ignore la politique mais sait la charité, Basile, l’éloquent ami de Libanius, les Grégoire, à lame poétique et sensible. Constantin, Julien, Théodose ! Ces trois grandes figures d’empereurs suffiraient pour donner au siècle une place dans l’histoire. Semblables à lui par la complexité de leur nature et l’apparente contradiction de leurs actes, ils semblent de ces figures qu’on ne peut définitivement fixer. La politique, la religion, la psychologie ont pu jusqu’ici apporter et établir sur eux les conclusions les plus opposées. Auprès d’eux, la vie religieuse parait lumineuse. Cependant, quelle confusion de hiérarchie, quelle instabilité de doctrine, quel mélange de christianisme et de paganisme ! Peu de place pour l’impiété, mais place immense pour l’occultisme et le mysticisme... Des conflits violents entre évêques : la calomnie coûte peu. Des mœurs qui, dans une Eglise encore informe, appellent déjà une réforme. Une activité étrange pour l’apostolat, les fondations charitables, les discussions interminables sur les dogmes, et auprès la non moins étrange apathie des moines de l’Amanus. Du peuple, de l’immense légion d’esclaves, personne ne se soucie ; personne ne songe à relever quelques traits de leur situation inique. C’est l’heure de la grande lutte entre Rome et les Barbares ; mais combien plus intéressante, plus l. importante, la lutte, pacifique souvent, violente parfois, toujours féconde des idées, celle dont vivent ou meurent les institutions et les nations, et dont l’humanité s’enrichit toujours. C’est celle-là qu’il faudrait analyser et décrire : le conflit du paganisme et du christianisme avec leurs mille nuances, celui de la langue grecque et de la langue latine, du droit contre la rhétorique, la guerre entre le principe de municipalité et le principe de centralisation, cette lutte intime de tous les éléments de la civilisation humaine, et ce départage entre ceux qui doivent disparaître, ceux qui doivent se transformer, ceux qui doivent régner demain encore et pour cela lutter avec l’âpre barbarie qui vient. Il semble ainsi qu’aux heures décisives l’humanité, comme Gédéon éprouvait ses hommes, éprouve ses idées et marche ! Le théâtre, c’est le monde civilisé tout entier ; le cadre, ces masses au grossier langage, aux mœurs étranges qui de la mer du Nord à Constantinople sont aux frontières, comme y sont à l’Orient, les Perses au nom glorieux. Et dans le lointain, qui prête l’oreille entend la cavalcade bruyante, désordonnée, qui a pour avant-garde l’épouvante, et pour arrière-garde le deuil et les ruines : ce sont les hordes d’Attila, de Genséric, les fossoyeurs de l’Ancien Monde. Il faudrait, pour parler dignement de ce siècle, manier le burin de Tacite, la plume de Montesquieu, la lyre d’Hérodote ; savoir comme le sage de Lucrèce en sa tour, impassible devant les flots soulevés, discerner les courants et les souffles, ceux d’hier et ceux de demain, ceux de Rome, d’Athènes, d’Antioche, d’Alexandrie, et ceux de Jérusalem, ceux des peuples neufs et rudes et ceux des peuples polis mais vieillis, les décrire, mieux encore les chanter. La reconnaissance a dicté cette longue préface. Je croirai avoir assez fait si j’ai attiré quelque regard curieux sur Antioche, inspiré quelque désir de s’initier à ce siècle encore mal connu. J’aime cette œuvre où j’ai trouvé les surprises de l’imprévu et de l’inconnu, les grandes joies des lettres si douces et si précieuses. Dérivatif en des heures amères, refuge et consolation, ce travail me fut un doux compagnon dont je ne me sépare qu’à regret et qu’accompagnent mes vœux inquiets. Æthereas,
lascive, cupis volitare per auras I, fuge, sed poteras tutior esse domi[13]. Ardon-sous-Laon, Septembre 1891. |