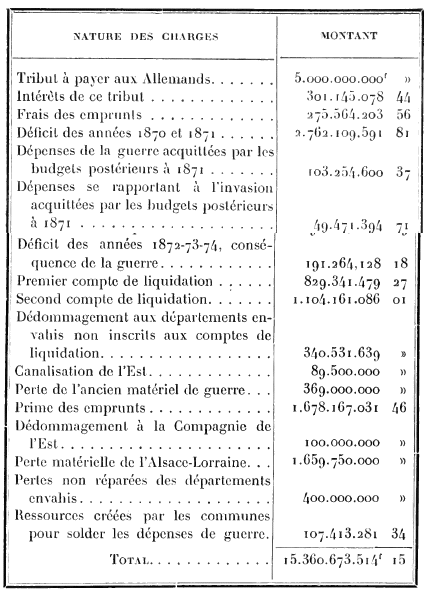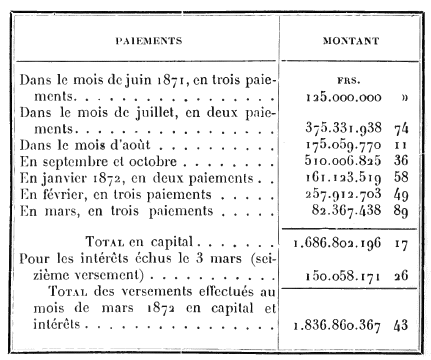HISTOIRE DE LA FRANCE CONTEMPORAINE (1871-1900)
I. — LE GOUVERNEMENT DE M. THIERS
CHAPITRE VI. — VERS LA LIBÉRATION.
|
Bilan général de la guerre. — L'emprunt de deux milliards. — Premiers paiements de l'indemnité de guerre. — M. Pouyer-Quertier à Berlin. — Les conventions du 12 octobre 1871. — Commencement de l'évacuation des troupes allemandes. — Discussion et vote des nouveaux impôts. — Les élections aux conseils généraux, du 8 octobre 1871. — La politique de M. de Bismarck ; rapprochement de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. — Les entrevues d'Ischl, de Gastein et de Salzbourg, entre les deux empereurs d'Autriche et d'Allemagne. I Il ne suffisait pas que le sang eût coulé, il ne suffisait pas que le territoire fût démembré et que la famille Mt dispersée : il fallait, maintenant, que la vieille loi germanique s'appliquât dans sa rigueur et que le wehrgeld fût payé. La richesse représente l'accumulation des efforts humains : il fallait que cette riche France fût frappée dans son épargne, c'est-à-dire dans son passé, et que, par l'emprunt, elle engageât son avenir. Le vainqueur prétendait perpétuer sa victoire dans l'accablement du vaincu. Le conflit qui avait ébranlé l'Europe allait donc se terminer par un débat d'affaires. Ces autres manieurs d'hommes, les rois de l'argent, entraient en scène. M. de Bismarck, lui-même, au cours de la négociation de Versailles, les avait introduits. Il avait présenté, à M. Thiers et à M. Favre, MM. Bleichrœder et de Henckel : Deux de nos financiers considérables, avait-il dit, ont étudié une combinaison, moyennant laquelle ce tribut si lourd en apparence (il s'agissait alors de six milliards) sera payé par vous sans que vous vous en aperceviez. Si leur concours est agréé par vous, nous aurons déjà résolu une grosse question ; les autres le seront sans peine. Grande avait été la surprise, et non moins grand le mécontentement de M. de Bismarck, quand les plénipotentiaires français crurent devoir décliner ces offres si obligeantes[1]. M. Thiers comptait sur la France, sur las ressources d'un pays qu'il connaissait mieux que personne. Ajoutons qu'il se fiait, avec une assurance singulière, à sa. propre habileté, à sa compétence, à ses lumières. S'il consultait les financiers français, il les étonnait eux-mêmes par la rapidité de ses conceptions et la sûreté de son jugement. Homme d'affaires, plus encore qu'homme d'État, il connaissait la force de résistance des populations françaises ; jamais son optimisme entêté ne fut mieux fondé et plus secourable au pays. Parmi ces graves préoccupations financières, la libération, si urgente pourtant, ne venait, elle-même, qu'en seconde ligne. Avant tout, il fallait faire face aux dépenses engagées pendant la guerre, et la première opération était la liquidation. Personne ne pouvait savoir ce que la guerre avait coûté : les dépenses de l'empire, les dépenses de la Défense nationale, les dépenses de la Commune, c'était un gouffre où l'on pouvait désespérer, en vérité, de faire jamais la lumière. Pendant près d'une année, sur toute l'étendue du territoire, des millions d'hommes avaient vécu, s'étaient dépensés et avaient dépensé pour la cause publique ; pendant ce temps, tout le monde avait, peu ou prou, réquisitionné, au nom de la France, au nom de la Prusse, au nom de la Commune. Au fort de la crise, le 19 décembre 1870, M. Laurier télégraphiait à M. Gambetta : La question financière acquiert un degré de gravité extraordinaire. J'ai vu M. de Roussy — le directeur général de la comptabilité publique — absolument désespéré... Et M. Gambetta télégraphiait le 23 décembre : Je suis résolu à tout. Nous briserons la Banque, s'il le faut, et nous émettrons du papier d'État... M. de Freycinet, élevé cependant dans les pratiques minutieuses de l'administration, approuvait : Je reçois à l'instant vos dépêches sur les finances. A la bonne heure ! voilà du bon Gambetta !... Et M. Laurier, à son tour, à la même date : Il faut créer l'abondance. Le salut est là. Si la Banque ne cède pas, nous passerons outre... Je ferai approuver mon projet de milliard que je tiendrai tout prêt[2]... On n'en était pas venu jusqu'aux mesures révolutionnaires. La Banque s'était inclinée devant la nécessité suprême qu'invoquaient les chefs de la Défense. Elle avait fait les avances réclamées. On avait vécu. Mais, au moment où la guerre s'achevait, le trésor était vide et l'immense passé, confus, encombrait les voies de la liquidation et du crédit. Il fallut faire une première ventilation et aviser au plus pressé. M. Thiers s'y employa. Il fut singulièrement secondé dans cette tache par son ministre des finances, M. Pouyer-Quertier, dont le calme, la bonne humeur, le sens pratique lui furent d'un secours continuel. Cependant, M. Pouyer-Quertier lui-même, tour à tour confiant à l'excès et inquiet sans motifs, ressentait, à ses heures, un trouble et une hésitation, que, parfois même, il communiquait à M. Thiers[3]. Ils furent aidés, aussi, par l'active collaboration de l'administration des finances, dont les chefs et, notamment M. Dutilleul, directeur du mouvement des fonds, consacrèrent un dévouement anonyme et insuffisamment reconnu, à préparer les éléments de la vaste enquête d'après laquelle les hommes d'État eurent à se prononcer. On ne peut que résumer ces travaux, qui, si on les considérait dans leur ensemble, apparaitraient comme un monument de la science financière au XIXe siècle. Les charges créées par la guerre se décomposaient ainsi : 1° Les dépenses militaires proprement dites, c'est-à-dire les sommes payées pour l'entretien, l'armement et les besoins des armées françaises ; les sommes payées à l'Allemagne pour l'indemnité de guerre, pour l'entretien de ses troupes, ainsi que les sommes représentant les frais que ces deux sources de dépenses ont occasionnés ; 2° Les frais d'emprunt et les primes allouées aux porteurs des titres émis pour ceux-ci ; 3° Les dépenses de travaux publics et autres, effectuées pour la réparation des dégâts et destructions de toute nature et pour dédommagements divers ; 4° Les sommes payées aux départements, aux communes et aux particuliers, victimes de dommages provenant du fait de la guerre ; 5° Les pertes subies par l'État, en dehors des sommes payées par le trésor ; 6° Les dommages éprouvés par les communes et les particuliers et non réparés par l'État. Une récapitulation fournit les chiffres suivants[4] :
A ce total, il convient d'ajouter les dommages causés par l'insurrection de Paris et qui comprennent : les indemnités allouées aux habitants et celles payées aux compagnies de chemin de fer ; la dépense pour la reconstruction de l'hôtel de M. Thiers et des monuments incendiés ou détruits par la Commune, le Palais-Royal, la bibliothèque du Louvre, le pavillon de Marsan, la colonne Vendôme, le Palais de Justice, la Caisse des dépôts et consignations et le Palais de la Légion d'honneur. Il faut ajouter encore à ce compte : la perle que représentent la destruction du Palais d'Orsay, des Tuileries et de l'Hôtel de Ville ; les frais de reconstitution des actes de l'état civil ; les frais de l'instruction des poursuites contre les insurgés et de la déportation des condamnés ; les sommes saisies chez divers comptables du trésor ; les réquisitions de la Commune à la Banque de France. Sans y comprendre les rentes viagères accordées aux veuves et aux enfants des victimes de l'insurrection, on arrive à un total de 231.794.626 francs. Le bilan général de la guerre et de la Commune se solde donc par une charge de 15.592.468.140 francs. Dans ce chiffre, figure le rétablissement des grandes voies de communication dans la région de l'Est, interceptées par la nouvelle frontière. Les lois du 10 août 1872 et du 24 mars 1874 ont autorisé, dans cette intention, la canalisation de la Moselle ; la canalisation de la Meuse, à partir de la frontière belge et son raccordement avec le canal de la Marne au Rhin vers Oussey ; la jonction de la Meuse à la Moselle et à la Saône, et l'amélioration de la partie du canal de la Marne au Rhin empruntée par la nouvelle voie ; le raccordement du canal du Rhône au Rhin avec le canal de l'Est ; la nouvelle route de Longwy à Pont-à-Mousson. D'autres grands travaux publics ont été également entrepris à la suite de la guerre, notamment pour développer le réseau des chemins de fer et celui des voies navigables. Dans le chiffre total de plus de 15 milliards et demi, ne sont pas comprises les pertes causées à l'agriculture, au commerce et à l'industrie par la suspension des travaux. Il résulte, de ce chef, un préjudice considérable, mais qu'il est impossible d'évaluer. La somme de 15 milliards et demi ne comprend que ce qu'il est possible d'appeler la charge liquide. Il est un autre compte, non moins lourd que les précédents, et qu'il serait non moins difficile de dresser exactement : c'est celui des victimes de la guerre et de la perte en hommes éprouvée par la France. Quelles ont été les conséquences démographiques de l'ensemble des événements ? Les rapports du service de santé de l'armée n'ont pas été fournis pour les années 1870 et 1871. Il faut donc s'en tenir à certaines évaluations de détail. C'est ainsi qu'on estime le nombre des tués à Wissembourg à 230 pour mille pour la division Douai, c'est-à-dire à près d'un quart. A Weerth, les pertes furent de 210 pour mille, soit de plus d'un cinquième. A Metz, sur un effectif de moins de 168 mille hommes, avant la capitulation, on avait perdu 25 généraux, 2.099 officiers et 40.339 hommes ; au total, 42.463 décédés, c'est-à-dire plus d'un quart de l'effectif. Après Sedan, M. L. Créteur dut détruire, par le pétrole, les corps des soldats tués, enterrés dans 1.986 fosses, alors que M. Michel, ingénieur, et M. Drouet employaient d'autres moyens de désinfection pour plus de 879 tumuli et près de 350 fosses contenant plus de dix mille cadavres. Au total, pendant toute la durée de la guerre, d'après un calcul, certainement de beaucoup inférieur à la réalité, il y aurait eu 139.000 morts et 143.000 blessés dans les armées françaises. On évalue, en outre, à 339.421 le nombre des hommes entrés dans les hôpitaux pour maladies diverses[5]. La différence entre les recensements de 1866 et de 1872 donne, d'ailleurs, des indications assez précises. Outre la perte de 1.597.228 habitants résultant de l'annexion de l'Alsace-Lorraine, la population de la France a subi une diminution de 491.915 habitants[6]. En outre, si l'on tient compte que, de 186i à 1866, la population française avait présenté l'accroissement annuel, faible d'ailleurs, de 3G sur dix mille, on peut supposer que, si la France n'avait pas eu subir les désastreux événements de 1870-1871, la population se serait accrue, comme dans la période précédente de 1861-1866, de 130.650 habitants par an, et pour six ans, de 783.900[7]. Ce défaut d'accroissement, joint à la perte absolue de 491.915 habitants, semblerait donc autoriser à attribuer à la guerre, en plus de la perte de la population d'Alsace-Lorraine, un déficit de 1.275.815 habitants. La guerre s'étant entièrement déroulée sur le territoire national, les pertes n'ont pas uniquement, porté sur l'année, mais tous les habitants ont été plus ou moins atteints par les privations et par les maladies. Alors qu'il n'avait été que de 21.656 en 1869, l'excédent des décès masculins sur les décès féminins a été, en 1870, de 59.165 et de 113.456 en 1871, et il porte, pour une grosse part, sur l'âge où, normalement, la mortalité est peu élevée : Au lieu de 34.816 décès de vingt à trente ans en 1869, il y en eut 148.472 en 1871. Au lieu de 52.160 décédés de trente à quarante ans en 1869, on en compta 102.826 en 1871. S'occupant de cette question, la Statistique officielle de la France constate que la mortalité de l'année 1871 dépasse, dans son énormité, tout ce que nous savons des périodes les plus douloureuses de l'histoire. De son côté, M. Levasseur, dans un travail sur la population française, remarque que la guerre franco-allemande fit descendre le taux des mariages et le nombre des naissances au chiffre le plus bas qu'ait vu la France au XIXe siècle. Telles sont, insuffisamment groupées et exposées, les charges infligées à la France par la guerre de 1871 et par ses suites funestes. Telle était la situation en présence de laquelle se trouvaient M. Thiers et ses ministres. Revenons à la question d'argent. Comment la France fit-elle face à la somme énorme qu'elle devait payer dans un si court espace de temps, si elle voulait libérer rapidement son territoire et supprimer la charge qui, du fait de l'occupation, pesait sur elle ? On eût pu admettre le système d'un règlement immédiat, par voie de diminution proportionnelle du capital national. Il pouvait paraître juste que la génération qui avait assumé la responsabilité de la guerre et qui n'avait pas su obtenir la victoire, supportât les charges de la défaite. Dans d'autres pays, et notamment en Angleterre, les dépenses de cette nature sont, dans la mesure du possible, mises à la charge de l'impôt, le principe admis étant que chaque époque doit porter la responsabilité de ses actes. Des sentiments analogues se firent jour en France, après les désastres de 1870-71. On eut l'idée de recourir à une souscription publique volontaire : elle échoua[8]. Des systèmes plus efficaces furent soumis à l'Assemblée nationale. MM. de Carayon-Latour, Philippoteaux, le général Chanzy, demandèrent. que le capital mobilier et immobilier de tous les Français fût frappé d'un impôt extraordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité de cinq milliards. Ils évaluaient le capital de la France à une somme de 100 à 150 milliards : un sacrifice de 3 ½ à 5 pour cent sur la fortune de chacun aurait suffi pour assurer la libération complète de nos charges. On recula devant les difficultés de la perception et devant les conséquences d'un déplacement immédiat et direct de sommes aussi considérables. D'autres propositions, s'inspirant du même esprit, furent écartées, et, après quelque hésitation, on en vint au système de l'emprunt en rentes perpétuelles, système qui grève l'avenir, qui dissimule la charge en la répartissant sous une forme relativement supportable, système qui, tout compte fait, punit l'avenir plus que le présent, surtout s'il n'est pas corrigé par l'organisation d'un puissant et rapide amortissement. M. Thiers et ses conseillers, entraînés par la préoccupation d'agir avec sécurité, avec promptitude et avec éclat, ne crurent même pas devoir s'arrêter à d'autres projets intermédiaires qui furent proposés : soit emprunt sous forme d'émission d'obligations remboursables en quatre-vingt-dix-neuf ans, du type des obligations de chemins de fer, soit emprunt sons forme d'obligations avec primes et lots remboursables en trente-deux ans. (Proposition J. Brame.) Ces combinaisons paraissaient à la fois moins onéreuses et plus sages. Mais eussent-elles donné des résultats complets et prompts ? Sans le concours des grandes maisons de banque, et peut-être avec leur opposition, ces divers procédés eussent-ils assuré immédiatement les sommes considérables dont on avait besoin ? Pour obtenir ces sommes, pour accomplir les grands déplacements d'argent qui allaient se produire, on pensa que le concours des capitalistes de toute l'Europe était nécessaire. On se décida donc à recourir la forme d'emprunt la plus simple et la seule qui soit admise sur toutes les places : l'emprunt public en rentes perpétuelles. D'ailleurs, le principe était adopté. Déjà, le gouvernement impérial avait, par la loi du 12 août 1870 et par le décret du 19 août suivant, ouvert un emprunt en rentes perpétuelles, en vue de faire face aux dépenses de la guerre. Cet emprunt avait produit une première somme de 804.500.000 francs ; pour le service des arrérages, une somme de 39.830.000 francs avait été inscrite au Grand-Livre. Le gouvernement de la Défense nationale, d'autre part, avait contracté, en Angleterre, par voie de souscription en partie publique, par l'intermédiaire dé la maison Morgan et un emprunt de 250 millions de francs, sur lequel il n'avait encaissé, d'ailleurs, que 200 millions. Cet emprunt, négocié à Londres par M. Laurier et M. de Germiny, délégué du conseil des finances, avait été très onéreux. En tenant compte des primes, des escomptes et des avantages divers faits aux intermédiaires et aux souscripteurs, la charge annuelle de l'emprunt ressortait environ à 8 %. Pour les autres dépenses de la guerre, le gouvernement impérial et le gouvernement de la Défense nationale avaient emprunté à la Banque de France, jusqu'à concurrence de 895 millions. Le gouvernement de M. Thiers, à son tour, vivant aussi au jour le jour, alimentait le trésor par des emprunts faits à la Banque et dont le total (y compris les emprunts des deux gouvernements antérieurs) devait monter, au 31 décembre 1871, à la somme de un milliard 485 millions. La Banque prêtait, d'abord, au taux de 3 %, taux qui, sur les observations très judicieuses de M. Henri Germain, fut ramené à 1 %. On avait atteint la limite de ce qu'on pouvait demander au grand établissement national de crédit. Il fallait liquider cette situation. La Banque fut autorisée à étendre son émission fiduciaire de 2 milliards 400 millions à 2 milliards 800 millions. Cependant, il y avait lieu de faire face aux échéances nouvelles. Ainsi, de partout, M. Thiers était amené à l'urgente nécessité d'un emprunt. Le 6 juin 1871, le gouvernement déposa, sur le bureau de l'Assemblée, une demande d'autorisation pour un emprunt de 2 milliards 5oo millions qu'il ramena bientôt à une somme de 2 milliards. L'Assemblée résolut de laisser toute latitude au gouvernement eu ce qui concernait les modalités de l'opération. M. Thiers présenta lui-même l'exposé des conditions, dans un discours qu'il prononça, le 20 juif' 1871. Après une discussion assez vive, la loi fut votée, à l'unanimité de 547 votants. Par un arrêté du chef du pouvoir exécutif, daté du 23 juin, il fut décidé que les rentes seraient émises, le 27 juin suivant, à 82 fr. 50. Tout était à improviser... On installa hâtivement la direction du mouvement des fonds au Louvre, et les guichets de souscription au Palais de l'Industrie. Les bureaux des finances campèrent. Le 26, on était prêt, tant bien que mal, et, dès le 27 au matin, les souscripteurs affluèrent aux guichets[9]. Le nombre des souscripteurs fut de 331.906. Le capital souscrit s'éleva à 4 milliards 897 millions ; il fut réduit à 2 milliards 225 millions. Les arrérages annuels à la charge du budget étaient de 134 millions 968.730 francs, ce qui représente 6,06 pour cent du produit brut de l'emprunt. Le gouvernement, en choisissant le type de 5 %, réservait, pour l'avenir, la possibilité de la conversion. Mais le capital nominal, — c'est-à-dire celui qui serait dû aux créanciers, au cas où le gouvernement opérerait le remboursement de la dette, — était de 2 milliards 698 millions de francs. En somme, l'emprunt était onéreux. Tout le monde est d'accord pour penser que le crédit de la France lui eût permis, même alors, d'obtenir les sommes nécessaires, à des conditions plus avantageuses, peut-être au cours de 87 ou de 88 francs. Mais, encore une fois, le gouvernement ne voulait, à aucun prix, courir le risque d'un échec. Ayant besoin de tous les concours, il consentit à les rémunérer largement. Le résultat de ce premier emprunt fut accueilli avec joie. Il donnait au pays le sentiment de son crédit, sinon de sa fortune. La déclaration de M. Pouyer-Quertier annonçant le résultat de l'émission fut accueillie, par l'Assemblée, aux cris de : Vive la France ! On pensa généralement, au dire de M. Mathieu-Bodet, que la souscription, qui atteignit près de 5 milliards, produirait, pour le crédit et le relèvement de la France, un effet heureux qui compensait largement la perte de capital dont le trésor avait dû faire le sacrifice. Le gouvernement s'étant assuré, dès lors, les sommes nécessaires pour les premiers versements de l'indemnité, il fallait procéder a une autre opération, non moins importante et en tout cas plus compliquée, celle qui consistait à transporter, des caisses françaises dans les caisses allemandes, les sommes qui allaient constituer les différents versements. Elle était des plus difficiles. Il ne manqua pas, en France, à l'étranger, voire même en Allemagne, d'économistes ou de financiers qui jugèrent impossible d'acquitter, à bref délai, une dette pareille. Un professeur d'économie politique à l'université de Berlin, M. Ad. Wagner, après avoir évalué les dépenses de l'Allemagne, dans la guerre de 1870-1871, à un milliard 500 millions, s'exprime ainsi, à propos du chiffre de l'indemnité de guerre fixé par les préliminaires de paix : La contribution frappée devait, par son énormité, exercer une pression sur les finances et sur l'économie entière de la France ; elle appliquait à ce pays la peine d'une confiscation partielle des ressources nationales[10]. La rigueur de ces dispositions se trouvait singulièrement accrue par les conditions du paiement, telles qu'elles avaient été stipulées par la paix de Francfort. M. de Bismarck, fâché, peut-être, que l'on n'eût pas accueilli l'intermédiaire onéreux des banquiers allemands, avait exigé que les paiements fussent tous effectués dans les principales villes de commerce de l'Allemagne, exclusivement en métal, or ou argent, en billets des Banques d'Angleterre, de Prusse, des Pays-Bas, de Belgique (à l'exclusion des billets de la Banque de France), en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre, valeur comptant, acceptés par les experts allemands. Il y avait donc à accomplir une immense opération de change qui devait compliquer singulièrement l'opération même du versement. Il fut convenu que toutes les sommes seraient centralisées à Strasbourg. Pour donner une idée de la complication matérielle du travail, il suffit de dire que l'on ne pouvait compter, en numéraire, plus de 800.000 francs par jour. En outre, on devait rencontrer les plus minutieuses exigences dans l'examen des valeurs offertes par le trésor français. M. Thiers s'explique, d'ailleurs, en termes lumineux, dans l'exposé qu'il fit à l'Assemblée nationale, en septembre 1871 : Savez-vous où est la difficulté de l'opération ? Elle est dans le transport de ces valeurs énormes hors de Paris. Si nous voulions les transporter en numéraire, — nous avons à la Banque 600 ou 700 millions de numéraire, — nous produirions, sur-le-champ, une crise monétaire effroyable. Nous ne pouvons les transporter en marchandises ; cela ne dépend pas de nous ; nous ne faisons pas le commerce. Nous ne pouvons nous servir que des résultats du commerce, de ce qu'on appelle des traites de place à place. Or, ces traites représentent, quoi ? Le commerce réel. Nous vendons aux Allemands ; ils nous vendent à nous ; nous vendons aux Anglais ; ils nous vendent à nous ; et le papier qu'on appelle traites et qui sert à porter les valeurs d'un pays dans un autre doit reposer sur un commerce réel et sérieux. Croyez-vous que nous avons, avec l'Allemagne, un commerce baisant pour trouver ou 15 cents millions de traites ? Non ; nous nous servons du crédit, et non seulement du crédit qui repose sur le commerce de la France avec l'Allemagne ; mais nous avons été obligés de nous servir du crédit, par exemple, de la France sur l'Angleterre et de l'Angleterre sur l'Allemagne. Nous trouvons du papier sur Londres pour trouver à Londres du papier sur Berlin. On le voit : les institutions financières de la France eussent difficilement suffi. Il fallait élargir la base de l'affaire et y faire concourir, en réalité, toute la banque européenne. C'est pourquoi il avait été fait si largement appel aux capitalistes étrangers. On établit, en outre, sur les principales places de l'Europe, et notamment à Londres, des agences spéciales chargées de raccoler, comme on l'a dit, tout le papier de commerce qui pouvait entrer en ligne de compte dans les versements à faire à l'Allemagne. On procéda, pendant deux ans, à une sorte de mobilisation de toute l'activité banquière de l'Europe. Les avantages accordés de ce chef aux grandes maisons européennes furent considérables. Mais, par contre, elles contribuèrent largement au succès des emprunts émis par le gouvernement de M. Thiers : leur concours, assuré de fortes primes, permit de faire face, avec une rapidité et une sécurité sans exemple, aux engagements si rigoureux que les négociateurs de ]a paix de Francfort, avaient dû prendre. Nous donnerons, en exposant la fin de l'opération, un tableau complet des valeurs de toute nature qui furent centralisées pour l'accomplir. Il suffit de mentionner, dès maintenant, l'incroyable surcroit d'activité et de travail qu'elle imposait, au gouvernement, parmi tant d'autres soucis dont il était alors accablé. Les versements s'opérèrent avec une régularité qui surprit d'abord et, bientôt, inquiéta les vainqueurs. Les dates des échéances avaient été fixées dans les conditions suivantes par le traité de paix définitif : 5oo millions dans les trente jours après le rétablissement de l'autorité du gouvernement français dans la ville de Paris ; un milliard dans le courant de 1871, et un demi-milliard le 1er mai 1872 ; les trois derniers milliards le 2 mars 1874. Les intérêts des trois derniers milliards, fixés à 5 %, étaient exigibles, le 3 mars de chaque année. Les frais d'alimentation des troupes étrangères étaient à la charge de la France. Par contre, il était convenu que l'occupation serait limitée à six départements de l'Est, lorsque les deux premiers milliards auraient été versés et que l'armée allemande serait alors réduite à 50.000 hommes. Dès le mois de juin 1871, M. Thiers se déclara en mesure de payer 500 millions. Cinq versements, en effet, atteignant cette somme, eurent lieu à Strasbourg du juin au 31 juillet. Jusque dans le détail, on rencontra, de la part de l'Allemagne, la rigueur la plus extrême. On discuta longtemps sur les modalités du comptage. Il fallut, plusieurs fois, l'intervention du général de Manteuffel et même de l'empereur Guillaume, pour que l'évacuation se réalisait conformément aux engagements. Cependant, à partir du 22 juillet, l'armée allemande commence le mouvement de retraite qui devait libérer le sol national. Les départements de la Normandie furent évacués d'abord. A la fin de septembre 1871, un milliard 500 millions étaient soldés, et douze départements seulement restaient occupés, sur lesquels six devaient être libérés par le paiement du quatrième demi-milliard et six devaient rester aux mains de l'Allemagne jusqu'à l'acquittement complet de la dette. M. Thiers offrit d'anticiper sur le paiement suivant, en réclamant, par contre, l'évacuation clos forts de Paris, des départements de la Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et de l'Oise. M. Pouyer-Quertier prépara même, à ce sujet, 'a Compiègne, avec le général de Manteuffel, une convention soumise il ratification (premiers jours d'août 1871). Mais la colère de M. de Bismarck rompit cette sage combinaison. C'est à cette occasion que le chancelier eut, le 12 août, avec M. de Gabriac, l'entretien, si plein de méfiance hautaine, que nous avons rapporté ci-dessus. Le général de Manteuffel fut désavoué. On dut donc attendre la bonne volonté de Berlin. D'ailleurs, le stock des lettres de change était épuisé. Un déplacement d'espèces trop considérable provoqua, en octobre, une crise monétaire qui eût pu devenir redoutable[11]. Cependant, l'Allemagne avait, à son tour, besoin de la France. Le régime transitoire accordant aux produits d'Alsace-Lorraine l'entrée en franchise sur le territoire français arrivait à échéance le 21 septembre. L'Allemagne du Sud appréhendait -vivement la concurrence des produits alsaciens. Elle réclamait une prorogation que l'Alsace-Lorraine sollicitait également. M. Thiers, comprenant qu'il pouvait y avoir un certain parti à tirer de cette situation, se décida à envoyer, à Berlin, M. Pouyer-Quertier, ministre des finances, dont M. de Bismarck avait apprécié la compétence et la rondeur. Le général de Manteuffel, averti de cette intention de M. Thiers, ne garda aucune rancune de l'échec récent du projet, de convention de Compiègne. Au contraire, il prit la peine d'indiquer lui-même au négociateur français les précautions à prendre auprès du prince-chancelier. M. de Saint-Vallier écrivait de Compiègne, le 15 août, à M. Thiers : M. de Manteuffel a deux recommandations de la plus haute importance à adresser à M. Pouyer-Quertier, si c'est à Gastein que M. de Bismarck lui donne rendez-vous : c'est de prendre bien garde, au cas où il serait reçu par le roi, de ne rien dire à Sa Majesté, en dehors des choses dont il aurait parlé au chancelier et sur lesquelles il serait d'accord avec lui, de veiller attentivement à ne pas fournir, à ce dernier, un grief de cette nature, car il ne le pardonnerait pas, et son influence sur son souverain est trop solidement établie pour qu'on puisse se flatter d'obtenir du roi une concession qu'aurait refusée le ministre. En second lieu, il faut éviter soigneusement d'aborder plusieurs questions ou des négociations différentes : outre le danger d'offrir quelque échappatoire commode à M. de Bismarck, on risquerait de faire échouer l'affaire qu'il est essentiel de mener aujourd'hui à bonne fin... Ces conseils que M. de Manteuffel donnait à M. Pouyer-Quertier, par l'intermédiaire de M. de Saint-Vallier, se terminaient par cette phrase qui exprimait, en somme, le désir de M. de Bismarck : Vous devez, avant tout, inspirer confiance, et vous y parviendrez en payant vite et beaucoup. A Berlin, W. Pouyer-Quertier sut profiter des indications qui lui avaient été fournies et des bonnes dispositions que lui témoignaient le chancelier et la cour. Ses négociations portèrent sur quatre points principaux : le paiement du quatrième demi-milliard, ayant, pour contrepartie, l'évacuation de six départements français ; la convention douanière relative à l'Alsace-Lorraine ; certains détails de délimitation de la nouvelle frontière, relatifs aux deux villages de Raon et à la région d'Igney et d'Avricourt, et enfin les prix fixés pour l'entretien des troupes allemandes pendant la durée de l'occupation. Il s'explique lui-même, avec une grande clarté, sur les conditions qu'il obtint, après une courte discussion avec M. de Bismarck et M. Delbrück, dans une dépêche télégraphique, datée de Berlin et adressée à M. Thiers, le 13 octobre 1871 : Berlin, le 13 octobre 1871. — Tout est signé, convention financière, convention douanière et territoriale. Conventions du 12 octobre 1871. Cette dernière doit être soumise au parlement et ne pourra être ratifiée qu'après le vote de cette assemblée. La convention financière sera ratifiée immédiatement à Versailles ; elle nous donne l'évacuation immédiate des six départements, qui doit être terminée dans les quinze jours de la ratification. Nous ne donnons aucun titre comme garantie ; on se contente de la signature de M. Thiers et de celle du ministre des finances. Nous payons quatre-vingts millions par quinzaine, à partir du 15 janvier. Je crois que ce résultat va inspirer une nouvelle confiance dans les affaires, et que la Bourse de Londres et l'escompte vont se rassurer. Nous n'avons donc plus besoin de la garantie des banquiers ; nous les retrouverons pour nos paiements dans trois mois. Pour la convention douanière, elle reste ce qu'elle était avant notre départ, avec quelque légère amélioration ; mais nous avons pu obtenir peu de ce côté. La convention expirera donc le 31 décembre, aux conditions que vous connaissez. Il est bien entendu que, si le parlement n'accepte pas la convention territoriale et douanière, les six départements n'en resteraient pas moins évacués. Au contraire, si le gouvernement français n'exécutait pas cette convention, le gouvernement allemand pourrait réoccuper les territoires évacués. J'ai aussi traité la question des changes, et j'ai obtenu que le jour de versement serait considéré comme le jour du paiement, en observant certaines mesures d'ordre et de sûreté convenues entre nous. Les traites appartenant à la Banque de France lui seront intégralement remises : c'est entendu. J'ai aussi terminé avec l'Allemagne pour l'entretien et la nourriture des cinquante mille hommes restants. Nous paierons 1 fr. 50 par homme au lieu de 1 fr. 75, économie de 12.500 francs par jour. Nous paierons 1 fr. 75 par cheval, au lieu de 2 fr. 25, ce qui fait une économie de 9.000 francs par jour. Total, 21.000 francs par jour d'économie. Telles sont les meilleures conditions que j'ai pu obtenir après bien des efforts. Je reste convaincu que la prolongation des négociations actuelles, quelque étendues qu'elles aient été, n'aurait jamais produit des résultats plus favorables pour la France. Aussi j'ai cru le moment venu, aujourd'hui, de signer définitivement et de m'empresser de retourner près de vous pour l'évacuation des six départements. L'empereur m'a fait renouveler, aujourd'hui, ses compliments, en m'assurant que nous trouverons son gouvernement prêt à s'entendre avec empressement sur toutes les questions qui pourraient s'élever entre les deux pays. Par discrétion, m'a-t-il fait dire, il ne m'a pas fait demander une seconde visite ; mais il reste convaincu que mon voyage à Berlin laissera des traces favorables et utiles aux deux pays, et l'on me charge d'en exprimer toute sa confiance au gouvernement français. On m'assure que, sur les ordres du roi, on s'occupe de renvoyer les prisonniers qui sont encore en Allemagne pour délits commis depuis la fin de la guerre. Les deux conventions porteront également la date du 12 octobre. C'est au cours de ces négociations que se produisirent, entre le chancelier de fer et notre ministre des finances, ces fameuses luttes de fourchette et de verre, devenues légendaires. Bien que M. Pouyer-Quertier eût
seul les pleins pouvoirs du gouvernement, raconte M. de Gabriac, alors
chargé d'affaires de France Berlin, dans ses Souvenirs
diplomatiques, il me pria néanmoins
d'être présent à la signature de la convention, à laquelle assistèrent
seulement le prince de Bismarck et le comte d'Arnim. Le soir, nous dinâmes
tous chez le chancelier. Dans ces deux entrevues, je fus témoin de la
constante harmonie qui régna entre eux, et à laquelle il est certain que le
caractère sympathique de notre ministre des finances ne fut pas étranger. Les
deux convives se firent mutuellement honneur, et je dus reconnaître que, dans
cette nouvelle passe d'armes, renouvelée des héros d'Homère, où chacun d'eux
cherchait à dominer son adversaire, le prince de Bismarck et lui
conservèrent merveilleusement leur position. La lutte se continua entre eux, le lendemain, chez M. Bleichröder avec un égal succès et aucun des deux antagonistes ne dut s'avouer vaincu. J'en eus la preuve, le soit- même, à l'Opéra, où M. Pouyer-Quertier entra, d'un pas très ferme, dans la loge où nous l'avions prié de venir entendre le ténor Niemann, qui jouait dans le Prophète[12]. La convention financière du 12 octobre était réellement avantageuse pour la France. L'évacuation prochaine des six départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône, du Jura et du Doubs, compensait largement l'anticipation du paiement des 650 millions restant dus sur les quatre demi-milliards. L'armée d'occupation était rétinite de cinq cent mille hommes et de cent cinquante mille chevaux à cinquante mille hommes et à dix-huit mille chevaux. La réduction du prix de la journée de l'homme et du cheval produisait également une réduction sensible. La franchise douanière, accordée par la France aux produits manufacturés de l'Alsace-Lorraine, était prolongée jusqu'au 31 décembre 1871. Du 1er janvier au 3o juin 1872, ils paieraient seulement un quart des droits. Du 1er juillet au 31 décembre 1872, la moitié, de façon à faire cesser le régime de faveur le Ier janvier 1873. Le paiement des deux premiers milliards s'effectua par deux compensations et seize versements qui s'échelonnèrent, ainsi qu'il suit, du 1er juin 1871 au 6 mars 1872 :
Les deux compensations — valeur du chemin de fer de l'Est et prise en compte du solde redît par l'Aile-magne il la ville de Paris — se sont élevées à 325 millions pour les lignes de l'Est et 98.400 francs pour la somme redue à Paris, soit en tout : 325.098.400 fr. L'opération porta donc sur une somme totale de 2.161.958.767 fr. 43[13]. Il y avait une légère avance sur les dates convenues, celle du versement du dernier terme des deux milliards étant fixée au 1er mai 1872. Par contre, à cette date, l'ennemi n'occupait plus, en France, que les départements de la Marne, de la Haute-Marne, des Ardennes, des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et le territoire de Belfort. II Il ne suffisait pas de voir clair dans l'arriéré énorme laissé par une guerre désastreuse : il fallait organiser les budgets futurs. Il ne suffisait pas d'emprunter, il fallait gager les emprunts ; il ne suffisait pas de réorganiser, il fallait faire face aux dépenses nouvelles qui allaient s'inscrire successivement dans les budgets. Ainsi, par une suite logique et inévitable, on aboutissait à l'extrême conséquence des faits qui s'étaient précipités depuis un an : l'augmentation des impôts. Pour le règlement des dépenses exceptionnelles,
conséquence directe de la guerre, M. Thiers proposa d'ouvrir un Compte général de liquidation, qui ne fut réglé que
par la suite. Il en a expliqué ainsi l'économie : Ce
compte n'avait rien de commun avec l'ancien budget extraordinaire de
l'empire. Je ne devais y porter que des dépenses qui, une fois faites, ne se
renouvelleraient plus, telles que les réparations de nos places fortes, le rétablissement de notre
matériel de guerre, perdu, usé ou suranné, l'entretien de l'armée
d'occupation, les indemnités à certaines localités maltraitées par la guerre
comme Paris, par exemple[14]. Mais, pour rétablir la marelle des affaires, il fallait, en même temps, apporter, à l'Assemblée, les budgets annuels en équilibre. Le dernier budget normal de l'empire, celui de 1869, avait atteint, ou peu s'en faut, si on fait entrer tous les comptes qui doivent y figurer effectivement, une somme de près de deux milliards de francs, exactement : un milliard 879 millions aux dépenses et un milliard 821 millions aux recettes, avec un déficit de 55 millions[15]. Le budget estimatif de 1870 avait été établi sur la base de un milliard 831 millions aux dépenses et un milliard 799 millions aux recettes, avec un déficit de 35 millions. Enfin, les prévisions pour 1871 avaient été arrêtées, par la loi du 27 juillet 1870, à la somme totale de un milliard 852 millions. Naturellement, tous ces chiffres avaient été bouleversés par les événements. D'après une première évaluation de M. Thiers, le budget ordinaire de 187o se trouvait en déficit de 6119 millions ; on sut, plus tard, kirs du règlement définitif, que le déficit réel fut de 858 millions. En comprenant le budget extraordinaire, le déficit total fut de un milliard 481 millions. Quant au budget de 1871, M. Thiers accusait un déficit de 987 millions, qui, en réalité, d'après la loi du 23 juillet 1885, portant règlement définitif de l'exercice 1871, était de un milliard 90 millions. On fit face à ces arriérés énormes avec une partie de l'emprunt de 700 millions, décidé par l'empire, avec les fonds disponibles de l'emprunt Morgan, avec les sommes empruntées à la Banque de France, avec une partie des deux emprunts dits de 2 milliards et de 3 milliards, émis par le gouvernement de M. Thiers : en partie, enfin, avec les ressources affectées an compte de liquidation. On ne pouvait, cependant, revenir à une situation normale qu'en soumettant d'abord à l'Assemblée nationale un budget rectificatif pour l'année 1871 qui était encore en cours. C'est ce que fit M. Pouyer-Quertier, dès le 15 avril 1871. Tel fut le point de départ des grands débats financiers qui allaient bientôt introduire, dans les dépenses annuelles de la France, le témoignage permanent des événements de 1870-1871. A quel chiffre s'élèverait la surcharge qu'il était nécessaire d'inscrire dans les futurs budgets ? M. Thiers, par une première évaluation, d'ailleurs bien insuffisante, présentée au cours d'un exposé de la situation financière, à l'occasion de la loi de l'emprunt de deux milliards, fixait cette surcharge à 556 millions par an, se décomposant ainsi : Trente millions pour la part d'intérêts, non encore assurée, de l'emprunt de guerre contracté sous l'empire ; Quinze millions pour le service de l'emprunt émis à Tours (emprunt Morgan) : Dix millions pour les pensions militaires, autrefois servies par les rentes de l'armée, et dont on s'était emparé dans l'urgence : Quinze millions d'intérêts pour le prêt consenti par la Banque de France ; Seize millions à verser à la compagnie des chemins de fer de l'Est, à titre d'indemnité annuelle, pour la partie de son réseau annexée par la Prusse ; Cent vingt millions pour les intérêts de l'emprunt de deux milliards ; Cent cinquante millions au moins pour les intérêts de l'emprunt des trois derniers milliards. Et, dans ces chiffres, M. Thiers ne comptait pas : L'indemnité à distribuer aux départements envahis, pour les pertes subies pendant la guerre ; L'entretien de l'armée allemande d'occupation, qui coûtait plus d'un million par jour ; La réorganisation de l'armée, avec un matériel à créer et la construction de nouvelles forteresses. Quand on en vint à faire des comptes précis, on trouva qu'il fallait plus de 75o millions de nouvelles recettes annuelles pour faire face aux charges de la guerre. C'était un impôt supplémentaire annuel de plus de vingt francs par chaque habitant. Comment se procurer ces ressources ? Deux systèmes étaient en présence : 1° Procéder à une refonte générale de notre législation financière ; faire appel à des ressources nouvelles ; créer tout un système fiscal, s'inspirant des nécessités extrêmes où l'on se trouvait ; 2° Ou bien s'attacher au système existant : accroître les impôts qui paraissaient, pouvoir supporter une augmentation ; procéder, par mesures de détail et par une révision minutieuse de toute l'organisation ancienne, en lui faisant rendre l'ensemble des ressources dont, on avait besoin. M. Thiers et le gouvernement se prononcèrent pour ce dernier système. Ils eussent craint de se livrer des expériences, dans une situation aussi critique. Après quelque hésitation, l'Assemblée les suivit. Elle se borna à compléter les lois en vigueur ; à frapper des revenus ou des consommations qui, jusqu'alors, avaient échappé à toute contribution aux charges publiques ; à réprimer plus vigoureusement la fraude ; enfin, à ajouter des centimes additionnels au principal de plusieurs impôts directs ou indirects. Ce résultat ne fut pas atteint sans des discussions passionnées, qui occupèrent de longues séances, au Cours des années 1871, 1872 et 1873. N'est-il pas naturel, en effet, qu'au moment où l'on procédait à un ensemble de mesures qui auraient, sur la situation du pays en général et de chaque citoyen en particulier, un contrecoup si marqué, les intérêts se soient énergiquement défendus ? Comment s'étonner que ces rivalités si naturelles aient donné naissance à des polémiques, à des dissentiments qui allèrent même jusqu'à mettre en péril l'existence du gouvernement ? A considérer l'ensemble des débats et l'efficacité des mesures qui furent prises, ce qui se dégage, en somme, c'est un vif sentiment d'admiration pour le calme relatif, la résignation, l'abnégation, avec lesquels l'Assemblée sut imposer et le pays accepter la charge si lourde dont un gouvernement disparu était responsable. M. Thiers, après avoir fait adopter, comme principe, le respect du système fiscal antérieur, n'eut pas de peine à en faire prévaloir nu autre, auquel il était également attaché. De tout temps, il avait pensé que l'agriculture est une des bases inébranlables de la prospérité française : il s'était toujours effrayé d'un libéralisme économique hardi qui, sous l'empire, avait ouvert le marché français à la concurrence des produits étrangers. Dans des interventions fameuses, il avait combattu la politique du libre-échange et des traités de commerce. Voici, d'ailleurs, ses sages paroles à ce sujet : Je considérais comme une grande imprudence de grever la terre de nouveaux centimes additionnels. La terre est un souffre-douleur continuel ; elle paye toutes les folies locales et celles des gouvernements. Un impôt sur le sel, facile à percevoir, il est vrai, aurait été, comme l'impôt sur la terre, supporté par le peuple des campagnes[16]. Il fit accepter ces idées en déclarant, tout d'abord, qu'il se refusait à aggraver le poids des contributions directes. Restreignant encore le champ où il comptait se mouvoir, il écartait également l'idée des nouveaux impôts sur les valeurs mobilières, par la crainte évidente d'inquiéter le marché financier, au moment où il avait besoin de son concours. Ainsi, il était amené, par voie d'élimination, à porter son principal effort sur les contributions indirectes, sur les douanes, et, en général, sur les impôts atteignant la consommation. En principe, l'Assemblée nationale était d'accord avec M. Thiers. Elle partageait ses tendances protectionnistes. On n'éprouva donc que peu de difficultés à établir une première liste d'impôts nouveaux. Suivant les propositions du gouvernement, l'Assemblée vota un impôt sur les créances hypothécaires ; des décimes furent ajoutés aux droits d'enregistrement et aux frais du timbre ; des surtaxes furent établies sur les sucres, les cafés, les alcools, le papier et sur les affranchissements postaux ; des droits frappèrent la circulation des voyageurs et des marchandises par chemins de fer ; on éleva, d'abord, les droits sur les allumettes, et, plus tard, on organisa le monopole de ce produit. On frappa d'un timbre de dix centimes les quittances et reçus quelconques, au-dessus de dix francs ; on créa, au bénéfice de la marine marchande, une surtaxe de pavillon et d'entrepôt. Si importantes que fussent les charges nouvelles imposées aux contribuables, elles étaient loin de suffire. Même en tenant pour exactes les premières évaluations de M. Thiers, il fallait créer d'autres ressources pour une somme de plus de cent millions. Ces grandes discussions relatives aux questions financières occupèrent la fin de la session qui, commencée à Bordeaux en février 1871, avait vu la conclusion de la paix, la répression de la Commune, et s'achevait à Versailles par le vote de la loi rivet. Des débats bien plus complexes encore furent abordés au cours de la session d'hiver. En septembre 1871, le gouvernement et l'Assemblée pensèrent que l'heure était propice pour suspendre les travaux parlementaires. D'ailleurs, il fallait appliquer la loi départementale, récemment promulguée (10 août 1871), et procéder aux élections cantonales pour la désignation des conseillers généraux. Il s'agissait de mettre à l'épreuve la nouvelle organisation, entreprise non moins intéressante que celle qui s'accomplissait à Versailles. Les Le lien social, en effet, se fait sentir surtout au point où il touche les populations, c'est-à-dire dans l'administration des départements, des cantons et des communes. Sous l'empire, le préfet tenait, d'une poigne solide, le bataillon des maires et, par lui, les masses dociles de la démocratie. Il fallait régler maintenant les rapports des trois forces mises en présence : l'administration préfectorale, le conseil général réorganisé, les maires élus par le conseil municipal ou désignés par le gouvernement. Le jeu devenait plus libre, mais, aussi, plus délicat. On pouvait craindre que les assemblées départementales, munies d'attributions plus importantes, ne se trouvassent pas en complet accord avec le pouvoir central et qu'elles n'entrassent parfois en lutte avec lui ; on pouvait craindre que les tendances divergentes de certaines provinces ne s'exagérassent, dans chacun de ces corps, sans lien entre eux, et que l'unité morale de la nation n'en souffrît ; on pouvait craindre, enfin, que la constitution, dans chacun de nos départements, d'une sorte de petit parlement, ne développât, à l'excès, le goût de la polémique stérile et l'ingérence encombrante des partis dans la marche normale des affaires publiques. Comment le préfet, dont l'autorité était affaiblie, prendrait-il contact avec une assemblée nommée directement et librement par le suffrage des populations ? Telle était la question qui allait se poser dans les quatre-vingt-six départements. Dans le message qu'il adresse à l'Assemblée, le 13 septembre 1871, M. Thiers rappelle l'œuvre accomplie. Il n'hésite pas à aborder les problèmes constitutionnels ; surtout, il signale l'intérêt de cette première consultation générale du suffrage universel pour les élections cantonales : Vous êtes réunis depuis près de huit mois, dit-il, et ces huit mois, vous le savez, ont été aussi remplis que des années : Conclure la paix, ressaisir les rênes du gouvernement, éparses ou brisées, transporter toute l'administration de Bordeaux à Versailles, dompter la plus terrible insurrection qui fut jamais, rétablir le crédit, payer notre rançon à l'ennemi, veiller sur les incidents de l'occupation étrangère pour en prévenir les suites quelquefois très inquiétantes, entreprendre une nouvelle constitution de l'armée, rétablir nos relations commerciales par des négociations avec tous nos voisins, arriver, enfin, à la libération du sol qui, chaque jour, s'avance, et essayer de rétablir l'ordre dans les pensées après l'avoir rétabli dans les actes : voilà, depuis près de huit mois, ce que nous faisons ensemble ; et vous savez que, dans ce travail, si votre part est bien grande, la nôtre ne l'est pas moins. Maintenant, la question constitutionnelle : Parlons, Messieurs, en toute franchise et avouons ce que, du reste, il est permis d'avouer, que nous sommes émus, profondément émus ! Comment ne le serions-nous point ? Il s'agit, en ce moment, pour le pays, des plus grands intérêts imaginables : il s'agit de régler son sort présent et futur. Il s'agit de savoir si c'est d'après la tradition du passé, tradition glorieuse de mille ans, qu'il doit se constituer, ou si, s'abandonnant au torrent qui précipite, aujourd'hui, les sociétés humaines vers un avenir inconnu, il doit revêtir une forme nouvelle, afin de poursuivre paisiblement ses nouvelles destinées. Ce pays, objet de l'attention passionnée de l'univers, sera-t-il république ou monarchie ? Adoptera-t-il l'une ou l'autre de ces deux formes de gouvernement qui divisent aujourd'hui tous les peuples ? Quel problème plus grand fut jamais posé devant une nation, dans les termes où il se pose maintenant devant nous ? Et M. Thiers conclut : Ainsi, Messieurs, vous allez vous séparer quelques semaines pour veiller à la réorganisation départementale de la France, pour en reprendre ou en modifier, s'il le faut, la tradition, vous mettre en tête-à-tête avec le pays pour régler vos pensées sur les siennes, pendant que le gouvernement emploiera le temps que vous lui laisserez à préparer vos nouveaux travaux. L'Assemblée nationale se sépara le 18 septembre 1871. Aussitôt la campagne s'ouvrit- en vue des prochaines élections pour les conseils généraux. C'était une véritable mobilisation du personnel politique provincial ; c'était une vaste sélection qui se produisait, pour la première fois, sur la totalité du territoire : chacune des organisations cantonales, embryon de la vie publique, allait avoir à se prononcer et à désigner ses chefs. Les élections eurent lieu le 8 octobre. Sur 2.860 conseillers à élire, les deux tiers environ appartinrent à l'opinion républicaine, avec une nuance conservatrice très marquée. Là où ne triomphèrent pas les républicains, les orléanistes furent élus à l'exclusion des légitimistes. On constata aussi la rentrée en scène d'un certain nombre de personnages bonapartistes. MM. Roulier, Dugué de la Fauconnerie, de Cassagnac père et fils furent nommés. Par contre, deux anciens ministres de l'empire, MM. Forcade de la Roquette et. Jérôme David, échouèrent. Le prince Jérôme Napoléon fut élu, en Corse, et on fit quelque bruit autour de cet te élection. Muni d'un passeport, le prince se rendit dans l'île et fut, durant le voyage, l'objet de manifestations hostiles. 11 espérait être choisi comme président du conseil général ; mais son élection fut annulée, le prince n'axant pu justifier de son inscription au rôle des contributions dans le département. Il communiqua aux journaux le discours qu'il attrait prononcé et dans lequel il réclamait un plébiscite qui aurait à trancher entre la république, la royauté ou l'empire. M. Thiers n'était pas sans inquiétude sur les manifestations auxquelles donnait lieu la présence du prince Napoléon en Corse. Il avait adressé des instructions très énergiques au préfet, M. Charles Ferry, et envoyé la flotte mouiller eu rade d'Ajaccio. Après son échec, le prince se hâta de regagner Prangins, par l'Italie. C'était un premier mouvement bonapartiste qui allait, bientôt, se développer. D'une manière générale, la manifestation en faveur des institutions républicaines était éclatante. M. Gambetta, qui ne manquait jamais une occasion de prouver que le parti républicain était un parti de gouvernement, adresse au docteur Cornil, conseiller général de l'Allier, une lettre qui peut être considérée comme une sorte d'instruction directrice pour les assemblées départementales. Il insiste, en premier lieu, sur la portée des élections, au point de vue des institutions républicaines : puis, se mettant dans l'hypothèse où il eût reçu lui-même un mandat de conseiller général, il ajoute : Tout d'abord, je m'interdirais sévèrement toute ingérence sur le terrain de la politique générale... Nommé comme républicain, je ne croirais pas devoir altérer la nature et la compétence du conseil. Plus que jamais, je chercherais à séparer l'administration de la politique. Je rue garderais de confondre les attributions et de transformer les conseils généraux en assemblées législatives au petit, pied... Je ne réclamerais donc ni la dissolution de l'Assemblée de Versailles ; ni la proclamation de la République, ni toute autre mesure de politique générale... Je concentrerais tous mes efforts sur le terrain de l'administration et des intérêts locaux... Donnez, dans les conseils généraux, l'exemple du travail ; démontrez votre compétence dans le maniement des affaires publiques, répandez vos idées et vos principes, et le pays saura bien vous appeler à les mettre eu pratique... Ainsi, peu à peu, sous la conduite de chefs sages et écoulés, la République prenait vie et ligure, le personnel nouveau s'habituait à ses devoirs et aux responsabilités du gouvernement. Le 23 octobre s'ouvrit la première session des conseils généraux, qui dura jusqu'à fin novembre. Sur 86 présidents, il y eut 56 conservateurs, 18 républicains et 12 radicaux. III Les vacances se passèrent dans le calme. Le pays reprenait le sentiment de son existence et de sa force, à la suite des cruelles épreuves que, depuis une année, il avait subies. Cependant, le spectacle des événements récents était encore présent partout. Paris commençait à replacer les pavés arrachés pour la construction des barricades. On disposait des clôtures, que l'on croyait provisoires, autour des monuments publics incendiés ou abandonnés, au Louvre, aux Tuileries, à la Cour des Comptes, au Palais de la Légion d'honneur, à l'Hôtel de Ville. Là où les maisons particulières avaient été surtout atteintes, rue du Bac, rue de Lille, rue de Rivoli, à la Croix-Rouge, on procédait lentement au déblaiement. Les maisons incendiées étaient encore chancelantes et noires ; les persiennes battaient aux fenêtres ; la nuit, ces coins, mal éclairés, faisaient comme des taches sombres. Les quartiers populaires, décimés, désunis par les passions toujours latentes de l'émeute et de la bataille, gardaient un aspect farouche. Ou parlait à voix basse chez les marchands de via et dans les endroits publics ; on croyait voir partout soit des communards, soit des espions. Les prisons étaient pleines. A Versailles, les tribunaux poursuivaient l'œuvre de la répression. La masse du peuple, frappée ou menacée, attendait, avec anxiété, une parole d'amnistie et d'oubli. Jusque dans les salles d'hôpitaux, où les blessés et les malades des deux partis étaient réunis, la méfiance régnait : des mourants se dénonçaient réciproquement. Les médecins durent intervenir pour protéger des souffrances et des agonies. Dans les maisons, beaucoup d'appartements restaient vides ou étaient occupés par des locataires de passage, dont on ne savait pas toujours le nom réel. Les concierges exerçaient une inquisition parfois redoutable. Dans les rues, des patrouilles fréquentes circulaient. Les environs de Paris étaient déserts. Il n'y avait plus d'arbres au bois de Boulogne ; il n'y avait plus de canotiers à Bougival. Meudon était abandonné. Saint-Cloud, où toutes les fureurs s'étaient succédé, était détruit comme par un tremblement de terre ; les ruines couvraient toute la colline ; le Mont-Valérien dressait sa silhouette militaire en haut du coteau décharné ct paraissait sinistre, le soir, sur les couchers de soleil sanglants. La vie reprenait dans le centre, aux Halles, sur les boulevards. L'été, on vit reparaitre, par les rues, les marchands des quatre saisons, et ce fut une joie, pour les Parisiens, de goûter, en plein air, aux premières cerises et aux premières pèches. L'activité industrielle et commerciale, suspendue depuis un au, prenait, par suite des événements eux-mêmes, un prodigieux essor. Les stocks d'approvisionnement étant épuisés, il fallait les reconstituer rapidement. Beaucoup de situations difficiles s'étaient liquidées dans le désastre général. Du dedans et du dehors, les commandes affluaient. La province envoyait sans cesse les blés, les animaux de boucherie sur Paris, dont la consommation se développait. Chez tous ceux qui n'avaient pas été frappés directement, on devinait une confiance, une joie d'être, un besoin instinctif de réparer les pertes et de combler les -vides. Sous ces ruines, que la poussée des premières herbes recouvrait à peine, on sentait courir la vie. L'automne de cette année terrible s'écoula donc entre les dernières tristesses et les premières espérances. Cependant, la foi en l'avenir l'emportait et tous les indices d'une renaissance rapide s'affirmaient. Ils ne pouvaient échapper à l'attention de M. de Bismarck. Dès le mois d'avril 1871, l'Assemblée avait entrepris l'étude d'une nouvelle loi militaire qui devait reconstituer et accroître la force du pays. Elle se donnait à cette tâche avec passion. Le sentiment général était favorable au service personnel et obligatoire pour chaque citoyen. On voulait obtenir l'instruction militaire du peuple tout entier. Une grande commission, nommée par l'Assemblée, se mit immédiatement à l'œuvre. Ses travaux ne durèrent pas moins de quatorze mois. Mais les discussions fécondes qui se produisaient dans cette commission avaient leur retentissement au dehors. Ces premiers faits, minutieusement recueillis, parfois grossis par les agents et par les attachés militaires allemands, étaient dénaturés, en tout cas, par des polémiques de presse, très vives en Allemagne et en France. De part et d'autre, c'était un déchaînement de haines qui faisait craindre un retour vers la barbarie. M. de Bismarck était atteint alors d'une maladie nerveuse qui se manifestait par un état d'irritation presque permanent. On racontait plaisamment, à Berlin, qu'il avait fait dire à son médecin qu'il était trop malade pour le recevoir. Déjà, à l'occasion de la revue du 14 juillet, M. de Waldersee avait présenté au ministre des affaires étrangères des observations tendant à incriminer les intentions du gouvernement français. A Francfort, les négociations se poursuivaient pour le règlement des questions d'ordre secondaire que le traité de paix avait laissées en suspens. La marche de ces travaux était extrêmement lente. Sur la réglementation du droit d'option pour les Alsaciens-Lorrains, sur la question du remboursement des sommes confisquées par les armées allemandes dans les succursales d'Alsace et de Lorraine de la Banque de France et, enfin, sur la question de l'amnistie à accorder aux Français des pays annexés qui avaient lutté pour leur indépendance, on n'arrivait pas à s'entendre. Les négociateurs allemands opposaient aux instances des négociateurs français l'affirmation réitérée qu'ils étaient sans instructions. M. de Bismarck devait déclarer bientôt lui-même à M. de Gabriac que cette attitude voulue équivalait à une fin de non-recevoir[17]. Nous avons déjà rappelé la grave difficulté que souleva, en août 1871, la tentative de négociation directe avec le général de Manteuffel pour le paiement anticipé d'un des versements de l'indemnité et l'évacuation simultanée de nouveaux départements français. M. de Bismarck considérait cette procédure comme portant directement atteinte à son autorité. C'est alors qu'il eut, avec M. de Gabriac, l'entretien si vif que nous avons également rapporté : Je suis venu du fond de la Poméranie, disait-il, pour rétablir ma position vis-à-vis de mes collègues. En réalité, il était non seulement nerveux, mais inquiet. Le chargé d'affaires explique encore très nettement la situation, lorsqu'il dit, dans une lettre adressée au ministre des affaires étrangères, M. de Rémusat : L'Allemagne n'a plus rien à attendre d'une guerre nouvelle. Celle qui s'achève lui a donné les trois choses qui lui manquaient : l'unité nationale, la suprématie militaire, l'argent de nos milliards. Elle désire donc la paix... Mais si nous donnions à M. de Bismarck un prétexte, tant soit peu légitime, il le saisirait sans trop de regrets, et il est assez fort aujourd'hui pour entraîner la nation... M. de Bismarck ne reconnaît, au fond, qu'une souveraineté réelle, celle du but à atteindre. Aujourd'hui, il est notre ennemi parce qu'il nous a fait trop de mal pour ne pas vouloir nous en faire davantage. Chi offende non perdona... Il n'est que logique en cherchant l'écrasement de la France pour la durée au moins d'une génération[18]. L'esprit, fertile en ressources, du puissant homme d'État cherchait, au même moment, dans des combinaisons politiques d'une tout autre portée que ces boutades diplomatiques, la consolidation de son œuvre. Son état de nervosité extrême et l'isolement où il se renfermait à Varzin, ne font peut-être que signaler le travail auquel il se livre. Jamais sa diplomatie n'a été plus active et plus féconde. Il veut compléter sa victoire de Versailles et de Francfort, et il se retourne vers ces neutres qui l'ont tant inquiété, au moment où il signait la paix avec la France. Infatigable, il engage une nouvelle campagne diplomatique, celle qui aboutira, d'abord, à la rencontre des trois empereurs, et, plus tard, à la Triple Alliance. Il commence à se rendre compte qu'il a manqué son but et qu'il n'a pu abattre définitivement, la France : il la voit devenant bientôt, pour l'Allemagne, un embarras de tous les instants. Dans les futures combinaisons européennes, elle tendra la main à toute puissance qui essaiera d'échapper à l'hégémonie allemande. C'est donc du côté de l'Europe qu'il faut se prémunir. On hésite à recommencer les hostilités, à mettre la fortune de l'Allemagne en jeu et la passivité de l'Europe à l'épreuve. On n'a pu écraser la France. Il faut, l'isoler. Parmi les puissances neutres, celle qui, il double reprise, avait le plus réellement préoccupé M. de Bismarck, c'était l'Autriche. C'est donc de ce côté qu'il se tourne. Depuis 1866, la politique de l'Autriche-Hongrie paraissait perplexe. Elle était dirigée, sous l'autorité de l'empereur François-Joseph, par un Allemand du Sud, sorte de condottiere de la diplomatie, M. de Beust. M. de Beust, brillant et spirituel, facilement satisfait de lui-même et quelque peu surfait, l'homme, a dit M. Thiers, qui avait le moins l'air de croire ce qu'il disait, hésitait entre deux systèmes : soit de vagues projets de résistance à l'influence prussienne, politique que M. de Beust qualifiait, pour ne mécontenter personne, de politique des mains libres, soit un parti pris de résignation et de soumission aux faits accomplis, autre système que le comte Andrassy devait baptiser, à son tour, quand il l'adopta : politique de l'itinéraire forcé. Avant la guerre. Cette double tendance s'était dessinée très nettement dans l'entretien décisif que l'empereur François-Joseph avait eu avec le général Lebrun, aide de camp de l'empereur Napoléon III, quelques semaines avant la déclaration de guerre, alors que l'intervention éventuelle de l'Autriche était, pour ainsi dire, escomptée par le cabinet de Paris : Je me plais à espérer, avait-il dit, que l'empereur Napoléon voudra bien tenir compte de ma situation personnelle et politique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si je déclarais la guerre en même temps que lui, il n'est pas douteux, qu'exploitant de nouveau l'idée allemande, la Prusse pourrait surexciter et soulever à son profit les populations allemandes, non pas seulement chez elle et dans l'Allemagne du Sud, mais aussi dans l'empire austro-hongrois, ce qui serait très fâcheux pour mon gouvernement[19]. Cela voulait dire que l'empire austro-hongrois se trouvait, dès lors, c'est-à-dire avant la guerre, en présence des complications ou des éventualités intérieures qui, en 1871, décidèrent de la direction définitivement adoptée. Les nationalités diverses qui composent l'empire ont assurément le sentiment historique de la nécessité de leur union ; mais, dans les luttes d'influence qui les divisent à l'intérieur, chacune d'elles cherche son idéal et, parfois, son point d'appui au dehors. Les dix millions d'Allemands autrichiens qui ont gardé au cœur le rêve d'une grande Allemagne, ont vu, en partie, ce rêve se réaliser, en dehors d'eux, par la main de la Prusse. Les Slaves admirent la grandeur du monde russe dont l'ombre, s'étend sur les continents. Quant aux Hongrois, ils sont isolés au milieu de l'Autriche et au milieu de l'Europe ; mais ils savent que, dans les conflits de race, selon qu'ils se porteront vers l'une ou l'autre politique, ils feront pencher la balance. M. de Bismarck avait, de très bonne heure, compris l'importance des Hongrois dans le jeu international européen. Il les avait caressés de longue date ; c'est lui qui, dans une dépêche datée de Francfort, avait lancé la formule du dualisme. Il avait tracé à la Hongrie tout un programme politique qu'il a précisé, à nouveau, dans cette phrase de ses Souvenirs Si les considérations d'une politique réfléchie avaient toujours le dernier mot en Hongrie, ce peuple, brave et indépendant, comprendrait qu'il n'est, en quelque sorte, qu'une île au milieu de la vaste mer des populations slaves et que, étant donnée son infériorité numérique, il ne peut garantir sa sécurité qu'en s'appuyant sur l'élément allemand en Autriche et en Allemagne[20]. Cette théorie est discutable : car il est évident que si l'élément allemand dominait toute l'Europe centrale et s'étendait du Rhin aux Balkans, la nationalité hongroise serait autrement menacée, et que Pilot, perdu dans la vaste domination germanique, serait, rapidement submergé. Mais l'art suprême, dans les relations internationales, c'est de fournir aux intérêts dont on entend se servir, sinon des raisons, du moins des formules. M. de Bismarck avait su ainsi se créer un point d'appui chez cet actif et rigoureux peuple hongrois, et, notamment, il avait amené à ses vues l'homme le plus influent d'alors, le président du ministère hongrois, le comte Andrassy. Ce travail s'était fait autour du comte de Beust et, en quelque sorte, par-dessus. sa tête, sans qu'il s'en fût aperçu. La présidence du conseil en Autriche était alors. aux mains du comte Hohenwart, qui soutenait le parti slave. Par suite de cette circonstance, les Allemands d'Autriche et les Hongrois avaient donc des. raisons particulières de se laisser aller aux sentiments et aux tendances naturelles qui les portaient vers l'empire allemand nouvellement constitué et vainqueur de l'Europe. M. de Bismarck dit que, dès le début de la campagne de France, étant à Meaux, il avait songé à faire jouer ces ressorts et qu'il avait déjà sondé les cours de Vienne et de Saint-Pétersbourg en vue d'une alliance des trois Empereurs, avec l'arrière-pensée que l'Italie monarchique viendrait s'y joindre. Le 14 décembre 1870, étant à Versailles, il avait adressé
à M. de Schweinitz, ambassadeur de Prusse à Vienne, une longue dépêche qui
était une véritable invite au gouvernement austro-hongrois : L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, nous osons l'espérer en
confiance, se regarderont avec un mutuel bon vouloir et se tendront la main
pour assurer le développement et le bonheur des deux pays[21]. M. de Beust, avait accueilli avec empressement ces premières ouvertures, tout en réservant son opinion sur les sentiments de la Prusse qui n'a pas été et ne sera pas un ami sincère ; il avait, dans un rapport, soumis à l'empereur François-Joseph, démontré clairement que l'Autriche-Hongrie, n'étant pas assez forte pour s'opposer aux succès de l'Allemagne, n'avait qu'à profiter des circonstances qui donnaient encore quelque prix à sa neutralité. Puis, après avoir fait un dernier effort pour contrebalancer les succès de la Prusse par la réunion d'un Congrès et la constitution d'un tribunal arbitral européen, — c'est le moment où le comte de Wimpfen reçoit pour instructions de faire, auprès de M. de Bismarck, la démarche en faveur d'une paix européenne, démarche qui avait tant inquiété ce dernier, — il avait pris son parti. M. de Beust, non originaire des provinces autrichiennes, et jugeant la situation, moins d'après des tendances de race, qu'en homme d'État, était trop fin pour ne pas comprendre que, si les directeurs de la politique austro-hongroise savaient s'abstraire des luttes intérieures et s'ils n'étaient préoccupés que des destinées de l'empire, l'alliance qui s'impose à eux, c'est l'alliance française. La France, en effet, est la seule puissance qui n'ait, dans l'Europe centrale on dans l'Europe orientale, aucune confraternité de race qui la sollicite, aucune visée politique déterminante qui l'attire, aucun intérêt contradictoire à la grandeur austro-hongroise. Mais les erreurs de Napoléon III avaient gâté ou faussé tout cela. Le comte de Beust fait, à ce sujet, cette réflexion : L'empereur Napoléon n'avait jamais compris la politique européenne. Quant au prince de Bismarck, avec une fertilité de moyens extraordinaires, il profitait du trouble universel pour embrouiller encore les intérêts et les systèmes. Le comte de Beust, donc, en ministre d'État plus qu'en ministre de parti, avait persévéré, tant qu'il l'avait pu, dans le système du rapprochement avec la France. Mais la fortune des armes s'était prononcée contre celle-ci. Les populations germaniques de l'empire austro-hongrois exultaient. Les fers étaient mis au feu pour le renversement du cabinet Hohenwarth. La Hongrie se déclarait fortement pour la politique allemande. Il fallait bien faire les premiers pas vers Berlin : c'était, même avant le comte Andrassy, l'itinéraire forcé. En février 1871, un échange de notes précisa cette nouvelle orientation politique. A la même époque, l'aide de camp général, comte de Bellegarde, fut envoyé à Berlin pour féliciter l'empereur Guillaume, son retour dans sa capitale. M. de Bismarck, de tout temps grand amateur de diplomatie thermale, voulut rendre le rapprochement plus éclatant, et if ménagea trois rencontres des deux empereurs allemands, pendant l'été de 1871, à Ischl, à Gastein, à Salzbourg. Nous avons, par le comte de Beust, le récit de ces entrevues, si grosses de conséquences pour l'avenir de l'Europe. Nous savons que l'empereur Guillaume, soufflé par M. de Bismarck, fi t tout, auprès de l'empereur François-Joseph, pour adoucir l'amertume des premières heures. C'est alors qu'on put apprécier la souveraine prudence qui avait dicté les clauses de la paix, à Nikolsbourg. L'Allemagne retrouvait maintenant l'Autriche sur sa route, et elle n'avait qu'à tirer tout le profit de sa propre modération : Le ciel avait favorisé les armes prussiennes, dit l'empereur Guillaume. Mais lui, le roi, — on sera bien obligé de le reconnaître, — s'était montré généreux... La grande faute était à Napoléon III, qui n'avait pas su attaquer l'armée prussienne par derrière et qui avait ainsi consommé la ruine de l'Autriche, et, par suite, celle de la France. Aussi, lui, le roi de Prusse, ne voulait pas croire, alors, à la neutralité de la France, et il en a conservé beaucoup de reconnaissance à l'empereur Napoléon... Maintenant que la dernière guerre, non plus désirée que prévue par lui, avait enfin placé la Prusse à la tête de l'Allemagne, également contre sa volonté, à lui, roi de Prusse, il n'a plus, comme empereur, d'autre désir que d'entretenir de bonnes relations avec l'Autriche ; en disant cela, il appuya fortement sur ce point qu'il comprenait parfaitement qu'on n'oubliât pas aisément le passé, et qu'il se réjouissait fort du rétablissement des bons rapports entre les deux empires[22]. M. de Beust eut aussi de longs entretiens avec M. de
Bismarck. Il entra de plain-pied dans le projet d'une ligue pacifique, qui lui était habilement
présenté pour couvrir ce qu'il pouvait y avoir de pénible dans la situation
faite à l'Autriche. Le prince de Bismarck ne fit pas de propositions en vue
d'engagements positifs, inscrits dans un traité : il s'agissait seulement de relations franches, durables, basées sur une bonne
volonté mutuelle, une confiance égale de part et d'autre. Mais il
reconnut, sans peine, que l'Autriche n'avait pas
d'autre politique à suivre que celle de l'acceptation franche, et sans
réserve, des faits accomplis en Allemagne. M. de Bismarck prenait le chancelier austro-hongrois par son faible, en lui disant que c'était lui qui avait formulé la théorie du rapprochement dans son dernier discours aux délégations ; il ouvrait pour la première fois, très prudemment, il est vrai, les perspectives de cette politique orientale qui devait être l'illusion et peut-être la déception de l'Autriche dans la combinaison du rapprochement : Cela est allé si loin, dit M. de Beust, que le passage de ma déclaration, visant une éventualité que nous ne devons pas favoriser, mais mettre à profit, — à savoir la dissolution de l'empire ottoman, — que ce passage se retrouvait dans les développements du chancelier impérial allemand, et il a marqué obligeamment, qu'on ne conçoit pas une grande puissance qui ne ferait pas, de sa faculté d'expansion, une condition vitale. Cependant, le comte de Beust, avec une habileté réelle, tirait avantage de la résolution avec laquelle il avait su se déterminer, en amenant la conversation sur la Russie. Il obtenait ainsi de M. de Bismarck des déclarations d'une haute portée : Il m'a été plus important, dit-il lui-même, d'entendre le prince de Bismarck caractériser les rapports de la Prusse et de la Russie... A Berlin, on ne veut pas se laisser entraîner à une attitude hostile à la Russie à cause de nous, mais on espère conquérir une situation plus indépendante vis-à-vis de la Russie, grâce à de bonnes relations avec nous. M. de Beust, lui-même, avait ajouté sans être contredit : Le rapprochement est la plus sûre des garanties contre les empiétements de la Russie[23]. En somme, les cieux chanceliers furent ravis de se sentir en si parfaite confiance, alors qu'ils avaient tant de raisons de se méfier l'un de l'autre : Nos deux esprits, disait, quelques jours après, M. de Beust, se sont trouvés réunis comme une clef dans une serrure. La clef devait bientôt se refuser à tourner dans la serrure. En effet, la démarche qu'il venait d'accomplir eut, pour le ministre autrichien, une conséquence bien inattendue. A peine était-il rentré à Vienne, que le cabinet Hohenwart tombait et qu'il était obligé, lui, comte de Beust, de le suivre dans sa chute ; de plus eu plus surpris, il se voyait remplacé, au pied levé, par le comte Andrassy. Il avait, lui-même, à Gastein, facilité la rencontre du ministre hongrois avec M. de Bismarck : Moi, qui suis toujours la bête à bon Dieu, dit-il, je fis en sorte que le vœu du comte Andrassy fût exaucé, de sorte que lui et le comte Hohenwart reçurent une invitation. Je ne m'occupais ni des rapports entre le comte Andrassy et le prince de Bismarck, ni de ceux du comte Andrassy avec le comte Hohenwart ; c'est à peine si j'écoutais ce qu'on men disait[24]... Les diplomates ont plus de profit à écouter qu'à parler, même quand ils parlent bien. D'ailleurs, qu'importe ? Cette disparition de M. de Beust était fatale. En Autriche-Hongrie, la politique impériale cédait la place à la politique des partis, à la politique des races. Slaves, Allemands, Hongrois, sacrifiaient tout à leurs rivalités intestines. L'activité politique de l'empire des Habsbourg était, pour de longues années, enfermée, par l'habileté de M. de Bismarck, dans ce manège sans issue où les trois nationalités dominantes se poursuivent sans jamais se rejoindre. Une situation nouvelle voulait des hommes nouveaux, et il était logique que le comte de Beust cédât la place au comte Andrassy. Dans l'entrevue mime qui avait été, pour lui, l'heure décisive, le comte de Beust avait, nous l'avons vu, par une dernière habileté diplomatique, singulièrement affaibli les avantages de la combinaison, au point de vue allemand, quand il avait obtenu, du prince de Bismarck, les déclarations relatives à la Russie. C'était une flèche qui devait rester dans la blessure. La combinaison, si longuement préparée et si lentement mûrie par M. de Bismarck, avait un point faible : se rapprocher de l'Autriche, c'était fatalement, un jour ou l'autre, se séparer de la Russie[25]. D'ailleurs, cette conséquence, M. de Bismarck la prévoyait et il l'acceptait comme inévitable ; il l'a déclaré lui-même, à diverses reprises, dans ses Souvenirs. Donc, au lendemain de cette guerre où l'Allemagne de M. de Bismarck avait été aidée, soutenue, sauvée peut-être par la Russie, elle se préparait, par une lente évolution, à se dégager des liens qui l'attachaient à l'empire des Isars. Elle se résignait, elle aussi, à étonner le monde par son ingratitude. Pour le moment, on parvint, par des démonstrations très empressées, à mettre un baume sur les premiers froissements provoqués en Russie par l'entrevue de Gastein. Le prince Gortschakoff, dans un court séjour qu'il fit à Berlin au début de novembre, fut accablé de procédés flatteurs et de déclarations rassurantes. M. de Bismarck allait employer toute sa séduction, toute l'autorité familiale que l'empereur Guillaume exerçait sur son neveu, Alexandre li, pour détourner les premiers soupçons et panser les premières blessures. Octobre 1871. Quant à la France, objet perpétuel des inquiétudes de la politique bismarckienne, elle subit, presque sans y prendre garde, cette première conséquence diplomatique de la défaite. M. Thiers, absorbé par d'autres préoccupations, n'avait aucun moyen de parer le coup ou de l'amortir. Et- ce n'était que le commencement ! On prétendait créer, contre la France, un nouvel ordre européen dont elle était exclue. On l'enfermait dans une sorte de blocus moral. On ameutait tous les conservateurs de l'Europe contre la France républicaine. On suscitait les intérêts rivaux, quels qu'ils fussent, et d'où qu'ils vinssent. Toutes les armes étaient bonnes. On abandonnait, quand il était question d'elle, les règles de celle politique non interventionniste dont on se targuait d'ordinaire. Par une contradiction manifeste, on se préparait à reprendre, contre elle, les pires procédures, en accusant cette même France républicaine et socialiste de pactiser avec Rome et avec la réaction noire. Aucune chaîne n'était assez forte, aucun boulet assez
lourd et assez fortement rivé au pied de la France, pour que M. de Bismarck
se sentit rassuré et garanti contre le relèvement d'une
puissance vaincue et démembrée, mais non soumise, dont la vitalité lui apparaissait comme une menace
permanente, qui était, à la fois, pour lui, une excitation et un remords[26]. Le succès obtenu par le rapprochement avec l'Autriche-Hongrie semble avoir eu pour effet momentané de détendre les nerfs du chancelier fédéral. Tranquillisé, il se montra plus accommodant ; c'est l'heure où il se prête aux négociations relatives au paiement du deuxième milliard ; où il reçoit, à Berlin, M. Pouyer-Quertier et conclut les conventions du 12 octobre 1871. Il donne, en même temps, aux plénipotentiaires de Francfort des instructions qui leur permirent de régler les questions restées pendantes à la suite de la paix. Enfin, il fait part à notre chargé d'affaires du désir qu'avait l'empereur de voir les relations entre les deux pays rétablies sur un pied normal, par la nomination et l'installation respective de deux ambassadeurs. Toutefois, au dernier moment, un incident des plus pénibles permet à M. de Bismarck d'affirmer publiquement les sentiments dont il entend ne pas se départir à l'égard de la France. A Chelles, arrondissement de Meaux, un jardinier du nom de Bertin, avait, le 10 août 1871, commis une tentative de meurtre contre le sergent-major prussien Krafft. Le 5 septembre suivant, un nommé Tonnelet avait tué au hameau de Montereau, territoire de Montreuil (Seine), un fantassin du 2e régiment de Thuringe. Arrêtés, Bertin et Tonnelet furent renvoyés devant la cour d'assises : le premier, de Seine-et-Marne ; le second, de la Seine. Malgré les réquisitoires très nets du ministère public, ils furent acquittés par le jury, les 14 et 24 novembre. Au même moment, deux attentats contre des soldats allemands furent commis dans la Marne, à Épernay et à A. Les meurtriers, ayant été arrêtés, furent livrés aux autorités allemandes et fusillés, le 29 novembre. Ces événements produisirent une vive impression en Allemagne. M. de Manteuffel reçut ordre d'exécuter rigoureusement les prescriptions de l'état de siège. Pendant trois jours, un traitement de rigueur fut infligé à la ville d'Épernay. M. Thiers, soucieux de ne pas laisser aggraver l'incident, avait, dans son message du 7 décembre, abordé la question à la tribune de l'Assemblée et n'avait pas hésité à blâmer les jurés : Il faut dire à ceux qui croient que frapper un étranger, ce n'est pas commettre un meurtre, que c'est là une erreur détestable ; qu'un étranger est un homme ; que, pour lui, les saintes lois de l'humanité subsistent. Nous supplions les juges de ne pas partager une erreur aussi déplorable... Le prince de Bismarck ne trouva pas suffisantes ces déclarations, pourtant si formelles ; il n'écouta pas davantage les avis modérés du général de Manteuffel ; il ne voulut pas prendre en considération la remarque si juste de M. de Rémusat, ministre des affaires étrangères, écrivant : L'occupation étrangère est une cause permanente de ressentiments et de représailles... La durée d'une telle situation ne fait que la rendre plus irritante et moins supportable... Au lieu d'apaiser, il crut devoir envenimer encore, et c'est alors qu'il adressa, le 10 décembre, au comte d'Arnim une dépêche qui devait être communiquée à M. de Rémusat : elle contenait un passage qui eut, en France et en Europe, un douloureux retentissement : Le fait que le sentiment du droit. est, en France, si complètement éteint, même dans les cercles où l'on cherche de préférence les amis de l'ordre politique et de la justice garantie, met l'Europe à même d'apprécier les difficultés que le gouvernement français rencontre dans ses efforts pour affranchir le sentiment de l'ordre et du droit de la pression que le tempérament passionné des masses-fait peser sur lui... Le degré d'éducation morale et le sentiment de droit et d'honneur qui sont particuliers au peuple allemand excluent toute idée d'une conduite analogue... A l'avenir, si l'extradition nous était refusée, nous serions contraints d'arrêter et d'emmener des otages français et même, dans le cas d'extrême nécessité, de recourir à des mesures plus étendues... Cette fois, on jugea, partout, que la mesure était dépassée. Le général de Manteuffel lui-même exprima sa désapprobation formelle et le sentiment de bon nombre de ses compatriotes, dans un entretien qu'il eut avec le-comte de Saint-Vallier et dont, la relation fut envoyée immédiatement à M. Thiers : Je quitte M. de Manteuffel, écrivait M. de Saint-Vallier le 24 décembre ; il vient de m'exprimer les sentiments de douleur qu'éveille en lui la lecture de l'inqualifiable dépêche adressée, le 10 décembre, par M. de Bismarck à M. d'Arnim et publiée avant-hier par les journaux de Berlin. Le général est confondu de la perfidie de cette pièce mensongère et calomnieuse, de sa violence brutale et, plus encore, de l'outrage qui nous est fait par sa publication ; il se demande avec effroi où tend M. de Bismarck, quel but mystérieux il poursuit, s'il veut réveiller les haines, recommencer la guerre, nous écraser entièrement et nous démembrer... il est inquiet pour nous, inquiet pour lui, inquiet pour son pays et pour son souverain... Le sentiment public de l'Europe entière se retournera contre nous, ajoute-t-il, comme autrefois contre Napoléon Ier, et je tremble que nous ne finissions par payer chèrement ces violences hautaines inspirées par l'enivrement de la victoire. Et M. de Manteuffel prenait la peine de réfuter, point par point, les assertions contenues dans la dépêche qu'il jugeait si sévèrement[27]. M. Thiers déployait, dans ces passes dangereuses et pénibles, un sang-froid, une autorité, qui lui font le plus grand honneur. C'est là qu'il reprenait l'avantage sur le sauvage de génie. Le 29 janvier, il répondait à M. de Saint-Vallier : Répétez bien à M. de Manteuffel que nous voulons la paix,
que nous en donnons les preuves bien décisives : la première, c'est de nous
tant presser de payer les deux premiers milliards et, ce qui est plus
démonstratif, de nous préparer et anticiper le paiement des trois derniers.
Si nous aimions mieux liquider par la guerre que par la paix, nous
profiterions du traité qui nous donne jusqu'en 1874 pour payer la seconde
partie de l'indemnité et nous nous réserverions ainsi le bénéfice des
événements. Or, très positivement, les 650 millions soldés en mai (ceux qui furent payés en mars), nous entreprendrons les négociations ayant pour but de
combiner un paiement successif et commençant immédiatement avec l'évacuation
du territoire occupé. J'ai limité ma triche politique à ce que j'ai appelé la
réorganisation de la France, et j'y ai fait entrer la paix d'abord, le
rétablissement de l'ordre, l'équilibre des finances et la reconstitution de
l'armée. Voilà ma triche avouée, avouable, et je ne puis pas évidemment la
laisser incomplète sans ôter à ma gestion ses vrais, ses solides motifs. Il semble que M. de Bismarck lui-même ait eu le sentiment du manque de mesure qui signalait ses derniers actes ; car, sans insister sur les formules comminatoires qui tombèrent d'elles-mêmes, il fit procéder, par les deux chancelleries, aux échanges de lettres qui consacraient la nomination des ambassadeurs. M. Thiers désigna, pour occuper l'ambassade de Berlin, dans les circonstances graves et difficiles que l'on traversait., le vicomte de Gontaut-Biron, chef d'une des plus vieilles familles de l'aristocratie française, personnage d'un tact parfait, d'une loyauté éprouvée, acceptant, sans autre pensée que le désir du bien, la lourde charge qui lui était imposée. M. de Gontaut-Biron sut se créer rapidement à Berlin une situation exceptionnelle. M. de Bismarck, que les relations de M. de Gontaut-Biron avec la cour, et notamment avec l'impératrice Augusta, mirent plusieurs fois en méfiance, le juge cependant, dans ses Souvenirs, en termes assez favorables : Gontaut-Biron agissait dans les intérêts du parti légitimiste auquel il appartenait de naissance... Diplomate habile et fort aimable, de famille ancienne, il trouvait, auprès de l'impératrice Augusta, des points de contact. Par le privilège d'être de haute naissance, il n'éprouvait aucune difficulté à se faire une situation dans les cercles de la cour, et s'était créé des relations qui, souvent, par un chemin ou par un autre, lui permirent d'arriver jusqu'à l'empereur[28]. Quelque temps après l'arrivée du comte de Gontaut-Biron à Berlin, M. Thiers pouvait se féliciter de cette nomination. Il écrivait spirituellement au nouvel ambassadeur, le 28 janvier 1872 : On est très content de vous et on me loue du choix que j'ai fait. J'en suis tout fier... J'ai donc gagné mon procès contre vous, et je crois que vous serez charmé de l'avoir perdu. Douceur, dignité, grand sens, tout cela a réussi auprès du prince de Bismarck. Le gentilhomme, qui est du vieux Sèvres et non du nouveau, a, de plus, beaucoup de titres auprès du roi, qui, au fond, est légitimiste et non pas bonapartiste... Quant à moi, qui suis un vieux philosophe, soucieux uniquement des affaires de l'État, je suis charmé du succès de votre personne, blanche ou bleue... D'autre part, M. de Bismarck désigna, pour représenter l'Allemagne en France, un de ses amis d'enfance, le comte Harry d'Arnim, diplomate intelligent, mais dont le chancelier dut bientôt dévoiler lui-même, dans un procès scandaleux, les trop graves défauts : la légèreté, la causticité, le manque de jugement et de pondération, la susceptibilité. Le comte d'Arnim se donna, tout d'abord, comme le représentant de l'exigence conquérante ; il se mêla aux intrigues intérieures, favorisant les divers partis d'opposition et se déclarant publiquement l'adversaire de M. Thiers. La révélation inouïe de sa correspondance, faite dans l'année 1874, prouve qu'il fallut au gouvernement français la plus grande patience pour tolérer, près de lui, cette présence dangereuse et ce visage chagrin. L'esprit brouillon de l'ambassadeur finit par se tourner contre son propre chef, qui, sûr de la confiance de l'empereur, eut la force et l'autorité nécessaires pour rappeler aux règles de la discipline un haut fonctionnaire qui n'avait su, en somme, se ranger à aucun de ses devoirs. Or, M. de Bismarck, en faisant ce choix, savait à qui il avait affaire. Dès 1872, un des officiers généraux les plus autorisés de l'armée allemande, M. de Berg, s'exprimait en ces termes sur le compte de l'ambassadeur : Il n'est nullement l'homme qu'il nous faudrait à Paris... C'est un ambitieux malade et hypocondre ; il a persécuté son cousin Bismarck pour obtenir de lui le poste de Paris. Il le poursuit aujourd'hui pour en avoir un autre : il est mécontent ; il l'a été toute sa vie ; il le sera toujours et désirera toujours autre chose que ce qu'il a. Le comte de Beust raconte, de son côté, une anecdote à la
fois plaisante et concluante : Nous dinions à
Gastein, avec le prince de Bismarck, au Chalet suisse, dans une espèce de
gloriette, d'où l'on apercevait la rue. Tout à coup, nous remarquâmes
l'arrivée d'une chaise de poste et nous présumâmes que ce devait être le
comte d'Arnim, qui venait d'être nommé ambassadeur à Paris. J'envoyai
aussitôt quelqu'un au-devant, de la voiture et fis prier le comte d'Arnim de
dîner avec nous. Nous vîmes que la voiture s'était arrêtée, mais notre invité
ne se montrait point. Enfin, on découvrit qu'il était descendu et qu'il
s'occupait, derrière la chaise de poste, à changer de toilette, alors que
nous étions nous-mêmes vêtus d'un costume du matin : Et l'on ferait de la haute politique avec une créature de
ce genre-là ! dit Bismarck[29]. Vingt ans après, quand le prince de Bismarck écrit ses Souvenirs, et alors qu'il voudrait se montrer indulgent pour l'ambassadeur, il résume encore, en ces termes, son opinion sur l'homme qu'il avait choisi pour présider aux relations nouvelles entre la France et l'Allemagne : C'est grand dommage pour notre diplomatie, que les aptitudes peu ordinaires d'Arnim ne fussent pas servies par une sûreté de caractère et une loyauté à la hauteur de ses moyens. En 1871, ses défauts ne déplaisaient pas. Quoi qu'il en soit, les relations étaient rétablies entre les deux grands peuples qui venaient de se mesurer dans une guerre affreuse. En Allemagne, la joie du triomphe et le sentiment d'une autorité prépondérante ne donnaient pas une pleine confiance en l'avenir. Il y avait, après ce succès prodigieux, une amertume dans le cœur et : une sorte de désenchantement. En France, l'œuvre du relèvement était ébauchée, mais elle était encore bien frêle et restait exposée au caprice des événements. |