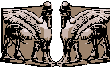HISTOIRE DES PERSES
LIVRE QUATRIÈME. — LES ACHÉMÉNIDES.
CHAPITRE IX. — XERXÈS.
|
Ici apparaissent pour la première fois et d'une manière très-claire, dans l'empire perse, les suites des inconvénients inhérents à la constitution des grands États. Nageant dans une atmosphère de pondre d'or, étincelants de richesses, formidables et imposants par leur masse, ils doivent finir par s'effondrer dans la boue, et les premiers symptômes de ce terrible affaissement ne tardent jamais à se montrer eu eux, bien qu'un laps de temps plus ou moins considérable puisse s'écouler jusqu'à ce que la ruine entière s'opère. Un immense État devient de bonne heure une sorte de corps inorganique dans lequel le rôle de l'intelligence est de plus en plus petit. Les hommes n'y sont plus comptés pour leur valeur intrinsèque, mais pour leur nombre ; les gouvernants pour leur mérite, mais pour leur puissance ; les faits pour les résultats naturels qu'ils doivent avoir, mais pour l'apparence d'opportunité dont ils sont revêtus ; et en général un besoin impérieux de faire vite rend témoignage du désir de repos qui domine une masse où l'engourdissement se glisse, et qui, ne se mouvant qu'avec peine, n'a d'autre mobile que le commandement violent et absolu, toujours irresponsable, toujours désintéressé de quoi que ce soit, sauf sa prolongation. Un orgueil démesuré chez le chef et chez les sujets, orgueil basé presque uniquement sur l'abondance des ressources matérielles, un profond ennui, un mépris chez les plus petits pour l'incapacité des plus grands, et chez les plus grands pour la servilité imposée aux plus petits, pour l'impuissance foncière de tous, devient à la longue le seul lien commun des hommes vivant dans de tels centres. La putréfaction se met vite et chemine inguérissable au milieu de cet organisme comprimé, et quand, sous un effort qui ne semble pas toujours bien fort, le colosse dont la tête était dans les nues s'écroule, empire perse, empire romain, empires chinois, empires indiens, laissent derrière eux une odeur viciée qui dégoûte autant l'histoire que les splendeurs de ces établissements gigantesques l'avaient surprise. Cyrus s'était donné la gloire de fonder la grande monarchie ; Darius lui avait imposé sa forme avec une autorité admirable sans doute ; mais rien ne prévaut contre les lois naturelles, et dès le règne de Xerxès, la pente descendante se trouva sous les pas des Achéménides. Ces princes avaient trop de ressources et l'empire était trop gigantesque pour tomber immédiatement ; mais s'il marcha avec lenteur vers sa ruine, il y marcha pourtant, et désormais ne se détourna plus de ce but funeste où le portait la pesanteur de ses pas. Darius laissait plusieurs fils qu'il avait eus de ses différentes
femmes. Le fait est également attesté et par les Grecs et par les Orientaux.
Ces derniers distinguent de tous les rejetons royaux Isfendyar-Mardanshah ou Mardonius,
et se plaisent à en faire le héros du règne. Non-seulement ils le constituent
vicaire de l'empire du vivant de son père, mais, par un effort qui ne leur
coûte aucun scrupule, ils prolongent jusqu'à son époque la vie de ce fameux
Roustem le Çamide, le plus éclatant des guerriers, afin de lui donner la
gloire de lutter contre un tel géant et de le faire périr de sa main. Mais d'autre
part, comme ils le disent fils de Kétayoun, la fille du roi d'Occident, et
que dans Kétayoun nous avons reconnu une personnification de Kythnos,
représentant la prise de possession des Cyclades ; qu'Isfendyar-Mardanshah se
trouve ainsi placé, comme Mardonius doit l'être, en rapport étroit avec les
entreprises dirigées contre Il semble que, sur ce point, la vérité est du côté d'Hérodote. Ce chroniqueur rapporte que parias, avant de parvenir au trône, avait eu trois enfants d'une fille de Gobryas, c'est-à-dire d'une sœur utérine ou germaine de Mardonius. Artobazanes était l'aîné ; mais Atossa, fille de Cyrus, avait ensuite donné à son époux, depuis roi, quatre fils, en tête desquels était Xerxès. Artobazanes et Xerxès prétendaient également à la succession, le premier en vertu du droit de primogéniture, le second comme fils d'une fille de Cyrus. Hérodote assure que la cour perse était embarrassée de
décider entre les deux rivaux, d'autant plus que Darius, sous l'influence
d'Atossa, penchait visiblement du côté de Xerxès, quand le roi spartiate
Démarate, venu à la cour pour ses affaires, conseilla à ce dernier de faire
valoir qu'il était venu au monde quand son père était roi, tandis
qu'Artobazanes n'était crue le fils d'un sujet ; il ajouta qu'on raisonnait
ainsi à Lacédémone. Il se peut que cet argument ait paru bon ; il se peut que
l'intrigant Grec qui le fournissait ait été écouté et consulté ; le temps
approchait où tous les aventuriers occidentaux allaient devenir les
conseillers favoris des Grands Rois ; en tout cas, Artobazanes fut débouté de
ses prétentions, et Xerxès devint l'héritier présomptif. Il monta sur le
trône aussitôt après la mort de son père, et rien n'empêche d'admettre que
les Çamides se soient à l'avance déclarés pour lui, ce qui devait être
assurément d'un poids plus considérable que les opinions de Démarate.
D'ailleurs Ctésias ne fait paraître ce prince errant à la cour de Suse que dans
le temps où Xerxès, déjà roi, organisait son expédition contre Les orientaux appellent Xerxès Artaxerxès ou Ardeshyr ; ceci ne constitue aucune différence sensible, arta n'étant qu'un qualificatif signifiant le grand. Ils disent aussi que le roi se nommait Bahman. Mais l'usage des titres, des surnoms variables est de toute ancienneté en Asie, de sorte que la même personne est désignée du façons fort différentes. Dans l'espace de peu d'années, le premier ministre de Nasr-Eddyn-Shah, aujourd'hui régnant, s'est appelé Myrza-Taghy-Khan, puis l'Émyr-Nizam. Il était l'Atabek quand il est mort ; mais l'exemple le plus curieux que je connaisse de cette mobilité ou, pour mieux dire, de cette inconsistance du nom, c'est le fait que voici et qui se reproduit sans cesse dans toutes les familles persanes. Un enfant reçoit en naissant le nom de son grand-père, soit, si l'on veut, Abdoul-Housseyn. Comme c'est le nom du grand-père, il serait irrespectueux de le prononcer ; on y substitue donc le titre d'aga, monseigneur, par lequel l'aïeul est toujours désigné. L'enfant, qui s'appelle Abdoul-Housseyn, sera donc appelé toute sa vie Aga, et de fait cette quantité énorme de Mirza-Aga et d'Aga-Khan que l'on rencontre. Chacun de ces personnages a un nom véritable sous ce nom qui n'en est pas un ; mais personne ne s'en informe, personne ne le sait, et il arrive que l'intéressé lui-thème, ne se l'étant jamais entendu appliquer, s'en soucie très-peu. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce que le successeur de Darius ait pu être nommé indifféremment, Vohumano, Xerxès et Artaxerxès. Les Persans ajoutent que c'est il lui qu'appartient encore le surnom de Dyraz-Dest ou Longue-Main, et qu'il lui fut donné à cause de l'étendue de ses conquêtes. Le Shah-nameh raconte peu de chose de ce prince. Bien que parvenu au trône par la protection des Çamides, il voulut d'abord, assure Ferdousy, venger la mort de son père Isfendyar et de ses oncles Housh-Azer et Mehrnoush. Il entra avec une armée considérable sur les terres du Seystan, battit son bienfaiteur et le fit prisonnier. Mais le fils de celui-ci, Fer-Amorz, que Ferdousy confond avec l'ancien héros de même famille et de même nom, comme il confond aussi le souverain d'alors avec Zal, continua la résistance, mais finit par être tué. Les Sakas et leur maison régnante étant ainsi abaissés, Ardeshyr-Bahman se laissa toucher par les observations de Peshouten, le conseiller ecclésiastique de son père Isfendyar, et rendit à Zal ses domaines. De retour dans l'Iran, il fut séduit par les charmes de sa
propre fille Homaï, surnommée Tchehrzad, et l'épousa, ce qui réduisit au
désespoir un fils qu'il avait déjà et qui se nommait Sassan. Ce jeune prince,
voyant que son père avait déclaré la reine héritière de la couronne à son
détriment, quitta la cour, et se réfugia auprès du feudataire de Nishapour,
dont il épousa la fille. Il mourut peu de temps après, laissant son lignage
en possession de cette contrée pastorale, où pendant des siècles ses
descendants, ajoute Ferdousy, ne régnèrent que sur des bergers répandus avec
leurs troupeaux dans les montagnes et dans les plaines. Le poète semble ici
n'avoir eu en vue que le soin de préparer de loin le droit des Sassanides à
la couronne, en les rattachant à d'anciennes origines souveraines. Après
Kishtasep-Darius, les Achéménides l'intéressent peu. Il en parle
sommairement, et se hâte d'arriver à Alexandre. Le fait est d'autant plus à
remarquer que les documents, du moins les indications, ne lui manquaient pas
pour s'étendre davantage. On en voit la preuve dans Hamza-Isfahany, qui a
travaillé à peu près sur les mêmes matériaux que le grand Aboul-Kassem.
Hamza, plus explicite, malgré sa brièveté, raconte qu'Ardeshyr-Bahman-Xerxès
a conduit de fort grandes guerres. Outre des triomphes éclatants remportés
sur les Çamides, il en eut de tels en Occident qu'il parvint jusqu'à Rome
même. Peut-être faut-il entendre ici la prise d'Athènes. Le conquérant fonda
plusieurs villes : une dans le Sawad, nommée Abad-Ardeshyr ; elle est située
sur le cours du Zab, et les gens du pays la nomment dans leur langue Haman ; une
autre, Bahman-Ardeshyr, ou mieux, du temps où écrivait l'auteur, Forat-al-Basrah,
dans le district de Meissan. Il se signala par sa piété, et, dans un seul
jour, dota le pays d'Ispahan de trois pyrées, une observation curieuse est
celle-ci : les annales juives, dit Hamza, appellent Bahman Koresh ; de la part de l'annaliste arabe, c'est une
allusion au livre d'Esther ; ainsi, dans l'opinion des contemporains de
Hamza, le charmant récit de Hamza donne Homaï-Tehehrzad pour héritière du trône
d'Ardeshyr-Bahman ; mais il ne dit nullement qu'avant été sa fille, elle
l'ait épousé. On le pourrait induire peut-être de ce que l'historien ajoute,
dans son catalogue des rois, que cette reine était fille de Bahman, fils
d'Isfendyar, et mère de Dara, fils de Bahman ; mais comme il n'est pas marqué
autrement que ce Bahman soit à identifier avec le père de la princesse ; que
le nom de Bahman, très-commun parmi les Mazdéens, a pu être porté par
plusieurs personnages, et cela d'autant plus que les mentes noms reviennent
sans cesse dans une même famille, ainsi qu'on l'a vu et qu'on le verra
encore, principalement pour les noms de Xerxès et de Darius, il semble que Hamza
n'a pas adopté l'opinion de Ferdousy sur le mariage incestueux du Grand Roi
père d'Homaï. En revanche, en insinuant que celle-ci a porté le nom de Shymyran,
il cherche a l'identifier avec Sémiramis. Il prétend qu'elle résidait à Balkh
; qu'elle envoya des troupes innombrables pour soumettre D'après le système d'Hamza, Homaï, résidant à Balkh, ne serait plus qu'une personnalité secondaire, malgré sa puissance et ses hauts faits ; son règne se confondrait avec celui de son prédécesseur et même de son successeur. Mais pour le moment, en ne s'occupant que de Xerxès, on voit par le rôle d'Homaï à son égard que, puisqu'elle réussit à lui faire déshériter Sassan, l'héritier légitime, elle exerce sur Ardeshyr-Bahman-Xerxès un très-grand crédit. Il y a ici un reflet marqué de cette puissance du harem dont le règne de Cyrus n'a présenté aucune trace. On l'a vue naitre sous Cambyse par l'intervention dans les affaires de la mère et des sœurs de ce prince. Elle s'est développée davantage sous Darius, en conséquence de l'autorité naturellement acquise à des femmes telles qu'Atossa et Artystone, filles de Cyrus, considérées par leur mari lui-même comme des représentantes plus directes que lui du prestige royal ; en même temps, une autre épouse, Parmys, fille de Smerdis et petite-fille de Cyrus, réclamait également un rang spécial, et une quatrième, la fille d'Otanès, qui, eu cette qualité, apportait en don à son mari l'appui des grands feudataires, ne pouvait pas non plus être sans prétentions. La cour devait, dès cette époque, s'être accoutumée à se fractionner en alitant de partis qu'il y avait de reines, sans parler des coteries formées sur un second plan autour des favorites. Après Darius, et sous Xerxès, l'empire du harem se maintint et se développa encore. Le pli était pris ; mille intérêts s'appuyaient sur l'intervention des femmes ; les eunuques régnaient. par elles, avec elles, sur elles ; il n'était plus possible que le train de la cour changeât, et au contraire l'intrigue domestique se marqua de plus en plus. Xerxès avait pour première épouse Amestris, fille d'Onophas, suivant Ctésias, et d'Otanès, suivant Hérodote. Comme Onophas ou Anaphas était le fils de ce dernier seigneur, le renseignement de Ctésias parait plus probable que celui de son rival ; car Otanès devait être fort âgé déjà à la mort de Darius, et d'ailleurs Amestris ne s'éteignit que longtemps après Xerxès et peu de jours avant son fils Artaxerxès, qui lui-même vécut très-vieux. On peut donc accepter qu'elle ait été la petite-fille et non la fille d'Otanès. Ce qui donne encore de la force à cette opinion, c'est que Xerxès était fort jeune quand il monta sur le trône, et nécessairement son épouse principale ne devait pas être plus âgée que lui. Elle lui donna trois fils, Darius, Hystaspes, Artaxerxès ; puis deux filles, Amytis et Rhodogune, et ces dernières, unies à leur mère, firent autant et plus de bruit dans la cour, dans les conseils et dans les camps, que tontes les souveraines du règne précédent n'en avaient pu faire. Amestris remplit sa longue vie de violences et de cruautés. Amytis ne valait pas mieux. Le nom de Homaï se rapporte à l'une ou à l'autre, peut-être à toutes deux ensemble. La continuation de leur crédit et de leurs menées sous les deux règnes de Xerxès et de son fils a donné naissance à l'idée persane que la reine Homaï, fille et épouse de Xerxès, avait régné de fait et seule entre lui et son successeur. Je ne dois pas omettre d'ajouter, pour donner une idée complète de l'anarchie où l'on était à Suse autour de Xerxès, qu'Atossa, suivant Eschyle, y vivait encore, et probablement avec elle quelques-unes de ses anciennes rivales ; ainsi, outre les querelles de la nouvelle cour, il y avait encore les antagonismes compliqués de l'ancienne. L'observation de Hamza-Isfahany que Xerxès ou Ardeshyr est le même prince que les Juifs appellent Koresh nous a ramenés au nom d'Ahasverus ou Akhasverosh porté par le Grand Roi mentionné au livre d'Esther, et nous avons ici la preuve qu'au dixième siècle de notre ère les Asiatiques, juifs et musulmans, identifiaient Xerxès avec le prince du livre hébreu. On veut aujourd'hui que la rédaction de cet ouvrage appartienne aux temps des Séleucides. Je n'en vois pas le motif. La peinture qu'on y trouve de la cour de Suse est exactement asiatique, et rien n'y montre le moindre reflet des mœurs grecques. Le Grand Roi, c'est-à-dire Xerxès, est dans la plénitude de sa jeunesse et de sa force. Il règne depuis les Indes jusqu'en Éthiopie sur cent vingt-sept provinces. Ici on s'aperçoit que l'auteur ne suit pas la division par satrapies, toute factice, toute conventionnelle, mais envisage les territoires d'après leurs différences réelles, telles que différences de nationalité, de culte ou de dynasties nationales. Depuis trois ans le souverain est monté sur le trône, et se reconnaissant bien établi contre ses rivaux, il convoque les seigneurs de ses pays et ses serviteurs, c'est-à-dire. les feudataires et les grands fonctionnaires de l'État, afin de les pénétrer tous de la solidité de sa puissance. Il ordonne une session de ces graves personnages qui durera cent quatre-vingts jours, c'est-à-dire six mois. Nous avons là un des rares monuments et des plus précieux témoignages d'une application de l'ancienne constitution iranienne. Ni la grandeur militaire du règne de Cyrus, ni la violence d'humeur de Cambyse, ni les travaux centralisateurs de Darius n'avaient pu détruire le principe essentiel du régime libre ; Xerxès lui-même, on le voit ici, fut contraint de réunir un parlement où, pendant six mois, il entendit, écouta, discuta les conseils et les prétentions de ses hommes, et soumit à leur assentiment les propositions qui l'intéressaient davantage. Il se montra alors en qualité de président des rois et non pas de souverain absolu, et de n'épie que Cambyse, malgré sa folie, n'avait pas cru pouvoir décider lui-même d'importantes questions et les avait commises a des hommes spéciaux, de même Xerxès, dans cette assemblée, dont la longue tenue implique une grande liberté de discussion, reconnut le droit des seigneurs à s'informer de tout et à prononcer sur tout ; il fit appuyer ses propres avis par les explications que ses mandataires, ses serviteurs, étaient chargés de fournir. Nous avons ici une cour des pairs en règle et suivant l'idéal des assises de Jérusalem. On ne saurait assez constater et admirer comme le même sang ramène toujours les mêmes institutions. Au bout de six mois, les affaires étant terminées et la clôture du parlement déclarée, le Grand Roi donna un festin d'adieu qui dura sept jours. Tout le monde y fût convié, non-seulement les seigneurs qui avaient pris part aux travaux législatifs et les officiers parlant pour la couronne, mais la population entière de Suse, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La fête eut lieu dans l'enceinte du pare royal, dont j'ai déjà eu l'occasion de laisser entrevoir la magnificence. De toute part, des voiles immenses défendaient les conviés contre les ardeurs du soleil ; les longues cordes qui les tendaient étaient passées dans des anneaux d'ivoire et les attachaient à de hautes colonnes de marbre. Ce n'étaient partout que pavés de mosaïque ingénieusement variés, savamment incrustés, et des peintures sans fin décoraient les détails infinis d'une somptueuse architecture. Le festin était digne d'un pareil cadre. Les mets étaient servis dans des plats et des tasses d'or ; le vin, abondamment versé, était offert dans des coupes, des vases, des amphores, des urnes du même métal. J'ai vu une ombre, un souvenir de ces anciennes somptuosités. Le roi de Perse a gardé la coutume, au jour ou le soleil entre dans le signe du Bélier, de recevoir en grande cérémonie les hommages de son peuple. A cette occasion, il est assis, couvert de pierreries et de perles, sur tut trône d'albâtre incrusté d'or, placé sous un kiosque, dans un des jardins royaux. Les princes, les grands de l'empire, les fonctionnaires publics de tous les rangs, les prêtres, les soldats, le peuple, sont disposés en groupes silencieux, debout, les bras croisés sur la poitrine, dans l'attitude du respect, aussi loin que la vue peut s'étendre. Les lions, les éléphants, les girafes, les animaux rares de la ménagerie royale sont amenés par leurs gardiens, et, au milieu du calme le plus profond, le souverain s'entretient de la situation de l'empire avec le premier ministre, auquel il demande à haute voix comment vont les affaires de l'État. Lorsque satisfaction lui a été donnée par le dépositaire de sa puissance, les serviteurs du palais s'approchent des vases d'or émaillé, d'argent travaillé, de porcelaines de Chine, de toutes formes, de toutes grandeurs, alignés sur le mur d'appui du kiosque et autour du bassin d'eau qui est toujours devant ce même kiosque, et y puisant des sorbets de différentes espèces, les font circuler parmi les assistants. En même temps, des employés du trésor distribuent à poignée des pièces d'argent amoncelées sur de grands plateaux. Le roi Xerxès avait voulu que son festin de sept journées, où l'on entrait et sortait librement, fût une occasion de joie et non de contrainte ; l'ordre était que chacun boirait à son gré et mangerait comme il l'entendrait, sans qu'aucun des seigneurs préposés à la présidence des tables eût le droit d'imposer une loi quelconque. On se contentait de maintenir le bon ordre. Cependant, tandis que les nobles et le peuple se
réjouissaient, la reine de son côté traitait les femmes dans l'intérieur de
ses jardins, et leur faisait goûter des plaisirs et admirer des magnificences
analogues à celles qui faisaient au dehors la joie des hommes. Cette reine
s'appelait Vasthi, dit Le septième jour, un peu avant le temps fixé pour le terme des réjouissances, le roi Xerxès, animé par le vin, commanda aux sept eunuques intendants du harem d'aller chercher la reine Vasthi, de lui mettre la couronne sur la tête, et de l'amener dans toute la pompe de son rang devant l'assemblée, afin que les seigneurs et le peuple pussent la contempler et voir sa beauté extraordinaire. Amestris, car je ne doute nullement que c'est d'elle qu'il s'agit ici, le nom de Vasthi ou Vahisti n'étant autre chose qu'un titre, Amestris refusa de se présenter ainsi en public, et le roi fut extrêmement irrité de cette désobéissance. Il y avait conflit en cette circonstance entre les impurs iraniennes et les habitudes sémitiques. Les mœurs iraniennes ne s'opposaient nullement à ce que les femmes se lissent voir au dehors ; elles permettaient même, sans aucune hésitation, que les deux sexes se réunissent à la même table ; c'était la conséquence des principes constants de la race ariane, toujours déférents, respectueux et confiants envers les épouses et les mères des guerriers ; mais la mode sémitique était tout autre ; ne considérant les femmes qu'au point de vue de l'amour, elle supposait qu'on ne pouvait les apercevoir sans les désirer, et trouvait nécessaire, en conséquence, de les tenir cachées ; en outre, ce qui était mystérieux et secret lui semblait plus vénérable. Ne pas se montrer ou se montrer rarement était, suivant elle, une prérogative essentielle du rang suprême. Xerxès, dans l'abandon de sa joie, avait pensé et commandé en noble iranien. Vasthi-Amestris s'en était tenue à l'usage adopté à Suse et à l'orgueil de son rang. L'opposition que le roi rencontrait en présence de tout son peuple et de la part de sa propre épouse lui parut constituer un fait si grave qu'il en fit immédiatement une grande affaire. S'il avait été le souverain absolu que nous supposons, rien n'était plus simple que de prononcer lui-même un arrêt sur la coupable et de le faire exécuter à l'instant. Mais ce n'est pas ainsi qu'il procéda. D'une part, agir despotiquement n'était guère opportun dans le moment où tous les chefs féodaux étaient rassemblés autour de lui précisément pour veiller au maintien des coutumes nationales ; ensuite c'était la fille d'Otanès, un des hommes les plus considérables de l'empire, envers lequel il n'eût jamais été à propos de prendre une détermination contraire aux lois. Xerxès présenta donc la question aux juges, qui, dit le texte, se tenaient toujours près de la personne du souverain, et sans lesquels l'État ne pouvait rien entreprendre. Ils jouissaient de cette haute prérogative, ajoute avec précision le livre sacré, parce qu'ils connaissaient les lois et les institutions des ancêtres[3]. Ces hommes si considérables étaient Charsena, Séthar, Admatha, Tharsis, Mérès, Marsena et Mémucan, tous princes des Perses et des Mèdes, ayant le droit d'approcher la personne royale alitant de fois qu'ils le jugeaient bon, et prenant place en toutes circonstances après le prince. Le titre de sar, que le
livre d'Esther emploie pour désigner les sept conseillers du Grand Roi, est,
à proprement parler, sémitique, puisqu'il apparait même dans La question avant été déférée à ce tribunal suprême dont l'autorité, parait-il, s'étendait jusque sur les membres de la famille régnante, le jugement fut rendu. Considérant que le refus d'obéissance de la reine dans une circonstance solennelle n'allait pas seulement à léser les droits du souverain, mais atteignait ceux de tous les hommes de l'empire, sans distinction de rang, en mettant en question l'étendue de la puissance maritale, il fut ordonné que, sauf l'agrément de Xerxès, un édit serait rendu et inscrit au code des lois des Perses et des Mèdes pour défendre à la reine Vasthi de paraître désormais devant le roi et pour transférer sa dignité à une autre femme meilleure qu'elle ; il était rappelé à cette occasion aux épouses, de quelque pas de l'empire et de quelque rang qu'elles fussent, d'avoir à plier sous la volonté de leurs maris. Le mot hébreu employé pour caractériser les lois des Perses et des Mèdes ne signifie nullement que le verdict rendu en cette circonstance ne pourrait pas être rapporté ; il est dit seulement que l'ensemble des luis perses et mèdes, perpétuelles ou transitoires, régit toutes les populations de l'État. Une telle clause était nécessaire, car les Égyptiens, les Ciliciens, les Bactriens, les peuples différents dont la réunion formait l'empire, possédant leurs lois propres, il importait de spécifier, lorsqu'une ordonnance était publiée, si elle s'ajoutait à la somme des prescriptions universellement obligatoires ou si l'action en était purement locale. En cette circonstance, le roi et ses conseillers voulurent, par un Grand exemple, agir sur la moralité de toutes les contrées soumises aux Achéménides dans lesquelles l'extension du luxe avait dû amener un relâchement dans les habitudes féminines, analogue à ce que l'on vit plus tard sous l'empire romain, et qui a fait faire aux gouvernements anciens tant de lois en pure perte. L'édit du roi Xerxès ne disait donc pas que la reine était répudiée à tout jamais et qu'elle ne pourrait pas être rappelée, mais seulement qu'il lui était défendu de paraître devant le prince et que sa place serait donnée à une autre femme. Elle était sévèrement punie ; il fallait que chacun le sût et reconnut pourquoi, à savoir que la désobéissance au mari entraînait un châtiment semblable ; mais il restait loisible au souverain, et partant à tout époux offensé, de ne faire durer la punition qu'aussi longtemps qu'il le jugerait opportun. Ce fut ce qui arriva pour Amestris, et après une retraite plus ou moins longue, la princesse reprit son rang et ses honneurs. Mais d'abord le monarque chercha des distractions à son veuvage dans des amours dont l'extrême inconstance semblerait indiquer le pouvoir secret que gardait l'épouse éloignée sur le cœur qui la repoussait. On amena des différentes provinces les plus belles personnes, afin de tenter le goût du roi. Aussitôt que ces filles arrivaient, elles étaient conduites dans un des palais intérieurs et remises aux mains des eunuques. Ceux-ci les soumettaient aussitôt au régime adopté comme le plus propre à développer leurs perfections. Pendant six mois, on les frottait avec de l'huile fine et de la myrrhe, afin de donner à leur peau toute la douceur et la finesse dont elle était susceptible, et ou multipliait les bains. Pendant six autres mois, ou faisait usage de parfums pénétrants, de cosmétiques précieux et d'une nourriture particulière. Quand les gens de l'art jugeaient qu'il n'y avait plus rien à ajouter aux moyens de perfectionnement, on annonçait à la vierge que le moment était venu de paraître devant son impérial amant. Ce qu'elle demandait alors, ce qu'elle désirait comme ajustement ou comme parure lui était immédiatement donné. On pensait sagement que son désir de plaire devait lui inspirer des idées auxquelles les théoriciens les plus raffinés en ces matières n'auraient pu atteindre. Le lendemain maths, la jeune lemme était conduite dans un nouveau palais sons la charge de l'eunuque Sahasgaz, gardien des concubines, et elle ne paraissait plus devant le roi, à moins que celui-ci ne la demandât expressément. Parmi les filles admises à être présentées au monarque, il se trouvait une juive dont le nom national était Hadassa, le myrte, mais qui avait reçu en entrant dans le harem le nom d'Esther, l'étoile. Elle était orpheline de père et de mère, et avait été élevée par son oncle Mardochée, qui, à la première nouvelle que l'on recrutait pour les plaisirs du roi, s'était empressé de présenter sa nièce, espérant beaucoup de la beauté extraordinaire d'Hadassa. En effet, Xerxès trouva la jeune fille fort à son gré, et comme elle avait mis de l'adresse dans ses rapports avec les eunuques chargés de sa conduite, elle les eut pour protecteurs et fut bientôt déclarée favorite. Mardochée menait un genre d'existence encore aujourd'hui très-ordinaire dans les grandes villes de l'Asie. Il sortait le matin de sa maison, allait au palais, et s'y promenant de cour en cour, ou passant des heures assis à l'ombre, à terre, dans un coin, avec les gens de sa connaissance, il faisait le nouvelliste et se mêlait subrepticement de beaucoup d'affaires. Les palais des grands sont encore aujourd'hui en Asie remplis de cette espèce de désœuvrés apparents, et les maîtres en sont bien aises, car cette foule réunie autour de hm puissance en est comme l'enseigne, la marque visible, la preuve et l'éclat. Beaucoup de ces gens, et en grand nombre, déjeunent et dînent de la. desserte de la maison ; la plupart sollicitent des grâces et les obtiennent quelquefois ; tous se pressent autour du grand personnage quand il monte à cheval ou qu'il en descend. Ils se font un honneur de marcher en cérémonie devant lui lorsqu'il fait des visites, et si par hasard ils sont remarqués, leur fortune s'en trouve bien. D'ailleurs ils parlent beaucoup et colportent des propos faux ou vrais du matin au soir. C'était ainsi que vivait Mardochée. Il comptait sur la faveur d'Esther pour rendre sa situation meilleure, et, avec l'esprit soupçonneux et prudent de sa race, il avait enjoint à la nouvelle favorite de ne dire à personne ni qui elle était, ni d'où elle venait, ni à qui elle tenait. Un jour, Mardochée eut le bonheur, dans ses entretiens avec les oisifs de la porte, de recueillir certains propos qui le mirent sur la trace d'une conspiration ourdie par deux des eunuques portiers du palais, Bigthan et Terès ; ceux-ci méditaient de s'emparer du roi et de le faire mourir. Sans doute il s'agissait de mettre à sa place quelqu'un de ses frères. Mardochée fit savoir sa découverte à Esther, qui en parla au roi. On fit des recherches ; les rapports furent confirmés et les deux eunuques pendus. Suivant l'usage, on inséra dans le journal du règne le fait tel qu'il venait de se passer ; puis, distrait bientôt par d'autres soins, on n'y songea plus. Cependant le principal ministre, l'homme en faveur auprès du prince, était alors un certain Haman, fils d'Hammédatha, que le texte sacré dit avoir été Agagien de naissance. Josèphe prétend que par cette désignation il faut entendre qu'il était Amalécite, descendu d'Agag. En tout cas, le roi l'aimait, et il était tout-puissant. Quand il arrivait le matin au palais, entouré de ses serviteurs et de ses clients, et que chacun de ceux qui étaient là se levaient avec respect et le saluaient, il avait remarqué plusieurs fois que Mardochée affectait de rester assis et de ne lui donner aucune marque de déférence. En vain les assistants, les domestiques du lieu faisaient-ils à cet égard toutes sortes d'observations, le Juif s'obstinait dans son impertinence, et à la fin Haman s'en offensa. Concentré et vindicatif, il feignit de mépriser l'offenseur ; mais il résolut de s'en prendre à toute sa nation quand il eut appris qu'il était de la race ennemie des Juifs. Cyrus, sollicité par les principaux zélateurs de ce peuple, avait permis de rétablir le temple de Jérusalem. Il avait rendu des décrets à cet égard ; mais, jusqu'alors la résistance des colons assyriens établis en Palestine et même le peu d'empressement que la masse des enfants d'Israël mettait à quitter le grand pays où elle vivait à l'aise pour aller jouir de la satisfaction assez stérile de retrouver une ancienne patrie, avaient paralysé l'enthousiasme des dévots et les bonnes intentions de la cour. Les rois perses étaient assez bien disposés pour les Juifs, parce qu'ils considéraient d'ordinaire, et avec raison, comme fournissant un contrepoids naturel à l'action des autres peuples sémitiques et en particulier des Assyriens ; mais quand ces rois avaient pour ministres des Sémites, il en résultait de nouveaux ajournements pour la question du rétablissement du temple, dont les partisans étaient représentés comme des sujets remuants, inquiets et dangereux. Haman donna cette couleur à son différend avec Mardochée, et le roi accueillit d'alitant plus volontiers les récriminations de son conseiller que celui-ci proposa de verser au trésor dix mille talents d'argent s'il lui était donné carte blanche pour terminer l'affaire à sa fantaisie. C'est ainsi que se résolvent encore en Asie la plupart des questions administratives. Haman reçut donc des mains de Xerxès l'anneau royal, avec l'autorisation d'en sceller quelque ordonnance qu'il jugerait à propos de faire, et qui recevrait ainsi force de loi. Investi de cette autorité, Haman se hâta d'adresser un rescrit à tous les satrapes des provinces, à tous les gouverneurs de villes, et bien plus à tous les chefs féodaux, pour qu'au nom du roi et à un jour dit on eût à arrêter les Juifs et à les mettre à mort. Les dépouilles des proscrits devaient rester aux exécuteurs, vrai moyen de stimuler leur zèle. Le massacre général était fixé au 13 du mois d'adar, c'est-à-dire du douzième trois. En apprenant cette nouvelle, les Juifs terrifiés tombèrent dans le désespoir. Plusieurs donnèrent des marques publiques de leur désolation en se recouvrant d'un sac et en se jetant de la cendre sur la tête. De ce nombre fut Mardochée, qui, en cet état, vint se coucher devant la porte du palais, mais n'entra pas dans les cours, comme il en avait l'habitude, car il n'était pas. permis de s'y montrer dans un semblable accoutrement. Esther, promptement avertie, fut dans la plus violente inquiétude, et elle s'empressa d'envoyer Hatash, un des eunuques royaux attachés à sa personne, pour savoir ce qu'elle devait penser et faire. Mardochée insista sur la nécessité d'agir auprès du roi. Esther s'y montra peu disposée. Elle objecta que ni elle ni personne n'avait le droit de se présenter devant le souverain sans être appelé ; qu'il y allait de la vie à enfreindre une telle loi ; que sa faveur n'était pas assez réelle pour lui en donner le courage, car il y avait trente jours que Xerxès n'avait demandé à la voir. Cette observation, jointe à celle-ci que le roi la faisait venir dans ses propres appartements et ne se rendait jamais chez elle, prouve clairement, d'après les usages constants des harems, que la belle Esther n'avait ni le rang ni les honneurs d'une épouse. Mardochée désapprouva la prudence de sa nièce. Il chargea l'eunuque de lui bien faire comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de la nation juive, mais qu'il s'agissait aussi d'elle-même, attendit que si ses coreligionnaires venaient à périr, elle périrait avec eux, tout habitante du palais impérial qu'elle part être, et les ennemis de sa race ne l'épargneraient pas. Du reste, qui pouvait savoir si son élévation inespérée n'avait pas été voulue de Dieu précisément pour la délivrance de son peuple ? Dans ce cas, comment oserait-elle se soustraire à la solidarité qui lui était imposée ? Esther céda enfin à ces encouragements mêlés de menaces, et fit dire à Mardochée que, malgré les défenses de la loi, malgré sa terreur extrême, elle lui obéirait et parlerait au roi ; que cependant elle allait jeûner, elle et ses suivantes, pendant trois jours et trois nuits, sans manger ni boire, et qu'elle suppliait la communauté juive d'en faire autant, afin d'adoucir l'Éternel en sa fureur. Mardochée lui promit ce qu'elle voulut, et reprenant espoir, quitta les abords du palais et se retira. Au bout de trois jours, et quand Esther crut avoir assez, jeûné et prié, elle se para de son mieux, et inopinément quittant ses chambres, apparut au milieu du parvis en face du trône placé devant la porte, sur lequel le roi se tenait assis. Elle apparut, dis-je, fort tremblante de l'action audacieuse qu'on lui imposait ; mais probablement aussi était-elle charmante, car Xerxès, au lien de s'irriter d'une infraction à une règle nécessaire pour le mettre quelque peu à l'abri des empressements tumultueux du harem, tendit vers la coupable son sceptre d'or, ce qui voulait dire qu'il lui pardonnait. Elle en toucha le bout, et le roi, amoureusement disposé et oubliant qu'il ne l'avait pas vue depuis trente jours, lui demanda : Que veux-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Fit-ce la moitié de mon empire, je te le donnerai ! Esther se borna à prier le roi d'accepter à souper chez elle ce même jour avec Haman, ce qui lui fut accordé. C'était une grâce signalée qui valait la peine d'être citée. Jusque-là, ainsi qu'on l'a remarqué, toute la faveur de la maitresse n'était pas allée plus loin que d'être appelée un peu plus souvent que ses compagnes ; mais recevoir le roi, le traiter avec le ministre favori, c'était de quoi la mettre hors de pair. Il était si explicable qu'elle attachât le plus grand prix à cette grâce, que, pour la mieux constater, elle demanda la répétition des mêmes bontés pour le lendemain, et Xerxès y consentit. De son côté, Haman n'avait pas moins sujet de se réjouir que la concubine juive. Il se voyait distingué par celle dont la beauté paraissait plaire au monarque ; il était admis à l'intimité des cieux amants, et il n'y a jamais eu de cours orientales on occidentales, fût-ce au temps de Xerxès ou à celui de Louis XIV, dans lesquelles une aventure comme celle-ci n'ait paru d'une valeur inestimable au plus puissant des favoris. Aussi celui-ci apprécia-t-il son bonheur comme il le devait. Il en fit trophée devant sa femme Zérès et devant ses amis, qu'il rassembla pour leur apprendre son triomphe ; mais il ajouta avec amertume : Je suis bien riche, j'ai de beaux enfants, le roi m'a élevé au-dessus de tous, enfin la reine Esther n'invite que moi au repas qu'elle donne à son maitre, et avec tout cela, je ne puis oublier l'insolence de ce Mardochée. A ces paroles, Zérès et les amis de la maison répondirent : Fais dresser un gibet haut de cinquante coudées, qu'on y pende Mardochée, et va t'asseoir joyeux au souper d'Esther ! Hauran fut aisément persuadé, et il donna ordre d'apprêter le supplice de l'homme qui le bravait. On voit du reste que, très-contrairement à ce qu'on s'imagine de l'arbitraire facile des fonctionnaires asiatiques, il n'est pas simple pour le favori de Xerxès de faire pendre un homme. Haman, à la vérité, s'y résout ; mais c'est un coup de tête ; il hésite ; ce n'est que poussé par la passion, encouragé par son entourage, enivré par de nouvelles apparences de crédit, qu'il ose faire disposer un gibet pour un misérable Juif. On peut juger d'après cela que dans l'empire perse personne ne disposait de la vie des sujets, et que lorsque la violence méditait quelque chose de pareil, c'était un crime dangereux pour les hommes les plus grands. Pendant que le ministre se laissait aller à ses colères, il se passait un événement auquel il était loin de s'attendre. Le roi avait souffert d'une insomnie pendant la nuit précédente, et s'était fait lire une partie du journal de son règne. Cet usage existe encore de nos jours, et le roi Nasr-Eddyn-Shah écoute assez fréquemment la rédaction de ce qu'il a dit ou fait, ordonné ou défendu dans telles ou telles circonstances ; il lit aussi ou fait lire devant lui les annales du règne de son père ou de son grand-père, et quelquefois il en est résulté des déterminations subites. Le passage lu devant Xerxès se trouva être le récit de la conspiration de Bigthan et de Téres, où Mardochée avait rempli un rôle si utile. Le roi interrompit le lecteur pour demander quelle récompense avait été accordée à ce Mardochée. Aucune, lui répondit-on. Le roi, scandalisé, s'informa si un de ses ministres n'était pas dans la salle d'attente, et précisément Haman venait d'y entrer, avec l'intention de solliciter du roi un arrêt de mort contre Mardochée. On voit qu'il avait réfléchi et ne parvenait pas à prendre sur lui d'ordonner l'exécution du Juif. Dans les républiques grecque et romaine, on assassinait sans tant de façons. Le roi ne laissa pas à Haman le temps d'expliquer ce qui l'amenait ; il le questionna sur le meilleur moyen d'honorer un homme que le roi voulait particulièrement distinguer. Le favori, jugeant que cet homme-là ne pouvait être que lui-même ne ménagea pas les distinctions ; il voulut que le triomphateur fût revêtu du vêtement royal, qu'on lui mit sur la tête la tiare sacrée, qu'on le fit monter sur le propre cheval du souverain, et enfin que la bride de ce cheval fût remise entre les mains d'un des plus grands seigneurs de la cour, qui le conduirait marchant à pied devant lui dans toutes les rues de Suse, en criant à haute voix : C'est ainsi qu'il faut faire à l'homme que le roi favorise ! Xerxès trouva ces propositions convenables, et ordonna à Haman d'aller de suite chercher Mardochée et de lui faire lui-même tout ce qu'il venait de dire. Cela eut lieu, et quand Haman, rouge de honte, rentra chez lui et raconta à sa femme ce qui venait d'arriver, elle devint soucieuse, et lui fit observer que si ce Mardochée était de la race des Juifs, ce qu'elle ignorait, les intrigues que lui, Haman, avait ourdies contre cette nation ne paraissaient pas en voie de réussir et pourraient bien finir par la ruine de leur auteur. Mais ce n'était pas le moment de s'étendre sur ce sujet, car les serviteurs du roi arrivaient pour conduire Hainan au festin de la reine. Cet usage est encore en vigueur, et quand quelqu'un doit aller à une audience royale, des domestiques du palais se présentent pour marcher devant le convié. Le repas était assez avancé, lorsque le roi, très-gai et animé par le vin et les grâces d'Esther, pressa celle-ci de lui faire enfin connaitre ce qu'elle souhaitait obtenir, en l'assurant de nouveau que rien ne lui serait refusé. Alors Esther n'hésita pas davantage : elle supplia qu'on ne la fit pas mourir, ni elle ni le peuple dont elle était sortie ; protesta que s'il ne s'était agi que d'encourir l'esclavage, son respect pour les ordres souverains lui aurait fermé la bouche, bien que le dommage souffert par le roi eût été tel que l'auteur de tant de maux n'eût jamais pu le réparer ; mais elle ne pouvait se résoudre ii mourir ignominieusement, elle et les siens, sans faire entendre ses plaintes. A une déclaration si inattendue, Xerxès, stupéfait, lui demanda ce qu'elle voulait dire et qui était cet ennemi qui la menaçait, elle et sa nation. Elle montra Hainan, et Xerxès, qui n'avait jamais eu l'intention d'exterminer une partie de ses sujets et qui croyait seulement avoir accordé la punition de quelques séditieux, ne sachant d'abord que répondre, troublé au milieu de ses plaisirs par l'apparition d'une de ces intrigues de palais que les princes redoutent par-dessus tout, se leva brusquement, et, sans répondre, passa dans le jardin. Haman, voyant le roi indécis, ne sut que faire et perdit la tête. Au lieu de suivre son maitre, il resta ; il se jeta comme un désespéré sur le lit où était couchée la favorite, il trama sur elle ses mains suppliantes. A ce moment, le roi rentrait ; sa colère éclata ; il crut, ou feignit de croire, que son ministre insultait la reine, et il s'en exprima avec tant de violence et d'un tel ton, que les serviteurs présents se jetèrent sur Haman et lui couvrirent la bouche et le visage, l'empêchant de parler. Harbona, l'un des eunuques, s'écria : Voilà ! même un gibet est tout
dressé dans la maison d'Haman pour ce même Mardochée qui a sauvé le roi ! Ce fut le coup de grâce ; le souverain fit un geste, on traina Haman jusqu'à la potence, où il fut lui-même suspendu. Esther et son oncle, leur race, tons triomphèrent. Les biens du supplicié furent confisqués au profil, de la favorite. Mardochée prit la place d'Hainan et reçut les sceaux. Il se montra désormais aux Susiens respectueux vêtu d'une robe blanche et d'un manteau de pourpre, coiffé d'une tiare d'or. On rechercha partout dans la capitale les complices d'Hainan et de sa conspiration. Plusieurs centaines de suspects furent unis à mort, et à leur tête les dix fils titi ministre tombé. Cependant le roi ne s' y était pas porté volontiers ; il
avait essayé de calmer l'emportement d'Esther ; mais elle avait sa parole, et
|