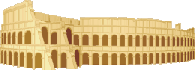HISTOIRE DES CLASSES PRIVILÉGIÉES DANS LES TEMPS ANCIENS
CHAPITRE XI. — Révolutions et Décadence de la République romaine.
|
Il n’y a pas de plus beau moment dans l’histoire de la République romaine que celui où les luttes intérieures des Patriciens et des Plébéiens ont abouti à l’égalité et à l’union, les guerres antérieures à la conquête et à l’organisation de l’Italie. C’est l’âge de la modération et de la force. La difficulté même des commencements de Rome lui avait été propice : au dehors, selon la sage observation de Montesquieu, la résistance opiniâtre de l’Italie lui avait donné des victoires qui ne la corrompirent point et qui lui laissèrent toute sa pauvreté[1]. Au dedans, l’aristocratie avait toujours su faire à la conservation de l’Etat, le sacrifice de ses privilèges, le peuple n’avait jamais perdu ce respect des grandes familles, de l’illustration du sang ou des services, qui semblait régler se choix et modérer ses passions. Les discordes même des deux ordres avaient entretenu une rivalité féconde pour le bien public, et un amour égal de la liberté et de la patrie, qui fit la gloire et la force des premiers Romains[2]. Mais Rome perdit sa pauvreté : après avoir conquis le monde, elle devint trop riche et ce fût la première cause de sa décadence. L’aristocratie de fortune prit la place de l’aristocratie de naissance, et contre celle-là, il faut le dire, la lutte fut moins féconde. La République se trouva partagée, non plus entre deux classes, l’une possédant tous les privilèges et les méritant, l’autre aspirant à les partager et digne du succès par cette seule ambition, mais entre deux castes, l’une composée de riches, l’autre de pauvres, l’une corrompue, l’autre avilie. Les esclaves composaient le reste, c’est-à-dire à plus grand nombre. Les mots sont encore les mêmes : on parle encore d’un côté, de Patriciens et de nobles, de l’autre, de Plébéiens et d’hommes sans naissance ; mais les choses sont changés. La pauvreté était jadis la vertu publique, et les richesses étaient dédaignées parce qu’elles ne donnaient pas la puissance. Plus tard la grandeur de l’Etat, dit Montesquieu, fit la grandeur dès fortunes particulières. Mais comme l’opulence est dans les mœurs et non pas dans les richesses, celles des Romains, qui ne laissaient pas d’avoir des bornes, produisirent un luxe et des profusions qui n’en avaient point. Ceux qui avaient d’abord été corrompus par leurs richesses le furent ensuite par leur pauvreté. Avec des biens au-dessus d’une condition privée, il fut difficile d’être un bon citoyen ; avec les désirs et les regrets d’une grande fortune ruinée ; on fut prêt à tous les attentats ; et, comme dit Salluste, on vit une génération de gens qui ne pouvaient avoir de patrimoine ni souffrir que d’autres en eussent[3]. Tite-Live, racontant que Rome, qui n’était encore que la première des cités du Latium, leva contre ses alliés rebelles dix légions,’ajoute avec douleur : A peine à présent Rome, que le monde entière ne peut contenir, en pourrait-elle faire autant si un ennemi paraissait tout à coup devant ses murailles : marque certaine que nous ne nous sommes point agrandis et que nous n’avons fait qu’augmenter le luxe et les richesses qui nous travaillent[4]. Richesse excessive d’un côté, de l’autre pauvreté extrême, double danger que les philosophés de l’antiquité et les législateurs de l’âge héroïque s’efforçaient d’écarter de leurs Républiques ; telle fut la cause des révolutions au milieu desquelles s’écroula la République romaine. I La défaite des Samnites et le triomphe de Curius Dentatus, au rapport de Florus, introduisit de grandes richesses dans la ville ; les Samnites avaient amassé depuis longtemps les dépouilles de l’Italie. La conquête des colonies grecques, enrichies par l’industrie et le commerce, acheva de donner à Rome une opulence qu’elle n’avait pas connue encore ou qu’elle avait dédaignée[5]. Trois ans après la prise de Tarente elle substitua à la lourde et modeste monnaie d’airain une monnaie d’argent[6]. Soixante ans après, la monnaie d’or s’ajoutait à la monnaie d’argent les dépouilles de la Sicile et les tributs de Carthage avaient accru à ce point la fortune publique et les fortunes privées. Qu’allaient donc faire bientôt les trésors de l’Orient, transportés dans la rude cité qui, à l’origine, ne connaissait d’autre butin de ses victoires que des gerbes de blé, dès troupeaux et de grossières armures[7] ? L’airain, l’argent, l’or changeaient aussi de valeur relative, et tout en était bouleversé. L’as d’airain, qui avait été la première monnaie des Romains, pesait une livre et avait conservé ce poids Jusqu’à la première guerre punique[8]. A la fin de cette guerre il est réduit à quatre onces, et trois années après à deux onces[9]. La dépréciation continua encore, et l’as se réduisit enfin à une demi-once. La proportion fut à peu près la même pour la monnaie d’argent : le denier d’argent valut d’abord dix as et fut de quarante à la livre ; il fut ensuite de soixante-quinze, et enfin de quatre-vingt-quatre à la livre, et sa valeur s’éleva à seize as du nouveau poids[10]. Quel fut le résultat de cette altération ? La division des classes de Servius s’était maintenue, et la fortune qui au temps de Servius, donnait accès qu’à la dernière Classe, pouvait désormais ouvrir la première[11]. Il fallait donc que l’antique organisation de la cité, fondée sur le cens, disparût ou se modifiât. Elle se modifia en effet, mais insensiblement et sans que les historiens aient pu marquer nettement, le temps où ce changement fut accompli, ni quelles furent les conditions nouvelles. Tout ce qu’on peut affirmer c’est que la constitution de Servius Tullius, dans son ancienne forme, n’existait plus au temps de la seconde guerre punique, et que la révolution datait peut-être de l’intervalle entre cette guerre et la précédente. Les Classes seules s’étaient maintenues, et les modifications avaient atteint surtout le cens et les centuries. Un texte de Tite-Live permet de conjecturer, avec quelque probabilité, quel fut le cens nouveau érigé pour les cinq Classes. Dans les dangers de la seconde guerre punique le Sénat venait de mettre sur pied vingt-deux légions et d’équiper une flotte redoutable. Des matelots manquaient : pour y suppléer, le Sénat accorda aux Consuls le décret suivant : Tout citoyen dont la fortune, sous le Censure de L. Semilius et de C. Flaminius, avait été recensée de cinquante à cent mille as, devait fournir ;un matelot avec six mois de solde ; de cent mille as à trois cent mille, trois matelots avec une année de solde ; de trois cent mille as à un million, cinq matelots ; au-delà d’un million, sept matelots ; les Sénateurs devaient donner huit matelots avec une année de solde[12]. En s’appuyant sur ce texte, on peut croire que la fortune, pour la première Classe, devait être d’un million d’as et plus ; pour la seconde, de trois cent mille à un million ; pour la troisième, de trente trois cent mille, pour la quatrième ; de cinquante à cent mille, pour la cinquième, au-dessous de cinquante mille. En dehors des Classes restaient toujours les pauvres, cette foule de citoyens qui ne vira bientôt que des distributions du trésor. Mais l’organisation des Classes, ainsi modifiée, était loin d’avoir gardé son importance, et toute la révolution n’était pas dans l’élévation du cens. Si les centuries avaient toujours été réparties, comme le voulait Servius Tullius, de manière a laisser la prépondérance aux deux premières Classes, l’État serait tombé aux mains des Ærarii, des affranchis, dont le nombre croissait sans relâche. Eux seuls avaient les profits du commerce et de l’industrie, que le citoyen dédaignait ; et, malgré les lois, ils vivaient et s’enrichissaient par l’usure. Depuis que la loi Pœtilia, pour adoucir la législation des dettes, avait livré la propriété du débiteur et garanti sa personne, la propriété saisie en gage était comptée dans le cens du créancier détenteur ; le débiteur perdait son rang dans les Classes, c’est-à-dire ses droits politiques ; et le créancier en prenait possession à sa place[13]. Cela explique pourquoi l’influence des Classes fut transportée aux Tribus, et pourquoi aussi les Ærarii, comme nous l’avons vu, depuis la trop célèbre censure d’Appius, jusqu’au tribunat de Clodius, s’efforcèrent sans cesse de pénétrer dans les Tribus. C’était le dernier effort de la cité pour fermer son enceinte aux intrus qui allaient la corrompre. La population de la cité romaine, à l’origine et quand les Patriciens étaient encore seuls citoyens, ne comprenait que trois Tribus[14]. Servius Tullius, par une division nouvelle qui embrassa les Plébéiens, porta le nombre des Tribus à trente[15]. Au commencement de la République, les victoires de Porsenna et des Etrusques, quel que soit le récit de Tite-Live ; restreignirent singulièrement le territoire romain : dix Tribus de la rive droite du Tibre disparurent par la conquête de leurs terres[16]. Les trente Tribus de Servius Tullius furent ainsi réduites à vingt. Mais Rome recommença à conquérir en même temps des citoyens et des sujets. La première Tribu qui s’ajouta aux anciennes fut la tribu Crustuminienne, ainsi désignée du nom d’une ville conquise sur les Sabins[17] Le nombre s’accrut successivement par les victoires et les traités de Rome jusqu’à trente-cinq. Les Etrusques en formèrent quatre, les Tribus Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis[18] ; les Latins deux, Mœcia et Scaptia[19] ; les Volsques deux, Pomptina et Publilia[20] ; les Ausones deux, Ufentina et Falerina[21] ; les Èques deux, Aniensis et Terentina[22] ; les Sabins deux, Velina et Quirina[23]. Le dénombrement de Servius avait donné 84.700 citoyens ; le cens de la deuxième année de la République 130.000[24] ; celui de la deux cent cinquante-cinquième année de Rome donna 150.700 citoyens[25]. Au commencement des guerres puniques le recensement s’éleva à 292.334 citoyens en état de combattre, et à 1.200.000 âmes[26]. C’était assez pour tenir en respect le reste de l’Italie. Les Tribus avaient formé à l’origine une assemblée toute plébéienne, que les chefs du parti populaire avaient opposée à l’assemblée noble des Curies, aux comices aristocratiques des Classes et des centuries. La cité comprenait alors comme deux peuples séparés et ennemis. Nous avons vu l’histoire de leur lutte. Lorsque l’égalité fut établie, et que les Patriciens et les Plébéiens, en restant par le fait deux ordres distincts, ne formèrent plus qu’un seul et même peuple, la distinction des assemblées cessa : les Curies perdirent leurs privilèges ; les Classes et les Centuries se confondirent avec les Tribus. Nous avons eu occasion de remarquer que les Patriciens avaient pu rester volontairement en dehors des Tribus, mais que, selon toute probabilité, ils n’y avaient jamais été étrangers ; la plupart des Tribus primitives tenaient même leurs noms des grandes familles patriciennes. Le rapprochement eut lieu naturellement et sans obstacles. Il commença par la fusion des Centuries et des Tribus : les Tribus adoptèrent la vieille division des centuries de jeunes gens et de vieillards, née jadis des conditions d’âge mises au service militaire. Chacune d’elle se divisa en Juniores et Seniores[27]. Les Classes avaient été pendant quelque temps comme oubliées : elles n’existaient plus que sur les livres des Censeurs, qui, pour répartir l’impôt, soumettaient à cette division même les Tribus[28]. Le Sénat parait avoir profité de la dictature, que lui remit de lui-même le peuple, pendant la seconde guerre punique, pour leur rendre leur rôle politique. Les catégories de fortune furent rétablies vers cette époque ; mais dans un sens plus démocratique que ne l’avait voulu le roi Servius[29]. C’est le témoignage de Denys d’Halicarnasse[30], et peut-être cela veut-il dire qu’il n’y eut plus dans la distribution des centuries la même inégalité[31]. Les indications incomplètes de Cicéron, de Tite-Live, de Denys sur cette question, si importante pour les destinées de l’aristocratie romaine, ont donné naissance à bien des systèmes. Nous n’avons pas à les discuter. En dehors des opinions de Niebuhr, toujours exclusives et absolues[32], le système le plus vraisemblable nous paraît être celui de Savigny, d’après lequel chaque Tribu aurait été répartie en cinq Classes, et chaque Classe en deux Centuries. En combinant ainsi les cinq Classes et les trente-cinq Tribus, on aurait porté le nombre des Centuries, à trois cent cinquante, moitié de jeunes gens, moitié de vieillards[33]. Enfin à ce nombre s’ajoutaient encore les Centuries équestres, qui avaient mieux conservé leur ancien état. Tite-Live affirme, en effet, que la division des Tribus en Centuries de Juniores et Seniores avait doublé leur nombre, sans doute dans les Classes[34]. Son témoignage s’accorde également avec Cicéron sur le maintien des Classes. En l’an 69, il parle des Centuries de Chevaliers et des Centuries de la premier Classe. Cicéron, racontant l’élection, de Dolabella son gendre, rapporte ainsi l’ordre du vote[35] : d’abord la Centurie prérogative tirée au sort, puis la première Classe, puis, selon la coutume, les suffrages des Chevaliers ; et enfin la seconde Classe. S’il ne parle pas des Classes suivantes c’est que dans ce système, comme dans celui de Servius Tullius, la majorité pouvait être acquise avant d’arriver à la troisième ou du moins à la quatrième Classe[36]. C’est toujours l’antique maxime de la politique romaine : que la plus grande puissance ne soit pas donnée au plus grand nombre[37]. Les riches ont perdu leurs prérogatives ; eux seuls ne décident plus de toutes choses comme au temps où la première Classe avait à elle seule la majorité des suffrages. Les Chevaliers ne votent plus les premiers, et la Centurie prérogative, dont le vote était regardés comme un présage, est tirée au sort dans chaque assemblée. Mais la prépondérance est restée à la classe moyenne, c’est-à-dire à celle qui est le plus intéressée à l’ordre et au maintien des lois. La cité romaine évite ainsi de tomber dans les excès de la démocratie par ce sage équilibre de la noblesse et du peuple, elle est encore toute aristocratique dans ses principes et dans ses institutions. Et quand de nouvelles Tribus seront formées, pour admettre encore une fois les vaincus au droit de cité ; nous verrons que les anciens Romains se réserveront une légitime influence[38] : les trente-cinq Tribus voteront avant les Tribus nouvelles, c’est-à-dire que les nouveaux venus n’auront même pas à voter ; comme les Plébéiens d’autrefois, ils ne jouiront que d’un honneur inutile. II Le danger n’était pas encore dans l’altération des institutions, mais dans l’altération des mœurs, et c’était là ce qui allait tout compromettre. Les Romains, dit Polybe, conservèrent la pureté de leurs mœurs jusqu’aux guerres d’outre-mer[39]. Et ailleurs : Une fois la Macédoine subjuguée on crut pouvoir vivre dans une entière sécurité et jouir tranquillement de l’empire du monde. Le plus grand nombre des citoyens vivaient à Rome dans un dérangement étrange. L’amour emportait la jeunesse aux excès les plus honteux. On s’adonnait aux spectacles, aux festins, au luxe, aux désordres de tout genre, dont on n’avait que trop évidemment pris l’exemple chez les Grecs pendant la guerre contre Persée[40]. Rome, dit Plutarque, dut à l’étendue de son empire et à la multitude de peuples devenus ses sujets, une grande variété de coutumes et les manières de vivre les plus opposées[41]. Écoutons aussi le témoignage d’un écrivain latin, qui sut peindre avec éloquence la corruption romaine après l’avoir partagée : Lorsque la République se fut agrandie par de laborieux efforts et par la justice, que les rois les plus puissants eurent été vaincus, les nations sauvages et les grands peuples domptés par la force, que Carthage, rivale de Rome, eut été détruite jusqu’en ses fondements, que sûr terré et sur mer tout fut assujetti à la domination romaine, il se fit une révolution admirable dans tout le corps de l’Etat. Ceux que ni les travaux, ni les dangers, ni l’adversité n’avaient pu vaincre, se laissèrent prendre au charme du repos, de l’abondance et de la prospérité. La cupidité et l’ambition, sources funestes de tous les maux, s’accrurent avec la puissance de Rome. La cupidité chassa la bonne foi, la probité et toutes les autres vertus ; elle mit à leur place l’arrogance et la cruauté ; elle apprit à mépriser les dieux et à trafiquer de tout ; l’ambition, à son tour, introduisit la dissimulation, la fourberie, la perfidie, et bientôt après les violences, les cruautés et les meurtres[42]. La corruption commença par atteindre la religion, dont les premiers législateurs avaient fait comme la gardienne de la cité. Le doute, avec ses funestes conséquences, envahissait les esprits. Si l’on cite encore la piété du grand Pontife Metellus, mort en voulant sauver des flammes le Palladium[43], c’est déjà une exception. Le Censeur Appius avait autorisé les Potitii à laisser aux esclaves de leur maison le soin des sacrifices d’Hercule. Le Consul Junius dédaignait les auspices, et son collègue Claudius Pulcher jetait à la mer les poulets sacrés. A la journée solennelle, d’Aquilonie, Papirius Cursor avait engagé la bataille malgré les présages, et s’était moqué de Jupiter en ne lui promettant qu’une coupe de vin miellé pour action de grâces de la victoire[44]. Les esprits se croyaient plus forts parce qu’ils méprisaient les superstitions antiques, niais .c’était seulement pour réclamer le droit de ne rien croire, et le scepticisme se trouva plus dangereux que la crédulité. S’il y a des dieux, disait Ennius, le poète des guerres puniques, assurément ils ne à s’inquiètent guère des choses de ce monde[45]. C’était déjà l’athéisme, ou au moins l’indifférence des hommes excusée par l’indifférence prétendue de la divinité. Dès que la religion fut ébranlée, on put comprendre que la Société allait changer ou que déjà elle n’était plus la même. La religion romaine était condamnée à cette fin par sa
nature même et son origine. Ce ne fut, dit Montesquieu,
ni la crainte ni la piété qui établit la religion
chez les Romains, mais la nécessité où sont toutes les Sociétés d’en avoir
une. Les premiers Rois ne furent pas moins attentifs à régler le culte et les
cérémonies, qu’à donner des lois et bâtir des murailles. Je trouve cette
différente entre les Législateurs romains et ceux des autres peuples, que les
premiers firent la religion pour l’Etat, et les autres l’Etat pour la
religion. Romulus, Tatius et Numa asservirent les Dieux à la politique, le culte
et les cérémonies qu’ils instituèrent, furent trouvés si sages, que, lorsque les
Rois furent chassés, le joug de la religion fût le seul dont ce peuple, dans
sa fureur pour la liberté, n’osa pas s’affranchir. Quand les Législateurs
romains établirent la religion, ils ne pensèrent point à la réformation des
mœurs ; ni à donner des principes de morale ; ils ne voulurent point gêner
les gens qu’ils ne connaissaient pas encore. Ils n’eurent donc d’abord qu’une
vue générale, qui était d’inspirer à un peuple qui ne craignait rien la
crainte des Dieux, et de se servir de cette crainte pour le conduire à leur
fantaisie. Mais que pouvait être une religion inventée par calcul,
acceptée par ignorance et superstition,-conservée par intérêt qu’on avait
rendue inséparable de tous les actes de la vie privée et de la vie publique,
dont on avait fait la base de l’Etat, pour laquelle ses ministres mêmes ne
pouvaient avoir ni foi, ni respect ? Elle dégénéra en vaines formalités, en
cérémonies toutes matérielles ; elle ne fut plus qu’un culte vide et muet,
qui touchait les sens ; mais ne parlait ni au cœur, ni à l’esprit. On finit
même par en soumettre ouvertement les pratiques à l’intérêt du moment : les
auspices parlèrent comme on le souhaita ; les présages parurent à volonté. Un
Fabius, étant augure, tenait pour règle que tout ce qui était avantageux à la
République,se faisait sous de bons auspices[46]. Mais deux
augures ne pouvaient, disait le proverbe, se rencontrer sans rire : c’est
l’aveu de Caton et de Cicéron. La corruption de la religion, comme celle des mœurs commença par l’invasion des idées et des superstitions étrangères. D’abord les Dieux de la Grèce vinrent prendre la place des Dieux austères et rudes de la vieille Italien puis Rome s’ouvrit aux Divinités plus dangereuses, encore de l’Orient. Sérapis, Isis, avaient déjà des temples à Rome au moment où commençait la guerre d’Annibal, et il fallut que le Sénat les fit démolir[47], profitant des erreurs de cette guerre, pour ranimer les croyances nationales. Et cependant le Sénat lui-même donna l’exemple d’appeler les Dieux étrangers. Il fit rapporter, de Phrygie à Rome, la pierre noire sous la forme de laquelle on adorait Cybèle. Un Scipion, le plus honnête homme de la République, fut chargé de cette mission. A mesure que la guerre se prolongeait, avoue Tite-Live, les esprits flottaient, selon les succès et les revers. Les religions étrangères envahissaient la Cité : on eût dit que les Dieux où les hommes s’étaient tout à coup transformés. Ce n’était plus en secret, ou dans l’ombre des murs domestiques, que l’on outrageait la religion de nos pères en public, dans le Forum, dans le Capitole, on ne voyait plus que femmes sacrifiant ou priant selon les rites étrangers[48]. Vers la fin de la guerre, le Sénat ordonne des sacrifices à Apollon, selon le rite grec[49]. On avait envoyé chercher à Epidaure la statue d’Esculape. Vénus Erycine eut bientôt le droit de cité. Les Bacchanales révélèrent un jour les scandales secrets qui préparaient la dissolution des mœurs. Ces fêtes immondes, empruntées de l’Orient, étaient arri6ées à Rome par l’Etrurie et la Campanie. A Lavinium, on les célébrait publiquement pendant un mois. A Rome les initiés les changèrent en mystères, et ajoutèrent à la débauche effrénée tous les crimes. La découverte de ces infamies épouvanta les magistrats. Sept mille coupables périrent sous la hache, ou dans les supplices par lesquels l’autorité du père de famille vengeait l’honneur domestique. Les rigueurs s’étendirent à toute l’Italie, malgré la liberté laissée aux municipes ; mais que pouvaient désormais les rigueurs ? Le mal était sans remède. L’histoire abonde désormais en exemples de la décadence des
anciennes vertus, et ce sont les noms les plus glorieux que l’on y trouve
avec regret flétris par des héritiers dégénérés. Les
légions de Manlius, dit Tite-Live, rapportèrent
à Rome le luxe et la mollesse de l’Asie. Elles introduisirent les lits ornés
de bronze, des tapis précieux, les voiles et les tissus déliés. Ce fut depuis
cette époque qu’on fit paraître dans les festins des chanteurs, à des
baladins et des joueuses de harpe ; qu’on mit plus de recherche dans les
apprêts des repas, et qu’un vil métier passa pour un art[50]. Les marchands,
les affranchis, les esclaves s’enrichirent pour voir la table des riches, à
satisfaire leurs caprices, à servir leurs débauches. Le prix d’un bon
cuisinier monté à quatre talents et celui d’un beau poisson dépassé celui-ci un
attelage de bœufs ou d’un chariot fertile[51]. L’ivoire, les
bois précieux, les marbres d’Afrique, les vases ciselés, les statues de
bronze, d’argent, d’or, suffisent à peine au luxe des villas. Drusus a onze
mille livres de vaisselle d’argent. Metellus bâtit un temple tout de marbre. Caïus
Gracchus lui-même, qui paraissait tempérant et sobre comparé aux autres Romains,
avait acheté des tables de Delphes, en argent massif, au prix de douze cent cinquante
drachmes la livre pesant[52]. Les rigueurs de la Censure et les lois somptuaires ne pouvaient rien contre ces désordres. Les mœurs seules faisaient jadis la force de la loi ; leur altération la réduisait à l’impuissance. Plus de trente Sénateurs avaient été dégradés depuis la seconde guerre punique. Le rigide Caton surtout avait frappé d’impôt les meubles de luxe, exclu de l’ordre équestre Scipion l’Asiatique, du Sénat L. Flaminius, et le fils même de Scipion l’Africain, alors préteur en charge. Il avait fallu nommer un curateur à Fabius Maximus. Mais bientôt, la Censure elle-même, était devenue le prix de la brigue, et l’on m’ait vu investi de cette magistrature suprême Valerius Messala, autrefois noté. Et avant lui, un autre censeur, Lepidus, prince du Sénat, et grand pontife, avait employé l’argent du trésor à construire une digue pour préserver ses terres de l’inondation. Acilius Glabrion était accusé de concussion au moment même où il briguait la Censure. Un Fulvius Nobilior était dégradé par son frère pour avoir vendu des congés à ses soldats. Un Metellus désorganisait et ruinait son armée en Espagne, par dépit contre son successeur. Pour Rome comme pour toutes les républiques de l’antiquité la corruption des mœurs privées était un danger public. La constitution et la liberté étaient nées des mœurs, et devaient tomber avec elles[53]. Le merl n’était pas venu seulement de l’importation des richesses et du ln e dès- peuples vaincus. Il vint surtout de ce que Rome avait en quelque sorte conquis sa civilisation comme son Empire, et qu’elle transporta dans son sein, avec les dépouilles des vaincus, leurs idées et leurs vices. Elle passa subitement de la pauvreté, de la simplicité, de 1’ignorance au luxe, aux arts, aux raffinements, aux subtilités, à la mollesse de la Grèce et de l’Orient. Elle fut séduite par ces sociétés décrépites et dégénérées ;’ leurs vices et 1èurs.sciences- l’étonnèrent d’abord ; puis elle y prit plaisir et vanité, elle s’en empara par droit de conquête, et elle finit par y périr[54]. Un jour les Athéniens envoyèrent à Rome trois députés, le stoïcien Diogène, le péripatéticien Critolaüs et le sceptique Carnéade. Les trois ambassadeurs se souvinrent qu’ils étaient philosophes et eurent l’idée de tenter la conversion des Romains par des leçons publiques. La jeunesse accourut en foule. La vertu est le seul bien et le vice le seul mal, disait Diogène. Le but de la vie est l’exercice parfait de la raison, disait Critolaüs. On les admira, mais, on ne les comprit pas. Carnéade seul fut applaudi : il enseignait l’indifférence et le doute, il soutenait avec la même éloquence le pour et le contre. Les Romains, étrangers aux subtilités de l’esprit grec, crurent voir dans le doute universel une preuve de force. Caton s’alarma[55]. Renvoyons chez eux, dit-il, ces habiles parleurs. Ils persuadent tout ce qu’ils veulent, et l’on ne saurait démêler la vérité à travers leurs arguments. Mais Caton lui-même avait protégé auparavant Ennius ; le traducteur du livre d’Evhémère, où était révélée l’origine du culte des principaux Dieux. Scipion Emilien protégeait l’historien Polybe, qui niait la Providence et réduisait la religion à la politique, et le stoïcien Panœtius, qui niait l’immortalité de l’âme. Les philosophes et les rhéteurs grecs furent chassés de Rome ; mais leur influence y resta, et elle y devint souveraine. On ne chassa ; d’ailleurs que les maîtres, on garda la foule obscure, accourue à Rome pour exploiter la corruption naissante, les esclaves ; les artistes, les précepteurs, les parasites, race méprisée et honnie, mais que chacun mit son amour-propre à rechercher : ils avaient tant de finesse d’esprit et parlaient si bien. L’antique éducation italienne et étrusque fit place à l’éducation grecque les plus illustres Romains confièrent leurs enfants à ces pédagogues ; avilis presque tous par l’esclavage, et dont le premier soin fut de leur enseigner le mépris des anciennes coutumes et des croyances de leurs aïeux[56]. C’était pour cela que Polybe reprochait à la constitution romaine de laisser uniquement au père de famille l’éducation des enfants. C’est une contradiction dans toute société, où les vertus privées sont en même temps des vertus publiques et où l’homme est avant tout citoyen. On vit bientôt les résultats de cette condescendance malheureuse aux mœurs étrangères : J’entrai dans une école où les nobles envoient leurs fils, dit Scipion Emilien ; grands Dieux ! j’y trouvai plus de cinq cents jeunes filles et garçons, qui recevaient, au milieu d’histrions et de gens infâmes, des leçons de lyre, de chants et d’attitudes. Et je vis un enfant, âgé de douze ans, le fils d’un candidat, exécutant une danse digne de l’esclave le plus impudique[57]. On avait commencé par mettre en honneur la langue grecque. Scipion le premier Africain et Lœlius, son ami, avaient donné l’exemple. Paul-Émile et Flamininus l’apprirent en conquérant la Grèce et la Macédoine. Scipion Emilien savait Homère par cœur et le citait souvent. Caton lui-même, après avoir combattu toute sa vie les modes nouvelles, prit un maître de grec à près de quatre-vingts ans. Ennius, le premier poète national, ouvrit une école de grec sur l’Aventin, et le commentateur d’Homère, Cratès de Malles, venu à Rome, fut bientôt entouré d’une foule nombreuse[58]. Deux poètes satiriques, Nævius et Lucilius, protestèrent par leur esprit contre cette invasion des idées et des mœurs étrangères. Le campanien Nævius, au milieu des imitateurs et des plagiaires de la Grèce, se plut à peindre les mœurs nationales ; et comme les nobles donnaient l’exemple du dédain pour les antiques vertus de Rome, il se fit l’ennemi des nobles ; comme le peuple proprement dit était encore étranger à cette influence[59], il emprunta ses idées et ses sujets à la vie populaire ; comme enfin la langue grecque était l’idiome des idées nouvelles, il n’accepta pas même l’hexamètre, emprunté par Ennius à Homère, et il resta fidèle au rythme national, au vers saturnin. Les nobles, les Claudius, les Metellus, les Scipion, ne lui pardonnèrent pas ; la loi des Douze Tables le condamnait à mort ; les tribuns le sauvèrent ; il mourut exilé et persécuté, et ses adieux à la vie ne démentirent pas son patriotisme : Que les immortels pleurent les mortels, ce serait chose indigne. Autrement les déesses du chant pleureraient Nævius le poète. Une fois Nævius enfoui au trésor de Pluton, ils ne surent plus à Rome ce que c’était que parler la langue latine. Le peuple seul se souvint de lui, et donna son nom à l’une des portes de la ville[60]. Lucilius, riche Chevalier, ami de Scipion Emilien, railla plus impunément les riches et les pauvres, le peuple et les grands. Consuls et Triomphateurs, les Metellus, Carbon, Opimius, meurtrier des Gracques, Cassius, Cotta, Torquatus ; Lupus, le juge corrompu, Gallonius le concussionnaire, furent châtiés par ses satires. Il fut populaire à sa mort, les citoyens voulurent, dit-on, faire les frais de ses funérailles. Et Lucilius cependant, en flagellant les vices de son temps, en poursuivant les nobles qui se croyaient tout permis par leur naissance, les riches pour qui l’or tenait lieu de vertu, était atteint lui-même de cette maladie du scepticisme et de l’impiété. Le représentait les douze Grands Dieux se moquant en conseil des mortels qui leur donnaient le titre de Pères, et Neptune embarrassé dans une discussion, dont Carnéade lui-même ne se tirerait pas. Plaute s’autorisait d’Aristophane pour être moins respectueux encore. Pacuvius attestait la décadence, de l’amour de la patrie, cette vertu dont la chute précède celle de la liberté : La patrie ! s’écriait-il, elle est où l’on vit bien ! III Pendant que de trop grandes richesses corrompaient une partie des citoyens et altéraient les mœurs publiques, l’équilibre était détruit entre les ordres de l’Etat, par la misère de la multitude. Ce n’était plus le sage tempérament qui avait succédé à la lutte des Patriciens et des Plébéiens ; et où les vieilles querelles avaient paru oubliées pour toujours. La République durait, et cependant la liberté se mourait. Le peuple n’était pas opprimé ; et cependant il était dans la plus affreuse misère. Le Cens marquait un plus grand nombre de citoyens qu’il n’en avait jamais indiqué, et cependant on manquait de soldats. C’est que les mœurs, sinon les lois, avaient changé, et que la constitution n’était plus qu’une forme vide, d’où la vie s’était retirée ; c’est qu’enfin le peuple Romain était déjà ce que disait Catilina, un corps sans tête et une tête sans corps : une foule immense de pauvres, et au-dessus d’elle, bien loin, quelques nobles, plus riches et plus fiers que des Rois. Un siècle de guerres, de pillages et de corruption, avait dévoré cette classe moyenne à qui Rome avait dû sa force et sa liberté[61]. La guerre avait commencé cette destruction. L’exemple de ce Romain qui fut enrôlé jusqu’à vingt-trois fois[62] n’était pas même une exception. Le citoyen restait sous le coup du service militaire jusqu’au delà de cinquante ans. Combien ce service devait-il être meurtrier, et combien rapidement devait décroître la classe qui le supportait ! Bientôt il ne faudra plus demander où sont les Plébéiens de Rome. Ils auront laissé leurs os sur tous les rivages. Des camps, des urnes, des voies éternelles ; voilà tout ce qui doit rester d’eux[63]. A l’action meurtrière des combats, des marches forcées, des privations, des maladies, s’ajouta la corruption plus funeste de la vie, des camps. Jadis le légionnaire revenait cultiver le champ modeste qui nourrissait sa famille. Plus tard l’institution de la solde l’exempta du travail, et permit de le tenir plus longtemps éloigné de Rome. La guerre alors devint un métier : le légionnaire passa quinze ou vingt ans dans les camps, ou dans les garnisons provinciales il vécut de pillage, de distributions, des libéralités de ses chefs ; il n’eut plus de famille, ni de patrie ; il appartint à son général bien plus qu’à la République. Revenait-il à Rome, le travail l’effrayait autant que la pauvreté ; après avoir dissipé en orgies l’argent rapporté du camp, et vendu ou abandonné le lot de terre qu’on lui donnait ordinairement, il reprenait les armes comme volontaire, il ne pouvait plus être que soldat. Indépendamment de la rapide consommation d’hommes que faisait la guerre, la constitution de Rome suffisait pour amener à la longue la misère et la dépopulation. Cette constitution était une pure aristocratie d’argent. Or, dans une aristocratie d’argent sans industrie, c’est-à-dire sans moyen de créer de nouvelles richesses, chacun cherche la richesse dans la seule voie qui puisse suppléer à la production, dans la spoliation. Le pauvre devient toujours plus pauvre, le riche toujours plus riche. La spoliation de l’étranger peut faire trêve à la spoliation du citoyen. Mais tôt ou tard, il faut que celui-ci soit ruiné, affamé, qu’il meure de faim, s’il ne périt à la guerre[64]. Ainsi la classe des Prolétaires s’accroissait sans dessein : le colon ruiné, le débiteur insolvable, l’étranger dépouillé et venu à Rome pour y chercher des ressources, les gens de métier, les citoyens dégradés par les Censeurs, s’amassaient et formaient une multitude confuse, prête à se soulever contre l’Etat. La liberté même pouvait périr dans le bouleversement. Voilà pourquoi la préoccupation constante des hommes qui comprirent le mieux la situation du peuple romain fut d’arrêter cet envahissement du paupérisme. S’il avait été sage de ne pas donner tous les droits de la cité à l’affranchi et à l’ærarius ou étranger, quelle que fut leur fortune, il était dangereux de laisser sortir de la République tant de citoyens ; intéressés aussitôt à. l’agiter et à la bouleverser. Pour que les pauvres cessassent d’accuser l’Etat de leurs misères, il fallait faire cesser leurs misères. C’est là l’origine et ce qui fit l’importance des lois agraires, il s’agissait de rendre des terres aux pauvres ; et leur rendre un peu de fortune, c’était leur rendre un peu de pouvoir, c’était toucher à la constitution même de l’Etat. Mais sur quelles terres pouvait être pris ce que les Tribuns voulaient assurer aux prolétaires ; ce n’était pas sur les nouvelles conquêtes ; on n’aurait fait ainsi que renouveler le leurre des colonies[65] ; ce n’était pas non plus sur les possessions légitimes et héréditaires des Patriciens, quelque considérables qu’elles fussent : l’hœredium était chose trop sacrée, et la spoliation trop voisine du sacrilège. Autour de Rome, il n’y avait qu’une sorte de terres dont les législateurs pussent songer à se servir pour sauver la cité : c’étaient les terres du domaine public. Dans les premiers partages du territoire romain, on avait réservé une portion pour les besoins de l’Etat, ordinairement les forêts et les pâturages, qui restaient le domaine commun. Chacun avait le droit d’y envoyer ses troupeaux, à la condition d’une légère redevance. Pour accroître la valeur de ce domaine toujours agrandi par la guerre, on l’afferma ; les fermiers durent payer le dixième de tous les revenus. La ferme devint une sorte de propriété précaire et révocable, distinguée par l’obligation de la dîme des propriétés quiritaires, qui n’étaient soumises à aucune condition. Les Plébéiens, qui à l’origine ne faisaient pas partie de la cité, ne paraissent pas non plus avoir été admis aux fermes publiques ; ils étaient considérés comme étrangers. Toutefois, certains témoignages prouvent aussi qu’ils parvenaient quelquefois à prendre place parmi les détenteurs du domaine public. Salluste parle de Plébéiens qui furent chassés de l’ager publicus. Licinius Stolon fut condamné à l’amende parce qu’il en possédait mille arpents. Les Patriciens du reste dominèrent là comme dans la cité, et purent ainsi augmenter leur influence, d’autant plus que le Sénat négligea peu à peu d’exiger les dîmes. Cette connivence transforma ainsi les fermes eu domaines privés. Ce fut sans doute la principale source des fortunes patriciennes. A Rome, comme à Carthage, les héritages primitifs, acquis par la conquête, n’étaient que de quelques arpents. Cincinnatus, Fabricius, Coruncanius, Æmilius Papus, M. Curius, Regulus, Fabius Cunctator, n’avaient que la part transmise de père en fils, sans avoir été accrue par les usurpations ou par l’usure[66]. Le plus grand nombre des Patriciens en agit autrement. Du jour où les terres publiques ne profitèrent plus qu’aux particuliers, l’idée vint naturellement de les reprendre à ceux qui les avaient usurpées et de les distribuer aux citoyens pauvres. C’était appliquer à ces terres le droit de partage légitime par la conquête. Il n’y avait pas d’ailleurs de prescription contre l’Etat : le détenteur ne pouvait pas alléguer qu’il tenait ces terres de son père, que son père les avait reçues lui-même en héritage ou qu’il les avait achetées de bonne foi, que son travail et celui de ses ancêtres en avaient augmenté la valeur. La longue tolérance du Sénat ne justifiait pas l’usurpation. Spurius Cassius préposa le premier de partager entre les citoyens les plus pauvres une partie du domaine public, de contraindre les fermiers de l’Etat à payer la dîme régulièrement, et d’employer ce revenu à solder les troupes. Le Sénat accepta la loi, fit périr Cassius, et ne changea rien à l’état des choses. Les plaintes des tribuns ne furent pas écoutées. Un siècle après, Manlius Capitolinus essaya peut-être de jouer le rôle de Cassius, et eût le même sort. Les Tribuns Licinius Stolon et L. Sextius tentèrent alors une réforme plus complète : ils demandèrent qu’aucun citoyen ne pût posséder plus de cinq cents arpents de terres du domaine[67], ni envoyer dans les pâturages publics plus de cent têtes de gros bétail et cinq cents de petit ; la dîme et les autres revenus devaient être exigés régulièrement, et les fermes renouvelées tous les cinq ans par les Censeurs ; sur les terres restituées, chaque citoyen pauvre devait recevoir sept arpents. L’opiniâtreté, des Tribuns fit passer leurs lois. Le Sénat lui-même sentait le besoin de soulager les pauvres : de nombreuses colonies furent fondées dans le Samnium, à Sora, Alba et Carseoli, on envoya jusqu’à quatorze mille familles plébéiennes[68]. Deux fois Curius Dentatus fit distribuer au peuple sept arpents par tête[69]. Il y eut aussi des distributions considérables à la fin de la première guerre punique : les petits héritages se multipliaient ainsi, et formaient une classe moyenne, qui fit la force de Rome contre Carthage, et lui fournit jusqu’à vingt-trois légions contre Annibal, ses frères et ses alliés. Rome alors achève la conquête du monde. Mais après la corruption qui suivit cette conquête, le mal reparut tout entier. La classe des petits propriétaires a été décimée dans ces longues guerres, et les désordres du luxe achèvent de la ruiner. En l’année 180, selon Tite-Live, les consuls peuvent à peine réunir, neuf légions. En vingt-huit ans, de 159 à 131, le cens diminue de plus de vingt mille citoyens, et le censeur Metellus propose de contraindre tous les célibataires au mariage. Quand plus tard le cens est au contraire augmenté de près de cent cinquante mille hommes, c’est la classe des prolétaires qui s’est accrue. L’historien des guerres civiles qui mènent Rome à la servitude, Appien explique ainsi les causes de la décadence de la Cité : Dans leur conquête Successive des diverses contrées de l’Italie, les Romains avaient coutume ou de s’approprier une partie du territoire et d’y bâtir des villes, ou de fonder, dans les villes déjà existantes, une colonie composée de citoyens romains. Ces colonies servaient comme de garnisons pour assurer la conquête. La portion de territoire dont le droit de la guerre les avait rendus propriétaires, ils la distribuaient sur le champ aux colons si elle était en valeur, ou bien ils la vendaient ou la baillaient à ferme ; si au contraire elle avilit été ravagée par la guerre, ce qui arrivait souvent, ils n’attendaient point pour la distribuer par la voie du sort, mais ils la mettaient à l’enchère telle qu’elle était, et se chargeait de l’exploiter qui voulait, moyennant une redevance annuelle en fruits, savoir, du dixième pour les terres qui étaient susceptibles d’être ensemencées, et du cinquième pour les terres à plantations. Celles qui n’étaient bonnes que pour le pâturage, ils en retiraient un tribut levé sur le gros et le menu bétail. Leur vue en cela, était de multiplier la race italienne, qui leur paraissait la plus propre à supporter des travaux pénibles, et de s’assurer d’auxiliaires nationaux. Le contraire arriva. Les citoyens riches accaparèrent la plus grande partie de ces terres incultes, et à la longue ils s’en regardèrent comme les propriétaires incommutables. Ils acquirent de gré ou de force les petites propriétés des pauvres qui les avoisinaient. Les terres et les troupeaux furent remis à des mains esclaves ; des hommes libres eussent été trop souvent éloignés pour le service militaire. Cela était très avantageux aux propriétaires ; les esclaves n’étant pas appelés à porter les armes, multipliaient à leur aise. Il résulta, de toutes ces circonstances que les Grands devinrent très riches, et que la population des esclaves fit dans les campagnes beaucoup de progrès, tandis que celle des hommes libres allait diminuant, par suite du malaise, des contributions et du service militaire qui les accablaient. Et lors même qu’ils jouissaient, à ce dernier égard, de quelque relâche, ils ne pouvaient que languir dans l’inaction, puisque les terres étaient entre les mains des riches, qui employaient des esclaves préférablement aux hommes libres. Cet état de choses excitait le mécontentement du peuple romain, car il voyait que les auxiliaires italiens allaient lui manquer, et que sa puissance serait compromise au milieu d’une si grande multitude d’esclaves. On n’imaginait pas néanmoins de remède à ce mal, parce qu’il n’était ni facile ; ni absolument juste de dépouiller de leurs possessions agrandies, améliorées, couvertes d’édifices, tant de citoyens qui en jouissaient depuis de longues années. Les tribuns du peuple avaient anciennement fait passer avec bien de la peine une loi qui défendait de posséder plus de cinq cents arpents de terres, et d’avoir en troupeaux plus de cent têtes de gros bétail et cinquante de menu[70]. La même loi avait enjoint à ces propriétaires de prendre à leur service un certain nombre d’hommes libres, pour être les surveillants et les inspecteurs de leurs propriétés. Cette loi fut consacrée par la religion du serment. Une amende fut établie contre ceux qui y contreviendraient. Le surplus des cinq cents arpents devait être vendu à bas prix aux citoyens pauvres. Mais ni la loi ni les serments ne furent respectés. Quelques citoyens, afin de sauver les apparences, firent, par des transactions frauduleuses, passer leur excédant de propriété sur la tête de leurs parents ; le plus grand nombre bravèrent la loi[71]. La propriété et l’agriculture auraient pu seules sauver la race italienne et la cité qui s’y était toujours recrutée. Mais la condition des petits propriétaires était devenue intolérable. Leurs voisins, riches et puissants, les opprimaient pour les dépouiller[72]. Les Grands ne se contentaient pas d’acheter à vil prix le modeste domaine de leurs voisins pauvres ou de les ruiner par l’usure ; ils chassaient souvent de leurs terres les parents ou les enfants mineurs des légionnaires qui avaient eu part à la distribution d’une colonie. Ils se faisaient ainsi des domaines dont ils ne pouvaient pas, dit Columelle, faire le tour à cheval ; ils y enfermaient des montagnes, des forêts, des lacs, des rivières. Posthumius employa dix mille légionnaires à défricher ses bois. A Viterbe, un aqueduc long de six milles ne traversait les biens que de neuf propriétaires. Le territoire de Léontium, en Sicile, comptait quatre-vingt-trois propriétaires, et les villes voisines n’en avaient pas beaucoup plus. Bientôt à Rome un tribun pourra dire : Il n’y a pas ici deux mille hommes qui possèdent[73], et César, trouvera trois cent vingt mille citoyens, sur quatre cent cinquante mille, nourris aux dépens du trésor. Pline n’a pas tort de dire que les Grands Domaines perdirent l’Italie ; ils perdirent aussi la puissance de Rome. Les pauvres eux-mêmes ne voulaient plus de terres : à Antium, à Tarente, à Locres, à Siponte, à Buxentum, et dans bien d’autres colonies encore, les colons avaient pris la fuite pour rentrer à Rome[74]. Quels avantages en effet pouvaient-ils trouver en échange des dangers et des embarras qui les menaçaient ? Les petits fermiers nourrissaient Rome ; ce soin était passé à l’Afrique, à la Sicile, à la Sardaigne, où les terres étaient plus fertiles et la culture moins coûteuse, grâce aux esclaves. L’exportation des blés d’Italie était interdite, et la concurrence des blés étrangers facilitée et protégée par l’État[75]. Il était impossible que l’agriculture ne tombât pas en discrédit. Caton ne place plus la terre à grains qu’au sixième rang. Les Grands transforment leurs terres en pâturages[76]. L’Italie ne peut plus se nourrir elle-même, non pas que son sol soit épuisé, il n’est qu’abandonné[77] : Maintenant, s’écrie Varron, que les pères de famille, abandonnant la faucille et la charrue, se sont presque tous glissés dans les murs de Rome, et aiment mieux se servir de leurs mains au Cirque et au Théâtre, que dans les vignobles et les champs, il nous faut, pour ne pas mourir de faim, acheter notre blé aux Sardes et aux Africains, et aller vendanger avec des navires dans les Iles de Cos et de Chio[78]. La Sicile, l’Afrique, l’Égypte deviendront les greniers de Rome et de l’Italie ; mais que deviendront Rome et l’Italie lorsque ces provinces, par l’invasion de nouveaux conquérants, seront passées en d’autres mains ? Non seulement d’ailleurs le citoyen romain ne pouvait trouver de travail ; il n’en voulait pas, les esclaves envahissant l’agriculture comme l’industrie ; tout l’encourageait à l’oisiveté, dont les préjugés antiques faisaient un bonheur, surtout à Rome où la gloire était de vivre aux dépens du monde vaincu. Les fêtes continuelles, les triomphes, les jours de supplications, les distributions faites par les édiles au nom de l’Etat, par les patrons pour garder leur clientèle, par les candidats pour acheter des voix, nourrissaient la multitude[79]. Le citoyen n’avait plus qu’à aller écouter les orateurs du Forum, à courir aux jeux, à faire cortége aux Grands, à vendre sa voix pour les élections, son témoignage pour les procès, ses bras pour l’émeute. Le peuple n’était même plus capable de comprendre la portée et les bienfaits d’une loi agraire ; il n’était frappé, dans ces lois, que de ce qui pouvait plaire il ses passions ou à sa cupidité. Ce peuple était-il encore le peuple romain ? Autrefois pour combler les vides faits par la guerre, dans les rangs des ces Plébéiens, que les nobles avaient appris à estimer à leurs dépens, le Sénat donnait le droit de cité aux plus braves populations de l’Italie. Mais depuis la fin de la première guerre punique, pas une seule tribu nouvelle n’a été formée. Qui remplaçait cependant les prisonniers de la seconde guerre punique, les soldats, restés sur les champs de bataille de Cannes, de Trasimène, de Zama, dans les gorges de l’Espagne, dans les terres fangeuses de la Cisalpine, en Grèce, en Asie et jusqu’au pied de l’Atlas ?[80] A Trasimène, Rome avait perdu six mille prisonniers, à Cannes huit mille, à Drépane vingt mille ; les légions en délivrèrent vingt mille en Afrique, quatre mille en Crète, douze cents dans la petite province d’Achaïe. Pour réparer ces pertes, Rome n’avait que les prisonniers qu’elle faisait elle-même, et qui, de l’esclavage par l’affranchissement, passaient dans la cité. Dans la première guerre punique, Duilius fit huit mille prisonniers, Regulus quarante mille, Lutatius trente-deux mille. Qu’on y ajoute ceux de la seconde et ceux de la troisième, guerre punique, ne pourra-t-on pas, avec un historien moderne de Rome, Kobbe, estimer le nombre des esclaves africains, transportés en Italie à un cinquième de la population romaine ? Aux Africains s’ajoutent les Siciliens, les Sardes, les Grecs, les Thraces, les Syriens, puis les Espagnols, les Gaulois, les Barbares. Dans la durée des deux premières guerres puniques, plus de cent mille affranchis, entrèrent dans la cité romaine. D’après les données de Tite-Live, sur les revenus du trésor amassé par l’impôt du vingtième sur les affranchissements, on peut calculer que le nombre des affranchis à Rome était de deux, trois ou quatre mille par année. Comme nous l’avons vu, dans notre étude sur le droit domestique des Romains, rien ne limitait le pouvoir du père de famille : le droit d’affranchissement lui donnait des clients, et par suite il acquérait une puissance politique dans la cité en créant des citoyens. Il s’établit ainsi entre Rome et les provinces une circulation incessante : la Cité, dit Lucain, se remplit de la lie du monde[81]. Un jour, Scipion Émilien osa dire à cette foule, qui n’avait plus que le nom du peuple romain : Taisez-vous, faux fils de l’Italie. Vous avez beau faire, ceux que j’ai amenés garrottés à Rome, ne me feront jamais peur, tout déliés qu’ils sont maintenant. Les affranchis se turent, et leur silence prouva que ce mot terrible était mérité. Ils craignirent qu’en descendant de la tribune, le vainqueur de Carthage et de Numance, ne reconnût ses captifs africains ou espagnols, et ne découvrît sous la toge les marques du fouet. Ainsi un nouveau peuple succède au peuple romain, absent ou détruit. Les esclaves prennent la place des maîtres, occupent fièrement le Forum, et dans ces bizarres saturnales, gouvernent par leurs décrets les Latins et les Italiens, qui remplissent les légions[82]. » Dans cette décadence de la cité, la puissance des Grands, qui autrefois du moins comptaient avec le peuple, reste sans contrepoids. Le Sénat n’est plus que la tête d’une aristocratie nouvelle, plus orgueilleuse et plus oppressive que l’aristocratie patricienne[83]. Il restait à peine quinze des anciennes gentes, les Plébéiens étaient plus nombreux que les Patriciens au Sénat, et souvent il fallut violer la loi en donnant le Consulat ou la Censure à deux Plébéiens. La noblesse s’était renouvelée comme le peuple. Mais qui la renouvellera désormais ? Elle se sépare du peuple, elle le méprise, elle l’insulte, elle proscrit les hommes nouveaux. L’égalité a disparu avec le respect des lois. Les Grands forment une faction, qui se soustrait à l’autorité du peuple et même à celle du Sénat : La république, dit Salluste, dans la paix et dans la guerre, est au caprice de quelques hommes[84]. Les généraux, les gouverneurs, Consuls, Proconsuls, Préteurs, agissent en maîtres dans leurs provinces, bravent le Sénat par le peuple, le peuple par le Sénat, et quelquefois l’un et l’autre. Eux seuls sont en possession du Sénat, des tribunaux, du Forum, des charges. La vénalité des suffrages et la nécessité de se ruiner d’abord dans l’édilité écartent des honneurs les citoyens trop pauvres. Dans un espace de quatre-vingt-six ans, neuf familles obtiennent quatre-vingt-trois Consulats ; ce sont les Cornelius, les Fulvius, les Sempronius, les Marcellus, les Postumius, les Servilius, les Fabius, les Appius, les Valerius. Aux funérailles de Metellus le Macédonique, quatre de ses fils suivent le lit de parade : deux ont été Consuls, le troisième l’est encore. Il n’y avait plus de place dans l’Etat pour les Hommes pauvres ou obscurs : la distance était désormais trop grande entre le peuple et l’aristocratie. La République tombe, et l’Empire vient rétablir l’équilibre, en confondant toutes les classes dans une commune servitude. |