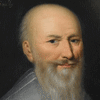ÉTUDE BIOGRAPHIQUE SUR SULLY
CHAPITRE X. — DEPUIS LA MORT DE HENRI IV JUSQU'À LA MORT DE SULLY.
|
1610-1641 Pendant qu'on rapportait au Louvre le corps du Roi, et qu'on y entendait les rires les plus scandaleux, et qu'on y voyait sur beaucoup de visages une gaieté indécente, Sully entendait à l'Arsenal un grand cri : c'étaient madame de Sully et quelques serviteurs qui accouraient auprès de lui en criant : Ah ! mon Dieu ! tout est perdu ! la France est détruite ! Sully sortit de sa chambre, tout déshabillé : Ah ! Monsieur, lui dit-on, le Roi est extrêmement blessé d'un coup de couteau dans les flancs : voilà saint Michel qui vous le vient dire et vous apporte le couteau. Lors levant les yeux au ciel, Sully s'écria : Voilà de quoi ce pauvre prince avait toujours appréhension. Ô Dieu ! aie pitié et compassion de lui, de nous et de l'Etat, car c'en est fait s'il est mort : et Dieu n'a point permis un si étrange accident, que pour montrer son ire[1] et déployer ses vengeances sur la France qui va tomber en d'étranges mains. Baillez-moi mes habillements et mes bottes, que l'on me fasse seller de bons chevaux, car je n'irai point en carrosse, et que tous mes gentilshommes se tiennent prêts pour m'accompagner ; il faut aller voir ce qui en est. Sully monta donc à cheval pour aller au Louvre. Il était suivi d'une centaine de chevaux, et sa troupe se grossissait sans cesse de tous les serviteurs du Roi. Passant par les rues, dit Sully, c'était pitié de voir tout le peuple en pleurs et en larmes, avec un triste et morne silence, ne faisant que lever les yeux au ciel, joindre les mains, battre leurs poitrines et hausser les épaules, gémir et soupirer ; et si quelques cris échappaient, c'était avec des élancements si douloureux, que rien ne se saurait représenter de plus affreux et pitoyable ; ensemble chacun me regardait en pitié et ne me faisait que dire : Ah ! Monsieur, nous sommes tous perdus si notre bon Roi est mort ! Passant à la rue de la Pourpointerie, un homme à cheval, à qui je ne prenais pas garde, me jeta un billet entre les mains, où il y avait ces mots : Monsieur, où allez-vous ? aussi bien c'en est fait, je l'ai vu mort ; et si vous entrez dans le Louvre, vous n'en réchapperez pas, non plus que lui. Cet avis me désola tout à fait, et de grosses larmes me sortirent des yeux. Vers Saint-Innocent je rencontrai M. du Jon qui me dit : Monsieur, notre mal est sans remède, Dieu en dispose ; je le sais pour l'avoir vu ; pensez à vous, car ce coup si étrange aura de terribles suites. A l'entrée de la rue Saint-Honoré, vers la Croix du Tiroir, l'on me jeta encore un semblable billet au premier. J'avais bien lors 300 chevaux, et ne laissais pas de m'avancer toujours vers le Louvre, jusques à ce qu'au carrefour des Quatre-Coins, je rencontrai M. de Vitry[2], le plus désolé de tous ceux que j'avais encore trouvés, qui me vint embrasser avec des exclamations pitoyables, et me dit : Ah ! Monsieur, on nous a tué notre bon maître malheureusement. C'en est fait de la France, il faut mourir ; et pour moi je suis bien assuré que je ne la ferai pas longue, et fais état de sortir hors de France et n'y rentrer jamais. Il faut dire adieu à tout le bon ordre que vous aviez établi. Mais, Monsieur, où allez-vous avec tant de gens ? L'on ne vous laissera pas approcher du Louvre ni entrer dedans qu'avec deux ou trois ; et comme cela, je ne le vous conseille pas, et pour cause. Il y a bien de la suite en ce dessein, ou je suis bien trompé, car j'ai vu des personnes qui apparemment[3] ont bien perdu, mais qui n'ont point la tristesse au cœur qu'ils y devraient avoir ; cela m'a pensé faire crever de dépit ; et si vous l'aviez vu comme moi, vous enrageriez. Pour moi je suis d'avis que vous vous en retourniez ; il y a assez d'affaires où vous aurez à pourvoir, sans aller au Louvre. Ces discours de M. de Vitry, confirmatifs en partie des avis et billets que l'on m'avait baillés, m'arrêtèrent tout court ; et, après quelque petite consultation avec ledit sieur de Vitry et dix ou douze des principaux de ma troupe, je résolus de m'en retourner à l'Arsenal, et d'envoyer vers la Reine, comme je fis, pour m'offrir à la servir, recevoir ses commandements et lui rendre obéissance, et qu'en les attendant j'allais pourvoir à la Bastille, à l'Arsenal, à mon gouvernement, à mes troupes, à l'artillerie, et au reste des affaires qui dépendaient de mes charges... Comme je fus parvenu à la rue Saint-Antoine, un gentilhomme me vint retrouver de la part de la Reine, qui me priait de venir promptement au Louvre et d'amener peu de gens avec moi, qu'elle avait des choses de grande importance à me communiquer, et que je m'en retournerais aussitôt. En même temps j'eus avis qu'un exempt des gardes et quelques quelques étaient venus aux premières portes de la Bastille, que l'on en avait envoyé d'autres au Temple où étaient les poudres, et chez les trésoriers de l'Epargne arrêter tous les deniers sans m'avoir fait parler de rien. Ces particularités et autres ci-devant dites, et que l'on me pressait d'aller seul au Louvre, me mirent en quelque doute, et furent cause que je renvoyai le gentilhomme de la Reine pour lui dire que j'avais envoyé vers elle un gentilhomme, lequel ayant ouï (entendu), peut-être changerait-elle de mandement, et partant que j'attendrais réponse par lui et demeurerais ce pendant à l'Arsenal et à la Bastille. Peu après m'arrivèrent, à un quart d'heure l'un de l'autre, MM. de Montbazon, de Praslin, de Schomberg, de la Varenne, et finalement M. de Béthune, mon frère, tous de la part de la Reine, pour me faire même instance, ce qui augmenta d'autant plus ma défiance. Et enfin je me résolus de n'aller point au Louvre pour ce jour-là, mais m'en aller à la Bastille pour changer de chemise et me mettre au lit, car j'étais si mouillé de sueur et si las, que je ne me pouvais soutenir, ayant été baigné le matin, n'ayant quasi point dîné, et ayant été travaillé excessivement de corps, d'esprit, de douleur et de tristesse, toute la journée. Je ne partis point de la Bastille, où MM. le Connétable et d'Epernon m'envoyèrent visiter, faire des offres, et conseiller de venir voir, le lendemain, la Reine, laquelle aussi m'envoya encore prier, mais que ce fût avec peu de suite ; à quoi finalement je me résolus. Le soir même, le Parlement était convoqué, et, sur l'ordre du duc d'Epernon, décernait sans désemparer la régence à Marie de Médicis ; plus exactement il donnait le pouvoir à Concini et à d'Epernon, que le cri général accusait d'avoir fait tuer Henri IV. Le lendemain Sully alla au Louvre avec sa suite ordinaire de vingt personnes. Chacun, dit Sully, me rendit beaucoup d'honneur, et particulièrement les archers de la porte, ceux de la garde du corps, les officiers des Sept-Offices, les valets de chambre, de garderobe et de pied, lesquels, à mesure qu'ils me rencontraient, me venaient embrasser, gémir et pleurer, avec des gestes les plus pitoyables qu'il était possible devoir, me criant : Hélas, Monsieur, nous sommes tous perdus ayant perdu notre bon maître. Nous vous conjurons tous, ayant si bien servi le père, de vouloir de même servir ses enfants et ne les abandonner point. Marie de Médicis reçut le Surintendant avec bonté ; et, ayant fait venir le jeune Roi, Sully le tint embrassé si étroitement qu'on ne pouvait le lui ôter. La Reine lui dit très haut : Mon fils, c'est M. de Sully, il vous le faut bien aimer, car c'est un des meilleurs et des plus utiles serviteurs du Roi votre père ; et je le prie qu'il continue à vous servir de même. En conséquence Sully conserva ses charges et continua à prendre part au gouvernement de la Régente. Sully essayait de rester au pouvoir par ambition et par le désir qu'il avait d'être encore utile à l'Etat ; mais la réaction qui éclata immédiatement contre la politique et toutes les idées de Henri IV lui montra combien son rôle allait être impossible à la Cour, au milieu de toutes les intrigues et de toutes les haines qui l'entouraient. L'armée de Champagne fut licenciée ; mais, pour conserver quelques apparences, on envoya une dizaine de mille hommes sous les ordres du maréchal de la Châtre, ancien ligueur, et du duc de Rohan, gendre de Sully, se joindre à Maurice de Nassau et au prince d'Anhalt, qui assiégeaient Juliers depuis trois semaines avec 30.000 hommes. Le 1er septembre, la ville capitula sans avoir reçu le moindre secours de l'Autriche, preuve infaillible de la faiblesse de l'Autriche et des succès assurés que devaient avoir Henri IV et ses alliés. Juliers pris, Marie de Médicis déclara à Sully que la politique du feu Roi allait être abandonnée et remplacée par une réconciliation complète avec l'Espagne ; le jeune Roi devait épouser l'infante Anne d'Autriche, fille de Philippe III, roi d'Espagne, et une des filles de Henri IV, Elisabeth, devait épouser le prince des Asturies, fils et héritier de Philippe III. Toute-puissante et entièrement dirigée par l'ambassadeur d'Espagne et Concini, Marie de Médicis licencia l'armée de Lesdiguières et abandonna notre allié le duc de Savoie, qui, pour se faire pardonner d'avoir eu la pensée de s'emparer du Milanais, fut obligé d'envoyer son fils à Madrid demander pardon à genoux au roi d'Espagne, d'avoir été l'allié de la France. Dès lors, en toute circonstance, les intérêts de la France furent constamment sacrifiés à ceux de l'Espagne et de l'Autriche, jusqu'à l'arrivée de Richelieu au pouvoir. Sully résolut de se retirer ; mais sa femme, son fils et son gendre blâmèrent cette résolution, et il eut la faiblesse de leur céder, faiblesse blâmable, bien qu'il leur ait dit : Eh bien, vous voulez donc que je me sacrifie pour le public et pour mes parents et amis, car je vois bien que vos intérêts vous font tenir tous ces langages pleins de vanité. Je le ferai, puisque vous m'en conjurez tant ; mais vous vous souviendrez que ce sera avec peu d'utilité et d'avantage pour vous tous, et beaucoup de hontes, de ruines et de fâcheries pour moi. En effet, Concini ne tarda pas à dire, en mauvais français et d'une voix aigre, à l'un des secrétaires de Sully : Comment, Monsieur Arnaut, M. de Sully pense donc encore gouverner les affaires de France comme du temps du feu Roi ? Or, c'est ce qu'il ne doit nullement espérer ; car la Reine étant reine, c'est à elle de disposer de tout, et je ne lui conseille pas de rien entreprendre sans sa volonté. Et quant à ma femme et à moi, nous n'avons besoin de l'aide ni de la faveur de personne pour obtenir des biens et des honneurs ; car S. M. nous affectionne pour l'avoir bien servie, et nul ne saurait empêcher les gratifications dont il lui plaira d'user en notre endroit ; et si M. de Sully désire quelque chose, il aura plus de besoin de notre assistance que nous de celle qu'il nous offre. Et s'il savait les poursuites qui se font, il nous rechercherait plus qu'il ne fait, n'y ayant prince ni seigneur à la Cour qui ne nous soit venu voir, réservé lui et un autre. Un Concini parler ainsi de Sully ! Le désordre des finances était redevenu ce qu'il était au début du ministère de Sully : les princes, les grands, Concini et ses amis ou partisans, recevaient de Marie de Médicis d'énormes pensions, des gratifications, de l'argent pour payer leurs dettes ; les impôts, le trésor de la Bastille, étaient livrés à toutes les cupidités. Le Chancelier avait conservé les sceaux du feu roi et s'en servait pour sceller et faire passer comme approuvées par Henri IV toutes ces folles et scandaleuses dépenses. Pendant le voyage de Louis XIII à Reims pour la cérémonie du sacre (17 octobre 1610), Sully obtint de la Reine la permission d'aller visiter ses châteaux ; il tomba malade à Montrond, et, à sa convalescence, il composa deux grandes pièces de vers : Parallèle de César et de Henri le Grand et l'Adieu de Monseigneur le duc de Sully à la Cour, dont il est bien difficile de citer quelques vers. A ce moment, Sully était décidé à se retirer de la Cour et à se démettre de sa charge de surintendant des finances. Marie de Médicis lui écrivit, et le fit revenir sur sa décision en lui envoyant sa femme, son fils et son gendre, toujours opposés à son départ. Sully aurait mieux aimé se défaire de ses charges, afin d'en tirer une grande et immense somme, qu'il aurait envoyée par tiers en Suisse, à Venise et en Hollande, pour y faire sa retraite, en cas de persécution contre les Huguenots, qu'il tenait, disait-il, pour infaillible. Il céda encore une fois et revint à Paris. A son retour, la Reine l'accueillit avec bon visage et bonnes paroles ; mais Concini n'avait pas dit le dernier mot. Toute la Cour était venue à l'Arsenal, faire visite au Grand-Maître. Le sieur Conchine fut trois jours, dit Sully, sans me venir voir, s'attendant que je le viendrais visiter, comme faisaient tous les autres, ou pour le moins enverrais vers lui l'assurer de ma bienveillance, et le remercier de ce que la Reine m'avait écrit et fait solliciter tant instamment de revenir à la Cour ; car il m'avait fait sentir par les sieurs Zamet et d'Argouges, que lui seul avait été cause que la Reine en avait ainsi usé, estimant que je lui en reconnaîtrais avoir l'obligation. Mais voyant qu'il n'avait nulles nouvelles de ma part, il me vint voir, non sous prétexte de me venir visiter, comme il ne manqua pas de me le faire bien entendre — car si je tenais bien ma gravité, il faisait encore plus valoir sa faveur —, mais pour me parler des affaires de la charge de premier gentilhomme de la Chambre, de l'augmentation de ses pensions que la Reine voulait qui fussent mises sur l'Etat, comme les avait M. de Bellegarde, et d'un don sur les officiers des gabelles de Languedoc, duquel j'avais obtenu un brevet dès le temps du feu Roi ; de quoi néanmoins je ne lui fis aucune mention. Mais, quoi qui se passât, ses procédures, son langage et ses demandes ne m'agréèrent pas plus que firent à lui mes répliques, surtout lorsque m'ayant parlé de m'accommoder aux volontés de la Reine, sans y interposer aucunes longueurs ni difficultés, je lui répondis que j'obéirais volontiers à tous ses commandements, èsquels le service du Roi, le bien de l'Etat, le soulagement du peuple, mon honneur et ma conscience se trouveraient joints ensemble. Après quelques autres propos pleins de froideurs et de retenue des deux côtés, nous nous séparâmes assez mal édifiés l'un de l'autre ; lui, reconnaissant bien que mon humeur ne serait pas accommodante à ses fantaisies, et moi, jugeant qu'il en aurait de bien étranges et puissamment autorisées, que ses espérances passaient au delà même de l'excès, et qu'il serait difficile de leur donner aucunes bornes ; qui furent à peu près les propos que j'en tins à Madame ma femme lorsqu'il s'en fut allé. Le lendemain de cette visite, la Reine était toute changée : sa froideur à l'égard de Sully contrastait avec l'accueil des jours précédents. Bientôt elle accorda, à la demande de Concini, tout ce que Sully faisait refuser dans le Conseil. Il était impossible, dans ces conditions, de conserver plus longtemps la direction des finances, et Sully se retira en janvier 1611[4]. Il renonça à ses charges de surintendant des finances, de capitaine de la Bastille, et de capitaine de la compagnie des gendarmes de la Reine ; mais il garda toutes les autres[5]. Le 27, Louis XIII agissant au nom de sa mère, accordait à Sully une somme de 300.000 livres (1.800.000 francs) en récompense des grands et recommandables services rendus au défunt Roi... et à cet Etat, durant une longue suite d'années. Sully quitta Paris pour se rendre à son château de Sully. Son départ fut une sorte de triomphe. Il était suivi de plus de 300 gentilshommes[6]. La victoire de Concini et la retraite de Sully n'avaient pas satisfait le cabinet de Madrid. Sur l'ordre de Philippe III, l'ambassadeur d'Espagne demanda à Marie de Médicis de faire arrêter le ministre de Henri IV et de le faire juger ! En se retirant, Sully avait adressé à la Régente une longue lettre apologétique[7] très fière, dont le début mérite d'être lu : Madame, entre toutes les conditions honorables d'un gentilhomme français, j'ai toujours estimé la plus avantageuse celle d'être employé aux affaires importantes de sa patrie, de les administrer heureusement et obéir au commandement de son prince. Durant plusieurs années, j'ai conduit les principales de cet Etat avec un succès non espéré ; je les ai portées, sous mon Roi, d'un profond abîme de misères au comble de toute gloire. Aujourd'hui, Madame, j'obéis aux désirs et aux volontés expresses de V. M. ; je remets entre ses mains les deux plus belles marques qui me restent des bienfaits et du ressentiment de mon bon maître : la Bastille et les Finances. Je les ai possédées durant sa vie, je les vous rends après sa mort, et me contenterai que les effets de mes services demeurent à jamais gravés dans le cœur de vos peuples. Un autre, moins fidèle que moi, remplirait toute la France de ses plaintes ; mais ma dévotion perpétuelle envers le lieu de ma naissance[8] tient ma langue muette, et me fait plutôt chercher en mon incapacité seule qu'en toute autre considération, la cause d'un si grand changement. Un des plus illustres contemporains de Sully, le cardinal de Richelieu, en parlant, dans ses Mémoires, de la chute du Surintendant, se contente de dire sèchement : On a vu peu de grands hommes déchoir du haut degré de la fortune sans tirer après eux beaucoup de gens ; mais, la chute de ce colosse n'ayant été suivie d'aucune autre, je ne puis que je ne remarque la différence qu'il y a entre ceux qui possèdent les cœurs des hommes par un procédé obligeant et leur mérite, et ceux qui les contraignent par leur autorité. Henri Martin[9] a écrit sur la
retraite de Sully une page plus juste et plus belle : Sully ne se résigna pas de longtemps à la retraite absolue, seule digne
de lui, mais si difficile à l'homme pour lequel les affaires publiques sont
devenues une seconde vie : il tenta plus d'un effort, sans éclat et sans
succès, pour agir encore sur les destinées de la France, avant de se résoudre
à ensevelir ses souvenirs et ses ennuis dans ses châteaux solitaires de
Rosny, de Sully, de Villebon. C'est un douloureux spectacle que celui d'un
grand homme, encore plein de verdeur et de sève[10], condamné par la fatalité des circonstances à une mort
anticipée. Sully vit abaisser et désorganiser la France sans pouvoir la
défendre. Il la vit plus tard se régénérer sans pouvoir prendre part à sa
régénération ; il vit un autre réaliser en partie les plans qu'il avait
rêvés, recueillir la gloire qu'il avait espéré partager avec son grand Henri
; il se survécut trente ans à lui-même, trente ans d'une existence pareille à
celle de ces tristes ombres d'Homère, qui regrettent toujours la vie sans
pouvoir revivre[11]. Sully ne prit aucune part aux soulèvements des princes et des grands contre l'odieux gouvernement de Concini, ni à la révolte des Huguenots en 1615. Son gendre, M. de Rohan, fut au contraire l'un des plus actifs parmi ceux qui prirent les armes. Le gouvernement de Concini et de Marie de Médicis n'était pas seulement devenu intolérable à la noblesse, mais à Louis XIII lui-même, tenu en chartre privée, comme un prisonnier, entièrement à l'écart des affaires et annulé autant qu'il était possible de le faire. L'année 1617 allait enfin voir arriver le terme de la captivité du jeune Roi. On lit dans Saint-Simon[12], à propos des âmes viles et mercenaires qui gouvernaient Marie de Médicis : Leur intérêt fut donc suivi en tout par une princesse qui ne se défiait point d'eux, qui n'était contente qu'avec eux, qui ne voyait et ne se conduisait que par eux. Leurs désirs les plus ardents étaient de la voir veuve et régente pour régner eux-mêmes sous son nom et avec une autorité qui mît à couvert celle qu'ils comptaient bien d'usurper, et tous les usages qu'ils se proposaient d'en faire pour s'enrichir et dominer à découvert. Pour arriver à ce but et jouir
tranquillement de leur fortune, il fallait à cette Régente un fils qui n'eût
que le nom de Roi, et dont la majorité ne troublât point leur puissance.
Aussi fut-il élevé avec les précautions les plus convenables à remplir leurs
vues, et conséquemment les plus nuisibles au jeune prince. On le laissa
croupir dans l'oisiveté, dans l'inutilité, et dans une ignorance si parfaite
de tout, qu'il s'est souvent plaint à mon père, dans la suite, en parlant de
son éducation, qu'on ne lui avait pas même appris à lire. On eut soin
d'écarter toute la Cour de lui. C'était un crime si connu et si redouté
d'approcher seulement de son appartement, qu'il n'y voyait que quelques
valets bien choisis par ceux de sa mère, et qu'on changeait dès l'instant que
les inquiétudes de ceux qui gouvernaient la Reine en prenaient le plus léger
ombrage. M. de Luynes fut l'unique courtisan qui put avoir leur attache pour
amuser l'ennui du Dauphin[13], toujours enfermé dans son appartement, et qui eut assez
d'adresse pour se maintenir dans la liberté de l'approcher. Ils ne
craignaient ni ses alliances ni ses établissements ; il eut la souplesse de
les rassurer sur son esprit et sur l'usage qu'il en pourrait faire ; il fut
ainsi très longtemps l'unique ressource du jeune prince dans sa réclusion et
les duretés sans nombre qu'il éprouvait. Il serait surprenant que Luynes n'en
eût pas profité, lui qui y avait tourné toutes ses vues, et qu'il n'eût pas
saisi l'esprit et le cœur d'un enfant à qui on laissait à peine voir le jour,
et qu'on ne s'appliquait qu'à abattre par la solitude, l'ignorance et la plus
austère contrainte et captivité, dont Luynes était le seul qui l'approchât et
qui inventait des amusements d'oiseaux et de voleries pour lui faire passer
le temps dans cette espèce de prison... Le Roi sacré, majeur et marié,
n'en devint ni plus libre ni plus instruit. Il était souvent refusé de la
permission de s'aller promener. Le maréchal d'Ancre l'envoyait faire taire
quand il lui faisait trop de bruit au-dessus de sa chambre, et il fallait
obéir sur-le-champ, ou être maltraité après de la Reine, sa mère, jusque-là
qu'elle lui donna un jour un soufflet ; et c'était sans cesse des choses
aussi difficiles à supporter, sans être jamais mêlées de la moindre douceur,
ni de la plus légère liberté. Luynes même ne pouvait l'entretenir tête à tête
que les soirs quand il se mettait au lit, sous prétexte de l'endormir. Ce fut
là aussi où il le fit résoudre de s'affranchir et de régner, en arrêtant le
maréchal d'Ancre et en éloignant pour un temps la Reine-Mère. Luynes avait
pris toutes ses mesures secrètes pour profiter de l'état insupportable où le
Roi était réduit, et de la haine publique que ces étrangers et le mauvais
gouvernement de la Reine leur avait attirée par leur insolence et leur
tyrannie. Il attendit en habile homme que tout son dessein fût bien arrangé
pour le proposer au Roi. C'était le tirer de prison pour le faire monter sur
le trône. Saint-Simon nous donne le tableau de la séquestration. Le marquis de Montpouillan, l'un des fils du maréchal de la Force, et auquel il était permis depuis quelque temps de voir le Roi, parle à plusieurs reprises, dans ses Mémoires[14], des desseins qu'avait Concini et qui alarmaient en quelque façon le Roi et le tenaient en peine, ainsi que ces messieurs de Luynes. Sully va nous apprendre en quoi consistaient ces desseins de Concini, et combien le Roi avait raison de les redouter. Le 15 avril 1617, Sully, étant dans son gouvernement du Poitou à l'abri des atteintes de Concini, écrivit à Louis XIII une lettre non signée. Il engageait S. M. à avoir la résolution nécessaire pour se remettre en liberté et sortir de servitude, résolution nécessaire, car ceux qui le tenaient prisonnier ne pouvaient rebâtir une nouvelle minorité que par sa mort, qu'il annonce au Roi. En effet, Louis XIII tué, comme son père, la couronne passait à Gaston, frère de Louis XIII, alors seulement âgé de neuf ans : Marie de Médicis redevenait régente, et Concini restait le maître du pouvoir[15]. Il faut lire cette lettre malgré sa longueur et son style quelquefois difficile ; elle éclaire la situation et fait grand honneur à Sully, serviteur énergique et dévoué du fils, comme il l'avait été du père. LETTRE ADRESSÉE À LOUIS XIII CONTRE LE MARÉCHAL
D'ANCRE ET SA FEMME. Sire, la connaissance ni le nom de celui qui a eu la vertu[16] et la générosité que d'oser écrire à V. M. royale, avec hardiesse et franchise, ne vous est point si nécessaire, qu'il sera utile à vous et à tout votre royaume d'examiner bien particulièrement les vérités contenues en cette lettre, de peser dignement les raisons qui vous y sont déduites, d'appréhender, pour les prévenir, les misères et calamités qui vous y sont dénoncées, et d'avoir un esprit absolument résolu d'appliquer les remèdes convenables qui vous y sont proposés. Pareils avertissements, Sire, ne vous ont point été sans cause tant de fois réitérés, ni ne vous sont point de présent prématurément donnés ; car les extrêmes maux sont à la porte, et le péril gît au retardement du médecin, comme il appartient à la prudence d'un magnanime roi. Ces avis, Sire, ne procèdent point des fantaisies d'un esprit mélancolique, dépité ou ulcéré pour son particulier, mais du propre devoir à quoi s'est ressenti obligé un très loyal et ancien serviteur de votre personne et de votre Etat, qui mérite, pour son intelligence et son expérience, d'être attentivement écouté. Telles dénonciations ne sont point et ne doivent être prises pour pures inventions, prédictions et divinations abusives, fondées sur des sciences curieuses et pleines d'erreur, mais seront trouvées par les événements vraies prophéties, appuyées sur un jugement très judicieux, et sur des conjectures infaillibles sur la multiplicité des prodiges passés, dont l'acte le plus furieux a été l'exécrable parricide commis en la personne de notre auguste monarque, sans que nul ait encore osé en rechercher la cause ni les auteurs certains. Ceci est encore appuyé d'une multiplicité d'exemples et de raisons, lesquelles ne laissent guère en erreur ceux qui les conjoignent ensemble, et sur la connaissance que chacun a des qualités, dessein et procédures de ceux qui ont usurpé l'administration des affaires et autant d'empire souverain sur les personnes et les volontés de Vos Majestés, qu'il leur sera besoin de prudence, d'industrie et de résolution pour se remettre en liberté et développer (sortir) de la servitude où ils vous ont réduit ; car ils ne vous découvriront jamais avoir le désir de ce faire, qu'ils n'aient essayé de rebâtir par votre mort une nouvelle minorité[17], ou user de quelque autre artifice qui leur redonne autant d'années de tyrannie à exercer qu'ils en ont eu ci-devant : voire leurs actions donnent une violente présomption qu'ils ne s'arrêteront pas là ; car tant d'intelligence et de conseils secrets avec l'ambassadeur d'Espagne ne se sauraient si longtemps continuer sans quelque participation du vieux dessein des Espagnols, auquel ils se sont reconfirmés plus que jamais par la terreur en quoi les ont tenus les armes et les vertus du feu roi votre père ; en laquelle désirant éviter de retomber à l'avenir, leur expédient plus certain est d'exterminer toute la lignée royale, afin de s'approprier la France, ou pour le moins la disperser en tant de roitelets, qu'ils n'aient plus sujet d'en appréhender la grandeur, la richesse et la valeur, suivant le dire de l'empereur Charles V, lequel oyant que l'on l'accusait de haïr les rois de France, répondit que c'était tout le contraire, car il les aimait tant, que pour un seul qu'il y en avait, il voudrait qu'il y en eût vingt. Auquel dessein ils ont porté, quoiqu'à regret, l'esprit de notre Saint-Père, l'ayant circonvenu sous ces espérances spécieuses, mais impertinentes et de succès impossible, qui sont de lui céder le royaume de Naples, et de détruire tous les hérétiques de la chrétienté, pourvu qu'avec les armes spirituelles et temporelles il lui aidât à s'approprier la couronne de France. J'ai honte, Sire, d'user de tant de paroles pour vous persuader des choses si visibles, et crois employer autant de temps inutilement que j'en consomme à rechercher des raisons pour vous faire croire mes avis et suivre mes conseils. Car, si dans les cœurs magnanimes des grands rois il se trouve des aiguillons plus puissants et pleins d'efficace que la gloire, l'honneur et les triomphes, celui de remédier au salut de votre personne et de votre Etat, et l'avantage que vous avez d'être fils du plus grand prince, du plus grand homme d'Etat et du plus grand capitaine de tous nos siècles, vous doivent servir d'une très forte induction pour mettre la main à la guérison des maux présents, et prévention de ceux qui nous menacent : lesquels sont d'autant plus déplorables qu'ils ont pour principales causes de si faibles auteurs et ridicules instruments... Après avoir déploré que les haines et les jalousies des grands, et leur lâcheté, aient laissé croître et enraciner une si mauvaise plante et détestable engeance, après avoir déploré l'élévation excessive et inouïe d'un maraud d'étranger, dans lequel et sa femme sont rassemblés tous les vices, Sully continue : Et néanmoins, cet homme et cette femme, ainsi faits et ainsi conditionnés, ont tellement abaissé les uns, corrompu les autres, par l'entière disposition qu'ils ont de toutes les charges et trésors de France, emprisonné, banni, affaibli et intimidé le reste, qu'il ne leur manque plus, pour se voir en réelle possession de la royauté, que le titre et le nom d'icelle ; à quoi ils sont aspirants par degrés, puisque l'espérance, non plus que l'apparence, ne leur dénie point absolument le succès, croyant avec quelque raison qu'il y avait bien plus loin de la condition la plus vile, honteuse et abjecte qui se puisse imaginer, en laquelle leur naissance les avait soumis, au degré d'extrême hautesse où ils sont maintenant constitués, qu'il n'y a d'icelui (degré) à obtenir le nom de Roi, sinon pour eux, au moins pour tel qu'il leur plaira. Et sur ce fondement sont-ils favorisés, soutenus et portés d'Espagne, qui tient pour infaillible la translation de la monarchie française en leur main, ou du moins une séparation d'icelle en tant de roitelets et de tyranneaux que leurs divisions inévitables lui ouvriront peu à peu le chemin pour y parvenir. Sur lequel (chemin), qui considérera bien l'état passé et présent des affaires de France, il jugera qu'ils ont déjà fait un grand progrès ; car il y a quarante ans, ou environ, que nous pouvions compter douze ou quinze princes de la maison royale, la plupart en âge de maturité, pleins de courage, d'esprit et d'expérience. Nous pouvons encore nombrer d'autres princes, ducs, pairs, officiers de la couronne et seigneurs qualifiés, qui les égalaient en suffisance et vertu, plus de cinquante ou soixante, tous capables de servir leur patrie et d'en empêcher l'usurpation : au lieu qu'après la mort de notre grand Roi, qui seul les valait tous ensemble, et lequel, s'il eût vécu, abattait pour toujours la tyrannie d'Espagne, nous avons été réduits à trois enfants et deux hommes faits, de la lignée royale, dont un de chaque qualité, non sans soupçon de maléfice, ont déjà fait place à leur dessein ; un autre est mis aux ceps[18], fort proche de même péril, et les deux autres consistent, Sire, en monsieur votre frère, qui est si bas d'âge, qu'ils en peuvent disposer à leur mode, et en Votre Majesté, qu'ils tiennent comme esclave et prisonnière. Car, quelle différence y a-t-il entre les murailles de la Bastille, qui empêchent M. le Prince de sortir, ou les gardes qu'ils vous baillent à leur dévotion, qui ne vous laissent autre liberté que celle qui tourne à leur établissement ? Et quelle différence y a-t-il entre M. le Prince, que l'on ne laisse communiquer, écrire, ni recevoir lettres de personne, ou de V. M., à laquelle on cache toutes les lettres d'importance qui lui sont adressées, lui empêche-t-on d'en écrire ni recevoir sans permission, ni de parler à qui que ce soit d'affaires qui touchent le rétablissement de votre autorité royale, de vos affaires et de votre Etat ? Et si quelqu'un s'enhardit de ce faire, il est assuré d'un prompt bannissement et d'une persécution continuelle, voire en péril de mort, comme s'il n'y avait plus autre crime que celui de vous bien servir et d'avoir pitié de la France ; laquelle est d'autant plus déplorée que la Reine votre mère, de laquelle seule elle pourrait attendre sa délivrance, est tellement assujettie par leurs charmes et ensorcellements diaboliques, qu'elle ne voit que par leurs yeux, n'ouït que par leurs oreilles, ne parle que par leur bouche, ne respire que parleurs mouvements. Voire l'on éprouve que le courage altier, et cette fierté qui lui est tant naturelle, n'est à leurs regards que douceur, patience, humilité, voire subjection et servitude. L'on voit que l'esprit de S. M., lequel naturellement est si arrêté, si inflexible, inexorable et obstiné en toutes ses volontés que ses premières imaginations lui font concevoir, à l'endroit de ces gens-là, est changeant, léger, volage, mobile, comme virant et mouvant à tous les vents de leurs volontés, quelque divers, violents et tyranniques puissent-ils être. Et quant aux autres princes, ducs, pairs, officiers de la couronne, grands seigneurs du royaume, Cours souveraines, Corps du clergé, des villes, communautés et officiers qui en dépendent, ils se sont jusques à présent montrés si déloyaux les uns envers les autres, si désireux de faire leur profit particulier aux dépens de V. M., de l'Etat et de leurs plus intimes amis, ou sont tellement faillis de courage et appréhensifs d'être trahis et abandonnés du reste, que chacun aime mieux s'exposer à une infamie perpétuelle, et quelque peu moins de persécution présente, dont les douleurs sont flattées sous le titre qu'elles sont communes à tous, que non pas pour acquérir une gloire éternelle, devancer ses compagnons en aucune action vertueuse (courageuse) qui peut être sujette au moindre péril particulier. Tellement que, par ignorance ou nonchalance, nous voilà réduits à ne rien espérer que malheurs sur malheurs, et enfin une entière désolation et perdition : car, n'est-ce pas chose effroyable, que réservé la Reine votre mère, qui est charmée, Conchine, sa femme, Barbin et Mangot[19], qui disent que tout va bien (et encore le dernier parlerait autrement s'il osait), il n'y a personne qui ratiocine[20] tant soit peu, qui ne die, qui ne crie et qui ne croie tout le contenu de cette lettre. Les marchés, les foires, les églises, les palais, les auditoires[21], les assemblées générales et particulières, les lieux publics, la cour du Louvre, les salles, chambres et cabinets du Roi, des Reines et des Enfants de France, voire les trois Etats de cette monarchie retentissent de ce bruit. Chacun crie que V. M. est mal nourrie, réduite en servitude ; bref que toutes les lois, constitutions, libertés et franchises du royaume sont perdues ; voire crie tout haut ce que ce papier vous dénonce ; et néanmoins nul n'a le courage ni de vous le dire comme il faut, ni de vous proposer les remèdes qu'il convient appliquer à tant de maladies. Car, étant fils du plus grand Roi, du plus grand homme d'Etat et du plus grand chef de guerre qui ait jamais fleuri entre les humains, il ne vous saurait avoir laissé si peu de désir de gloire pour vouloir régner seul, si peu de prudence pour conduire utilement les affaires, et si peu de courage pour vaincre vos ennemis et vous tirer d'entre leurs mains, que vous n'ayez assez de toutes ces vertus pour les employer à votre délivrance, à exécuter ce qui vous sera conseillé sur ce sujet, et à vous jeter à propos en lieu de sûreté pour votre vie, et de facile accès pour vos bons sujets et serviteurs qui soupirent journellement après une telle occasion ; laquelle arrivant, vous serez émerveillé du nombre infini de gens de bien qui accourront à votre première voix, et ne trouverez autre difficulté en tout cela qu'en une absolue résolution, et au secret du jour, du temps et du lieu de l'exécution, et au choix des personnes qui y devront participer : car si ce dessein vient à la notice (connaissance) de ceux qui sont dénoncés, il n'y a sortes de violences et maléfices qu'ils n'exerceront contre votre personne, votre autorité et ceux qui auront été proposés pour vous y servir, n'ignorant point que votre liberté tire en conséquence nécessaire leur prison ; l'établissement de vos affaires, la destruction des leurs ; la validité des lois, des châtiments exemplaires de leurs crimes ; et la sûreté de votre domination, des supplices rigoureux en leurs personnes, qui ôtent l'audace à tous autres d'entreprendre et l'espérance de parvenir à ce qu'ils ont osé attenter, qui est d'autant plus effroyable qu'il est sans exemple. Je n'ignore point, Sire, qu'il se rencontrera de ces esprits envieux et contredisants, qui, ne faisant ni ne disant jamais rien qui vaille, ont accoutumé de mépriser et trouver mauvais toutes les actions et paroles d'autrui, lesquels essayeront de vous faire avoir cette lettre désagréable, ou la supprimeront, de peur que V. M. n'en tire les fruits qui lui seraient utiles, ou blâmeront le style, les avis et les conseils ; l'accuseront de redites en plusieurs points, et surtout en invectives contre les Espagnols, Conchine et sa femme, lequel dernier point j'ai aussi bien reconnu, en écrivant, qu'ils sauraient faire en accusant ou récriminant. Mais il m'est arrivé comme à ceux qui ayant une humeur superflue en excroissance maligne qui s'est tuméfiée, laquelle pour ne pouvoir suppurer ni s'écouler, s'est envenimée et enflammée, de sorte qu'elle cause d'excessives douleurs, aux nouveaux et fréquents élancements desquelles ils mettent la main sur la partie offensée, éclatent en mêmes cris contre mêmes causes. Et qui doute aussi que moi et tout bon Français qui a du jugement, lequel voit ces trois créatures avec leur Barbin et Luçon[22] régir tout le royaume, présider aux Conseils d'Etat, disposer des dignités, armes et trésors de France, et tenir Vos Majestés en servitude et comme esclaves de leurs fantaisies, ne tienne cela pour un prodige et une excroissance pestiférée en l'Etat, excessivement envenimée, laquelle, ne pouvant être réduite à la boue et jetée hors du corps de l'Etat, cause toutes ces cuisantes douleurs ; lesquelles m'ont ainsi fait réitérer mes cris et mettre si souvent la main sur ces aposthumes enflammées à la destruction de nos Rois, de la lignée royale, de tous les bons Français, voire de la couronne entière. Tous lesquels, s'ils avaient rien réservé[23] de la générosité de leurs ancêtres, ne jetteraient qu'un même cri, et tellement uniforme, qu'il serait suffisant pour jeter hors de cette vie, ou au moins du royaume, ces abominables chancres qui le vont gangrenant. N'est-ce donc pas une chose monstrueuse et lamentable de voir que chacun reconnaît toutes ces vérités, le crie bien haut, juge, voire même déjà ressent que la vertu et liberté française s'en vont entièrement opprimées, la monarchie ailleurs transférée, la justice anéantie, le droit subverti, et que le crime le plus capital du temps présent, c'est d'être bon Français, homme vertueux, capable de bons services et désireux de rétablir vraiment et absolument l'autorité royale en votre personne seule, sans que vos volontés et mouvements aient autre dépendance que celle de votre bon naturel et vertueuse inclination ? Et néanmoins, les peuples, villes et communautés, officiers subalternes, voire les Cours souveraines, les corps de la noblesse et du clergé, sont tellement fascinés de ce nom de Roi, dont ces gens font une fausse parade pour véritablement l'exterminer, et sont frappés d'un tel esprit d'étourdissement et d'avarice, et portent à l'avancement des uns des autres telle envie et jalousie ; les haines pour la diversité des religions s'en vont de sorte fomentées, et les aigreurs d'icelles, amorties par le feu Roi votre père, revêches, qu'ils aiment mieux se manger, ronger et consommer entre eux, et s'opposer à leur propre repos, qu'au progrès de ces pestes d'étrangers qui les tiennent à la gorge et sont prêts à les étrangler, avec un tel et si désordonné appétit de vengeance, pour avoir reconnu que quelques princes et grands du royaume avaient consulté pour se défaire de Conchine, qui est résolu de ne laisser jamais poser les armes en France, tant que votre mère la Reine la régira, qu'il n'ait détruit et fait mourir tous les princes et personnes qualifiées de l'Etat, afin d'établir sa valetaille, et ne laisser nul esprit ni homme assez puissant pour lui contester l'usurpation de l'Etat, ou la translation d'icelui en la main des Espagnols. Ce qui est d'autant plus déplorable qu'il est de plus facile remède, n'y ayant quasi qu'à le vouloir et l'entreprendre, ou par votre absolu commandement, ou par l'uniforme consentement de quelques personnes puissantes et ulcérées, dont il n'y a pas manque en France, ou par quelque esprit généreux résolu à la délivrance de son prince et de sa patrie, étant certain qu'après le coup il sera loué et applaudi de tous. Or, l'excès de notre turpitude et désolation est d'autant plus effroyable, qu'il n'était jamais tombé en l'imagination d'aucun que, après une perte tant épouvantable, reçue par vous et par toute la France, en l'assassinat cruel du feu Roi votre père, après tant de hontes et spoliations pleines d'opprobres, que les plus vertueux et capables personnages ont souffertes depuis ce temps, il restât plus rien d'exécrable et horrible à exercer, ni que dans les plus profonds abîmes des malices spirituelles, ni sous les révolutions secrètes des plus malignes influences, ni dans les plus noirs cachots de la mauvaise fortune, il y restât chose plus détestable que ce que la France avait enduré. Mais par ce que le succès des choses et la notice plus visible de leurs pernicieux desseins nous dénonce et fait conjecturer, les plus énormes calamités s'en vont à leur période, et prêtes à passer de nous à notre postérité, laquelle, encore qu'elle lise dans les histoires, et antiques et modernes, d'étranges et horribles mutations, subversions et désolations, sine trouvera-t-elle rien de semblable à celles qu'elle éprouvera, et que nos perfidies et lâchetés lui auront laissées en héritage, sans y laisser lieu de remède. Les siècles passés nous fournissent bien plusieurs exemples assez tragiques, funestes et pleins de manie et forcenerie, pendant les interrègnes, gynocraties[24], mairies du palais, changements de lignée et débilités d'esprit de nos souverains ; mais ces choses ont été souffertes, les unes en un temps et les autres en un autre, èsquels il se rencontrait toujours quelque personnage vertueux et brave qui embrassait la manutention et restauration de la monarchie, au lieu qu'à présent, il semble que toutes ces lamentables conditions ensemble soient échues en notre misérable siècle, puisque nous sommes à la veille d'en ressentir tous les désastres accumulés en un moment, le remède n'en consistant quasi plus qu'en vous seul et en la résolution généreuse que vous prendrez de garantir votre liberté, et peut-être votre vie, faisant tomber sur autrui le péril que l'on vous prépare. Ce que je veux encore espérer, par le coup digne du fils d'un si admirable père, et que vous mettrez votre personne en sûreté, et donnerez libre et sûr accès à tous vos sujets pour vous venir trouver et consacrer à votre service leurs biens et leur vie, gardant sur toutes choses votre foi et votre parole, et rendant la justice sans acceptation de personne, afin qu'à votre exemple la loyauté et confiance soit rétablie, le respect et l'obéissance rendue à qui il appartient, comme seuls biens de la société humaine, par lesquels les rois règnent, les royaumes florissent et jouissent, avec leurs souverains, d'une souveraine joie, repos d'esprit et félicité perdurable. En laquelle je prie l'Eternel, Sire, qu'il vous veuille maintenir et vous conserver en santé et longue vie. C'est votre très humble, très obéissant et très fidèle sujet et serviteur. Du 15 avril 1617. Douze jours après, Concini était tué, au Louvre, par ordre du Roi, et Marie de Médicis chassée du pouvoir et de Paris. Il me paraît certain que la lettre de Sully dut faire cesser les irrésolutions du Roi et de ses quelques serviteurs[25]. En apprenant que M. de Vitry l'avait débarrassé de son geôlier, Louis XIII s'écria : A cette heure, je suis Roi ![26] M. de Luynes, qu'il n'est plus permis aujourd'hui de considérer comme une nullité, devint à son tour tout puissant et essaya de remettre l'ordre dans l'Etat ; mais il se trouva bientôt en lutte avec les Huguenots (1621). Pendant cette guerre, Sully reparut aux armées comme Grand-Maître de l'artillerie ; ce fut en cette qualité qu'il prit part aux sièges de Saint-Jean-d’Angély et de Montauban[27]. Le duc de Sully, dit
l'abbé de l'Ecluse, ne pouvant, à cause de sa
religion, avoir aucun ordre, il s'en était fait un pour lui-même. L'inventaire
de ses effets porte plusieurs chaînes de diamants servant à cet usage. Il
portait donc à son cou, surtout depuis la mort de Henri IV, une chaîne d'or
ou de diamants, où pendait une grande médaille d'or, sur laquelle était
empreinte en relief la figure de ce grand prince. De temps en temps il la
prenait, s'arrêtait à la contempler et la baisait : il ne la quittait pas,
même lorsqu'il venait à la Cour, non plus que l'ancien habillement, qu'il
conserva toujours, sans vouloir s'assujettir à la mode. On sait ce qui lui arriva un jour à la Cour, où Louis XIII l'avait mandé. Je vous ai fait venir, monsieur de Sully, lui dit le jeune prince, comme étant l'homme de confiance du feu Roi mon père et un de ses principaux ministres, pour vous demander avis et m'entretenir avec vous, sur les importantes affaires que j'ai à présent. Le duc de Sully, qui ne voyait autour du Roi que de jeunes courtisans, qui riaient entre eux et qui, pour faire leur cour au connétable de Luynes, tournaient en ridicule son habillement, son maintien grave et toutes ses manières, fit cette réponse : Sire, je suis trop vieux pour changer d'habitude sur rien : quand le feu Roi votre père, de glorieuse mémoire, me faisait l'honneur de m'appeler auprès de ça personne, pour s'entretenir avec moi sur ses grandes et importantes affaires, au préalable il faisait sortir les bouffons. Le jeune Roi parut approuver cette liberté ; il fit retirer tout le monde et demeura seul avec M. de Sully. Tallemant des Réaux[28] raconte, à propos des anciennes modes conservées par Sully, que, tous les jours, quand il était à Paris, il se promenait ainsi vêtu et paré de ses chaînes et insignes de diamants, sous les porches ou arcades de la place Royal[29], qui était près de son hôtel[30]. Tous les passants s'amusaient à le regarder. Le connétable de Luynes n'avait pas craint de rappeler Sully à l'armée et de confier à son habileté le service de l'artillerie pendant la campagne de 1621 contre les Huguenots. Richelieu, qui ne l'aimait pas, le tint éloigné de la Cour et de l'armée. En 1634, Sully fut remplacé dans la charge de Grand-Maître de l'artillerie par M. de la Meilleraie, cousin du Cardinal, qui lui acheta sa charge. En même temps Sully recevait le bâton de maréchal de France. Les dernières joies de Sully furent les victoires des généreux français sur les bravaches espagnols[31] et sur l'Angleterre : la prise de la Rochelle, la victoire de Ré, les secours de Casai, la prise de Privas, la destruction de la faction huguenote. Nous ne savons ce que Sully pensa des victoires remportées dans les années suivantes ; mais on peut être sûr qu'il applaudit aux victoires qui réalisaient en partie les projets de Henri IV et les siens. Le duc de Sully mourut le 22 décembre 1641 en son château de Villebon. Il avait alors quatre-vingt-deux ans. |