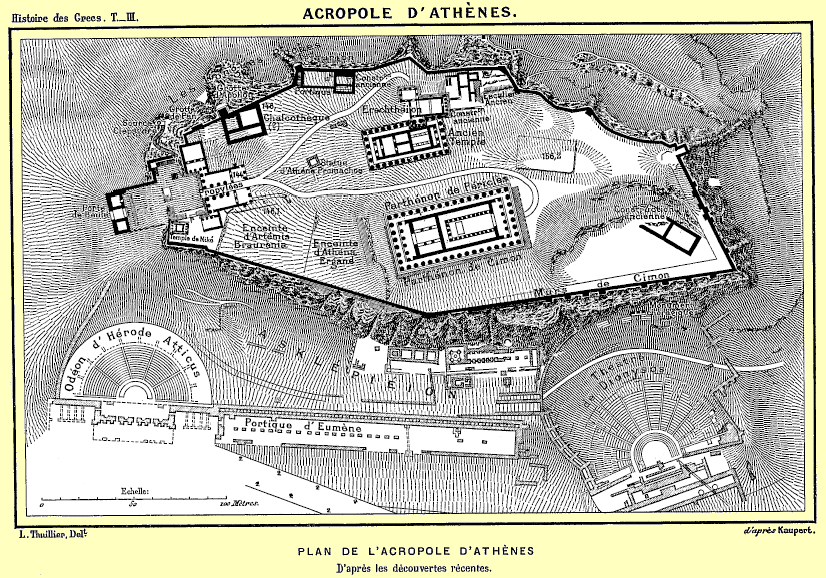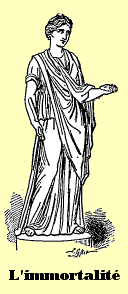HISTOIRE DES GRECS
HUITIÈME PÉRIODE — LA LIGUE ACHÉENNE (272-146) – EFFORTS IMPUISSANTS
POUR S’UNIR ET SE SAUVER.
Chapitre XL — Résumé général.
— I —Rome a commencé par la prose et, durant des siècles, elle
n’a pas connu d’autre expression de la pensée. Croire que la mythologie n’est fiction qu’à la surface et vérité au dedans ; que c’est une toile de décor qu’il suffit de lever pour voir une action véritable, ce serait singulièrement méconnaître la puissance créatrice de l’imagination populaire. Deux forces qui agissent souvent en sens contraire, le sentiment et la raison, conduisent la vie des hommes et des peuples. L’un, qui a la puissance de l’instinct, règne longtemps seul et, toujours, dispute la prépondérance à l’autre, dont l’autorité ne s’établit qu’avec une extrême lenteur, sur des points successivement et laborieusement conquis. Il y a donc, dans la vie des nations, un âge où tout est sentiment et image, où tout s’anime et se personnifie, comme il envient un autre où tout est réflexion et examen, où tout s’analyse et se décompose. Le premier est le temps de la foi aux phénomènes, l’époque des légendes qui peuplent de tant de divinités l’Olympe et le Walhalla, qui grossissent de tant d’aventures l’histoire des héros, celle d’Achille ou de Roland, de Thésée ou d’Arthur. Le second est le temps du doute pour ce qui parait sortir des lois naturelles; l’époque où la recherche scientifique des causes et des effets réduit le rôle des dieux et des héros, en montrant derrière ceux-ci la société qui fait la moitié de leur force; et derrière ceux-là la foi qui les a créés et qui leur commande, tout en paraissant leur obéir. De ces deux âges, le premier dure, même pour les plus
éminents génies de l’Hellade, jusqu’au sixième siècle avant notre ère, et le
second commence avec Anaxagore et Thucydide. Hérodote subit encore le joug de
la vieille foi; il a la curiosité enfantine du voyageur que tout étonne et,
sauf quelques timides interprétations, il admet les récits de la muse. D’Hérodote
à Thucydide, En un autre livre, j’ai refusé d’entrer dans le dédale des
origines romaines; à plus forte raison me suis-je gardé de l’aire effort pour
tirer une histoire suivie de ces poétiques débris, qui recouvrent et cachent
sous de gracieuses ou de redoutables fictions les commencements de Cependant, sous D’où ceux-ci venaient-ils ? De l’Asie, berceau de la
race aryane, laquelle, dans son long voyage jusqu’aux extrémités de l’Occident,
laissa sur le bord oriental de la mer Égée, en Thrace et dans Si, dans la période légendaire, l’histoire politique a peu d’événements certains à recueillir, l’histoire sociale trouve beaucoup à prendre dans les usages qui ont persévéré. C’est alors que la famille se forme, que le culte s’établit, que les cités s’élèvent, et ce sont des bases antiques qui portent le foyer domestique, le prytanée public et l’Agora où d’abord siègent, autour du roi, les chefs., son conseil, où le peuple ensuite viendra délibérer et voter. Il n’y a pas dans Homère que le fracas des armes, dans Hésiode que la naissance des dieux et les travaux des champs. Dans ces vieux poèmes et dans les légendes d’où ils sont sortis, les faits, sans doute, tiennent plus de l’imagination que de la réalité; mais on y trouve des idées, des moeurs, des croyances qui ont vécu longtemps. Achille chante la gloire des braves; Hector compte sur ses exploits pour avoir, dans la mémoire des hommes, l’immortalité, et ils ont légué aux vaillants de l’âge historique le sentiment de l’honneur. Les femmes sont : la noble Andromaque, Arété, ou la vertu, si digne de son nom, sa fille Nausicaa, d’une simplicité virginale, Alceste, qui meurt pour son époux, Antigone, pour son frère, et tous ces types d’héroïnes qui traversent chastement le théâtre de Sophocle. La religion y garde les restes d’un naturalisme grossier qui se mêle au culte des glorieux Olympiens, et, à côté de démons bienfaisants, elle fait vivre des divinités que le bonheur des hommes irrite. Mais peu à peu le ciel sombre s’éclaircit ; le Destin cesse d’être aveugle, Némésis d’être envieuse; Apollon, le dieu de la lumière, donne de sages conseils, et Minerve adoucit les moeurs -de son peuple. La mort se relie à la vie par les honneurs funèbres qui valent aux aïeux une nouvelle existence d’outre-tombe, et font d’eux les protecteurs de ceux qu’ils ont quittés. Le culte des morts, lien des générations, consacre les familles aristocratiques, et c’est autour des tombeaux, comme auprès des temples, que le patriotisme, la grande vertu de ces vieilles sociétés, prend la force qui lui a fait accomplir tant de miracles[1]. — II —Le retour des Héraclides et les grands mouvements de
peuples qui en sont la suite ferment la période légendaire. Après elle, les
traditions s’arrêtent soudain ; Nous n’avons donc rien à mettre entre l’invasion des
Doriens, cette race que l’Iliade ne connaît pas, et l’ère des
Olympiades. Pour Sparte, avant Lycurgue, pour Athènes, avant Solon, on peut
recueillir quelques mots à peine, et à peu près rien pour le reste de l’Hellade,
bien que, dès cette époque, Du onzième au septième siècle, un fait considérable se
produisit, la diffusion de la race hellénique sur presque tous les rivages de
Les Grecs, qui se plaisaient à cacher un sens profond sous les plus gracieuses images, contaient qu’un berger, faisant paître ses troupeaux sur le bord de la mer, vit un jour une belle jeune fille sortir du sein des eaux, lui sourire et l’appeler près d’elle. Il hésita d’abord, puis céda au charme et se jeta dans les flots. Combien de sirènes enchanteresses jouaient ainsi autour de ces beaux rivages et en appelaient les habitants sur l’onde azurée ! Les Grecs cédèrent comme le pâtre à l’attrait irrésistible et coururent d’île en île, entre les trois continents qu’elles rapprochent, à la rencontre, sur bien des points, de peuples qui avaient avec eux une même origine, ou de vieilles relations de commerce. La nature leur imposait de deux manières l’obligation de naviguer sans cesse sur le grand abîme, par la situation de leur pays d’où l’on voit presque partout la mer; plus encore par les produits qu’il donne. Le sol grec, peu propre aux céréales, malgré la protection de Déméter, la déesse vénérable, l’est beaucoup à la vigne et à l’olivier, cultures industrielles et commerciales. Un peuple qui a du blé et du bétail peut se passer des autres et ne demander rien de plus à la terre qui le nourrit; de là, la lente croissance des peuples agriculteurs. Mais celui qui n’a que du vin et de l’huile mourrait de faim s’il n’échangeait ses denrées. Le voilà donc forcé de vivre en relations continuelles avec ses voisins, de courir le monde et d’y ramasser, avec les marchandises, des connaissances et des idées. Nous étonnerons-nous, après cela, que le peuple grec ait été et soit encore le peuple commerçant par excellence ; qu’il ait visité toutes les terres à portée de ses yeux et laissé une colonie sur tous leurs rivages ? Le commerce vit de liberté : les colonies grecques furent libres: celles de Rome ont été dépendantes parce qu’elles étaient un instrument de conquête et que la domination veut l’obéissance. Pendant que les Grecs sortaient par les mille portes que la nature avait ouvertes devant eux, une révolution intérieure substituait lentement aux rois de l’âge héroïque, fils des dieux, les nobles qui prétendaient encore à une descendance divine. Quand ces nobles n’eurent plus de maîtres au-dessus d’eux, ils voulurent, au-dessous, n’avoir que des sujets. Les sujets, à leur tour, arrivés à plus de bien-être et d’intelligence, se crurent capables de gérer eux-mêmes leurs affaires; ils accomplirent contre l’oligarchie ce que l’oligarchie avait fait contre les rois. Mais, pour cette lutte, ils avaient pris des chefs, qui s’emparèrent du gouvernement, τύραννοι : ici par force ou surprise, là par le consentement du peuple, qui leur donnait le pouvoir pour qu’ils lui donnassent l’ordre et l’égalité. Ces tyrans aussi passèrent. Les abus, les violences,
amenèrent une révolution nouvelle, cette fois démocratique. Telle est donc la
vie intérieure de Durant ce long et pénible travail de transformation intérieure, la vie intellectuelle est comme suspendue dans la métropole. Mais, dans les colonies asiatiques, au voisinage des grandes civilisations orientales, le génie se déploie. L’art, la science, y naissent ; la poésie augmente l’héritage d’Homère, et le monde grec s’illumine à sa circonférence du plus vif éclat. A la fin du sixième siècle, une domination ennemie s’étend sur ces intelligentes cités. Cette main de l’étranger glace les sources de la vie, et la civilisation allait périr, étouffée dans son germe ; Marathon et Salamine la sauvèrent : noms glorieux que l’humanité reconnaissante répétera toujours. — III —Avec ses golfes pour fossés et ses montagnes pour
bastions, Au-dessus des hommes supérieurs qui se pressent dans ses
murs domine la noble figure de Périclès. Ses ennemis l’appelaient l’Olympien.
Ils avaient raison; car il dirigeait et contenait avec une souveraine sagesse
ce peuple intelligent, passionné, mobile, qui au besoin sut avoir la
constance romaine ; qui fit des fautes, mais qui les a rachetées par
tout ce qu’il nous a donné de chefs-d’œuvre et de grands exemples. Foule
élégante et spirituelle, curieuse d’art, de science, de poésie ; où la
fortune indiquait à peine des rangs, où l’éducation, la même pour tous, n’en établissait
pas ; moins peuple qu’aristocratie populaire, et élevée à ce point de
grandeur par son génie propre, résultat de sa position géographique et de son
histoire, et par les institutions les plus humaines, les plus vraiment
libérales que l’antiquité ait eues[2]. Supprimez de l’histoire
Athènes et ses grands hommes, que restera-t-il de J’avoue ma sympathique affection pour cette glorieuse
république qui eut des partis et des révolutions, mais point de guerres
civiles ni de révoltes d’esclaves[3] ; pour la
ville que ses deux grands ennemis, Philippe et Alexandre, ne purent haïr;
pour ce peuple dont l’histoire s’ouvre à Marathon par un éclatant triomphe et
se ferme à Chéronée, avec ce cri éloquent de Démosthène : Non, non, vous n’avez pas failli, Athéniens, en défendant
jusqu’à la mort la liberté de C’était bien le peuple favori de la déesse aux pensées nombreuses[10] qui, du haut de
l’Acropole, veillait sur la cité fidèle ou l’inspirait ; qui se mêlait
aux combattants, mais pour modérer leur fougue ; qui tenait la lance,
mais pour faire triompher le droit ; qui était Tel dieu, tel peuple; ou, ce qui serait plus vrai : tel peuple, telle divinité. La plus intelligente et la meilleure des cités grecques, devait avoir pour déesse Poliade et Éponyme, la plus respectable des divinités de l’Olympe hellénique. Le jour où le jeune Athénien, arrivé à sa dix-huitième année, recevait les armes qu’il devait porter pour la défense de son pays, il prêtait le serment que voici : Je ne déshonorerai pas ces armes sacrées et je ne quitterai pas mon compagnon de rang. Je combattrai pour tout ce qui est saint et sacré, seul ou avec beaucoup, et je ne rendrai point à ceux qui nous succéderont ma patrie moindre que je ne l’aurai reçue, mais plus grande et plus forte. J’obéirai aux magistrats et aux lois, et si quelqu’un détruit ces lois ou n’y obéit pas, je les vengerai, seul ou avec mes concitoyens. et j’honorerai la religion de nies pères. Je prends les dieux à témoin de mes paroles. Et ce serment, ils l’ont tenu. Grâce à leur système d’éducation et d’entraînement militaire, les Grecs ont été, avant la phalange d’Alexandre et la légion romaine, les premiers soldats du monde. Après cela, il n’y a point à s’étonner que ce peuple se soit divinisé lui-même, ou plutôt qu’il ait divinisé ses institutions qui, pour le cinquième siècle au moins, l’avaient fait si grand : un sanctuaire fut consacré au Démos et aux Charites, les déesses qui personnifiaient la reconnaissance[13]. — IV —Nous aimons
La vie politique des Grecs, à l’époque historique, était faite de deux idées : l’indépendance de, la cité et l’égalité des citoyens. Ils voulaient que leur ville se gouvernât d’après les lois qu’elle s’était données c’était l’autonomie, et que tous les citoyens eussent les mêmes droits c’était l’isonomie. Avec cette double préoccupation, l’homme disparut d’abord derrière le citoyen. Pour faire celui-ci plus grand, on diminua celui-là, et on l’eût diminué bien davantage si l’on eût écouté les philosophes, même les plus illustres, Platon et Aristote. L’importance sociale donnée au citoyen fortifia en lui le sentiment de la dignité personnelle, qui le mit bien au-dessus des serviles populations de l’Orient. C’était un premier pas vers le grand principe que le christianisme apportera, celui de l’égalité morale et de la fraternité humaine; le second sera fait par Rome, quand elle donnera à tous les habitants de l’empire le droit de cité et que ses jurisconsultes diront, après les stoïciens : Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet[14] ; mais le progrès est si lent que ce dernier sentiment reste encore, dans l’heure présente, à l’état de formule, qui n’empêche ni les guerres de classes, ni celles de nations. La cité hellénique, où commençait cette grande évolution, n’avait qu’une très faible population, qu’elle ne tenait pas à accroître. L’assemblée souveraine à Athènes allait rarement à cinq mille citoyens, et d’une phrase de Démosthène on serait en droit de conclure qu’il suffisait souvent d’un très petit nombre de votes pour trancher une question importante. Le jour de l’élection des Pylagores, dit-il, trois ou quatre mains se levèrent pour Eschine, et il se trouva revêtu de l’autorité d’Athènes[15]. Quelques hommes, beaux parleurs, pouvaient donc exercer une influence dangereuse sur ces assemblées souveraines, réunies parfois au hasard des circonstances, et qui légiféraient, jugeaient, administraient au moyen d’un vote, eût-il été enlevé par surprise ou demandé à la passion du moment. Autre péril ; avec une population si restreinte, ces villes ne pouvaient être une base solide pour un empire. Vivant isolées dans les limites que la nature du sol leur avait données, elles eurent au delà des alliés ou des sujets et elles contractèrent des liens d’hospitalité; mais, jalouses de leur droit de cité qui eût ouvert à l’étranger l’agora et les temples, elles ne voulaient pas livrer leurs divinités poliades à des adorateurs d’autres dieux, ni leurs institutions à des hommes élevés sous d’autres lois. Athènes et Sparte auraient bien volontiers détruit, l’une Mégare, l’autre Argos ; jamais elles ne leur auraient accordé l’isonomie[16]. Cette inimitié entre cités voisines fut cause de guerres continuelles. Mais personne n’a le droit de reprocher aux Grecs leur humeur batailleuse, car, partout et toujours, l’humanité a obéi à ce reste d’animalité, dont elle ne se débarrasse pas, et qui lui l’ait aimer la destruction. En théorie, le régime municipal semble le meilleur des gouvernements, parce qu’il suppose plus de liberté pour l’individu; dans l’Hellade, il n’a pas donné aux Grecs le besoin de vivre tranquilles autour de leurs temples et de leurs lieux d’assemblée. Nous, leurs héritiers, nous gémissons de ces violences, et nous sommes prés de les regarder comme un crime contre nous-mêmes, parce qu’elles ont détourné, pour l’œuvre sanglante de la guerre, des forces qui eussent profité aux travaux bienfaisants de la paix. Mais si la civilisation n’est ni la fleur des ruines ni celle des tempêtes, ce n’est pas non plus dans le calme et le silence que toujours elle s’épanouit. La lutte des intérêts et des passions développe les caractères; la vie est plus énergique; les facultés deviennent plus actives et plus riches. De ces petites villes, tourmentées et bruyantes, sortit souvent une merveille de l’art ou de la pensée. Aristote a dit : Pour ces petites cités, l’ennemi était souvent aux portes et, avec lui, les blessures, l’esclavage et la mort. Aussi la ville qui, derrière ses remparts, abritait la famille, les dieux et l’indépendance, était-elle aimée d’un ardent amour; comme dans une place assiégée, on sacrifiait tout à son salut, non seulement sa vie, mais ce qui, souvent, est plus difficile, sa fortune. Une inscription parle de souscriptions volontaires[18], sans intérêt tiré du capital; et les doits patriotiques étaient fréquents. Démosthène cite le stratège Nausiclès qui paya la solde de deux mille hoplites que la république ne payait pas; deux généraux donnèrent huit cents boucliers à leurs soldats qui en manquaient; d’autres employèrent une partie de leur bien à réparer les murs de la cité. Pour pareil ouvrage, Démosthène, qui n’était point riche, contribua volontairement de 5 talents, et pour le théâtre de 100 mines[19]. Quelle était leur récompense ? une couronne que, par décret du peuple, ils recevaient au théâtre de Dionysos, le jour des Grandes Panathénées. Ces libéralités ne doivent pas étonner ; elles
partaient du sentiment le plus énergique dans ces villes, le
patriotisme ; mais nous en trouvons un autre que d’ordinaire on n’y
cherche pas la charité. L’heure des grandes institutions charitables, que le
christianisme et la philosophie ont multipliées, n’était pas encore venue,
parce que l’état social ne les réclamait pas. Démosthène ne fut pas seul à
racheter des captifs, à doter des filles pauvres et à pouvoir dire, comme
dans le discours sur Ces sentiments sont le beau côté des mœurs municipales de Aux temps aristocratiques, les Eupatrides étant seuls comptés avaient seuls aussi des obligations, comme, dans les épopées homériques, les héros attiraient sur eux le fort du combat. Héritières de cette vieille coutume, la plupart des villes grecques eurent pour principe de leur organisation financière qu’une partie des dépenses publiques resterait à la charge des riches. Solon, par exemple, sans changer beaucoup l’état ancien des choses, attribua aux membres des premières classes de lourds impôts; mais, en retour, il leur assura des privilèges politiques. Avec le temps, les charges augmentèrent et les privilèges disparurent. Tout citoyen, même le plus pauvre, put arriver par le sort aux fonctions publiques et, à cause de la fréquence des guerres, de l’éclat croissant des fêtes, les liturgies et les chorégies réservées aux riches imposèrent des dépenses de jour en jour plus lourdes. Un armement était-il décidé, aussitôt arrivaient, à l’assemblée publique, des demandes en dégrèvement; au temple de Diane, de prétendus riches qui fuyaient les charges de la triérarchie; dans les prisons, les malheureux qu’y traînait l’inspecteur de lit marine, parce qu’ils n’avaient pas apporté des voiles neuves pour leur galère[25]. Sophocle et Socrate ont bien parlé des lois non écrites que la nature a mises dans la conscience humaine ; les constitutions, même les meilleures, n’avaient su que faire de la cité l’arbitre suprême du bien et du mal, de sorte que, dans les villes grecques, la justice était souvent absente, de même que le fut toujours la liberté véritable. Aristote peint la démocratie comme occupée partout à passer le niveau sur les fortunes, par de ruineuses amendes et des confiscations ; et en effet pour beaucoup d’agitateurs, pour ces brouillons, comme Polybe les appelle, τούς xαχέxτας, le fin de la politique consistait à mettre dessous ce qui était dessus. Ainsi, Messène partage au peuple les biens des riches ; Cléomène à Sparte, Nicoclès à Sicyone, font de même. Comme les morts seuls ne reviennent pas, un démagogue de Cios fait tuer ceux qu’il dépouille; Nabis n’agit pas autrement partout où il est le maître. Les Étoliens, les Thessaliens, abolissent les dettes ; les Chiotes ont une autre économie sociale : lorsque le gouvernement a besoin d’argent, il décrète que toutes les dettes privées seront payées à l’État ; ailleurs, on prend aux femmes leurs bijoux, aux détenteurs du sol leurs moissons, et jusque dans Athènes plusieurs pensent qu’une confiscation illégale n’est pas une ressource à dédaigner[26]. La conséquence de cette servitude financière des riches et des dangers qui menaçaient la propriété fut que les détenteurs du sol ou des capitaux se montrèrent trop souvent, dans un monde devenu commercial et industriel, les ennemis naturels des vieilles coutumes et des constitutions qui les consacraient. De là des complots, des révolutions, des sentences d’exil ou de confiscation, et les bannis rôdant en armes autour de la cité pour en forcer les portes[27]. Les héliastes disaient bien à Athènes, dans leur serment officiel : Je jure de ne souffrir jamais ni l’abolition des dettes ni le partage des terres et des maisons[28]. Et en effet ces mesures révolutionnaires ne furent pas décrétées dans la cité de Minerve, dont la prospérité commerciale dépendait de la fidèle exécution des contrats ; mais que de fois les sycophantes de cette ville ruinèrent d’anciennes et légitimes fortunes par les plus futiles accusations[29]. Lorsque ces bouleversements se furent multipliés, les vieilles idées de dévouement à la cité se perdirent ; des alliances contraires au génie et aux intérêts du peuple furent contractées ; et comme ces nouveautés survinrent en un temps où tout était ébranlé, la religion, le patriotisme et les vertus civiques, la cité, ne portant plus sur ses bases antiques, s’écroula. Les Grecs avaient, comme nous, deux autres sortes de propriétés : le domaine public, qui variait d’une ville à l’autre, et les biens ecclésiastiques, souvent très considérables, mais qui n’étaient pas toujours respectés : ainsi, les trésors de Delphes furent pillés par les Phocidiens, ceux d’Olympie par les Arcadiens, et plus d’une fois on sécularisa certaines parties des possessions sacrées. En cas de nécessité, l’État empruntait au sanctuaire et, devenu débiteur de ses dieux, il leur payait l’intérêt des sommes prêtées, mais oubliait parfois de rendre ce qu’il avait reçu. Par suite de la prépotence de l’État. ces biens étaient soumis aux vicissitudes des événements, et la politique réglait tout, au temple comme à l’agora[30]. Sur un autre point, l’organisation de la famille, les
Grecs n’ont rien non plus à nous donner. Trop voisins de l’Asie, ils n’ont
point fait à la femme, dans l’âge historique, une condition très supérieure à
celle qu’on lui reconnaissait à Ninive et à Babylone. Son devoir était de
donner à son époux des enfants légitimes qui continueraient la famille et les
sacrifices domestiques : il ne lui était pas demandé autre chose et les
nobles femmes des temps homériques, Alceste, Andromaque, Pénélope, étaient
bien oubliées. Toutes, certainement, ne se seraient point faites les
compagnes de Malgré notre admiration pour l’ancienne Grèce, nous n’avons donc pas en politique de leçons à lui demander, si ce n’est afin d’éviter les fautes où elle est tombée : entre elle et nos sociétés modernes, la différence est trop grande. — V —Aux causes politiques qui firent sombrer Il faut bien le dire: l’ébranlement produit dans les intelligences par le siècle de Périclès, cet âge d’or de l’esprit humain, ouvrit l’entrée de régions inconnues où la vieille Hellade se perdit. Elle y trouva pour l’art et la pensée de belles inspirations; mais alors se montra, avec une force qu’elle n’avait jamais eue, la philosophie, fille rebelle du polythéisme, qui voulut se rendre compte de l’homme et du monde, que les vieux mythes n’expliquaient pas. Née aux abords des temples qu’un jour elle renversera, car de pareils enfants tuent leur mère, comme ces plantes qui croissent dans les joints des vieilles murailles et finissent par les faire crouler, la philosophie entra de bonne heure en lutte avec la religion positive. Celle-ci, d’ailleurs, n’était point faite pour devenir une règle morale. Dans la nature, il n’y a ni bien ni mal, seulement le jeu des forces physiques et chimiques. Les anciens peuples, trop rapprochés d’elle pour ne pas subir son influence, eurent des religions que, par un barbarisme expressif, on a appelées le culte de la nature naturante ou des forces matérielles, et celui de la nature naturée ou des apparences sous lesquelles ces forces se manifestent. De là les monstrueuses conceptions de l’Égypte et de l’Asie, les prostitutions sacrées de Babylone et de Corinthe, même les symboles étranges dont Athènes décorait les rues et que ses jeunes filles portaient dans les fêtes. Aussi ces peuples n’hésitaient pas à attribuer à leurs dieux les plus honteuses passions, le vol, l’inceste, l’adultère, la haine, la vengeance, de sorte que le polythéisme obscurcissait la notion du juste et légitimait le mal par l’exemple de ceux qui étaient quelquefois, et auraient dû être toujours, la représentation du bien. Alors, par le développement parallèle. mais en sens contraire, des légendes divines et de la raison humaine, il arriva que le polythéisme grec se trouva dans cette condition, mortelle pour un culte, que la religion fut d’un côté et la morale de l’autre. Celle-ci attaqua celle-là et en eut raison : les dieux tombèrent de l’Olympe et l’herbe poussa au parvis des temples. C’eût été bien si les légendes de ces dieux détrônés avaient été remplacées par de viriles doctrines qui auraient éclairé et purifié la raison humaine. Cet enseignement se trouvait çà et là, dans les paroles des poètes et des philosophes; niais la foule ne les écoutait pas, livrée qu’elle était aux superstitions honteuses par où finissent, pour les faibles les grandes croyances. En chassant les dieux de l’Olympe, la philosophie sortait
du cercle des croyances vulgaires; elle sortit aussi, par ses leçons, de l’étroite
enceinte de la cité. Au-dessus de l’homme, elle vit l’humanité; au-dessus de
l’État, le monde. Et j’ai bien peur qu’elle n’ait aidé à la ruine du
patriotisme, comme à celle des dieux, par cela même qu’elle s’élevait à des
idées plus pures sur la divinité et sur la vertu véritable. La belle parole
qu’on lit dans Marc Aurèle : Je suis citoyen du monde,
est de Socrate[31],
ou de ses disciples ; une autre école osera tourner en dérision les
patriotiques sentiments des aïeux. Ne peinons pas
pour sauver La poésie, à son tour, popularisa les déductions
sceptiques des philosophes. Épicharme, Aristophane, par leurs sarcasmes,
firent entendre le cri recueilli à Rome par Lucrèce : Les dieux mourront ! Aussi, dans l’effroi que
causent aux peuples le silence des cieux, et les ténèbres que les sophistes
amoncellent sur des questions autrefois simples, ils frappent même ceux qui
tenaient le flambeau de l’avenir. Athènes chasse Anaxagore et fait boire la
ciguë à Socrate. Cruelle et stérile victoire de l’intolérance ! C’en est
fait : les dieux s’en vont ; et, par malheur, le Dieu nouveau n’est pas
encore venu. Cependant un grand esprit semble l’entrevoir. Platon annonce
quelques-unes des vérités de la foi de l’avenir. Mais un petit nombre
seulement le comprennent; les autres n’écoutent et n’entendent que ceux qui
leur crient de douter de tout, du ciel, de la patrie, de la vertu, et de ne
croire qu’à la fortune, au plaisir. Alors le patriotisme tombe, la moralité
se perd, les cités s’affaissent sous le poids de la corruption ; et — VI —Le grand éclat de la vie hellénique n’a pas duré plus d’un siècle et demi, depuis les victoires de la guerre d’indépendance jusqu’à la bataille de Chéronée où la liberté grecque trouva son tombeau. Cet intervalle est rempli par le duel de Sparte et d’Athènes auquel Thèbes à la fin se mêla, par des combats sans cesse renaissants, par une grande destruction d’hommes et de cités. Néanmoins, ce temps si court a suffi pour faire de là Grèce la terre sainte de la civilisation : la pensée humaine est née là. Mais pourquoi cette grandeur ne s’est-elle pas conservée
plus longtemps ? Nous venons de marquer les principales causes de cette
rapide décadence ; il reste à dire quels en furent les instruments :
deux peuples grecs, les Spartiates et les Macédoniens, et une nation
étrangère, les Romains. Pour ceux-ci, lorsqu’ils parurent sur la côte
orientale de l’Adriatique, ils ne trouvèrent, dans Le dix-huitième siècle n’a eu d’admiration que pour Lacédémone, gagné qu’il fut par le paradoxe de Rousseau sur la supériorité de l’homme de la nature, et sur la prépotence nécessaire de l’État. Mais les Spartiates qui, par la généalogie fabuleuse d’Hellen, s’étaient dits les aînés de la nation, furent toujours une exception au milieu d’elle. Rien de ce qui faisait le fond d’un Grec : l’amour des arts, des discours à l’agora, des discussions philosophiques à l’école, ne les intéressait. Avec leur propriété limitée, ils n’eurent qu’une liberté restreinte, si tant est qu’ils aient jamais été des hommes libres comme nous l’entendons aujourd’hui. Les anciens admiraient, et nos utopistes ont admiré après eux, les grandes choses qu’on trouve dans la cité sans murs des bords de l’Eurotas : la sobriété, la discipline, le mépris pour les passions, la douleur et la mort. Les Spartiates savaient obéir et mourir. Si un peuple n’a d’autre devoir que de vivre au jour le jour, sans souci du lendemain ni du monde, dans l’adoration de lui-même et la pratique de certaines qualités morales, Sparte a rempli sa tâche. Mais si tout peuple est comptable devant l’histoire de ses efforts pour apporter sa pierre dans l’édifice que l’humanité se construit, Sparte, simple machine de guerre, instrument de destruction qui a fini par se détruire lui-même, que peut-elle répondre, lorsqu’il lui est demandé quelle a été sa part dans le labeur commun, et quelle oeuvre elle a légué au monde ? On cite les musiciens et les poètes qui ont passé par Lacédémone : le Crétois Thalétas, Alcman de Sarcles, Terpandre de Lesbos, Polymnésios de Colophon, Sacadas d’Argos, même l’Athénien Tyrtée ; ils venaient tous d’autres cités et aucun n’a fait école au milieu de cette population où la seule vertu guerrière était honorée. Et de ses citoyens, qu’a-t-elle fait ? Des serfs de l’État, n’ayant que le droit trompeur d’élire leurs maîtres, comme on l’aura en des institutions d’un autre âge, où la grande préoccupation ne sera pas l’activité de la vie sociale. La moitié de Ce, n’est pas Athènes seule qui tombe à la lin de cette
lutte : L’Assemblée de Corinthe renouvela le conte, si souvent
véridique, du cheval qui veut se venger du cerf. Pour assouvir sa haine deux
fois séculaire contre le grand empire oriental, Maîtres des immenses richesses que les Grands Rois gardaient au fond de leurs palais, ses successeurs achetèrent tout en Grèce. Quiconque se sentit du courage, du talent ou de l’ambition, déserta sa vieille cité pour se faire soldat de fortune, courtisan de prince, ou ministre de débauches royales. Athènes avait été si brillante en ses beaux jours, parce qu’on venait de toutes parts lui demander l’inspiration ou la consécration de la gloire. C’est vers les pays hellénisés d’Afrique et d’Asie que la vie grecque, à présent, s’écoule[34], c’est là que sont la fortune et le plaisir ; un poète de cette triste époque a dit : La patrie, elle est où l’on vit bien. — VII —Quelle est cependant dans l’histoire générale de l’humanité
la place de Dans les vastes plaines que le soleil des tropiques féconde et que de grands fleuves arrosent, l’homme trouve sans effort une nourriture abondante. Mais ce soleil brûle et énerve; mais ces fleuves emportent dans leurs débordements les forêts et les cités, et cette complaisante nature s’agite parfois en convulsions terribles. Là tout est extrême, le bien comme le mal; et l’homme tour à tour épouvanté et séduit, s’abandonne aux charmes comme aux terreurs qui l’entourent, et se laisse accabler sans résistance. Dominé par cette fatalité physique, incapable de réagir victorieusement contre ce monde extérieur qui exerce sur lui une si puissante influence, il reconnaît sa faiblesse, il l’avoue, et ces forces redoutables de la nature deviennent pour lui d’impérieuses divinités, qui ont dans les prêtres et dans les rois leurs immuables représentants. Chez le peuple qui chantait, avec le poète, cette audace des héros, le sentiment religieux perdait’ beaucoup de sa puissance, mais au profit d’un autre sentiment que l’Orient n’a pas connu et que la philosophie développa, celui de la liberté morale et de la dignité humaine. Dans les théogonies indiennes, l’homme ne s’appartenant pas à lui-même, toutes les actions sont indifférentes ; et le bien, c’est la soumission, le mal, la désobéissance à certaines prescriptions arbitraires. L’homme en se déclarant libre devint responsable et moral. Voilà le pas immense que l’esprit grec a fait faire au monde. Vingt-cinq siècles n’ont pas suffi pour épuiser toutes les conséquences de ces deux principes, la morale privée et la liberté individuelle. C’est pourquoi il n’y a, sous l’apparente diversité des formes, que deux civilisations : celle de l’Orient on règnent la fatalité dans les doctrines et le despotisme dans la société, c’est-à-dire qui est immuable, malgré tant d’empires qui s’y élèvent et qui tombent ; celle de l’Europe grecque et moderne, qui est le mouvement même parce qu’elle relève de la liberté. Ce n’est pas, comme le disait je ne sais plus quel Romain
envieux, parce que Le créateur de la comédie syracusaine, Épicharme, disait,
il y a vingt-quatre siècles : Les dieux nous vendent
tous les biens au prix du travail. Ce que le poète disait Mais précisons davantage. En religion, Il y a toujours dans le monde une certaine somme de folie
dont les espèces varient selon les temps, comme les maladies changent suivant
les climats. Le délire de l’ambition est fréquent chez nous; au moyen âge,
les ensorcelés du diable étaient nombreux, et le mal du surnaturel a toujours
sévi en Orient, avec son cortège de prophètes illuminés et de pieux
charlatans, dupes d’eux-mêmes. Tout en gardant son fond d’esprit
rationaliste, Il n’en fut pas de même quand l’autorité de l’ancien culte diminua, quand Alcibiade et ses amis bafouèrent les mystères, et que les poètes ôtèrent aux dieux le gouvernement du monde. Pour les anciens, la transmission héréditaire de la faute et de l’expiation avait été un acte de foi, et cette croyance avait fortement constitué la famille et l’État, par la solidarité des parents et des membres de la communauté. Lorsque les Erinyes disparurent avec leurs serpents et leurs vengeances, lorsque la foudre de Jupiter s’éteignit et que les flèches d’Apollon furent brisées, toute sanction morale manquant à la vie, il ne resta plus que le plaisir et l’abandon de soi-même à tous les caprices de la fortune. Sous leur ciel vide ou peuplé d’entités métaphysiques, les Grecs cessèrent d’être des citoyens, même des hommes. Mais, pour l’art, le polythéisme eut une fécondité qui n’est pas encore épuisée. A la religion se rattachaient les jeux publics auxquels tout Hellène avait le droit d’assister, comme spectateur ou concurrent. C’était sous l’œil d’Apollon à Delphes, de Zeus à Olympie, de Poséidon à Corinthe qu’ils étaient célébrés, et la sécurité pour le voyage, à l’aller et au retour, était garantie par une trêve de Dieu qui suspendait les hostilités. Ainsi fera l’Église au moyen âge, mais les Grecs l’avaient fait avant elle. Notons même, puisqu’un souvenir du moyen âge est survenu au milieu de cette vieille histoire, qu’on trouve parfois eu Grèce des sentiments chevaleresques, comme le jour ou les gens d’Érétrie et de Chalcis convinrent de n’employer dans les combats aucune arme de jet, qui devenait pour eux l’arme des lâches, parce qu’elle frappait de loin[36]. En politique, Législation.
— Philosophie.
— Comme Tout a sa loi : l’insecte qui rampe invisible sur un grain de sable, comme les soleils qui roulent impétueusement dans l’infini, et la vie est mesurée à l’hysope et au cèdre aussi bien qu’à l’étoile qui, un jour, s’éteindra. L’homme aussi a sa loi par la constitution physique que la nature lui a départie; il en a une seconde par la constitution morale que le temps, les religions et la philosophie lui ont faite, en la dégageant de sa nature supérieure. De celle-ci, Socrate et Aristote ont donné la formule la plus nécessaire à l’État : l’utile cherché dans le bien indispensable à la cité ; Platon, la formule la plus haute pour l’individu, όμοίωσις τώ θεώ, et Spinoza, au bout de vingt siècles, la répète : Il faut gouverner sa vie sous l’idée de l’Être parfait ; ce qui veut dire, pour ceux qui ne peuvent s’élever à la conception de la pure essence divine, qu’il faut concevoir un idéal de perfection humaine et chercher sans relâche à s’en approcher. Le but que proposait le platonisme fut poursuivi par une mâle école née au milieu des ruines de la société grecque et dont l’esprit est résumé dans ce vers héroïque : Faites
votre devoir et laissez faire aux dieux. Dans son second âge, le stoïcisme, par sa morale pratique, a formé de grands caractères ; combiné avec l’esprit chrétien et modifié par lui, il peut en faire encore. Il n’en subsista pas moins une différence profonde entre
la conception hellénique du monde et celle des chrétiens. Ceux-ci ont vu surtout
le ciel, les autres ont regardé surtout la terre, et leurs héroïnes, lorsqu’elles
allaient mourir, n’exhalaient d’autre plainte que de quitter la douce lumière
du jour[37].
C’étaient deux esprits absolument opposés. De là, les haines violentes que le
christianisme a conçues pour le vieil Olympe, quoique les héritiers de Platon
eussent préparé la transition de leur démiurgos au fils de Jéhovah. Sans
déserter la nouvelle Jérusalem, qui voulut substituer à la religion du beau
celle du bien, à la morale aristocratique des Grecs, la morale populaire de l’Évangile,
nous retournons à Sciences. — Le
dernier Père de l’Église, Bossuet, a appelé les vérités que la science
découvre le christianisme de La science qui, elle aussi, a sa poésie, a ruiné celle des anciens poètes ; elle a tué les Nymphes, les Océanides et tous les dieux de l’air, de la terre et des eaux. Cependant ils vivent encore, mais ils s’appellent prosaïquement l’influence du milieu et, sous ce nom, ils gardent sur les hommes et les peuples un pouvoir plus grand que n’en ont jamais eu les radieux Olympiens. Dans les lettres, quel éclat! que de genres créés et
portés à la perfection : l’épopée, l’élégie, l’ode, la tragédie, la comédie,
l’histoire, l’éloquence de la tribune, celle du barreau, quand elle n’était
pas au service de sophistes tels que ce Carnéade qui faisait un jour l’éloge
de la justice et le lendemain celui de l’iniquité ! Et quel durable
empire ! L’Europe, depuis qu’elle a recommencé sa vie intellectuelle,
tire toute sa sève du fonds grec. Les littératures germaniques sont d’hier,
sauf Shakespeare et Milton, qui ne sont pas bien vieux ; sauf Gœthe,
parfois si grec, et Schiller, qui n’est pas toujours allemand. Les
littératures slaves naissent à peine ; celles du Nord ne méritent pas
une place à part ; mais celles du Ainsi, presque toute la littérature laïque sort de Pour les arts, les Grecs ont fait plus encore. Race amoureuse de la forme, de la couleur et de tout ce qui est la foie des yeux, ils ont su saisir le moment fugitif de la beauté, et ils l’ont rendu éternel en le fixant sur le marbre et l’airain. L’Égypte, l’Assyrie et l’Inde n’ont jamais connu la fleur d’élégance, née aux bords de l’Ilissus, où elle a duré si longtemps. Leurs productions, qui étonnent sans charmer par l’énorme entassement des matériaux et des aventures, ou qui éblouissent l’esprit et le fatiguent par l’infinie variété et le monstrueux accouplement des formes les plus diverses, ont été ramenées en Grèce aux justes et harmonieuses proportions de la beauté humaine qui rayonne de jeunesse et de vie dans les œuvres de Phidias et de Praxitèle, comme dans celles d’Homère, de Sophocle et de Platon. Au statuaire, au peintre, la religion et la poésie offraient la mine la plus précieuse, et les moeurs publiques, aussi bien que les institutions, leur donnaient les plus énergiques encouragements. L’époque de la liberté républicaine, dit Winckelmann, fut l’âge d’or des beaux-arts. La beauté architecturale ne dépend pas seulement des
proportions et des lignes, mais surtout de la perspective aérienne et de l’accord.
avec la nature environnante. Or celle-ci offrait, en Grèce, les sites les
plus propres à recevoir la décoration du marbre, du bronze et de la grande
sculpture. Aussi Chateaubriand a-t-il pu écrire, avec l’exagération d’un
poète : Si, après avoir vu les monuments de Rome,
ceux de Aussi, pour la beauté plastique, sommes-nous restés païens et adorateurs de ces dieux morts sous les coups de la raison, mais à qui l’art a rendu l’immortalité. Avons-nous des sculpteurs qui ne soient pas les élèves des grands statuaires d’Athènes, de Sicyone ou de Pergame ? Et de Londres à Vienne, de Saint-Pétersbourg à Madrid, quelle est l’architecture qui, jusqu’à nos jours, ne soit pas venue d’Olympie ou du Parthénon ? Quel art nouveau le monde a-t-il créé depuis deux mille ans ? Le moyen âge a eu la coupole byzantine que l’Orient a édifiée et qu’il garde à cause de son climat, et l’architecture ogivale, expression monumentale d’une société qui n’existe plus, par conséquent art éphémère. Les temps modernes ont la musique, le plus jeune des arts, quelle que soit sa complication actuelle, et la peinture qui aurait trouvé dans l’antiquité des modèles si les oeuvres de Zeuxis et d’Apelles n’avaient point péri. Enfin la grande doctrine platonicienne que le beau, le vrai, le bien, doivent s’unir et se confondre dans le sentiment de l’harmonie universelle, n’est-elle pas encore la nôtre, malgré les efforts contraires de certaines écoles qui ne vivront pas. Ce culte du beau, qui fait la seconde religion de — VIII —Il y a sans doute de nombreuses réserves à faire dans les
éloges donnés à la civilisation grecque : une religion poétique, mais sans
influence morale ; la famille imparfaitement constituée ; la propriété
mal garantie; malgré une intelligence toujours éclatante, la moralité souvent
obscure, à la différence de Rome, on ce qui fut grand, en général, ce n’est
pas l’esprit mais le caractère ; dans les plus beaux jours, l’absence de
sécurité, les perfidies, les guerres civiles avec leurs suites ordinaires :
le bannissement, la confiscation et le sang coulant à flots ; dans les
mauvais, une dépravation hideuse, que notre langue est heureusement
impuissante à décrire ; et toujours et partout la plaie saignante de l’esclavage,
avec toutes les misères qu’il apporte. Voilà bien les maux dont les Grecs ont
souffert et que l’histoire retrouve. Mais, à mesure qu’on s’éloigne, à mesure
qu’on s’élève, ces ombres se perdent dans la lumière : Démade disparaît, Démosthène
demeure; Périclès efface Alcibiade ; l’Athènes de Sophocle cache celle d’Alexis;
la ville de Léonidas, celle de Nabis, et au vice grec s’opposent d’héroïques
et chastes amitiés[42]. On ne compte
plus les maux dont Montesquieu a bien raison : Cette antiquité m’enchante, et je suis toujours prêt à dire avec Pline : C’est à Athènes que vous allez, respectez les dieux. Un jour que Raphaël voulut peindre Il me sera permis, en écrivant ces dernières lignes, de me
féliciter qu’il m’ait été accordé assez de jours pour achever la tâche
entreprise, il y a plus de quarante ans, de donner à notre littérature
historique deux ouvrages qui lui manquaient : l’histoire de la vie de Rome
durant douze siècles et celle de l’ancienne Grèce jusqu’à la perte de son
indépendance. On fera mieux plus tard. Du moins, aurai-je, dans la mesure de
mes forces, ouvert la route et attesté la reconnaissance que Hic cæstus artemque repono. Avant de fermer ce livre, je
dois remercier du concours qu’ils m’ont prêté : M. Babelon, du Cabinet de
France, pour les monnaies qui souvent constatent des faits politiques,
militaires et religieux, ou sont des objets d’art et montrent, par leur diversité,
la fécondité du génie grec ; M. B. Haussoullier, de l’École des Hautes
Études, pour les gravures qui font connaître les chefs-d’œuvre des musées de
l’Europe, et dont l’explication a mis la partie archéologique de l’ouvrage au
courant des travaux de notre jeune et laborieuse école. J’ai encore à payer
une dette de gratitude à M. Salomon Reinach, du Musée de Saint-Germain, qui a
bien voulu, à mon grand avantage, relire mes épreuves une dernière fois. FIN DE L’HISTOIRE DES GRECS |
[1] Isée, le maître de Démosthène, disait encore, au quatrième siècle : Tous ceux qui pensent à la mort veulent laisser derrière eux quelqu’un qui apporte à leurs mânes les offrandes funéraires. La loi même impose à l’archonte le soin de veiller à ce qu’aucune maison de citoyen ne devienne déserte (De l’héritage d’Apollodore, 50).
[2] Il s’y trouvait, outre le principe de l’égalité devant la loi (ίσονομία), une véritable loi d’habeas corpus. Démosthène (Contre Timocratès, 144) montre que, sauf deux exceptions, en cas de haute trahison ou de fraude à l’égard de l’État comme fermier de l’impôt, un citoyen, même après que l’autorisation de le détenir en prison avait été légalement donnée, devait être mis en liberté si trois de ses concitoyens, de la même classe, se portaient ses cautions. Dans le cas de crime d’État, il ne fallait pas moins qu’une décision de l’assemblée générale pour ordonner la mise en accusation (Hypéridès, Pour Euxénippos, 6, édit. Didot). Le domicile des citoyens était inviolable ; on ne pouvait y pénétrer sans l’assistance d’un magistrat (Démosthène, Contre Androtion, 50). Un jour des lettres de Philippe à Olympias furent interceptées ; le peuple défendit de les ouvrir, pour ne pas violer la correspondance d’un mari avec sa femme (Plutarque, Πολιτιxά παραγγέλματα, 5).
[3] Une seule révolte d’esclaves, d’ailleurs toute locale, et une seule guerre civile, celle que provoqua Thrasybule. Mais était-ce bien une guerre civile et non une guerre nationale ? Derrière les Trente il y avait Lacédémone !
[4] Il ne lui répugnait
pas de faire de ses esclaves des citoyens. Après la bataille des Arginuses, en
406, tous les esclaves embarqués sur la flotte reçurent la liberté et le droit
de cité (Hellanicus, dans les scholies aux Grenouilles
d’Aristophane, vers 664). Andocide (de
Reditu suo, 23, Didot, p. 76) félicite Athènes d’avoir souvent accordé la
πολιτεία,
δούλοις
άνθρώποις. Dans le discours
sur
[5] Démosthène, Contre Androtion, 68. Cicéron (de Offic., II, 15) dit que, pour un Athénien, ne pas montrer le chemin à un voyageur égaré était une faute punissable.
[6] Le dernier supplice
à Athènes était la simple privation de la vie, habituellement par le moyen le
moins effrayant, une coupe de ciguë. Pour donner la torture à un homme libre,
il fallait, pense M. Dareste (Plaid.
polit. de Démosthène, t. II, p. 301), une décision spéciale du peuple.
Andocide (Mystères, 45, Didot, p. 55)
rappelle un décret rendu sous l’archontat de Scamandrios qui interdisait de
mettre un citoyen à la torture. Antiphon y fut condamné, puis mis à mort, mais
après un décret qui l’avait chassé d’Athènes, où il était secrètement rentré
pour incendier la flotte (Démosthène, Sur
[7] Le bannissement, mais non l’exil, entraînait la confiscation des biens et, pour des meurtres d’une certaine nature, on pouvait échapper par la fuite à la sentence.
[8] Voyez le Ménexène de Platon, ad finem ; Aristote, Politique, II, 6.
[9]
Les Athéniens,
suivant Isocrate,
passaient pour les plus doux et les plus miséricordieux de tous les Grecs
(Antidosis, 20). Plutarque dit aussi
(Πολιτιxά
παραγγέλματα,
3) : ό
Άθηναίων
εύxίνητός έστι
xρός όργήν,
εύμετάδοτος πρός
έλεον. Voyez encore (ibid., 17, 8 et 9) les faits touchants et délicats qu’il cite à
l’honneur d’Athènes. Je ne garantis cependant pas le suivant : Un sénateur de
l’aréopage fut puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui s’était réfugié dans
son sein. On avait vu là absence de pitié et cruauté (Photius,
Biblioth., p. 1591, édition de 1653).
Encore moins serai-je affirmatif pour le fait qu’Athénée (XIII, 21, p. 566)
rapporte, d’après Hypéridès, que l’entrée de l’aréopage fut interdite à un
citoyen parce qu’il avait été vu dînant dans une auberge qui pouvait être un
πορνείον.
Mais je crois, sur la parole de Démosthène, à la condamnation de cet Athénien
que les héliastes punirent pour avoir trafiqué de la beauté de jeunes filles
d’Olynthe, qu’il avait achetées comme esclaves, après la ruine de cette
malheureuse cité par les Macédoniens. Aristote (Histoire des Animaux, VI, 24) parle d’un mulet octogénaire pour
lequel les Athéniens firent un décret qui interdisait aux marchands de blé de
le chasser, quand il venait manger dans leurs coffres. Ce fait est rendu
vraisemblable par d’autres que Plutarque raconte dans
[10] Homère, Hymn., XXVIII, 2.
[11] Pausanias, VIII, 36, 3.
[12] Lorsque ce livre
parut pour la première fois, en 1851, le travail des savants hommes qui étaient
en train de renouveler la science de l’antiquité n’était pas encore arrivé au
gros du public, et j’étonnai quelques personnes en montrant pour le peuple de
Périclès un respect inusité, comme pour la vie stérile de Lacédémone et les
agitations sans but des derniers jours de
[13] Voyez, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Saglio, le savant mémoire de M. B. Haussoullier, sur le Démos.
[14] Digeste, XVII, I, 2, 63.
[15]
Disc. sur
[16] C’est le reproche que Tacite leur adresse : quid aliud... exilio fuit... nisi quod victos pro alienigenis arcebant ? A cette idée étroite de la cité, il oppose la politique de Rome qui eodem die hostes, dein cives, habuerit (Annales, XI, 24). Un Grec ne pouvait que par exception se marier et posséder dans une autre ville. Pour la concession du droit de cité, il fallait, à Athènes, une première réunion du peuple qui accordait ce titre pour des services signalés rendus aux Athéniens ; et une seconde assemblée où plus de 6000 citoyens confirmaient au scrutin secret le vote favorable (Collection Démosthénique, Contre Néera, p. 724. éd. Didot).
[17] Politique, IV, 6, 1.
[18] Corpus Inscr. attic., II, 334.
[19] Discours
sur
[20] Dans le discours
Sur les affaires de
[21] XIX, 59.
[22] Hist. des Romains, chap. LXXXIII. Des citoyens se chargèrent aussi de la surveillance des écoles.
[23]
République, I, 9. On retrouve ces
sentiments dans
[24] A Sparte, comme
dans
[25] Démosthène,
Disc. sur
[26] Lysias, Contre Nicomachos, 22 ; Polybe, VII, 10 - XV, 21 - fragm. 68. Aristote, Économique, II, 9. Il mentionne cette politique comme ayant été pratiquée à Byzance, Chios, Clazomène, Éphèse, Héraclée de Pont, Lampsaque.
[27] Isocrate dit à Philippe qu’il trouvera en Grèce, pour son expédition d’Asie, autant de soldats qu’il en voudra, parce qu’il y a tant de bannis qu’il est plus facile de lever une armée parmi eux que parmi les citoyens (Philippe, 96, édit. Didot, p. 65).
[28] Westermann a attaqué l’authenticité de l’ΟΡΚΟΣ ΗΑΙΑΣΤΩΝ, mais sans convaincre ni M. Dareste ni M. Weil, qui l’ont maintenue : l’un dans sa traduction du discours contre Timocrate (Plaidoyers politiques de Démosthène, I, p. 304 et 184), l’autre dans son édition grecque de Démosthène, IIe série, p. 137.
[29] Le vice naturel de la démagogie est l’envie et le soupçon qui, lorsqu’elle dispose des tribunaux, se traduisent par des spoliations judiciaires. Aristophon d’Azenia fut cité en justice soixante-quinze fois pour proposition de décrets contraires aux lois, γραφή παρανόμων ; mais il est juste d’ajouter qu’il ne fut jamais condamné (Eschine, Ctésiphon, 194). Démosthène n’eut pas autant de procès ; cependant le seul Aristogiton lui intenta sept actions, et contre combien d’autres n’eut-il pas à se défendre !
[30] La vie privée n’échappait pas à cette omnipotence de l’État. Beaucoup de cités grecques défendaient à l’homme de rester célibataire. Sparte punissait non seulement celui qui ne se mariait pas, mais même celui qui se mariait tard. L’État pouvait prescrire à Athènes le travail, à Sparte l’oisiveté. Il exerçait sa tyrannie jusque dans les plus petites choses : à Locres, la loi défendait aux hommes de boire du vin pur ; à Milet, à Marseille, elle le défendait aux femmes. Il était ordinaire que le costume fût fixé invariablement par les lois de chaque cité ; la législation de Sparte réglait la coiffure des femmes, et celle d’Athènes leur interdisait d’emporter en voyage plus de trois robes. A Rhodes, la loi défendait de se raser la barbe ; à Byzance, elle punissait d’une amende celui qui possédait chez soi un rasoir ; à Sparte, au contraire, elle exigeait qu’on se rasât la moustache (Fustel de Coulanges, La cité antique, p. 265).
[31] Plutarque, De l’Exil, 5 ; Cicéron, Tusculanes, V, 57. Diogène le cynique répéta le mot : xοσμοπολίης (Diogène Laërte, VI, 65) ; Démocrite l’avait déjà prononcé et Zénon l’enseignera.
[32] On ne se marie plus, dit-il au livre XXXVII, 4, on n’élève plus d’enfants même nés hors mariage, tout au plus un ou deux, pour laisser à ceux-là sa richesse ; que la maladie ou la guerre les enlève, la maison devient déserte, et la cité est une ruche abandonnée.
[33] Voyez dans l’Andromaque d’Euripide, 445-449, les
violentes imprécations du poète contre la politique tortueuse et perfide de
Lacédémone : Ô
les plus odieux des mortels... princes du mensonge, artisans de fraudes, c’est
sans justice que vous prospérez dans
[34] Dans les seules satrapies de la haute Asie, vingt-trois mille Grecs se soulevèrent après la mort d’Alexandre. Combien y en avait-il dans les autres provinces et combien avaient péri dans cette guerre de dix ans ? A la bataille de Raphia, entre les armées d’Égypte et de Syrie (217), il se trouva parmi les combattants soixante ou soixante-dix mille mercenaires grecs.
[35] Cuvier a écrit les
lignes suivantes dans l’Éloge de Werner :
A l’abri des
petites chaînes calcaires inégales, ramifiées, abondantes en sources, qui
coupent l’Italie et
[36] Strabon, X, 1-12.
[37] On a trouvé du
pessimisme en Grèce ; sans doute, il y en eut, car la mort est la condition de
la vie, et la désespérance a un côté poétique où parfois lame se complaît.
Aussi Némésis a-t-elle été longtemps une des divinités redoutées de l’Olympe
hellénique. Mais les Grecs étaient trop amoureux de l’action dans la politique,
l’art et la science, pour aspirer comme un Hindou à l’éternel repos. L’Inde et
[38] Un fait
remarquable est le grand âge auquel parviennent, avec la plénitude de leurs
facultés, beaucoup de grands hommes de
[39]
Les Grecs, maîtres
du beau, l’ont été aussi du vrai, soit que, avec Pythagore, Euclide, Archimède,
ils aient établi les bases de
[40] Fr.-Aug. Wolf a compté que la littérature classique comprenait mille six cents ouvrages entiers ou mutilés, dont les trois quarts appartenaient aux Grecs ; pour ceux-ci quatre cent cinquante étaient antérieurs à Livius Andronicus, le plus ancien des écrivains romains.
[41] Du moins, nous ne connaissons pas de mosaïques grecques du temps de l’indépendance ; mais Pergame et Alexandrie connurent cet art qui passa à Rome et prit, sous l’empire, une grande importance. Voyez Histoire des Romains, passim.
[42] La femme n’ayant pas eu en Grèce la place qu’elle a su conquérir dame la société moderne, il se forma à côté d’elle des liaisons coupables ou généreuses. Pétrarque, presque mi ancien, disait encore, comme beaucoup de Socratiques : L’amitié est la plus belle chose du monde après la vertu.
[43] Dans le
pro Flacco, 26, 62, il dit de