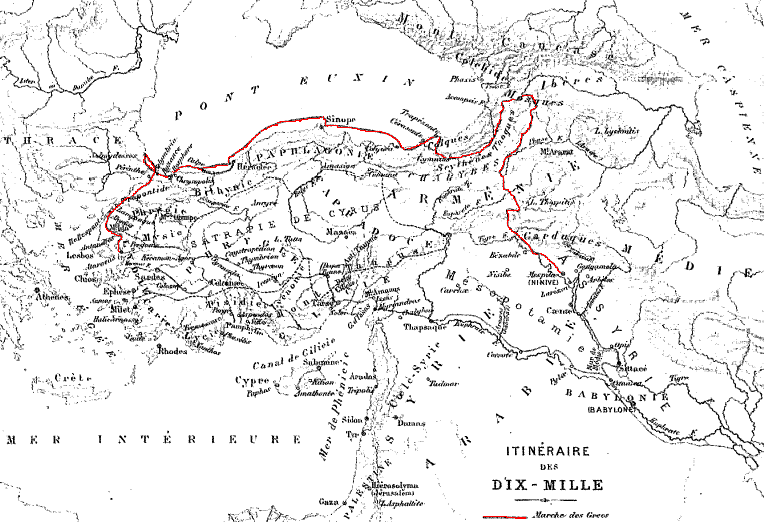HISTOIRE DES GRECS
SIXIÈME PÉRIODE — SUPRÉMATIE DE SPARTE, PUIS DE THÈBES (404-339) –
DÉCADENCE DE LA GRÈCE.
Chapitre XXVIII — Depuis la prise d’Athènes jusqu’au traité d’Antalcidas (404-387).
I. Les Dix Mille (402-403)Ce n’est pas au moment où les doctrines sont trouvées, que
leurs résultats politiques et sociaux se produisent. Il faut des siècles aux
idées pour faire leur chemin et déraciner les croyances qu’elles combattent.
La philosophie devait tuer un jour le paganisme et modifier, en s’infiltrant
dans les lois, les bases de la société ; mais, aux temps qui nous
occupent, elle n’était qu’une curiosité pour les esprits d’élite. Dans l’histoire
politique de Mais tous pouvaient voir que les démagogues et les
factions avaient fait perdre aux Athéniens le magnifique empire que Périclès
et la sagesse politique leur avaient donné ; qu’Athènes n’était pas
tombée seule et que Quand une longue guerre se termine subitement, des forces militaires considérables se trouvent sans emploi. Une foule d’hommes qui ont grandi dans les camps et qui ne connaissent pas d’autre existence que les armes se sentent incapables de commencer une vie nouvelle, de changer les habitudes du soldat contre celles du citoyen. Flue l’entreprise la plus hasardeuse se présente, ils y courront. Lorsque, après Ægos-Potamos, la paix fit rentrer les armes et les galères dans les arsenaux, les mercenaires de Sparte et d’Athènes, les bannis, toujours nombreux en Grèce, se trouvèrent inoccupés, et l’on vit qu’un des plus affligeants résultats de cette lutte avait été de produire une force flottante, une armée sans patrie, qui ne demandait que la guerre, parce qu’elle en avait besoin pour vivre. Cette armée se donna au plus offrant, au jeune Cyrus. Depuis que les Perses avaient réussi à mettre Encouragées par ces désordres, les provinces s’agitaient. L’Égypte fut en révolte continuelle dans ce siècle. Certains peuples, jamais bien soumis, secouaient tout à fait le joug. En d’autres pays, c’étaient les satrapes qui visaient à l’indépendance. Tissapherne, qui administrait le sud-ouest de l’Asie Mineure, avait du moins bien servi le monarque par son habileté à tenir la balance égale entre Sparte et Athènes. En 407, Cyrus l’avait remplacé dans une partie de ses provinces et y avait apporté une autre politique, parce qu’il avait d’autres desseins. A la mort de Darius II, arrivée peu de temps après la bataille d’Ægos-Potamos (404), Parysatis aurait voulu faire monter Cyrus au trône, par la raison qu’étant né après l’avènement de son père, il était fils de roi, tandis qu’Artaxerxés, né auparavant, n’était que fils de prince. Cyrus courut, à ce moment, risque de la vie ; sauvé par l’intercession de sa mère, il fut renvoyé dans son gouvernement et y rentra avec des projets de vengeance. Il employa prés de trois années à amasser des trésors et une armée pour renverser son frère. Dès qu’il vit la lutte finie en Grèce, il appela à lui tous les aventuriers, leur faisant dire : au piéton, il sera alloué un cheval ; au cavalier, un attelage ; au propriétaire d’un champ, des villages ; au maître de villages, des cités, et la solde sera mesurée au boisseau. Il donna dix mille dariques à un banni de Sparte, Cléarque, pour lui acheter des soldats en Thrace ; le Thessalien Aristippe, le Béotien Proxène, Sophénète de Stymphale, Socrate d’Achaïe, d’autres encore, reçurent semblable commission. Sparte même lui envoya sept cents hoplites, et mit à sa disposition une flotte de vingt-cinq galères, qui croisait dans la mer Égée, en feignant de croire que Cyrus ne se servirait des soldats et des navires que contre les tribus pillardes du littoral cilicien : duplicité peu héroïque imaginée par de lourdes intelligences qui croyaient pouvoir servir l’usurpateur sans offenser celui que l’usurpation menaçait. Cyrus réunit ainsi treize mille Grecs, dont prés de la moitié étaient Arcadiens et Achéens ; il avait de son côté cent mille barbares. Il ne dévoila pas d’abord ses desseins, même à ses
généraux ; il prétexta une guerre contre Tissapherne qui lui retenait
une partie de son gouvernement, puis une expédition contre les Pisidiens qui
infestaient ses frontières. Il partit de Sardes au printemps de 401 et se
dirigea vers le Sud-est à travers L’auteur de l’Anabase se complaît à marquer ainsi chaque étape par une surprise. Il se peut que la foule s’y soit laissée prendre ; mais il se trouvait à Sardes trop de Grecs avisés pour croire que le prince avait réuni une si formidable armée dans le seul dessein de mettre quelques montagnards à la raison. Notre auteur devait être de ces Grecs-là : on verra plus loin qu’il avait des motifs pour parler comme il le fait. Nulle part, ni dans les passes du Taurus, ni aux Portes Syriennes, Cyrus n’avait rencontré de résistance. L’Euphrate pouvait être une barrière, surtout si une armée campait sur son bord oriental : il ne s’y trouva pas un soldat, et les eaux étaient si basses, que les troupes purent passer le grand fleuve à gué. De Thapsaque, elles tournèrent à droite vers le sud, en longeant la rive gauche, sans être gênées par d’autres obstacles que ceux du désert. En cette saison cependant (septembre), elles durent avoir beaucoup à souffrir ; mais, au bout du chemin, général et soldats voyaient une grande proie à saisir, et cette espérance faisait braver un soleil tropical. Quand on fut à 15 ou 16 lieues de Babylone, dans la plaine de Cunaxa, on aperçut pour la première fois l’ennemi[1]. On allait établir le camp, lorsque l’on vit accourir, bride abattue, sur un cheval couvert de sueur, un des confidents de Cyrus. Il crie en langue barbare et en grec, à tous ceux qu’il rencontre, que le roi est tout proche avec une armée innombrable[2]. Aussitôt Cyrus saute à bas de son char, revêt sa cuirasse, monte à cheval, et ordonne que chacun s’arme et prenne son rang. Les Grecs se forment à la hâte : Cléarque à l’aile droite, près de l’Euphrate, et appuyé de mille cavaliers paphlagoniens ; au centre, Proxène et les autres généraux ; Mnémon à l’aile gauche, avec Ariée et l’armée barbare. Cyrus se place au milieu de sa ligne, suivi de six cents cavaliers montés sur des chevaux bardés de fer, eux-mêmes revêtus de grandes cuirasses, de cuissards et de casques. Le prince voulut combattre tête nue. On était au milieu du jour, et l’ennemi ne paraissait pas encore; mais quand le soleil commença à décliner, on aperçut une poussière semblable à un nuage blanc, qui prit une couleur plus sombre et couvrit la plaine. Lorsqu’ils furent plus près, on vit briller l’airain, on distingua les rangs hérissés de piques. En avant, à une assez grande distance, étaient des chars armés de faux, dont les unes, attachées à l’essieu, s’étendaient obliquement à droite et à gauche ; les autres, placées sous le siège du conducteur, s’inclinaient vers la terre de manière à couper tout ce qu’elles rencontraient. Le projet était de se précipiter sur les bataillons grecs et de les rompre avec ces chars. Un des quatre généraux de l’armée royale était Tissapherne, dont les avis tenant Artaxerxés au courant des projets de son compétiteur lui avaient donné le temps de faire d’immenses préparatifs de défense. Il n’y avait plus que trois ou quatre stades[3] entre le front des deux armées, lorsque les Grecs entonnèrent le pæan et invoquèrent à grand cris Arès Ényalios ; puis ils s’ébranlèrent et prirent le pas de course, en frappant les boucliers avec les piques pour effrayer les chevaux ennemis ; ils se précipitaient avec l’impétuosité des vagues en courroux. Avant même d’être à la portée du trait, la cavalerie barbare tourna bride ; les Grecs la poursuivirent, mais en se criant les uns aux autres de ne pas rompre les rangs. Quant aux chars, abandonnés bien vite de leurs conducteurs, les uns étaient emportés à travers les troupes ennemies, les autres vers la ligne des Grecs, qui s’ouvrit et les laissa passer. Il n’y eut qu’un soldat qui, frappé d’étonnement comme on le serait dans l’hippodrome, ne se rangea pas et fut renversé par un de ces chars, sans toutefois avoir d’autre mal. Un seul Grec aussi fut blessé d’une flèche. Cyrus fut rempli de joie à la vue de ce succès des Grecs, et déjà ceux qui l’entouraient l’adoraient comme leur roi. Cependant il n’y avait qu’une aile qui fût dispersée, et l’armée royale était si nombreuse que son centre dépassait encore l’aile gauche de Cyrus. Aussi le prince garda sa position et tint serrés autour de lui ses sis cents chevaux, en observant tous les mouvements du roi. Artaxerxés, qui s’était placé au centre avec six mille cavaliers, fit un mouvement pour entourer les Grecs. Cyrus, craignant qu’il ne les prit à dos et ne les taillât en pièces, courut à lui avec ses cavaliers, replia tout ce qui était devant le roi, et tua, dit-on, de sa main, leur général. Mais ses cavaliers se dispersèrent à la poursuite des fuyards, et il n’y avait plus que peu de monde auprès de lui, lorsqu’il reconnut le roi : Je vois l’homme, s’écria-t-il. Il se précipita sur lui, le frappa à la poitrine, et le blessa à travers sa cuirasse. Au même instant il fut atteint lui-même au-dessous de l’œil, d’un javelot lancé avec force par un soldat inconnu. Il tomba mort, et sur son corps périrent huit de ses principaux amis. Ainsi finit Cyrus. Tous ceux qui l’ont intimement connu s’accordent à dire que c’est le Perse, depuis l’ancien Cyrus, qui s’est montré le plus digne de l’empire, et qu’il possédait toutes les vertus d’un grand roi... (septembre 401). Sa mort changea l’issue de la bataille. Ses troupes, sans
chef et sans raison de combattre davantage, se dispersèrent, et le roi pénétra
dans leur camp, où le harem du vaincu tomba en ses mains. Il s’y trouvait
deux Grecques que leurs parents avaient offertes au prince lorsqu’il résidait
à Sardes : usage habituel à ces populations asiatiques, qui trafiquaient de
tout, même de la beauté de leurs filles, dotées par eux, dans cette
intention, d’une éducation brillante. Une d’elles, originaire de Milet, s’échappa ;
la belle Milto de Phocée, moins ou plus heureuse, devint une des femmes du
grand roi et, comme Pendant que Cyrus mourait, les Grecs victorieux continuaient leur marche en avant. Lorsqu’ils apprirent que l’ennemi pillait leurs bagages, ils revinrent sur leurs pas. D’abord les Perses allèrent hardiment à leur rencontre ; mais en les voyant se mettre en ligne, entonner le pæan et charger avec fureur, ils s’enfuirent plus vite encore que la première fois. Au coucher du soleil, les Grecs revinrent à leurs tentes, surpris de n’avoir pas de nouvelles de Cyrus et n’imaginant pas qu’il eût péri. Ils ne le surent que le lendemain matin, et apprirent en même temps qu’Ariée, avec les auxiliaires barbares, avaient fui à une journée de marche en arrière ; de sorte que cette petite troupe de Grecs, qui avait à peine perdu un ou deux soldats, demeurait maîtresse du champ de bataille entre deux armées, l’une alliée, l’autre ennemie, fuyant en sens contraires ! Alors commença cette retraite fameuse, à travers des pays pour la plupart inconnus des Perses eux-mêmes et malgré les déserts, les montagnes, les fleuves, les neiges, la disette et les peuplades sauvages. Elle fut appelée la retraite des Dix Mille, parce que tel était à peu près le nombre des soldats. D’abord les Grecs se rapprochèrent d’Ariée, et les deux armées se jurèrent une alliance inviolable. Le roi les fit sommer de déposer leurs armes ; comme ils répondirent fièrement que ce n’était pas aux vainqueurs à désarmer, il changea de ton et chercha à les gagner, en leur promettant les subsistances dont ils manquaient. Ils acceptèrent, mais n’en continuèrent pas moins leur route. Alors Tissapherne arriva, se dirigeant, disait-il, vers son gouvernement. Les Grecs avaient offert à Ariée de prendre la place et le rôle de Cyrus ; il préféra négocier sa soumission au grand roi et réunit ses troupes à celles du satrape d’Ionie. En voyant ces Asiatiques se réconcilier et s’entendre, les Grecs entrèrent en défiance. Pour les rassurer, Cléarque se rendit auprès de Tissapherne avec quatre autres chefs. Malgré la foi promise, le satrape les fit saisir dans sa tente même et les livra au roi, qui ordonna leur mort. L’armée privée de ses généraux, tomba d’abord dans l’abattement.
On était à 10.000 stades de À ce moment, notre auteur entre en scène. Il y avait, dit-il, à l’armée un Athénien nommé Xénophon, qui ne la suivait ni comme général, ni comme officier, ni comme soldat. Entre lui et Proxène il existait depuis longtemps des liens d’hospitalité; ce chef l’avait engagé à quitter son pays, en promettant de lui concilier les bonnes grâces de Cyrus. L’or de ce prince avait assuré la victoire de Sparte et la ruine d’Athènes; Xénophon n’avait pas voulu s’en souvenir. Il avait pourtant consulté sur ce voyage Socrate, qui, lui aussi, dans ses hautes spéculations, oubliait volontiers Athènes. Le philosophe l’avait renvoyé au dieu de Delphes, et un oracle ambigu avait permis à Xénophon d’exécuter ce qu’il voulait faire. En réalité, le disciple du citoyen du monde s’était mis comme les autres à la solde de Cyrus, et il savait bien que, si ce prince renversait son frère, le nouveau roi de Perse, par les qualités mêmes qu’il lui donne, serait pour Athènes un ennemi bien autrement redoutable que le faible Artaxerxés. Ce rôle qu’il s’attribue, le naïf étonnement qu’il affecte, dans son livre, ait sujet du but enfin dévoilé de l’expédition, n’étaient pour lui qu’une réponse au décret athénien qui lui retira le droit de cité, comme serviteur de Cyrus. D’après son récit, il aurait sauvé l’armée du découragement. Éclairé, dit-il, par un songe, il rassembla le conseil des officiers, fit chasser un traître qui parlait de se rendre, et conseilla d’élire de nouveaux généraux, ce qu’on fit sur-le-champ : il fut nommé à la place de Proxène. Par ses soins, un corps de cinquante cavaliers et un autre de deux cents frondeurs ou archers furent organisés, de sorte qu’on put tenir à distance les troupes de Tissapherne.
Nous ne suivrons pas les Dix Mille dans leur glorieuse retraite : le fait seul qu’ils purent traverser impunément le grand empire importe à l’histoire générale. Arrivé chez les Carduques, Tissapherne cessa de marcher sur leurs traces et prit la route de l’Ionie. Mais ils n’échappèrent à ses embûches que pour tomber dans celles des montagnards du pays, qui leur firent beaucoup de mal avec leurs longues flèches, auxquelles nul bouclier ne résistait. Le satrape d’Arménie, Tiribaze, les accueillit bien ; il conclut avec eux un traité, promettant de ne pas les attaquer, s’ils se contentaient de prendre des vivres, sans brûler les villages. Mais une tempête les surprit dans ces montagnes, et la température s’abaissa au point que des soldats moururent de froid ; d’autres perdirent la vue par l’éclat des neiges ; la plus grande partie des bêtes de somme périt. Il fallut ensuite franchir le Phase, l’Harpédos, repousser la belliqueuse peuplade des Chalybes. Enfin, arrivés à la montagne de Théchès, ils découvrirent à l’horizon la vaste étendue du Pont-Euxin. Les premiers qui atteignirent le sommet et aperçurent la mer jetèrent de grands cris. Xénophon, en les entendant, crut que les ennemis attaquaient la tête de l’armée. Les cris augmentaient à mesure qu’on approchait ; de nouveaux soldats se joignaient en courant aux premiers. Xénophon, de moment en moment plus inquiet, monte à cheval, prend avec lui la cavalerie, et longe le flanc de la colonne pour donner du secours ; mais bientôt il entend les soldats crier : La mer ! la mer ! en se félicitent mutuellement. Alors, arrière-garde, équipages, cavaliers, tout court au sommet de la montagne ; arrivés, tous s’embrassent, les larmes aux yeux, et se jettent dans les bras de leurs généraux et de leurs officiers. Aussitôt, sans qu’on ait jamais su par qui l’ordre fait donné, les soldats apportent des pierres et élèvent sur la cime une pyramide qu’ils recouvrent d’armes enlevées à l’ennemi. C’était un trophée qu’ils dressaient, et le plus glorieux que main d’homme eut élevé, car ils avaient vaincu l’empire perse et la nature même. Après quelques nouveaux combats contre les belliqueuses
tribus de la côte, ils arrivèrent à la ville grecque de Trapézonte, colonie
de Sinope, où ils célébrèrent leur délivrance par des jeux solennels et des
sacrifices (mars 400).
Ils étaient encore 8600 hoplites et 1400 archers ou frondeurs[4]. Ils n’avaient
plus qu’un désir, trouver des vaisseaux qui les transportassent dans leur
patrie. Je suis las, dit l’un d’eux dans l’assemblée,
de plier bagage, de marcher, de courir, de porter
mes armes, de garder mon rang et de me battre ; puisque voilà la mer, je
veux m’embarquer et arriver en Grèce, comme Ulysse, étendu sur le tillac et
dormant. L’amiral spartiate était à Bvzance. Chirisophos lui fut envoyé
pour demander des vaisseaux ; mais Sparte ne voulait plus avoir rien de
commun avec des gens qui avaient échoué dans leur entreprise. Les navires
furent refusés, et les Dix Mille, forcés de longer la côte par terre, tantôt
combattant, tantôt en paix, atteignirent péniblement deux colonies de Sinope,
Cérasonte et Cotyora. Cette dernière ville leur fournit les moyens de gagner
par mer Sinope, Héraclée et Calpé. Dans la traversée de Là se termina la retraite des Dix Mille. En quinze mois et
en deux cent quinze étapes ils avaient parcouru, tant à l’aller qu’au retour,
34.650 stades ou II. – Dureté de l’hégémonie spartiateLa guerre du Péloponnèse avait eu de désastreuses conséquences pour les mœurs publiques. Sa longue durée, ses péripéties sanglantes, avaient produit partout la méfiance, exalté les passions, déifié la force, et si profondément altéré le caractère grec, qu’il ne s’en releva jamais[6]. On était féroce sur les champs de bataille, féroce dans les luttes des partis. Voici, dit Aristote, le serment que fait prêter aujourd’hui l’oligarchie dans plusieurs cités : Je serai l’ennemi du peuple et je lui ferai tout le mal que je pourrai[7]. Il est vrai qu’à ce serment homicide nous pouvons opposer celui des héliastes d’Athènes après la tyrannie : J’oublierai tous les torts passés, et je ne permettrai que personne s’en souvienne et les cite. Mais Athènes, même dans sa décadence, était toujours Athènes, libérale et généreuse, comme ces statues mutilées, belles encore dans leur dégradation. Le système de guerre avait changé. J’ai déjà constaté une révolution de l’art militaire, l’armée démocratique du cinquième et du sixième siècle succédant à l’armée aristocratique du temps des héros ; voici maintenant l’âge des mercenaires, toutes les villes grecques mêlent des soldats salariés à leurs soldats citoyens. Mais, pour les payer, il faut de l’or. Pour se faire des complices de sa haine, Sparte avait,
pendant trente années, accusé le despotisme de sa rivale et promis de briser
les fers dont elle enchaînait Une flotte, qui surveillait toute la mer Égée, depuis Chypre jusqu’à Byzance ; des finances, dont Sparte ne troublait pas l’économie, compte Athènes, par de glorieuses inutilités ; une armée, toujours facile à trouver dans ces pauvres et arides populations du Péloponnèse, qui avaient vendu à Cyrus la plupart de ses mercenaires ; enfin une surveillance active et énergique exercée, à Sparte même par les éphores, dans toutes les cités par les harmostes, tels étaient, avec l’immense réputation de Lacédémone, les soutiens de son empire. Athènes avait jadis plus habilement constitué le sien,
sans violences, ni spoliations ou cruautés; aussi put-elle le garder
longtemps et ne point voir, même dans ses malheurs, de trop nombreuses
défections. Sparte n’en savait pas faut sur l’organisation des Etats. Elle ne
connaissait que la force, et elle en abusait. Soli empire n’eut pas d’autre
lien : c’était aussi celui qu’avait employé sa rivale ; mais celle-ci y
avait joint habituellement la justice. Elle s’était faite le centre
politique, militaire et judiciaire de son empire, mieux encore, la métropole
des arts et des lettres de l’Hellade entière. Rien de grand ou de glorieux,
rien de fécond ou d’utile ne sortira de la domination lacédémonienne : à
peine élevée, elle menace ruine. Mille causes de dissolution préparaient
cette rapide décadence : les unes étaient dans Sparte même et dans Les conséquences des institutions de Lycurgue continuaient
à se développer. La cité spartiate diminuait de jour en jour, comme usée par
le jeu de ses institutions de fer. Le cadre étroit dont elle s’était
enveloppée et qui, jamais ne s’ouvrant, se resserrait toujours, finissait par
ne plus renfermer qu’un petit nombre de Spartiates. Une foule avait péri dans
les guerres; d’autres étaient rejetés dans la classe inférieure par leur
pauvreté, qui ne leur permettait plus de venir s’asseoir aux tables
publiques. Aristote le dit : Qui n’avait pas les
moyens de fournir aux dépenses de ces tables était privé de ses droits
politiques. Les Spartiates sentaient bien qu’ils étaient menacés de
périr par défaut de citoyens : on se souvient du cri de douleur qui s’éleva
lorsque les quatre cent vingt soldats de Sphactérie furent enfermés dans
l’île. Le territoire de Sparte, dit encore
Aristote, pourrait entretenir quinze cents cavaliers
et trente mille hoplites, il nourrit à peine aujourd’hui mille guerriers.
Dans des assemblées de quatre mille personnes, à peine voyait-on quarante
Spartiates[14].
En outre, à mesure que le nombre des Spartiates diminuait, l’inégalité
augmentait[15].
Depuis longtemps l’or et l’argent avaient cessé d’être proscrits et le
désintéressement des Lacédémoniens d’être vanté. Ou connaissait de nombreux
exemples de leur vénalité : Eurybiade avait été acheté par Thémistocle ;
Pleistoanax et Cléandridas, par Périclès ; Léotychidés, par les
Aleuades ; l’amiral et les capitaines de la flotte, par Tissapherne. Les
rois, les sénateurs, les éphores, avaient été maintes fois gagnés à prix d’argent,
et Gylippos, le sauveur de Syracuse, chargé de porter à Sparte le butin d’Athènes,
en avait soustrait 30 talents. Aussi un interlocuteur de l’Alcibiade
disait-il : Il y a plus d’or et d’argent dans
Lacédémone que dans le reste de Il résultait de là une haine violente entre les privilégiés et la classe inférieure, qui se recrutait des Spartiates déchus de leur rang, d’Hilotes affranchis, de Laconiens auxquels on avait accordé certains droits, d’enfants nés de Spartiates de la première classe et de femmes étrangères. Ces catégories étaient soigneusement séparées par des dénominations et, sans doute aussi, par des conditions différentes. Au-dessous des Égaux, qui formaient une étroite oligarchie se trouvaient les Inférieurs, ou Spartiates exclus des tables publiques, et les Néodamodes ou Hilotes affranchis pour services rendus à l’État ; enfin les Périèques. Ces hommes, qui ne participaient pas au gouvernement, n’en avaient pas moins le vif sentiment de leur valeur et de leurs services. Des hommes considérables, nés de pères spartiates et de femmes hilotes, étaient sortis de cette classe, tels que Lysandre, Gylippos et Callicratidas. Les Thébains disaient, à Athènes, dans un discours haineux contre Lacédémone, que les Spartiates prenaient leurs harmostes parmi les hilotes[18] : entendez parmi des hommes ayant du sang d’hilote dans les veines. D’ailleurs, beaucoup de ceux-ci avaient amassé un pécule qui leur donnait l’ambition de sortir de l’état où la coutume les retenait. Lorsque Cléomène III promettra la liberté aux hilotes qui pourront verser 5 mines (470 fr.) au trésor, six mille se présenteront[19]. Lacédémone conservait cependant ses deux maisons royales, dont la principale fonction aurait dû être de maintenir la discipline dans l’État. Mais l’autorité croissante des éphores et la fortune nouvelle de Sparte avaient diminue le pouvoir des rois. Ceux-ci, réduits depuis longtemps au rôle de généraux héréditaires, ne partaient plus pour une expédition sans être accompagnés de dix surveillants, déguisés sous le nom de conseillers, qui dirigeaient véritablement les opérations militaires[20]. Dans les dernières années de la guerre du Péloponnèse, les grands coups se frappaient sur mer et c’étaient des parvenus qui commandaient les flottes, vendaient les captifs, rançonnaient les cités et recevaient les subventions du grand roi. Aussi Aristote dans sa Politique, appelle-t-il la charge d’amiral une autre royauté[21]. Lysandre ne s’abandonnait donc pas à une folle ambition,
lorsque, devenu le premier citoyen de Sparte, il se proposa de remanier à son
profit l’état politique de la cité. Il ne put voir
sans chagrin, dit Plutarque, qu’une ville
dont il avait si fort augmenté la gloire fût gouvernée par des rois qui ne
valaient pas mieux que lui, et il pensa à enlever leur dignité aux deux maisons
régnantes, pour la rendre commune à tous les Héraclides[22]. D’autres disent qu’il voulait étendre ce droit non
seulement aux Héraclides, mais encore à tous les Spartiates, afin qu’il pût
passer à quiconque s’en rendrait digne par sa vertu. Comme ce héros était
monté par son propre mérite au premier rang dans l’estime publique de À la tête de cette opposition était le roi Pausanias, qu’on a déjà vu renverser à Athènes, en 403, l’ouvrage de Lysandre. Quatre ans après, Dercyllidas fit ou laissa faire la même chose dans les colonies : elles se débarrassèrent des oligarchies que le vainqueur d’Ægos-Potamos leur avait imposées et elles revinrent à leurs anciennes lois. Pourtant, quand Agis mourut en cette même année 399, Lysandre eut assez de crédit pour faire proclamer roi Agésilas, un des frères d’Agis, au détriment du fils de ce prince, Léotychidas, qu’il accusa de n’être que le fils d’Alcibiade. Agésilas était petit et infirme d’un pied, ce qui permettait à ses adversaires de dire que, chez un peuple de vigoureux soldats, il ne pouvait avoir les qualités royales ; on fit même courir un oracle de Delphes qui menaçait Lacédémone de grands malheurs le jour où elle aurait un roi boiteux. Lysandre n’était pas homme à se laisser arrêter par une intervention sacerdotale. Il accepta l’oracle comme véridique, puis démontra que le dieu, pour conserver la pureté du sang des Héraclides, avait condamné le prétendant bâtard et non celui contre lequel on ne pouvait relever qu’un accident de nature. Ces lourds esprits furent charmés d’une distinction aussi subtile, et Agésilas fut élu roi. Lysandre comptait régner sous son nom ; mais il se trouva que le protégé était un homme supérieur qui, à la première occasion, rejeta loin cette tutelle, et Lysandre fut réduit à retourner à ses intrigues. Pendant ces sourdes menées, une conspiration du caractère le plus grave avait été formée par un certain Cinadon, qui n’appartenait pas à la classe des Égaux. Celui qui le dénonça raconta aux éphores qu’un jour Cinadon l’avait conduit au bout de la place et lui avait dit d’examiner combien il s’y trouvait de Spartiates. Après en avoir compté jusqu’à quarante, y compris le roi, les éphores et des sénateurs, je lui demandai à quoi servait ce calcul. Ces gens-là, me répondit-il, tiens-les pour tes ennemis ; les autres, au nombre de plus de quatre mille, sont à nous. Cinadon, ajoutait-il, avait fait remarquer ici un, là deux de ces ennemis, qu’on rencontrait dans les rues ; il regardait les autres comme des amis. Quant aux domaines ruraux, si dans chacun d’eux nous avons un ennemi, qui est le maître, nous y comptons aussi beaucoup de partisans. Les éphores lui demandèrent à combien montait le nombre des complices. Il n’est pas considérable, m’a dit Cinadon, mais les chefs sont sûrs d’eux, ainsi que des Hilotes, des Néodamodes, des Inférieurs et des Périèques. Sitôt qu’on parle d’un Spartiate aux hommes de ces différentes classes, ils ne peuvent cacher le plaisir qu’ils auraient à le manger tout vif. On lui demanda encore où ils comptaient prendre des armes. Cinadon lui avait assuré que tous les conjurés en avaient ; il l’avait mené dans le quartier des forgerons, et lui avait montré quantité de poignards, d’épées, de broches, de cognées, de haches et de faux dont la multitude s’emparerait[24]. Cinadon fut arrêté avec quelques-uns de ses complices. Quand on l’interrogea sur ce qui l’avait poussé à de tels desseins: Je ne voulais point de maître à Lacédémone, dit-il. On lui fit subir un cruel supplice (399). Cette conjuration venait de révéler un abîme de haines creusé sous la société spartiate, et en même temps un effrayant accord de toutes les classes inférieures, libres et esclaves. Une guerre sociale pouvait sortir de là. Mais Sparte savait encore déjouer les complots avec cette vigilance qu’une méfiance continuelle donne à toutes les oligarchies. Malgré, ces hostilités entre les classes, malgré bien d’autres tiraillements, lutte des rois contre le sénat et contre les éphores, qui les avaient réduits à la condition de sujets[25], rivalité des rois entre eux, etc., le gouvernement de Sparte n’en était pas moins puissant pour l’action extérieure, par la concentration du pouvoir dans un petit nombre de mains. Au dedans les éphores, au dehors les harmostes, ces prétendus conciliateurs, exerçaient une dictature permanente ; elle avait des garnisons à Mégare, à Égine, à Tanagra, à Pharsale, à Héraclée de Trachinie, en avant des Thermopyles, et Denys de Syracuse était son allié. Mais ce pouvoir si étendu n’était guère qu’une force d’opinion, puisque Sparte par elle-même avait peu de ressources, ayant peu de citoyens; et déjà cette force s’éloignait d’elle. Ses prétentions blessaient ceux qui aimaient encore la liberté, et qui n’avaient point, pour se consoler de la perdre, ce qu’Athènes avait donné a ses sujets, les dédommagements d’un commerce immense, l’éclat des fêtes, des arts et de la poésie. Sparte, aussi intéressée et plus oppressive, prenait tout. Chaque année, elle levait un tribut de plus de 4000 talents qui venaient s’enfouir à Lacédémone, d’où ils ne sortaient plus[26] ; et ceux qui lui avaient donné des soldats, comme les Achéens et l’Arcadie, des vaisseaux, comme Corinthe, des auxiliaires, comme Thèbes, ne recevaient rien. On sentit bientôt de quel poids pesait ce lourd génie
dorien ; et beaucoup regrettèrent la suprématie athénienne, aimable
jusque dans ses insolences. Que les Grecs des côtes de Thrace ou d’Asie, ces
peuples qui jamais n’avaient su dire .lion, tremblassent devant un bâton ou
un manteau spartiate, il n’y avait pas à s’en étonner, ils avaient l’habitude
d’obéir. Pourtant c’était beaucoup, même pour eux, de deux servitudes, celle
des oligarques amis de Lysandre, doublée de celle des harmostes de
Lacédémone. Mais, dans la mère patrie, Sparte ne devait pas compter sur tant
de docilité. Elle n’avait pas craint, au sujet des bannis d’Athènes, de
parler en souveraine et de faire seule des décrets pour Puissance continentale, Thèbes, prétendait depuis
longtemps jouer dans Avec les Éléens, Sparte fit moins de façon. Durant la
guerre du Péloponnèse, ils lui avaient infligé de sensibles outrages ;
elle s’en souvint après la chute d’Athènes. En 402, elle leur réclama des
frais de guerre pour les campagnes qu’ils avaient refusé de faire contre le
peuple qu’on appelait l’ennemi commun, et elle les somma de rendre l’indépendance
à leurs sujets. Sur leur refus, Agis s’avança avec une armée. Arrêté par un
tremblement de terre, il revint l’an d’après suivi des contingents de tous
les alliés, même d’Athènes ; Corinthe seule et Thèbes avaient refusé d’aider
à cette violence. Nombre de volontaires de l’Achaïe et de l’Arcadie étaient
accourus à la curée. Xénophon assure que le pillage de cette riche province,
depuis des siècles épargnée par la guerre, répandit l’abondance dans le reste
du Péloponnèse. L’Élide dut reconnaître l’indépendance des villes de Aux exigences impérieuses du gouvernement lacédémonien s’ajoutaient les violences individuelles des citoyens, qui souvent sont plus odieuses, parce qu’une victime même obscure excite plus de pitié qu’un peuple courbé sous la défaite, et qu’il est moins dangereux de toucher, par la force, à la liberté publique, le bien de tous, que, par le mépris, à l’honneur ou à la vie d’un seul. Un homme de Leuctres, bon et hospitalier, Skédasos, reçut un jour chez lui deux jeunes Lacédémoniens. Il avait deux filles dont la beauté frappa ses hôtes. Au retour d’un voyage à Delphes, où ils étaient allés consulter le dieu, ils les trouvèrent seules et leur firent violence, puis les égorgèrent et jetèrent les cadavres dans le puits de la maison. Skédasos, revenu le lendemain, s’étonne de ne pas voir ses filles accourir à sa rencontre ; son chien jette des hurlements plaintifs et courts sans cesse du puits à son maître. Inquiet, il y regarde, voit le crime et apprend de ses voisins quels sont les coupables. Il part aussitôt pour Lacédémone. En Argolide, dans une auberge de la route, il rencontre un homme aussi malheureux que lui : c’était un père dont le fils avait été tué parce qu’il résistait aux brutalités outrageantes d’un Spartiate. Le père avait cru à la justice de Lacédémone et n’avait rien obtenu. Pourtant Skédasos continue son chemin et, arrivé, raconte son malheur aux éphores, aux rois, à tous les citoyens qu’il rencontre : nul ne fait attention à lui. Alors, pour appeler sur Sparte la colère divine, il invoque les dieux du ciel et de la terre, surtout les Furies vengeresses, et se tue. On éleva à ses filles un tombeau à Leuctres. Un jour la fortune de Sparte s’y brisera[28]. Pour quelques faits que nous connaissons, combien qui nous échappent ? On peut le comprendre à voir la haine que Sparte excitait jusque dans le Péloponnèse. Les Arcadiens et les Achéens ne la servaient que par crainte ; elle était, disaient-ils, placée sur leurs flancs, comme une citadelle, tenant toute la péninsule sous sa garde. À Lacédémone, on ne se faisait pas illusion sur leurs sentiments. Au retour d’une expédition où un corps spartiate fuit détruit, dans la guerre de Corinthe dont il sera bientôt question, Agésilas n’entrait qu’à la nuit dans les villes et en sortait au point du jouir, pour ne pas laisser voir à ses soldats la secrète joie causée aux habitants par ce désastre. Enfin, les Perses avaient cessé d’être les alliés de
Lacédémone depuis que, maîtresse de III. — Expédition d’Agésilas ; guerre de Corinthe ; traité d’Antalcidas (387)En l’année 366 Lysandre fit décerner à Agésilas le commandement de l’armée d’Asie. Comme pour réveiller les souvenirs de la guerre de Troie, le roi vint s’embarquer au port d’Agamemnon, à Aulis, avec deux mille Néodamodes et sis mille alliés. Cette fois encore Corinthe et Thèbes refusèrent leur contingent., Thèbes sans explication, Corinthe en s’autorisant d’un présage funeste : l’inondation de son temple de Zeus ; Athènes s’était excusée sur sa faiblesse. Une querelle s’éleva même entre Agésilas et les Béotiens, qui arrachèrent de l’autel et dispersèrent les chairs d’une victime immolée par lui, attendu qu’il s’était servi pour le sacrifice, contrairement à l’usage, d’un devin étranger au pays où il sacrifiait. Il partit sans tirer vengeance de cette insulte et se rendit à Éphèse : Lysandre l’accompagnait avec un conseil de trente Spartiates[29]. Les villes grecques d’Asie étaient alors bouleversées ; aucun parti n’y dominait ni le démocratique, autrefois protégé par Athènes, ni l’aristocratique, établi par Lysandre. Celui-ci, venu pour rendre à ses partisans l’influence, espérait conduire à son gré le roi, dont il ne connaissait pas les grandes qualités. Ne se donnant même pas la peine de dissimuler, il se forma une cour nombreuse de tous ceux qui venaient solliciter sa protection, et vécut dans un faste royal : On eût dit le prince simple particulier et Lysandre roi. Agésilas en prit ombrage, et se plut à lui montrer son mauvais vouloir. Pour dérober le spectacle de son impuissance à ceux qui l’avaient vu maître de tout, Lysandre finit par demander une mission qui l’éloignât. A la faveur de la trêve, Tissapherne avait assemble; une
armée nombreuse, qui couvrait Ce meurtre accompli, le nouveau satrape feignit de croire qu’il n’y avait plus de sujet de guerre entre Sparte et le grand roi ; il offrit même de reconnaître l’indépendance des Grecs asiatiques, à condition qu’ils payeraient l’ancien tribut., enfin il donna 30 talents à Agésilas pour qu’il sortit de son gouvernement, eu attendant la réponse de Sparte à ses ouvertures. Agésilas prit l’argent et se rejeta sur l’autre satrapie, celle de Pharnabaze. Tithrauste s’y attendait bien ; pourvu que la guerre s’éloignât de ses provinces, il s’inquiétait peu qu’elle allât fondre sur titi autre point de l’empire. Ires satrapes, jaloux les tins des autres, au grand plaisir de la cour de Suse, qui eût redouté leur bonne intelligence, réduisaient toute l’administration à lever le tribut, et toute la politique à tenir leurs provinces en paix : le grand roi ne leur en demandait pas davantage. Tithrauste s’occupa pourtant de débarrasser I’Asie d’Agésilas. Le plus sûr moyen était de rallumer une guerre en Grèce; il y envoya un agent dévoué, Timocrate, qu’il arma de 50 talents. Cependant Agésilas continuait d’avancer en Asie. Il gagna
à son alliance Atys, un prince paphlagonien, et pénétra jusque dans le
voisinage de Dascylion, résidence de Pharnabaze, qui sollicita une entrevue. Agésilas et les Trente attendaient le satrape, couchés sur
le gazon. Pharnabaze arriva superbement vêtu : ses esclaves étendirent à
terre des coussins pour lui faire un siège délicat; ruais, voyant la
simplicité d’Agésilas, il eut honte de sa mollesse, et, comme lui, s’assit
sur la terre nue avec ses riches vêtements. Agésilas l’engagea à
secouer l’autorité du grand roi. Il ne se rendit pas, mais le Spartiate put
conclure de ses paroles qu’il serait aisé de détacher l’Asie Mineure de l’empire
et de mettre une foule de petits États entre le grand roi et Au milieu de ses préparatifs et de ses espérances, il
reçut l’ordre de revenir en Grèce où venait d’éclater une guerre qui rendait
sa présence nécessaire. Cette nouvelle l’affligea
vivement, car il voyait une grande gloire lui échapper; néanmoins il convoqua
les alliés, et leur montra les ordres de la république, en leur disant qu’il
fallait voler au secours de la patrie : Si les affaires s’arrangent,
sachez, mes amis, que je ne vous oublierai pas ; je reviendrai parmi
vous répondre à vos vœux. À ces mots, ils fondirent en larmes et
décrétèrent qu’ils iraient avec lui au secours de Lacédémone. Il nomma un
harmoste d’Asie, auquel il laissa quatre mille hommes. Après quoi, il passa
dans Ce sont trente mille archers du roi qui me chassent de l’Asie, disait Agésilas, faisant allusion à l’empreinte marquée sur les trente mille pièces d’or reçues par les orateurs de Thèbes, de Corinthe et d’Argos qui venaient d’exciter la guerre[30]. Tithrauste avait calculé juste ; son envoyé avait trouvé les Thébains fort animés contre Lacédémone. Une querelle entre les Phocidiens et les Locriens, que Thèbes soutenait, alluma la guerre. Lysandre se fit envoyer au secours des premiers ; le roi Pausanias devait venir le rejoindre sous les murs d’Haliarte. Au jour convenu, Lysandre se trouva seul au rendez-vous. Il n’était pas dans son caractère de reculer ou d’attendre; il attaqua la place, fut repoussé et tué. Pausanias, qui n’avait peut-être pas grande confiance dans le dévouement de ses alliés, n’osa risquer une bataille, et demanda une trêve pour enlever les morts. Les Thébains l’accordèrent. Mais, fiers de ce succès, s’ils voyaient un soldat de Pausanias s’écarter tant soit peu, pour gagner une métairie, ils le ramenaient au grand chemin en, le frappant. De retour à Sparte, le roi fut condamné à mort ; il se réfugia à Tégée, et y mourut de maladie. Cette sentence était une satisfaction donnée à la vanité nationale. L’oligarchie de Sparte n’a rien à reprocher en fait d’injustices politiques à la démocratie d’Athènes (395)[31]. En 401 les Thébains avaient montré une haine violente contre Athènes. Cependant il avait suffi de deux ou trois années d’hégémonie lacédémonienne pour tourner contre Sparte ses anciens alliés. En politique, les voisins sont souvent des ennemis, aussi y avait-il eu, des deux côtés du Parnès, de longues inimitiés. Mais du moment que le danger venait du Péloponnèse, Thèbes et Athènes devaient se tendre la main, puisque au fond elles n’avaient point d’intérêts contraires, l’une étant puissance continentale et agricole, l’autre puissance maritime et commerçante. Par leur union, elles empêchaient Sparte de sortir de sa péninsule. Avant la bataille d’Haliarte, une ambassade thébaine était venue dans l’Attique demander assistance. Athènes, toute mutilée encore, était sans vaisseaux, sans remparts. La délibération fut courte cependant. Pour toute réponse à l’orateur thébain, Thrasybule lut le décret d’alliance. Résolution aussi sage qu’héroïque, disait plus tard Démosthène en rappelant ce souvenir, car l’homme de cœur doit toujours, quel que soit le péril mettre la main aux grandes entreprises que l’honneur commande[32]. L’armée athénienne n’arriva que le lendemain du combat d’Haliarte,
mais elle était en ligne avec les Thébains quand parut Pausanias, et cette
intervention d’Athènes décida les Eubéens, les Acarnanes, les Ambraciotes, Ce succès n’était cependant pas pour Lacédémone une
victoire décisive, car les alliés regagnèrent tranquillement leur camp et,
dans Agésilas rapporta cependant de A Chéronée, Xénophon, revenu d’Asie avec l’armée lacédémonienne, avait combattu sous les ordres d’Agésilas contre les Thébains, ce qui était combattre contre Athènes, l’alliée de Thèbes. Sparte lui témoigna sa reconnaissance par le don d’un vaste domaine en une vallée charmante de l’Alphée, prés de Scillonte en Élide. Il y apporta son butin de guerre et y vécut longtemps au milieu des soins donnés à ses terres, de ses dévotions au temple d’Artémis qu’il avait bâti, et dans le culte des lettres[36]. La veille du combat, de Chéronée, Agésilas avait reçu la nouvelle d’un grand désastre, qu’il cacha à ses troupes. L’athénien Conon, réfugié en Chypre avec huit galères après la bataille d’Ægos-Potamos, avait trouvé le meilleur accueil auprès du roi de ce pays, Évagoras, et, de Salamine, il avait suivi d’un œil attentif les événements. On ignore ses patriotiques menées, bien qu’on parle d’un voyage qu’il fit à la cour du grand roi. Mais on voit tout à coup l’activité des ports de Phénicie se réveiller, un grand armement en sortir, Pharnabaze le rejoindre, et Conon prendre le commandement de 1a flotte royale. Il avait déjà suscité une révolution à Rhodes, qui renversa son gouvernement oligarchique; et il enleva nu immense convoi de blé que l’Égyptien Néphéritès envoyait aux Spartiates. Réuni à l’escadre de Pharnabaze, il détruisit la flotte lacédémonienne à la hauteur de Cnide : sur quatre-vingt-cinq trirèmes ennemies, cinquante furent prises. L’amiral Pisandros, beau-frère d’Agésilas, n’avait pas voulu quitter sa galère poussée au rivage, et s’était fait tuer (juillet 394). Les Lacédémoniens venaient donc de perdre la supériorité
sur la mer, excepté dans l’Hellespont dont Dercyllidas tenait les clefs à
Sestos et à Abydos. Ils la conservèrent plus longtemps sur terre. La guerre
qui s’était faite précédemment en Béotie se concentra, dans les six années
suivantes, autour de Corinthe, que les alliés défendaient avec toutes leurs forces,
barrant les deux passages de l’isthme pour enfermer les Spartiates dans le Péloponnèse.
Mais Corinthe renouvela presque les scènes atroces de Corcyre. Un parti
surprit, un jour de fête, ses adversaires, qui furent égorgés jusque dans les
temples et au pied des statues des dieux (392). Ces violences tournèrent mal ;
les bannis appelèrent les Lacédémoniens, coupèrent les Longs-Murs et s’emparèrent
du Léchée, d’où ils tinrent Corinthe comme assiégée (391). Une des routes de l’isthme était
rouverte, Athènes et Thèbes s’en effrayèrent. On essaya de faire la paix.
Sparte consentit à laisser Athènes relever ses murs et sa marine ; elle
lui reconnaissait même la possession de Lemnos, d’Imbros et de Scyros, mais
refusa de lui abandonner Parmi les chefs était l’Athénien Iphicrate, qui commandait un corps de mercenaires. On a vu déjà des mercenaires dans les armées d’Asie et sur toutes les flottes ; nous en trouvons maintenant d’une manière régulière en Grèce. Autrefois les citoyens, formés dès le jeune âge aux exercices de la guerre, dans les gymnases de la patrie, fournissaient la grosse infanterie, autour de laquelle se groupaient les soldats armés à la légère, donnés par les alliés, et les esclaves. Les devoirs du guerrier faisaient alors partie des devoirs du citoyen, le métier des armes n’était pas un métier à part ; ce que la tête avait conçu ou accepté, au sénat ou à l’assemblée, le bras l’exécutait sur le champ de bataille, et avec quelle puissance ! Cela change à l’époque où nous sommes. Mais ces hommes payés, ces soldats au service du plus offrant, n’apportaient plus, dans la guerre, l’ardeur et la passion patriotique qu’y mettaient auparavant les citoyens. Une guerre savante, toute de manoeuvres et de tactique, prit la place de l’ancienne guerre, plus ignorante, mais plus héroïque, comme aux temps modernes, la stratégie est née parmi les condottieri italiens. Iphicrate prit une part active à cette révolution. Il changea aussi l’armement d’une partie de l’armée athénienne, en donnant une grande importance aux peltastes, qui, armés de petits boucliers et de cuirasses légères, de fortes lances et de longues épées, réunirent les avantages de la grosse infanterie et des troupes légères, la suppression des armures pesantes permettant aux soldats des mouvements plus rapides. Iphicrate avait aussi presque deviné la tactique qui, plus tard, de l’autre côté de la mer Ionienne, valut aux Romains tant de triomphes : il occupait sans relâche ses troupes, ne campait jamais, même en pays ami, sans se retrancher et avait établi l’usage, dans les rondes, d’un mot d’ordre double, le premier donné par l’officier, le second par la sentinelle. Une affaire dans laquelle les peltastes d’Iphicrate affrontèrent les terribles Spartiates, qui perdirent deux cent cinquante homme, consacra leur réputation et celle de leur général (390). Ils purent dès lors butiner jusqu’au fond de l’Arcadie sans que les alliés de Lacédémone osassent sortir à leur rencontre. Était-ce le courage qui manquait à ceux-ci ? A voir Agésilas traverser furtivement, la nuit, avec ses troupes, les villes arcadiennes pour éviter les rires moqueurs des habitants, on peut croire que ce peuple ne portait pas le deuil de l’humiliation spartiate. L’année suivante, 359, Sparte fit un grand effort ;
les Achéens cherchaient à s’étendre sur la rivé septentrionale de leur
golfe ; à leur requête, Agésilas envahit le pays des Acarnanes, qu’il
ravagea comme s’il se fût trouvé en terre barbare, coupant les arbres à
fruit, enlevant les troupeaux, seule richesse de ce peuple pasteur, mais ne
prenant aucune des villes qu’entouraient des murailles cyclopéennes. Les Acarnanes
se résignèrent à entrer dans la ligue péloponnésienne. L’autre roi,
Agésipolis, essaya d’obtenir un pareil résultat en Argolide. Argos et Sparte,
quoique toutes deux doriennes, étaient des ennemies quatre ou cinq fois
séculaires ; elles s’étaient livré de nombreux combats, sans pouvoir se
frapper au cœur. Récemment Argos s’était faite l’âme de la ligue du
Nord ; les Spartiates y avaient répondu par des menaces d’invasion, que
les Argiens arrêtèrent plus d’une fois en envoyant à l’ennemi des hérauts pour
dénoncer l’ouverture des solennités qui suspendaient la guerre. Quand
Agésipolis approcha, ils essayèrent de l’arrêter encore, en prétextant la prochaine
célébration des jeux isthmiques et la trêve sacrée. Mais le roi s’était mis
en règle avec les dieux. Avant de commencer l’expédition, il avait consulté
les prêtres de Jupiter Olympien, qui n’avaient pas manqué de répondre suivant
ses désirs, puis il avait demandé à Durant ces opérations qui causaient tant de ruines et
moissonnaient tant d’existences, sans rien donner en échange de ces maux, un
événement considérable s’était accompli à Athènes. Les Perses, encouragés par
la victoire de Cnide, avaient pris audacieusement l’offensive. Conon et
Pharnabaze chassèrent les harmostes des îles et des cités grecques d’Asie, qu’ils
laissèrent sagement se donner un gouvernement de leur choix, et conduisirent
leur flotte jusque dans le golfe de Messénie, où ils ravagèrent la riche
vallée du Pamisos. Cythère aussi fut enlevée, et Conon y plaça une garnison
athénienne. De là, Pharnabaze vint à l’isthme conférer avec le conseil de la
ligue ; il l’exhorta à pousser vivement la guerre, et appuya ses
conseils d’un subside. Comme il se disposait à retourner en Asie, Conon s’offrit,
s’il lui laissait la flotte, à la faire vivre sans rien demander au trésor
perse, et à relever les Longs-Murs d’Athènes, ce qui serait le coup le plus
sensible porté à Lacédémone. De fortes murailles étaient alors chose de
grande importance. Ces Grecs si braves, si batailleurs, ne savaient prendre
une ville que par ruse ou famine. Leurs pères, disait-on, étaient restés dix
ans devant Troie et autant devant Cirrha ; eux n’en savaient pas
davantage : c’est plus lard que naîtra la poliorcétique[37]. Relever les
Longs-Murs était donc assurer l’indépendance d’Athènes et lui rendre, avec la
sécurité, le désir de retrouver sa puissance. Pharnabaze ne vit dans le
projet de Conon qu’un moyen de créer des embarras à l’orgueilleuse cité qui,
deux fois en quelques années, avait humilié le grand roi. Il pressa l’Athénien
d’exécuter son dessein et, pour que l’ouvrage allât plus vite, il donna ce
qui lui restait d’argent. Conon vint au Pirée avec quatre-vingts galères. Ses
équipages, les ouvriers qu’il solda, ceux que Thèbes et d’autres villes
envoyèrent, aidèrent le peuple à refaire l’ouvrage de Thémistocle, de Cimon
et de Périclès. Malheureusement, cette fois, c’était le grand roi qui payait les
travailleurs (393).
Un sanctuaire élevé à Aphrodite dans le Pirée, par Képhisodotos, le père du
grand Praxitèle, conserva le souvenir de la victoire de Conon et de l’assistance
royale[38]. Du même artiste
fut le groupe de Athènes n’eut pas plutôt rebâti ses murs qu’elle s’occupa
de relever son empire, tombé avec eux. Ses rapides progrès alarmèrent les
Lacédémoniens, qui se décidèrent à traiter avec Cette force, qui revenait si vite à un peuple naguère abattu et désarmé, effraya le grand roi autant que Lacédémone. Antalcidas, envoyé une seconde fois en Asie, fut parfaitement accueilli à Suse ; Sparte et la l’erse arrêtèrent les bases de la paix qui serait dictée aux Grecs. Les courses continuelles des Éginètes, qui, une nuit, surprirent le Pirée, le succès des Spartiates dans l’Hellespont, où leur flotte de quatre-vingts voiles intercepta le commerce d’Athènes, forcèrent cette ville d’accepter le traité qui porte le nom d’Antalcidas. Tiribaze convoqua les députés de toutes les cités belligérantes, et leur lut les ordres de son maître[42]. Le roi, était-il dit, trouve juste que les villes d’Asie avec les îles de Chypre et de Clazomène restent dans sa dépendance, et que les autres villes grecques, grandes ou petites, soient libres, à l’exception de Lemnos, d’Imbros et de Scyros, qui appartiendront comme autrefois aux Athéniens. Ceux qui refuseront cette paix, je les combattrai de concert avec ceux qui l’accepteront ; je leur ferai la guerre par terre et par mer, avec mes vaisseaux et avec mes trésors (oct. 387). Voilà la chose honteuse et impie[43] qu’acceptaient les fils des vainqueurs de Salamine et de Platée, ceux qui venaient de traverser deux fois impunément cet empire maintenant si fier. Voilà ce qu’il fallait graver sur la pierre et l’airain et exposer dans les temples des dieux[44]. A Sparte revient particulièrement cette honte. Par la bataille de Leuctres, dit Plutarque[45], elle avait perdu la prépondérance ; mais, par la paix
d’Antalcidas, elle perdit l’honneur. Après avoir provoqué cette
intervention hautaine des barbares, ce fut, elle qui fit exécuter leur
sentence. Les Grecs asiatiques furent abandonnés au grand roi, et toute
ligue, toute union de cités fut détruite en Grèce. Les Thébains refusaient d’accepter
cette clause qui détachait d’eux les villes de Béotie, depuis longtemps dans
leur dépendance; Agésilas réunit une armée pour les y contraindre : ils se
soumirent. La faction oligarchique dévouée à Sparte rentra à Corinthe, tandis
que les chefs du parti contraire s’exilaient à leur tour et qu’Argos retirait
la garnison qu’elle y tenait. Mais Sparte se garda bien de s’appliquer le
traité à elle-même et de rendre Un orateur athénien, se souvenant de la turbulence de ses compatriotes, reconnaissait que c’était avec justice que Lacédémone avait l’hégémonie en Grèce, et il assignait plusieurs causes à cette fortune persistante : le courage des Spartiates et leur discipline militaire, qui avaient préservé leur pays des ravages de l’invasion, quoiqu’ils n’eussent point de forteresses pour le défendre, et leur obéissance aux lois et aux coutumes des aïeux qui avait empêché les discordes intestines[46]. Cette image toujours vivante d’un passé lointain inspirait le respect, et cette immobilité, au milieu des perpétuels changements des autres États, était une force ; mais cette immobilité est contraire à la nature des institutions humaines, et cette force sera mise au service de l’iniquité. Pourtant la postérité gardera la mémoire de cette cité qui, longtemps, méprisa la mollesse et remplaça les remparts de pierres par de vaillantes poitrines d’hommes. |