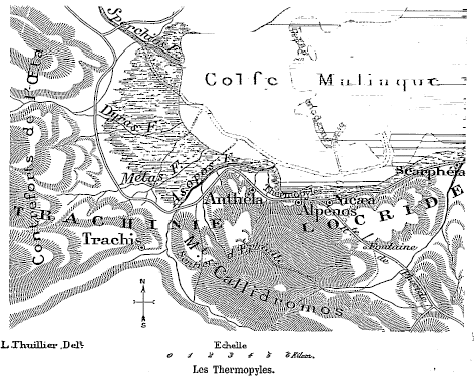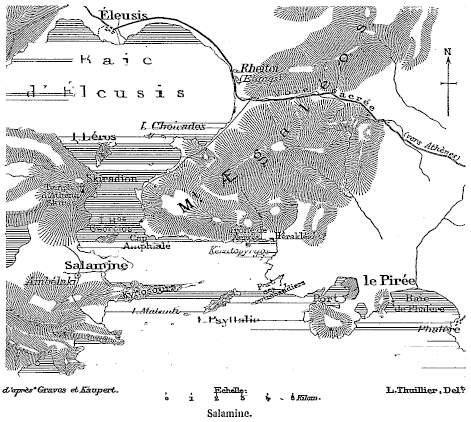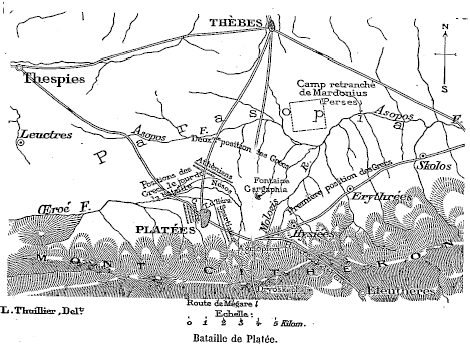HISTOIRE DES GRECS
TROISIÈME PÉRIODE — LES GUERRES MÉDIQUES (492-479) — UNION ET VICTOIRES.
Chapitre XVII — Salamine et Platée (480-479).
I. Xerxès en GrèceEn apprenant le désastre de Marathon, Darius sentit que sa
gloire et sa puissance étaient engagées à sortir victorieusement de cette
lutte. Lui, le souverain d’un immense empire, vaincu par une petite et
obscure nation! Un pareil outrage laissé sans châtiment eût été un coup
funeste porté à son empire, une dangereuse invitation à la révolte pour tant
de peuples soumis à ses lois. Que les Scythes eussent échappé à ses armes et
trompé sa poursuite, c’était moins leur valeur que leurs déserts qui avaient
triomphé de lui. D’ailleurs la conquête de Pendant trois années, à partir de la bataille de Marathon,
l’Asie tout entière fut agitée par l’enrôlement des soldats, l’armement des
vaisseaux, la réunion des chevaux et des vivres. Dans la quatrième année,
l’Égypte se révolta, et Darius s’apprêtait à marcher contre elle lorsqu’il
mourut en 484. Le premier soin de son fils Xerxès fut d’étouffer cette
révolte. Après y avoir réussi, il s’occupa de L’homme le plus porté à cette guerre était un beau-frère du roi, le bouillant Mardonius, qui espérait bien avoir le commandement et la gloire de l’expédition. La soumission de Il fallut encore quatre années pour achever les
préparatifs. De toutes les expéditions dont la
mémoire est venue jusqu’à nous, dit Hérodote, celle-ci
fut sans contredit la plus grande ; toute autre n’est rien en
comparaison… Est-il une nation de l’Asie que Xerxès n’ait armée et conduite
contre Pendant ces préparatifs qui ébranlaient et épuisaient
l’Asie, Xerxès fit exécuter deux grands ouvrages : le percement du mont Athos
et l’établissement d’un pont sur le détroit qui sépare Abydos de Sestos, ou l’Asie
de l’Europe. Il ne convenait pas au fastueux maître de l’Orient de passer ce
bras de mer, comme un simple mortel, sur un vaisseau ; et quant à
l’Athos, il voulait l’humilier et le punir du désastre qu’il avait causé à la
flotte de Mardonius[2]. On creusa dans
l’isthme qui réunit cette montagne au continent un canal long de
Si tout cela se passa ailleurs que dans l’imagination des Grecs, le grand roi fut ridicule ; il fut cruel lorsqu’il donna l’ordre de mettre à mort ceux qui, ayant dirigé les travaux, étaient coupables de l’avoir laissé vaincre dans la lutte qu’il avait entreprise contre les éléments. L’ouvrage fut recommencé : sur une double rangée de vaisseaux, on construisit avec de forts madriers un plancher solide que l’on recouvrit d’une couche de terre fortement battue, et on le borda de chaque côté d’une barrière. Cette fois l’ouvrage tint bon. L’armée s’avançait partagée en deux grosses colonnes. Dans l’espace que celles-ci laissaient entre elles venait le roi avec l’élite des troupes persiques. Devant lui marchait le char de Jupiter, c’est-à-dire d’Ormuzd, traîné par huit chevaux blancs nyséens ; lui-même était porté sur un char magnifique. Un trône de marbre blanc l’attendait à Abydos sur la côte ; de là il vit se déployer sur la mer son immense flotte, et se donna le divertissement d’un combat naval où les Phéniciens furent vainqueurs. «En contemplant l’Hellespont caché sous ses vaisseaux, et les rivages de la mer, les champs, d’Abydos couverts d’un nombre infini d’hommes, Xerxès se crut le plus heureux comme le plus puissant des mortels, et il s’en félicitait ; cependant ses yeux se remplirent de larmes ; Artabaze, qui s’en aperçut, lui dit : Ô roi, que vous avez mis peu d’intervalle entre deux actions bien différentes ! Il y a un moment, vous célébriez votre bonheur, et maintenant vous pleurez. — Je pleure, répondit Xerxès, de pitié sur la brièveté de la vie humaine, en réfléchissant que de cette foule immense pas un seul homme n’existera dans cent ans. Le grand roi se flattait : c’était dans un an qu’il eût fallu dire. Le lendemain, les troupes sous les armes, avant le lever du soleil, attendirent le moment où cet astre paraîtrait : pendant ce temps, on purifiait les ponts avec des parfums, et la route était semée de branches de myrte. Aussitôt que le soleil se montra, Xerxès fit, avec une coupe d’or, une libation dans la ruer, et, tourné vers l’orient, demanda au dieu de ne rencontrer dans son expédition aucun obstacle capable de l’arrêter avant qu’il eût atteint les dernières limites de l’Europe. Puis il lança dans l’Hellespont le vase qu’il tenait, un cratère d’or et un cimeterre. L’armée mit sept jours et sept nuits à passer les ponts ;
quand elle fut tout entière sur le sol de l’Europe, Xerxès voulut en faire le
dénombrement. On mesura cette moisson d’hommes que l’épée des Grecs allait
faucher, comme le grain se mesure au boisseau. Dans la vaste plaine de
Doriscos au bord de l’Hèbre, on entoura d’un mur une enceinte qui contenait
10.000 hommes bien serrés, et en y faisant entrer des fournées successives,
on put connaître combien il y avait de soldats clans l’armée quand elle y eut
passé tout entière. Les nombres donnés par Hérodote sont prodigieux. Tout en convenant
qu’il n’a pas de renseignements certains, il évalue les forces venues d’Asie
à 1.700.000 fantassins, 80.000 cavaliers, 20.000 hommes montés sur les chars de
guerre et les chameaux, 517.000 répartis sur 5000 vaisseaux de charge et 1200
vaisseaux de guerre : il y faut ajouter 120 trirèmes et 524.000 hommes tirés
de Ce qui donnait à cette immense cohue un aspect plus étrange encore, c’est que tous s’avançaient pêle-mêle, sous les costumes les plus bizarres, et ayant les armes les plus diverses[7] : les Perses, les Mèdes, les Hyrcaniens, avec des vêtements à dessins variés, des cuirasses à écailles d’acier poli, de légers boucliers d’osier, des flèches de roseau et de courtes piques ; les Assyriens avec des casques de forme bizarre et des massues garnies de fer ; les Saces armés de la hache: les Indiens vêtus d’étoffe de coton; les Arabes portant la zéira flottante ; les Éthiopiens couverts de peaux de lions et de panthères, qui faisaient voir leur corps peint moitié blanc et moitié rouge ; les Sagartiens armés d’un poignard et d’une corde terminée par deux filets; puis tous les peuples de l’Asie Mineure, les Thraces, et vingt autres encore. Mardonius partageait avec deux autres généraux le commandement de l’infanterie. Il n’est point étonnant que des fleuves aient été épuisés sur le passage de cette effroyable multitude, et que de vastes pays n’aient pu suffire à sa nourriture. Les hommes d’Europe, qui voyaient s’avancer ce torrent, étaient éperdus, et demandaient aux dieux s’il était donc nécessaire de dépeupler une partie du monde pour saccager l’autre. On dit que les Abdéritains, ruinés par le passage de l’armée, rendirent grâces aux dieux de ce que Xerxès ne faisait qu’un repas par jour : il leur eût fallu se vendre eux-mêmes et leur ville pour fournir au second. Un de ces repas avait coûté à Thasos 400 talents, c’était le tribut d’une année de l’Asie Mineure et presque la somme, 460 talents, qu’Athènes demanda à ses alliés pour les garantir contre le retour de la domination persique. Sur les bords du Strymon, les mages firent un sacrifice de chevaux blancs ; au lieu appelé les Neuf Voies, près d’Amphipolis, ils enterrèrent vivants neuf jeunes garçons et neuf jeunes filles. Jusqu’alors Xerxès n’était pas sorti de son empire. Un seul homme avait osé rejeter ses ordres, le roi des Bisaltes, entre le Strymon et l’AXios, qui se retira fièrement à l’approche des Perses sur les cimes du Rhodope. Il avait ordonné à ses fils de le suivre, ils rejoignirent Xerxès ; quand ils revinrent, il leur fit arracher les yeux. Cependant les Grecs étaient dans le même trouble que le montagnard qui entend rouler l’avalanche au-dessus de sa demeure[8]. Au milieu d’eux il y avait des traîtres. Et ce n’est pas merveille : quel amour de la patrie et de la liberté, quel courage ne fallait-il pas pour attendre de sang-froid et de pied ferme une ruine qui semblait certaine ! Mais Prométhée, lui aussi, avait senti, au milieu des grondements du tonnerre, la terre trembler sous lui, et il n’avait pas fléchi : Athènes et Sparte eurent le courage que la légende donnait au Titan du Caucase. Au premier bruit de la marche du roi, les Grecs avaient
envoyé des espions à Sardes pour connaître ses forces. Ils furent
découverts ; Xerxès, au lieu de les faire mourir, commanda qu’on leur
montrât tout, et les renvoya frappés d’effroi. Il avait lui-même dépêché aux
Grecs des hérauts pour recevoir l’hommage de ceux que le bruit de ses
armements aurait épouvantés. Les peuples de Ceux des Grecs qui avaient conservé l’amour de la patrie
s’étaient réunis à l’isthme de Corinthe et étaient convenus, avant tout, de
mettre fin à leurs inimitiés : Athènes et Égine se réconcilièrent. Puis on
envoya des ambassades à Corcyre, en Crète et en Sicile, auprès de Gélon,
tyran de Syracuse : elles eurent peu de succès. Corcyre répondit qu’elle
armerait soixante vaisseaux, mais ne les envoya pas ; retenus par les
vents étésiens, dit-elle après la victoire, ils n’avaient pu doubler le cap Malée.
Ainsi, les Grecs, au lieu de s’unir dans ce grand danger, étaient divisés. Qui donc les sauva ? Athènes, qui résolut de vaincre ou de mourir. Cette opinion, dit Hérodote, pourra déplaire à beaucoup de monde ; mais je ne puis la taire, parce que je la crois vraie. Si les Athéniens, en effet, se fussent retirés ou soumis, nulle marine n’eût été en état de protéger les côtes du Péloponnèse qui, assiégé comme une ville par l’immense flotte des Perses, eût succombé, malgré l’héroïsme des Spartiates.
Cependant pour l’armée de terre, deux plans avaient été
successivement adoptés. A l’époque où Xerxès allait passer l’Hellespont, 10.000
Grecs avaient été envoyés au défilé de Tempé pour fermer en cet endroit
l’accès de Tel est l’étroit passage que les Grecs résolurent de disputer aux Perses[10]. Tout prés de là, leur flotte trouvait une position non moins avantageuse dans l’Artémision, bras de mer resserré entre la côte de Magnésie et celle de l’Eubée où s’élevait un sanctuaire d’Artémis. II. L’Artémision et les ThermopylesQuand l’armée et la flotte eurent pris, à la fin de juin,
la position qui leur était assignée, Xerxès était déjà dans Dans le même temps, les Grecs avaient reçu un renfort de cinquante-trois galères d’Athènes ; ils présentèrent de nouveau le combat, les Perses le refusèrent. Pourtant une escadre de vaisseaux ciliciens qui se laissa surprendre fut détruite. Les généraux perses commencèrent à craindre que Xerxès ne leur demandât compte de ces revers répétés. Ils engagèrent toutes leurs forces dans une action générale. Les Grecs restèrent encore maîtres du champ de bataille; mais ils avaient éprouvé des pertes considérables, et ils songeaient à la retraite. La nouvelle que le passage des Thermopyles était forcé les décida. Dans ces combats, dit Pindare, les fils d’Athènes avaient jeté les bases brillantes de la liberté. Pendant que l’armée, s’éloignait, Thémistocle parcourut
avec quelques navires fins voiliers tous les endroits de la côte où les
ennemis devaient descendre pour faire de l’eau, et écrivit sur les rochers
l’avis suivant qui devait rendre les Ioniens suspects au roi, ou décider leur
défection : Ioniens, vous faites une mauvaise action
en portant les armes contre vos pères et en aidant à asservir Durant ces combats sur mer, Léonidas mourait aux Thermopyles.
Quand la résolution de défendre les Thermopyles avait été prise, on était, au temps des jeux olympiques et des fêtes d’Apollon Carnéen, qui duraient à Sparte neuf jours. Quelque pressant que fût le danger, les Grecs n’abandonnèrent pas leurs fêtes; une petite armée, sorte d’avant-garde, fut envoyée seulement aux Thermopyles : elle comptait 300 Spartiates, choisis parmi ceux qui laissaient derrière eux des fils, 1000 Tégéates et Mantinéens, 120 Orchoméniens, 1000 hommes du reste de l’Arcadie, 400 de Corinthe, 200 de Phlionte, 80 de Mycènes, 700 Thespiens, 1000 Phocidiens, toutes les forces des Locriens Opuntiens et 300 Thébains que Léonidas avait plutôt pris comme otages que comme auxiliaires, parce qu’on soupçonnait leur ville d’incliner vers le Mède. Chacun de ces petits corps avait son chef particulier, mais ils obéissaient tous au roi de Sparte. Pendant quatre jours Xerxès se flatta que la seule vue de son armée déciderait les Grecs à se rendre. Quelques hommes du Péloponnèse en effet parlèrent de s’en retourner pour défendre l’isthme de Corinthe ; mais ils furent arrêtés par Léonidas, les Phocidiens et les Locriens. Le cinquième jour, comme les Grecs ne s’éloignaient pas, Xerxès envoya contre eux les Mèdes et les Cissiens, leur ordonnant de les lui amener vivants. Il se plaça sur un trône élevé pour voir l’action et attendre les captifs. Les Mèdes attaquèrent, mais ils furent repoussés après avoir perdu beaucoup de monde; d’autres les remplacèrent sans plus de succès, et Xerxès commença à comprendre qu’il avait dans son armée beaucoup d’hommes et peu de soldats. Les Mèdes, trop maltraités, s’étant retirés, le corps des Immortels prit leur place ; ils ne firent pas mieux. Dans cet étroit défilé, la supériorité du nombre ne pouvait leur servir, et ils avaient le désavantage des armes, leurs piques étant plus courtes que celles des Grecs. De temps en temps les Lacédémoniens tournaient le dos comme pour fuir, et les barbares les poursuivaient en poussant de grands cris ; mais les Grecs se retournaient bientôt et en jetaient un grand nombre sur la place. Dans cette journée les Spartiates n’éprouvèrent qu’une perte légère. Les barbares croyaient qu’après un si long combat il n’y avait plus dans l’armée grecque que des blessés hors d’état de lever leurs armés : ils tentèrent donc le jour suivant une nouvelle attaque; elle ne réussit pas mieux. Les Grecs, rangés par ordre de peuples, prirent part tour à tour à ces divers combats, à l’exception cependant des Phocidiens qui, placés sur la montagne, en gardaient les sentiers. Tandis que Xerxès balançait sur le parti à prendre, un Malien, nommé Éphialte, vint le trouver et, dans l’espoir d’une grande récompense, lui apprit qu’il existait dans la montagne un sentier conduisant sur les derrières du camp grec. Le roi ordonna aussitôt à Hydarnès de suivre le traître avec la troupe des Immortels. Les Perses, partis du camp à l’heure où l’on allume les feux, marchèrent pendant toute la nuit, ayant à leur droite le mont Œta, et à la gauche les montagnes de Trachis. Au moment où l’aurore parut, ils avaient, atteint le point le plus élevé du passage. Sur ce sommet étaient placés les 1000 Phocidiens qui gardaient le sentier. Pendant le temps que les Perses gravissaient la montagne, les Phocidiens n’avaient pu les apercevoir, la grande quantité de chênes qui la couvrent les dérobant à la vue. Cependant, comme l’air était tranquille, le bruit des feuilles foulées aux pieds révéla leur approche aux Phocidiens : ils prirent les armes et accoururent. Dans ce moment, les barbares paraissaient, et, voyant devant eux des soldats, ils furent saisis d’étonnement et de crainte, car ils s’étaient flattés de ne rencontrer personne en ces lieux. Hydarnès lui-même craignait d’avoir affaire à des Lacédémoniens, mais Éphialte lui ayant dit de quelle nation était cette troupe, il disposa ses Perses au combat. Les Phocidiens, accablés de traits et de flèches, lâchèrent pied et gagnèrent le plus haut sommet du Callidromos, où ils s’attendaient à périr. Les Perses, au lieu de les poursuivre, s’empressèrent de descendre l’autre revers. En ce moment le devin Mégistias examinait les entrailles des victimes, et prédisait aux Spartiates que la mort les attendait au lever du jour. Bientôt arrivèrent des transfuges qui annoncèrent le détour que les Perses devaient faire. Des sentinelles descendues en courant des hauteurs confirmèrent cette nouvelle : le jour paraissait alors. Les Grecs délibérèrent sur le parti à prendre : ceux-ci étaient d’avis qu’il fallait se défendre, ceux-là insistaient pour une retraite immédiate. On ne put s’accorder. Les uns se mirent en marche pour retourner dans leurs foyers, les autres en adoration se décidèrent à rester avec Léonidas. On prétend cependant que le roi donna aux troupes qui se retirèrent l’ordre de partir, pour les sauver d’une perte certaine, mais en annonçant qu’il ne convenait ni à lui ni aux Spartiates de déserter, sous quelque prétexte que ce fût, le poste qu’ils étaient chargés de défendre. Les Thespiens et les Thébains seuls demeurèrent : les Thébains retenus contre leur gré par Léonidas, les Thespiens de leur propre volonté. Cependant, au lever du soleil, Xerxès, ayant fait des libations, attendit l’heure convenue avec Éphialte pour attaquer de front le retranchement. À l’approche des Perses, les Grecs sortirent au-devant d’eux et livrèrent leur dernière bataille dans une partie plus large du défilé, afin d’avoir plus d’ennemis en face et d’en frapper davantage avant de mourir. Un nombre infini de barbares trouvèrent la mort dans cette action. Indépendamment de ceux qui succombèrent sous le fer des Grecs, comme il y avait derrière les rangs des chefs armés de fouets et sans cesse occupés à pousser à grands coups les soldats en avant, beaucoup de ceux-ci tombèrent dans la mer et y furent noyés : d’autres, en plus grand nombre, furent écrasés vivants sous les pieds de la foule qui se succédait sans interruption. Quand les Lacédémoniens eurent brisé leurs piques à force de tuer, ils continuèrent à combattre avec l’épée. Enfin Léonidas tomba. Une lutte furieuse s’engagea sur son corps : quatre fois les Grecs repoussèrent l’ennemi. Ils gardaient encore ce glorieux trophée, quand les barbares, sous la conduite d’Éphialte, parurent. A leur approche, les Grecs se retirèrent en arrière dans la partie étroite du chemin. Ils repassèrent la muraille et l’arrêtèrent, à l’exception des Thébains, sur une hauteur qui est à l’entrée du défilé, où l’on voit actuellement le lion de marbre élevé en l’honneur de Léonidas. C’est là qu’enveloppés de toutes parts, et après s’être encore défendus, les uns avec les armes qui leur restaient, les autres avec leurs mains et leurs dents, tous tombèrent sous la grêle de pierres et de traits que lançaient les barbares. Les soldats valaient le chef. Un Trachinien disait à l’un d’eux dans son effroi : L’armée persique est si nombreuse, que ses traits obscurciraient le soleil. — Tant mieux, nous combattrons à l’ombre. Un Lacédémonien était retenu au bourg d’Alpénos par une fluxion sur les yeux, on lui dit que l’ennemi approche, il prend ses armes, se fait conduire par son hilote dans la mêlée, frappe et tombe. Léonidas voulait sauver deux jeunes Spartiates, il donne à l’un une lettre, à l’autre une commission pour les éphores. Nous ne sommes pas ici pour porter des messages, mais pour combattre. Vingt mille Perses avaient péri, et parmi eux deux fils de
Darius. Du côté des Grecs, pas un Spartiate ni un Thespien n’échappa,
quelques Thébains demandèrent la vie. Xerxès fit mettre en croix le corps de
Léonidas, mais III. SalamineMinerve parut d’abord moins compatissante à son peuple, et
pourtant son autorité n’en fut pas affaiblie, parce qu’on a pu dire, après
l’invasion, que, si elle n’avait pas défendu, dans Athènes, les maisons et
les sanctuaires, elle avait, à Salamine, sauvé la cité. Ce jour-là, en effet,
Après que les Perses eurent forcé le passage des Thermopyles, les Athéniens avaient espéré que toutes les forces des alliés viendraient protéger l’Attique; lorsqu’ils apprirent que les Péloponnésiens se refusant à sortir de leur presqu’île ne songeaient qu’à en défendre l’entrée par une muraille élevée au travers de l’isthme[13] et en roulant des rochers dans la passe scironienne, ils demandèrent qu’au moins la flotte s’arrêtât dans le canal étroit qui sépare Salamine du continent. Les vaisseaux des Grecs revenus de l’Euripe jetèrent l’ancre sous cette île, tandis que ceux des Athéniens mouillaient sur la côte de l’Attique, pour procéder à l’évacuation du pays. L’Aréopage avait fait proclamer que tout citoyen avisât au moyen de sauver sa femme, ses enfants et ses esclaves comme il pourrait. Un présage avait levé les derniers scrupules : le serpent sacré nourri dans le temple de Minerve venait de disparaître, signe que la déesse elle-même abandonnait son sanctuaire. Tous les non-combattants furent envoyés à Trézène, à Égine ou à Salamine ; ceux qui pouvaient porter une pique ou remuer une rame allèrent rejoindre la flotte. Elle était à peine réunie qu’un fugitif, arrivé d’Athènes, annonça au conseil des chefs que les Perses avaient brûlé Thespies et Platée, pénétré dans l’Attique et pris la ville, où quelques citoyens réfugiés dans la citadelle, derrière des palissades qu’ils crurent être les remparts de bois recommandés par l’oracle, y avaient été surpris et massacrés. Le temple d’Érechthée n’était plus qu’un monceau de cendres. Cette nouvelle causa un tel trouble dans le conseil, que plusieurs chefs, sans attendre une décision, firent hisser les voiles de leurs vaisseaux et se disposèrent à partir. Ceux qui restèrent pour continuer la délibération décrétèrent que l’on ne combattrait qu’en avant de l’isthme de Corinthe. Cependant la nuit était arrivée; chacun regagna son navire. Quand Thémistocle fut de retour sur le sien, son vieil ami
Mnésiphilos lui demanda ce que le conseil avait résolu, et en l’apprenant,
lui dit : Si les vaisseaux partent de Salamine, vous
n’aurez plus la chance d’un combat qui, seul, peut sauver la patrie : chacun
quittera la flotte pour retourner chez soi : ni Eurybiade, ni personne n’empêchera
que l’armée se disperse, et Thémistocle se rendit auprès d’Eurybiade, et, à force de
prières, obtint de lui qu’il réunît de nouveau le conseil. Là il se garda
bien de parler du motif allégué par Mnésiphilos, qui eût blessé les autres
chefs ; mais il représenta qu’en se retirant sur l’isthme on s’exposait
à combattre dans une mer ouverte, grand désavantage pour une flotte
inférieure en nombre. que, de plus, on abandonnait sans nécessité Mégare,
Salamine, Égine ; enfin qu’on attirait l’ennemi sur le Péloponnèse, de
sorte qu’en cas de revers, tout espoir serait perdu. Alors se montra datas
son jour l’aveugle et ignorante jalousie des Péloponnésiens. Le Corinthien
Adimante voulut obliger Thémistocle à ne parler qu’à son tour : Ceux qui partent avant le signal, lui dit-il, sont battus dans les jeux. — Mais ceux qui partent trop tard, répliqua
l’Athénien, ne gagnent pas la couronne. Et il
continua à montrer les avantages du plan qu’il proposait. Les chefs se
récrient et s’emportent ; Eurybiade, irrité de la confusion du débat où
domine la voix de l’Athénien, vient sur lui le bâton levé : Frappe, dit Thémistocle, mais
écoute. Le calme se rétablit et la discussion recommence. Adimante
s’étonne que, pour le bon plaisir des Athéniens, on s’expose à n’avoir
d’autre refuge, si l’on était battu, que l’île de Salamine. Qu’est-il besoin d’ailleurs, ajoute-t-il, d’écouter plus longtemps un homme sans patrie !
— Notre patrie ! s’écrie Thémistocle, elle est ici sur ces deux cents vaisseaux que nous mettons
au service de
Le jour suivant, quelques renforts arrivèrent et portèrent la flotte grecque à 378 vaisseaux, sans parler des navires à cinquante rames ; celle des Perses en comptait encore plus de 1000 (?) qui étaient venus se ranger dans la rade de Phalère. En même temps leur armée de terre s’approchait du Péloponnèse. Cette marche ranima les craintes de ceux qui avaient été d’avis de se retirer sur l’isthme. Des murmures et des cris s’élevèrent de nouveau, un conseil fut encore convoqué, et la majorité se montra disposée à la retraite. Thémistocle prit, dans cet extrême danger, une résolution extrême. Il sortit du conseil et envoya un homme sûr au général des Perses avec cette commission : Thémistocle, général des Athéniens, est secrètement dévoué au roi de Perse ; il m’envoie vous dire que les Grecs ne se méfient de rien et que vous pouvez leur fermer les deux bouts du détroit, cernés ainsi, ils seront facilement vaincus. Xerxès crut cet avis sincère et donna aussitôt l’ordre d’envelopper les Grecs. Thémistocle était retourné au conseil, prolongeant à dessein le débat. Un homme le demande, c’est Aristide, qui venait de traverser la flotte persique pour combattre avec ses concitoyens. Soyons toujours rivaux, lui dit l’exilé, mais rivalisons de zèle pour le salut de la patrie. Pendant que vous perdez le temps ici en de vaines paroles, les barbares vous entourent. — Je le sais, répond Thémistocle, c’est par mon avis que cela s’exécute, et il introduit Aristide dans le conseil pour y porter cette nouvelle. Il fallait donc combattre, aux lieux que Thémistocle, avec l’audace du génie, imposait comme champ de bataille à ses concitoyens[14]. Le jour où l’action s’engagea, 19 boédromion ou 20 septembre, était une des grandes fêtes religieuses de l’Attique. Ce jour-là, une théorie sacrée portait solennellement à Éleusis Iacchos, le dieu des mystères, et un navire ramenait d’Égine les saintes images des Éacides, descendants de Jupiter. Les Grandes Déesses allaient certainement punir les sacrilèges qui empêchaient l’accomplissement des rites habituels. En ce moment, dit Hérodote[15], l’Athénien Dicéos, réfugié chez les Mèdes, se promenait avec Démarate dans la plaine de Thrias. Ils virent s’élever au-dessus d’Éleusis un nuage de poussière, comme celui qui se forme sous les pas des pèlerins, et il en sortit une grande voix qu’ils reconnurent pour être celle d’Iacchos. Le nuage s’étendit du côté de Salamine ; c’étaient les Grandes Déesses qui se réfugiaient près de la flotte, Minerve y était déjà et les héros Éacides y vinrent avec la galère éginétique pour assister dans le combat ceux qui les honoraient d’un culte pieux. Croire à la protection des dieux, c’est l’obtenir, parce
que le cœur en est mieux affermi. Mais, pour le devin Euphrantidès, ce
n’était pas assez : il demanda le sacrifice de trois prisonniers, et la foule
superstitieuse pensa racheter le sang de Bientôt le Jour aux blancs
coursiers répandit sur le monde sa resplendissante lumière : à cet instant,
une clameur immense, modulée comme un cantique sacré, s’élève dans les rangs
des Grecs, et l’écho des rochers de l’île répond à ces cris par l’accent de
sa voix éclatante. Les barbares sont saisis d’effroi, car il n’était pas
l’annonce de la fuite, cet hymne saint que chantaient les Grecs. Le signal
est donné; soudain les rames frappent d’un battement cadencé l’onde salée qui
frémit, et leur flotte apparaît tout entière à nos yeux. L’aile droite
marchait la première, en bel ordre; le reste de la flotte suivait., et ces
mots retentissaient au loin : Allez, ô fils de Artembarès, le chef des dix mille cavaliers, a été tué sur les rochers escarpés de Silénie. Dadacès, qui commandait mille hommes, frappé d’un coup de lance est tombé de son bord. Ténagon, le plus brave des guerriers bactriens, est resté dans cette île d’Ajax tant battue par les vagues. Lilée, Arsamès, Argestès, renversés tous les trois sur les rivages de l’île chère aux colombes, se sont brisé la tête contre les rochers… Celui qui commandait à trente mille cavaliers montés sur des coursiers noirs, Matallos de Chryse, est mort ; sa barbe rousse, épaisse, au poil hérissé, dégouttait de son sang ; son corps s’est teint de la couleur de la pourpre. Le mage Arabus, Artamès le Bactrien, ne sortiront plus de l’âpre contrée… Ah ! la ville de Pallas est une ville inexpugnable. Athènes contient des hommes : c’est là le rempart invincible. Le messager qui apporte à la reine Atossa ces funèbres nouvelles n’a pas tout dit encore : Une autre calamité a frappé les Perses… Cette jeunesse de Perse, si brillante par son courage, si distinguée par sa noblesse, par sa fidélité au roi, a péri misérablement d’une mort sans gloire. Une île est en face de Salamine, petite, d’un accès difficile aux vaisseaux, où le dieu Pan mène souvent ses chœurs[16]. C’est là que Xerxès envoie ses guerriers ; ils devaient, quand la flotte des ennemis serait en déroute, faire main basse sur tous les Grecs qui se réfugieraient dans l’île et recueillir ceux des leurs qu’y jetterait la mer. Il lisait mal dans l’avenir ; car les dieux donnèrent la victoire à la flotte des Grecs. Ce jour-là même, les vainqueurs, armés de toutes pièces, débarquent dans l’île, et la cernent : les Perses ne savent où fuir ; la main des Grecs les écrase sous une grêle de pierres ; ils tombent percés par les flèches des archers ennemis. Puis les assaillants s’élancent tous ensemble d’un même bond : ils frappent, ils hachent ; tous sont égorgés jusqu’au dernier. Xerxès sanglote à l’aspect de cet abîme d’infortunes, car il était assis en un lieu d’où l’armée entière se découvrait à sa vue : c’était une colline élevée, non loin du rivage de la mer. Il déchire ses vêtements, il pousse des cris de désespoir, et, donnant le signal, il fuit avec son armée de terre, précipitamment, en désordre[17]. Nous n’avons pas voulu interrompre le récit d’Eschyle pour citer quelques particularités du combat que nous trouvons ailleurs. Un vent s’élevait à une certaine heure, dans le détroit ; Thémistocle avait attendu qu’il soufflât pour attaquer. Au milieu des vagues soulevées, les lourds vaisseaux perses s’entrechoquaient et évitaient difficilement les coups rapides que leur portaient les navires plus légers des Grecs. A cette première cause de désordre se joignaient les défiances que les Ioniens inspiraient aux Phéniciens, la difficulté pour tant de nations de s’entendre et de suivre les mêmes ordres, enfin la disposition des lieux, très défavorables aux Perses. Dans ce détroit, ils ne pouvaient déployer leurs forces, et ils gênaient réciproquement leurs mouvements. Les Phéniciens, opposés aux Athéniens, commencèrent l’attaque. Leur amiral Ariabignès, un frère de Xerxès, s’étant bravement élancé sur une galère athénienne qui venait de fondre sur son vaisseau amiral, fut percé de coups, et sa mort jeta le désordre dans l’aile droite qu’il commandait. Une femme se signala : Artémise, reine de Carie. Comme sa galère était vivement pressée par un navire athénien[18], elle se détourna sur un vaisseau perse et le coula. L’Athénien, croyant qu’il poursuivait un ami, chercha un autre adversaire. Xerxès vit l’action d’Artémise; il pensa que le vaisseau brisé par elle était grec, et s’écria qu’en ce jour les femmes se battaient comme des hommes, les hommes comme des femmes. Pour honorer son courage, dans la retraite il lui confia ses enfants, qu’elle ramena à Éphèse. Les Perses avaient perdu 200 vaisseaux, les Grecs 40 : la
flotte barbare avait donc encore la supériorité du nombre. Xerxès affecta un
moment le courage et l’assurance : il ordonna de joindre Salamine au
continent par une chaussée et de préparer une nouvelle attaque. Mais, au
fond, il avait perdu tout espoir, et déjà il craignait d’être coupé de
l’Asie, s’il ne se hâtait d’y repasser. Mardonius, le conseiller de cette
fatale expédition, voyait sa ruine dans cette défaite. Pour la conjurer, il
s’offrit à rester en Grèce avec 300.000 hommes (?), qui suffiraient à en
achever la conquête ; car les Cypriotes et les
hommes de Phénicie, de Cilicie et d’Égypte seuls, disait-il, ont été vaincus, non les Perses, qui n’ont pu combattre.
Xerxès, pressé de fuir, accueillit avec joie cette proposition, et dès qu’il
eut, dans sa retraite précipitée, atteint Les Grecs, de leur côté, levaient des contributions clans
les Cyclades, pour les punir d’avoir trahi la cause commune. Ils assiégèrent
Andros. Je viens à vous, disait Thémistocle
aux habitants, avec deux divinités puissantes, IV. Platée et MycaleDébarrassé plutôt qu’affaibli par
le départ du roi et de la foule tumultueuse qui le suivait, Mardonius hiverna
dans Un décret ordonna aux prêtres de dévouer aux dieux infernaux quiconque entretiendrait des intelligences avec l’ennemi. Il est triste d’avoir à ajouter qu’un parti, celui des grands, qui avait déjà commencé la longue série de ses trahisons envers la liberté, trouvait insensé ce généreux dévouement. Un d’eux va proposer de se soumettre ; d’autres, à Platée même, méditeront une défection. Sparte avait offert de nourrir pendant toute la campagne les familles des Athéniens : ils refusèrent, et demandèrent seulement que l’armée du Péloponnèse se tint prête d’assez bonne heure pour que l’Attique ne fût pas une troisième fois sacrifiée. Elle le fut. Les Lacédémoniens, contents d’avoir rompu
cette négociation, retournèrent dans leur presqu’île et ne s’occupèrent que
d’achever la muraille qui en barrait l’entrée : L’isthme
étant fermé, dit Hérodote, ils crurent
n’avoir plus besoin des Athéniens. Mardonios put donc traverser Averti de ce mouvement par les
Argiens, Mardonius quitta l’Attique, où il avait tout saccagé, et chercha
dans les plaines de Cependant, dans la position que les Grecs occupaient, ils étaient exposés a manquer d’eau. Pausanias descendit dans la plaine de Platée, que de nombreux ruisseaux arrosent, et campa avec ses Lacédémoniens près de la fontaine de Gargaphie. Quand on distribua les autres postes, une dispute violente s’éleva entre les Athéniens et les Tégéates. Ceux-ci prétendaient au commandement de l’aile gauche, que les Athéniens réclamaient. Des deux côtés on rappela les exploits des aïeux : Tégée ceux du héros Échémos, Athènes sa victoire sur les Amazones. Aristide trouva de meilleures paroles. Nous sommes ici non pour disputer un poste, mais pour combattre. Que les Lacédémoniens décident : en quelque lieu que nous soyons placés, notre courage en fera un poste d’honneur. Les Spartiates se prononcèrent tout d’une voix pour Athènes. Les Perses avaient fait aussi un mouvement, et les deux armées n’étaient séparées que par le lit de l’Asopos. Aucune n’osait le franchir, parce que les présages menaçaient d’une défaite celle qui engagerait le combat. Les Grecs avaient intérêt à cette sorte de trêve, car ils recevaient continuellement des secours et des vivres, tandis qu’il devenait difficile à Mardonius de nourrir son immense armée. Mais il espérait mettre ce temps à profit pour acheter quelques chefs alliés et dissoudre la ligue. Au bout de dix jours, il perdit patience; malgré les avis et les craintes de ceux qui l’entouraient, il annonça l’attaque pour le lendemain. Au-dessus des oracles était, disait-il, cette vieille loi du pays qui ordonnait de conduire sans retard les Perses au combat. Durant la nuit, un cavalier se présenta au camp des Grecs,
en demandant à parler aux généraux : Soyez sur vos
gardes, leur dit-il ; Mardonius, malgré
les présages, vous attaquera à la pointe du jour. Recevez en bonne part
l’avis que je vous donne. Forcé de suivre malgré moi l’armée des Perses, je
vous apporte une preuve évidente de mon dévouement à Sur cet avis, Pausanias changea son ordre de bataille. Aux Perses il opposa les Athéniens, qui connaissaient leur manière de combattre, et il plaça les Spartiates en face des Grecs auxiliaires. L’ennemi fit un changement semblable, de sorte que les deux armées se trouvèrent dans leur ancienne position. Ces mouvements parurent à Mardonius un aveu de crainte ; il envoya à Pausanias un défi insultant, et offrit de tout terminer par un combat singulier entre un nombre égal de Perses et de Spartiates. Le roi ne répondit pas. Deux circonstances forcèrent encore les alliés à changer leur ordre de bataille: la cavalerie persique parvint à détruire la fontaine de Gargaphie d’où les Grecs tiraient toute leur eau, car les archers ennemis les empêchaient d’approcher de l’Asopos, et les coureurs thébains inquiétaient les convois de vivres qui arrivaient par les défilés du Cithéron. Il fut résolu que l’on décamperait à la nuit pour se rapprocher de Platée et des montagnes par où l’on communiquait avec le Péloponnèse. Le moment venu, une grande partie des troupes se mirent en marche ; mais, au lieu de s’arrêter aux points fixés, elles allèrent jusqu’à un temple de Junon qui tenait à la ville même de Platée. Les Lacédémoniens et les Athéniens ne partirent qu’à la fin de la nuit : Pausanias n’avait pu décider à la retraite un brave officier lacédémonien qui regardait comme une honte de reculer. Il résulta de ce retard que les deux corps n’étaient pas encore bien éloignés lorsque les Perses s’aperçurent, au lever du soleil, que l’ennemi était en retraite.
Mardonius, tout joyeux, traversa l’Asopos et lança ses
barbares en désordre à la suite des Lacédémoniens, qui filaient par le pied
de la montagne. Les Athéniens avaient pris tout droit par la plaine et ils
atteignaient déjà les collines qui descendent de Platée, lorsqu’ils furent
avertis par un pressant message de Pausanias de l’attaque des Perses. Ils se
portèrent à son secours ; mais les Grecs, alliés de Mardonius, les
chargèrent avec tant de vigueur, qu’ils n’eurent plus à songer qu’à se défendre
eux-mêmes. Les Lacédémoniens et les Tégéates, restés seuls avec leurs troupes
légères, formaient une armée de 53.000 hommes très capable de se défendre.
Mais, d’abord, on consulta les dieux par des sacrifices, et les premières victimes
n’ayant pas donné d’heureux présages, on différa l’attaque. Cette inaction
fut fatale aux Lacédémoniens, qui eurent beaucoup de soldats tués ou blessés
; car les Perses, après avoir planté en terre leurs gerrhes ou boucliers,
lançaient les traits à l’abri de ce rempart, et sans aucun risque en
accablaient les Lacédémoniens. Pausanias, désespéré de ne pouvoir obtenir de
réponses favorables des victimes, tourna ses regards vers le temple de Junon
et supplia la déesse de ne point permettre que les espérances de Il parlait encore, quand les Tégéates, impatients, se levèrent et marchèrent à l’ennemi. Un instant après, les Spartiates obtenaient enfin l’assentiment du ciel et se mettaient en mouvement. Les arcs des Perses étaient une faible défense contre la phalange lacédémonienne. D’abord la lutte s’engagea en avant des gerrhes, et, lorsque ce rempart fut forcé, un second combat plus acharné eut lieu près du temple de Déméter ; il dura longtemps, et l’on se battit presque corps à corps, les barbares saisissant les piques des Grecs et les brisant avec leurs mains. Ils se montraient aussi braves que leurs adversaires, mais sans adresse, mal armés et combattant presque nus contre des hommes couverts d’une armure complète. Ils ne mettaient point d’ensemble dans leurs attaques, et venaient tantôt isolément, tantôt par troupes de dix, plus ou moins, et toujours en désordre, se ruer sur les Spartiates, qui les taillaient facilement en pièces. Le point où les Grecs se virent serrés le plus près fut celui où se trouvait Mardonius, monté sur un cheval blanc, et entouré d’un corps de mille hommes choisis parmi les plus braves des Perses. Tant qu’il fut vivant, ses troupes soutinrent les efforts des Lacédémoniens; mais, quand il tomba et que ce corps d’élite eut été détruit, le reste des troupes tourna le dos. Les fuyards s’étaient retirés dans le camp que Mardonius
avait fait construire ; les Lacédémoniens les poursuivirent jusque-là,
mais lorsqu’il fallut forcer le retranchement, leur inexpérience se montra :
constamment repoussés, ils furent obligés d’attendre les Athéniens, qui
avaient eu à supporter le choc des Grecs auxiliaires. De ce côté, les
Thébains seuls se battirent vaillamment. Quand ils eurent été mis en fuite,
les Athéniens accoururent et, après un rude combat, jetèrent bas une partie
du mur. Les Grecs se précipitèrent en foule dans cet étroit espace, où ils
firent un grand carnage. A en croire Hérodote, des 300.000 hommes qu’avait
conservés Mardonius, à peine 3000 auraient survécu, si l’on excepte les 40.000
qu’Artabaze n’engagea pas, et qu’à la vue du désastre il emmena
précipitamment vers Les Lacédémoniens et les Athéniens se disputaient vivement
le prix de la valeur ; un Mégarien leur proposa d’y renoncer, et tous
les suffrages se réunirent en faveur des Platéens, qui, suivant l’usage,
avaient combattu avec les Athéniens. Aristide fit passer ce décret : Les peuples alliés formeront contre D’immenses richesses couvraient le champ de bataille. On fit d’abord la part des dieux. Apollon Delphien, Zeus d’Olympie et Neptune Isthmique reçurent chacun un dixième des dépouilles; Pausanias en eut un autre; on partagea le reste entre les vainqueurs. Des monuments funèbres furent élevés aux Spartiates, aux hilotes, aux Tégéates, aux Athéniens et aux Mégariens morts dans le combat, et les Platéens furent institués gardiens de ces tombeaux. Ceux des Grecs qui n’avaient pas pris part à la lutte cherchèrent dans la suite à tromper la postérité : ils construisirent auprès de ces tombeaux véritables des cénotaphes, comme s’ils avaient eu des guerriers tués à ce grand jour de la commune délivrance. Mais, sur le trépied d’or déposé par les vainqueurs dans le trésor de Delphes, on grava les noms des peuples qui, depuis le commencement de la lutte, avaient pris part à la guerre de l’indépendance. Le roi de Lacédémone y avait d’abord fait écrire : Le chef des Grecs, Pausanias, après avoir détruit l’armée des Mèdes, a consacré cette offrande à Apollon ; orgueil qui annonce le faible et vaniteux personnage que nous allons bientôt retrouver. Les Platéens intentèrent, par-devant les Amphictyons, un procès aux Spartiates pour cette confiscation, par un d’entre eux, de la gloire commune ; le conseil condamna Lacédémone, et le distique qu’avait rédigé Simonide fut remplacé par la liste d’honneur des trente et une cités qui avaient combattu[22]. A Platée, les Thébains avaient donné une vigoureuse assistance à Mardonius. Le onzième jour après la victoire, l’armée grecque parut devant leurs murs, et les contraignit de livrer les auteurs de la défection, que Pausanias fit mettre à mort dans Corinthe (479). Pendant que les Grecs frappaient ce grand coup, leur armée de mer, commandée par le Spartiate Léotychidas, s’illustrait par une éclatante victoire qu’on a placée au même jour que la bataille de Platée. La flotte stationnait à Délos, n’osant s’aventurer plus loin, malgré les prières des bannis ioniens, qui la pressaient d’arriver sur les côtes d’Asie. Des envoyés de Samos furent plus heureux. Léotychidas fit route pour cette île, et, voyant les Perses fuir à son approche, il les suivit jusqu’à Mycale. Ceux qui montaient la flotte perse descendirent à terre pour se mettre sous la protection d’une armée de 60.000 hommes que Xerxès, encore à Sardes, tenait dans l’Ionie. Les Grecs débarquèrent à leur tour et virent avec étonnement une grande confusion chez les Perses qui, par crainte d’une trahison, désarmaient les Samiens et éloignaient les Milésiens du camp sous prétexte de leur faire garder les passages des montagnes. Au moment du combat, le bruit se répandit que Mardonius venait d’être vaincu en Béotie. Cette nouvelle accrut l’audace et la confiance des Grecs ; le camp fut forcé, les généraux perses périrent, et avec eux presque tous leurs soldats. C’était la dernière armée de Xerxès. Les Athéniens, que commandait Xanthippe, père de Périclès, eurent la principale gloire de cette journée ; car ils vainquirent presque seuls, les Lacédémoniens s’étant égarés en voulant tourner l’ennemi. Ainsi, non seulement les Grecs avaient repoussé la guerre
de leurs foyers, mais ils la portaient déjà chez leur ennemi. Cette dernière
victoire équivalait à la conquête de la mer Égée. En moins d’un an, ils
avaient battu les Perses à Salamine, à Platée, à Mycale, et, d’attaqués
qu’ils avaient été, étaient devenus agresseurs et conquérants. Qui eût cru,
quelques mois auparavant, que la grandeur de l’Asie trouverait en Grèce son
tombeau ? Toutes les multitudes de l’Orient ne purent prévaloir contre
cette petite nation qui avait en elle le double génie de la civilisation et
de la liberté. C’était aussi un monde jeune qui l’emportait sur un monde
vieillissant et épuisé. Les Grecs le sentaient eux-mêmes. La divinité qu’ils
invoquèrent à Mycale, leur cri de ralliement., fut Hébé, Aussi quelle longue et légitime ivresse ! Cette
grande épopée des guerres Médiques eut son inimitable historien dans
Hérodote, et son poète dans Eschyle : Hérodote, qui lut des fragments de son
histoire aux grands jeux de réalisé. Elle veut tout savoir et interroge. ATOSSA. Amis, où dit-on qu’est située cette ville d’Athènes ? LE CHŒUR. Bien loin vers le couchant, aux lieux où disparaît le soleil, notre puissant maître. ATOSSA. Et c’est la ville que mon fils a voulu conquérir ? LE CHŒUR. Oui, car près elle,
toute ATOSSA. Ont-ils donc chez eux d’innombrables guerriers ? LE CHŒUR. Assez nombreux pour avoir fait déjà bien du mal aux Perses. ATOSSA. Et possèdent-ils d’abondantes richesses ? LE CHŒUR. Ils ont une source d’argent, trésor que leur fournit la terre. ATOSSA. Quelles armes brillent dans leurs mains ? Est-ce l’arc et les flèches ? LE CHŒUR. Non, ils combattent de près avec la lance, et se couvrent du bouclier. ATOSSA. Quel monarque les conduit et gouverne leur armée ? LE CHŒUR. Nul homme ne les a pour esclaves ni pour sujets. ATOSSA. Comment donc résisteraient-ils à l’attaque de nos guerriers ? LE CHŒUR. Comme ils ont fait jadis pour cette immense, cette belle armée de Darius : ils l’ont détruite. ATOSSA. Quelles terribles choses tu dis là pour les mères de ceux qui sont partis ! Et plus loin l’ombre de Darius parait, et les vieillards lui demandent comment ils devront se conduire désormais pour le bonheur du peuple des Perses. Gardez-vous, leur répond Darius, d’attaquer jamais le pays des Grecs, votre armée fût-elle encore plus nombreuse que celle de Xerxès, car la terre elle-même combat pour eux… Elle tue par la faim nos armées trop nombreuses. Ailleurs, c’est l’Asie abattue qui tombe lourdement sur le genou, et le chœur qui s’écrie : Ô Jupiter ! tu viens donc de la détruire cette armée des Perses, superbe, innombrable : tu as plongé dans les ténèbres du deuil les villes de Suse et d’Ecbatane. Que de femmes déchirent leurs voiles et arrosent leur sein de larmes amères ! … L’Asie entière gémit dépeuplée ! Xerxès a tout emmené. Hélas ! Xerxès a tout perdu, hélas ! Xerxès, sur de frêles navires, a tout livré, l’imprudent, à la merci des flots. Et plus loin : Chez les nations de l’Asie, plus d’obéissance, plus de tributs, plus de fronts prosternés dans la poussière, devant la majesté souveraine. La langue des hommes est libre comme leur pensée. Ces mots du poète disaient aux spectateurs que deux choses, qu’ils aimaient autant que leur délivrance, avaient été gagnées par leur victoire : la forme républicaine l’avait emporté sur la royauté orientale, et la liberté de l’esprit sur son asservissement. Enfin Xerxès arrivait sur la scène, ses habits magnifiques en lambeaux; et, comme pour les anciens la vengeance était un fruit délicieux, les Grecs savouraient ces humiliations du grand roi, alternant avec le choeur ses gémissements. XERXÈS. Fonds en larmes. LE CHŒUR. Mes yeux en sont baignés. XERXÈS. Réponds à mes cris par tes cris. LE CHŒUR. Hélas ! hélas! hélas ! XERXÈS. Retourne en gémissant à ton foyer. LE CHŒUR. Hélas ! hélas ! ô Perse ! Perse ! pousse un cri de douleur ! XERXÈS. Oui, que le cri de douleur remplisse la ville. LE CHŒUR. Poussons des sanglots! des sanglots! encore des sanglots ! XERXÈS. Hélas ! hélas ! notre flotte ; hélas ! hélas ! nos vaisseaux ont péri ! LE CHŒUR. Je t’accompagnerai avec de tristes lamentations. Et le chœur se retirait en poussant des cris déchirants qu’étouffait enfin le bruit des applaudissements des Athéniens, spectateurs radieux du drame qu’ils avaient joué naguère sur les flots sonores de Salamine. |
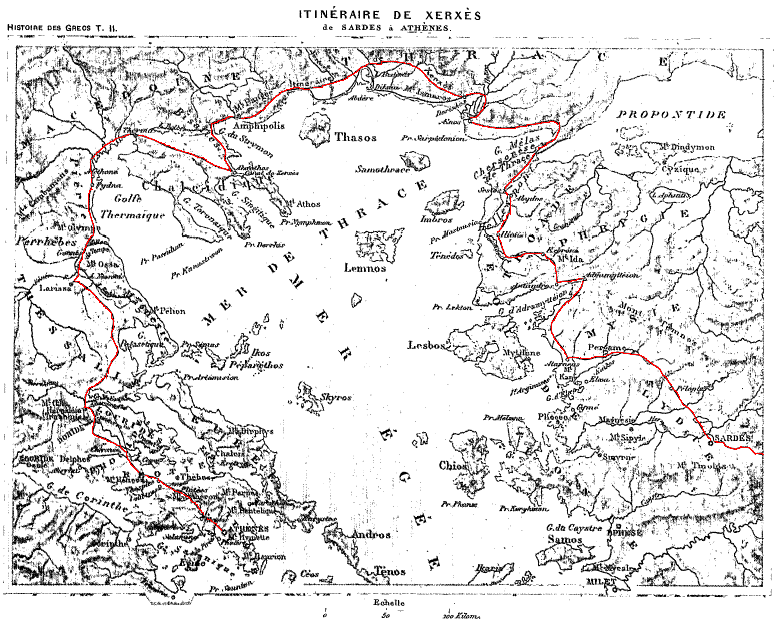
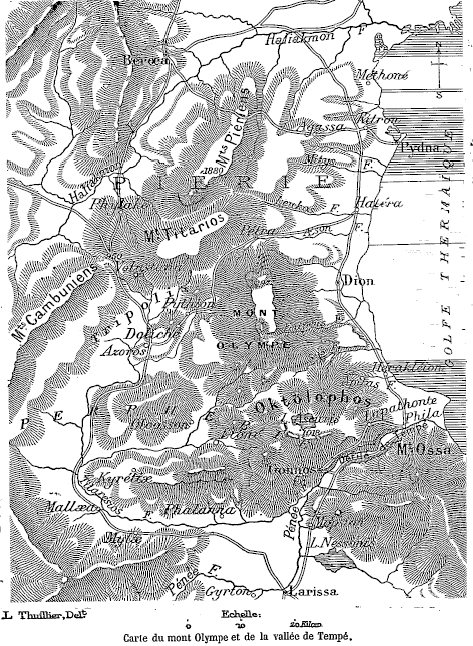 L’oracle de Delphes, consulté par les Athéniens, n’avait
cependant rendu que d’obscures et terribles réponses :
L’oracle de Delphes, consulté par les Athéniens, n’avait
cependant rendu que d’obscures et terribles réponses :