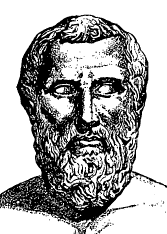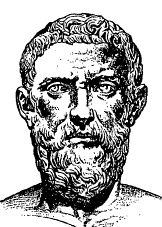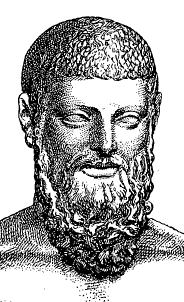HISTOIRE DES GRECS
DEUXIÈME PÉRIODE — DE L’INVASION DORIENNE AUX GUERRES MÉDIQUES (1104-490) — ISOLEMENT DES ÉTATS - RÉVOLUTIONS INTÉRIEURES - COLONIES.
Chapitre XIII — Grandeur et civilisation des colonies grecques.
I. Rapports de la colonie avec sa métropole ; prospérité commerciale des Grecs asiatiquesPour les rapports de la colonie avec la métropole, Ces rapports varièrent selon les temps et les circonstances de la fondation du nouvel État. Les premières colonies, chassées le plus souvent par une race étrangère et conquérante ou par une faction ennemie, brisent complètement avec leur métropole, qui les perd de vue et les oublie. Plus tard, c’est ordinairement sur la foi d’un oracle que la colonie s’éloigne. Elle se sépare de sa mère en paix et bonne amitié, et lui reste attachée par des liens de religion et de piété filiale ; elle emporte ses divinités, son culte, son gouvernement, souvent sou nom, quelquefois ses prêtres et un symbole d’éternelle union, comme ce feu sacré que les Ioniens prirent au Prytanée d’Athènes, et qu’il n’était permis de rallumer que sur l’autel de la mère patrie. Si le danger la presse, elle lui demande un devin, les prêtres de ses dieux, ou des secours de troupes et de vaisseaux. Quand elle-même fondait une nouvelle cité, c’était la mère patrie qui, d’ordinaire, donnait un chef aux émigrants. Aux fêtes de celle-ci, la colonie envoyait des députations et des offrandes; aux siennes, elle réservait une place d’honneur pour les citoyens de la métropole, et c’étaient eux qui goûtaient les premiers a la chair des victimes. Plus tard encore, après les guerres Médiques, l’État revendiqua des droits rigoureux sur les colonies qu’il envoyait. Il ne se contenta plus des antiques rapports de bienveillance réciproque ; il ne considéra les nouvelles cités que comme des postes militaires et commerciaux qui devaient étendre son commerce et assurer sa puissance. C’est ce mode de colonisation qu’adoptèrent Athènes au siècle de Périclès, Carthage, et plus sévèrement encore la grande cité qui devait être l’héritière de tout l’ancien monde, Rome. Les rapports des colonies entre elles, lorsqu’elles étaient nées l’une de l’autre, étaient les mêmes que ceux de la colonie avec la métropole : ainsi Épidamne était obligée de rendre à Corcyre les mêmes devoirs que Corcyre devait à Corinthe. Entre colonies d’une parenté plus éloignée, le caractère des relations dépendait de la plus ou moins grande affinité de race. Lorsque cette affinité était fort étroite, elle donnait naissance à des confédérations assez semblables aux amphictyonies. Mais ces confédérations ne se retrouvent que chez les colonies asiatiques, ce qui semble prouver qu’à l’époque oit celles-ci se fondèrent, l’institution amphictyonique était dans toute sa vigueur, et qu’elle perdit plus tard de son influence, puisque les colonies nouvelles n’en emportèrent pas le souvenir. Les onze villes éoliennes avaient probablement un temple commun, celui d’Apollon Grynéen. Les douze cités ioniennes envoyaient des députés à des époques périodiques, non seulement pour des jeux et des fêtes, mais aussi pour discuter les intérêts de la nation au panionion, autour du temple de Neptune qui s’élevait sur le mont Mycale, en face de la mer de Samos. Toutefois, même chez les Ioniens, le lien fut toujours plus religieux que politique ; et ce n’est qu’aux rares moments où toute l’Ionie se trouva menacée que ses villes opposèrent à un péril commun une commune défense. Les Doriens avaient une confédération analogue, plus religieuse aussi que politique, dont le centre était le temple d’Apollon Triopios ; mais ils n’y admettaient que six villes : Lindos, Ialysos, Camiros dans l’île de Rhodes, Halicarnasse et Cnide sur la côte, Cos dans l’île du même nom. C’est l’hexapole dorienne, qui ne fut plus qu’une pentapole, quand Halicarnasse en eut été exclue pour avoir violé les lois de l’association. A partir de 408, Lindos, Camiros et Ialysos se fondirent en un seul État, dont Rhodes fut la capitale. Les colonies asiatiques précédèrent leurs métropoles dans
les voies de la civilisation. On trouverait à ce phénomène plusieurs raisons
: la première, c’est que les colons ne tombèrent pas au milieu de barbares qu’il
fallut vaincre, puis exterminer ou contenir par une législation sévère, mais
qu’ils arrivèrent parmi des peuples de même sang et de même langue qui couvraient
toute cette côte, et y avaient développé déjà la vie sociale. Organisés
militairement, comme il faut l’être quand on va chercher fortune au loin, les
nouveaux venus amenèrent de gré ou de force les indigènes à partager avec
eux. Il y eut, somme toute, peu de combats, et il se fit le prompt et
pacifique mélange des races qui est si favorable aux progrès de la
civilisation. Ensuite, tandis que Une autre cause d’émancipation intellectuelle, sur
laquelle nous insisterons bientôt, fut le voisinage et le contact de
civilisations qui allaient périr, mais qui étaient alors les plus avancées du
monde, dans Les cours d’eau descendus du massif montagneux de l’Asie
Mineure fertilisent sa côte occidentale, qui s’ouvre par mille ports sur une
mer semée d’îles nombreuses. Assises au pied de tous les promontoires, au débouché
de toutes les vallées, au fond de tous les golfes, les colonies grecques
étaient, par leur position même, invitées à porter sur leurs navires d’un
pays à l’autre les produits propres à chacun d’eux. Elles ne négligèrent pas
l’agriculture qui fait vivre, mais elles se livrèrent surtout au commerce qui
enrichit, à la navigation qui ouvre l’esprit à de nouvelles idées, comme elle
montre aux yeux de nouveaux aspects. Rivaux des Phéniciens, ils les chassèrent
de la mer Égée et de l’Euxin, et leurs nombreux vaisseaux allèrent échanger
partout la laine de Deux villes marchèrent à la tête des autres dans cette
voie, Phocée et Milet. Tandis que la première s’étendait vers l’occident,
explorait les côtes de l’Italie, de Ce commerce avait été d’abord aux mains des Phéniciens ;
Milet le leur enleva et borda ces côtes de plus de quatre-vingts comptoirs :
au sud, Sinope, vieille cité assyrienne, Trapézonte et Amisos, sur l’Euxin ;
Cyzique[2] et Proconnèse,
dans la mer à laquelle des îles de marbre ont valu le nom de Marmara ;
Abydos et Lampsaque, sur l’Hellespont, pour donner un refuge aux navires que
la violence du courant des Dardanelles entraîne ; au nord, Istros et
Tyras, dans le delta du Danube (Ister) et le liman du Dniester (Tyras) ;
Odessos et Olbia, près des embouchures de l’Hypanis
(le Boug) et
du Borysthène (le Dnieper), que les anciens
comparaient au Nil pour la pureté de ses eaux et la richesse de ses
rives ; sur les côtes inhospitalières de La prospérité commerciale des Grecs d’Asie atteint son
apogée au septième et au sixième siècle. En 704, les Samiens ne possédaient
pas une trirème, et avant 634, pas un vaisseau grec n’avait vu les côtes de
Libye ; deux générations plus lard, les Ioniens dominent sur la mer
Égée ; Corcyre et Corinthe, sur la nier d’Ionie; l’Italie méridionale
est devenue L’asservissement de l’Ionie par les Perses[3], les attaques incessantes des Sabelliens contre les Grecs italiotes, enfin les dangers de la mère patrie, menacée elle-même dans sa liberté, arrêtèrent ce brillant essor. Mais les heureux fruits que cette prospérité devait mûrir avaient été déjà cueillis. II. Influence des civilisations asiatiques sur le génie grecLa civilisation des peuples commerçants est plus rapide
que celle des peuples agriculteurs ou pasteurs, surtout si leurs navires et
leurs marchands touchent à des pays civilisés. Comme ils visitent un grand
nombre de contrées, ils recueillent partout ce qui leur semble propre à procurer
les jouissances d’une vie plus douce. En même temps qu’ils acquièrent la
richesse nécessaire pour encourager les arts, leur esprit s’ouvre et s’excite
par le spectacle de tant de choses, et leur curiosité se plait aux nouveautés
plus qu’elle ne les repousse. Or la jeune civilisation de Hérodote, Diodore et Pausanias veulent que tout, art et
religion[5], soit venu de l’Égypte
à Les Phéniciens, dont les navires visitaient toutes les
côtes de Une influence probablement plus grande fut celle de l’Assyrie
où de riches et puissantes monarchies s’étaient élevées. Il y eut là un foyer
de civilisation qui rayonna bien au delà des frontières de Route de mer, route de terre, toutes deux ont servi à cette transmission de l’influence orientale, et celle-ci est attestée par ce qu’on pourrait appeler l’éclairement successif des pays de langue hellénique. C’est sur les côtes de l’Asie-Mineure que paraît d’abord la lumière ; elle gagne les Cyclades, puis le continent, européen. Les poètes, les philosophes naissent à l’orient de la mer Égée ; les premières écoles d’art s’y fondent et les premiers temples s’y élèvent. Les Grecs ont donc reçu des artistes inconnus de l’Orient l’initiation première. Mais, comme ce personnage de la fable qui changeait en or ce qu’il avait touché, ils transformèrent tout ce qu’ils reçurent de l’étranger. Les lettres grecques, comme l’alphabet latin et celui des Étrusques, sont des caractères empruntés par les Phéniciens à l’Égypte, non seulement pour la forme, l’ordre de succession et la valeur, mais quelquefois pour le nom même, comme bêta pour beth, thêta pour tet. Mais si les Phéniciens ont donné l’écriture, ce sont les Grecs qui ont écrit[9]. Le plus ancien système métrique qu’on ait suivi dans l’Hellade,
celui d’Égine, avec ses divisions en talents, mines et oboles, est identique
au système babylonien et phénicien. Le mot mina (mna), unité du système, est même d’origine
chaldéenne[10].
De là vinrent encore la division duodécimale du jour, l’usage de la sphère
céleste et du gnomon qui sert à mesurer les heures par l’ombre que projette
un corps solide sur une surface plane. L’Égypte donna la géométrie pratique, Des trois modes de la musique grecque un est lydien, un autre phrygien. La flûte est de Phrygie, comme Hyagnis qui l’inventa, comme Marsyas, qui osa lutter, disaient les Grecs, avec Apollon ; Olympos était Mysien. Mais c’est en Grèce que la musique est devenue un procédé d’éducation et une institution sociale. Deux des trois ordres d’architecture existaient aux bords du Nil et de l’Euphrate avant de se montrer en Grèce. Champollion a trouvé des triglyphes et des colonnes doriques décorant l’entrée des tombeaux de Béni-Hassan, qui sont antérieurs de plusieurs siècles à l’usage des colonnes doriques en Grèce. MM. Layard et Botta ont trouvé la volute ionienne â Ninive, dans le palais de Sargon, qui est du huitième siècle[12]. Dans tout l’Orient, on a fait des statues, on a commencé l’art ; mais ce sont les Grecs qui ont réalisé la beauté. Avec une religion qui pesait d’un poids si léger sur les âmes, ils n’avaient pas l’idéal qui emporte l’esprit et le perd dans les régions de l’infini, ou l’abîme au pied d’idoles qui ne disent rien à l’esprit, parce qu’elles veulent trop lui dire. Ils n’eurent ni la forme parfois monstrueuse de l’art indien ou égyptien, qui montre surtout la force et n’impose que par la masse, ni la forme naïve et transparente de l’art chrétien, qui voudra surtout montrer l’âme. Sous l’inspiration d’un heureux génie et d’une nature adoucie et suave, ils achevèrent, en d’harmonieuses proportions, ce que les artistes de Ninive et de Memphis avaient commencé dans des proportions grandioses, mais sans grâce ni beauté. Ils eurent l’art libre et laïque, l’art humain par excellence; le plus parfait équilibre de la forme et. de la pensée. III. Les arts et la poésieL’Égypte et l’Assyrie avaient élevé des temples â leurs
divinités, des palais et des tombeaux de leurs rois. Chez les Grecs des temps
historiques, qui n’avaient plus de rois, l’art monumental ne fut d’abord qu’au
service des dieux ; c’est dans les derniers siècles seulement qu’on l’employa
à décorer les villes. En arrivant dans l’Hellade, la science architectonique
de l’Orient se modifia et s’ennoblit. Avec des procédés qui furent les mêmes,
le dessin général fut très différent, parce que les croyances et les
conditions sociales ne se ressemblaient pas. Rien ne rappelle moins les
édifices religieux de l’Égypte ou de l’Assyrie que le temple grec,
réalisation en pierre d’une idée simple : la demeure du dieu élevée
au-dessus de celles des hommes, mais d’un dieu. toujours visible par l’ouverture
de la cella ; qui veut, du fond
de son sanctuaire, voir son peuple et communier avec ses fidèles par les
sacrifices offerts à sa divinité. De nos jours les mots dorique et ionique
servent à désigner deux ordres d’architecture différents, l’un sévère, l’autre
plus élégant, quoique grave encore, qui se sont formés dans Trois autres temples de la côte d’Asie réunissaient à la
grâce de l’art ionique la grandeur et la majesté : à Magnésie du Méandre, le sanctuaire
d’Artémis Leucophryne, dont plusieurs débris sont au Louvre ; à Priène,
celui d’Athéna d’une date plus récente, et, sur le territoire de Milet, celui
d’Apollon Didyméen, le rival de l’Artémision d’Éphèse par la richesse de son
ornementation, par ses colonnes de Les Grecs, qui aimaient à mettre une histoire gracieuse à
l’origine de toute chose, contaient qu’une jeune fille de Corinthe, recevant
les adieux de sort fiancé, prêt à partir pour un long voyage, avait remarqué que
le profil de son amant était projeté en ombre sur la muraille par la lumière
d’une lampe. Pour garder ce cher souvenir, elle avait fixé l’image fugitive
en passant aussitôt un trait sur les contours ; le dessin était trouvé.
Aristote, qui ne se plait pas à ces sortes d’histoires, se rapprochait de la
vérité en disant que le premier peintre avait été Eukheir, un parent de ce
Dédale qui, pour les mythographes, représentait le génie de l’invention dans
les arts. Dédale connaissait l’Égypte, puisque son labyrinthe de Crète passait
pour avoir été une copie du labyrinthe égyptien. La vérité est que sur les
bords du Nil, comme sur ceux du Tigre et de l’Euphrate, les temples et les
tombeaux étaient couverts de peintures. Il n’y a donc point à s’étonner que
les premiers peintres de La sculpture devait atteindre la perfection en un pays, le seul qui ait jamais eu des institutions destinées à développer et, à fortifier le corps, où pour mieux juger des coups, pour mieux trouver les poses, les attitudes et les gestes nécessaires, les athlètes, les coureurs, les pugilistes, s’exerçaient nus dans le gymnase et combattaient nus dans la lice. Mais deux choses en arrêtèrent longtemps l’essor : l’imperfection des procédés techniques et le respect superstitieux des peuples pour les objets informes de leur adoration. Longtemps on n’eut pour représenter les dieux qu’un tronc d’arbre à peine dégrossi, une pierre brute, puis des plaques de fer ou de bronze rapportées et tenues réunies par des rivets, ce qui ne produisait que de disgracieuses images[15]. Au septième siècle, Théodoros de Samos, qui grava la fameuse émeraude jetée par Polycrate dans la mer, imagina la fonte en creux qui permit de donner au bronze toutes les formes. Un peu plus tard, Glaucos de Chios inventa la soudure du fer, en se servant de métaux plus fusibles que ceux qu’on voulait assembler (Hérodote, I, 25). Enfin, vers le milieu du sixième siècle, deux artistes crétois, Dipœnos et Scyllis, établis à Sicyone, firent prévaloir pour la statuaire l’emploi du marbre. Une invention très modeste et cependant importante assura aux temples une plus longue durée : un architecte de Naxos imagina de protéger les joints de la toiture par des tuiles de marbre qui empêchèrent les dégradations produites par l’eau des pluies. Le service fut jugé assez grand pour que l’artiste méritât une statue. L’art fut alors armé de ses moyens d’action ; il lui restait à s’affranchir des exigences théocratiques pour être libre dans ses conceptions. La piété défendait de changer, même pour les embellir, les images des dieux qui gardaient leurs formes roides et ingrates. Mais l’art laïque, celui qui reproduisait, pour les cités, les traits des vainqueurs aux jeux nationaux, réagit sur l’art religieux, qui devint peu â peu moins sévère. Tout en gardant pour certaines cérémonies les représentations informes des vieilles divinités, les fidèles permirent qu’on donnât aussi la grâce et la beauté aux héros fils des hommes, même aux dieux. Alors des écoles se formèrent celle de Naxos, entre autres, qui du septième au quatrième siècle fut très florissante, et de véritables artistes parurent. Bathyclès, de Magnésie du Méandre, fit pour le temple d’Amyclées, pris de Sparte, un ouvrage considérable où la vieille et informe image d’Apollon eut autour d’elle les statues des Saisons et des Grâces ; le trône sur lequel elle était debout avait été décoré de bas-reliefs qui représentaient l’histoire des dieux et des héros. Avant Phidias, Athènes eut aussi une école de statuaires, que Quintilien compare aux étrusques primitifs (XII, 10, 7). A Sicyone, Kanachos fit une Vénus d’or et d’ivoire, et un Apollon dont le musée Britannique et le Louvre possèdent une répétition en bronze. Cicéron (Brutus, 98) reprochait à ce maître de ne s’être pas encore affranchi de la raideur et de l’immobilité archaïques. Sort Apollon a cependant plus de souplesse dans les membres, plus de finesse dans le visage qu’on n’en trouve dans l’Apollon de Téméa[16], Mais, à Argos, à Égine, la vie vint enfin animer le marbre et le bronze. Agéladas d’Argos, né peut-être en 540, sculpta plusieurs
statues de vainqueurs aux jeux olympiques, un Hercule Αλεξίxαxος,
ou Tutélaire, un Zeus pour les Messéniens de Naupacte. C’était un artiste
éminent, car il fut le maître de Phidias, de Myron et de Polyclète ; il
ouvre donc l’époque du grand art sculptural. Son contemporain, Onatas d’Égine,
fut célèbre pour ses statues de bronze et ses trophées des vainqueurs
olympiques, même pour un tableau peint dans le temple de Platée, consacré à Au milieu du sixième siècle, l’art avait donc cessé d’être
condamné à reproduire des formes invariables ; au lieu de l’imitation
servile, il eut la recherche de l’idéal, et le don de la liberté devint pour l’artiste
celui du génie, car il avait sous les yeux la plus belle race qui fût au
monde. La figure ionienne, dit Dion Chrysostome,
réunit tous les caractères de la beauté, et Hippocrate
déclare que le sang ionien était le plus pur de la Grèce[18]. Un fait montre
quelle influence le voisinage des cités asiatiques exerça sur le
développement des arts dans l’Hellade européenne: on ne trouve d’artistes que
sur la côte orientale ; La religion grecque avait remplacé les dieux de l’Orient, abstraits et symboliques comme Brahma et Ormuzd, ou matériels et grossiers comme Apis, par des êtres moraux et personnels. Cette transformation ouvrit un champ immense à la poésie. Tout naturellement l’épopée en sortit d’abord, mais une épopée où nulle part le merveilleux n’écrase l’homme. Cette poésie est fille de l’Ionie. Smyrne et Chios sont les deux villes qui revendiquent avec le plus de vraisemblance l’honneur d’avoir vu naître Homère. A la suite du chantre d’Achille parurent une foule de poètes. Les noms de vingt ou trente ont surnagé, mais à peu près rien de leurs œuvres. On les appelait cycliques, parce que leurs poèmes réunis formaient comme un ensemble complet de traditions sur l’âge héroïque. Ils avaient célébré les exploits des anciens héros, ou ceux des incidents de la guerre de Troie, auxquels le chantre d’Achille n’avait pas touché, et ramassé, comme dit Eschyle, les miettes du festin d’Homère. Les poètes épiques avaient célébré le passé héroïque et
religieux de La liste de ces précurseurs de Pindare est longue, mais il nous reste d’eux à peine quelques fragments. Terpandre, né à Lesbos, le pays où l’on disait que les vents et les flots avaient apporté la tête et la lyre d’Orphée, et où les rossignols jetaient, dans la nuit, leurs plus harmonieuses chansons, ajouta trois cordes à la lyre, qui d’abord n’en avait eu que quatre. Il avait été vainqueur au premier concours de chant établi à Sparte, vers 676, pour les fêtes d’Apollon carnéen, et les anciens le regardaient comme le législateur de l’art musical. Nous avons trois ou quatre fragments de ses poésies qui étaient des hymnes religieux[19]. Arion, de Méthymne, fut un autre chantre fameux. Il passait pour avoir inventé le dithyrambe, ou poème en l’honneur de Bacchus, et il chantait ses vers sur la cithare. Terpandre avait séduit les Spartiates ; Arion fit mieux, il charma les monstres marins. Du moins Hérodote raconte gravement qu’Arion fut jeté à la mer par des pirates, et qu’un dauphin, qu’il avait attiré près du navire par la douceur de ses accents, le sauva[20]. On lui attribue, probablement à tort, un fragment d’hymne à Neptune où il remercie le dieu et ses monstres bondissants : C’est vous qui m’avez pris sur vos dos inclinés et m’avez conduit vers la terre de Pélops, par un chemin que nulle voie ne sillonne. Les hommes perfides m’avaient jeté, du haut du navire, dans les flots soulevés. Les anciens croyaient à la puissance de la musique sur les bêtes et les hommes ; la fable d’Arion courut parmi eux pour en prouver l’efficacité ; et les navigateurs n’en doutèrent pas lorsqu’en doublant la pointe du Péloponnèse, ils virent, au pied du cap Ténare, l’image en bronze d’un homme sur un dauphin[21]. Dans la poétique Lesbos étaient encore nés : Alcée au plectre d’or, comme dit Horace, qui l’imita
souvent, et Sappho, avec lui la gloire de Mytilène et de Sappho, de quelques années plus jeune qu’Alcée, qui l’aima, fut-elle une vierge chaste, puis une respectable matrone, ou une courtisane avec les passions ardentes et les vices honteux que le soleil d’Ionie peut faire éclore ? S’est-elle précipitée du rocher de Leucade, par désespoir de l’abandon de Phaon ? Autant de questions où l’on se complaît, mais que nous n’avons pas à décider. Il nous suffira de dire qu’au sentiment de toute l’antiquité, Sappho fut un grand poète. Malheureusement elle est du nombre de ceux à qui nous n’avons rien à demander, pas même son ode à Vénus et ses vers à une femme aimée. Alcman était Lydien, mais vécut à Sparte, où il mérita, par l’énergie de ses vers, d’être fait citoyen. Tout en se félicitant d’avoir changé de patrie, il ne renia pas la ville qui avait été son berceau. Sardes, antique séjour de mes pères, si j’avais été élevé chez toi, je serais devenu prêtre de Cybèle et, vêtu d’habits tissus d’or, je frapperais les tambours sacrés. Aujourd’hui mon nom est Alcman et je suis citoyen de Lacédémone ; j’ai appris à connaître les Muses grecques et elles m’ont fait plus grand que les rois Dascylès et Gygès. Stésichore d’Himère, contemporain d’Alcée et de Sappho, a droit à plus d’attention de notre part. En introduisant dans ses poèmes lyriques l’épode, où il célébrait les héros, protecteurs des cités, il prépara une innovation importante, la récitation d’une légende par un personnage distinct du choeur, en un mot Faction, le drame ajouté au chant. La tragédie était là en germe. Quintilien[24] a dit de lui que chantre de grandes guerres et de chefs illustres, il avait soutenu avec la lyre le fardeau de l’épopée. S’il avait su garder la juste mesure, nul poète n’eût approché plus près d’Homère. Il nous reste de lui trop peu de ses vers, pour que nous puissions vérifier l’exactitude de l’éloge ou de la critique. Croyons ce que les anciens nous disent de lui. Horace, qui a souvent la dent dure, l’appelle le disciple des muses sévères[25].
La muse nouvelle se rapprochait de l’épopée lorsque, avec les poètes lyriques, elle chantait les héros ; elle fut l’élégie quand elle exprima des sentiments plus personnels. Callinos d’Éphèse, qui inventa le vers élégiaque, s’en servit, comme Tyrtée, pour des chants guerriers ; après lui, Mimnerme de Smyrne ou de Colophon l’employa pour l’expression de la douleur et du plaisir. Un contemporain de Callinos et de Tyrtée, Archiloque de Paros, trouva l’ïambe vers 680, et le fit servir à ses cruelles satires. Malgré sa mauvaise langue et ses vices, même malgré sa défaillance sur le champ de bataille où, salas en rougir, il abandonna son bouclier, les Grecs, gagnés par ses beaux vers, le mirent à côté de leur poète favori[26] ; ils avaient l’ivresse de la poésie et l’adoration des dons de l’intelligence. L’Éphésien Hipponax hérita de la verve et des colères d’Archiloque. Le sixième siècle finit par les poètes qu’on appela gnomiques, ou les diseurs de sentences, de prologues et d’apologues. tels que Phocylide de Milet, Solon d’Athènes, Théognis, le poète aristocratique de Mégare, et Ésope, né sur les côtes de Thrace, mais qui vécut à Samos. Ces poètes marquent la tendance nouvelle de l’esprit grec vers l’observation et l’abstraction philosophiques. C’est à peine si les sentences très morales de Phocylide ont quelques traces de poésie. Un pas de plus dans cette voie, et la prose écrite, libre de tout rythme, de toute servitude, naîtra : la langue des hommes après celle des dieux.
Anacréon de Téos, qui, ne sachant pas vieillir, mêlait ses cheveux blancs aux tresses blondes des jeunes filles, comme le lys se marie à la rose[27] ; Simonide de Céos, le rival de Pindare et le familier du Pisistratide Hipparque qui fait excuser son usurpation par son culte pour les lettres ; Bacchylide, son neveu, poète élégant et pur, qu’Horace a aussi quelquefois imité[28] et dont nos désespérés devraient répéter certains vers, ceux-ci, par exemple : Il n’est dans ce monde qu’une route qui conduise au bonheur, c’est de ne pas permettre que notre âme s’affaisse sous l’excès de la souffrance, et qu’elle se laisse abattre par les malheurs dont notre vie est assiégée. Ces poètes ne sont pas morts tout entiers, bien qu’un petit nombre de leurs vers aient été sauvés ; mais s’ils intéressent l’histoire littéraire, ils ne donnent rien à l’histoire politique et nous passons devant eux en les saluant[29]. Ainsi toute la sève poétique de cette époque coule et s’épand sur les côtes de l’Asie et dans les îles. Les colonies de Sicile n’ont à citer que Stésichore, et l’inventeur de la comédie, Épicharme, qui, né à Cos, vécut à Syracuse. Sur cette liste d’honneur on pourrait inscrire encore Hésiode, que d’anciens auteurs font naître à Cymé en Éolide, d’où son père vint s’établir dans l’Ascra béotienne. Mais qu’est le poète béotien à côté du divin aveugle que Smyrne et Chios se disputent ! Les colonies asiatiques avaient donc reçu tous les dons des muses : l’épopée, l’élégie, la satire, la fable et la musique, compagne inséparable de la poésie, qu’elle discipline au rythme et à la mesure. Que leur manquait-il en poésie ? Le drame, une des gloires réservées à Athènes, et dont les éléments avaient été préparés par le culte des héros, la religion des morts et la croyance à la vertu de l’expiation. Pendant que les colonies brillaient de l’éclat jeté sur elles par ceux qui ne sont plus pour nous que de glorieux mutilés, La mère patrie avait eu seulement trois poètes, Tyrtée, Solon et Théognis, quatre si nous faisons rentrer dans cette période Pindare, qui y appartient par la nature de son génie et qui, par son âge, est contemporain d’une autre école, celle des grands tragiques d’Athènes. Le temps, qui a maltraité tous ses rivaux, lui a été plus favorable et nous gardons assez de ses œuvres pour lui assigner nue place à part. Ses vers lui ont valu, durant sa vie, la gloire avec la fortune et l’honneur inusité d’un siège dans le temple d’Apollon[30]. Après sa mort, sa popularité s’est continuée jusque parmi nous, qui ne le comprenons pas toujours, mais qui respectons le jugement que les anciens ont porté sur lui[31]. Ce fut, un homme heureux. Aussi aima-t-il son temps, sa religion, les assemblées des vieillards qui, dans l’État, règlent tout paisiblement, même ceux qu’Athènes appelait les tyrans, et que lui nomme les ordonnateurs des cités. Sa pensée est avec les dieux, dont il accepte toutes les légendes, excepté celles où ils ne paraissent pas à leur avantage ; elle est aussi avec les rois, dont la puissance lui semble bonne pour contenir la foule populaire. Il est croyant et il est partisan du pouvoir monarchique et de celui des grands. Ébranler une cité, dit-il avec vérité (Pyth., IV, ad fin), est chose facile, même pour les plus misérables, mais la rasseoir sur des bases solides est un rude labeur. Aussi ses affections étaient pour Lacédémone, et il parlait le dialecte dorique. Nous devons noter ce double caractère de Pindare, qui le fait plus vieux que son âge ; car, s’il a vécu, comme on le croit, de 522 à 442, il a vu la poésie commencer le divorce avec l’ancienne mythologie et les gouvernements libres remplacer ceux des Eupatrides. Par suite des relations, de jour en jour plus fréquentes,
avec l’Égypte, l’usage du papyrus s’étend; l’écriture y trouve une matière
commode, et les ouvrages en prose qu’il est plus difficile de confier à la
mémoire que des vers qui se chantent, vont se multiplier. Les premiers
prosateurs sortent encore des colonies. Phérécyde de Syros[32] écrit, vers 550,
une théogonie, le premier livre en prose dont il subsiste quelques fragments.
Cadmos de Milet rédige l’histoire de sa patrie; Hécatée, son compatriote
(510-490), Hellanicos de Mytilène, Phérécyde de Léros, précèdent Hérodote,
qui, né vers 484, allait, dans les guerres Médiques, écrire ou plutôt chanter
le triomphe de IV. La philosophieCette activité d’esprit, qui poussait les Grecs asiatiques dans toutes les voies de l’art et de la pensée, devait les conduire à la recherche des grands problèmes de la nature de l’homme, de Dieu et du monde, que l’esprit humain se pose toujours et qu’il essaye de résoudre par les seules lumières de sa raison, quand il ne se contente plus des solutions que lui offre la religion populaire. Cette recherche, cette étude, s’appelle la philosophie, et l’Asie Mineure fut encore son berceau. A ses premiers pas, la philosophie apparaît enveloppée des
liens de la religion et de la poésie; il n’en pouvait être autrement. Mais,
au sixième siècle, la religion perdait déjà de son crédit auprès de quelques
hommes qui prétendaient regarder au fond des choses. Le besoin de se
représenter La foule eut d’autant plus de dévotion à ces dieux obscènes qu’ils légitimaient par leur exemple ses désordres. Mais ceux qui plaçaient plus haut leur esprit et leur cœur cherchèrent par eux-mêmes, au-dessus de ces fables, la vérité obscurcie. Ce premier effort de l’esprit ne consista d’abord qu’en réflexions confuses sur l’homme et la nature, avec une propension singulièrement téméraire à créer des conjectures et des systèmes qui embrassaient le monde entier. A son début, la philosophie veut être la science universelle.
Quelques-uns de ces philosophes furent appelés les sages ; ceux-là s’occupaient surtout de morale pratique. On varie sur leur nombre comme sur leurs noms ; les uns en nommaient sept, d’autres dix. C’était une légende par laquelle les Grecs marquait les débuts de l’observation morale. Thalès de Milet, Bias de Priène, Pittacos de Mytilène et Solon d’Athènes étaient les seuls qu’on reconnût généralement. On leur adjoignait d’ordinaire Chilon de Sparte, Cléobule de Lindos et Périandre de Corinthe, qui fut pourtant un cruel tyran. On a conservé quelques-unes de leurs maximes, que Platon, dans son Protagoras, appelle les prémices de la sagesse grecque : Connais-toi toi-même — Rien de trop[33] — L’infortune te suit de près ; mais plus malheureux est celui qui ne sait pas supporter le malheur — Écoute beaucoup et parle peu - Qui donne la sagesse ? L’expérience — La vraie liberté, c’est une conscience pure. — Et encore le grand précepte : Ne fais pas toi-même ce qui te déplaît dans les autres. — Bias, qui mettait les seuls biens dans l’intelligence, disait, sortant nu de sa ville natale prise par l’ennemi : J’emporte tout avec moi. Le temple de Latone, à Délos, portait ces mots de Théognis : Ce qu’il y a de plus beau, c’est la justice.
Pythagore enseignait que les dieux avaient fait à l’homme deux magnifiques présents : la vérité et la bienfaisance ; et il aimait à répéter deux salutaires maximes : Garde la mesure ; c’est le grand conseil de la modération en tout, et : Respecte-toi toi-même ; ce qui veut dire : honore l’intelligence qui a été mise en toi, en te montrant digne du don que tu as reçu. Kant a fait de ce sentiment un des fondements de la morale, et il a eu raison de le faire. Dans les Vers dorés qu’on a attribués à Pythagore et qui, du moins, sont de son école, on lit une excellente règle de perfectionnement : Ne t’abandonne pas au sommeil avant d’avoir examiné par trois fois ce que tu as fait dans ta journée. Demande-toi : Quelle faute ai-je commise ? A quel devoir ai-je manqué ? Interroge-toi ainsi sur chacune de tes actions. C’est le moyen d’arriver à la vérité et au bonheur. Et ailleurs : Plus que devant tout autre rougis devant toi-même. — Honore ton père et ta mère, et choisis pour ton ami celui qui sera le meilleur par la vertu. Peut-être était-elle d’eux aussi cette inscription gravée
sur la porte du temple de Delphes : Tu es,
qui semble un écho de
Ces sages donnaient une autre preuve de sagesse. Elle est de Bias cette maxime peu métaphysique, mais éloquente dans sa concision : Au sujet des dieux, dis : Il y a des dieux. Vingt-cinq siècles ne nous en ont pas appris davantage. Le fondateur de la première école de philosophie grecque,
celle. d’Ionie, fut Thalès de Milet, né vers 640 d’une famille originaire de Les découvertes mathématiques de Thalès sont bien modestes, mais elles ouvraient une route nouvelle. Le génie grec s’y engagea, et, séparant peu à peu la géométrie de la métaphysique qui d’abord l’enveloppait, il s’efforcera de substituer à l’observation des phénomènes la recherche des lois, qui affranchira l’esprit humain des entraves de la théologie. Une grande chose venait donc de se passer à Milet : l’avènement de la science mathématique, qui sera l’auxiliaire puissant des autres sciences, quand celles-ci seront nées. Tout en devançant son temps, Thalès y tenait trop pour ne
pas agiter, lui aussi, la question de l’origine de la vie, qui est restée, en
dehors des religions, une énigme indéchiffrable. Nous savons maintenant que
tout être vivant vient d’un être vivant et que la vie est une propriété que
ne possède pas la matière. Mais l’homme, et c’est son honneur, ne se résigne
pas à ignorer. Sur ce point, Thalès rompit avec le monde légendaire ; il
vit des forces naturelles là où Homère et Hésiode voyaient des dieux.
Quelques observations fort simples sur l’humidité et la croyance générale à l’existence
du fleuve Océan autour de la terre, furent, selon Aristote, les éléments dont
le chef de l’École ionienne composa son système du monde. L’eau fut pour lui,
comme elle l’avait été dans les cosmogonies orientales, le principe des
choses, parce que, sans forme par elle-même, elle peut les prendre toutes. Tout en vient, disait-il, et
tout y retourne. Mais si Thalès déterminait le principe composant, il n’en séparait pas le pouvoir formateur. Physicien, il n’osa s’élever au-dessus dit monde matériel pour trouver Dieu. Il crut que l’univers était un organisme vivant, et les dieux furent pour lui les forces mêmes de la nature, les causes qui produisent les phénomènes. Tout est plein de dieux, disait-il[37]. Il était naturel qu’après cette philosophie qui voyait le cosmos par les yeux du corps, il en vint une qui ne voulût le saisir que par les yeux de l’esprit. Les Grecs avaient trop de bon sens pour ne pas regarder autour d’eux dans le monde physique, et ils étaient de trop grands raisonneurs pour ne pas subordonner leurs observations à la dialectique. Avec Anaximandre, la métaphysique commença. Ce philosophe, le compatriote et l’ami de Thalès, qui. le premier en Grèce, construisit un gnomon, ou cadran solaire, une sphère, une mappemonde, et calcula l’inclinaison de l’écliptique[38], plaça en tête de son système, dans son livre Περί φύσεως, l’axiome que rien ne vient de rien, et remplaça l’élément primitif de Thalès par un principe infini, éternel, dont l’essence était de produire, en vertu de sa seule force, la foule infinie des phénomènes. A un principe physique il substituait donc un principe métaphysique, et le raisonnement pur à l’observation, qui pourtant l’avait d’abord si bien servi. Anaximène, peut-être élève d’Anaximandre[39], rentra dans les voies de Thalès; seulement, à l’eau, il préféra l’air qui enveloppe la terre et semble la source de toute vie : raréfié, il devient le feu ; condensé, il forme les nuages, l’eau, la terre et les pierres. Héraclite d’Éphèse, qui florissait vers 500, prit un autre agent primordial, le feu, et nia l’existence d’un être suprasensible ; mais il conçut la remarquable idée de la constance des lois générales, malgré la variété infinie des formes : πάντα χωρεϊ, ούδέν μένει, tout se meut, rien ne demeure. Les variations de la matière étaient pour lui des changements temporaires, un perpétuel devenir, comme dira Hegel, un écoulement sans fin, sous des formes changeantes, comme penseront les évolutionnistes[40]. Génération et destruction ne signifiaient pas, pour Héraclite, autre chose qu’union et séparation ; et l’ordre de la nature était l’équilibre de forces contraires. La science moderne croit avoir révélé deux lois fondamentales : la conservation de la matière et la conservation de l’énergie. Il semble qu’on pourrait, avec de la complaisance , trouver ces idées en germe dans le mouvement perpétuel d’Héraclite[41]. Le philosophe d’Éphèse refusa, dit-on, de donner des lois à son pays, ce qui a fait représenter comme un solitaire misanthrope et désolé le penseur opiniâtre qui ne voulait point être détourné de ses méditations profondes par le souci importun d’intérêts transitoires, et le fier génie qui osait déjà dire : Ils prient des statues, comme si l’on parlait à des pierres ; ou encore : Jupiter s’amuse et le monde se fait. Il ne mettait pas de différence entre la substance des dieux et celle des hommes ; l’humanité lui semblait faite de matière divine : Hésiode l’avait déjà dit ; mais, pour Héraclite, le divin était l’élévation de la pensée au-dessus des sens. Cinquante ans plus tard, Cependant ce ne fut point par leurs seuls écrivains et par leurs artistes que les Grecs furent les initiateurs de la civilisation. En soupçonnant les premiers que l’univers est gouverné par des lois, ils ont préparé quelques-unes de nos sciences. Nous continuons d’admirer les travaux d’Aristote sur l’Histoire Naturelle, et les Éléments d’Euclide, qui fut presque son contemporain, forment encore le fond de notre enseignement géométrique[43]. Les Grecs avaient donc essayé de résoudre le grand problème de la philosophie naturelle, la constitution de la matière, dont la solution n’est pas encore trouvée. Les fluides impondérables n’ont fait que passer: l’éther des physiciens, l’atome des chimistes, l’unité de la matière, sont des hypothèses qui auront peut-être le sort de tant d’autres : vérité aujourd’hui, erreur demain. Déjà ne prétend-on pas tout expliquer par un nouveau venu, le mouvement, qui est aussi très ancien, puisqu’on peut le faire descendre d’Héraclite et que Descartes disait : Donnez-moi de la matière et du mouvement, et je referai le monde. Il est un problème encore plus difficile, celui dont la métaphysique s’occupe : la recherche du principe des choses. Anaximandre, on vient de le voir, l’avait abordé. L’école d’Élée et celle de Pythagore essayeront, de le résoudre, mais ce sera plus d’un siècle après Thalès, qu’au témoignage d’Aristote[44], Anaxagore de Clazomène, né vers 500, dégagera clairement, φανερώς, de la matière la cause première, ou le Dieu ordonnateur du monde, et méritera d’être appelé, pour ce sublime effort, ό Νούς, l’Intelligence (v. chap. XXII). L’école éléatique, qui prit son nom de la ville italienne d’Élée, fondée par les Phocéens, opposa au multiple des physiciens de l’Ionie, pour l’explication du monde, le principe de l’unité. Xénophane de Colophon y arriva vers 536, et Parménide y naquit peu de temps après. Leur dialectique puissante les détournant de l’observation extérieure pour ne leur laisser écouter que les révélations de ce qu’ils croyaient être la raison pure, devint l’arme d’une école austère dont la tendance fut de tout absorber en un être sans commencement ni fin ; infini dans l’espace comme dans le temps, de sorte qu’il n’y avait ni espace ni temps, et que l’être et le tout étaient identiques ; immuable, de sorte qu’il n’y avait ni changements, ni mouvements ; toujours identique à lui-même, de sorte qu’il ne pouvait se produire rien de nouveau, ni acte ni pensée. Mais ce principe éternel, invariable, qui n’était pas un esprit et n’avait aucun des attributs reconnus au Dieu des religions monothéistes, se confondait avec les lois de l’univers. Une seule chose est vraie, disait audacieusement Parménide, la métaphysique ; le reste n’est que trompeuses apparences et illusions des sens. Ainsi la raison, non encore maîtresse d’elle-même à ce premier éveil, allait s’abîmer dans ses propres abstractions, et elle y entraînait avec elle les dieux du vulgaire. La religion des poètes était durement traitée par ces métaphysiciens : Si le bœuf et les lions savaient peindre, disait Xénophane, ils feraient des dieux semblables à eux-mêmes ; et il reprochait à Homère, à Hésiode d’avoir souvent célébré les actions criminelles des Olympiens[45]. Parménide était poète, comme Xénophane. Dans l’élan
idéaliste qui l’emporte au-dessus du monde des réalités, il jette sur son
austère philosophie tin voile de poésie, dont le panthéisme s’enveloppe
volontiers comme de la robe d’Isis. Tel est le fragment où il raconte le
voyage, en dehors des sentiers battus par les hommes,
qui le fait arriver dans la demeure éthérée dont Zénon d’Élée, son disciple, s’enfonça plus encore dans les sophismes de l’école d’Élée. Un jour, dit-on, qu’il niait le mouvement, un de ses pratique n’était auditeurs se leva et marcha. Cette démonstration pas pour prévaloir en lui sur les spéculations abstraites. L’esprit, enivré de sa puissance depuis qu’il avait secoué les vieilles manières de penser, perdait terre. Le philosophe fermait les yeux et se satisfaisait avec un cliquetis de paroles ; ce n’est pas une habitude absolument perdue.
Cependant, à cette école d’Élée, si étrange en ses
affirmations que le bon sens condamne, se rattachent de puissants esprits
qui, après elle, ont repris le problème de l’Être, devenu, suivant les temps
et les systèmes, Pythagore, né à Samos vers 570 ou un peu plus tôt, fonda
une autre école qui porta son nom. Il émigra en Italie, par haine, dit-on, du
tyran Polycrate, et se fixa à Crotone. On l’a fait, voyager en Orient, tout
au moins dans l’Égypte et la Babylonie[46], et l’on en
concluait que c’était de là qu’il avait rapporté ce goût pour les sciences
mathématiques qui caractérise son école. Il n’est pas nécessaire, qu’il ait
parcouru tant de pays pour y recueillir des idées. Nous savons que celles-ci voyagent
plus qu’on ne le pense et qu’on les retrouve souvent bien loin de leur point
de départ. comme ces veines de métaux précieux qui, des profondeurs de la
terre, viennent affleurer à la surface. Mais les relations entre Samos, l’Égypte
et
On peut, en effet, distinguer dans le pythagorisme deux parties : l’une qui a plus le caractère grec ; l’autre qui rappelle davantage l’Orient. On peut regarder comme appartenant à celle-ci les points suivants : le principe des choses est le feu central, ou le soleil, l’âme du monde, le dieu de vie. Les âmes des sphères qui gravitent autour du premier sont des dieux inférieurs; de ceux-ci émanent des dieux de troisième ordre. Les âmes des hommes et des animaux émanent aussi du feu central, rayons immortels de l’immortelle divinité; elles entrent dans le corps à la naissance et elles en sortent à la mort pour animer un corps nouveau, montant ou descendant, suivant leurs mérites, toute l’échelle des êtres. Voici le côté grec : l’âme est double, une partie d’elle-même est dans le cerveau, c’est le νοϋς ; l’autre est dans la poitrine, c’est le θυμός ; l’une raisonnable et immortelle, l’autre principe de la force et périssable. Les animaux n’ont que la dernière, l’homme les a toutes deux, mais il doit s’étudier à subordonner toujours celle-ci à celle-là. Ce qui est encore plus grec, ce sont les découvertes de Pythagore en géométrie, en astronomie et en musique, quoique sa théorie des nombres et sa doctrine de la métempsycose aient fait surtout sa réputation[48]. Cette théorie des nombres, si étrange d’abord, n’est cependant pas sans rapports avec les doctrines de l’école ionienne. Le point est en géométrie ce que l’unité est en arithmétique et la molécule dans la matière; ce sont les trois éléments générateurs, soumis aux mêmes lois. Mais, pour expliquer le monde physique, il faut deux choses, la matière et le principe organisateur. Cette idée, appliquée aux nombres, conduisit à considérer la monade comme le principe actif, la dyade comme le principe passif, et l’action du premier sur le second donna la triade ; d’où cette conséquence : l’impair est le type des choses parfaites, et le pair le type des choses imparfaites. Cette conclusion s’appliquait également à la religion, qui, pour Pythagore, repose sur le dogme de l’unité divine représentée par la monade primordiale, et aux sciences morales : le beau, le bien et le vrai, consistant dans l’harmonie qui résulte de l’unité, comme le laid résulte du défaut d’accord et d’harmonie, le mal et le faux du multiple et de l’indéterminé. Les successeurs de Pythagore allèrent plus loin ; ils dirent que les nombres, au lieu d’être le symbole numérique d’une vérité réelle, étaient les principes mêmes des choses[49]. Le nombre trois, type du parfait, quatre, le premier carré, dix, somme des quatre premiers nombres, eurent alors de grandes propriétés mystiques, surtout la triade qui deviendra la trinité platonicienne et alexandrine, dont Plotin et Proclus feront la loi universelle des êtres, et que les chrétiens appliqueront à leur dogme fondamental. De là bien des rêveries auxquelles s’abandonna l’école pythagoricienne, qui proclamait cependant une grande vérité, l’harmonie de l’univers, qu’elle n’appelait plus τόπάν, le tout, mais xόσμος, en latin mundus, l’ordre : mot et idée qui sont restés. Cette harmonie que Pythagore voyait au ciel où il croyait entendre la musique des sphères, il la voulait dans l’état par la concorde, dans la famille par l’affection, dans l’homme par la vertu. La théorie pythagoricienne de la métempsycose est une des plus curieusement imaginées pour résoudre l’insoluble question de l’existence par delà le tombeau, dissiper l’effroi que cause la destruction finale de notre être et donner à la vie une sanction morale. Après la mort, l’âme, selon ses mérites ou ses démérites, passait dans un corps nouveau placé plus haut ou plus bas dans l’échelle des êtres ; de sorte que l’univers vivant était le théâtre de migrations perpétuelles qui avaient pour terme suprême l’absorption en Dieu de l’âme arrivée à l’état de perfection. Aussi Pythagore prohibait d’une manière presque absolue les sacrifices sanglants sur les autels des dieux, et détournait ses disciples de l’usage habituel de la viande. Comme il avait purifié la notion de la divinité et de la vie, il purifia la morale, qui dépend toujours de cette double conception, et il arriva. sur certains points, à une élévation qui rappelle le christianisme. Il n’enseignait pas seulement la justice, qui lui semblait le principe de toute vertu, mais la tempérance, la chasteté et la pudeur. On pourrait voir aussi dans le fond de sa pensée le principe qui est devenu l’axiome de la science moderne : tout change ; rien ne se détruit. Sa doctrine a formé deux des hommes qui ont laissé le nom le plus pur, Archytas de Tarente et le Thébain Épaminondas, peut-être même Eschyle. Pythagore ne se borna point à de pures spéculations. Pour leur donner autorité et les répandre, il fonda un institut, sorte d’ordre monastique, formé de communautés, où un noviciat, à trois degrés, préparait les élèves à recevoir les révélations du maître. A l’aide de ce corps moitié sacerdotal et moitié politique, Pythagore voulait faire prédominer dans l’État l’empire de la sagesse et de la vertu, comme dans l’individu celui de la raison. La discipline et l’enthousiasme de ses élèves lui acquirent dans Crotone, à Locres, à Caulonia, à Tarente, à Métaponte, une autorité qui lui permit de faire dans ces villes une révolution morale et politique. Mais les principes de gouvernement aristocratique que ses doctrines renfermaient se développèrent; la secte s’empara des places, du pouvoir, et s’y montra probablement, comme toute corporation qui triomphe, fort peu tolérante. C’était une théocratie qui se fondait, c’est-à-dire quelque chose d’absolument contraire au génie grec. Elle provoqua une réaction du parti populaire, et, un jour qu’à la suite d’une victoire sur Sybaris, les pythagoriciens de Crotone, qui formaient le gouvernement, voulurent se réserver tout le butin, la révolution éclata. L’institut fut dispersé ; beaucoup de ses adeptes périrent (505) ; toutefois ses doctrines survécurent, et le paganisme mourant les combina avec celles de Platon, pour combattre le christianisme. Quant à Pythagore, il paraît être mort à Métaponte, quelque temps après la dispersion de son institut. Il avait été regardé, même par ses contemporains, comme un être presque surnaturel et en rapport avec les dieux. La légende qui se forma autour de son nom s’accrut, à chaque génération, de nouveaux récits merveilleux, comme celle des saints du moyen âge. On raconta que, lorsqu’il passa en Grèce, à Olympie, il montra aux assistants une cuisse d’or ou d’ivoire, et qu’il fascina de son regard un aigle qui fondait sur lui. On le fit descendre, de son vivant, aux Enfers, et, après sa mort, apparaître à ses amis. Il prophétisait l’avenir, commandait à la tempête et arrêtait soudain les maladies contagieuses. Des faits semblables se retrouvent aux époques les plus diverses, parce que ce qui manque le moins, ce n’est pas la froide raison, mais la crédulité publique et l’imagination populaire[50]. Toutes ces philosophies avaient un vice radical : elles étaient des conceptions a priori. Partant de l’inconnu pour arriver au connu, elles suivaient une marche contraire à la méthode scientifique, qui procède en sens inverse. Cependant, bien que les doctrines de Thalès, de Xénophane et de Pythagore ne fussent que les bégayements de la raison, trop soumise encore aux illusions de l’imagination, leurs trois écoles ouvraient une ère nouvelle pour l’esprit grec et pour l’esprit humain. Au polythéisme panthéistique d’Homère et d’Hésiode, à cette nature toute pétrie de divinité, dont les divers éléments et les mille aspects avaient été personnifiés en autant d’êtres divins, ils substituaient une matière réglée par des lois fixes, xόσμος, que l’intelligence de l’homme pouvait aller saisir. Ce monde divin, cet antique Protée aux formes changeantes, était chargé de liens et forcé de répondre sur lui-même ; c’était donc bien une révolution morale qui délivrait la pensée de ses chaînes. Le doute et l’examen succédaient à la foi aveugle et craintive, la recherche scientifique des causes à l’adoration servile des phénomènes, l’âge historique et rationaliste à l’âge légendaire et mythique. Aussi, écoutez Xénophane, arrivant déjà, par désespoir des forces de la raison, à dire : Nul n’atteint à la certitude ; nul ne peut rien savoir des dieux ni du monde. En toutes ces choses, il n’y a que des opinions. Dès sa première heure, la philosophie commençait son oeuvre de destruction contre la religion positive[51]. Nous avons tenu à montrer, clans ce rapide tableau, avec
quelle ardeur les colonies grecques, surtout celles d’Asie, se portèrent dans
toutes les directions où l’esprit humain peut espérer de trouver le beau et
le vrai. Elles ont ouvert de larges voies, où |