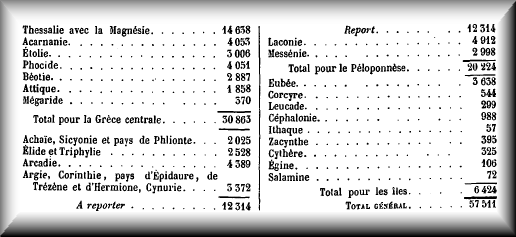|
I. Position géographique et configuration générale de la Grèce
Qu’entendez-vous par la Grèce ? demande
ironiquement Philippe de Macédoine aux Étoliens quand ceux-ci lui reprochent
d’être un roi barbare. Où placez-vous ses limites ? Et vous-mêmes, pour la
plupart, êtes-vous Grecs ?
Ce nom eut la même fortune que celui d’Italie : tous deux
voyagèrent d’une extrémité à l’autre de la péninsule qu’ils servirent plus
tard à désigner tout entière. Un petit canton de l’Épire, celui de Dodone,
s’appela d’abord ainsi; mais le mot gagna de proche en proche, et s’étendit
peu à peu sur la Thessalie,
les pays au sud des Thermopyles et le Péloponnèse. Dans la suite, il comprit
encore l’Épire, l’Illyrie jusqu’à Épidamne, enfin la Macédoine. Par
une autre singularité, le nom de Grèce était inconnu à la Grèce : elle se nommait Hellas, le pays des Hellènes, et nous
ne savons pas quels motifs ont fait prévaloir le mot de Græcia dans la
langue romaine[2].
Nous-mêmes nous désignons les peuples d’outre-Rhin par un autre nom que celui
qu’ils se donnent, comme les pays qui s’étendent de l’Himalaya au cap Comorin
ont été appelés d’un nom d’origine persane, l’Hindoustan.
La Grèce
est l’une des trois péninsules qui terminent l’Europe au sud. Si l’on
mesurait son étendue au bruit qu’elle a fait dans le monde, elle serait une
vaste région; en réalité, elle est le plus petit pays de l’Europe. Sa
superficie, les îles comprises, est loin d’égaler celle du Portugal; mais ses
rivages sont si bien découpés, que leur développement surpasse celui de tout
le littoral espagnol. II n’y a pas de pays au monde qui, â surface égale,
présente tant d’îles, de golfes, de péninsules et de ports, et où par
conséquent s’accomplisse mieux cette union de la terre et des eaux qui est
pour la nature la suprême beauté, et pour l’homme la meilleure condition du
progrès social. Aussi la mer a-t-elle été de tout temps la grande route des
Grecs, si bien qu’ils n’en ont guère connu d’autres. La forte expression latine
siruere viam,
qui rappelle une des gloires de Rome, ses grandes voies militaires, ne
trouverait pas â s’appliquer en Grèce, quoique les prêtres eussent la charge
de veiller â l’entretien des routes qui menaient aux sanctuaires nationaux, afin
d’en faciliter l’accès[3]. Ce fait seul
montre la différence profonde des deux peuples : l’un qui a pris possession
de la terre par son agriculture, ses routes monumentales, ses forteresses, et
y a gagné ses rudes vertus, sa vie grossière, toutes ses victoires et sa domination
pesante; l’autre qui a eu la mer pour domaine, le commerce pour mobile, les
arts pour parure et toutes les curiosités de la pensée.
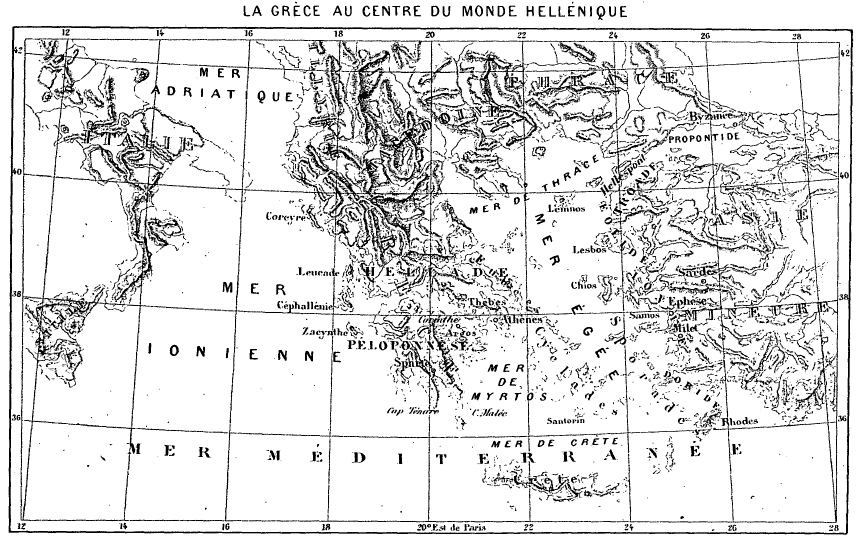
Au nord, la
Grèce tient au massif des Alpes orientales, qui l’isolent, par
des obstacles presque insurmontables, de la vallée du Danube, la grande route
des migrations asiatiques en Europe. Aussi ces invasions ont-elles passé près
d’elle sans la toucher, de même qu’elle n’a porté de ce côté ni ses colonies,
ni sa civilisation, ni sa langue. Par sa configuration, la Grèce regarde au sud. Elle
plonge par trois pointes dans la Méditerranée, presque sous la latitude de
Gibraltar et en face d’une des plus fertiles provinces de l’Afrique, la Cyrénaïque. Séparée
par la mer de l’Asie, de l’Afrique et de l’Italie, elle s’en rapproche par ses
îles. Les Cyclades, qui commencent près du cap Sunion, vont se mêler aux
Sporades, lesquelles touchent à l’Asie. Par un temps clair, un navire a
toujours la terre en vue. De Corcyre on peut apercevoir l’Italie ; du
cap Malée, les cimes neigeuses de la
Crète, et de cette île, les montagnes de Rhodes et de la
côte asiatique[4].
Deux journées de navigation menaient de la Crète à Cyrène; il en fallait trois ou quatre
pour atteindre l’Égypte. Comment s’étonner que la Grèce ait rayonné bien au
delà de ses frontières maritimes par son commerce, ses colonies et sa
civilisation, lorsque, devant elle, s’ouvraient tant de routes où les étoiles
d’un ciel habituellement sans nuages guidaient, la nuit, les navires? La
géographie prépara l’histoire. Des deux côtés et en face du continent grec,
l’antiquité connut : à l’orient, une Grèce asiatique ; à l’occident, une
Grèce italienne; au midi,
sur le vaste promontoire, aujourd’hui désert, de la Cyrénaïque, une Grèce
africaine[5]. Que d’échanges
d’idées et de produits entre ces quatre pays, et quelle intensité de vie dans
celui qui, placé au centre, était comme le foyer où tous les rayons partis de
ce cercle lumineux venaient s’unir en décuplant leur force !

II — Montagnes et cours d’eau
Les géologues, qui sont en train d’écrire la grande
histoire de la terre, montrent l’Italie et la Grèce méridionale comme
les parties de notre continent que la nature a remaniées les dernières[6]. Sa terrible
puissance y agit encore. Si la
Grèce n’a ni le Vésuve ni l’Etna, les yeux des hommes y ont
vu des îles surgir du sein des flots bouillonnants ou disparaître dans les
gouffres de la mer. Santorin n’est que le bord d’un cratère immense dont le
fond se trouve à 400
mètres au-dessous des eaux, mais qui, à plusieurs reprises,
a vomi des îles brûlantes[7]. Milo, Cimolo,
Thermia, Délos, s’élevèrent au-dessus de l’abîme, en même temps que le
Taygète sortit des entrailles du Péloponnèse et que le cap Ténare éleva
au-dessus des vagues son front rugueux, que la tempête fouette et déchire.
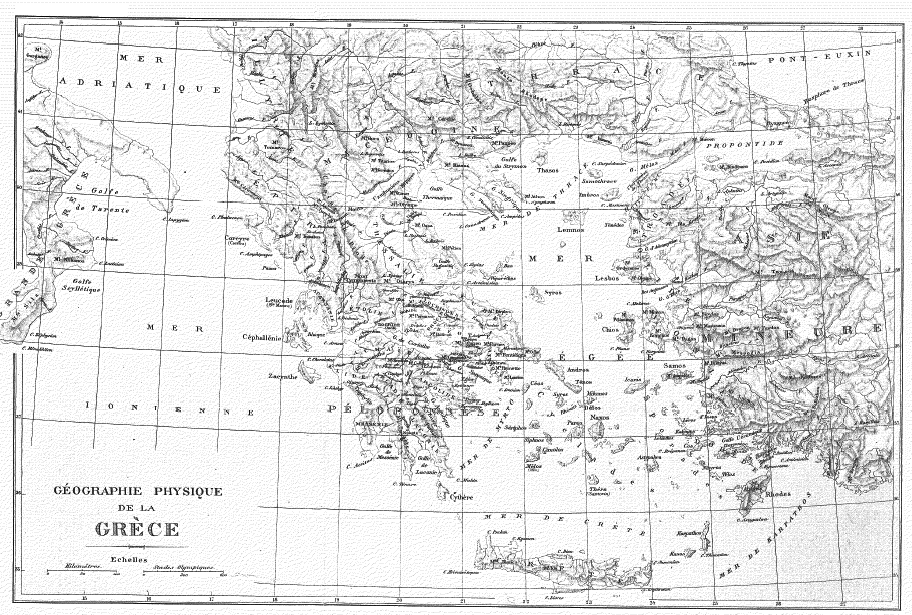
Les anciens Grecs eurent la révélation instinctive de ces
grandes révolutions. Ces montagnes entr’ouvertes et aux flancs déchirés, ces
rochers entassés au hasard, ces îles où se voit encore la trace des feux qui
les formèrent, leur rappelaient la lutte des Titans contre Jupiter, les
combats des puissances infernales contre les forces célestes ; et, en
célébrant les exploits de leurs dieux, ils faisaient l’histoire de leur
terre. Écoutez la
Théogonie d’Hésiode[8] : Voilà les Titans, fils de la Terre, qui combattent
contre les Centimanes, fils du Ciel. Autour d’eux, la mer sans bornes mugit
avec fracas ; sous leurs pieds, la terre gronde profondément ; le
vaste ciel s’agite et gémit ; l’Olympe même tremble jusqu’en ses
fondements, et les abîmes du Tartare retentissent du bruit des rochers qui
s’écroulent. Jupiter déploie alors sa puissance. Des hauts sommets de
l’Olympe, il lance des feux étincelants. Les foudres sortaient sans relâche
de sa main redoutable. La terre s’embrasa, les vagues de l’Océan roulaient du
feu, et des vapeurs étouffantes enveloppaient les Titans. Éblouis par la
foudre, les yeux brûlés par l’éclair, ils sont précipités dans les abîmes de
la terre. Briarée, Gygès et les autres fils du Ciel les y enchaînent de liens
indestructibles ; sur eux reposent les fondements de la mer et des continents,
qu’ils essayent parfois d’ébranler encore.
Cependant ces montagnes forment, en plusieurs points, des
chaînes continues. Ce que l’Apennin est pour l’Italie, le Pinde l’est pour la Grèce. Il se détache
des Alpes orientales comme l’Apennin des Alpes maritimes, descend au sud, en
séparant l’Illyrie de la
Macédoine, l’Épire de la Thessalie, et couvre
la péninsule d’innombrables ramifications. Les monts Cambuniens s’appuient,
au nord des sources du Pénée, sur cette chaîne centrale et courent droit à
l’est, vers les bords du golfe Thermaïque, où ils se relèvent pour former la
masse colossale de l’Olympe : montagne haute de 3000 mètres, qui
présente, en beaucoup d’endroits, l’aspect d’une muraille taillée à pic. Au midi, ses pieds baignent dans le
Pénée ; de l’autre côté du fleuve se dresse l’Ossa, qui garde longtemps
aussi, dans l’été, les neiges de l’hiver.
Quelque convulsion du globe a violemment séparé les deux
montagnes. Leurs flancs déchirés se correspondent, et Neptune qui ébranle la terre pourrait, en les rapprochant,
les unir. Des roches énormes pendent encore à demi déracinées, mais, dorées
par les rayons du soleil, elles offrent de vives couleurs qui tranchent sur
la sombre verdure des bois, et donnent à ces beaux paysages un éclat incomparable.
Entre le pied des deux monts, le Pénée s’est frayé une route jusqu’à la mer.
Il coule lentement, entre des rives gazonnées qu’abritent d’énormes platanes,
l’arbre des fleuves grecs. Mais, sur un espace de cinq mille pas, son bassin
n’a souvent que quelques mètres de largeur : c’est la vallée de Tempé,
célèbre dans l’antiquité par sa grandeur sauvage. Un petit nombre d’hommes
arrêteraient une armée dans cette étroite fissure des monts, le seul passage
fréquenté qui menât de Grèce en Macédoine.
Comme les monts Cambuniens ferment la Thessalie par le nord,
le mont Œta la ferme par le sud et se termine aussi, sur le golfe Maliaque,
entre des marais et des rochers à pic, par un défilé que l’histoire a rendu
fameux, celui des Thermopyles[9]. Le long de la
côte, le Pélion se rattache à l’Ossa et, par un chaînon qui contourne le
golfe Pagasétique ou de Volo, va rejoindre l’Othrys, qui sépare le bassin du
Pénée de celui du Sperchéios. Le nord de la Thessalie est donc
bien ce que l’appelait Xerxès, un vallon qu’il serait facile de noyer sous
les eaux, si on leur fermait la seule issue par où elles s’échappent, la
vallée de Tempé.
Les Grecs avaient trouvé dans cette région quelques-unes
de leurs plus gracieuses ou plus terribles légendes, et la moitié de la
poésie homérique en était sortie. Cette vallée de Tempé, c’était le bras du
fils d’Alcmène ou le trident de Neptune qui l’avait ouverte. Sur la cime de
l’Olympe et de ses neiges presque éternelles, au milieu des nues qui
l’enveloppent et que déchire la foudre, s’élevaient les trônes des douze
grands dieux. Là les géants avaient combattu les maîtres de l’Olympe et voulu
mettre Pélion sur Ossa, pour escalader le ciel; là les Muses étaient venues
aux noces de Thétis et de Pélée prédire la naissance d’Achille et la ruine de
Troie. Le laurier d’Apollon croissait d’abord à Tempé[10], et le dieu y
avait des autels, Άπλουνι
Τεμπείτα[11] ; sur le
Pélion furent coupés les arbres dont on fit le navire Argo, auquel Minerve donna
pour mât un des chênes fatidiques de Dodone, et les héros qui le montaient
s’embarquèrent au port thessalien de Pagase.
Au sud de la
Thessalie et au sud-est de l’Épire, la Grèce centrale est
couverte d’un inextricable réseau de montagnes qui part du mont Tymphrestos.
Une chaîne, qu’on peut regarder comme la continuation du Pinde, descend
jusqu’au golfe de Corinthe, entre l’Étolie et la Locride. Une autre
se détache de celle-ci dans la
Doride, court à l’est et comprend des monts célèbres : le
Parnasse, qui portait Delphes sur ses pentes, et d’où la légende faisait
descendre une race nouvelle pour repeupler la Grèce après le déluge de
Deucalion ; l’Hélicon, séjour des Muses, qui, disait-on, n’avait jamais
produit une plante vénéneuse ; le Cithéron où Œdipe tua Laïos, et qui,
réuni au Parnès, couvrait l’Attique contre la Grèce centrale ;
enfin, derrière Athènes, le Pentélique, dont un roc détaché portait
l’Acropole, et l’Hymette, que le Laurion semble continuer jusqu’au
promontoire de Sunion, au sommet duquel se voient, encore debout, quinze
colonnes d’un temple écroulé[12].
Cette chaîne, souvent brisée, envoie vers le sud, entre
les golfes Saronique et Corinthien, un puissant rameau, qui forme une seconde
péninsule à l’extrémité de la première et s’y étale circulairement, de sorte
que le Péloponnèse a presque la figure d’un cône tronqué, dont le sommet est
à 6 ou 7000 pieds
au-dessus de la mer : c’est la hauteur des montagnes autour de l’Arcadie[13]. Au nord, sur la
frontière de l’Achaïe et de l’Élide, l’Érymanthe, où Hercule accomplit un de
ses douze Travaux, s’élève à 2259 mètres ; à l’est, près de Sparte, le
Taygète en a 2567, et, vu du golfe de Messénie, dont il n’est éloigné à vol
d’oiseau que de 4
kilomètres, il s’élève majestueusement dans les
airs ; aussi les Grecs le croyaient-ils une des plus hautes cimes du
monde.
Par cette disposition de ses montagnes, la Grèce est, si j’ose dire,
un piège à trois fonds. Les monts Cambuniens et l’Olympe s’élèvent au nord,
comme une première barrière. Si ce difficile obstacle est franchi ou tourné[14], l’assaillant
sera arrêté par l’Œta, aux Thermopyles, et enfermé dans la Thessalie. Ce
passage encore forcé, la Grèce
centrale n’est plus défendue, parce que les hauteurs n’y forment point une
chaîné continue; mais la résistance peut reculer jusque vers l’isthme de
Corinthe, où elle trouve de nouveau, excepté sur l’isthme même, une
formidable position : des montagnes d’accès difficile ne laissant, entre
leurs flancs abrupts et la mer, que deux routes dangereuses suspendues au-dessus
des flots.
Les eaux intérieures de la Grèce pouvaient être
également fermées aux navires des peuples anciens sur trois points : au nord
de l’Eubée, pour couvrir les Thermopyles ; près de l’Euripe[15], pour défendre
les approches de l’Attique ; dans le détroit de Salamine, pour protéger
l’isthme de Corinthe.
La mer se trouvant partout à une faible distance des
montagnes, la Grèce
n’a que des cours d’eau peu étendus.
Les plus considérables sont le Pénée et l’Achéloos (430 à 175
kilomètres de longueur) ; presque tous ont
le caractère capricieux des torrents. Les pluies d’automne et d’hiver,
tombant sur des montagnes décharnées, descendent rapidement vers les vallées
qu’elles inondent. Avec l’été arrive la sécheresse, car le schiste et le
calcaire siliceux des montagnes, ayant peu absorbé, ne rendent rien ;
les sources s’épuisent, et le fleuve, naguère furieux, n’est plus qu’un
ruisseau caché sous les lauriers-roses, quand il n’est pas un torrent
desséché. Plusieurs de ces fleuves, l’Eurotas, l’Alphée, le Styx et le
Stymphale, poursuivent sous terre une partie de leur cours ; l’Alphée
allait même plus loin. Le Fleuve aimait la nymphe Aréthuse, qui avait fait
jaillir une source limpide dans l’île d’Ortygie. Touché de cet amour, le dieu
de la mer d’Ionie laissait l’Alphée traverser les flots amers et mêler ses
eaux pures à celles de la nymphe sicilienne.
La Grèce
véritable ne dépasse point, au nord, le 40e degré de latitude. A
ce point, le climat, parfois rigoureux, arrête le myrte, l’olivier et la
flore méridionale, qui s’épanouit plus au sud. Comme l’habitant de ces
régions plus froides avait d’autres cultures et d’autres besoins, l’histoire
y trouve d’autres mœurs et d’autres idées : c’est la Macédoine, qui ne put
se faire comprendre dans le corps hellénique qu’au temps où ce corps se
mourait ; à côté d’elle, l’Illyrie, qui, n’ayant ni ports sur ses
rivages ni plaines dans ses montagnes, par conséquent sans beaucoup de
cultures et sans commerce, resta toujours barbare.
De l’Olympe au cap Ténare, les montagnes, couvrant la
majeure partie de la Grèce,
lui donnent une grande variété de climats et de productions. Les flancs des
monts, les chaudes vallées qu’ils abritent, les côtes qui reçoivent les
tièdes effluves de la mer, offrent, à de courts intervalles, une végétation
différente. Tandis que les essences de nos bois couvrent le Pinde, le palmier
qui balance, en quelques endroits des Cyclades, son gracieux panache de
verdure, mûrit à peu près ses dattes en certains points de la Messénie, et le
citronnier, l’oranger, importés sur les côtes de l’Argolide, y forment des
forêts. La nature n’exerce donc pas en ce pays l’influence despotique qui, en
d’autres contrées, condamne l’homme à une vie uniforme et aux mêmes pensées.
Sur cette terre variée et sur sa mer hospitalière, le Grec a trouvé cet
esprit alerte et curieux qui a voulu tout savoir et qui a su tout exprimer.

III — Divisions naturelles et politiques
A voir le grand nombre de divisions politiques faites en
ce pays, on les croirait arbitraires ; presque toutes ont été dessinées
sur le sol par la nature même. Des montagnes courant en sens contraire se
sont soudées les unes aux autres et, en se réunissant, ont enfermé, comme
entre de hautes murailles généralement stériles, parfois inexpugnables, les
plaines de la Phocide,
de la Béotie,
de l’Attique, de la
Mégaride, de la Corinthie, de l’Argolide, de la Laconie et de Mantinée.
De là, la division du peuple grec en tant de petits États, l’ardent
patriotisme dont chaque cité était animée et sa haine contre la cité voisine
qui, placée dans une autre vallée, semblait être dans un autre monde. La
géologie a fait la constitution politique de l’ancienne Grèce.
Parcourons quelques-unes de ces réglons naturelles.
La Thessalie
a formé parfois un seul État, malgré l’Othrys qui la coupe en deux, parce que
cette montagne, assez haute pour être la ligne de partage des eaux, ne l’est
pas assez pour être la ligne de démarcation des hommes. Seulement, la vie a
été bien autrement active aux bords des golfes Maliaque et Pagaséen, qui
s’ouvrent sur la Grèce,
que dans le bassin solitaire du Pénée. Les villes s’y pressent comme les
légendes.
Les deux Locrides, opuntienne et épienémidienne,
couvrent les pentes qui descendent à la mer Eubéenne ; la Béotie, celles qui
s’inclinent à l’intérieur vers le lac Copaïs[16] : sol gras et
humide, climat brumeux sous lequel on s’étonne que Pindare ait chanté. Mais la Béotie avait deux jours
sur la mer : par le pays d’Aulis, sur l’Euripe, où Agamemnon s’embarqua[17], et, par les
vallées de Creüsis et d’Aphormion, sur le golfe de Corinthe.
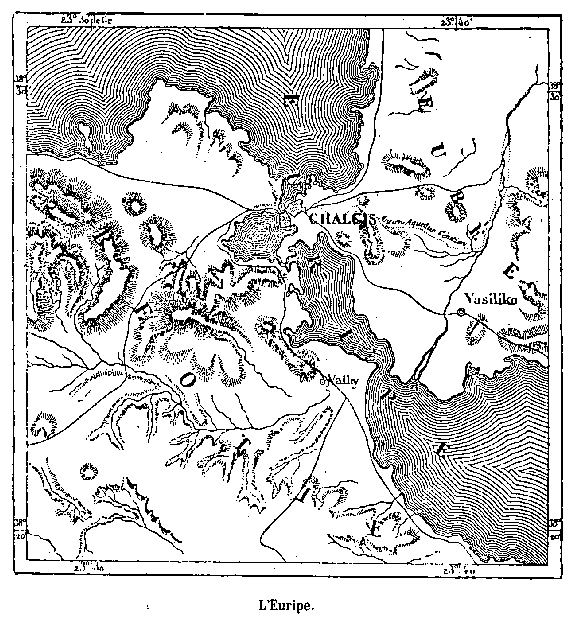
La
Phocide, plus haut dans la montagne, enveloppait la Béotie et, comme elle,
touchait aux deux mers : à la mer Eubéenne par Daphnous, au golfe de Corinthe
par Cirrha, où commençait la route des pèlerins qui montaient au temple
d’Apollon.
La Doride,
haute et froide vallée entre l’Œta et le Parnasse, attrait pu n’être que le
commencement de la Phocide.
Le canton montagneux des Locriens Ozoles offrait à
ce peuple d’inexpugnables retraites. Pausanias tire leur nom de l’odeur de
leurs vêtements en peaux de bêtes non préparées ; un de leurs poètes,
des fleurs qui embaumaient l’air de leurs montagnes. Je crains que le poète
n’ait tort ; leur vie grossière donne raison à Pausanias.
Leurs voisins à l’ouest, les Étoliens, habitaient
un pays sauvage, où les villages bâtis sur la pente des rocs restaient,
l’hiver, sans communication entre eux. Ces hauteurs sont les dernières
ramifications du Pinde et de l’Œta qui viennent mourir d’une part sur les
bords du fleuve Achéloos, de l’autre sur ceux du golfe de Corinthe, au point
le plus étroit de cette mer, là où la côte du Péloponnèse n’est qu’à 1600 mètres de
distance. C’est par là que les Étoliens iront, dans les derniers temps,
ravager si souvent la presqu’île, comme ils passeront entre le Pinde et l’Œta
pour piller la Thessalie.
Ils n’avaient que ces deux portes ouvertes sur la Grèce.
L’Achéloos, dont le delta grandit sans cesse par les
alluvions que le fleuve apporte, les séparait de l’Acarnanie, autre
région montagneuse, mais composée d’un calcaire poreux qui ne tient pas
l’eau. Aussi l’appelle-t-on aujourd’hui le pays sec, Xéroméros. Pas une
rivière ne circule à sa surface. La mer a beau lui envoyer de trois côtés des
nuées pluvieuses, les torrents à peine formés par un orage disparaissent en
des gouffres profonds. Le sol prend tout et ne rend rien, si ce n’est au bas
des collines où les nappes intérieures reviennent au jour et s’étendent en
lacs et en marais. Un autre trait de la géologie de cette région est une
chaîne de montagnes hautes de 4600 mètres qui borde la mer Ionienne et n’y
laisse point de place aux populations pour vivre et s’étendre, aux cités pour
s’élever ; de sorte que le côté par où l’Acarnanie pouvait le plus aisément
recevoir l’influence de la
Grèce s’est trouvé hermétiquement fermé. Comment s’étonner
qu’elle ait vécu à l’écart ? Au temps de Périclès, on y trouvait les
mœurs de l’âge héroïque ; il n’y avait qu’à regarder un Acarnane pour
savoir comment un héros d’Homère était fait. Jusqu’à ce jour, ils n’ont guère
changé ; quelques-uns se nourrissent encore du gland amer des chênaies[18].
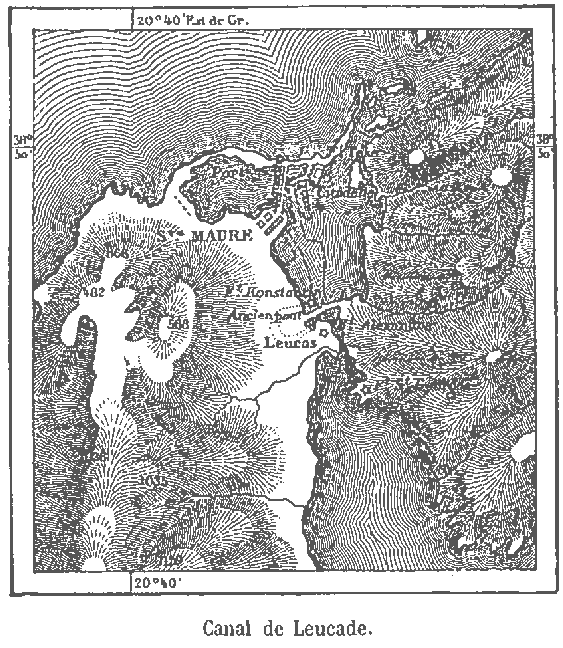
Le nord-est de l’Acarnanie, d’accès fort difficile, fut
cependant envahi par les tribus de l’Épire. Les Amphilochiens, qui
l’habitaient, étaient à demi Grecs et à demi barbares. A l’ouest s’établirent
les colons de Corinthe. De ce côté s’étend l’île de Leucade (Sainte-Maure),
qui d’abord tenait au continent par un isthme de 3 stades. Les colons, pour
se mettre en sûreté contre les brigandages des Acarnanes, creusèrent un
canal, le Dioryctos. La mer fit le reste, mais c’est le plus modeste
et le plus calme des détroits : on le traverse en quelques minutes, dans un
bac et à la perche, comme un obscur ruisseau. Il faut plus de façons pour
l’Euripe[19].
A l’extrémité opposée de la Grèce centrale s’étend une
presqu’île bien mieux dessinée, l’Attique, que le Cithéron et le Parnès
séparent de la Béotie,
que le Pentélique et l’Hymette partagent en deux versants, et qui s’incline
vers trois mers. Malgré ces directions divergentes, c’est une des contrées
les mieux faites de la Grèce
et où l’unité était le plus facile, car les Athéniens, qu’Eschyle appelle les constructeurs de routes qui ont apprivoisé la terre
sauvage[20],
en relieront tous les points par des voies que la nature sèche du sol rendra
toujours praticables, sans qu’elles aient besoin de la solide grandeur des
voies militaires de Rome. L’Attique eut beaucoup de villages, mais une seule
ville, l’asile commun, le marché et la forteresse du pays : Athènes, entre
l’Ilissos et le Céphise, au pied de rocs escarpés qui lui servirent de
citadelle, à 8
kilomètres du Pirée, dont les trois ports pouvaient
abriter quatre cents vaisseaux. Toute la vie de l’Attique devait se porter en
ce point ; elle s’y concentra. Tous les échos de l’Asie vinrent y
retentir, toutes les affaires du monde s’y traiter, toutes les doctrines,
tous les arts, s’y épurer et y grandir. Le genre humain salue encore avec
reconnaissance la patrie de Socrate, de Phidias et de Sophocle.
En suivant la côte qui regarde Salamine, on trouve dans un
fertile vallon Éleusis, qu’Athènes attira et retint sous son influence, et
entre deux rochers Mégare qui, protégée par ses montagnes, échappa à cette
attraction. Les Mégariens n’avaient qu’un sol stérile : Ils labourent des pierres, dit Socrate ; mais
leur ville était la porte de l’isthme. Pindare compare cet isthme à un pont
jeté par la nature au milieu des mers pour lier ensemble les deux principales
parties de la
Grèce. Malheureusement les abords de ce pont, au nord, sont
hérissés de montagnes qui rendent le passage difficile : en mille endroits,
quelques hommes résolus y tiendraient tête à une armée. Cette position de
Mégare et ses deux ports sur les golfes Saronique et corinthien, faisaient
toute son importance. Mais, dans l’une de ces mers, elle trouvait la marine
rivale de Corinthe ; dans l’autre, celle d’Athènes : redoutable
concurrence qui devait la tuer.
Entre Cenchréæ et Léchéon, l’isthme corinthien a de 5 à 6 kilomètres de
largeur, et le point culminant est assez bas pour qu’on ait pu transporter
par terre les vaisseaux d’un de ces ports à l’autre, afin d’éviter les
longueurs et les périls d’une navigation autour du Péloponnèse. Démétrius
Poliorcète, César et Néron songèrent à creuser en cet endroit un canal[21].
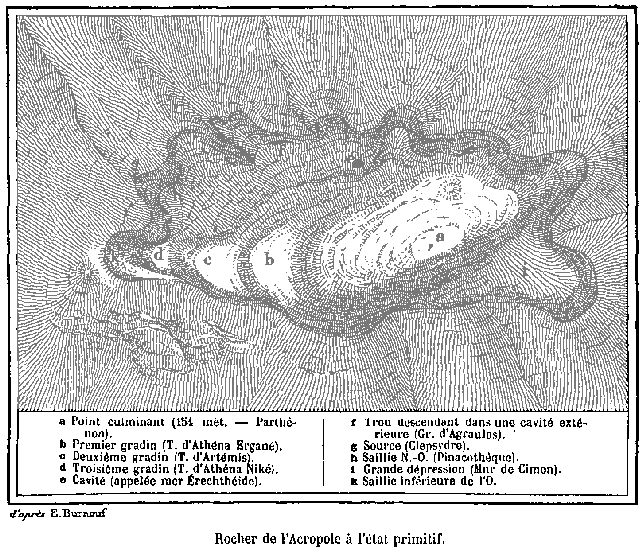
Le Péloponnèse a trois régions bien caractérisées : le
plateau central, ou l’Arcadie; la
Laconie, ou le bassin de l’Eurotas; la Messénie, ou le bassin
du Pamisos. Je parlerai plus loin des deux dernières, que le Taygète sépare
et que la mer enveloppe de trois côtés; quant à l’Arcadie, entourée d’un
cercle de hautes montagnes qui ne s’ouvre qu’à l’ouest, du côté d’Olympie, en
un étroit défilé par où l’Alphée s’échappe, elle présentait l’aspect d’un
chaos de monts verdoyants et de fraîches vallées couvertes de bourgades, avec
quelques rares plaines où s’élevaient les villes. C’était le pays le plus
divisé de la Grèce
: aussi ses habitants n’arrivèrent à l’union politique que fort tard et pour
un moment; c’était aussi le mieux arrosé : il avait des lacs à des hauteurs
de 600 à 800 mètres
au-dessus de la mer, comme le Phénéos, dont l’altitude est de 753
mètres ; et il en résultait un singulier phénomène géologique. Ces lacs
servaient de réservoirs aux eaux du Péloponnèse ; alimentés par les
ruisseaux descendus des hautes cimes, ils se déchargeaient par les conduits
souterrains ou katavothra qui existaient naturellement à travers les
montagnes, et formaient au delà les rivières de la zone maritime. L’Eurotas,
l’Alphée, le Styx et le Stymphale ont ainsi sous terre une partie de leur
cours ; on compte dans l’Arcadie plus de trente de ces katavothra, mais
aussi il arrivait souvent que ces canaux souterrains s’engorgeaient et alors
se produisaient de redoutables inondations[22].
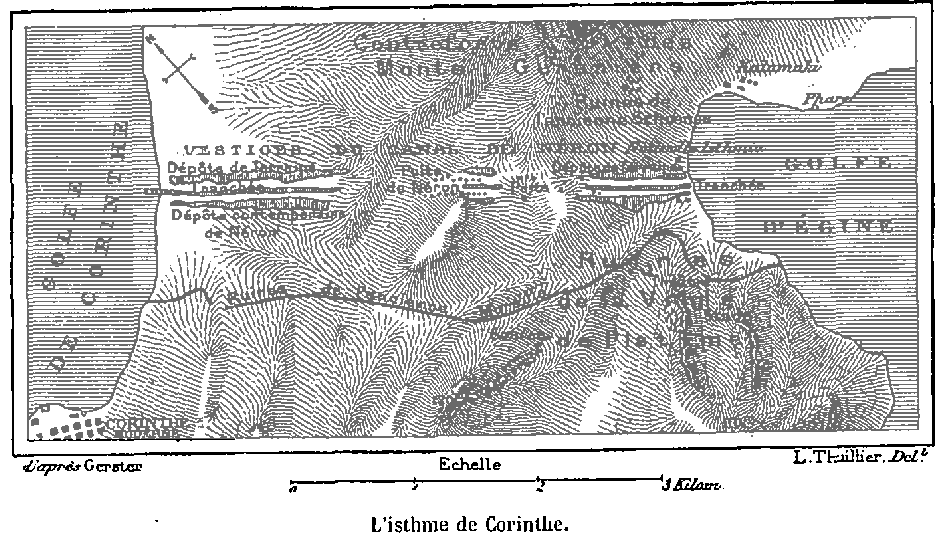
Le reste du Péloponnèse, c’est-à-dire le littoral du nord,
n’est qu’une suite de courtes vallées descendant à la mer, chacune avec une ville
qui formait un État à part. Les anciens y distinguaient cependant trois
régions : l’Élide, la plus fertile contrée de la péninsule[23], l’Achaïe et
l’Argolide. Ils ne faisaient habituellement, sur cette côte, d’exception que
pour Sicyone et Corinthe, en donnant le nom de chacune de ces villes au pays
environnant.
L’Argolide, presqu’île entre trois mers, reproduit presque
la figure de l’Attique. Mais la capitale n’est pas au centre; son port était
mauvais, même pour les navires des anciens ; son littoral était
marécageux, et elle avait Sparte à ses côtés. Aussi., après avoir jeté un vif
éclat dans les temps primitifs, elle ne joua, comme Thèbes, qu’un rôle
secondaire, sans avoir, ainsi que cette autre rivale de Sparte et d’Athènes,
la gloire éclatante de Leuctres et de Mantinée pour dédommagement de sa
longue obscurité[24].

IV — Influence du sol et du climat
Les montagnes de la Grèce couvrent les neuf dixièmes de sa surface
et ne laissent à découvert qu’un très petit nombre de plaines, dont les plus
grandes se trouvent en Thessalie. Il en résulta que cette province fut la
seule qui nourrit une bonne et forte race de chevaux. Ces montagnes, aujourd’hui
privées de leurs antiques forêts, ne sont pas plus riches que celles de
l’Italie en métaux précieux. Cependant on tirait du cuivre et de l’amiante de
l’Eubée ; du fer de la
Béotie, du Taygète et des îles de Mélos, de Sériphos et
d’Eubée ; Chalcis en fabriquait des armes excellentes, et ses ouvriers
se vantaient d’avoir su les premiers travailler le cuivre. Il y avait de
l’argent en Épire, en Chypre, à Siphnos et dans l’Attique, où Athènes, aux jours
de sa puissance, occupa 20.000 hommes dans ses mines du Laurion[25]. Dans l’Hémus et
l’Orbélos, dans la
Thessalie, au mont Pangée, entre la Macédoine et la Thrace, et dans les îles
de Siphnos et de Thasos, on trouvait de l’or. L’Hèbre de Thrace en roulait
dans ses flots. L’Attique et les îles, surtout Paros, avaient des marbres
renommés[26].
Dans les pays montagneux, les plaines sont ordinairement
d’une extrême fertilité. La
Thessalie, la
Messénie, le nord de l’Élide et l’Eubée, qui fut le grenier
d’Athènes, ne démentaient pas ce principe. La Béotie devait aussi à ses
nombreux cours d’eau et à leurs dépôts longtemps accumulés une grande
richesse, surtout la vallée inférieure du Céphise, fécondée, comme l’Égypte,
par des inondations périodiques. Mais les habitants, gâtés par cette nature
trop généreuse, s’engourdirent dans les plaisirs sensuels. Tandis que
l’Attique, si pauvre, se couvrait d’une active et ingénieuse population, la Béotie nourrit un peuple
dont la paresse d’esprit devint proverbiale, quoiqu’il ait compté parmi ses
enfants Hésiode, qui, bien loin d’Homère, tient encore une grande place dans
la poésie grecque, et Pindare, dont Horace a dit : Un
souffle vigoureux soutient le cygne de Dircé lorsqu’il monte dans la région
des nues. Les cantons élevés de l’Arcadie avaient pour habitants une
race d’hommes qui ont quelques traits de ressemblance avec les Suisses par
leurs moeurs simples et pastorales, leur esprit belliqueux, leur amour du
gain et leur dispersion en de nombreux villages.
Prise dans son ensemble, la Grèce n’était pas assez
fertile pour nourrir ses habitants dans l’oisiveté, et elle n’était pas assez
pauvre pour lés contraindre à dépenser toute leur activité dans la recherche
des moyens de subsistance. La diversité du sol, plaines et montagnes, celle
du climat, qui varie des neiges du Pinde aux cultures presque asiatiques du
Péloponnèse, leur imposaient cette multiplicité de travaux qui développe les
facultés et provoque la variété des idées par celle des connaissances,
c’est-à-dire la civilisation. De leur sol les Grecs reçurent bien plus
qu’aucun autre peuple l’obligation d’être à la fois pâtres et laboureurs,
surtout marchands. Avec du blé et du bétail, un peuple peut vivre enfermé
chez lui. Les Grecs en avaient peu, mais ils produisaient beaucoup de vin et
d’huile, denrées essentiellement échangeables et qui exigent une main-d’œuvre
intelligente. Le commerce fut donc pour eux une nécessité. Les Phéniciens
leur avaient de bonne heure appris à construire le
cheval de mer et à l’armer d’une voile, pour soulager les rameurs. La
nuit, ils le guidèrent sur les flots d’après la plus brillante des
constellations qui tournent autour du pôle, la Grande Ourse[27]. Ajoutez qu’ils
habitaient en face ou à proximité des contrées alors les plus civilisées et
les plus riches, la Lydie,
l’Ionie, la Phénicie,
l’Égypte et, plus loin dans l’est, la Chaldée, dans l’ouest, Carthage ; de sorte
qu’ils eurent le spectacle des moeurs les plus différentes, quand eux-mêmes
étaient forcés de se donner les aptitudes les plus diverses. Quel vaste champ
ouvert à l’imagination et à l’intelligence, et combien ce peuple avait de
motifs pour se croire né de la terre qui le portait !
Comme leur sol encore, les Grecs avaient une constitution
sèche qui les rendit agiles et nerveux. Leur large poitrine était celle de
l’homme des montagnes qui respire à pleins poumons ; quoiqu’ils ne
fussent pas de grande taille, ils étaient forts à la lutte, résistants à la
fatigue, rapides à la course; après avoir garanti leur indépendance, ces
qualités militaires les rendirent maîtres de l’Asie. La nature avait mis la
beauté sur leur visage ; la vie au grand air, de continuels exercices,
développèrent les élégantes proportions de leur corps, et les artistes
n’eurent qu’à regarder autour d’eux pour trouver des modèles.
Ajoutez que sur ce sol découpé, où pas une vallée ne
ressemble à l’autre, il y eut une telle variété de moeurs et d’institutions
que l’agitation fut partout, à l’agora et dans les esprits, partout l’effort
et la lutte. Nul peuple n’a autant vécu.
Un pays, en Grèce, résume par excellence les défauts et
les avantages du sol hellénique et de la configuration de ses côtes, où la
terre et la mer se marient harmonieusement ; c’est la stérile Attique,
avec ses fertiles campagnes de Marathon et d’Éleusis qui rendaient soixante
pour un de semence, avec ses oliviers, son miel parfumé de l’Hymette, ses marbres
du Pentélique, ses mines du Laurion, son atmosphère si pure, qu’on prétendait
apercevoir du cap Sunion l’aigrette et la lance de la Minerve de
l’Acropole ; et, mieux que tout cela, avec la mer qui, de trois côtés,
lui sert de ceinture. Lorsqu’ils montaient au Parthénon, les Athéniens
découvraient ces îles nombreuses semées autour d’eux sur les flots, comme
pour devenir leur domaine ou les mener aisément, par les
routes humides, aux côtes de Thrace, d’Asie et d’Égypte. Chaque matin
se levait le vent du nord qui conduisait doucement leurs navires aux
Cyclades; chaque nuit soufflait le vent contraire qui en quelques heures les
ramenait au port, sous un ciel tout semé de feux étincelants que ne voilent
jamais les brumes épaisses de nos mers. Douce et
suave est notre atmosphère, dit un poète athénien ; l’hiver est pour nous sans rigueur, et les traits de Phœbus
ne nous blessent point[28].
Cependant, au milieu de ces îles, autour de ces caps et
dans les nombreux golfes du littoral, les courants marins et atmosphériques
changent fréquemment de direction; dans la haute mer surviennent des sautes
de vent dangereuses. Au sud du Péloponnèse et vers la côte d’Asie, la
navigation avait ses dangers[29]. C’étaient des
conditions favorables pour former d’habiles marins.
La Grèce
était donc un magnifique théâtre préparé à l’activité humaine. Que le
despotisme eût approché de cette terre et de ces hommes, que Darius et Xerxès
eussent vaincu à Marathon ou à Salamine, et les heureuses influences du sol
et du climat étaient neutralisées ; la Grèce ancienne fût devenue ce que les empereurs
et les sultans de Byzance ont fait de la Grèce moderne, une terre de désolation. Mais le
génie de la liberté s’assit au foyer de ce petit peuple victorieux ; il
éleva l’âme des Grecs, que la servitude eût dégradée ; il les aida à
tirer de leur sol et d’eux-mêmes tous les trésors qu’une nature bienfaisante
y avait déposés, que des institutions mauvaises et des circonstances contraires
eussent rendus stériles ; et comme cette force vient du sol, elle s’y
trouve encore.
Il y a soixante ans, Byron, parcourant ce pays couvert des
ruines faites par quatre siècles d’esclavage, s’écriait : Que tu es belle encore dans ta vieillesse douloureuse,
patrie déshéritée des dieux et des héros ! Libres aujourd’hui,
les Hellènes aspirent à de nouvelles et glorieuses destinées. Mais, au
voisinage d’États puissants et jaloux de toute vie qui s’éveille près de
leurs frontières, pourront-ils réaliser ce qu’on disait de la Grèce il y a cinquante ans :
C’est une grande chose qui commence !
|