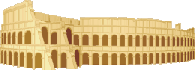ÉCONOMIE POLITIQUE DES ROMAINS
LIVRE QUATRIÈME — INSTITUTIONS POLITIQUES - ADMINISTRATION - FINANCES
CHAPITRE V. — Lois de Caïus Gracchus.
|
Caïus, dit Plutarque (C. Gracchus, I), était questeur en Sardaigne ; l’hiver était très rude ; le général demanda aux villes des habits pour ses soldats. Les villes envoyèrent des députés au sénat pour le prier de les décharger de cette imposition trop onéreuse. Le sénat ordonna au général de chercher ailleurs de quoi habiller ses troupes. Comme celui-ci ne trouvait aucun moyen de fournir à cette dépense et que cependant les soldats souffraient beaucoup, Caïus s’avisa d’aller de ville en ville, et fit si bien par son éloquence qu’il leur persuada à toutes d’envoyer des habits et de secourir les Romains dans leur détresse (ibid., II). Ce grand service partit aux patriciens, de la part de Caïus, un essai et un prélude pour gagner l’affection du peuple, et les indisposa fortement contre lui. Leur malveillance alla même si loin, dit toujours Plutarque (ibid.), que des ambassadeurs arrivés en même temps à Rome de la part du roi Micipsa, ayant déclaré au sénat que le roi leur maître, pour l’amour de Caïus, envoyait en Sardaigne, au général romain, une provision de blé, les sénateurs s’emportèrent contre eux et les chassèrent honteusement. Caïus fut ensuite accusé et cité devant les censeurs pour être revenu de Sardaigne avant son général. Il demanda audience pour se défendre ; par un discours plein d’adresse et d’éloquence, il changea l’esprit de tous ses auditeurs, et fut absous complètement et à l’unanimité par ses juges. Les nobles ne se lassèrent point de le poursuivre, et ils intentèrent contre lui divers chefs d’accusations encore plus graves. On l’accusa d’avoir sollicité les alliés à la défection et d’avoir eu part à la révolte de Frégelles[1] ; mais il répondit si bien aux différents griefs qu’on alléguait contre lui qu’il détruisit tous les soupçons ; et, après s’être lavé, il demanda le tribunat, auquel il fut porté par totale la faveur du peuple[2]. Bientôt il proposa deux lois qui tendaient l’une et l’autre à attaquer les ennemis de Tiberius[3]. L’une portait que tout magistrat que le peuple aurait déposé ne pourrait plus aspirer à aucune charge ; l’autre ordonnait que le magistrat qui aurait banni un citoyen sans lui avoir fait son procès dans les formes serait cité et poursuivi devant le peuple. Parmi les édits qu’il présenta pour relever la puissance du peuple et pour rabaisser celle du sénat, il y en avait un qui regardait les colonies et qui donnait aux citoyens pauvres les terres des villes où on les envoyait pour les repeupler ; un autre en faveur des troupes, qui ordonnait qu’on leur fournirait des habits, sans rien retrancher pour cela de leur solde, et qu’on n’enrôlerait point de soldat qui n’eût dix-sept ans accomplis ; un troisième en faveur des alliés, qui conférait à tous les peuples de l’Italie le droit de suffrage, tel que l’avaient les propres citoyens ; un quatrième pour diminuer, à l’égard des pauvres, le prix du blé ; un cinquième, enfin, concernant l’administration de la justice, par lequel il enlevait au sénat la plus grande partie de son autorité ; car les sénateurs étaient les seuls juges de tous les procès, ce qui les rendait très redoutables aux chevaliers et au peuple. Caïus ne se contenta pas d’associer les chevaliers au sénat pour le jugement des procès ; il ôta entièrement le droit de juger aux sénateurs, et l’attribua aux chevaliers, qui en jouirent pendant seize ou dix-sept ans[4]. Nous allons maintenant discuter ces diverses lois, et nous ferons voir, par le développement des faits, que les unes étaient très avantageuses à la république, que celles qui lui étaient nuisibles furent adoptées dans la suite par le sénat, et que le seul moyen de les éviter eût été la pleine et entière exécution de la première loi agraire proposée par Tiberius. On sait quel fut le sort de Caïus Gracchus ; on sait que la faction des riches arma le consul Opimius d’un pouvoir illimité, et qu’il fit massacrer dans Rome Caïus et trois mille de ses partisans, dont les corps furent jetés dans le Tibre et tous les biens confisqués[5]. Les deux premières lois de Caïus, dont l’une portait que tout magistrat que le peuple aurait déposé ne pourrait plus exercer aucune charge ; l’autre, que le magistrat qui aurait banni un citoyen romain sans lui avoir fait son procès serait cité et poursuivi devant le peuple ; ces deux lois, dis-je, me semblent irréprochables. La première existe encore dans notre code pour les fonctionnaires destitués et flétris par un jugement légal ; la seconde était l’habeas corpus, le palladium de la liberté civile chez les Romains. Tite-Live, Tacite, Cicéron louent unanimement cette belle institution[6], en vertu de laquelle un citoyen devait toujours être jugé par ses pairs, institution qui donnait à l’accusé tous les moyens de se défendre, et qui lui permettait même, avant le prononcé du jugement, de se soustraire à la peine en s’infligeant un exil volontaire. Quant à la loi qui ordonnait qu’on fournirait aux légions des habits, sans rien retrancher pour cela de leur solde, et qu’on n’enrôlerait point de soldat qui n’eût dix-sept ans accomplis, il me semble qu’on peut aisément la justifier. La conquête de l’Asie et de l’Afrique avait jeté en Italie beaucoup de métaux précieux ; la culture par les esclaves avait renchéri et diminué à la fois les produits ; les denrées avaient beaucoup augmenté de valeur, et cependant la solde des troupes était restée la même ; il me semble qu’il était juste de leur accorder cette indemnité. Quant à la défense d’enrôler avant dix-sept ans accomplis, elle était fondée sur les lois invariables de la croissance de l’homme ; je suis même étonné que les lois romaines admissent au service des hommes d’un âge si peu avancé ; car, en 1811, j’ai vu plusieurs régiments de conscrits levés dans l’État de Rome et le royaume de Naples, et parmi ces jeunes soldats, dont le moins âgé avait vingt ans, il y en avait la moitié d’une petite taille et d’une constitution faible. La loi de Caïus qui attribuait aux citoyens pauvres les terres du domaine public, dans les villes qu’on voulait repeupler, n’était qu’une modification de la loi licinienne que Tiberius avait fait passer, et dont le sénat avait su toujours éluder l’exécution. L’autre loi en faveur des alliés, loi qui donnait a tous les peuples de l’Italie inférieure[7] le droit de suffrage, tel que l’avaient les propres citoyens, tendait évidemment à fortifier la puissance romaine, en intéressant au maintien de ses lois et de son gouvernement des peuples unis par la même langue, par les mêmes habitudes, par les mêmes intérêts, enfin par une longue confraternité d’armes et de succès. Ce n’était qu’étendre et continuer ce principe d’incorporation suivi depuis la fondation de la république, et auquel elle avait dû sa foi-ce et son agrandissement. Velleius, ennemi des Gracques, approuve fort ce projet de loi (II, XV). Le nombre des votants ne serait pas devenu, par l’effet de cette loi, aussi énorme et aussi dangereux que quelques publicistes ont paru le supposer ; car le dénombrement fait par César, dans sa dictature, â une époque où tous ces peuples avaient reçu le droit de suffrage, ne fournit qu’environ 450.000 citoyens[8]. De plus, le refus du droit de cité aux alliés excita une terrible guerre civile, qui pendant trois ans fit couler des flots de sang, ravagea l’Italie entière, mit Rome à deux doigts de sa ruine, et ne se termina enfin que par la concession de ce droit de suffrage. Le sénat, à coup sûr, aurait pu éviter tous ces maux en accordant à propos et de bonne grâce ce qui était une justice et qui devint bientôt une nécessité. L’autre loi de Caïus, qui enlevait le jugement des procès aux sénateurs et le conférait aux chevaliers, n’atteignait pas entièrement son but. Elle était motivée par les odieuses injustices commises dans les jugements, où les coupables les plus décriés pour leurs vols et leurs concussions trouvaient une protection assurée, en corrompant les juges à force de présents. Cicéron le dit en termes formels[9]. Il y joint un tableau curieux de la haine et du mépris des nobles pour les hommes nouveaux. L’opinion générale est, dit-il, qu’avec les juges actuels nul homme riche, quelque coupable qu’il soit, ne peut être condamné[10]. Il rappelle comme un fait reconnu[11] que le sénat s’est rendu odieux au dedans et au dehors par l’infamie de ses jugements, et qu’évidemment toute justice est bannie de ses décisions[12]. Il précise enfin tous les genres de corruption devenus habituels chez les juges[13]. Aussi les sénateurs se sentant coupables n’osèrent-ils même point disputer aux chevaliers l’administration de la justice. Mais les chevaliers, seuls maîtres des jugements, pouvaient imiter la corruption et l’iniquité des sénateurs qu’ils avaient remplacés. Comme les fermiers des revenus publics étaient tirés de leur ordre[14], leur nouvelle puissance leur donnait le moyen d’exercer hardiment le péculat et de piller la république avec une entière impunité. Il est vrai qu’Appien dit[15] que les chevaliers vendaient aussi la justice, mais le témoignage de Cicéron, auteur contemporain, doit l’emporter sur celui d’un Grec du IIe siècle de l’ère chrétienne. Le peuple romain, dit l’orateur[16], apprendra de moi par quelle raison, pendant près de cinquante ans de suite que l’ordre des chevaliers a jugé, jamais il n’y a eu contre un seul chevalier romain le plus léger soupçon qu’il eût reçu quelque argent pour le jugement d’une affaire. Asconius s’exprime dans des termes semblables[17]. La corruption des juges, en 682, était devenue si odieuse que le peuple redemandait la censuré, magistrature jadis si impopulaire[18]. Cicéron parle[19] d’un sénateur qui, étant juge, reçut dans la même cause de l’argent de l’accusé, pour corrompre les autres juges, et des accusateurs, pour condamner l’accusé. Catulus lui-même, l’un des oligarques, prononça en plein sénat un anathème contre la vénalité des jugements du sénat[20]. On voit que, chez les Romains, le système de l’ordre judiciaire était tout à fait vicieux ; ils ne possédaient ni des juges inamovibles, ni des tribunaux désintéressés, tels que notre cour des Comptes, dont la seule fonction est d’examiner et d’apurer les comptes de recette et de dépense des comptables. Mais la loi la plus funeste de celles que firent éclore les débats entre Caïus et le sénat fut sans contredit la loi sur les céréales, lex frumentaria, pour faire distribuer aux pauvres citoyens du blé presque gratuitement, c’est-à-dire à raison de cinq sixièmes d’as[21] le modius, pesant 13 ½ de nos livres. Cette loi, dont tous les bons esprits, Cicéron, Salluste, J. César, Auguste, ont senti et fait connaître les inconvénients, subsista cependant jusqu’à la chute de l’empire romain ; preuve évidente qu’elle était devenue une nécessité. Ce fut une concession obligée de l’oligarchie envers le peuple, qui, réduit à la misère par l’abrogation des lois liciniennes, par l’introduction de la culture au moyen des esclaves, et cependant conservant toujours ses droits politiques, avait besoin d’être contenu par de puissants motifs d’intérêt personnel pour ne pas être tenté d’exciter une révolution dans l’État. Alors les hommes publics se virent contraints à rechercher comment ils pourraient soulager le peuple, non en favorisant le travail et l’industrie, mais en sacrifiant les revenus du trésor ; car on regardait la fortune publique comme une propriété commune qui devait être partagée entre les particuliers. Cependant les distributions gratuites ne semblent nulle part moins nécessaires que dans les États où il y a des esclaves, l’avilissement de la plus grande partie de la population permettant à ses maîtres de disposer de ses forces et de vivre sans peine à ses dépens. Cicéron[22] a bien raison lorsqu’il dit : C. Gracchus porta la loi sur les distributions de blé ; cette loi fut très agréable au peuple romain, car elle lui fournissait, sans travail, une nourriture très abondante. Les gens de bien s’y opposaient, tant parce qu’elle épuisait le trésor public que parce qu’ils prévoyaient que le peuple s’éloignerait du travail et se plongerait dans la paresse. Salluste[23] donne à César un conseil très sage : Il te faut, dit-il, pourvoir à ce que le peuple, corrompu par les largesses et les distributions de blé, soit retenu par des occupations personnelles, qui lui ôtent le loisir de nuire à l’État...... Il faudra aussi que les distributions de blé, qui jusqu’ici ont été le prix de la paresse, ne se fassent dorénavant que dans les villes municipales et les colonies, et soient réservées pour les vétérans qui retourneront dans leur patrie après avoir achevé le temps de leur service. Auguste, cet administrateur si habile, voulut supprimer l’abus des distributions gratuites de blé ; mais il fut retenu par des considérations politiques dont j’ai parlé ailleurs[24]. Le véritable motif fut qu’Auguste redoutait les excès auxquels pouvait se porter une populace privée de tout moyen de travail et d’existence[25], mais qui se souvenait d’avoir été libre et puissante. On jetait du pain au peuple, comme le gâteau dans la gueule de Cerbère, pour l’empêcher de mordre. Le despotisme est forcé à ces concessions. Il en était à Rome sous les empereurs comme il en est de nos jours à Constantinople ; la crainte des révoltes, des incendies, fait que l’approvisionnement de la capitale, le maintien des vivres â un prix très bas, sont le principal soin du gouvernement ottoman, comme ils étaient l’objet de l’attention spéciale des empereurs romains. J. César, qui avait reconnu aussi l’abus de ces distributions gratuites, mais qui se sentait appuyé de toute la puissance de son génie et de ses victoires, osa frapper un grand coup. Il y avait, dit Suétone (César, 41), avant sa dictature, 320.000 citoyens romains qui recevaient du blé gratis de la république ; il réduisit à 150.000 le nombre de ceux qui durent participer aux distributions[26]. Une preuve évidente qu’à cette époque le travail avait peu d’emploi et de valeur se déduit de ce fait, rapporté par Denys d’Halicarnasse[27] et par Dion Cassius (XXXIX, 24), que beaucoup de Romains affranchissaient alors leurs esclaves, pour avoir une plus grande part aux distributions gratuites, que ceux-ci partageaient avec leurs maîtres. Il faut nécessairement qu’à cette époque le prix des esclaves fait très bas et au contraire le blé à une très haute valeur, puisque c’était une bonne spéculation que d’affranchir ses esclaves. Le montant de la moitié des distributions gratuites, des repas publics, des sportules, des congiaires, de l’argent donné pour acheter les voix dans les élections, devait donc surpasser l’intérêt du capital employé à l’acquisition de l’esclave, plus le profit annuel de son travail, sans quoi personne n’aurait consenti à aliéner ainsi sa propriété. Il existe depuis cent cinquante ans, dans un royaume
voisin de Je crois que la concentration des propriétés foncières dans un petit nombre de familles, la prédominance d’une oligarchie jalouse de ses prérogatives, circonstances qui caractérisent l’état social des cent vingt dernières années de la république romaine et des cent trente dernières de l’Angleterre, peuvent donner une explication satisfaisante du maintien d’un abus universellement reconnu. Dans les deux États on s’est vu forcé de nourrir les pauvres, au risque de leur ôter l’habitude du travail et de les encourager à la paresse, de peur qu’ils ne se jetassent sur les biens des riches et qu’ils ne produisissent une révolution dans le gouvernement. Les deux lois des distributions gratuites et de la taxe en faveur des pauvres, si semblables sous tous les rapports, ont néanmoins produit à Rome et en Angleterre un effet directement opposé relativement à la population. Ce fait curieux, qui n’a point été remarqué jusqu’ici, mérite un examen particulier. Nous avons vu que, lors de la dictature de César, l’an de
Rome 705 (48 avant
J.-C.), le cens exécuté par le dictateur avec un soin minutieux dans
la portion de l’Italie comprise entre les deux mers, les golfes de Tarente et
de Messine, et une ligne tirée de La population libre de l’Italie était donc considérablement diminuée, puisqu’en 599, entre la première et la deuxième guerre punique, cette même portion de l’Italie avait 750.000 citoyens mâles libres, de dix-sept à soixante ans, et il faut remarquer qu’il n’y avait point alors d’étrangers compris parmi les citoyens romains. Cependant, depuis la loi de C. Gracchus, qui date de l’an de Rome 629, les distributions gratuites avaient nourri un très grand nombre de citoyens pauvres[32]. On s’est aperçu en Angleterre que la taxe en faveur des pauvres engage les journaliers ou les ouvriers à donner le jour à un grand nombre d’enfants. Cette classe imprévoyante, assurée que l’État nourrira sa progéniture, ne s’impose ni l’obstacle privatif, ni la contrainte morale, que Malthus lui recommande si fortement comme la base de son bien-être et de son indépendance. Mais à Rome, au VIIe siècle, il en fut autrement. La disproportion des fortunes, la concentration des richesses étaient à la vérité bien plus grandes qu’elles ne le sont de nos jours en Angleterre et même en Russie, puisque, au rapport de Cicéron[33], le tribun Philippe attestait qu’il n’y avait pas alors 2.000 citoyens qui eussent une fortune indépendante : Non esse in civitate duo millia hominum qui rem haberent. La distribution des richesses était devenue tellement inégale qu’il n’y avait plus, dans le peuple romain, que des fortunes colossales, et à côté, l’extrême indigence. La classe moyenne, si utile à l’État, et qui devait former les degrés intermédiaires, était presque entièrement anéantie[34]. Nous avons vu qu’en 705, lors de la dictature de César, sur 450.000 citoyens, 320.000 recevaient des secours de l’État ; ce qui confirme l’assertion de Philippe, tout étonnante qu’elle paraisse ; et cependant nous savons par Dion[35] que, sous Auguste, en 762, il y avait, dans le nombre total des citoyens romains, plus de célibataires que d’hommes mariés. Tacite dit (Ann., III, 25) que, sous Tibère, on fit un rapport dans le sénat sur la nécessité de mitiger la loi Papia Poppæa, par laquelle Auguste, dans sa vieillesse, avait voulu augmenter les punitions portées dans la loi Julia contre le célibat, et en même temps accroître les revenus du fisc. Cette loi n’avait rendu ni les mariages plus communs, ni l’infanticide plus rare. Les mœurs du siècle attachaient à l’orbité trop d’avantages. Par cette loi les célibataires ne pouvaient hériter que de leurs plus proches parents ; hors ce cas, tous les legs qu’on leur faisait par testament revenaient au fisc, à moins que, dans l’espace de cent jours, ils ne se mariassent ; ce qui fait dire à Plutarque que l’on ne se mariait plus pour avoir des héritiers, mais pour l’être. De plus, toutes les lois portées depuis le VIIe siècle de Rome jusqu’à Constantin contre le célibat, les lois en faveur des personnes mariées, les prérogatives accordées à celles qui avaient trois enfants, prouvent évidemment que la pratique du mariage fut de plus en plus négligée parmi les citoyens romains, et qu’on sentait fortement le besoin de propager la population libre. Je vais maintenant rechercher les causes qui me semblent pouvoir expliquer la différence des effets qu’ont produits, relativement à la population, à Rogne et en Angleterre, les deux lois, si semblables entre elles, des distributions gratuites et de la taxe en faveur des pauvres. La première de ces causes est sans contredit la différence des classes sur lesquelles, dans les deux pays que je compare, s’est répandue cette faveur du gouvernement. En Angleterre, ce sont des journaliers ou des ouvriers employés, soit aux travaux agricoles, soit aux manufactures, qui, lorsqu’ils ne peuvent vivre de l’emploi de leurs bras, qu’ils ont trop d’enfants et qu’ils ne peuvent nourrir leur famille par leur travail, sont pris à la charge des paroisses. Rien ne change pour eux, leurs habitudes restent les mêmes ; seulement ils perdent le goût du travail, et, assurés d’une existence misérable, mais viagère, pour eux, leurs femmes et leurs enfants, ils continuent à peupler avec la même imprévoyance qui les a jetés dans la nécessité d’être nourris par la charité publique. La société est surchargée d’une population oisive, ignorante et presque inutile à la production ; mais cette classe est exclue des affaires publiques et ne prend aucune part au gouvernement. A Rome, dans le VIIe
siècle, la population nourrie aux frais de l’État était bien différente ;
450.000 citoyens disposaient du sort d’un empire sept fois aussi étendu que ......
Duas tantum res anxius optat, Panem et circenses[36]. Pour s’être opposés au rétablissement des lois liciniennes, le sénat et ensuite les empereurs se virent contraints de continuer à nourrir et à divertir cette populace fainéante ; car elle était toujours prête à troubler l’État et à se vendre au premier ambitieux qui voudrait la payer. Plusieurs autres causes puissantes s’opposèrent à la reproduction de l’espèce dans la classe des citoyens romains et amenèrent la diminution progressive de la population libre ; je les ai déjà signalées. Ce furent : 1° L’usage fréquent des avortements et de l’infanticide, l’exposition des enfants, l’excessive corruption des mœurs et l’extension des goûts contre nature[37] ; 2° Le défaut de tranquillité et le manque de stabilité dans le gouvernement. Les deux derniers siècles de la république ne sont qu’une convulsion violente : d’abord les commotions excitées par les lois des Gracques, la révolte des esclaves en Sicile, la guerre sociale ; puis, les guerres civiles de Marius et de Sylla, la guerre de Spartacus, la conjuration de Catilina, la guerre de César et de Pompée ; enfin les guerres civiles d’Octave et d’Antoine, des triumvirs contre Brutus et Cassius, d’Octave contre Sextus Pompée, et, en dernier lieu contre Antoine, guerres qui ne furent terminées que par la bataille d’Actium et l’établissement du despotisme impérial. 3° Les avantages attachés au célibat dans toutes les classes des citoyens romains n’eurent pas moins d’influence sur la diminution de la population libre. On sait combien le célibat et l’orbité procuraient aux riches de considération, de présents, de soins et de caresses. Aussi Auguste trouva-t-il, dans l’ordre des chevaliers, dont il fit la revue, beaucoup plus de célibataires que d’hommes mariés ; Dion nous a transmis ce fait (LVI, 1). Dans les classes inférieures, et même parmi les citoyens pauvres, les profits attachés au service militaire, et qu’on ne pouvait obtenir que par vingt ans de célibat, devaient détourner du mariage beaucoup de citoyens. Depuis les guerres civiles la discipline s’était altérée ; les soldats, que les généraux étaient forcés de ménager parce qu’ils étaient les éléments de leur puissance, obtenaient la liberté de piller à leur gré pendant la campagne, et, quand leur parti avait triomphé, ils étaient récompensés par des distributions de terres et de meubles confisqués sur les propriétaires vaincus ou sur les villes rebelles. Sous les empereurs, outre une paie assez forte, ils obtenaient une gratification à l’avènement de chaque prince ; on donnait des terres aux vétérans, à l’expiration de leur temps de service ; on les destinait à repeupler les colonies désertes et on les engageait à se marier ; mais ces vieux soldats, peu accoutumés à se soumettre aux liens du mariage et à élever des enfants, mouraient presque tous sans postérité. Tacite (Annal., XIV, 27) est garant de ce fait curieux, dont il a été témoin oculaire, Après l’extinction de la famille des Césars, le métier de soldat devint encore plus lucratif. Les légions faisaient et défaisaient à leur gré les empereurs ; le donativum ou la gratification s’accroissait à chaque nouvelle élection. Plus tard les armées finirent par mettre l’empire à l’enchère et par le vendre au plus offrant. Aussi, à cette dernière époque, la population libre des citoyens romains était-elle presque éteinte, et on se trouvait forcé de recruter les légions avec des Barbares. 4° Enfin on peut trouver encore une cause de la diminution de la population libre de l’Italie dans l’amélioration progressive de la condition des femmes et des lois sur le mariage[38]. Dans les six premiers siècles de la république, la femme était, pour ainsi dire, comprise dans la catégorie des choses et non dans celle des personnes, puisqu’on pouvait la réclamer, ainsi que les autres meubles, en prouvant l’usage et la possession d’une année entière. Le mari avait le droit de la vendre ; il exerçait sur elle le droit de vie et de mort, et, dans les cas d’adultère ou d’ivrognerie, l’usage autorisait à la tuer ; les biens qu’elle acquérait ou dont elle héritait appartenaient au mari, qui était nommé son maître[39]. Lorsque Rome eut triomphé des Carthaginois, les matrones réclamèrent le droit d’une union libre, égale et indépendante ; elles obtinrent successivement, depuis cette époque jusqu’au règne d’Auguste, des prérogatives au détriment de l’autorité de leurs époux. Les Romains alors se dégoûtèrent du mariage légitime ; le célibat, favorisé par la corruption des mœurs et fournissant à tous les désirs, du pouvoir, de l’argent, des terres, des amants et des maîtresses, devint de plus en plus commun. Cette cause, jointe à celles que j’ai déjà indiquées, explique pleinement, ce me semble, et la diminution de la population dans la classe des citoyens romains et la différence des effets qu’ont produits à Rome et en Angleterre, relativement à la propagation de l’espèce, l’établissement des distributions gratuites de vivres et celui de la taxe en faveur des pauvres. de crois avoir traité complètement la question des lois agraires et de celles qui concernaient les distributions, gratuites, leges agrariæ et frumentariæ, et avoir prouvé que ces deux sortes de lois ont exercé la plus grande, influence sur le sort de la république romaine, sur les mœurs, la population, les produits de l’Italie, enfin sur le rapport des populations libre et esclave, l’équilibre des pouvoirs et la stabilité du gouvernement. Ce n’est pas seulement, comme le titre semble, l’annoncer, un sujet particulier, limité et circonscrit ; c’est une grande question historique qui se rattache à l’ensemble des causes de la grandeur et de la décadence de l’empire romain. Ce sujet n’avait pas même été touché par Montesquieu et Gibbon ; il méritait, je crois, d’être approfondi. Je conclurai maintenant en assurant avec confiance : 1° Que l’établissement des lois liciniennes rendit l’agriculture florissante, fonda la division des propriétés, l’équilibre des pouvoirs, la stabilité et la puissance de la république romaine : trois siècles de prospérité croissante, sous le règne de ces lois, en sont la preuve évidente ; 2° Que l’abrogation de ces mêmes lois fut fatale à la république, fit diminuer la population libre et les produits de l’Italie, surchargea le pays d’esclaves, amena la corruption des mœurs, éteignit l’amour de la patrie et le goût du travail, que remplacèrent la turbulence, la paresse et la vénalité ; 30 Que le rétablissement de la loi licinienne, proposé par Tib. Gracchus, était la seule mesure qui pût alors sauver la république ; que, les usurpations des riches étant récentes et illégales, cette mesure, loin de bouleverser la société, rétablissait entre les trois ordres de l’État une balance de propriétés foncières, de richesses et de pouvoir, nécessaire à leur équilibre ; que, par conséquent, au lieu de regarder les Gracques comme des factieux, on doit voir en eux des hommes d’état qui avaient, sur la nature de la société et celle du gouvernement romain, les vues les plus justes et les plus étendues ; 4° Que l’oligarchie, mue par un vil intérêt personnel, renversant par la violence les lois des Gracques, assassinant un magistrat inviolable, don. nant le premier exemple des guerres civiles et des proscriptions, a porté le coup mortel et à la république et même à sa propre puissance, sans cesse ébranlée, depuis cet attentat, par les séditions, les révoltes et les attaques des chefs ambitieux qui caressaient ou achetaient le peuple pour le soulever contre la noblesse ; 5° Enfin, que l’abrogation des lois liciniennes renouvelées par Tib. Gracchus, de ces lois qui étaient la base fondamentale de la constitution romaine, a forcé le sénat d’adopter les mesures les plus désastreuses, telles que la loi sur les distributions gratuites, l’a privé du droit exclusif de rendre les jugements, l’a fait décimer par les proscriptions et les guerres civiles, lui a ravi tout son pouvoir légitime, et, en dernière analyse, après un siècle de désastres et de calamités, l’a jeté sans défense sous le joug du despotisme impérial. |