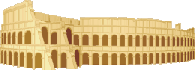ÉCONOMIE POLITIQUE DES ROMAINS
LIVRE TROISIÈME — AGRICULTURE - PRODUITS
CHAPITRE VII. — Exposé de l’agriculture de Varron.
|
Le savant Varron, qui, dans son premier livre sur l’agriculture proprement dite, de agricultura (car le deuxième traite des bestiaux, de repecuaria, le troisième des basses-cours, des parcs et des viviers, de villaticis pastionibus), Varron, dis-je, qui fait exprimer ses idées sur la culture par Tremellius Scrofa ; regardé alors comme le plus habile agriculteur parmi les Romains[1], définit l’agriculture non seulement comme un art, mais comme art vaste et nécessaire, comme une science qui apprend ce qu’il faut semer et faire dans chaque champ, et quelle terre donnera perpétuellement les plus grands produits : Non modo est ars, sed etiam necessaria ac magna. Eaque est scientia, quæ docet quæ sint in quoquo agro serunda ac faciunda, quæque terra maximos perpetuo reddat fructus (I, III). On voit que, depuis Caton, la science a déjà pris un vol plus élevé ; aussi le docte Varron a-t-il soin de nous apprendre (I, I, 7-11) qu’il a extrait les faits les plus importants de cinquante auteurs grecs, parmi lesquels figurent des hommes tels que Hiéron et Attale Philométor, rois de Sicile et de Pergame, Démocrite, Xénophon, Aristote et Théophraste, et qu’en outre il a pris la substance des vingt-huit livres du Carthaginois Magon et de ceux des auteurs romains qui avaient écrit sur cette matière. Il trace (I, I, 1) en peu de mots le plan de son ouvrage, dont un livre est consacré à l’agriculture, l’autre à l’éducation et à l’engrais des bestiaux, et le troisième à la propagation, à la nourriture et à l’engrais des volailles, des poissons et du gibier. Il indique les trois sources dans lesquelles il puisera ses préceptes : Ce sont, dit-il : 1° les faits que j’ai observés en cultivant mes propriétés ; 2° ceux que j’ai trouvé consignés dans les livres ; 3° ceux que j’ai recueillis dans la conversation des agriculteurs instruits. Tum de his rebus dicam, sequens naturales divisiones : ea erunt ex radicibus trinis, et quæ ipse in meis fundis colendo animadverti, et quæ legi, et quæ a peritis audii. Il prescrit d’abord de choisir un canton et un emplacement salubres. Je ne reviendrai pas sur cet objet, que j’ai traité dans le troisième chapitre de ce troisième livre. Il y a, dit Varron (I, V, 2-4) par la bouche de Scrofa, quatre parties principales en agriculture, dont la première est la connaissance du terrain, des qualités du sol, et de son emploi en général et en particulier ; la seconde, ce qui est convenable au terrain et doit déterminer le genre de culture ; la troisième, les frais qu’entraîne la culture de cette propriété ; la quatrième, ce qu’il convient de faire et en quel temps il convient de le faire sur ce terrain. Chacun de ces quatre points comporte au moins deux subdivisions ; le premier renferme ce qui appartient au sol de la terre et ce qui concerne les étables et les villas ; le second, qui embrasse tout ce qui agit et doit être dans la propriété instrument de culture, se partage en deux les hommes avec lesquels on cultive, et les autres moyens d’action ; le troisième, qui traite des choses, enseigne ce qu’il faut préparer pour chaque chose et où l’on doit faire chacune d’elles ; le quatrième est relatif aux temps ou aux saisons, que règlent le cours annuel du soleil et les phases du cours mensuel de la lune. Je traiterai d’abord, dit Varron, des quatre premières parties, et ensuite avec plus de soin des huit secondes. Il est difficile de mettre plus d’ordre, de netteté, de liaison, de sagesse dans l’exposition d’un ouvrage de ce genre et dans la distribution de ses parties principales et accessoires. Nous ne connaissons guère dans l’antiquité qu’Aristote chez qui l’esprit méthodique et la faculté d’ordonner et de déduire soient portés aussi loin ; et l’étonnement redouble quand on songe que cette lucidité, cet ordre, cette précision, cette propriété d’embrasser, de coordonner, de diviser, de disposer enfin si judicieusement l’ensemble et les parties d’un sujet si vaste, étaient le partage d’une tête octogénaire et d’un homme dont la vie avait été remplie par les emplois divers de la guerre, du forum, de l’administration, et par les travaux de la grammaire et de l’érudition. Varron, témoin oculaire, cite (I, VII, 8) un fait curieux sur l’emploi
que faisaient les Gaulois de la marne comme engrais, et du charbon de
certains arbrisseaux brûlés en place de sel. Dans
l’intérieur de C’est la plus ancienne mention de l’usage de la marne en Gaule ; il subsiste encore aujourd’hui ; mais je ne connais aucune province de France où l’on use de charbon en place de sel. Cependant la combustion des espèces de soudes, de salicornes, qui fournit la soude du commerce, pouvait produire un sel approchant du sel marin ou muriate de soude. Varron met, comme je l’ai dit, dans le classement des terres, au premier rang, les bons fonds de prés, et cite ceux de Rosea, près de Riéti, où une perche (pertica), laissée la veille dans une partie rase, ne se voyait plus le lendemain et était déjà cachée par l’herbe qui avait poussé dans l’intervalle[2]. La même rapidité de végétation a été observée dans quelques prairies de la vallée d’Auge, département du Calvados. Varron fait aux vignes le même reproche que nous leur faisons, de coûter autant qu’elles rapportent : Vineam sunt qui putent sumptu fructum devorare (I, VIII, 1-5). Il décrit ensuite les diverses manières de cultiver la vigne ; il distingue les vignes liasses sans échalas, comme celles de l’Espagne et de l’Asie, et les hautains, ou vignes soutenues par un échalas de cinq pieds, tantôt droites, tantôt conduites en festons transversaux sur des perches, des roseaux (l’arundo donax), des cordes, des arbres, comme la plupart de celles de l’Italie. Il décrit ensuite (I, IX, 2-5) les diverses variétés dé terre, froide, sèche, humide, argileuse ou pierreuse, crayeuse ou siliceuse, et veut qu’on approprie les cultures à la nature du terrain. Voilà pourquoi, dit-il, les cultivateurs habiles sèment dans les lieux humides le far adoreum, ou l’épeautre, plutôt que le triticum, ou froment, et au contraire, dans les lieux secs, l’orge plutôt que le far. Quant aux engrais, dit Varron (I, XIII, 4), il faut avoir deux formes à fumier, ou une seule divisée en deux parties. Il faut porter de la ferme dans les champs une portion du fumier fraîche et une autre consommée. Le fumier employé frais est moins bon ; il est meilleur quand il a bien pourri, et qu’on a défendu des ardeurs du soleil, avec des branches garnies de feuilles, la superficie et les côtés du tas ; car il ne faut pas que le soleil pompe d’avance les sucs que la terre réclame. C’est pour y retenir le jus que les cultivateurs habiles y font couler de l’eau, quand ils le peuvent, et que quelques-uns y placent les lieux d’aisances[3]. Toute cette théorie de l’engrais et les méthodes indiquées pour les formes à fumier sont vicieuses et devaient l’être en effet. Nous devons aux progrès de la chimie moderne la connaissance des gaz qui s’exhalent des sécrétions animales ou des substances en putréfaction, et celle de l’influence de ces gaz sur la végétation des plantes. On sait maintenant qu’il y a plus d’avantage à enterrer de suite le fumier dans le champ qu’à le laisser réduire en terreau, parce que, dans ce dernier cas, il perd presque toutes ses parties gazeuses, alcalines et acides, si importantes pour le succès de la végétation. Varron traite ensuite (I, XIV, 2-4) des clôtures, qu’il range en
quatre classes : les haies vives[4], les lices ou les
haies sèches les fossés avec une levée, agger ;
enfin, les murs, maceria, qui sont construits,
ou avec des pierres, comme dans les champs de Tusculum, ou avec des briques
cuites, comme dans Ce passage curieux nous apprend qu’à cette époque, le Ier siècle avant J.-C.,
l’agriculture était assez soignée dans Dans les pays où les clôtures étaient inconnues, les Romains plantaient[7], pour marquer les limites des terres, des arbres, comme des pins, des cyprès et surtout des ormes, arbre qu’ils préféraient à tous les autres, à cause de l’utilité de son tronc comme appui de la vigne, comme bois de chauffage, et de celle de ses branches et de ses feuilles pour la confection des haies sèches et la nourriture des bestiaux. Après avoir traité de la composition de la propriété, de la nature du terrain, de la mesure des terres, du mode de culture, Varron, sous le nom de Scrofa, parle (I, XVI, 2) des choses qui sont hors de la propriété et qui influent puissamment sur la culture, à cause de leur rapport avec elle. Ainsi il faut considérer : 1° si le pays voisin est tranquille ou non ; 2° s’il y a ou non des débouchés faciles pour les produits, des facilités pour se procurer ce qui est nécessaire ; 3° si les routes et les rivières utiles à l’exportation ou à l’importation des denrées sont en bon, en mauvais état, ou s’il n’en existe pas ; 4° s’il y a dans les propriétés limitrophes quelque chose qui nuise ou qui serve à vos terres. Varron donne ensuite des exemples. L’ordre et la méthode de ses déductions sont, je le répète, dignes de toute sorte de louanges ; on peut s’en convaincre par cet abrégé concis, dont je m’abstiens de rapporter les développements. Je ne citerai qu’un seul précepte très sage sur la culture en grand des jardins. Il y a, dit-il (I, XVI, 3), du profit à cultiver en grand, près d’une ville, le jardinage, même les roses et les violettes, et beaucoup de choses que consomme la ville ; tandis qu’il n’y a point d’avantage à le faire dans une propriété éloignée, qui n’a pas de marché ouvert à ces sortes de produits. Itaque sub urbe hortos colere late expedit, sic violaria, ac rosaria, item multa, quæ urbs recipit. Le goût des fleurs était alors si répandu en Italie qu’on cultivait avec fruit des champs de violettes et de roses, tandis qu’aujourd’hui les dames romaines ne peuvent supporter sans s’évanouir l’odeur d’une fleur. Ce fait curieux mérite d’être remarqué. On voit quel progrès le luxe avait fait dans le siècle écoulé depuis Caton le Censeur jusqu’à Varron. |