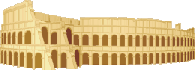ÉTUDE SUR LES LETTRES DE PLINE ET DE TRAJAN
relatives aux Chrétiens de Bithynie.
P. DUPUY, professeur d’histoire au lycée de Bayonne.
|
Dès la publication du dixième livre de Pline le Jeune, des doutes furent ouvertement exprimés sur l’authenticité de la correspondance de Bithynie. Sans nommer personne, Alde s’applique à les dissiper dans l’épître dédicatoire à Aloys Morenigo qu’il plaça en tête de son édition de 1508 ; les rapprochements qu’il y signale avec d’autres lettres du recueil général sont tout à fait concluants, et personne ne doute aujourd’hui que, prise dans son ensemble, la correspondance de Bithynie ne soit réellement l’œuvre de Trajan et de Pline. Les soupçons cependant n’ont pas cessé de s’attacher à deux de ces lettres, les plus curieuses assurément du recueil, la consultation de Pline sur les Chrétiens et le recueil de Trajan (96 et 97, éd. Keil.). A la fin du XVIIIe siècle, une vive polémique fut engagée à ce sujet en Allemagne. Le rationaliste Semler, dès 1767, dans ses Historiæ ecclesiasticæ selecta capita (Halle), signala les invraisemblances nombreuses qui l’avaient frappé dans la lettre de Pline et accusa Tertullien de l’avoir fabriquée. En 1788, il porta de nouveau sur cette lettre les efforts d’une critique plus subtile qu’impartiale, et, par neuf arguments, tirés en partie de la pièce incriminée, il démontra ou plutôt crut démontrer qu’elle était apocryphe. Rédigées en allemand, ces accusations eurent un retentissement plus grand : il les avait fait paraître dans le premier fascicule des Neue Versuche die Kirchenhistorie der ersten Jarhunderte mehr aufzuklären (Leipzig, 1708, pp. 119 à 246). Corrodi les approuva et les reprit pour son propre compte dans les Beiträge zur Beförderung des vernünftigen Denkens in der Religion. La réponse ne se fit pas attendre, et Haversaat leur opposa la Vertheidigung der Plinischen Briefe über die Christen gegen die Einwendungen des H. D. Semlers, (Gœttingue, 1788). Mais ce défenseur de l’authenticité ne laissa pas d’éprouver lui-même des doutes dont se sont moins préoccupés les écrivains ecclésiastiques de nos jours. La lettre 96 est un trop précieux témoignage de la part d’un païen et d’un persécuteur, la réponse de Trajan est un trop beau prétexte de reprendre les déclamations de Tertullien et de tonner contre la cruauté systématique des meilleurs princes à l’égard des Chrétiens, pour que les apologistes attitrés des martyrs reconnus et surtout des martyrs contestés se soient jamais avisée d’émettre ou de signaler le moindre doute sur des pièces aussi probantes et aussi précieuses. Dans sa volumineuse histoire universelle de l’Église catholique, M. l’abbé Rohrbacher ne semble pas même soupçonner que le document qu’il allègue soit sujet à caution ; au reste, il suffit de dire qu’il consacre de longe développements aux épîtres de saint Ignace dont la fausseté est le plus solidement démontrée, reconnue même par d’autres écrivains religieux, pour donner une idée de la critique et des scrupules de cet historien. Esprit incomparablement supérieur, Mgr Freppel n’a pas néanmoins jugé à propos, dans ses Pères apostoliques, d’insister sur les doutes qu’ont soulevés les lettres 96 et 97, et c’est pour mémoire seulement qu’il cite les critiques de Semler, incomplètement d’ailleurs et sans se donner la peine de les réfuter. Tout récemment, la question a été de nouveau débattue par des écrivains qui ont apporté dans l’examen de l’authenticité un esprit dégagé de tout parti pris, libre de tout engagement religieux. M. Aubé, dans son Histoire des persécutions de l’Église jusqu’à la fin des Antonins, a émis de judicieuses raisons contre l’authenticité des lettres sur les Chrétiens, et lorsqu’on a lu sa démonstration si complète, on a peine à comprendre la timidité qui l’a fait revenir à résipiscence dans une note bizarrement conçue. Aussi bien, après avoir démontré que la lettre de Pline et le rescrit de Trajan étaient apocryphes, il a eu beau déclarer qu’il préférait les considérer comme authentiques d’un bout à l’autre que d’en suspecter la moindre partie, sa démonstration et ses objections n’en sont pas moins demeurées acquises, et M. Desjardins s’en est déclaré partisan convaincu dans un article sur Trajan, publié par la Revue des Deux-Mondes en 1874. Dans la Revue archéologique de 1876, M. Boissier a répondu par un article en faveur de l’authenticité et combattu l’opinion de M. Aubé et de M. Desjardins. Cet article a eu le suffrage de M. Renan qui, appréciant dans le Journal des Savants la publication de M. Aubé a déclaré qu’il avait pleine confiance dans l’authenticité du texte que nous possédons. Dans sa remarquable thèse sur Trajan, M. C. de La Berge a consacré quelques pages (208-210) à l’examen des deux lettres, et le rescrit de Trajan seul lui a paru sujet à caution ; Enfin dans la Revue des questions historiques, du 1er juillet 1878, M. l’abbé Joseph Variot a entrepris à son tour de réfuter l’opinion de MM. Aubé et Desjardins en montrant que la lettre 96 répond bien aux faits d’un ordre général contenus dans l’ensemble de la correspondance, et qu’aucun témoignage ne la contredit. Nous ne nous proposons pas précisément de revenir sur toutes les opinions différentes émises dans ce débat et de les examiner une à une. Nous avons entrepris cette étude avec la conviction bien arrêtée que, si les lettres 96 et 97 étaient l’œuvre de faussaires, il était impossible qu’elles n’en portassent pas la marque en elles-mêmes, qu’il n’y eût point dans d’aussi longs morceaux quelque inconséquence ou quelque contradiction capable de nous éclairer sur la valeur du texte. C’est ainsi que les auteurs des correspondances apocryphes se trahissent la plupart du temps. Nous avons donc soumis les diverses parties des lettres 96 et 97 à un examen comparatif, trop négligé peut-être jusqu’à présent ; nous avons voulu voir si, comme le dit M. Aubé, ces parties concordaient bien entre elles ; et c’est de cette critique que nous tirerons nos conclusions. Solemne est mihi, Domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest menus vel cunctatianem meam regere, vel ignorantiam extruere ? — Ce début a paru suspect à Semler. Pourquoi Pline juge-t-il à propos d’exposer en tête de cette lettre une règle de conduite qui était celle de tous les légats impériaux ? Et d’ailleurs n’était-ce pas aux juges de la province qu’il devait s’adresser tout d’abord pour éclaircir ses doutes ? Cette objection est sans valeur. Nous savons au contraire que la règle de conduite de Pline n’était guère que la sienne ; envoyé comme réformateur dans une province sénatoriale, il avait reçu de Trajan la permission de le consulter toutes les fois qu’il se trouverait embarrassé ; s’il avait fallu que l’empereur entretint une semblable correspondance avec tous les gouverneurs de province, son temps n’aurait jamais suffi. Semler, d’ailleurs, s’en est pris ainsi le plus souvent à des lambeaux de phrase insignifiants, et il a dispersé sans grand profit ses efforts mal dirigés : le parti pris est chez lui trop évident et l’expose à l’accusation de partialité. Cognitionibus de CAristiauis inter quatenus aut puniri soleant quæri. — On a instruit contre les Chrétiens, s’écrie M. Aubé ; qui donc ? où ? et quand ? C’est là une première objection très importante : si nous admettons qu’avant Trajan il n’y avait pas eu d’action régulière contre les Chrétiens, il est inutile de pousser plus loin l’examen de la lettre : elle n’a plus de raison d’être, c’est une consultation sans motif, contraire aux faits et par conséquent apocryphe. Mais il suffirait au besoin d’invoquer Tacite et Suétone, de rappeler dans quels termes le premier parle de la persécution de Néron, le second de. celle de Domitien, pour montrer qu’à l’époque où écrivaient ces deux amis de Pline, sous les Antonins, les préventions de l’opinion publique contre le Christianisme étaient telles que le gouvernement impérial ne pouvait s’empêcher d’en subir la tyrannie et de leur donner satisfaction. Odio generis humani convicti sunt, dit Tacite : Ils furent condamnés par la haine du genre humain. Le vulgaire les avait en horreur, propter flagitia, à cause de crimes le plus souvent mal définis, dont l’idée s’était confondue d’abord avec les accusations qui s’élevèrent toujours contre les Juifs, et qui, depuis que le Christianisme commençait à se détacher plus vivement sur le fond obscur du Judaïsme, avaient emprunté leur principal caractère aux pratiques des nécromanciens et des magiciens. Dans le mysticisme de la primitive Église, chaque fidèle se croyait appelé à participer aux révélations de l’Esprit-Saint, se regardait comme un dépositaire de la puissance divine : opérer une guérison miraculeuse, chasser l’esprit malin d’un corps qu’il possédait, ce n’était point le privilège de quelques élus, mais une œuvre de foi naïve et ardente dont tout néophyte convaincu n’avait garde de se juger incapable : Cette foi seule dans leur pouvoir surnaturel faisait tomber les Chrétiens sous le coup des lois qui défendaient la magie. D’un autre côté, l’État élevait contre eux un grief qui, pour être moins répandu dans la foule, n’en était pas moins grave : un seul mot le désignait et le condamnait : ignavia. (Suétone, Domitien, XV.) Le goût de la retraite, dit M. Renan dans le Journal des Savants, la recherche d’une vie paisible et retirée, l’aversion pour les théâtres, les spectacles et les scènes cruelles que la vie romaine offrait à chaque pas, les relations fraternelles avec des personnes d’un rang humble, n’ayant rien de militaire, que les Romains méprisaient ; enfin, l’éloignement des affaires publiques étaient inséparables du Christianisme. La société romaine ne pouvait pardonner cette lutte d’inertie, cet abandon total des devoirs et des honneurs de la vie civique, qui était comme une part de la religion de l’État. Il aurait donc été étonnant qu’elle ne se prémunit point contre ceux qui affectaient de la mépriser, et ne tachât pas de s’en débarrasser légalement. M. E. Le Blant, essayant dans un mémoire très seyant de reconstituer le De officio proconsulis d’Ulpien, en ce qui regardait les Chrétiens, a pensé que des armes spéciales n’avaient point été nécessaires contre eux, et que les principaux caractères du Christianisme étaient autant de points vulnérables qui appelaient l’attaque. Mais ce n’est pas une raison pour qu’il n’y ait jamais eu de dispositions particulières contre les Chrétiens ; il est fort probable au contraire que, s’ils se montraient par tant de côtés rebelles aux principales lois de l’État, la législation fut promptement simplifiée à leur égard, et les différentes lois qui avaient servi tout d’abord à les condamner, résumées en une simple interdiction qui rendait désormais la procédure facile : le simple aveu de christianisme supprimait toute enquête, tout interrogatoire sur des points particuliers, et la condamnation était d’autant plus sûre que le texte de loi était plus bref, plus précis, prêtait moins à l’interprétation. Ce serait là une hypothèse très naturelle, mais une simple hypothèse, si M. Boissier n’avait démontré par le rapprochement d’une foule de textes presque identiques, que cette interdiction existait réellement et qu’elle était formulée à peu prés en ces termes : Non licet esse Christianos. Le magistrat, dit-il, rappelait à l’accusé ce décret sommaire et terrible ; à quoi l’accusé répondait s’il était fidèle : Christianus sum, et la cause était entendue. Il y avait donc, à l’époque où Pline était en Bithynie, une législation très simple, ouvertement hostile au Christianisme, et si la persécution n’était pas déchaînée, c’est que le gouvernement impérial n’avait encore dérogé que dans de rares exceptions au principe de droit qui défendait à la justice de rechercher et de poursuivre : Ubi non est accusator, non est judex. La persécution n’existait pas à l’état latent. Tant que l’État ne se fit pas accusateur, il n’y eut que des procès isolés, et, condamné en principe, le Christianisme ne fut persécuté en fait que le jour où la justice publique ne se borna plus à punir quand l’occasion s’en présentait, mais rechercha elle-même l’occasion d’appliquer la loi. C’en est assez pour établir qu’à l’époque de Pline, des Chrétiens avaient été accusés et jugés : le bruit en était venu sans doute jusqu’à lui, mais les dénonciations et les procès n’avaient pas été assez nombreux pour que Pline connût quelle procédure on avait suivie. On alléguera avec M. Aubé qu’il avait exercé toutes les charges publiques, y compris la préture et le consulat, que, pendant plus de vingt ans, il n’avait pas quitté le barreau, et l’on pourra s’étonner à bon droit que, si les Chrétiens avaient été poursuivis, un avocat, un jurisconsulte, un légat impérial ne sût ni de quoi on les accusait, ni pourquoi on les punissait, ni quelle peine on leur faisait subir, ne connût rien de ce qu’on statuait à leur égard. Mais aucune de ces assertions ne prévaut contre ce que Pline nous apprend lui-même de son ignorance du droit et de son aversion pour les affaires publiques qui lui prenaient une part de sa vie. Tantôt (I, 9) il plaint Minatius Fundanus de ne pouvoir s’arracher au bruit, aux vains tracas, aux labeurs ineptes de Rome, et lui rappelle le joli mot d’Atilius : Mieux vaut ne rien faire que faire des riens. Tantôt (II, 8) il envie le sort de Caninius, qui se repose sur les bords de son cher Larius, et maudit les chaînes qui le retiennent lui-même à Rome. Enfin, pour qui a lu la quatorzième lettre du huitième livre, il n’est pas douteux que s’il mettait quelque affectation à marquer son dégoût de la vie publique, il avait certainement reçu une instruction, une éducation juridique très imparfaite. Il y marque, comme Tacite avait fait pour l’éloquence, les causes qui avaient amené la décadence des études de droit. Il est donc très probable, qu’esprit curieux surtout des choses purement littéraires, il ne compléta guère ses études juridiques inachevées, il oublia de se tenir au courant de ce qui fut changé ou ajouté à la législation romaine, comptant sur de doctes amis, comme Ariston, pour éclairer son ignorance lorsque la nécessité le forcerait à consulter. Quoi d’étonnant alors, s’il n’a pas connu les prescriptions qui s’appliquaient aux Chrétiens, s’il n’a pas mieux connu les Chrétiens eux-mêmes que ne faisaient Tacite et Suétone ? Ainsi, il n’y a pas de raison pour s’arrêter à la seconde objection de M. Aubé, la première une fois écartée. Mais il faut d’autre part s’en tenir au texte lui-même : des Chrétiens sont dénoncés, Pline sait que d’autres chrétiens ont été jugés, mais ignorant complètement sur quoi doit porter l’interrogatoire, pourquoi et dans quelle mesure les accusés doivent être punis, il en réfère à l’empereur. La phrase n’admet aucune explication, étant par elle-même très claire et très explicite : Pline ne sait qu’une chose, c’est qu’il y a une procédure contre les Chrétiens, puisqu’on les accuse ; quelle est-elle ? il l’ignore et il s’informe auprès de l’empereur. Rien en réalité n’autorise l’hypothèse de M. Boissier, que Pline connaissait la loi non licet esse Christianos, mais qu’elle l’embarrassait, qu’elle l’effrayait par sa rigueur, et qu’il se résigna tout d’abord à l’appliquer, sauf à demander à l’empereur s’il n’y avait pas un moyen de l’adoucir. Si prodigue de considérations morales dans le Panégyrique, Pline s’en est abstenu complètement ici : il a raconté les faits, et rien que les faits. En résumé, la phrase prise en soi n’excite aucun soupçon : elle établit une situation possible et vraisemblable ; rien n’autorise à la révoquer en doute ou à la commenter ; nous l’acceptons telle qu’elle est, et elle ne deviendra suspecte que si, dans la suite ; quelque autre phrase de la lettre vient contredire la donnée première qu’elle fournit, savoir : ignorance complète de la procédure suivie contre les Chrétiens. La phrase qui suit ne se présente pas dans d’aussi favorables conditions : Nec mediocriter hæsitavi sitne aliquod discrimen ætatum, an quamlibet teneri nihil a robustioribus differant, detur pœnitentiæ venia, an ei qui omnino Christianus fuit desisse non prosit, nomen ipsum si flagitiis eareat, an gitia cohœrentia nomini puniantur. — Tout d’abord, le fait que Pline demande s’il faut établir une différence entre les enfants et les hommes faits semble à bon droit bizarre. Semler prétendait qu’à ce passage la trace du faux était manifeste : il y voyait une allusion à la grâce surnaturelle du baptême qui consacre l’enfant au Christ aussi complètement qu’un homme maître de sa volonté, et le rend ainsi passible au même titre des peines édictées par la loi. Ces raisons sont pitoyables ; nous ne nous en rangeons pas moins à l’avis de Semler : il y a ici trace de faux. Ce qui révèle la main d’un chrétien, c’est l’idée du martyre, si éclatante dans l’épître de saint Ignace aux Romains, si vive dans la secte nouvelle aux époques de persécution acharnée, qui entraîna à la mort des enfants et des femmes. M. Renan, dans son livre sur les Apôtres (p. 379), racontant l’horrible boucherie qui fit périr d’un seul coup à Téhéran la secte des Bâbis en 1852, rapporte une description de M. de Gobineau, où l’on voit s’avancer entre les bourreaux des enfants et des femmes, les chairs ouvertes sur tout le corps, avec des mèches allumées flambantes, fichées dans les blessures ; un petit garçon âgé de quatorze ans et rouge de son propre sang, les chairs calcinées, se fait égorger sur la poitrine de son père. Mais de semblables horreurs ne peuvent naître que du choc de deux fanatismes également exaltés, au milieu de populations barbares et violentes. Alors, sans doute, le fanatisme des persécutés donne aux enfants le courage de subir le martyre, et le fanatisme des persécuteurs donne aux bourreaux le courage d’infliger le martyre à ces êtres petits et faibles. Mais se peut-il qu’à une époque assez peu troublée par les passions religieuses pour qu’un gouverneur de province ignorât les lois dirigées contre une secte nouvelle, Pline ait eu un seul instant la pensée que des enfants pussent bien être traduits devant son tribunal, et que, victimes d’une religion imposée ou martyrs volontaires, ils pussent sur son ordre être livrés au supplice ? car c’est là le châtiment provisoire dont la lettre 96 veut que Pline ait fait choix pour rassurer sa conscience inquiète. La chose paraît tout à fait invraisemblable, et la première question que Pline adresse â l’empereur est, à notre avis, un des arguments les plue forte contre l’authenticité de la lettre. Mais ce n’est pas tout, et cette phrase qui commence par une invraisemblance se termine par un non-sens. Que punit-on ? demande Pline. Est-ce le nom lui-même, si aucun crime n’y est attaché, ou les crimes attachés à ce nom ? L’opposition est trop fortement marquée entre cohœrentia nomini, flagitia et si flagitiis (nomen) careat pour qu’on puisse traduire ces derniers mots ainsi : s’il n’est accompagné d’aucun crime ; le texte oppose bien l’un à l’autre le nom qui entraîne crime et celui qui ne l’entraîne pas. Mais alors comment Pline peut-il demander lequel des deux on punit ? La supposition préalable d’un châtiment nécessaire supprime l’alternative : si l’on punit, un, homme parce qu’il porte le nom de Chrétien, c’est que porter ce nom est un crime, et dire qu’il n’entraîne pas crime (flagitiis caret) est un non-sens. Ce n’est pas plus le flagitium que le nomen qui mérite châtiment, puisque le nom seul est un crime, et que le crime est précisément de porter ce nom (nomini flagitia cohœrent). Comme tout à l’heure, nous surprenons ici sur le fait une main chrétienne, non, comme pense Semler, parce que cette question suppose la connaissance de ce que plus haut Pline. déclarait ignorer (dans l’incertitude où il se trouvait, sa première pensée devait être de demander aux accusés l’aveu de leur foi) ; mais, interrogeant l’empereur sur un point de droit, Pline aurait fait la distinction entre les crimes étrangers au nom de chrétien et le crime constitué par ce nom même ; or les termes mêmes de la phrase ne comportent pas cette distinction : il n’y en a qu’une visible, celle que les Chrétiens établissaient tout naturellement entre l’idée qu’ils avaient eux-mêmes de leur nom, et celle que les païens s’en faisaient d’après le non licet. Ils répètent partout, dit M. Boissier, qu’on ne les accuse que d’être chrétiens (Saint Justin, Ire Apologie, 4), qu’on ne leur reproche que leur nom (Tertullien, Apologie, 5), et Tertullien arme à deux reprises que la sentence qui les condamne ne vise d’autre crime que celui-là (Ibid., 2 ; Ad nat., I. X). Nous pourrions ajouter à ces citations le passage de la lettre 96 où le faussaire chrétien, dominé par sa propre pensée, met un non-sens sous la plume d’un juge romain et païen. Les mesures provisoires que Pline aurait prises en attendant la réponse de Trajan ne sont pas moins extraordinaires que ses questions. Interim, dit la lettre, in iis qui ad me tanquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum. Interrogavi ipsos an essent Christiani. Confitentes iterum ac tertio interrogavi, suplicium minatus ; perseverantes duci jussi. — Il n’y a tout d’abord aucun doute sur le sens de duci jussi. Haversaat a beau accumuler les exemples pour prouver que duci jussi veut dire ici je les ai fait conduire en prison, les exemples ne font rien à l’affaire. Si l’accusé menacé du supplice a persisté dans son crime, c’est au supplice qu’il est conduit et il faut évidemment sous-entendre après duci jussi, ad supplicium. Mais quoi ! Pline ignore ce qu’il faut punir dans les Chrétiens et dans quelle mesure il faut punir ; il demande à l’empereur de lui enseigner sur ce point son métier de juge, et dans l’incertitude, dans l’ignorance où il se trouve, voilà comment il l’exerce. Cet homme humain et timoré à l’excès ne sait quelle peine légale il doit prononcer, et provisoirement il inflige le dernier supplice. Pour quelqu’un qui craint si souvent d’excéder les limites de son pouvoir et qui doit le craindre ici plus que jamais, puisqu’il les ignore, c’est, il faut l’avouer, une manière étrange de lever ses scrupules que d’exercer ce pouvoir dans toute sa rigueur. Le faussaire l’a bien senti, et c’est ce qui nous a valu cette excuse ridicule : Neque enim dubitabam, qualecumque essel quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. — Pline clans le reste de sa correspondance peut apparaître comme un gouverneur faible, timide, aveugle, si l’on veut, mais il est incapable de se rassurer lui-même par d’aussi mauvaises raisons, et ses défauts ne sauraient s’accorder avec un pareil abus du pouvoir absolu. Si l’auteur de la lettre avait assez attentivement lu les lettres de Pline pour être capable d’en imiter aussi parfaitement le style, il faut avouer qu’il avait étudié avec moins de soin le caractère de son auteur, et que son œuvre, au moins par ce côté, ne saurait mériter le nom de Plinienne. En aucun cas, d’ailleurs, la rigueur de ces mesures provisoires ne saurait s’expliquer, et puisque la lettre annonce à la fin que tout est suspendu jusqu’à ce que la réponse de l’empereur soit arrivée, nous ne voyons pas ce qui a empêché le juge ignorant de tout suspendre dès qu’un chrétien a été déféré à son tribunal. Nous passerons sous silence les puériles objections de Semler, contre les mots diffundente se crimine, ture ac vino supplicarent, pour examiner la façon même dont Pline interroge ceux qu’avait dénoncés le libelle anonyme. Qui negabant esse se Christianos aut ficisse, cum, præeunte me, deos appellarent, et imagini tuæ quam propter hoc jusseram cuni simulacris numimum adferri, ture ac vino supplicarent, præterea maledicerent Christo, quorum nihil cogi posse dicuntur qui sunt revera Christiani, dimittendos esse putavi. — Que Pline, sachant seulement que des Chrétiens avaient été punis, ait demandé tout d’abord à ceux qu’on lui amenait s’ils étaient Chrétiens, rien de mieux, et nous avons dit que nous n’admettions pas sur ce point les critiques de Semler ; mais, sans parler du præeunte me réservé aux cérémonies officielles où Pline, à la tête de ses administrés, se rend au temple pour célébrer le renouvellement de l’année ou le natalis de l’empereur, il est difficile d’admettre que Pline ait soumis à cette épreuve ceux qu’on accusait de christianisme, s’il avait ignoré le fond même de cette accusation et le motif pour lequel on les punissait. Si, pour les absoudre, il ne se contente pas de la déclaration Je ne suis pas chrétien, et leur demande d’adorer les dieux de l’empire, c’est qu’il sait ce qu’on leur reproche, c’est qu’il connaît la procédure qu’on a toujours suivie contre eux. Peut-on croire qu’il y ait là un pur hasard, ou que quelqu’un l’ait renseigné, puisqu’il consulte l’empereur en déclarant qu’il ne sait rien, et que, d’ailleurs, la dénonciation est anonyme ? Quant aux mots maledicerent Christo, ils ont paru suspects même à l’un des plus ardents défenseurs de l’authenticité, à Haversaat. Aussi Gierig a-t-il allégué un passage du De natura deorum (I, 44), et un du De ira, de Lactance (VIII, 4) pour proposer valedicerent ; mais il nous paraît évident qu’il y a ici une allusion à la coutume juive, mais exclusivement juive, de renier le Messie et de forcer les Chrétiens à le renier toutes les fois qu’ils le pouvaient. Un semblable procédé n’était pas conforme à l’esprit même de la loi romaine : elle ne demandait, surtout à cette époque de scepticisme, que la stricte observation des pratiques religieuses officielles, elle n’atteignait que la conduite extérieure et s’inquiétait peu du fond même de la pensée ; au contraire, les droits de la conscience avaient été de tous temps respectés, et il suffit pour le prouver de citer le passage célèbre de Tite-Live, relatif aux Bacchanales (XXXIX, 18) : Ne qua bacchanalia Romæ neve in Italia essent. Si quis tale sacrum solemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo se id omittere posse apud prætorem urbanum properetur, prætor senatum consuleret ; si ei permissum esset, quum in senatu centum non minus essent, neu qua pecunia communis, neu quis magister aut sacrorum sacerdos esset. Il paraît donc impossible d’admettre que, malgré son ignorance, Pline, qui avait étudié Tite-Live, ait violé un principe général de droit aussi connu que celui-là, en forçant les accusés à renier le Christ après avoir rendu aux statues des dieux et de l’empereur les hommages qu’ils leur devaient. La déclaration qui suit sur les coutumes des Chrétiens et sur le caractère de leur religion, pourrait paraître peu naturelle dans la bouche d’apostats, et l’on se demande comment ils ont pu abandonner un culte dont ils s’accordent à faire un si bel éloge. Ce qui frappe davantage encore, c’est qu’il soit ici question d’un décret de Pline et d’une lettre de Trajan contre les hétairies, dont il n’existe pas traces dans le reste de la correspondance. On s’étonne en outre qu’après avoir parlé d’un décret interdisant les hétairies, Pline trouve une déclaration où sont mentionnées les assemblées nocturnes tellement favorable aux Chrétiens, qu’il met deux esclaves à la torture pour en tirer des accusations plus graves, comme si le fait de se réunir la nuit n’avait pas constitué un crime de lèse-majesté, et provoqué de tous temps l’application d’une loi rigoureuse. Mais surtout le passage de Tertullien qui se rapporte à cette lettre, ne laisse subsister aucun doute sur le sens du mot sacramentum qui est employé ici : c’est le sens chrétien de sacrement, et Pline ne pouvait le connaître, à plus forte raison il ne pouvait l’inventer, puisqu’il avait affaire à des Grecs et qu’il est censé traduire leur déposition. Néanmoins, M. Boissier est disposé à admettre tout cela, parce qu’il lui semble inadmissible, malgré les doutes favorables aux Chrétiens, qu’un chrétien zélé ait pu accuser ses frères d’obstination inflexible, de superstitions criminelles et surtout d’apostasie. Ceux, dit-il, qui pour le triomphe de leur doctrine n’hésitaient pas à inventer des livres faux, n’étaient pas des indifférents, des tièdes, c’étaient des fanatiques tellement convaincus de la justice de leur cause et de la nécessité de son succès que, pour l’avancer, aucun moyen ne semblait coupable. Ceux-là, ne sont pas des gens à se contenter de peu : il faut qu’ils se rendent à eux-mêmes et à leur parti un témoignage complet, et qu’ils se ménagent un triomphe retentissant. Mais quel heureux moyen, en vérité, d’assurer un triomphe retentissant à sa cause, que d’avancer des faits manifestement contraires à la vérité et qui révéleraient aussitôt la main du faussaire, et d’attribuer à un juge païen qui condamne provisoirement les Chrétiens au supplice, un éloge, sans restriction, de ceux qu’il fait périr. Il fallait bien faire la part du feu, et l’auteur de la lettre nous paraît avoir assez mal conçu le caractère de Pline le Jeune, pour que nous ne soyons nullement disposés à regretter une autre preuve de sa maladresse. Si néanmoins nous poursuivons l’examen de la lettre 96, nous avons lieu de nous étonner du résultat étrange auquel aboutit la torture des deux diaconesses. Leur réponse confirma la déposition des apostats, puisque le juge se sentit ébranlé au point de tout suspendre jusqu’à nouvel ordre ; et, malgré cela, il traite ces réponses de superstitio prava et immodica, expressions à peine moins fortes que pertinacia et inflexibilis obstinatio, dont la punition a été la mort. Enfin, les dernières phrases de la lettre achèvent de confirmer nos doutes sur son authenticité. N’y a-t-il pas lieu de s’étonner, dit M. Aubé, de ce passage d’un document officiel ou l’explosion de la secte nouvelle dans une province est si vivement attestée, qu’on attribue à son succès et à ses envahissements le délaissement des temples, l’interruption des cérémonies et des sacrifices solennels ? Saint Pierre, il est vrai, avait adressé sa première épître aux fidèles de la Bithynie ; Saint Paul avait évangélisé la province voisine de Galatie ; on peut croire que le nombre des églises était assez considérable, qu’il s’en était fondé une à côté de chaque synagogue, et les Juifs étaient nombreux dans l’Asie Mineure ; mais il est impossible d’admettre qu’au commencement du deuxième siècle le Christianisme se soit déjà établi quelque part comme religion dominante, et ait tué les cultes païens. Tacite dit bien que Néron avait fait périr une grande multitude, mais dans cette multitude tous n’étaient certainement pas chrétiens, et l’empereur, uniquement préoccupé de détourner les soupçons et de venger avec éclat l’incendie qu’il avait ordonné lui-même, dut accueillir sans contrôle la plupart des dénonciations. Au reste, les Chrétiens auraient pu former une grande multitude à Rome, sans que la proportion entre leur nombre et celui des païens fît pencher la balance en leur faveur. Quant au passage de Tertullien (Apologétique, 57) où il s’écrie que, si les Chrétiens se retiraient de l’empire, il deviendrait un désert, c’est une pure exagération de rhétorique ; les païens auraient pu lui répondre sans se préoccuper d’autre chose : Où se retireraient-ils ? Chez les Barbares de la Germanie ou bien chez ceux de la Scythie ? Deux passages d’Origène dont la contradiction n’est qu’apparente, permettent d’affirmer sérieusement que les Chrétiens, même au troisième siècle, n’étaient pas encore aussi nombreux que la lettre 96 les représente au commencement du deuxième. Au chapitre 26 du livre I, contra Celsum, Origène demande à son adversaire : Άρα τό έν τούτοις τοϊς έτεσι βουληθέντα σπεϊραι τόν έαυτοΰ λόγον καί διδασκαλίαν τόν Ίησοΰν τοσοΰτον δεδυνήσθαι, ώς πολλαχοΰ τής καθ̕ ήμάς οίκουμένης διατεθήναι πρός τόν λόγον αύτοΰ ούκ όλίγους Έλληνας καί βαρβάρους, σοφούς καί άνοήτους.... — Sans cela, sans être fils de Dieu, le Christ voulant répandre sa doctrine, aurait-il pu y convertir, en si peu d’années, un grand nombre de Grecs et de Barbares, de savants et d’ignorants ? — Ici Origène célèbre la diffusion rapide du Christianisme, mais les expressions dont il se sert ne prouvent rien pour le nombre même des Chrétiens. Par exemple, ne dirait-on pas aujourd’hui d’une ville de France, où le quart des habitants appartiendraient au culte réformé : les protestants y sont nombreux ? Ce mot de nombreux résulte d’une comparaison mentale entre la diffusion présumée de la religion nouvelle en un temps donné, et sa diffusion effective. En disant que le Christianisme a opéré de nombreuses conversions, Origène ne veut pas dire qu’il y ait plus de chrétiens que de païens, mais seulement plus de chrétiens qu’on n’aurait pu l’espérer après si peu de temps, et il voit là une preuve de la divinité du Christ. Dans l’autre passage, au contraire, Origène ne considère pas le nombre des Chrétiens en soi, mais il le compare à celui des païens et il déclare cette fois qu’il est très restreint : Τί χρή νομίζειν εί μή μόνον, ώς νΰν, πάνυ όλίγοι συμφωνοΐεν, άλλά πάσα ή ύπό τών ̔Ρωμαίων άρχή ; — Qu’arriverait-il si tous les sujets de Rome, et non pas un tout petit nombre comme aujourd’hui, reconnaissaient la divinité du Christ ? — Ce passage ne contredit pas nécessairement le premier, comme a pensé M. Boissier, puisque Origène ne se place pas au même point de vue : il pouvait, sans se mettre en contradiction avec lui-même, dire que le Christianisme avait fait de grands progrès et, pour une religion naissante, acquis de nombreux adeptes, mais que ce nombre n’était qu’une très faible partie des sujets de l’empire, si on le comparait à celui des païens. Le dernier passage cité d’Origène conserve donc toute sa valeur, toute son autorité ; ce témoignage ne peut être taxé d’inexactitude, et, s’il en était ainsi au troisième siècle, nous avons peine à croire que cent ans auparavant, à l’époque de Pline, on ait pu prétendre le contraire sans s’écarter maladroitement de la vérité. D’ailleurs, dit la lettre, les mesures adoptées ont produit d’excellents résultats : les temples se remplissent, les cérémonies longtemps interrompue sont de nouveau célébrées, et les victimes se vendent ; elle conclut en exhortant l’empereur à la clémence : ex quo facile est opinari quæ turba hominum emendari possit, si sit pœnitentiœ locus. — Après tant d’autres arguments contre l’authenticité de la lettre, nous n’insisterons pas sur cette singulière conclusion : si les rigueurs provisoires de Pline ont produit d’aussi bons effets, il est étrange qu’il invoque sa cruauté même pour réclamer la mansuétude impériale. Le faussaire s’est rappelé trop tard que Pline était une âme douce et compatissante, mais il a oublié que lui-même en avait fait un persécuteur farouche. Ainsi, dans toute cette lettre, il y a peu de passages qui n’appellent la critique, et moins encore qui la supportent. Une seule chose est possible, et elle est donnée par la première phrase, c’est que des Chrétiens aient été amenés devant Pline. Mais où et quand ? M. Mommsen pense que la lettre qui concerne ces procès a été écrite pendant la tournée dans le Pont ; mais comment se fait-il que rien n’indique sa provenance ? Nous savons par Eusèbe qu’Amastris était le siège d’un évêché, centre des églises du Pont, mais il n’est pas question d’Amastris dans le long document que nous venons d’examiner : on n’y trouve pas un seul renseignement précis, tout y est vague et général ; tandis que dans d’autres affaires Pline marque l’endroit où il jugeait, il ne dit pas un mot qui puisse faire soupçonner où il a reçu la dénonciation anonyme, olé les esclaves ont été mises à la torture. Même en admettant que l’attention de Pline n’ait été attirée sur les Chrétiens qu’à la suite des mesures provoquées par son décret contre les hétairies, décret dont la correspondance n’offre pas de trace, en est tout étonné qu’il parle de la répression du Christianisme avec si peu de précision, sans informer Trajan d’aucun des détails qui ont précédé les procès. De toutes ces observations il résulte que si la lettre n’est pas entièrement contraire aux faits vrais ou possibles, elle n’a pas du moins été écrite par le personnage auquel on l’attribue ; elle trahit en plusieurs endroits la main et surtout la pensée d’un faussaire préoccupé d’établir un témoignage favorable aux Chrétiens et d’exagérer la rigueur des persécutions. Dans le rescrit impérial, on s’est borné à introduire une phrase souvent citée, très vague d’ailleurs en elle-même et qui porte dès les deux premiers mots le caractère habituel des interpolations : Neque enim in universum aliquid quod quasi certam formam habeat constitui potest. — Ce sont là des mots vides dans le goût de Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam. On y sent l’épuisement d’un faussaire à bout d’haleine, qui n’a plus rien de précis à dire et qui n’ose se répéter. Ils ont en outre l’inconvénient grave de contredire l’esprit même de la lettre. Quand on ne lit qu’à partir de conquirendi non sunt, on voit dans cette fin si nette, si conforme aux réponses de Trajan, la règle générale qu’il prescrit à Pline pour l’application de la loi : Non licet esse Christianos. Si l’on se reporte à la phrase précédente, on se demande alors ce qu’elle signifie, et pourquoi l’empereur, au moment où il s’apprête à instituer un précepte général, déclare précisément qu’il n’en fera rien, par la bonne raison que la chose est impossible. A part cette phrase malheureuse, le rescrit de Trajan nous parait authentique, et il en résulte que Pline s’occupa effectivement des Chrétiens de Bithynie et écrivit à leur sujet. Mais la lettre que nous possédons n’est pas celle qu’il a écrite. Si l’on en juge par le rescrit de l’empereur, Pline lui avait simplement annoncé qu’il avait puni selon la loi des Chrétiens dénoncés, et comme la religion nouvelle était déjà assez répandue dans sa province et les dénonciations anonymes fréquentes, demandé l’approbation de l’empereur avec une règle de conduite pour l’avenir. Voilà le thème sur lequel on a exécuté une variation assez habilement développée sans doute dans son ensemble, mais trop libre, parfois incohérente, et surtout dans un ton fort éloigné de celui de Pline. A quelle époque eut lien la substitution ? Pline était probablement mort lorsque sa correspondance avec Trajan fut publiée par des amis : un chrétien lettré put donc de bonne heure remplacer dans son exemplaire la brève missive de Pline par le long morceau que nous possédons, et le répandre parmi ses coreligionnaires. La chose était faite à l’époque de Tertullien, qui s’empare sans scrupules de la lettre apocryphe, comme il cite ailleurs les actes de Pilate à Tibère. Nous ne pouvons affirmer qu’on n’ait pas réclamé, sous prétexte qu’aucune réclamation ne nous est parvenue ; d’ailleurs, le recueil de Pline n’étant pas la propriété exclusive des Chrétiens, il est certain que, malgré la diffusion du texte apocryphe après le triomphe du Christianisme, des exemplaires contenant la lettre véritable durent subsister pendant longtemps. Ont-ils été détruits systématiquement au moyen âge ? Il est permis de le supposer, mais on ne peut rien affirmer, puisqu’on n’a jamais connu qu’un seul manuscrit. Peut-être la découverte d’un nouveau manuscrit d’une recension païenne permettra-t-elle un jour de rétablir à sa place la lettre authentique de Pline. Annales de la Facultés des Lettres de Bordeaux — 1880 |