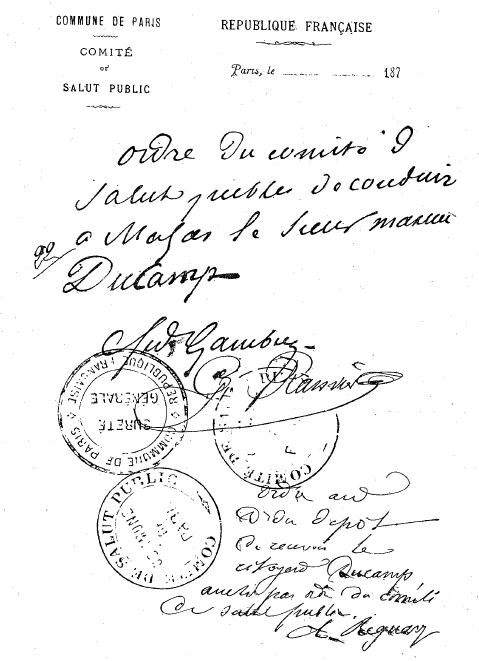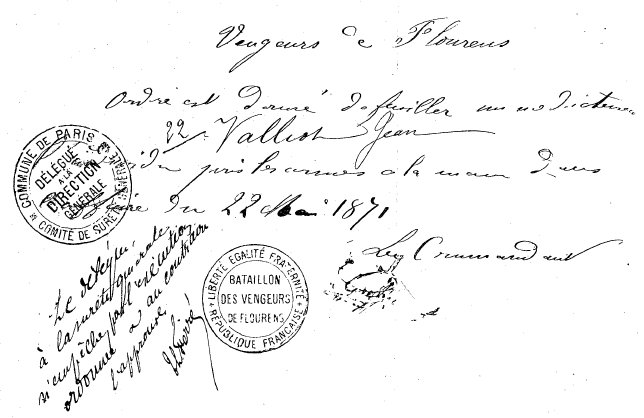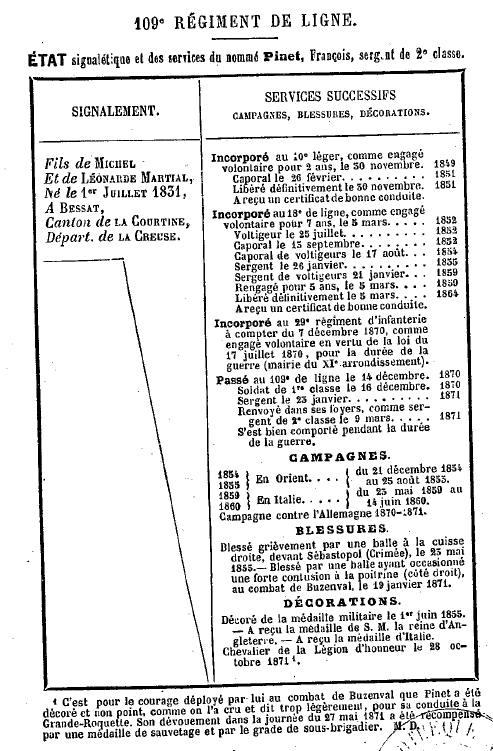LES CONVULSIONS DE PARIS
TOME PREMIER. — LES PRISONS PENDANT LA
COMMUNE
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
|
NUMÉRO 1. Arrêté du ministre de l'intérieur relatif à la solde de la garde nationale.
Le ministre de l'intérieur ; Vu le décret du 16 février 1871 concernant l'allocation de 1 fr. 50 aux gardes nationaux ; Vu l'avis conforme du ministre des finances, Arrête ce qui suit : ARTICLE PREMIER. — Les officiers-trésoriers de bataillon de la garde nationale de la Seine sont remplacés par des officiers civils de trésorerie ayant rang de lieutenant, nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du payeur général. L'allocation aux gardes nationaux et à leurs femmes sera payée par des agents comptables ayant rang d'adjudant sous-officier, nommés par le payeur général sur la proposition des payeurs divisionnaires ART. 2. — Les demandes des gardes nationaux qui sont dans la situation de réclamer à titre provisoire la continuation de l'allocation de 1 fr. 50 seront établies par compagnie, sur un état contenant les indications prescrites par le décret ci-dessus visé. Elles seront reçues par l'adjudant sous-officier aux heures de payement inscrites sur des états spéciaux préparés à l'avance et signés séance tenante par les parties intéressées. ART. 3. — Les demandes de chaque compagnie seront communiquées chaque jour par l'adjudant sous-officier à l'officier de trésorerie et au payeur divisionnaire. Ils examineront tous les trois si les demandes sont fondées, et dresseront un état de celles qu'ils admettront. Les demandes qu'ils auront repoussées seront renvoyées, à l'examen du conseil de contrôle, qui prononcera en dernier ressort. ART. 4. — Les demandes des gardes réclamant pour leur femme le subside de 75 cent, seront inscrites sur les mêmes états. Les femmes se présenteront accompagnées de leur mari, et signeront, en leur présence, une déclaration indiquant leurs nom, prénoms et profession, ainsi que la date et le lieu de leur mariage. ART. 5. — Les officiers et les adjudants sous-officiers de trésorerie pourront sur leur demande recevoir une indemnité spéciale, fixée sur la proposition du payeur général. ART. 6. — Les états de payement seront dressés d'après les demandes présentées avant le 2 mars qui auront été reconnues fondées ; il n'y sera porté de modifications que par retranchements, suivant les changements survenus dans la situation des bénéficiaires. ART. 7. — Les sommes non distribuées pour un motif quelconque seront reversées au Trésor, conformément aux instructions du payeur général. Approuvé, le ministre des finances.
Paris, le 20 février 1871. Sous la Commune, les fédérés furent encore moins scrupuleux que les gardes nationaux du siège ; l'ordre du jour suivant, lancé par lourde, délégué aux finances, en fait foi. Ministère des Finances, 18 mai 1871. La solde de la garde nationale a donné lieu à de scandaleux abus. Le délégué aux finances a constitué un service spécial de contrôle pour arrêter les détournements qui se commettent tous les jours. Quant aux misérables qui ont osé profiter de la situation actuelle pour tromper indignement la Commune, le service de contrôle est appelé à faire une enquête secrète sur ces délits qui, à l'heure présente, sont des crimes. Leur culpabilité établie, ils seront déférés à la cour martiale et jugés avec toute la rigueur des lois militaires. La direction du contrôle, siégeant à la délégation des finances, recevra avec reconnaissance tous les documents de nature à l'éclairer NUMÉRO 2. Ordre de Charles Riel.Nous, délégué civil agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Attendu que la loi défend de sortir de Paris, tout individu de 19 à 40 ans, Attendu que dans certains postes, des résistances même à main armée ont été opposées à un sous-délégué agissant pour l'exécution de la loi, Ordonnons : Tous les chefs de postes devront mettre à la disposition de nos sous-délégués toutes les forces disponibles des postes, sur un simple avis des sous-délégués. Les gardes devront défendre à main armée les sous-délégués. Tout individu qui voudra résister sera au besoin passé par les armes, séance tenante. Les chefs de postes ou gardes récalcitrants seront envoyés au dépôt en vertu du mandat décerné de nos sous-délégués. Le délégué civil, CH. RIEL.
Paris, le 17 avril 1871. Cet ordre fut appuyé par l'instruction suivante ; Paris, le 17 avril 1871. Le citoyen porteur du présent est chargé d'assurer l'exécution du décret de la Commune qui interdit à tout citoyen âgé de plus de dix-neuf ans et de moins de quarante ans de sortir de Paris. Il est également chargé de veiller à ce que le bénéfice de cette disposition ne s'étende pas aux gens qui auraient des relations avec l'ennemi. Tout chef de poste est requis de prêter main-forte à l'exécution du présent ordre. Le délégué civil, RAOUL RIGAULT. Signature du porteur : DUPONT. La signature est lourde, d'une écriture incorrecte et ne doit pas être confondue avec celle d'A. Dupont, qui fut un des chefs de la police municipale pendant la Commune. La minute de cette pièce est tout entière de la main de Raoul Rigault ; j'en trouve deux expéditions signées de lui. Celle qui porte la signature de Dupont est pliée, salie, fatiguée aux angles ; il est évident que l'on en a souvent fait usage. Il est probable que sept copies de l'ordre original ont été laites et remises à sept individus différents, qui furent délégués à chacune des sept gares de Paris pour faire appliquer rigoureusement les prescriptions de la Commune. Ceci n'est qu'une supposition, mais tout semble la justifier. M. D. NUMÉRO 3. Ordre du Comité de salut public.
NUMÉRO 4. Lettre de Théophile Ferré.A MONSIEUR LE DIRECTEUR DU DÉPÔT, Dépôt de la Préfecture de police, n° 12. Mardi, 11 juillet 1871. Monsieur, Je viens vous rappeler que vous m'avez promis de me faire donner les quarante francs que j'ai laissés au greffe et dont j'ai besoin pour des achats indispensables. Je vous prierai également de vouloir bien faire cesser la petite taquinerie dont je suis l'objet depuis mon arrivée dans votre maison ; à chaque instant on ouvre mon guichet, on me regarde comme si j'étais une bête féroce du Jardin des Plantes et derrière ma porte j'entends constamment ces aimables exclamations prononcées d'une voix assez haute ; Canaille ! scélérat ! On devrait bien le fusiller, etc., etc. Enfin, je vous prie d'autoriser votre cantinier à me donner un crayon ; je prends l'engagement de respecter vos murs pourtant si peu vierges. Recevez, Monsieur, toutes mes civilités. TH. FERRÉ. NUMÉRO 5. Ordre de Greffier.
Pour comprendre toute l'importance de l'ordre d'exécution dont je donne ici le fac-simile, il faut le lire comme il a été libellé, par trois mains différentes. Un vengeur de Flourens rédige l'ordre de fusiller immédiatement l'individu pris les armes à la main ; on ignore son nom, qu'on ne lui demande même pas ; le commandant Grenier applique sa griffe — il sait à peine signer — sur cette paperasse homicide. Celle-ci est portée à Ferré, délégué à la sûreté générale, qui non seulement ne s'oppose pas à l'exécution, mais au contraire l'approuve, sans même savoir quel est le malheureux qui va en être la victime. L'ordre d'exécution est transmis au greffe du Dépôt ; le greffier, après explication, devine que l'individu que l'on veut fusiller est un détenu amené quelques instants auparavant ; alors, entre les lignes, il inscrit le nom qu'il relève sur le registre d'écrou ; Jean Vaillot, puis à côté, la date ; 22 (mai). Ceci fait, l'homme est extrait de la cellule et remis au peloton meurtrier. Pendant que l'on accomplissait ces étranges formalités, J. Vaillot avait eu le temps d'écrire une lettre que j'ai entre les mains et que je cite en entier, parce qu'elle me semble démontrer l'innocence de celui qui allait ouvrir la série des massacres systématiques : Paris, le 22 mai 1871. Je m'appelle Jean Isidore Valliot. Je suis à Paris depuis le 20 mars. J'ai d'abord été employé à la Commune comme palefrenier dans les caves de l'hôtel de ville. Étant tombé malade j'ai entré à l'embulance de la caserne de l'Ourcine. J'en suis sorti ces jours-ci pour m'engager dans les troupes de la Commune. On m'a donné un ordre pour me rendre à la porte Maillot — il est encore dans mon calepin qu'on m'a prie —. Ma blessure n'étant pas guérie, j'ai pensé que l'artillerie qui était mon arme me fatiguerait beaucoup. Je me suis enrôlé aux éclaireurs fédérés, rue des prêtres saint Germain l'auxerrois, je figure le 2me sur la liste d'enrôlement ; j'ai passé ma journée hier à chercher des jeunes gens pour former notre première compagnie. Déjà hier soir nous étions une centaine ; nous fûmes casernes à la caserne Babylone. Moi j'ai pour camarade un jeune homme qui est ordonnance du colonel Ponce gouverneur de la caserne de la Citée, j'ai couché avec lui la nuit dernière. A huit heures seulement ce matin j'ai trouvé un chassepot à la caserne et je suis parti du côté des Tuileries. Comme le feu sur le quai de la rive' droite était accablé d'obus, j'ai pris le pont des saints Pères et je suis entré dans la rue de Varennes, je crois. Nous avons tiraillés quatre que nous étions toute la matinée contre des espèces de sergents de Ville habillés en gardes nationaux avec un galon blanc à leur képi. Nous avons gagné de maison en maison jusqu'à la rue de Sèvres. Là les Versaillais étaient en face de nous. Nous avions un couvent sur notre passage, j'ai voulu en fermer la porte pour pouvoir gagner la terrasse, c'est alors qu'un vengeur de Flourens en casquette blanche me fait signe tombe sur moi et me désarme malgré mes protestations. On me prend un beau revolver de cavalerie que j'ai depuis le 10 décembre, on me prend mon fusil chassepot et cinq francs d'argent et tous mes papiers parmi lesquels une carte d'identité du bataillon. Maintenant on m'accuse d'insulte à la Commune, je ne connais pas tous les membres de la Commune, mais je peux dire dut-il m'en couter la vie, que j'ai indignement été traité dans mon arrestation. Ajoutons à cela que je me trouve complètement sourd et comme fou par les coups de feu ce matin. On m'accuse d'ivresse, je n'ai ni bu ni mangé depuis ce matin, si je suis soul c'est par la poudre. Un dernier mot j'invoque comme preuve de mon identité le colonel Ponce qui m'a foutu à la salle de Police il y a deux jours, il m'a toujours vu à la caserne de la Citée dont il est le gouverneur. J'invoque le témoignage du citoyen Forein ordonnance du colonel de la Citée, qui est mon camarade, nous étions à Paris auparavant la guerre de Prusse, nous sommes déserté ensemble le 18e d'artillerie pour venir nous mêler au mouvement de Paris. Cytoyen ceux qui m'ont arrêté se sont mépris, seulement je demande à ce qu'on me rende ce que j'avais, un chassepot, un revolver, cinq francs d'argent et tous mes papiers compris dans un fort calepin. Je suis victime d'une erreur déplorable, que je sois interrogé en règle. J'ai encore sur moi les effets de la commune avec le cachet seulement, mon ancien pantalon de cavalerie. NUMÉRO 6. Le Mont-Valérien après le 18 mars.Marais, 23 avril 1880. Vous me demandez, monsieur, de faire appel à mes souvenirs pour retracer le rôle qu'a rempli le lieutenant-colonel de Lochner, mon père, au Mont-Valérien, pendant la Commune, en 1871. Je vais tâcher de vous satisfaire en vous envoyant sur ce sujet quelques détails absolument certains, qui me sont fournis par ses lettres et par le registre Journal militaire qu'il tint dans ces jours néfastes. En sa qualité de commandant de place, il avait dû, selon les conditions de l'armistice, remettre la forteresse aux mains des Prussiens. Il y rentra le 7 mars, avec un bataillon du 113e de ligne, et y reçut le lendemain les deux bataillons de chasseurs, 21e et 23e, cités par vous à propos de l'assassinat du malheureux Vincenzini. L'esprit de ces bataillons était tel, qu'il manquait le premier jour à l'appel 286 hommes au 21e bataillon, et 315 au 23e. Il fallait réorganiser les services avec cette garnison, et, pour premier soin, approprier le fort. Voici ce qu'écrivait le colonel de Lochner à ce sujet ; Les chasseurs sont sans armes, et partant très désœuvrés, tous faubouriens de Paris, et très disposés à achever l'œuvre de destruction si bien réussie par les Prussiens. Vous ne vous figurez pas l'état de saleté et de dégradation dans lequel ils ont laissé mon pauvre fort.... Les ouvriers manquent pour les réparations, et l'on ne consentira pas à faire des dépenses en ce moment malheureux. Tout cela me cause une tristesse inexprimable. Cette dévastation, ces ruines, sont l'image de notre pays tout entier, et je n'ai plus, pour faire diversion aux cruelles pensées que ce dissolvant tableau suggère, la vie si active que je menais pendant la guerre. (Lettre du 8 mars 1871). Ce n'était cependant pas l'occupation qui devait lui manquer. Il vit bien vite ce qu'il pressentait, le mauvais vouloir des chasseurs : J'ai 3.000 chasseurs à pied recrutés dans Paris, actuellement sans armes, qui font le diable, et qui pilleraient comme de véritables insurgés si l'on ne faisait bonne garde. (Lettre du 10 mars 1871). On cherche par tous les moyens possibles à employer les loisirs des chasseurs, dont la remuante activité devient inquiétante ; gymnase, manœuvre du canon, corvées, tout est mis en usage et ne produit que de médiocres résultats. (11 mars, Journal militaire.) Envoi des corvées sans armes au plateau de la Bergerie et à Buzenval pour l'enterrement des cadavres demeurés sans sépulture dans les lignes prussiennes. (15 mars, Journal militaire.) Continuation des précédentes corvées et de deux autres. Les corvées d'ensevelissement ne peuvent être abandonnées, bien que ce soit un dimanche. (18 mars, Journal militaire.) C'est au milieu de ces difficultés, et dans cette situation déjà si tendue que le colonel Pottier, commandant le 113e de ligne, reçut, le 18 mars, vers minuit, l'ordre de se replier sur Versailles, ne laissant au Mont-Valérien que les chasseurs. Si, comme il est dit dans l'enquête parlementaire, plusieurs députés, dont le général Martin des Pallières, l'amiral Jauréguiberry, s'émurent de l'abandon de cette forteresse, et firent sans résultat des démarches auprès du chef du pouvoir exécutif, que ne ressentit pas le commandant du fort qui voyait s'amonceler l'orage et qui le sentait près d'éclater ! Il savait par quelques avis sûrs que les bataillons de chasseurs communiquaient secrètement avec les insurgés. D'autre part, quand, dans la journée du dimanche (19 mars), ces chasseurs s'aperçurent qu'ils avaient été laissés seuls au fort, leur agitation grandit d'une manière inquiétante ; aussi vers neuf heures du soir, le lieutenant-colonel de Lochner rassembla un rapide conseil dans lequel il décida, sous sa responsabilité et avec l'adhésion unanime des chefs de corps et des officiers, le renvoi des deux bataillons. Le commandant du fort prescrit, sous sa responsabilité, aux chefs de bataillon Pallach et Bayard, commandant les 21e et 23e bataillons, de faire partir avec des feuilles de route tous les hommes de leurs bataillons en mesure d'être libérés Puis il ordonne à ces chefs de corps de se disposer à partir, le premier pour Évreux, l'autre pour Chartres, points auxquels ils trouveront de nouveaux ordres de route. (19 mars, Journal militaire.) A l'issue de ce conseil, M. Pelletier, officier de chasseurs, et deux autres émissaires furent envoyés à Versailles au général Vinoy pour l'informer des mesures prises et réclamer du secours. Au reçu de ces messages, le général Vinoy se rendit, vers une heure du matin, auprès de M. Thiers, parvint à pénétrer jusqu'à lui et obtint enfin l'envoi au Mont-Valérien de troupes sûres. Il prescrivit alors le départ immédiat, pour la forteresse, du 119e de ligne. Avis fut donné de cet ordre au colonel de Lochner. La nuit est difficile à passer, dit le Journal militaire. — Un poste de vingt-huit chasseurs choisis veille à l'entrée du fort. Les poternes sont gardées chacune par un factionnaire. Une ronde incessante surveille ces derniers. Pas une poterne n'est fermée à clé ; toutes les serrures ont été brisées la veille. Le lieutenant-colonel commandant le fort passe la nuit au poste de la porte d'entrée, placé littéralement entre deux feux ; les chasseurs rebelles qui grondent sourdement n'attendant qu'une occasion pour se révolter, et la menace de ce qui peut venir du côté de Paris. Le 23e part à 6 heures ; le 21e à 9 heures. Le fort n'est plus gardé que par le poste d'entrée. A ce moment se présente un sergent-major de la garde nationale, annonçant que le Comité de défense a ordonné l'envoi au Mont-Valérien de deux bataillons des Ternes et des Batignolles, et qu'ils devaient arriver dans la journée. (Journal militaire.) Le colonel accueille froidement ce message. — A 9 heures ½ une troupe lui est signalée. Il la voit venir avec une inexprimable anxiété. Est-ce la perte ? Est-ce le salut ? — Il cherche avec sa lorgnette à reconnaître à travers le brouillard quelque signe distinctif, lorsqu'une voix s'écrie joyeusement à ses côtés. Pantalons rouges, mon colonel !.... C'était un premier bataillon du 119e ; son attitude était résolue, la situation était sauvée. Le reste du régiment arriva peu après, puis de l'artillerie, du génie, quelques chasseurs à cheval et pour quatre jours de vivres. — Vers 8 heures du soir, on annonça, au poste de l'avancée, une députation d'officiers de la garde nationale, parmi lesquels, paraît-il, était le citoyen Lullier. — Le commandant du fort et le colonel Cholleton, commandant le 119e, les reçurent au poste d'entrée, afin d'empêcher toute inspection ou tout contact avec la garnison, qui était alors de 1800 hommes. Ces messieurs, dit le Journal militaire, déclarent qu'ils appartiennent à deux bataillons, l'un de la garde nationale des Ternes, l'autre de celle des Batignolles, qu'ils précèdent leurs bataillons, arrêtés à environ 1.000 mètres du fort et qu'ils viennent communiquer au commandant l'ordre qu'ils ont reçu du comité de défense de venir occuper le fort. Le lieutenant-colonel, commandant la place, leur répond qu'il n'a reçu aucun ordre à leur sujet, qu'il ne reconnaît pas le comité de défense dont lui parlent les délégués ; qu'il ne recevra d'ordres que de ses chefs directs ; et, quant à la garde du fort, au sujet de laquelle les gardes nationaux paraissent être soucieux, ils peuvent se tranquilliser ; le Mont-Valérien est à l'abri de toute attaque, de quelque côté qu'elle vienne. — Les envoyés se sont retirés en donnant à entendre que la manière dont ils avaient été accueillis mécontenterait beaucoup. — En effet, en prêtant attentivement l'oreille, il a été possible d'entendre après leur départ, à travers l'obscurité, quelques rumeurs venant de la direction qu'ils avaient suivie. Cette tentative infructueuse fut la seule que firent les communards pour occuper le Mont-Valérien. Malgré leur échec, et l'on ne sait pourquoi, ils croyaient encore a la complicité de la forteresse, et le premier coup de canon qui leur barra le chemin au rondpoint des Bergères, dissipa leurs illusions d'une manière terrifiante. On sait quel fut le rôle du Mont-Valérien pendant la Commune, par son action et par ses observations. M. Thiers y rendit hommage dans sa déposition devant la Commission d'enquête, en disant : Les officiers placés au Mont-Valérien et munis d'instruments qui leur permettaient de bien voir les mouvements des insurgés, nous rendirent d'immenses services. Je termine sur ce témoignage flatteur un récit que le culte que je porte à la mémoire de mon père me porterait encore à allonger. Veuillez, monsieur, en excuser l'étendue et croire à, etc., etc.[1] M. B., Née DE LOCHNER. NUMÉRO 7. Protestation des pasteurs protestants.Paris, le 20 mai 1871. Citoyens membres de la Commune, A cette heure d'une gravité terrible pour notre ville, pour la France et pour vous-mêmes, consentez à écouter la libre voix d'hommes, vos concitoyens, demeurés à leur poste à Paris, au milieu de tant de souffrances, pour y exercer un ministère de paix, en consolant les affligés, en soignant les blessés et assistant les mourants. Ce qui les fait parler, ce n'est ni motif politique ni esprit de parti ; c'est l'humanité, c'est l'honneur de la France, c'est la loi du Dieu de l'Évangile, auquel ils croient et qu'ils prennent à témoin de leur sincérité. Ils osent le dire aussi, c'est leur devoir envers vous ; ils vous doivent de vous dire la vérité telle qu'elle est dans leurs cœurs. Citoyens, nous avons frémi à la nouvelle que la Commune semble résolue d'entrer dans la voie des représailles sanglantes et des exécutions politiques. S'il en est ainsi, ce que nous hésitons à croire, nous nous unissons à ceux qui ont déjà protesté contre un tel dessein, et nous vous supplions de ne pas ajouter à tant de sang versé sur les champs de bataille le sang versé en dehors des combats. Punir de mort un otage parce qu'un autre est accusé d'avoir commis un meurtre ; frapper pour le crime d'autrui, si ce crime est prouvé, un homme qui n'a commis aucun délit que les lois ordinaires condamnent, serait-ce justice ? Nous le demandons à la conscience de tous les membres de la Commune ; ne serait-ce pas plutôt le retour à la barbarie ? Nous vous en supplions, ne permettez pas que le souvenir de tek actes accomplis à Paris en plein dix-neuvième siècle vienne se joindre au souvenir d'actes semblables qui ont ensanglanté et assombri l'histoire de la France ; ne permettez pas qu'il passe à la postérité attaché à vos noms. Après tant de douleurs et de deuils, accordez-nous plutôt là consolation d'obtenir de vous un acte de justice et de miséricorde, dont le souvenir adoucira un jour celui des luttes sanglantes qui déchirent en ce moment la patrie. Plusieurs de nos coreligionnaires étrangers qui sont restés à Paris pendant le siège, et qui ont donné à notre nation la preuve éclatante de leur sympathie envers nos blessés et nos populations affamées, ont voulu signer avec nous cette adresse. En vous la présentant, nous obéissons à la voix de notre conscience, qui ne nous permettait pas de nous taire. GRANDPIERRE, pasteur ; VALLETTE, pasteur ; GUILLAUME MONOD, pasteur ; VICTOR GEGUEL, pasteur ; G. FISCHE, pasteur ; ERNEST DHOMBRES, pasteur ; FÉLIX KUHN, pasteur ; E. ROBRIN, pasteur ; Louis VERNES, pasteur ; ROUVILLE, pasteur ; VESSEN, pasteur ; EDMOND DE PRESSENSÉ, pasteur ; A. DECOUPPET, pasteur ; MURE-ROBINEAU, pasteur ; DE LEPOIDE, pasteur ; A. DEZ, pasteur ; MATTER, pasteur ; A. L. MONTANDON, pasteur ; ÉMILE COOK, pasteur ; JOHN-ROSE CORMACK, D. M. de Paris et d'Edimbourg ; H. PAUMIER, pasteur ; P. G. GAUBERT, pasteur ; EUGÈNE BERSIER, pasteur ; EDOUARD FORBES, pasteur anglican. NUMÉRO 8. Intervention de M. Washburne, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, en faveur de Mgr Darboy ; archevêque de Paris.M. Elihu Washburne a bien voulu nous autoriser à traduire et à publier la brochure écrite par lui sous le titre de : Account of the Sufferings and Death of the Most Rev. George Darboy, la'e Archbishop of Paris, communicated by His Excellency E. B. Washburne, Minister of the United States at the Court of France, in answer to a Letter of the Catholic Union of New York thanking His Excellency for his attention to that Prelate. — Published by the Catholic Union of New-York. 1873[2]. À MONSIEUR H. J. ANDERSON, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE L'UNION CATHOLIQUE DE NEW-YORK. Paris, 31 janvier 1873. Cher Monsieur, Avant de quitter New-York, j'ai eu l'honneur de vous accuser réception, dans un court billet, de la lettre que vous et les autres membres du bureau de l'Union catholique de New-York m'aviez adressée, en témoignage de l'approbation qui a été donnée à mon attitude comme représentant des États-Unis en France pendant le siège et pendant la Commune de Paris, et particulièrement en ce qui concerne l'illustre prélat Mgr Darboy, archevêque de Paris. De retour à mon poste, je tiens aujourd'hui à vous remercier sincèrement de votre courtoisie, et à vous dire combien j'attache de prix à l'approbation des membres de l'Union. Je n'avais pas eu de relations personnelles avec l'archevêque de Paris avant qu'éclatât l'insurrection communale du 18 mars 1871, mais je connaissais bien son caractère de réputation. C'était un homme éminent par sa piété et ses vertus, et aimé de toute la population parisienne pour sa bienveillance, sa générosité, sa bonté. Quand la ville tomba dans les mains d'une populace armée, qui avait pouvoir absolu sur la vie et les biens de chacun de ses habitants, et alors que tant de personnes des hautes classes fuyaient loin du péril qui les menaçait, l'archevêque refusa résolument d'abandonner la capitale, donnant pour raison que c'était son devoir d'affronter les dangers et de tâcher de modérer les horreurs de la situation par son exemple et son courage. C'est dans les premiers jours d'avril que j'appris qu'il avait été arrêté et arraché de sa résidence par ordre du sanguinaire Raoul Rigault, le procureur de la Commune, et qu'il était écroué à la prison de Mazas, où on le gardait au secret. Il n'était accusé d'aucun crime, mais on confessait, ouvertement qu'il avait été pris pour être retenu comme otage. D'autres hommes éminents et distingués furent arrêtés à la même époque et incarcérés pour le même objet. Parmi eux étaient M. Bonjean, l'un des présidents de la Cour de cassation, l'abbé Deguerry, curé de la Madeleine, et plusieurs prêtres. Le 18 avril 1871, Mgr Chigi, nonce du pape à Paris, fit une démarche auprès de moi, en son nom et au nom de quatre chanoines ecclésiastiques de l'église métropolitaine de Paris, afin d'invoquer ma protection en faveur de l'archevêque Je dois donner ici une explication ; c'est que quand l'insurrection éclata le 18 mars, et que le gouvernement fut obligé de quitter Paris pour aller à Versailles, le corps diplomatique tout entier dut l'y suivre. J'y transférai donc ma légation ; mais tel était l'état des choses à Paris, et il y avait tant d'intérêts américains en jeu, et aussi tant d'intérêts allemands — desquels je me trouvais chargé —, que je considérai comme de mon devoir de rester dans la ville, tandis que mon secrétaire, le colonel Hoffmann, prendrait possession de là légation à Versailles ; et c'est probablement parce que j'étais le seul membre du corps diplomatique qui fût demeuré dans Paris pendant le règne de la Commune, que l'on s'adressa à moi en faveur de l'archevêque. J'eus une entrevue avec Mgr Chigi, à Versailles, le 22 avril, et il m'exposa la situation périlleuse de ce prélat. La Commune était à cette heure à l'apogée de sa puissance. Avec plus de cent mille combattants, tous complètement armés, équipés et approvisionnés, avec toute la richesse de Paris à ses pieds, cette grande cité de deux millions de population était gouvernée par la violence et la terreur. Le nonce reconnut avec moi combien c'était chose délicate de tenter une intervention auprès des autorités de la Commune en faveur de l'archevêque ; mais, convaincu que je ne me trompais pas sur les sentiments de mon gouvernement et de la nation américaine et plein de profonde sympathie pour les épreuves du prélat, j'exprimai au nonce non seulement ma bonne disposition, mais mon ardent désir de faire tout ce qui serait possible, tout ce que me permettrait ma position, pour obtenir son élargissement. Étant retourné à Paris ce jour-là assez tard, je pris le soir même des mesures pour me procurer une entrevue le lendemain matin avec le général Cluseret, alors ministre de la guerre de la Commune, afin d'examiner ce qui pourrait être fait. J'avais connu antérieurement Cluseret, qui a été général au service de notre pays pendant la rébellion, et qui a été naturalisé citoyen des États-Unis. Accompagné de mon secrétaire particulier, M. Mac Kean, j'allai le trouver au ministère de la guerre, à l'heure indiquée. Tout en exprimant beaucoup de sympathie pour l'archevêque et en déclarant qu'il regrettait son arrestation, il me dit franchement que l'exaspération des esprits était telle, que nul ne pourrait sans péril proposer de le relaxer. Je m'élevai contre ce qu'il y avait d'inhumain et de barbare à se saisir d'un homme comme l'archevêque sans qu'il fût accusé d'aucun crime, à le jeter en prison, à ne permettre aucun ami auprès de lui, et à le détenir comme otage. Je dis que, s'il n'était point possible de le relaxer, je devrais au moins être autorisé à le visiter dans la prison, à m'assurer de ses désirs et à pourvoir à ses besoins. Cluseret reconnut que ma demande était fondée en raison, et offrit d'aller avec moi en personne à la Préfecture de police pour voir Raoul Rigault et obtenir l'autorisation nécessaire de visiter l'archevêque à Mazas. Il était environ onze heures du matin quand nous arrivâmes à la Préfecture de police, et, escorté d'un dignitaire comme Cluseret, nous nous engageâmes dans le labyrinthe de cette vieille et affreuse geôle, dont toutes les issues et les salles étaient remplies de troupes de la garde nationale insurgée. Ayant demandé à voir Raoul Rigault, nous fûmes informés qu'il était encore au lit, et Cluseret alla le trouver, pendant que M. Mac Kean et moi nous attendîmes dans le Salon doré du palais préfectoral. Il revient bientôt, rapportant une passe qui est par elle-même une curiosité, et dont voici la copie : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. PRÉFECTURE DE POLICE. Cabinet du secrétariat général. Paris, 23 avril 1871. Nous, membre de la Commune, délégué civil à la Préfecture de police, autorisons le citoyen Washburne, ministre des États-Unis, et son secrétaire, à communiquer avec le citoyen Darboy, archevêque de Paris. RAOUL RIGAULT. (Timbre officiel.) Pour profiter sans délai de ce permis, nous nous fîmes conduire immédiatement de la Préfecture à la prison de Mazas. Quoiqu'elle fût entre les mains de la Commune ; j'y fus reçu courtoisement et j'obtins sans difficulté l'accès de l'archevêque. J'ai fait le récit complet de mon entrevue avec lui dans une dépêche officielle écrite le jour même à mon gouvernement. Je prendrai la liberté de vous envoyer avec la présente une copie de ma correspondance sur ce sujet, qui a été publiée par le département d'État à Washington. L'ayant trouvé très faible et souffrant beaucoup de la dyspepsie, j'obtins l'autorisation de lui procurer du vieux vin d'Espagne et aussi de lui envoyer quelques journaux. Je lui offris de lui envoyer toutes autres choses qu'il pourrait souhaiter et de lui remettre l'argent dont il pourrait avoir l'emploi, mais il n'avait actuellement aucun besoin de cette sorte. Après ma première entrevue avec l'archevêque, je me sentis pour qui un si profond intérêt, et il parut si content de me voir, que je lui rendis visite aussi fréquemment que me le permettaient mes pressants devoirs. On me laissa pendant un certain temps entrer librement, et j'étais reçu par les gardiens avec un certain degré de politesse. L'avant-dernière fois que j'allai à la prison, je vis affiché un ordre portant, que toutes les permissions de visite aux prisonniers étaient révoqués ; mais l'archevêque était tellement débile, que je résolus de faire tout ce qui serait possible pour obtenir un nouveau permis. J'envoyai donc M. Mac Kean à Raoul Rigault, qui était alors, comme toujours, l'âme de la Commune, pour lui demander une passe permanente. M. Mac Kean, qui avait été obligé de voir souvent cet homme pour affaires concernant ma légation, et qui s'était maintenu en bons termes avec lui, tira de lui, non sans discussion, le papier que voici : COMMUNE DE PARIS. CABINET DU PROCUREUR DE LA COMMUNE. Paris, 18 mai 1871. Le directeur de Mazas laissera les citoyens Washburne et Mac Kean communiquer avec le prisonnier Darboy. Permanent. RAOUL RIGAULT, Procureur de la Commune. (Timbre officiel.) Vu, 21 mai 1871. Vous remarquerez les termes qui montrent bien le caractère
de l'homme à ce moment. Je ne suis plus désigné comme le citoyen Washburne, ministre des États-Unis, mais seulement le citoyen Washburne, et l'archevêque, au lieu
d'être désigné comme citoyen Darboy, archevêque de
Paris, est seulement appelé le prisonnier
Darboy. J'avais jusqu'à cette heure visité l'archevêque six différentes fois, et c'est pour moi une grande satisfaction de penser que mes visites lui ont fait un bien réel Je lui apportais toujours des journaux et lui communiquais les nouvelles du jour. Notre conversation eut beaucoup pour objectif les efforts que l'on faisait pour qu'on l'échangeât contre Blanqui, le grand communiste et révolutionnaire, alors prisonnier du gouvernement régulier. Vous serez frappé de son exposé clair et concis de cette question, qui se trouve parmi les documents que je vous envoie, et que je possède de sa propre écriture. Il m'a toujours fait des remercîments de ce que je le venais voir, et il eut la bonté de dire plus d'une fois qu'une des raisons pour lesquelles il aimerait à être rendu à la liberté, était qu'il désirait pouvoir dire au monde ce que j'avais été pour lui dans sa prison. L'avant-dernière fois que je le vis, je fus très affligé de le trouver dans un état de santé plus faible encore que précédemment La réclusion aggravait sa dyspepsie et abattait ses forces. Éprouvant à son égard une certaine inquiétude, je retournai le voir dans l'après-midi du dimanche 21 mai, porteur du permis spécial de Raoul Rigault, transcrit ci-dessus, grâce auquel je pénétrai facilement dans la prison ; mais, une fois entré, je trouvai que ce n'était plus la même chose qu'auparavant. La plupart des hommes de service étaient nouveaux et la plus grande confusion régnait. Presque tous étaient plus ou moins pris de boisson, et ma présence sembla les gêner tous. Au lieu de la politesse ordinaire avec laquelle j'avais été uniformément reçu, j'étais traité avec rudesse. On s'opposa à ce que j'entrasse dans la cellule de l'archevêque comme j'avais fait antérieurement ; on l'amena dans le couloir, où je ne pouvais l'entretenir qu'en présence des gardiens. Malheureusement j'avais à lui dire que je n'apportais pas de bonnes nouvelles, qu'il n'y avait pas d'amélioration dans la situation. Je lui dis que je l'avais trouvé si souffrant la dernière fois que je l'avais vu, que j'étais revenu pour savoir comment il allait et si je pouvais encore lui rendre quelque service. Il me renouvela ses remercîments et dit qu'il ne voyait rien qu'il pût avoir à me demander quant à présent. Après avoir encore causé avec lui quelques instants, je lui dis un adieu qui devait être, hélas ! le dernier, mais en l'informant que j'avais reçu un permis permanent et en promettant de revenir sous peu. Jusque-là, bien que souffrant dans sa santé et accablé d'anxiétés, non seulement pour ce qui concernait sa situation personnelle, mais pour ce qui intéressait l'état de sa patrie, chaque fois que je l'avais vu, j'avais trouvé en lui non seulement de la bonne humeur, mais parfois même de la gaieté. Jamais je n'oublierai la bonhomie avec laquelle il m'introduisit dans sa sinistre petite cellule, me disant qu'elle lui servait à la fois de cabinet, de salon, de chambre à coucher et de salle à manger. Quoiqu'il comprît le danger de sa situation, il pariait comme préparé, au sort quel qu'il fût qui l'attendait, et comme je l'ai dit dans ma dépêche à M. le gouverneur Fisch, il ne lui échappait jamais un seul mot de reproche contre ses persécuteurs ; au contraire, il parlait d'eux avec bonté. Je n'avais jamais vu auparavant, chez aucun homme, une telle résignation et un tel esprit chrétien, et jamais personne qui parût plus élevé au-dessus des choses de la terre. Lors de ma dernière visite, il semblait bien changé. Il avait perdu sa bonne humeur, et paraissait triste et abattu. Le changement des gardiens de la prison et la démoralisation générale, qui prenait là le dessus, étaient de mauvais présage. Et en effet, au moment même où je me trouvais avec lui cette dernière fois, les troupes du gouvernement étaient entrées dans Paris par la porte de Versailles, au côté opposé de la ville, fait qui ne fut connu que plusieurs heures après. Vous pouvez vous figurer la sensation que fit chez les insurgés la nouvelle que l'armée de Versailles était dans les murs de Paris. Le sentiment qui était celui des meneurs à l'endroit de l'archevêque, avant cette entrée, se trouve exprimé par la Montagne, un des organes les plus sauvages et les plus brutaux de la presse communiste de la capitale ; il était traduit par cette honteuse menace : Les chiens ne vont plus se contenter de regarder les évêques — allusion au proverbe : Un chien regarde bien un évêque —. Nos balles ne s'aplatiront plus contre les scapulaires, pas une voix ne s'élèvera pour nous maudire le jour où l'on fusillera l'archevêque Darboy. Il faut que M. Thiers le sache, il faut que Jules Favre, le marguillier, ne l'ignore pas ; nous avons pris Darboy pour otage, et si l'on ne nous rend pas Blanqui, il mourra. La Commune l'a promis, et si elle hésitait, le peuple tiendrait son serment pour elle. — Et ne l'accusez pas ! Que la justice des tribunaux commence, a dit Danton le lendemain des massacres de septembre, et celle du peuple prendra fin. Ah ! j'ai bien peur pour monseigneur l'archevêque de Paris[3] ! Aussitôt que le commandant en chef des troupes du gouvernement se trouva dans Paris, je lui rendis visite à son quartier général pour l'aviser de la situation de l'archevêque, afin qu'il pût prendre les mesures qui seraient jugées propres à tenter de préserver ses jours. Mais il fut impossible de rien faire, car les troupes insurrectionnelles étaient en possession de toute cette partie de la ville qui se trouve entre la place de la Concorde et les prisons de Mazas et de la Roquette, et elles combattaient derrière les barricades avec la fureur et l'acharnement du désespoir. On a su plus tard que, le lundi 22 mai, une demi-douzaine des plus féroces meneurs de la Commune, y compris Raoul Rigault, s'étaient réunis en conseil et avaient décidé la mort de l'archevêque et de cinq autres otages. Je ne puis entrer ici dans tous les détails horribles de ce qui suivit ; Ils furent bientôt transférés de Mazas à la Roquette, dans un vulgaire chariot de déménagement, suivi pendant tout le trajet par une tourbe forcenée d'hommes, de femmes et d'enfants, qui accablèrent ces malheureux de cris outrageants et de quolibets obscènes. Enfermés à la Roquette, ils y restèrent jusqu'au mercredi soir 24 mai. A environ six heures, un détachement d'une quarantaine d'hommes appartenant à une compagnie de la garde nationale insurrectionnelle nommée les Vengeurs de la République, avec un capitaine, un premier et un second lieutenant, un commissaire de police et deux membres délégués par la Commune, arrivèrent à la prison. Après un long pourparler avec le directeur en fonctions, qui d'abord refusa de livrer les victimes, ils furent enfin abandonnés à cette bande d'assassins et à une mort certaine et expéditive. Comme j'étais anxieux de recueillir tout ce que je pourrais apprendre sur les dernières heures de l'archevêque, je visitai la prison de la Roquette peu de jours après le massacre. Grâce à la courtoise obligeance du commandant militaire et d'un des vieux gardiens, je pus pénétrer dans la cellule où il avait été détenu et d'où il avait été tiré pour être fusillé. Tout était dans cette cellule exactement comme il l'avait laissé. L'abbé Deguerry (curé de la Madeleine), le président Bonjean et trois autres otages de distinction furent appelés en même temps, et tous ensemble, au nombre de six, furent emmenés dans la cour et placés contre la muraille qui clôt le sombre édifice de la prison. On m'a montré tout cela. L'archevêque, le plus éminent d'entre eux, fut placé en tête de la ligne. Les démons qui l'ont assassiné avaient, comme par dérision, gravé une croix sur une pierre de la muraille à laquelle il était adossé, et à l'endroit même que sa tête doit avoir touché au moment où le fatal feu de peloton fut exécuté. Quoique blessé, il ne tomba pas au premier coup, mais resta debout, calme et immobile, comme absorbé dans la prière. D'autres décharges suivirent immédiatement, et la vénérable victime tomba à terre sans vie. Vers trois heures du matin, les corps des six otages fusillés ensemble furent entassés dans une charrette prise au cimetière du Père-Lachaise, et jetés pêle-mêle, sans linceul ni bière, dans la fosse commune, d'où ils ont été heureusement tirés avant que la décomposition fût entière. Le corps de l'archevêque avait été dépouillé de tout, même de ses souliers. Les détails écœurants de ce drame terrible et sanglant ont été exposés tout au long dans le procès des assassins devant le conseil de guerre à Versailles. Plusieurs des coupables ont reçu le juste châtiment de leur crime. Le corps, de l'archevêque, ayant été embaumé, fut exposé sur un lit de parade dans une chapelle ardente, à l'archevêché, du 1er au 7 juin. Je me joignis à l'immense multitude de peuple qui traversa le palais épiscopal pour jeter un dernier regard sur les traits bien connus de celui que sa charité chrétienne, ses actes de bienfaisance, sa cordialité de cœur, sa bonté pour les pauvres et les humbles, avaient rendu cher à tous. Tel est le récit que j'ai cru devoir vous tracer succinctement de la mort de Mgr Darboy. Que n'ai-je été assez heureux pour sauver sa précieuse existence ! C'était un homme éminent, et l'on ne pouvait avoir commerce avec lui sans être captivé par son caractère sympathique et sa parole lumineuse. Instruit, éloquent, libéral et juste, il mettait en pratique toutes les vertus chrétiennes. Il a subi son destin avec la fermeté d'un martyr et mérite que tous les cœurs généreux payent un tribut de respect à sa mémoire. J'ai l'honneur d'être, etc. E. B. WASHBURNE. M. WASHURNE À M. FISH. N° 423. LÉGATION DES ÉTATS-UNIS. Paris, 23 avril 1871. (Reçu 10 mai.) Monsieur, .... Vous êtes informé que Mgr Darboy, archevêque de Paris, a été appréhendé, il y a quelque temps, par ordre de la Commune, et jeté en prison pour y être retenu comme otage. Un pareil traitement envers cet homme dévoué et excellent ne pouvait manquer de faire grande sensation, surtout dans le monde catholique. Dans la nuit- de jeudi dernier, je reçus une lettre de Mgr Chigi, archevêque de Myre et nonce apostolique du Saint-Siège, et aussi une communication de MM. Louvrier, chanoine du diocèse de Paris, Lagarde, vicaire général de Paris, Bonnet et Allain, chanoines et membres du chapitre métropolitain de l'Église de Paris ; tous m'adressant. un appel énergique, au nom du droit des gens, de l'humanité et de la sympathie, pour que j'interpose mes bons offices en faveur de l'archevêque prisonnier. J'ai pensé que je ne ferais que me conformer à ce qui me paraît être la politique de notre gouvernement et aux désirs qui devaient être les vôtres dans cette circonstance, en me rendant au vœu de cette requête. En conséquence, je me suis mis, ce matin de bonne heure, en communication avec le général Cluseret, qui paraît être ici, pour le présent, l'homme dirigeant. Je lui dis que je m'adressais à lui, non en ma qualité de diplomate, mais simplement dans l'intérêt des bons sentiments et de l'humanité, afin devoir s'il n'était pas possible de faire cesser l'arrestation et l'emprisonnement de l'archevêque. Il me répondit que cette affaire n'était pas de sa juridiction, et que, quel que fût son vif désir de voir relaxer l'archevêque, il croyait que, dans l'état actuel des choses, il serait impossible de l'obtenir. Il a dit qu'il n'était point arrêté pour crime ; mais simplement pour être gardé comme otage, avec beaucoup d'autres. Dans les circonstances actuelles, il pense qu'il serait inutile de faire aucune démarche en ce sens. C'est aussi mon sentiment que la Commune, dans l'état d'excitation où se trouve présentement l'esprit public, n'oserait pas relâcher l'archevêque. Je dis au général Cluseret qu'il fallait cependant que je le visse pour m'assurer de sa situation réelle, de l'état de sa santé et des besoins qu il pouvait éprouver. Il répondit qu'à cela il n'y aurait point d'objection, et il m'accompagna immédiatement en personne à la Préfecture de police, où, sur sa demande, je reçus du préfet une permission pour visiter librement et quand je voudrais l'archevêque. En compagnie de mon secrétaire particulier, M. Mac Kean, je me rendis alors à la prison Mazas, où je fus admis sans difficulté, et après qu'on m'eut fait pénétrer dans une des cellules vides, on m'introduisit bientôt auprès de l'archevêque. Je dois dire que je fus profondément touché à l'aspect de cet homme vénérable. Sa personne chétive, sa taille un peu courbée, sa barbe longue (car il semblait n'avoir pas été rasé depuis son incarcération), son visage rendu hagard par la mauvaise santé, tout cela eût certainement ému le plus indifférent. Je lui dis qu'à la demande de ses amis, j'étais intervenu en sa faveur avec un grand plaisir, et que, si je ne pouvais me promettre la satisfaction de le voir élargi, j'étais bien heureux de le visiter pour m'assurer de ses besoins et de la cruelle position où il se trouvait. II me remercia avec beaucoup de cordialité et d'expansion des dispositions que je lui manifestais. Je fus charmé par sa bonne humeur et l'intérêt de sa conversation. Il paraissait avoir conscience de sa situation critique et être préparé au pire. Il n'avait aucune parole d'amertume ou de reproche pour ses persécuteurs ; mais, d'autre part, il fit la remarque que le monde les jugeait pires qu'ils n'étaient réellement. Il attendait patiemment la logique des événements, et priait pour que la Providence pût trouver à ces terribles troubles une solution qui épargnât le sang humain. Il est détenu dans une cellule de six pieds sur dix, peut-être un peu plus grande, qui a le mobilier ordinaire de la prison ; une chaise et une petite table en bois, et un lit de prison. Elle est éclairée par une petite fenêtre. Comme prisonnier politique, il a la faculté de se faire apporter sa nourriture du dehors, et, en réponse à l'offre que j'étais heureux de lui faire, de lui envoyer tout ce qu'il pourrait souhaiter, ou de lui remettre tout l'argent dont il pouvait avoir besoin, il me dit qu'il n'avait, quant à présent, besoin de rien. J'étais la seule personne qu'il eût vue depuis son emprisonnement, et on ne lui avait pas laissé voir de journaux, ni avoir aucune nouvelle des événements de chaque jour. Je ferai une démarche auprès du préfet de police pour être autorisé à lui envoyer des journaux et des livres, et je profiterai du permis qui m'a été donné pour le visiter et lui rendre tous les services qui dépendront de moi. Je ne puis me dissimuler néanmoins le grand danger où il se trouve, et désire sincèrement de pouvoir aider à le préserver du sort qui semble le menacer. Je suis, etc. E. B. WASHBURNE. N° 425. Paris, 25 avril 1871. (Reçu 10 mai.) Monsieur, Bien que j'aie relaté dans ma dépêche du 25 (n° 423) la démarche par suite de laquelle je suis intervenu en faveur de l'archevêque de Paris, je crois utile de vous envoyer une copie de la lettre de S. Ex. Mgr Chigi, le nonce du. pape, et aussi une copie de la lettre du vicaire général de Paris et de ses collègues, toutes deux à moi adressées et contenant les motifs de leur requête. Je viens d'apprendre que l'on avait fait une démarche auprès de l'ambassadeur d'Angleterre avant d'en faire auprès de moi, et qu'il avait décliné toute intervention. Mais cet acte de la légation anglaise, si je l'avais connu, n'aurait point modifié mes résolutions, car je me serais considéré comme parfaitement, en droit d'étendre mes bons offices, officieusement, en faveur d'un homme aussi éminent par sa piété et aussi distingué par ses sentiments libéraux et ses vues philanthropiques que l'archevêque de Paris, aujourd'hui si cruellement persécuté. Je suis, etc. E. B. WASHBURNE. N° 427. ..... Du ministère des affaires étrangères, je me suis rendu en personne à la Préfecture de police, pour obtenir l'élargissement de plusieurs Allemands, parmi lesquels se trouvaient un prêtre, incarcéré à Mazas. J'ai trouvé là un jeune employé qui m'a très promptement donné satisfaction et m'a remis des ordres écrits pour leur mise en liberté. Hier, une dame américaine est venue à la légation pour me demander de m'intéresser en faveur de deux sœurs de charité (françaises), afin de les faire sortir de prison. Cette dame était elle-même sœur de charité et fille du dernier gouverneur de la Louisiane, Roman. Les deux religieuses en prison étaient ses amies, et avaient été arrachées à leur couvent par quelques gardes nationaux, il y a trois ou quatre semaines. Elle était dans la plus grande inquiétude à leur sujet. Je lui dis que, bien que je ne puisse aucunement intervenir d'une manière officielle, je consentais, par amitié pour elle comme Américaine, à appeler l'attention des autorités sur le cas de ses amies. J'ai, en effet, signalé cet incident à mon employé de la Préfecture et il m'a sans hésiter donné aussi un ordre de liberté pour elles. Je l'ai porté moi-même, au dépôt des prisonniers, et après avoir attendu environ une heure pour l'accomplissement de certaines formalités, j'ai eu le plaisir de voir les deux sœurs hors des murs de la prison. Du dépôt je suis allé à Mazas et je n'y ai rencontré aucune difficulté à faire opérer l'élargissement de trois prisonniers allemands, y compris le prêtre. J'ai profité de l'occasion pour visiter l'archevêque de Paris et lui apporter quelques journaux et une bouteille de vieux vin de Madère. Je l'ai trouvé à peu près dans le même état que dimanche et avec la même bonne humeur. J'ai été peiné de ne pouvoir lui annoncer aucun changement dans la situation. E. B. WASHBURNE. M. WASHBURNE À M. FISH (Extrait). N° 431. Paris, 2 mai 1871. Je regrette d'avoir à dire que la vie de l'archevêque de Paris est à mes yeux dans le plus imminent danger. Le bruit s'étant malheureusement répandu que le prince de Bismarck avait résolu d'intervenir pour sauver la vie de l'archevêque, a causé une grande agitation. Dimanche dernier une bande de gardes nationaux s'est dirigée sur la prison Mazas, avec le projet avoué de le fusiller. Par bonheur, un membre de la Commune fit son apparition à ce moment et eut le pouvoir d'empêcher ces gens d'exécuter leur dessein. Les gardiens ordinaires de la prison ont eu les plus vives alarmes ; ils ont fait changer l'archevêque de cellule et l'ont mis dans une autre partie de la prison. Ce qui a été empêché dimanche par la présence d'un membre de la Commune peut arriver chaque jour. Ayant des raisons de croire que le général Fabrice est chargé par son gouvernement de faire son possible pour sauver la vie de l'archevêque, et est chargé comme je le suis moi-même de la protection des intérêts allemands aussi bien que des intérêts de l'humanité, j'ai cru de mon devoir de lui adresser un message verbal confidentiel, par un membre de ma légation, pour l'informer de la critique situation de l'archevêque, afin que, s'il a des instructions pour intervenir, il puisse procéder ainsi qu'il le jugera convenable. E. B. WASHBURNE. M WASHBURNE À M. FISH (Extrait). N° 444. Paris, 19 mai 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Depuis que j'ai commencé à écrire cette dépêche, j'ai fait une nouvelle visite à l'archevêque, pour lui faire connaître qu'il était impossible d'effectuer son échange contre Blanqui. Je regrette d'avoir à dire que je l'ai trouvé très faible. Il avait été cloué sur son grabat toute la semaine dernière par une espèce de pleurésie ; il est sans appétit et ses forces sont considérablement diminuées. Il est cependant de bonne humeur, et, en apparence, résigné au sort, quel qu'il soit, qui peut l'attendre. E. B. WASHBURNE. N° 473. Paris, 29 juin 1871. (Reçu 13 juillet.) En rapport avec l'histoire de l'insurrection et avec la mort tragique de l'archevêque de Paris, j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, pour être déposée aux archives du département, une copie de toute la correspondance et des papiers relatifs à l'emprisonnement du prélat et aux démarches faites pour obtenir son élargissement. E. B. WASHBURNE. L'ARCHEVÊQUE CHIGI À M. WASHBURNE. Versailles-Montreuil, 18 avril 1871. 2, rue de la Vieille-Église. Monsieur et cher collègue, Permettez-moi de vous prier confidentiellement de faire bon accueil aux quatre chanoines ecclésiastiques de l'église métropolitaine de Paris, qui viennent vous demander votre protection en faveur de leur archevêque, jeté en prison par les insurgés de Paris. Permettez-moi de joindre ma prière à celle de ces bons prêtres et de vous assurer de ma grande reconnaissance pour tout ce que vous croirez pouvoir tenter dans l'intérêt des jours de Mgr Darboy. Recevez, etc. FLAVIUS CHIGI, Archev. de Myre, nonce apostolique. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. PRÉFECTURE DE POLICE. CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. Paris, 23 avril 1871. Nous, membre de la Commune, délégué civil à l'ex-préfecture de police, autorisons le citoyen Washburne, ministre des États-Unis, et son secrétaire, à communiquer librement avec le citoyen Darboy, archevêque de Paris. RAOUL RIGAULT. (Cachet.) Vu, 6 mai 1871. Le chef de division, EDMOND LEVRAUD. (Cachet.) M. WASHBURNE À L'ARCHEVÊQUE CHIGI. Paris, 24 avril 1871. Mon cher collègue, Je suis venu à Paris samedi soir, et le soir même j'ai pris mes dispositions pour voir un des chefs de la Commune le lendemain matin à 9 heures. Je ne saurais mieux faire que de vous envoyer un récit écrit par moi pour mon gouvernement à ce sujet. Je vous adresse donc confidentiellement une copie de la dépêche que j'ai expédiée hier à Washington. Après l'avoir lue, vous m'obligerez de me la retourner sous enveloppe, rue Mademoiselle, n° 7, à Versailles. Je joins ici une lettre de l'archevêque à l'abbé Lagarde. J'espère vous voir. MGR DARBOY A M. WASHBURNE. Je prie M. le ministre des États-Unis de recevoir mes remercîments pour la bonne visite qu'il a eu la bonté de me faire dans ma prison, et de vouloir bien faire parvenir la lettre ci-incluse à sa destination, par son secrétaire qui se rend à Versailles. L'adresse de la personne à qui elle est adressée sera donnée par S. Exc. le nonce apostolique ou par l'évêque de Versailles. Si cette personne est déjà repartie pour Paris, le secrétaire du ministre des États-Unis pourra détruire la lettre ou la rapporter à son retour à Paris. G. DARBOY, Archev. de Paris. Prison de Mazas, 23 avril 1871. L'ARCHEVÊQUE CHIGI À M. WASHBURNE. (Confidentiel.) Versailles-Montreuil, 23 avril 1871. Monsieur et cher collègue, Je ne sais véritablement comment vous remercier pour tout ce que vous avez eu la bouté de faire afin de venir en aide au digne archevêque de Paris. Vous avez fait plus que je n'eusse pu espérer, malgré la confiance que j'avais en vous, sachant les sentiments d'humanité et de compassion de votre cœur et connaissant la généreuse nation que vous représentez si dignement en France ; et je suis sûr que les démarches faites par vous auprès des hommes de qui dépend le sort de Mgr Darboy ne manqueront pas de produire le résultat le plus favorable qu'on puisse espérer dans les circonstances présentes. J'ai lu avec un grand intérêt et avec un sentiment de profonde gratitude envers vous, monsieur, les dépêches que vous avez eu la bonté de me communiquer confidentiellement et sous toutes réserves, et je m'empresse de vous les renvoyer, avec tous mes remercîments, à la légation des États-Unis, à Versailles, suivant l'indication que contenait votre honorée lettre d'hier. Le colonel Hoffman m'a informé que vous viendriez bientôt à Versailles, et je l'ai prié de me faire connaître votre arrivée, afin de pouvoir, sans délai, aller vous exprimer toute ma gratitude et mon respect. En attendant, veuillez agréer, etc. FLAVIUS CHIGI, Archev. de Myre, nonce apostolique. MGR DARBOY À M. WASHBURNE. 28 avril 1871 Je prie S. Exc. le ministre des États-Unis de recevoir l'hommage de mon respect et d'avoir la bonté de faire parvenir la lettre ci-incluse à Versailles. L'adresse de M. Lagarde, dans le cas où le représentant de Son Excellence ne la connaîtrait pas, pourra être obtenue soit à la résidence du nonce, soit à l'évêché de Versailles. G. DARBOY, Archev. de Paris. MGR DARBOY A M. WASHBURNE. 28 avril 1871. Je prie S. Exc. le ministre des États-Unis de recevoir l'hommage de mon respect et de me permettre d'avoir recours à son obligeance pour envoyer à Versailles la lettre ci-incluse. Je lui en serai très reconnaissant. G. DARBOY, Archev. de Paris. L'adresse de M. Lagarde est, sans doute, connue du représentant de M. Washburne à Versailles. En tout cas, on peut se la procurer chez le nonce ou chez l'évoque de Versailles. MÉMORANDUM DE L'ARCHEVÊQUE DE PARIS. ÉCRIT PAR LUI DANS LA PRISON DE MAZAS, LE 10 MAI 1871. On ne sait pas précisément quelle réponse a faite M. Thiers à la proposition qui lui a été adressée d'élargir Blanqui afin d'obtenir ; en échange, l'élargissement de l'archevêque de Paris et de quatre ou cinq personnes détenues avec lui. Le vicaire général Lagarde, qui est allé à Versailles pour s'occuper de cette affaire, n'a envoyé ici que des rapports vagues et incomplets sur le résultat de sa démarche ; mais, comme il ne revient point, on croit que tout espoir de succès n'est pas perdu. A défaut d'information précise, on conjecture que le gouvernement craint de paraître traiter avec la Commune, en acceptant l'échange proposé ; il est possible, en outre, qu'il regarde la libération de M. Blanqui comme dangereuse, au milieu de la présente agitation. Maintenant, les personnes qui s'intéressent soit à Blanqui, soit à l'archevêque, désirent vivement que l'on soumette les considérations suivantes à M. Thiers, qui les appréciera avec sagesse et humanité, et l'on croit qu'elles auraient un grand poids si elles étaient présentées à M. Thiers par Son Exc. le ministre des États-Unis. La question n'est pas entre la Commune et le gouvernement, mais entre le gouvernement et les personnes sus-mentionnées. Ces dernières ont décidé que l'archevêque et quatre ou cinq autres prisonniers, à désigner par M. Thiers, seraient envoyés à Versailles, si l'on peut avoir l'assurance que M. Blanqui sera mis en liberté. Cette assurance devait être garantie par la parole du ministre des États-Unis, autorisé à cet effet par celle de M. Thiers. Quant à la libération de M. Blanqui, au lieu de l'ordonner officiellement, ne serait-il pas possible de la réaliser, en lui laissant la faculté de s'évader, en sous-entendant qu'il ne serait pas repris, à moins que ce ne fût pour quelque nouveau délit commis par lui ? De cette façon le gouvernement n'aurait rien absolument à faire avec la Commune ; quelqu'un en dehors de la Commune recevrait l'assurance donnée par M. Washburne, et tout serait arrangé. Il ne pourrait y avoir aucun danger sérieux à élargir M. Blanqui, même dans l'état actuel des choses. La résistance de Paris est une résistance entièrement militaire, et la présence de M. Blanqui n'y pourrait rien ajouter. Les idées politiques et sociales que représente la Commune ne sont pas, en elles-mêmes, ni dans leur application, celles de M. Blanqui ; s'il venait à s'associer lui-même à la Commune, il ne serait pas un lien d'union entre les membres qui la composent, mais plutôt un nouvel élément de discorde. A tout événement, il ne semble pas qu'au milieu des théories politiques et sociales de la Commune il puisse être mis fin au présent conflit autrement que par la force des armes On n'aurait donc aucun nouvel embarras à surmonter si M. Blanqui était mis en liberté, et même s'il revenait à Paris. Le ferait-il, d'ailleurs, ou ne le ferait-il pas ? On l'ignore. Si l'on savait exactement pour quelles raisons M. Thiers hésite à prendre une résolution favorable sur la proposition d'échange qui lui a été soumise, il serait possible de les affaiblir et de l'amena peut-être à une meilleure conclusion. En outre, il ne devrait pas ignorer que la vie de l'archevêque est sérieusement menacée. En le sauvant, M. Thiers donnerait, croyons-nous, une grande satisfaction au clergé français et particulièrement à l'épiscopat. E. B. W. M. WASHBURNE À MGR CHIGI. Paris, 11 mai 1871. Mon cher collègue, M. Mac Kean, mon secrétaire particulier, ira vous trouver au sujet de l'archevêque. Il vous remettra une copie du mémorandum écrit par lui concernant un échange avec Blanqui. Je n'ai pas besoin de vous assurer que je serai très heureux de faire tout ce qui pourra être fait en cette circonstance — officieusement s'entend — pour faciliter tout arrangement qui pourrait être concerté. M. Mac Kean a visité l'archevêque avec moi hier, et pourra vous donner tous les éclaircissements en ce qui le touche. J'ai l'honneur d'être, etc. E. B. WASHBURNE. M. WASHBURNE À M. W. B. NORCOTT. Paris, 11 mai 1871. Cher monsieur, J'ai envoyé aujourd'hui à Mgr Chigi une copie du mémorandum do l'archevêque de Paris, au sujet de l'échange à faire entre lui et Blanqui et je lui ai dit que je ferais avec empressement tout ce qui serait possible, officieusement, bien entendu. Je crois que l'archevêque a très bien posé la question, et j'espère que l'attention de M. Thiers sera appelée sur son mémorandum. Je comprends bien les raisons que le gouvernement de Versailles pourrait opposer à la proposition d'échange ; mais il me semble qu'on pourrait s'élever au-dessus de ces raisons, dans un cas pareil, alors que la vie d'un homme tel que l'archevêque est en danger. Le gouvernement français ne perdrait rien à mettre Blanqui en liberté, et en le faisant il sauverait probablement les jours de l'archevêque. Je considère que sa vie est dans le plus imminent danger, et, pour ce motif, dans le désir d'alléger ses souffrances en prison, je me suis décidé à prêter tous mes bons offices en cette affaire. Dans votre visite à Versailles, j'espère que vous pourrez amener M. Thiers à consentir à l'échange. Je crois que la Commune est prête à élargir plusieurs prisonniers, y compris M. Bonjean, en plus de l'archevêque, dans le cas où Blanqui serait mis en liberté. C'est une considération de plus à faire valoir auprès de M. Thiers. Je suis, etc. E. B. WASHBURNE. MGR CHIGI A M. WASHBURNE. Versailles-Montreuil, 12 mai 1871. Monsieur et cher collègue, M. Mac Kean m'a remis ce matin la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser hier, ainsi que la copie du mémorandum écrit par l'archevêque de Paris, et j'ai reçu également, il y a quelques jours, par la poste et fort en retard, l'autre lettre que vous avez eu la bonté de m'écrire le 29 avril, avec les deux lettres qui y étaient jointes de Mgr Darboy pour l'abbé Lagarde, à qui je les ai remises immédiatement. Ce matin j'ai envoyé confidentiellement à M. Thiers le mémoire de l'archevêque, et je l'ai prié de me répondre confidentiellement afin de pouvoir vous envoyer cette réponse, pour être communiquée par vos soins à Mgr Darboy. Si je la reçois, comme cela a été promis, vers 3 heures, je m'empresserai de vous la transmettre, en vous priant de la faire connaître à Mgr l'archevêque. En attendant, il est bon que vous sachiez où en sont les affaires. M. Thiers ayant reçu, il y a quelques jours, la lettre apportée par l'abbé Lagarde, l'a soumise d'abord au conseil des ministres, puis à la commission des quinze députés qu'il s'est adjoints ; il a également soumis au conseil et à la commission la question d'échange, de Blanqui d'une part, et de l'archevêque avec quatre ou cinq ecclésiastiques d'autre part, et tous ont refusé unanimement leur consentement à un semblable arrangement[4]. Après cela, M. Thiers a déclaré que, malgré le désir qu'il éprouvait de voir l'archevêque en liberté, ainsi que l'abbé Deguerry, qui était son ami personnel, il ne pouvait prendre sur lui d'exécuter l'échange. Il a ajouté que M. Blanqui allait être jugé à nouveau, et que s'il était condamné à mort, il aurait lui, comme Président, le pouvoir de lui accorder la vie ; mais que, quant à le mettre en liberté, surtout avant qu'il fût jugé, cela lui était impossible ; que cela dépasserait son droit comme chef du pouvoir exécutif. Cette réponse, adressée à Mgr Darboy, il y a plus de deux semaines, a été couchée par écrit, et M. Lagarde a été prié de la porter à l'archevêque, sous enveloppe cachetée, comme elle était. Mais M. Lagarde a refusé, et persiste à refuser de le faire, donnant pour motif de son refus qu'il ne peut porter une lettre cachetée en réponse à une lettre qu'il avait apportée ouverte. Il en résulte que la lettre de M. Thiers est encore au ministère des cultes, et on ne veut l'envoyer que par M. Lagarde, qui, de son côté, n'a pas envie de s'en charger. M. Thiers veut aussi que je sois assuré qu'il est convaincu que ni les jours de l'archevêque de Paris, ni ceux des autres ecclésiastiques, actuellement prisonniers, ne sont en danger. Quant à moi, je ne partage pas, je l'avoue, la confiance du président sur ce point. 4 heures. — J'arrive de l'hôtel de la préfecture. M. Thiers a lu avec attention la copie du mémoire dont j'ai parlé plus haut, et il a répété, après mûre réflexion, les mêmes observations faites par lui dans sa réponse à Mgr Darboy. Il a résolu de ne point mettre Blanqui en liberté, mais d'épargner sa vie s'il était condamné à mort. C'est là tout ce que ses pouvoirs l'autorisent à faire. En outre, il ne lui serait jamais permis de sanctionner une iniquité, consistant à saisir des otages parmi les hommes éminents afin de faire élargir dés garnements et des criminels, en l'amenant à se prêter à de pareils projets d'échange plus ou moins déguisés. Il a renouvelé l'assurance que la vie de l'archevêque ne courait aucune espèce de' danger, et il a dit en terminant que dans deux jours environ les troupes seraient dans Paris et que tout péril aurait disparu. Telle est, mon cher collègue, la réponse que je puis vous faire, et je regrette avec vous qu'elle ne soit pas plus en rapport avec le désir de l'archevêque, et avec votre généreux et charitable dessein. Permettez-moi, en finissant, de vous communiquer, conformément aux ordres que le cardinal Antonelli m'a transmis, les sentiments de gratitude de Sa Sainteté le Pape et du cardinal pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous pourrez faire en faveur de l'archevêque si injustement martyrisé. Agréez, monsieur, avec mes sincères et affectionnés sentiments, la nouvelle assurance, etc. FLAVIUS CHIGI, Archev. de Myre, nonce apostolique. COMMUNE DE PARIS. CABINET DU PROCUREUR DE LA COMMUNE. Paris, 18 mai 1871. Le directeur de Mazas laissera les citoyens Washburne et Mac Kean communiquer avec le détenu Darboy. (Permanent.) Vu, 21 mai 1871. RAOUL RIGAULT, Procureur de la Commune. M. PLOU À M. WASHBURNE. A Son Excellence le Ministre des États-Unis, à Paris. Paris, 11 mai 1871. Monsieur, Je sais quel intérêt Votre Excellence a témoigné en faveur de Mgr Darboy, archevêque de Paris, et quelle gratitude en auront les amis de l'Église catholique. Permettez-moi d'invoquer cet intérêt pour demander à Votre Excellence de faire une démarche qui sera, sans doute, utile à Mgr Darboy. Les célébrités du barreau de Paris ont quitté la capitale, et Monseigneur a eu la bonté de me prendre pour conseil. J'ai, en conséquence, demandé au citoyen Raoul Rigault, procureur de la Commune, le permis nécessaire pour le visiter à la prison de Mazas. J'ai eu deux entrevues avec Monseigneur. Ces entrevues m'ont mis à même de faire certaines démarches ayant un caractère d'intérêt public, et j'avais espéré qu'elles pouvaient être renouvelées de temps en temps, quand la Commune a supprimé tous les permis qui avaient été accordés pour visiter les prêtres détenus, et a autorisé le citoyen Ferré, un de ses membres, à délivrer à l'avenir ces sortes de permis comme il le jugerait convenable. Malgré mon instante requête et ma qualité de conseil, qui aurait, dû s'opposer à un refus, — car un détenu ne peut être, sans barbarie, privé des avis de son conseil, — je n'ai rien pu obtenir de M. Ferré, qui déploie une sévérité intraitable. J'ai donc l'honneur de me prévaloir auprès dé vous de mon sincère dévouement envers Mgr l'archevêque de Paris — et sans aucune suggestion de qui que ce soit —, de supplier Votre Excellence de consentir à user de sa grande influence pour obtenir du citoyen Ferré la permission qu'il me refuse, sans donner aucune raison. Je demande pardon à Votre Excellence de l'importuner de la sorte, et j'espère qu'elle excusera mon indiscrétion en faveur du motif qui me porte à le faire. Je suis, avec un profond respect, monsieur, votre obéissant serviteur. PLOU, Jurisconsulte, rue Ventadour, 6. NUMÉRO 9. Lettre du surveillant Henrion.Pantin, le 25 mai 1871. Monsieur Brandreith, Le 24 à six heures et demie du soir, il est arrivé un piquet de 40 hommes commandé par un officier ; je crois être le 106e bataillon ; ils venaient pour fusiller l'archevêque, les gendarmes et sergents de ville. Me voyant seul avec un de mes collègues pour aller chercher tous ces malheureux et les livrer à leurs bourreaux, j'ai profilé de l'encombrement de la cour et du poste qui regardait par la grille, pour partir. A sept heures j'étais dehors l'enceinte ; j'ai pu remarquer que c'étaient tous des hommes de 20 à 25 ans avec le pantalon gris de fer à bande rouge ; il y en avait un en bourgeois ; le capitaine qui est arrivé un instant après, dit à ses hommes que c'était abominable que ce bataillon soit commandé deux fois pour cette corvée dans la même journée et que tout cela retomberait sur les officiers. Les gendarmes et sergents de ville étaient à la promenade. Ils sont arrivés ; je ne puis vous dire si l'exécution a eu lieu. Je n'aurais jamais pu remplir cette tâche que je me voyais tracée ; conduire quatre ou cinq de mes camarades de régiment dans les mains des exécuteurs, sans les embrasser. D'après la réputation que j'avais devant le directeur et les greffiers, je me voyais perdu. Sitôt que M. le directeur Brandreith aura repris son poste, s'il veut avoir l'obligeance de m'écrire, je me rendrai à mon poste ; je resterai à Pantin en attendant. Recevez, Monsieur le Directeur, mes sentiments les plus respectueux. Signé : HENRION. Mon adresse ; Route des Petits-Ponts, n° 17, à Pantin. (Lettre timbrée Pantin, 25 mai 1871 ; arrivée à Versailles, timbrée 26 mai 1871. M. Brandreith était le directeur régulier du dépôt des condamnés.) NUMÉRO 10. Jean-Baptiste Jecker.Je connaissais J. B. Jecker depuis 1856, époque à laquelle je fus envoyé au Mexique pour y prendre la direction de la chancellerie de la légation de France, ainsi que la gérance des consulats généraux d'Espagne et de Suisse. M. Jecker habitait alors le Mexique depuis une vingtaine d'années il était chef et fondateur de la plus importante maison de banque de la République, en même temps que l'un des plus grands industriels du pays. Tant que je suis demeuré au Mexique, c'est-à-dire jusqu'à la guerre de notre Intervention, je n'ai jamais entendu dire que du bien de lui. Jecker appartenait à l'une des premières familles du canton de Berne. Il était né à Porrentruy vers 1810, alors que cette petite ville était réunie à l'Empire français. Dans l'année qui suivit sa majorité, il avait négligé de faire la déclaration exigée par notre Code civil. Il avait un frère d'une douzaine d'années plus âgé que lui, qui s'est trouvé Français par le seul fait de sa naissance en temps utile. Ce Jecker aîné, ou docteur Jecker, avait fait à Paris d'excellentes études et était devenu un médecin de grand mérite. Après avoir exercé quelques années à Paris, il alla se fixer à Mexico, où il acquit une fortune considérable. On en peut juger par le legs de 300.000 francs qu'il fit à notre Académie de médecine. En 1835 ou 1836, le docteur Jecker fit venir son jeune frère à Mexico, et le commandita. J. B. avait fait aussi ses études à Paris, et a toujours été fort laborieux. En sortant du collège, il était entré dans la maison Hottinguer pour y étudier la banque. Il n'a quitté cette maison qu'à l'âge de vingt-quatre ou vingt-cinq ans, pour aller rejoindre son frère le docteur. J'attribue la chute commerciale de Jecker à la jalousie de plusieurs maisons qui s'étaient liguées contre lui. Profitant d'un moment où Jecker venait de débourser une somme considérable pour une escadre anglaise du Pacifique, elles obtinrent de Juarez — après quelque résistance de sa part — l'annulation des Bons Jecker, intitulés alors Bons 20 pour 100, prétendant qu'il avait eu pour but principal de soutenir Miramon, son antagoniste. Jecker fut donc obligé de suspendre ses payements, alors qu'il avait manifestement beaucoup plus d'actif que de passif. Sa fortune nette était évaluée au moins à 20 millions de francs. A partir de ce moment, le pauvre Jecker fut contrecarré en tout, et le plus souvent on disposa de lui sans lui. Son existence ne fut plus qu'une série de tribulations. Il est triste de penser qu'il ne se trouva pas une autorité française pour prendre courageusement la défense de cet homme de bien, converti en bouc émissaire par les perfidies de maisons intéressées à sa perte. Jecker avait souvent réclamé la qualité de Français. Il paraîtrait qu'il obtint des lettres de naturalisation en 1863. Si dans le moment ses créanciers s'en sont réjouis, ce devait être plus tard pour lui un grand malheur. On sait avec quel odieux acharnement plusieurs journaux l'ont attaqué sous la fin de l'Empire. Il a dû beaucoup en souffrir, car, bien que d'apparence calme et froide, il avait les perceptions délicates. C'était le type du vrai négociant ; parlant peu, réfléchissant beaucoup et agissant résolument. Nul ne traitait mieux que lui ses auxiliaires, qui recevaient toujours plus qu'il ne leur avait été promis. Il possédait les principales langues d'Europe, et était au moins aussi fort en minerie qu'en finances. Pendant son dernier séjour en Europe, Jecker avait étudié avec soin un nouveau procédé d'invention allemande qui consistait à traiter le minerai d'argent sans l'emploi du mercure. Après avoir répété en Angleterre les essais qu'il venait de faire en Allemagne, il résolut d'aller exploiter avec ce même procédé une excellente mine qui lui restait dans l'État de Zacatecas. Aussitôt sa détermination connue, il trouva, à Londres même, parmi ses créanciers, des amis qui se cotisèrent pour mettre à sa disposition 500.000 francs, afin qu'il pût de nouveau tenter la fortune au Mexique. Jecker devait encore à cette époque 10 millions de francs à trois cent vingt créanciers. Quel est l'industriel qui, en pareille occurrence, trouverait parmi ses créanciers les moyens d'aller tenter de nouveau la fortune à trois mille lieues ? Aussitôt de retour à Paris, Jecker avait hâte d'en partir ; ses amis étaient également heureux de le savoir approvisionné et en voie de pouvoir travailler utilement. Pas un ne mettait en doute sa réussite. Mais il eut la funeste idée d'aller demander un passeport à la Préfecture de police, où il fut arrêté. Le jour de son arrestation, je l'avais attendu chez moi quelques heures, parce qu'il m'avait promis la veille de ne point partir sans prendre mes commissions pour Mexico, et que je le savais pressé de nous quitter. Il avait pris son pied-à-terre rue Blanche, n° 5, chez sa sœur, Mme Ersesser, alors absente. Je m'y rendis le lendemain matin, et on me dit qu'il n'était pas rentré depuis la veille. Je courus à la légation de Suisse. Le secrétaire de la légation mit le plus grand empressement à aller trouver Raoul Rigault ; mais celui-ci lui objecta que Jecker était devenu sujet français. Le jeune diplomate eut peut-être le tort de ne point assez insister, car personne n'avait la preuve de ce changement de nationalité et l'on pouvait sauver ce martyr. En apprenant cette inquiétante fin de non-recevoir, j'allai trouver un mien ami, M. Charles Read, que je savais en anciennes relations avec Arnould, l'un des membres de la Commune. Mais le pauvre Arnould commençait à devenir suspect à ses furibonds collègues ; de sorte qu'il nous assura que sa recommandation ne ferait qu'aggraver la situation du prisonnier. Il nous confessa qu'en ce moment il la croyait des plus dangereuses. De là je me rendis à la Préfecture de police, dans l'espoir d'obtenir tout au moins des nouvelles du pauvre détenu. Étant entré, comme dans une halle — sans gardien ni sentinelle — dans la grande pièce du rez-de-chaussée, je vis au fond de la salle un jeune citoyen qui semblait trôner au milieu d'un groupe et qui devait être Raoul Rigault[5]. Ce personnage m'accueillit avec une politesse à laquelle je ne m'attendais point, me disant qu'il allait donner des ordres pour que je pusse voir le citoyen Jecker, et il sortit aussitôt par une porte d'intérieur. Entre temps le groupe principal s'était fractionné en petites coteries, dans lesquelles on causait avec plus ou moins d'animation. L'un des assistants, à figure placide, profita de ce mouvement qui s'était fait dans la salle pour s'approcher de moi et me dire à l'oreille : Monsieur, n'attendez pas le retour du citoyen que vous avez vu sortir par cette porte ; il y va de votre sûreté. Je ne me fis point répéter l'avertissement ; je remerciai mon bienveillant informateur par un signe de tête, et m'en allai à reculons. Le nom de Jecker doit être éteint, car le docteur et J.-B. n'ont jamais été mariés. L'aînée de leurs sœurs avait épousé un négociant de Bordeaux, M. Bornèque, dont elle eut trois fils. J.-B. en avait appelé deux au Mexique ; l'un travaillait dans son cabinet (Jules), et l'autre était sur sa grande usine de fer ; le troisième est encore attaché à une grande maison de banque à Londres. Après la chute de notre hideuse Commune, Bornèque de Londres vint à Paris rechercher le corps de Jecker et l'a fait inhumer. A mon témoignage sur l'honorabilité de J.-B. Jecker je puis joindre celui fort compétent de M. Hottinguer père. En octobre 1860, le comte de Saligny, qui allait partir pour le Mexique, se trouvant appelé par une affaire chez M. Hottinguer, demanda à celui-ci qu'elle était son opinion sur Jecker, dont on parlait si diversement. Il lui répondit : Je suis un des principaux créanciers de M. J.-B. ; on n'est jamais bien disposé quand on se trouve en danger de perdre une somme considérable ; néanmoins je dois dire que c'est le plus honnête homme que j'aie rencontré en affaires. A. DE MORINEAU, Consul de France en retraite, ancien gérant des consulats généraux de Suisse et d'Espagne au Mexique. Paris, août 1877 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 391 NUMÉRO 11. La mort de Delescluze.Le corps de Delescluze se trouvait à l'église Sainte-Elisabeth, le dimanche 28 mai 1871 ; une première fois je l'ai examiné et une seconde fois quelques heures plus tard, en présence d'un général, qu'on m'a dit être le général Clinchant. Delescluze n'avait reçu qu'une seule balle, laquelle avait traversé la poitrine de part en part ; cette balle, comme vous le dites, l'avait atteint de côté ; elle a dû perforer dans leur épaisseur les deux poumons et le cœur ; la blessure a été certainement mortelle. Mais ce qui a pu faire croire à quelque chose du côté du cou, c'est qu'il y portait une brûlure formant un cercle complet, large comme deux travers de doigt ; à chaque poignet existait une brûlure semblable, de même largeur et moins profonde d'un côté que de l'autre. Il est assez difficile de donner une explication à ce fait, car les vêtements n'étaient pas brûlés, ni la chemise, ni le gilet, ni la redingote. Le col et les manches de la chemise étaient déboutonnés. — (Paris, 14 octobre 1877. Docteur H. Colombel.) Dans la semaine qui suivit la défaite de la Commune — j'ai négligé de prendre la date exacte —, le journal la Liberté a publié le récit suivant, que l'on considéra à cette époque comme ne s'éloignant pas trop de la vérité ; MORT DE DELESCLUZE. On nous a raconté, d'après des témoins que nous ne pouvons malheureusement pas invoquer, parce qu'ils sont dispersés, impossibles peut-être à retrouver, des détails sur la mort du chef de l'insurrection parisienne. Nous allons les donner, en n'en prenant pas la responsabilité. Delescluze s'était renfermé, après la prise de l'Hôtel de Ville, dans la mairie du onzième arrondissement, et c'est de là qu'il dirigeait les mouvements de ses farouches séides. La vieille hyène, comme avaient fini par l'appeler eux-mêmes ses collègues de la Commune, avait depuis quelques jours, une activité fébrile que rien ne pouvait calmer ; il ne dormait plus et ne rêvait que sang et meurtre. — On parlera de moi, s'écriait-il sans cesse dans son ivresse implacable. Il faut que Paris disparaisse. Lâche ville qui ne veut pas qu'on la délivre de ses oppresseurs. Et il multipliait ses ordres infâmes, et il veillait à ce que les complices des incendies fussent approvisionnés de bombes et de pétrole. Parfois le nom de Chaudey passait sur ses lèvres blafardes, et il semblait que le remords pénétrait l'âme de ce monstre. En effet, on ne l'ignore pas, c'est pour échapper au témoignage d'un ancien ami qu'il avait ordonné à Raoul Rigault de faire fusiller l'infortuné rédacteur du Siècle. Delescluze, ne l'oublions pas, avait commis dans sa jeunesse un vol chez M. Denormandie[6], avoué, chez lequel il était clerc. Proudhon, qui connaissait son Delescluze, et le savait capable de toutes les infamies, voulait se garder contre ses manœuvres. Il possédait la preuve du vol ; il l'avait confiée à Chaudey[7]. Lorsque le général Vinoy s'empara du quartier dans lequel est compris le onzième arrondissement, on trouva le corps de Delescluze sur le boulevard du Prince-Eugène. Voici ce qui s'était passé. Tant que la résistance de l'insurrection fut une véritable bataille, Delescluze commandait comme un général, il consultait le plan do Paris et donnait des ordres ; mais quand il se vit resserré dans le petit cercle qu'il occupait, il perdit la tête, il redoubla de rage incendiaire ; mais en même temps il ne pensait plus qu'à avoir la vie sauve. Il n'espérait pas en la clémence des généraux ou du gouvernement régulier. Il voulait fuir. Les plus dévoués de ses amis, les plus fanatiques de son état-major, en eurent le soupçon et le surveillèrent. Il s'en aperçut et voulut marcher le front haut ; mais la peur, l'horrible peur se lisait dans ses yeux jaunes. Au plus fort de la bataille, alors que l'épouvantable fracas de l'artillerie était le plus intense, Delescluze quitta son cabinet de la mairie par une petite porte et sortit. Parvenu à la barricade du boulevard du Prince-Eugène, il fut reconnu. On accusa Delescluze de fuir, il voulut protester de ses intentions, et il affirma que son devoir l'appelait sur un autre point. Déjà une foule nombreuse s'était rassemblée ; on s'informe, on s'inquiète, on se dit, on se redit les soupçons pesant déjà sur le farouche dictateur qui, pendant ce temps, essayait de convaincre son entourage. Mais les réactions sont promptes dans le peuple. Ceux, les femmes surtout, qui avaient tant souffert de ce siège horrible, crièrent à la trahison et en vinrent tout naturellement à accuser Delescluze des malheurs de la patrie. Ce fut alors un cri unanime de malédiction contre l'auteur de tous les maux de la capitale, et une femme lui mit le poing sur la ligure. Delescluze repoussa la main ; on crut qu'il frappait cette femme. La fureur populaire fut portée alors à son comble. Tous les poings se levèrent, des armes furent déchargées dans la foule, et une panique effroyable se mit parmi tout ce monde. C'était à qui fuirait de tous côtés, car dans la demi-obscurité de la soirée, on ne savait d'où partaient ces coups de feu. Ceux qui fuyaient ne cessaient de proférer des imprécations contre Delescluze ; mais ils y ajoutaient leurs appréhensions que cet homme eût pu s'échapper. Il n'en était rien. Delescluze avait été frappé et ce furent les troupes du général Clinchant, ainsi que nous l'apprend le Journal officiel, qui trouvèrent son cadavre. Son corps a été transporté dans l'église Sainte-Elisabeth, puis exposé un peu après dans le square du Temple. Ainsi a fini cet homme que l'insurrection a essayé de grandir et qui, après avoir été un vulgaire voleur, laissera dans l'histoire le nom de l'un des plus exécrables assassins. C'est l'Érostrate moderne. NUMÉRO 12. Gendarmes et gardes de Paris tués rue Haxo.L'état nominatif des sous-officiers, brigadiers, gardes et gendarmes qui ont été fusillés, comme otages, le 26 mai 1871, et inhumés en tranchée gratuite, dans le cimetière de Belleville (14e division), le 30 du même mois, portait les noms suivants ; Garaudet, Jacques. Geanty, Jean-Baptiste-Onésime. Millotte, Louis-Ferdinand. Pons, Jean-Pierre-Edmond. Cousin, Pierre-Baptiste. Poirot, Jean-Étienne. Bermond, Louis. Bianchardini, Jean-Valère. Bodin, Jean-Philippe. Bouzon, Jean-François-Auguste (assassiné à Sainte-Pélagie). Breton, Nicolas. Capdeville, Pierre-Léon (assassiné à Sainte-Pélagie). Carlotti, Xavier. Chapuis, Georges. Colombani, Fabien. Condeville, Charles-Louis-Benoît. Doublet, Léon-Firmin. Ducros, Jean-Louis. Dupré, Augustin. Sischer, Joseph. Sourès, Jean-Benjamin. Keller, Philippe. Mannoni, Jean-Thomas. Marchetti, Charles-François. Marguerite, Jean. Marty, Jean-Antoine-Casimir. Mongenot, François-Eugène. Mouissie, Joseph. Pacotte, Dominique (assassiné à Sainte-Pélagie). Paul, Laurent-Marie. Pauly, Jacques. Pourteau, Pierre. Riolland, Claude-Alphonse. Valder, Louis-Alexandre. Villemin, Sébastien. Bellamy. Lacoze. Blanchon. Valet. Un monument funèbre élevé dans le cimetière de Belleville a reçu es restes de tous ces malheureux, le 12 et le 13 février 1877. NUMÉRO 13. Le surveillant Pinet et les otages de la troisième section.M. l'abbé Amodru a publié le récit des événements dont il a été le témoin et failli être la victime[8]. Dans la dix-septième édition, qui vient de paraître, il a repoussé avec chaleur la version que j'ai adoptée. Il a même ajouté à son volume une longue note que je crois devoir mettre sous les yeux du lecteur. RECTIFICATION OU RÉPONSE À DES RÉCITS ERRONÉS PUBLIÉS DE BONNE FOI SUR NOTRE DÉFENSE ET NOTRE DÉLIVRANCE. Dans la Revue des Deux-Mondes, on a publié, au commencement d'octobre 1877, un récit détaillé sur notre défense et notre délivrance de la Roquette. Nous rendons justice aux bonnes intentions de l'auteur et nous le remercions de consacrer son talent à la défense de la bonne cause, mais nous le prions de vouloir bien accepter une rectification très importante, que d'ailleurs il provoque lui-même (pages 546 et 547). Il s'agit de la troisième section de la prison, celle où furent faites les barricadés et où l'on se défendit vaillamment contre les assassins, en implorant publiquement le secours de Dieu. On attribue principalement la gloire et le succès de cette défense à un gardien de prison, M. Pinet. Voici les faits tels qu'ils se sont passés sous mes yeux, et j'ai en main des lettres de plusieurs otages qui confirment ce que je vais dire. L'honneur de cette défense appartient, après Dieu, à nos 82 jeunes soldats et à quelques sergents de ville, tous otages avec nous[9]. Quand les barricades étaient faites et la bataille à peu près gagnée par eux, M. Pinet arriva le dernier, trouvant des amis parmi nous. Sa présence et ses renseignements contribuèrent sans doute à raffermir quelques otages dans la résolution de se défendre et nous lui en sommes reconnaissants ; mais il serait injuste de lui attribuer la part principale et l'initiative de la défense. J'entre dans quelques détails pour que désormais on ne renouvelle plus ces récits erronés qui enlèvent aux jeunes militaires et aux sergents de ville l'honneur qui leur est dû et ne laissent qu'une faible part à l'action extraordinaire de la Providence. Lorsque les barricades étaient faites et que tous les otages de la troisième section se trouvaient dans le corridor en étal de défense, nous entendîmes crier à la porte du petit escalier. C'était quelqu'un qui demandait à entrer ; je me rendis là avec plusieurs militaires otages qui se refusaient énergiquement à ouvrir la porte et se montraient indignés contre tous les employés de la prison. M. Pinet protestait de ses bonnes intentions et courait les plus grands dangers, à cause de la fureur de Ferré et de François, qui ne s'expliquaient pas notre résistance[10]. J'engageai les jeunes militaires qui se trouvaient à mes côtés à entrebâiller seulement la porte, pour donner ensuite passage à ce gardien, si vraiment il avait de bonnes intentions, ce qui jusque-là nous était inconnu dans notre section. Ils y consentirent avec hésitation. Alors les obstacles jetés là pour la barricade furent précipitamment retirés, la porte fut assez entrouverte pour livrer passage à un seul homme et M. Pinet, se glissant à mes côtés, entra, le dernier, quand toutes les barricades étaient faites et la défense organisée. Il déploya ensuite de l'énergie et du courage comme nous l'avons raconté, mais, en vérité, nous étions sauvés quand il arriva, et sauvés sans le concours d'aucun employé de la prison. Il serait d'une injustice révoltante de lui attribuer la gloire due à ces 82 jeunes gens que la Commune avait faits prisonniers et qui restèrent fidèles à leur devoir. On a prêté quelquefois aux jeunes détenus un rôle de protection qu'ils n'ont pas exercé à notre égard ; quelques-uns mirent le feu à notre barricade, nous menacèrent de coups de fusil et voulurent nous forcer à descendre sur les ordres de Ferré et de François ; les autres s'échappèrent de la prison et se dispersèrent de tous côtés. Si des gardiens de la prison les ont argumentés en notre faveur, nous n'avons pas eu lieu de nous en apercevoir[11]. Le tumulte des jeunes détenus, la panique générale d'un grand nombre de fédérés armés et convoqués pour le massacre, le cri les Versaillais ! le départ des chefs de la Commune, la sortie d'un grand nombre d'otages qui étaient dans les bâtiments en face du nôtre dans la même prison, tout cela s'est accompli à la suite de la construction de nos barricades énergiquement défendues. Sans ces barricades, suivies d'une résistance qui n'entraîna aucune effusion de sang, les massacres auraient été inévitablement exécutés. Tous les témoignages s'accordent sur ce point. Il est donc important de savoir quand et comment ces barricades commencèrent. Dans l'intérêt de la vérité, nous avons au moins le droit do ne par tolérer qu'on en attribue leur commencement à un homme qui n'y était pas lorsque déjà elles étaient finies. Le lendemain matin, 28 mai, jour de la Pentecôte, tous les otages de la deuxième et de la troisième section sortaient de la Roquette sous la protection de l'armée française. Ceux qui sont venus là le 29 mai pour recueillir des renseignements après notre départ n'ont pu y trouver que des récits sujets à contrôle. Les choses étant telles que nous les avons publiées, comment donc se fait-il que certains otages fort dignes de respect aient accrédité une version différente relativement à M. Pinet ? La réponse et très facile. Le corridor est long ; il y avait deux barricadés, l'une du côté du grand escalier, c'était la principale, et l'autre du côté du petit escalier, c'était celle qui exigeait le moins de monde. Évidemment ceux qui se trouvaient loin du petit escalier et au milieu du bruit vertigineux de la grande barricade qu'on achevait précipitamment, n'ont pu voir et entendre ce qui se faisait à l'autre extrémité. Pour moi, j'affirme ce que j'ai vu et d'autres otages l'affirment avec moi. J'invite ceux qui auraient encore quelques doutes à interroger les témoins qui ont bien vu tout ce qui s'est passé. Parmi ces témoins dont les témoignages s'accordent avec le nôtre, je cite un prêtre assurément très grave, très consciencieux et bien connu du clergé de Paris. C'est M. l'abbé Bacuez, directeur au séminaire Saint-Sulpice. Avant son introduction dans notre section, M. Pinet ne nous avait rien dit qui pût nous faire soupçonner ses bons sentiments et il est trop honnête pour vouloir accepter seul la gloire due à 82 autres pour la journée du 27 mai 1871. Qu'on l'interroge lui-même. Son honnêteté ne lui permettra certainement pas d'affirmer que nos barricades ont été commencées sur son invitation, car il était absent quand on les faisait, et il les trouva faites en rentrant dans notre section. On nous a quelquefois objecté que nous avions tort d'insister tant sur ce fait ; nous répondrons que ce fait intéresse l'histoire de France et celle de l'Église. En conséquence, nous ne pouvons supporter qu'on écrive cette histoire contrairement à la vérité, et nous ne craignons pas un contrôle, puisque nous avons cité les noms et les adresses de cinquante-deux témoins. Quant à l'importance du fait, voici les considérations que nul ne peut dédaigner. N'est-ce pas dans la Roquette qu'ont été massacrés quatre prêtres avec l'archevêque de Paris et le premier Président de la Cour de Cassation[12] ? N'est-ce pas de là que sont sorties, le 26 mai, les 47 victimes massacrées à la rue Haxo[13] ? N'est-ce pas à côté de nous, dans la Petite-Roquette, qu'il y avait environ onze cents soldats otages qu'on voulait mettre à mort et qui furent sauvés ? N'est-ce pas sur la place de la Roquette que le premier archidiacre de Paris fut massacré et qu'un grand nombre d'autres victimes furent immolées ? N'est-ce pas dans la Roquette que furent emprisonnés deux vicaires généraux de Paris, le secrétaire général de l'archevêché, plusieurs curés et vicaires et des prêtres de diverses congrégations religieuses ? Enfin, n'est-ce pas à la Roquette que les chefs de la Commune s'étaient retirés à la dernière heure, pour y établir le centre de leur gouvernement[14] ? Comment des hommes religieux pourraient-ils oublier que dans cette prison Dieu fut invoqué publiquement, et solennellement en face des massacreurs dont la rage resta impuissante ? Et si cette impuissance se produisit d'une manière inattendue et extraordinaire, pourquoi ne le dirions-nous pas ? Et si quelqu'un veut s'attribuer à lui seul l'honneur principal de cette délivrance qui en a produit tant d'autres, pourquoi ne lui ferions-nous pas remarquer qu'il est dans l'erreur et qu'il offense la vérité historique ? Nous avons sagement évité de caractériser le fait de notre délivrance ; mais dussions-nous en souffrir encore, nous ne tolèrerons jamais qu'on le réduise aux simples proportions d'un fait vulgaire qu'un homme prépare d'avance, comme un capitaine prépare une compagnie sous ses ordres. Le capitaine en ce temps-là était invisible, il l'est encore aujourd'hui. A l'appui de cette rectification, M. l'abbé Amodru cite en pièces justificatives des lettres de MM. Walbert, Arnoux, Rougé, Cuénot, qui furent otages, les deux premiers à la troisième section, les deux autres à la seconde ; en outre, M. Amodru parle d'une lettre de M. l'abbé Bacuez conforme à ses propres souvenirs, mais il ne la produit pas. Le caractère sacré dont est revêtu M. l'abbé Amodru ne me permet point de douter de ses assertions ; aussi mon embarras est extrême, car un otage de la troisième section, revêtu d'un caractère non moins sacré, présente sous un tout autre aspect l'intervention du surveillant Pinet. M. l'abbé Lamazou, ancien vicaire de la Madeleine, actuellement curé à Auteuil, animé, comme M. l'abbé Amodru, de l'amour de la vérité et bien décidé à ne point la trahir, a raconté, lui aussi, ses aventures à la Grande-Roquette. Son livre, qui a paru deux mois environ après celui de M. Amodru — voyez la Roquette, préface de l'éditeur —, renferme quelques pages qu'il est bon de citer, afin que le lecteur puisse juger par lui-même des difficultés qui assaillent un historien soucieux de l'exactitude, pris entre deux récits contradictoires émanés tous deux de témoins oculaires, de bonne foi et incapables de mentir. M. l'abbé Lamazou dit : A trois heures quelques minutes, les lourds verrous de nos cellules s'agitèrent avec une rapidité inaccoutumée ; j'étais à genoux, récitant d'une voix éteinte l'office de la veille de la Pentecôte. Mon voisin ouvre vivement la porte de ma cellule : Courage, me dit-il, c'est maintenant notre tour ; on nous fait tous descendre pour nous fusiller ! — Courage, lui répondis-je de mon côté, et que la volonté de Dieu soit faite ! Je m'étais déjà revêtu de mes habits ecclésiastiques ; je m'avance au milieu du corridor où étaient mêlés et confondus prêtres, soldats, gardes nationaux. Les prêtres et les gardes nationaux avaient une attitude calme et résignée ; les soldats ne pouvaient croire au sort qui les attendait : Qu'est-ce que nous leur avons fait à ces malheureux ? Nous nous sommes battus contre les Prussiens, nous avons rempli notre devoir ; pourquoi veulent-ils nous fusiller ? Non, cela n'est-pas possible ! Les uns poussaient des cris de colère, les autres restaient silencieux et immobiles, comme ils avaient été le jouet d'un rêve. Les prêtres se mettaient à genoux pour se fortifier par une dernière absolution ; l'un d'eux engage les soldats à nous imiter et leur adresse quelques paroles d'encouragement. Une voix vibrante comme l'airain[15] domine tout à coup ce bruit confus ; Mes amis, écoutez un homme de cœur ; ces ignobles scélérats ont déjà tué trop de monde ; ne vous laissez pas assassiner, venez à moi, résistons, combattons ; plutôt que de vous livrer, je veux mourir avec vous !... C'était la voix du gardien Pinet. Ce généreux enfant de la Creuse, ahuri par tant de forfaits, ne pouvait plus étouffer son indignation ; chargé par le sous-brigadier Picon d'ouvrir lentement nos cellules et de nous livrer deux par deux aux insurgés qui nous attendaient au guichet du greffe, il avait fermé sur lui la porte du troisième étage, ouvert rapidement nos cellules pour nous conseiller et organiser promptement la résistance, prêt à sacrifier sa vie, qui ne courait aucun danger, pour nous aider à sauver la nôtre. M. l'abbé Amodru avait pris à son tour la parole et joignait ses protestations à celles de Pinet ; Ne nous laissons pas fusiller, mes amis, défendons-nous ; ayez confiance en Dieu, il est pour nous et avec nous, il nous sauvera !... Les esprits étaient hésitants et partagés : Se défendre, objecta l'un, est une folie ; nous n'y gagnerons qu'une mort plus cruelle ; au lieu d'être simplement, fusillés, nous allons être égorgés par la populace ou consumés par les flammes ! — Faisons monter les gardes nationaux, s'écriait un naïf, nous leur prouverons que nous sommes d'honnêtes gens, et non des voleurs et des assassins. — Ce n'est pas notre vie qu'on menace, s'écriait un soldat dont l'impartiale vérité me fait un devoir de reproduire les paroles et qui avait aussi peu de discernement que de sens moral ; c'est aux curés seuls qu'on en veut ; n'allons pas exposer notre vie en cherchant à défendre la leur. Je n'avais pas encore dit une parole ; je suivais avec une anxiété facile à comprendre les phases de cette étrange situation ; quelques confrères me demandaient ce qu'il y avait à craindre ou à espérer. Les sergents de ville qui sont au-dessous de vous, s'écria le gardien Pinet que les hésitations rendaient plus énergique et plus éloquent, sont disposés à se défendre ; ils travaillent déjà à la barricade ; à défaut d'armes, nous avons du cœur ; ne vous laissez pas fusiller par ce tas de bandits. J'étais convaincu que la résistance, dont je jugeais le succès humainement impossible, était néanmoins le parti le plus digne. Depuis le 18 mars, je ne cessais de protester contre le silence et l'abdication des honnêtes gens en face des malfaiteurs ; pour me montrer jusqu'au bout fidèle à mon programme, je sortis de mon inaction apparente. M. Walbert, ancien officier de paix, et M. l'abbé Carré, vicaire de Belleville, émettent l'idée qu'il faut percer le plancher pour nous mettre en communication avec les sergents de ville enfermés au second étage, et aussitôt ils s'arment de planches et de tringles de fer que nous arrachons de nos lits pour défoncer le sol. Je me joins à eux. Moi qui, le matin, n'avais plus la force de me tenir debout et qui n'avais pas reçu une bouchée de pain, je brisais les planches et tordais les tringles avec une irrésistible facilité. En cinq minutes, une large ouverture est pratiquée entre le troisième et le deuxième étage. Les sergents de ville sont prêts à vendre chèrement leur vie. Le sous-officier Teyssier se hisse à travers cette ouverture pour prendre avec Pinet le commandement de l'insurrection[16]. Le récit de M. l'abbé Lamazou porte en lui-même un accent de sincérité dont il est difficile de n'être pas saisi ; mais je n'en ai tenu compte, car il était en contradiction formelle avec celui de M. Amodru. Je me suis donc adressé à d'autres autorités, à celles dont mes longues études sur Paris m'ont enseigné à apprécier la rectitude et l'impartialité. Je ne m'en suis pas rapporté aux éléments que j'avais personnellement recueillis à la Grande-Roquette le 29 mai et le 11 juin 1871, et qui tous sont conformes à la version que j'ai donnée ; j'ai eu recours à la grande administration qui dirige le service des prisons de la Seine, et je lui ai demandé de vouloir bien m'aider à saisir la vérité. Avec une complaisance dont je reste très touché, tous les documents ont été mis à ma disposition et ont dissipé mes doutes. Le service des prisons de la Seine, réinstallé à Paris dès le 27 mai, s'occupa, sans désemparer, de faire des recherches approfondies sur la conduite de son personnel pénitentiaire pendant la Commune. L'intérêt était des plus graves ; il s'agissait de livrer les employés coupables à la justice militaire et de récompenser ceux qui étaient restés fidèles à leur devoir. Il y eût enquête, contre-enquête, contrôle de l'inspection générale ; tous les surveillants, plusieurs détenus, plusieurs otages furent interrogés ; les témoignages, furent reçus et examinés contradictoirement ; des rapports furent demandés aux otages qui appartenaient à l'administration, et aux greffiers demeurés à leur poste ; tous ces documents forment des pièces historiques de la plus haute valeur, au point de vue des faits généraux et au point de vue des faits individuels, car la conduite de chacun des employés — greffiers, brigadiers, sous-brigadiers, surveillants — y est minutieusement examinée. Toutes les notes relatives à Pinet sont concordantes et peuvent se résumer par cette phrase que je cite textuellement : Il leur demanda (aux otages) s'ils étaient bien décidés à vendre chèrement leur vie ; oui, lui fut-il répondu unanimement ; en ce cas, à l'œuvre ! je suis des vôtres ; si vous succombez, je succomberai avec vous. Sur ces mots, Pinet commença à improviser dans la troisième section les moyens les plus efficaces pour résister aux insurgés. Une barricade fut construite à l'entrée de la galerie, etc., etc. Tous les rapports, toutes les lettres, toutes les dépositions constatent le même fait. Il y a plus ; dans la matinée du 27, Pinet avait prévenu un otage de la deuxième section de son dessein bien arrêté de s'opposer aux tentatives des fédérés. — Parmi les détenus de cette section se trouvait M. Antoine Rougé, sous-brigadier de sergents de ville. Sorti le 28 mai dans la matinée, il se rendit immédiatement au ministère des affaires étrangères, où les services de la police municipale étaient établis, et, sur l'ordre de l'un de ses chefs, M. l'inspecteur divisionnaire Vassal, il rédigea le récit de ce qui lui était arrivé depuis son arrestation (19 mars). On n'a pas résumé la déposition de M. Rougé ; le rapport est entièrement écrit de sa main et signé de lui ; voici ce que j'y lis : Le surveillant Pinet (François) s'efforça tous les jours de rendre notre captivité moins dure. Il nous l'a prouvé jusqu'à l'heure de notre délivrance, attendu que le samedi 27, à midi, il est venu, en compagnie du surveillant Bourguignon, me prévenir qu'il venait de découvrir cinquante bombes Orsini dans un coin du poste des fédérés qui nous gardaient ; il en avait saisi une qu'il m'a fait voir ; elle était hérissée de capsules. C'est là qu'il m'a dit, dans ma cellule, qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour nous, si nous voulions nous défendre contre ces ignobles bandits. Nous avons fait part de cette proposition à nos infortunés voisins, et chacun se mit à la construction des barricades. Bourguignon a disparu pour nous être utile en bas ; il n'a pas cessé de nous servir. Lorsque M. Antoine Rougé écrivait ce rapport, sous l'impression toute vive encore des évènements auxquels il venait d'échapper, il ne se doutait pas qu'il donnait à l'histoire un document d'irrécusable sincérité. Ses souvenirs se sont modifiés depuis le 28 mai 1871, je le sais ; M. l'abbé Amodru nous en fournit la preuve en publiant (p. 391) un témoignage dans lequel M. Rougé dit : Aucun employé des prisons ne s'est sacrifié pour nous. Nous devons notre salut au courage de tous les otages qui s'est produit instantanément. Dès que les troupes régulières se furent emparées de la Grande-Roquette, une dépêche fut adressée au maréchal Mac-Mahon, commandant en chef de l'armée française. Cette dépêche, qui donnait le premier avis officiel de la mort des otages, fut immédiatement transmise à M. Thiers ; voici ce que j'y lis : Dans la journée de samedi, les prisonniers restants allaient être fusillés, lorsque, à l'instigation du gardien Pinet, de l'ancien personnel conservé par la Commune, ils se sont révoltés et retirés dans une portion de la prison où ils se sont barricadés, et où les insurgés ont cherché à les brûler vifs. Les matelas qui étaient en laine et leur servaient de défense n'ont pas bien brûlé ; et cent soldats qui étaient restés entre les mains de la Commune quand la caserne du Prince Eugène a été envahie, ont formé parmi eux le noyau de résistance le plus solide. A cinq heures du soir, samedi, la Commune, prise définitivement de panique, s'est enfuie, en emportant la caisse et se dirigeant sur la mairie du XXe arrondissement. Elle se trouverait encore à Belleville. En résumé, il reste encore en ce moment à la prison ; 1° cent militaires sortant des hôpitaux, etc., qui ont refusé de participer aux prises d'armes décrétées par la Commune ; 2° quinze ecclésiastiques ; 3° cinquante-quatre sergents de ville. Le directeur de la prison nommé par la Commune était un sieur François, demeurant rue de Charonne, 20. Il s'est enfui hier avec la Commune. (Il avait été l'instigateur du complot contre les pompiers de la Villette. — Affaire Eudes.) — P. C. C. Le général de division, chef d'état-major général, BOREL. Les détails contenus dans cette dépêche, et recueillis à la Grande-Roquette même, prouvent, qu'elle a été expédiée entre le moment où les troupes sont entrées dans la prison et celui où les otages l'ont définitivement quittée, c'est-à-dire entre cinq et sept heures du matin, et qu'elle a été rédigée d'après les renseignements fournis par les témoins des faits qu'elle relate. Je suis, pour ma part, fort désintéressé dans la question ; je n'ai été ni surveillant, ni otage à la Grande-Roquette. Je n'ai recherché que la vérité, j'avais cru l'avoir mise en lumière ; M. Amodru fait effort pour me prouver que je suis dans l'erreur, et se refuse à tolérer ma version, malgré les témoignages auxquels je l'ai empruntée. Je n'insisterai pas et j'accorderai, si l'on veut, que Pinet n'a pénétré dans la troisième section que lorsque déjà les détenus de celle-ci avaient construit leur barricade ; car le fait en lui-même, je le répète, me paraît insignifiant. M. l'abbé Amodru dit que c'est là le fait capital, et après lui MM. Cuénot, Rougé, Arnoux et deux et cætera l'affirment spontanément. Mon très humble avis est que M. l'abbé Amodru attribue à l'initiative de la résistance une importance qu'elle n'a pas. Il se produisit un fait capital qui, plus que tout autre, a protégé les otages et les a sauvés ; c'est qu'il fut impossible à François, à Ramain, à Picon, aux acolytes de Ferré, aux fédérés, de pouvoir ouvrir les grilles des sections, par la raison très simple que les clefs de service et les clefs de secours étaient entre les mains de Pinet, comme la clef et la double clef de la première porte de secours donnant, par l'escalier en colimaçon, accès aux autres portes de secours, étaient au pouvoir de Bourguignon. La porte de secours ne pouvait être ouverte malgré les otages, je le sais ; elle bat dans la section ; il suffisait donc d'une cale bien placée, ou d'une planche arc-boutée contre la muraille, pour l'empêcher de jouer sur ses gonds. Mais quant à la grille qui ferme la section sur la galerie où aboutit le grand escalier, il n'en est point ainsi. Cette grille est fortement scellée dans la muraille ; elle encadre une baie dont la porte, à un seul battant, n'est autre qu'une grille qui s'ouvre en dehors — hauteur 1m,96, largeur 0m,96 — ; toute barricade destinée à maintenir close cette grille d'entrée doit être établie dans la galerie et non pas dans la section. En un mot, lorsque l'on veut pénétrer dans la section, il faut tirer la grille et non pas la pousser. C'est à cette disposition, élémentaire dans une prison, et qui, le 11 décembre 1877, était encore ignorée par M. l'abbé Amodru lui-même, c'est à cette disposition que les révoltés de la Grande-Roquette ont dû leur salut. La barricade, il est vrai, les protégeait ; mais la grille fermée défendait la barricade et ôtait aux assaillants toute possibilité de la démolir et même de l'atteindre. Sans cela, il n'était ni très difficile, ni très périlleux d'enlever les matelas[17]. Tout soldat sait que lorsque l'assiégeant travaille à pic du mur de l'assiégé, il est à l'abri des projectiles de celui-ci. Pendant que les fédérés auraient essayé de détruire la barricade, un simple peloton, armé de fusils, placé dans la galerie, eût eu raison des otages qui se seraient aventurés au sommet de l'obstacle improvisé par eux. Les otages étaient énergiquement décidés à se défendre, j'en suis persuadé ; ils étaient armés de briques, de lances en bois, de pieds de lit en fer, je ne l'ignore pas ; ils auraient contusionné et éborgné quelques fédérés, j'en suis convaincu ; mais ils eussent été dans l'impossibilité de résister à des hommes porteurs d'armes à feu et à répétition, si ceux-ci étaient parvenus à déplacer les matelas de la barricade élevée derrière la grille. Or les fédérés et les employés obéissant à François n'ont pu attaquer cette barricade, parce qu'ils n'ont pu ouvrir la grille, et ils n'ont pu ouvrir la grille, parce que les clefs de service et les clefs de secours étaient au pouvoir de Pinet, enfermé dans la troisième section. — C'est là le fait capital d'où résulte le salut des prisonniers, qui, sans cela, aurait pu être singulièrement compromis. Quant aux autres incidents de la révolte des otages de la Roquette, incidents qui ont été signalés devant les conseils de guerre par des témoins déposant sous la foi du serment, ils n'ont qu'une importance relative. J'admets que la version de M. l'abbé Amodru soit indiscutable, j'admets que Pinet ne soit entré dans la troisième section qu'après la construction des barricades, j'admets tout ce que l'on voudra, mais je n'en persiste pas moins à croire fermement que dans l'insurrection et le salut des otages une part considérable appartient au surveillant François Pinet, actuellement sous-brigadier à Mazas. — Je prie le lecteur de m'excuser, si je l'ai fatigué par cette longue et fastidieuse discussion ; elle est, du reste, à l'honneur des otages de la troisième section ; car elle prouve simplement que tout le monde, à l'heure du péril, a eu la ferme résolution d'être héroïque, et qu'aujourd'hui chacun se souvient de l'avoir été. Je donne ici l'état des services militaires de Pinet ; le lecteur jugera si l'homme qui sort de l'armée avec un tel certificat était capable de courage et d'initiative.
|