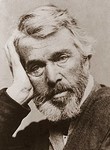HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
LA GUILLOTINE
LIVRE QUATRIÈME. — LA TERREUR.
I. — CHARLOTTE CORDAY.Dans les mois de juin et de juillet, mois des feuilles, on voit, dans plusieurs départements, se développer une multitude de feuilles appelées Proclamations, Résolutions, Journaux, de l'union pour résister à l'oppression. La ville de Caen, dans le Calvados, en particulier, voit sa feuille du Bulletin de Caen germer soudainement, et s'établir tout à coup comme journal, sous la direction de représentants girondins. C'est que parmi les Girondins proscrits, il y en a quelques-uns qui sont exaspérés. Quelques-uns, tels que Vergniaud, Valazé, Gensonné, aux arrêts dans leur domicile, attendent les événements avec une stoïque résignation. D'autres, tels que Brissot, Rabaut, prendront la fuite, se cacheront ; ce qui n'est pas encore difficile, car les barrières restent encore ouvertes pendant un jour ou deux. Mais, il y en a d'autres qui se jetteront dans le Calvados avec Buzot ; au qui se disperseront aux extrémités de la France, à Lyon, à Toulon, à Nantes et ailleurs, puis se donneront rendez-vous à Caen, pour réveiller avec la trompette de guerre les départements respectables et abattre la faction anarchique de la Montagne ; du moins pour ne pas céder sans combat. Nous en comptons une vingtaine et plus, dont les uns étaient en état d'arrestation, tandis que les autres n'y étaient pas encore : Buzot, Barbaroux, Louvet, Guadet, Pétion, qui ont quitté leurs domiciles et enfreint les arrêts ; Salles, Valady le pythagoricien ; Duchâtel, celui qui alla, en bonnet de nuit et enveloppé d'une couverture, voter pour la vie de Louis, qui ont échappé au péril et à la probabilité d'une arrestation. Ces personnages, un moment au nombre de vingt-sept, résident à l'Intendance ou hôtel départemental de la ville de Caen dans le Calvados, bien accueillis des autorités, bien venus et défrayés de tout, car ils n'ont pas un sou sur eux. Et le Bulletin de Caen parait avec les articles les plus encourageants. On y voit comment les départements de Bordeaux et de Lyon, ce département-ci, ce département-là se prononcent tour à tour ; soixante, on dit même soixante-neuf ou soixante-douze[1], départements respectables font également leur déclaration ou sont tout disposés à la faire. Et même Marseille, à ce qu'il parait, marchera sur Paris, s'il le faut. Oui, la ville de Marseille a dit qu'elle marcherait. Mais, d'un autre côté, la ville de Montélimar a dit : Point de passage Elle est même résolue à s'ensevelir plutôt sous les décombres de ses murs ; mais il n'en est point fait mention dans le Bulletin de Caen. Tels sont les articles excitants qu'on lit dans ce journal, accompagnés de sarcasmes chaleureux et éloquents, de tirades contre la Montagne, œuvres du député Salles ; cela rappelle, disent ses amis, les Provinciales de Pascal. Ce qui est plus important, c'est que ces Girondins ont un général en chef, un Wimpfen, jadis sous Dumouriez, de plus un général en second assez suspect, Puisaye, et d'autres, lesquels font tout leur possible pour lever des forces pour la guerre. Volontaires nationaux, vous tous qui avez le cœur honnête, rassemblez-vous ; accourez volontaires nationaux, amis de la liberté, de nos villes du Calvados, de l'Eure, de la Bretagne, de loin et de près, marchez sur Paris, et étouffez l'anarchie ! Ainsi il y a dans les premiers jours de juillet, à. Caen, un état-major et une armée, pérorant et en consultation, battant du tambour et faisant la parade ; un concile, un club de Carabots, anti-Jacobins amis de la liberté pour dénoncer l'atroce Marat. Avec tout cela et la publication des Bulletins, un représentant national a beaucoup d'affaires sur les bras. Caen est plein d'ardeur, et, comme on l'espère, il y a plus ou moins d'ardeur dans des soixante-douze départements qui se joignent à nous. Dans cette France enveloppée par des coalitions cimmériennes envahissantes, et déchirée à l'intérieur par la Vendée, telle est la conclusion où nous sommes arrivés, de renverser l'anarchie par la guerre civile ! Durum et durum, dit le proverbe, non faciunt murum. La Vendée est en feu, Santerre n'y peut rien faire : qu’il retourne chez lui brasser sa bière. Les bombes cimmériennes volent sur tout le Nord, le siège de Mayence est devenu célèbre ; — les amateurs du pittoresque — comme l'attestera Gœthe —, les gens propres de la campagne, vont s'y promener les dimanches pour voir l'artillerie jouer des deux côtés. Vous n'avez qu'à baisser la tête, lorsque le boulet passe en sifflant[2]. Condé se rend aux Autrichiens. Son Altesse royale d' York, pendant ces quelques semaines, canonne vigoureusement Valenciennes ; car, hélas ! notre camp fortifié de Framar a été emporté, le général Dampierre tué, le général Custine réprimandé, — et même il se dirige à présent vers Paris pour donner des explications. Il faut qu'à tout cela la Montagne et l'atroce Marat tiennent tête de leur mieux. Cette Convention, tout anarchique qu'elle est, publie des décrets, des débats, des explications, qui ne manquent pourtant pas de sévérité ; en envoie partout des commissaires, un ou deux à la fois, la branche d'olivier dans une main et l'épée dans l'autre. Des commissaires arrivent même à Caen, mais sans résultat. Le mathématicien Romme et Prieur de la Côte-d'Or, qui s'y risquent avec leur olivier et leur épée, sont jetés en prison ; là Romme restera sous clef pendant cinquante jours ; il méditera sur son nouveau calendrier, si bon lui semble. Les Barbares, la Vendée et la guerre civile ! Jamais une république une et indivisible ne fut plus bas. Au milieu de cette obscure fermentation de Caen et du monde, l'histoire remarque spécialement une chose sous le portique de la maison de l'Intendance, où les députés occupés vont et viennent, une demoiselle suivie d'un serviteur âgé fait un adieu grave et gracieux au député Barbaroux[3]. Elle a une figure normande magnifique ; elle est âgée de vingt-cinq ans, d'une contenance belle et calme ; son nom est Charlotte Corday : jadis elle s'appelait d'Armand, lorsque la noblesse existait encore. Barbaroux lui a donné un mot pour le député Duperret, — celui qui un jour, dans un moment d'effervescence, tira l'épée. Sans doute elle se rend à Paris pour quelque affaire ? Elle était républicaine avant la révolution, et ne manqua jamais d'énergie. La résolution, la détermination sont empreintes sur sa belle figure féminine. Par énergie elle entend le courage qui porte un homme à se sacrifier pour sa patrie. Que diriez-vous si cette belle et jeune Charlotte, sortant de sa retraite paisible, brillait tout à coup, comme un astre soudain et cruel, avec une splendeur à demi angélique, à demi diabolique, qui brillera un moment et qui sera dans un instant éteinte, qui restera dans les mémoires, tant elle était belle et accomplie, à travers de longs siècles ! — Quittant les coalitions cimmériennes du dehors et les vingt-cinq millions d'hommes qui fermentent sourdement au dedans, l'histoire tiendra ses yeux fixés sur cette belle apparition de Charlotte Corday, dira où va Charlotte, comment se termine sa courte existence si rayonnante, qui s'évanouit absorbée par la nuit. Avec la lettre d'introduction de Barbaroux et son léger bagage, nous voyons Charlotte s'établir, le mardi g juillet, dans la diligence de Caen pour Paris. Personne ne lui dit adieu, ne lui souhaite un heureux voyage ; son père trouvera les quelques lignes qu'elle a laissées après elle, par lesquelles elle lui dit qu'elle est partie pour l'Angleterre, qu'il doit lui pardonner et l'oublier. La lourde diligence est pleine ; pendant toute la route, des conversations endormantes de politique, des éloges de la Montagne dans lesquels elle n'intervient pas, et cela dure deux nuits et un jour. Le jeudi, un peu avant midi, nous sommes au pont de Neuilly ; voici Paris avec ses milliers de toits sombres : le but de ton voyage ! Arrivée à l'hôtel de la Providence, rue des Vieux-Augustins, Charlotte demande une chambre, se hâte d'aller se coucher, dort tonte l'après-midi et toute la nuit, jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, elle présente sa lettre à Duperret. Cette lettre parle de certains papiers de famille qui sont entre les mains du ministre de l'intérieur, et dont une religieuse de Caen, une ancienne amie de couvent de Charlotte, a besoin et que Duperret doit l'aider à obtenir : tel était le motif du voyage de Charlotte t Elle termina cette affaire dans la journée du vendredi, et pourtant ne parla pas de repartir. Elle a vu et étudié en secret diverses choses. Elle a vu la Convention en chair et en os, et ce qu'était la Montagne. Elle n'a pu voir le visage de Marat ; il est malade et retenu chez lui. Le samedi, vers les huit heures du matin, elle achète au Palais-Royal un couteau dans sa gaine ; puis elle va tout droit à la place des Victoires, prend un fiacre, et se fait conduire rue de l'Ecole-de-Médecine, n° 44. C'est la résidence du citoyen Marat ! — Le citoyen Marat est malade, on ne peut le voir, ce qui parait la désappointer beau coup. C'est donc Marat qu'elle a besoin de voir ? Malheureuse et belle Charlotte, malheureux et sale Marat ! De Caen, dans la partie la plus éloignée de l'Ouest, de Neuchâtel aux extrémités de l'Est, tous deux se sont rapprochés l'un de l'autre ; leur destinée les prépare à une bien étrange entrevue. Charlotte, de retour à. son hôtel, envoie un billet à Marat, lui disant qu'elle est de Caen, siège de la rébellion, qu'elle désire ardemment le voir et le mettra à même de rendre un grand service à la France. Pas de réponse. Charlotte écrit de nouveau, avec plus d'instances encore ; elle part en voiture vers les sept heures du soir, portant elle-même la lettre. Les ouvriers, fatigués, ont fini leur semaine ; le vaste Paris s'agite et bouillonne, suivant son habitude, d'un mouvement confus. Cette belle personne n'a pas d'indécision, elle va droit devant elle, à son but. C'est une lumineuse soirée de juillet, disons-nous, le 13 du mois, la veille du jour de la Bastille ; — de ce jour où M. Marat, il y a quatre ans, dans la foule du Pont-Neuf, requit impérieusement les hussards de Besenval, qui avaient alors des dispositions si amicales de mettre pied à terre et de livrer leurs armes, ce qui le fit remarquer parmi les citoyens patriotes. Il y a quatre ans, quel chemin il a fait depuis ! — et le voilà aujourd'hui à sept heures et demie du soir plongé dans sa baignoire ; souffrant cruellement, — malade d'une fièvre de révolution, ou de quelque autre maladie que cette histoire fera mieux de ne pas nommer. Il est bien malade et épuisé, le pauvre homme, ayant en tout vingt-trois sous d'argent comptant en papier-monnaie, et sa baignoire, un fort tabouret à trois pieds pour écrire dans le bain ; et une sale blanchisseuse, si l'on peut rappeler ainsi. Tel est son établissement civique dans la rue de l'École-de-Médecine ; c'est là que sa route l'a conduit ; non au règne de la fraternité et de la félicité parfaite, mais assurément sur le chemin qui y mène ? — Écoutez, on frappe encore ! la voix musicale d'une femme qui ne veut pas être renvoyée c'est la citoyenne qui doit rendre service à la France. De l'intérieur, Marat, la reconnaissant, s'écrie Laissez-la entrer. Charlotte est introduite. Citoyen Marat, je suis de Caen, le siège de la rébellion, et désire m'entretenir avec vous. — Asseyez-vous, mon enfant. Que font à présent les traîtres à Caen ? quels députés sont à Caen ? — Charlotte en nomme quelques-uns. Dans une quinzaine leurs têtes tomberont, croasse le furieux ami du peuple, en prenant ses tablettes pour y écrire. Barbaroux, Pétion, écrit-il en montrant son bras maigre et nu et en se tournant de côté dans son bain ; Pétion et Louvet... et — Charlotte a tiré le couteau de la gaine, et en frappe d'une main ferme le cœur de l'écrivain. À moi, chère amie ! Frappé à mort, il ne peut en dire ni crier davantage. La blanchisseuse secourable se précipite dans la chambre, il n'y a plus d'ami du peuple, ni d'ami de la blanchisseuse ; mais son existence s'échappe avec un gémissement, pleine d'indignation et fuit vers les ombres souterraines[4]. Telle est la fin de Marat l'ami du peuple ; le stylite solitaire a été tout à coup renversé et jeté par terre du haut de son pilier. — Où va-t-il ? Seul celui qui le créa le sait. Le Paris patriote peut faire retentir tant qu'il voudra sa tristesse et ses gémissements, répétés parla France patriote et la Convention. Chabot, pâle de terreur, déclarant qu'ils vont tous être assassinés, peut décréter pour lui les honneurs du Panthéon, des funérailles publiques, et mettre ses cendres à. la place dé celles de Mirabeau ; et les sociétés des Jacobins, dans des discours lamentables, récapitulant ses qualités, peuvent le comparer à celui qu'ils croient honorer en l'appelant le bon Sans-culotte, — et que nous ne nommons pas ici[5] ; on peut même élever une chapelle sur la place du Carrousel pour y placer l'urne qui contiendra son cour, donner aux enfants nouveau-nés le nom de Marat ; les colporteurs du lac de Côme peuvent user des montagnes de plâtre, pour reproduire son buste hideux, et David peindre son portrait et la scène de sa mort, et d'autres imaginer toutes les apothéoses que le génie humain peut inventer en pareilles circonstances : Marat, malgré tout, ne verra plus la lumière du soleil. Il est un seul fait que nous ayons.lu avec une véritable sympathie dans l'ancien Moniteur, c'est l'arrivée du frère de Marat, qui vient de Neufchâtel pour demander à la Convention, qu'on lui remette le mousquet de feu Jean-Paul Marat[6]. Car Marat aussi avait un frère et des affections naturelles. Il avait ét6, comme nous, enveloppé dans des langes ; il avait dormi paisiblement dans un berceau, comme nous. Ô vous, fils des hommes ! — Une de ses sœurs, dit-on, vit encore aujourd'hui à Paris. Quant à Charlotte Corday, son œuvre est accomplie, le prix en est proche et certain. La chère amie et les voisins courent à elle. Elle renverse divers meubles, se retranche derrière, jusqu'à ce que les gendarmes arrivent ; elle se livre alors sans résistance, et se dirige paisiblement vers la prison de l'Abbaye. Elle seule est tranquille. Paris entier, autour d'elle, bruit et s'agite d'étonnement, de rage ou d'admiration. Duperret est arrêté à cause d'elle, ses papiers mis sous scellés, — ce qui peut avoir des conséquences. Il en est de même de Fauchet, bien que Fauchet n'eût pas même entendu parler d'elle, Charlotte, confrontée avec ces deux députés, loue la fermeté grave de Duperret, censure la lâcheté de Fauchet. Le mercredi matin, le palais de justice et le tribunal révolutionnaire peuvent voir sa figure, belle et calme ; elle appelle ce jour le quatrième de la préparation de la paix. A sa vue, une étrange rumeur circule dans la salle, vous ne pouvez dire de quelle sorte. Tinville a l'acte d'accusation et les pièces à l'appui ; le coutelier du Palais-Royal certifiera qu'il lui a vendu le couteau dans sa gaine. Tous ces détails sont inutiles, interrompt Charlotte, voilà le fait, j'ai tué Marat. — Sur l'instigation de qui ? — De personne ! — Qui vous y a poussée ? — Ses crimes. J'ai tué un homme, ajouta-t-elle en élevant extrêmement la voix, j'ai tué un homme pour en sauver cent mille ; un scélérat, pour sauver des innocents ; une bête sauvage, pour donner la tranquillité à mon pays. J'étais républicaine avant fa révolution ; je n'ai jamais manqué d'énergie. Il n'y avait, après cela, plus rien à dire. Le public la contemple avec étonnement ; les peintres esquissent son portrait à la hâte : Charlotte n'en est pas offensée ; les hommes de loi procèdent à leurs formalités. Elle est condamnée à mort comme meurtrière, Elle adresse des remercîments à son défenseur, en termes gracieux et choisis. Elle remercie également le prêtre qu'on lui a envoyé, mais elle n'a besoin ni de confession, ni de communion, et refuse son assistance. En conséquence, le même soir, à sept heures et demie environ, de la grille de la Conciergerie part le chariot fatal il traverse la ville qui est toute sur pied. Sur ce char est une charmante créature couverte du vêtement rouge foncé des meurtriers ; elle, si belle, si sereine, si jeune encore, elle va à la mort, — seule en ce monde, Beaucoup se découvrent et saluent avec respect quel est le cœur qui ne serait pas ému ? D'autres grognent et hurlent, Adam Lux de Montz déclare qu'elle est plus grande que Brutus, qu'il serait beau de mourir avec elle. Ce jeune homme semble avoir perdu la tête. Sur la place de la Révolution, la figure de Charlotte porte encore le même sourire tranquille. Les bourreaux se mettent en mesure de lui lier les pieds, elle résiste, pensant que c'était une insulte ; sur un mot d'explication, elle se soumet en s'excusant gaiement. Au dernier acte, tout étant prêt, on lui ôte du cou son fichu ; une rougeur virginale de honte couvre toute cette belle figure et ce cou charmant. Les joues en étaient encore teintes, lorsque le bourreau enleva la tête, séparée du tronc, pour la montrer au peuple. Il est vrai, dit Forster[7], qu'il la souffleta grossièrement ; je l'ai vu, de mes propres yeux vu. La police le mit en prison pour ce fait. Ainsi furent en contact et périrent l'une et l'autre la plus belle et la plus sale des créatures. Jean-Paul Marat et Marie-Anne-Charlotte Corday, tous deux soudainement ont disparu. Jour de préparation de la paix. Hélas comment la paix serait-elle possible, ou en voie de préparation, quand, par exemple, des cœurs ardents de vierges, du fond de leurs couvents, rêvent, non au paradis d'amour, et à la lumière de la vie, mais au sacrifice de Codrus, et à une mort noblement méritée ? Vingt-cinq millions de cœurs partagent ces dispositions, voilà l'anarchie : comment la paix pourrait-elle en sortir ? La mort de Marat, aiguisant les animosités dix fois plus encore, sera pire que son existence. Ô vous, infortuné couple qui vous êtes éteints mutuellement, la Belle et le Repoussant, dormez profondément, —- dans le sein de la mère qui vous porta tous les deux. Telle est l'histoire de Charlotte Corday, créature entière, complète ; ange et démon, elle parut comme une étoile Adam Lux retourne chez lui à demi fou, pour écrire son apothéose, et la livrer à la publication et à l'impression, pour proposer qu'on lui élève une statue avec cette inscription : Plus grande que Brutus. Ses amis lui en représentent le danger ; Lux n'en tient aucun compte, il pense qu'il serait beau de mourir avec elle. II. — GUERRE CIVILE.Presque en même temps une autre guillotine fonctionne sur une autre victime : Charlotte pour les Girondins meurt à Paris aujourd'hui ; demain Chalier par les Girondins mourra à Lyon. Après avoir fait rouler les canons dans les rues de cette cité, on en est venu à le tirer, à se battre avec furie. Nièvre Chol et les Girondins triomphent ; derrière eux il y a, comme partout, une faction royaliste attendant que son tour vienne. Il y a Lien des troubles à Lyon ; et le parti dominant poursuit hardiment sa carrière ! Voyez en effet, tout le Midi est soulevé ; les Jacobins y sont incarcérés, on s'arme pour les Girondins ; nous avons donc un congrès de Lyon — et aussi un tribunal révolutionnaire de Lyon, et les anarchistes trembleront. Ainsi Chalier a été reconnu coupable de jacobinisme, de meurtre prémédité, pour avoir présenté une adresse, un poignard nu à la main, le 6 février dernier et le lendemain lui aussi fait ses derniers pas dans les rues de Lyon, côté d'un ecclésiastique avec lequel il semble s'entretenir avec chaleur. Le couteau de la guillotine est tout près qui brille. Il a pu verser des larmes sur ses vieux ans, cet homme, et tomber à genoux sur le pavé, bénissant le ciel à la vue des programmes de la fédération, et de choses semblables ; puis il est allé en pèlerinage à Paris, pour s'y prosterner devant Marat et la Montagne ; aujourd'hui Marat et lui ont disparu. — Nous avions dit qu'il ne finirait pas bien. Le jacobinisme gémit tout bas à Lyon, tout haut il n'oserait. Chalier, lorsque le tribunal prononça la sentence, fit cette réponse : Ma mort coûtera cher à cette cité. La ville de Montélimar n'est point ensevelie sous ses ruines ; Marseille est maintenant en marche par ordre du congrès de Lyon ; on incarcère les patriotes ; les royalistes mêmes montrent maintenant leurs visages. Contre cette réaction le général Canaux lutte, bien qu'avec peu de forces, et avec lui un officier d'artillerie du nom de — Napoléon Buonaparte. Ce Napoléon fera voir, en définitive, que les Marseillais n'ont aucune chance pour eux, non-seulement combat, mais écrit ; il publie son Souper de Beaucaire, dialogue devenu curieux. Cités malheureuses avec leurs actions et. leurs réactions ! Violence qui sera payée par la violence en proportion géométrique ; le royalisme et l'anarchisme luttent l'un contre l'autre : — quant au total de ces séries géométriques, quel homme pourra le faire ? La barre de fer n'a pas encore flotté dans le port de Marseille mais on y a vu flotter le corps de Rebecqui, qui s’est noyé lui-même. L'ardent Rebecqui, voyant combien la confusion était profonde et comme la respectabilité s'infectait de royalisme, sentit qu'il n'y avait pas d'autre refuge pour un républicain que la mort. Rebecqui disparut ; nul ne savait où il était, lorsqu'un matin on vit la demeure abandonnée par son hôte, son corps sans vie monter du fond de l'eau et flotter sur les vagues salées[8]. Rebecqui s'était retiré pour toujours. — Toulon jette également en prison les patriotes, envoie des députés au congrès, intrigue, en cas de besoin, avec les royalistes et les Anglais. Montpellier, Bordeaux, Nantes, la France entière qui n'est pas sous la griffe de l'Autriche et des Cimmériens, semble se précipiter dans la folie, dans le suicide mortel. La Montagne travaille semblable à un volcan sur le sol volcanique. Les comités conventionnels, ceux de sûreté, de salut, sont occupés jour nuit ; les commissaires de la Convention volent sur toutes les routes, portant tout à la fois la branche d'olivier et l'épée, et peut-être aujourd'hui l'épée seulement. Chaumette et les municipaux viennent chaque jour aux Tuileries, demandant une constitution ; il y a déjà quelques semaines qu'on a résolu à l'Hôtel de ville qu'une députation irait tous les jours demander, jusqu'à ce qu'on l'ait obtenue, une constitution[9] autour de laquelle la France qui se suicide puisse se grouper et se pacifier ; désir ardent, indomptable. Voilà le fruit que vos Girondins anti-anarchistes ont recueilli de cette levée d'armes dans le Calvados ! Ce fruit, on peut le dire, ce fruit seulement, et nul autre. Car vraiment avant que la tête de Charlotte ou celle de Chalier fat tombée, la guerre du Calvados s'était, pour ainsi dire, évanouie, comme un rêve, dans un cri perçant ! Avec soixante-douze départements de notre côté, on pouvait espérer de meilleurs résultats. Mais ce qui perd ces respectabilités, c'est qu'elles veulent voter et ne veillent pas combattre. La possession suivant la loi compte toujours pour neuf points ; mais dans les procès de cette sorte, on peut, le dire, elle en a quatre-vingt-dix-neuf. Les mortels font ce qu'ils ont l'habitude de faire, et ont une irrésolution, une inertie prodigieuses ; ils obéissent à celui qui possède les symboles qui commandent l'obéissance. Considérez ce que, dans la société moderne, signifie ce seul fait : La métropole est avec nos ennemis ! La métropole, la cité mère, justement dénommée ainsi. Tout le reste n'est autre chose que ses enfants, ses nourrissons. Cette diligence qui en sort avec ses valises et ses bagages, elle porte partout le mouvement et la vie. Si vous l'arrêtez, que de choses vous arrêtez en même temps ! Paris est l'âme de tout. — Le général Wimpfen, examinant la situation en homme pratique, ne voit autre chose à. faire que de revenir au royalisme, de se mettre en communication avec Pitt ! Il lance brusquement, à cet effet, de sombres insinuations, dont nous tressaillons, frappés d'horreur, nous, Girondins. Il présente, comme son second dans le commandement, un certain ci-devant comte Puisaye, tout à fait inconnu à. Louvet, et qui lui est fortement suspect. Peu de guerres aussi bien furent jamais entreprises avec des dispositions plus insuffisantes que cette guerre du Calvados. Celui qui est curieux de connaître de telles choses peut en lire les détails dans les mémoires du ci-devant Puisaye, cet homme et ce royaliste infatigable. Ils y verront comment nos forces nationales girondines, marchant avec force musique, se mirent en campagne près du vieux château de Brécourt, dans un pays boisé près de Vernon, pour y rencontrer les forces nationales de la Montagne, qui venaient de Paris. Comment, le 15 juillet, dans l'après-midi, les deux troupes se rencontrèrent, et poussèrent des deux côtés des cris perçants, et prirent toutes deux la fuite sans perte. Comment puisage ensuite, — car les troupes de la Montagne s'enfuirent les premières, et nous nous crûmes les vainqueurs, — sortit de son lit bien chaud dans le château de Brécourt, et dut galoper sans bottes, nos nationaux, dans la nuit, ayant été surpris inopinément par un sauve-qui-peut. Bref, la guerre du Calvados fit long leu, et la seule question fut bientôt de savoir où l'on se sauverait, dans quel trou on se cacherait[10]. Les volontaires nationaux rentrent chez eux plus vivement qu'ils n'en sont sortis. Les soixante-douze départements respectables, dit Meillan tournèrent tous et nous abandonnèrent, et cela dans l'espace de vingt-quatre heures ! Malheureux ceux qui, comme Lyon, par exemple, se sont avancés trop loin pour reculer ! Un matin, nous voyons placardé sur notre hôtel de l'Intendance, le décret de la Convention qui nous met hors la loi, affiché par nos magistrats de Caen, — l'avis est bien clair, nous aussi il nous faut disparaître. Vraiment disparaître ; mais où ? Gorsas a des amis à Rennes, il s'y cachera, — malheureusement il ne restera pas caché ! Guadet, Lanjuinais, courent les chemins pour aller à Bordeaux ! Bordeaux ! tel est le cri général, celui du courage comme du désespoir. Quelques drapeaux de la respectabilité y flottent encore, ou l'on croit qu'ils y flottent. Allons-y donc : chacun comme il pourra. Onze de ces infortunés députés, au nombre desquels nous devons compter comme douzième l'ami Riouffe, l'homme de lettres, font une chose originale : ils prennent l'uniforme de volontaires nationaux, et se retirent dans le Midi avec le bataillon Breton, comme simples soldats dans ce corps. Ces braves Bretons nous sont restés plus fidèles que tous les autres. Néanmoins, au bout d'un jour ou deux, ils deviennent également douteux, divisés entre eux ; nous devons nous en séparer et avec une demi-douzaine de gens pour escorte ou guides, battre nous-mêmes en retraite, — détachement isolé, en marche à travers les vastes régions de l'Ouest#[11]. III. — RETRAITE DES ONZE.C'est une des plus belles retraites dont l'histoire fasse mention que celle de ces onze. Une poignée de législateurs au désespoir, se retirant, sans s'arrêter, le fusil sur l'épaule et parfaitement munis de cartouches, dans le jaune automne ; il y .a de longues centaines de milles entre eux et Bordeaux ; tout le pays est hostile, soupçonne la vérité, frémit et bourdonne de tous côtés, de plus en plus. Louvet a conservé leur itinéraire, travail qui vaut tout ce qu'il a jamais écrit. Ô vertueux Pétion ! dont la tête est blanchie avant le temps ! ô brave et jeune Barbaroux ! est-ce là que vous en êtes arrivés ? marches pénibles, souliers déchirés, bourse légère ; — partout un océan de périls ! Des comités révolutionnaires sont établis dans chaque ville principale, avec des dispositions jacobines tous nos amis sont épouvantés, notre cause est une cause perdue. Par malheur, dans le bourg de Moncontour, c'est jour de marché ; dans le public badaudant, la marche de ce détachement solitaire fait naître des soupçons, il nous faut de l'énergie, de l'activité et de la chance, pour nous en tirer. Hâtez le pas, pèlerins fatigués ! Le pays se lève, le bruit se répand de jour en jour de la retraite mystérieuse des douze solitaires ; de jour en jour un flot plus grand de poursuites acharnées s'amoncelle, jusqu'à ce que tout l'Ouest soit agité. Cussy est tourmenté de la goutte, Buzot est trop gras pour pouvoir marcher. Riouffe, couvert d'ampoules saignantes, ne marche que sur la pointe des pieds. Barbaroux, par suite d'une entorse, va clopin-clopant, pourtant toujours gai, plein d'espoir et de courage. Le léger Louvet a les regards, mais non le cœur d'un lièvre. La sérénit6 du vertueux Pétion ne s'altéra qu'une fois[12]. Ils reposent dans des greniers sur la paille, dans les bois sur la fougère ; la plus grossière paillasse dans l'appartement d'un ami secret est un luxe. Ils sont empoignés dans le silence de la nuit par les maires jacobins et au bruit du tambour ; ils s'en tirent de leur mieux par une contenance ferme, par le bruit du mousquet et un esprit prompt. Quant à se rendre à Bordeaux en traversant la farouche Vendée, et les longues distances qui restent, ce serait folie d'y penser ; mais peut-être vous pouvez atteindre Quimper sur les bords de la mer, ét là vous embarquer. Vite, plus vite que jamais ! avant la fin de mars, le pays devient tellement ardent, qu'on juge à propos de marcher toute la nuit. C'est ce qu'ils font, sous la voûte paisible des nuits ils cheminent, et pourtant, voyez, la renommée les a devancés. Dans le pauvre village de Carhaix — avec ses cabanes couvertes de chaume, et ses fondrières tourbeuses connues depuis longtemps du voyageur —, on est étonné de voir encore de la lumière, les habitants ne dorment pas, et les chandelles brillent dans ce recoin de la planète terrestre. Comme nous en traversions rapidement la seule et misérable rue, une voix fit entendre ces mots : Les voilà gui passent[13]. Plus vite encore, ô vous les Douze estropiés et condamnés : hâtez-vous, avant qu'on ait pris les armes ; gagnez les forêts de Quimper avant le jour, et restez-y tapis. Les douze condamnés le font, bien qu'avec difficulté, tout en s'égarant sur les chemins, et au milieu des dangers et des erreurs de la nuit. Dans Quimper il y a des amis girondins, qui peut-être logeront les malheureux privés de demeure, jusqu'à ce qu'un navire bordelais lève l'ancre. Épuisés par la marche, le cœur découragé, dans l'agonie de l'incertitude, jusqu'à ce que l'amitié de Quimper les ait ranimés, ils gisent là, tapis sous l'épais et humide bocage, redoutant le visage de l'homme. Accordons quelque pitié au courage, au malheur ! Législateurs infortunés, ah ! quand vous faisiez vos paquets, il y a quelque vingtaine de mois, et que vous montiez dans telle ou telle voiture de cuir pour devenir les pères consorts de la France régénérée, et recueillir des lauriers immortels, — pensiez-vous que votre voyage vous conduirait ici ? Les Samaritains de Quimper les trouvent accroupis, leur donnent aide et soulagement, les cachent dans des lieux sûrs. De là. qu'ils se dispersent peu à peu, ou bien qu'ils y vivent tranquilles s'ils peuvent, et écrivent des mémoires, jusqu'à ce qu'un bâtiment bordelais fasse voile. Et ainsi tout est dissipé dans le Calvados. Romme est sorti de prison, il médite sur son calendrier ; les chefs des factions sont incarcérés à sa place. A Caen, la famille Corday porte le deuil en silence ; la maison de Buzot est un amas de poussière et de démolitions ; et au milieu des décombres est planté un poteau avec cette inscription : Ici demeura le traître Buzot qui conspira contre la république. Buzot et les autres députés absents sont hors la loi ainsi que nous l'avons vu ; leur vie appartient à quiconque pourra les découvrir. Le plus mauvais lot est pour les députés qui sont à Paris. L'arrêt à. domicile menace de devenir l'emprisonnement au Luxembourg ; pour finir où ? Quel est cet être maigre, au teint pâle, se dirigeant vers la Suisse, comme négociant de Neufchâtel, et que l'on arrête à Moulins ? Il est suspect aux yeux du comité révolutionnaire. En approfondissant la matière, il est bien évidemment le député Brissot ! Retourne à tes arrêts, pauvre Brissot ; ou même dans une étroite prison, où le destin te fera suivre par bien d'autres. Flahaut, s'étant construit une cloison dans la maison d'un ami, vit invisible dans l'obscurité entre deux murs. Il finira cet arrêt par la prison et le tribunal révolutionnaire. N'oublions pas non plus Duperret, et les scellés apposés sur ses papiers à cause de Charlotte. Il y a là une pièce qui peut causer bien des malheurs ; une protestation secrète et solennelle contre ce suprema dies du 2 juin ! Cette secrète protestation, notre pauvre Duperret rédigée, la même semaine, dans le langage le plus explicite, attendant le moment de la rendre publique ; à cette secrète protestation se trouve apposée, en caractères lisibles, sa signature, ainsi que celle d'autres honorables députés, non pas en petit nombre. Et si les scellés sont une fois levés, la Montagne sera alors triomphante Tous ceux qui ont protesté, Mercier, Bailleul, soixante-treize autres qui restent encore de ces respectables Girondins dans la Convention, doivent trembler d'y penser — voilà ce qu'on recueille quand on fomente la guerre civile. Nous trouvons aussi que dans ces derniers jours de juillet, le fameux siée de Mayence est terminé ; la garnison en sort avec les honneurs de la guerre, à la condition de ne pas agir contre la coalition pendant une année. Lei amateurs du pittoresque, et Gœthe, sur la chaussée de Mayence, ont regardé avec un intérêt naturel la procession qui sort avec pompe. Escortée par la cavalerie prussienne, arrive d'abord la garnison française. Rien ne peut paraître plus étrange que cette dernière : une colonne de Marseillais, légers, basanés, bigarrés, couverts de vêtements rapiécés, arrive en trottant ; — comme si le roi Edwin avait entrouvert la montagne des Nains et lancé ses agiles bataillons ; après suivaient les troupes régulières, l'air sérieux et sombre, mais non découragé, ni confus. Mais le spectacle le plus remarquable qui frappa tout le monde, fut celui des chasseurs sortant à cheval. Ils s'avancèrent en silence jusqu'à l'endroit où nous étions, et alors leur mu-sique fit entendre la Marseillaise. Ce Te Deum révolutionnaire a en lui-même quelque chose de lugubre et de prophétique, même quand il est joué avec vivacité ; mais dans ce moment ils lui donnèrent un mouvement lent en rapport avec la, lenteur de leur marche : c'était un spectacle imposant et terrible, de voir ces cavaliers, grands, maigres, d'un Age déjà mûr, s'avancer avec une mine conforme à la musique. Séparément, vous pouviez trouver chez chacun d'eux de la ressemblance avec Don Quichotte ; en masse, ils avaient une grande dignité. Mais alors une petite troupe se fit remarquer, celle des commissaires ou représentants. Merlin de Thionville, en uniforme de hussard, remarquable par une le physionomie et une barbe étranges, avait à sa gauche un autre personnage dans le même costume ; la foule poussait de furieuses acclamations à la vue de ce dernier, bourgeois de la ville, Jacobin en réputation et clubiste, et s'agitait pour le saisir. Merlin tire la bride de son cheval, parle de sa dignité de représentant français, de la vengeance qui punirait toute injure qui lui serait faite ; il les engage tous à se modérer, car ce n'est pas la dernière fois qu'on le voit ici[14]. Ainsi s'avance Merlin, à cheval, menaçant dans la défaite. Mais à présent qui arrêtera cette armée de Prussiens, qui se jettent sur le Nord-Est découvert ? Heureusement que les lignes fortifiées de Weissembourg et les passages impraticables des montagnes des Vosges l'arrêtent dans l'Alsace française et l'empêchent de pénétrer au cœur de la patrie ! De plus, précisément dans les mêmes jours, le siège de Valenciennes est terminé dans le Nord-Ouest ; tombée sous la grêle rouge d'York ! Condé était tombé quelque quinzaine de Jours auparavant. La coalition cimmérienne nous serre de près. Ce qui semble encore très-remarquable, c'est que dans ces villes françaises prises, ne flotte pas la royale fleur de lis, au nom du nouveau Louis, le prétendant, niais bien le drapeau autrichien ; comme si c'était l'intention de l'Autriche d'en faire son profit personnel. Peut-être le général Custine, toujours à Paris, pourra-t-il donner quelques explications au sujet de la chute de ces places fortes ? La société-mère, de la tribune et de la galerie, crie bien haut qu'il doit le faire ; — elle remarque cependant avec un sentiment d'amertume que les messieurs du Palais-Royal poussent des vivat pour ce général. La société-mère, à présent nettoyée par des examens ou épurations successives de toute teinte de girondinisme, est devenue une puissante autorité ; ce corps est comme l'écuyer, le second de la Convention nationale elle- même épurée. Les débats des Jacobins sont rapportés dans le Moniteur, comme les débats parlementaires. IV. — Ô NATURE !Mais en regardant plus particulièrement la ville de Paris, que se passe-t-il le 10 août ? L'an I de la liberté en vieux style, an 1793 que voit l'histoire ? Dieu soit loué, c'est une nouvelle fête des Piques ! C'est que la députation journalière de Chaumette produit son résultat, une constitution. Ce fut une des plus promptes constitutions qu'on ait jamais faites faite, dit-on, en huit jours, par Hérault de Séchelles et autres, probablement constitution pratique, capable de marcher ; — sur ce point, néanmoins, nous ne pouvons guère, et pour cause, nous former un jugement. Pratique ou non, les quarante-quatre mille communes de la France, avec des majorités écrasantes, se hâtèrent de l'accepter, heureuses d'avoir une constitution quelle qu'elle fût. Les députés des départements sont arrivés, les plus vénérables républicains de chaque département, chargés du solennel message d'acceptation, et maintenant il ne reste plus qu'à proclamer notre nouvelle constitution, et à la faire jurer dans la féte des Piques. Les députés des départements, disons-nous, sont arrivés depuis longtemps. Chaumette, très-inquiet à leur égard, craint que les messieurs Girondins, les agioteurs, ou que même les filles de joie du parti girondin, ne les corrompent. Le 10 août, anniversaire immortel, presque plus grand que l'anniversaire de la Bastille, telle est la date. Le peintre David n'est pas resté oisif : grâce à David et au génie français, il parera sous le soleil, ce jour-là, une fantasmagorie th6a.trale sans exemple — dont l'histoire, fort occupée de fantasmagories réelles, ne parlera que peu. Il est une chose que l'histoire peut noter avec satisfaction : sur les ruines de la Bastille, est une statue de la Nature, gigantesque, des deux mamelles de laquelle jaillit l'eau. Ceci n'est point une fiction, mais bien un fait palpable et visible. Elle lance des jets d'eau, la grande Nature, avant le lever du jour. Mais quand le soleil rougit l'est, il arrive d'innombrables multitudes en ordre et eu désordre : arrivent les députés provinciaux, arrivent la société-mère et ses filles ; arrive la Convention nationale conduite par le beau Hérault, une musique douce soupire des notes qui expriment l'attente. Puis, dès que le puissant soleil lance ses premiers feux, colore les montagnes et le haut des cheminées de ses rayons dorés, Hérault est aux pieds de la grande Nature — elle est tout simplement de plâtre de Paris — ; Hérault prend dans une soucoupe de fer l'eau provenant des mamelles sacrées, en boit, tout en prononçant une éloquente prière païenne qui commence : Ô Nature ! Et tous les députés des départements boivent, chacun poussant les prières et les inspirations prophétiques qui lui viennent à l'esprit, au milieu des soupirs de la musique qui deviennent des orages, du rugissement de l'artillerie et des voix humaines, ce qui termine fort bien le premier acte de cette solennité. Il y a ensuite des processions sur les boulevards : les députés et les autorités sont attachés ensemble par un long ruban tricolore ; les membres généraux du souverain, c'est-à.-dire la foule, marchent pêle-mêle, armés de piques, de marteaux, d'outils et des emblèmes de leurs professions ; nous remarquons entre autres une charrue, et les vieillards Philémon et Baucis assis dessus, traînés par leurs descendants. Une multitude de voix harmonieuses et discordantes remplissent l’air. Il y a un grand nombre d'arcs de triomphe, et au pied du premier nous apercevons, — qu'attendez-vous ? — les héroïnes de l'insurrection des femmes. Les fortes dames des halles sont là — Théroigne est trop malade pour s'y trouver —, avec des branches de chue, des ornements tricolores, solidement assises sur leurs canons. Le beau Hérault, faisant une pause d'admiration devant elles, leur adresse des paroles éloquentes et flatteuses ; sur quoi elles se lèvent et suivent la marche. Et maintenant remarquez, sur la place de la Révolution, quelle peut être cette autre auguste statue enveloppée d'un voile — que nous enlevons rapidement au moyen de poulies et de cordes ? La statue de la Liberté ! Elle aussi est de plâtre, niais elle espère se changer en métal ; elle est placée à l'endroit où se dressait autrefois le tyran Louis XV. Trois mille oiseaux sont lancés et partent dans l'univers entier, ayant autour du cou des écriteaux portant ces mots : Nous sommes libres, imitez-nous. Un holocauste de momeries royalistes et des défroques de ci-devant qu'on a pu réunir est livré aux flammes ; l'éloquence pontificale s'exprime par la bouche du beau Hérault, et des oraisons païennes sont prononcées. Et maintenant avançons, traversons la rivière. Nous trouvons encore une énorme sculpture, une immense montagne de plâtre : c'est le peuple-Hercule tenant sa massue victorieuse levée ; le dragon du fédéralisme girondin dresse ses cent têtes au-dessus d'un marais fétide. — Nouvel accès d'éloquence de Hérault. Nous ne parlons pas du Champ de Mars et de l'autel de la patrie ; de l'urne des défenseurs tués, du niveau des charpentiers de la loi ; Il y a de telles clameurs, tant de gestes et de péroraisons, que les lèvres de Hérault doivent devenir blanches et sa langue se clouer à son palais[15]. Vers les six heures, alors que le président harassé, que le patriotisme parisien s'asseyent en masse pour prendre un repas social tel quel, alors avec un pot écumant, ou un verre plein d'un liquide brillant, on inaugure cette ère nouvelle et très-nouvelle. Au fait, le nouveau calendrier de Romme n'est-il pas prêt ? Sur tous les toits flottent de petits drapeaux tricolores surmontés de la pique et du bonnet de la Liberté. Sur tous les murs des maisons, car ni le patriote, ni le suspect ne veulent rester en arrière, on lit cette inscription : République une et indivisible. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Quant au nouveau calendrier, nous devons dire ici, plutôt qu'ailleurs, que les savants ont été frappés des défauts et des imperfections du calendrier ; on a résolu qu'il en fallait un nouveau. Maréchal, l'athée, environ dix ans auparavant, proposait un nouveau calendrier, affranchi du moins de superstition. La municipalité l'accepte aujourd'hui faute de mieux ; en tout cas, ayons ou celui de Maréchal ou un autre meilleur, — l'ère nouvelle étant venue. Des pétitions en grand nombre ont été adressées à cet effet, et en vérité, depuis plus d'un an, tous les corps publics, les journalistes et les patriotes en général, ont pris pour date la première année de la république. C'est un sujet qui ne manque pas de difficultés, mais la Convention a pris sa décision, et Romme, comme nous le disons, a médité sur ce sujet. Ce n'est point le calendrier de Maréchal, mais un meilleur, celui de Romme que nous aurons. Romme aidé par un Monge, un Lagrange et autres, fournit les mathématiques ; Fabre d'Églantine fournit la nomenclature poétique, et ainsi, le 5 octobre 1793, après beaucoup de peines, on lance ce nouveau calendrier républicain, leur ouvrage, tout à fait au complet, et de par la loi il est mis en vigueur. Quatre saisons égales, douze mois égaux chacun de trente jours, ce qui fait trois cent soixante jours, et cinq jours de plus dont il reste à disposer. Les cinq jours de surplus seront des jours de fêtes, de réjouissance, et seront appelés les cinq sans-culottides. La fête du génie, celles du travail, des actions, des récompenses, et de la pensée, ce sont les cinq sans-culottides. Ainsi le grand cercle ou l'année est complétée ; seulement à chaque quatrième année, appelée autrefois bissextile, nous introduisons un sixième jour sans-culottide, désigné sous le nom de fête de la révolution. Et maintenant, quant au jour du commencement qui offre des difficultés, n'est-ce pas une des plus heureuses coïncidences que la république elle-même ait commencé le 21 septembre juste à l'équinoxe de l'automne. L'équinoxe de l'automne, à minuit, par le méridien de Paris, en l'an 1792 de l'ère chrétienne, sera donc le point à partir duquel on commencera à calculer l'ère nouvelle. Vendémiaire, brumaire, frimaire ; ou bien, comme on pourrait dire en anglais hybride, vintagearious, fogarious, frostarious : ce sont là les trois mois d'automne. Nivôse, pluviôse, ventôse, ou snowous, rainous, windous, sont notre saison d'hiver. Germinal, floréal, prairial, ou buddal, floweral, meadowal, sont notre saison de printemps. Messidor, thermidor, fructidor — dor provenant du grec et signifiant présent —, reapidor, heatidor, fruitidor, sont l'été de la république. Ces douze mois divisent l'année républicaine. Quant aux subdivisions, risquons tout de suite un coup hardi, adoptons votre système décimal ; au lieu de la semaine, vieille comme le monde, prenons la décade. Il y a, par conséquent, trois décades dans chaque mois, ce qui est très-régulier, et le décadi ou le dixième jour sera toujours le jour de repos. Et le jour du sabbat chrétien que deviendra-t-il ? Cela le regarde. Tel est, en peu de mots, le nouveau calendrier de Romme et de la Convention, calculé pour le méridien de Paris et l'évangile de Jean-Jacques. Ce n'est pas un petit embarras pour les Anglais d'aujourd'hui qui lisent l'histoire de France ; l'esprit est confondu avec ces messidors, jusqu'à ce qu'enfin, pour son propre intérêt, on soit forcé de se faire quelque règle pour passer du nouveau style à. l'ancien style, et qu'on s'y arrête[16]. Le calendrier de Romme a joué un grand rôle dans cette époque dans tous les journaux, les mémoires, les actes publics ; une nouvelle ère qui subsista douze ans et au delà, ne doit pas être dédaignée. Que le lecteur donc passe, à l'aide de notre tableau, si besoin est, du nouveau style à l'ancien, appelé aussi style de l'esclavage ; quant à nous, dans ces pages, nous emploierons autant que possible le dernier seulement. Ainsi, la France, avec les nouvelles fêtes des Piques, et la nouvelle ère ou le nouveau calendrier, accepta sa nouvelle constitution ; constitution la. plus démocratique qu'on ait jamais confiée au papier. Mise en pratique, comment marchera-t-elle ? Les députations patriotiques en sollicitent de temps en temps la jouissance, demandent qu'on la mette à l'épreuve. Cependant on n'ose, c'est inopportun pour le moment. Quelques semaines plus tard, le salut public, par l'organe de Saint-Just, fait un rapport, disant que, dans les circonstances présentes, l'état de la France est révolutionnaire, que son gouvernement doit être révolutionnaire jusqu'à la pacification ! C'est donc seulement sur le papier, et comme espoir, qu'elle doit exister, cette pauvre constitution ; — et, sous cette forme, nous pouvons la considérer comme reposant encore maintenant avec une infinité d'autres choses, dans ces limbes près de la lune. Elle n'a jamais existé, n'existera jamais que sur le papier. V. — L'ARME TRANCHANTE.Au fait, ce ne sont pas des théorèmes sur le papier qu'il faut à la France maintenant, c'est du fer et de l'audace. La Vendée n'est-elle pas encore en feu ? — hélas ! trop à la lettre ! car le coquin de Rossignol incendie les moulins à blé ; le général Santerre n'a rien pu faire ; le général Rossignol, dans son aveugle furie, souvent ivre, fait moins que rien. La rébellion s'étend, devient plus furieuse que jamais. Heureusement ces maigres figures de Don Quichotte que nous avons vues sortir de Mayence, ayant juré de ne pas agir contre la coalition pendant une année, sont arrivées à Paris. La Convention nationale les entasse dans des voitures de poste et des chariots, et les expédie promptement en Vendée. Là ils se battent vaillamment dans des escarmouches et des engagements obscurs, sous les ordres du coquin de Rossignol qu'il& sauvent, sans recevoir de lauriers, la république, et qu'ils soient successivement massacrés jusqu'au dernier[17]. La coalition, comme une marée de feu, ne monte-t-elle pas ? La Prusse par le nord-est découvert ; l'Autriche et l'Angleterre par le nord-ouest. Le général Houchard n'y réussit pas mieux que le général Custine avant lui, qu'il y fasse attention ! Dans l'est et l'ouest des Pyrénées, l'Espagne se déploie ; les bannières des Bourbons déployées, elle inonde le Midi. Les cendres et les tisons des Girondins écrasés couvraient déjà cette région. Marseille est abattue, non éteinte ; elle s'éteindra dans le sang. Toulon, frappé : de terreur, ayant été, trop loin pour tourner casaque, s'est jeté dans les bras des Anglais. Sur l'arsenal de Toulon flotte un drapeau : — ce n'est pas même la fleur de lis du prétendant Louis ; c'est la maudite croix de Saint-George d'Angleterre et de l'amiral Hood ! Tout ce qui restait à la France de matériel naval, d'arsenaux, de cordages, de bâtiments de guerre, s'est livré ces ennemis du genre humain. Assiégez-le, bombardez-le, vous représentants Barras, Fréron, Robespierre le jeune ; toi, général Cartaux ; toi, général Dugommier avant tous, toi, remarquable major d'artillerie, Napoléon Buonaparte ! Hood se fortifie, s'approvisionne, il semble vouloir en faire un nouveau Gibraltar. Mais voilà, dans une nuit d'automne, une des dernières du mois d'août, qu'une clarté de soleil rougeâtre s'élève au-dessus de la ville de Lyon, accompagnée d'un bruit rendre sourd l'univers. Cette clarté, quelle est-elle ? C'est la poudrière de Lyon, c'est l'arsenal avec ses quatre poudrières, qui ont éclaté dans le bombardement, et sauté en l'air, entraînant avec eux cent quinze maisons lançant une lumière, on peut se l'imaginer, semblable à celle du soleil en plein midi, avec un rugissement qui ne le cède qu'à celui de la trompette du jugement dernier ! Tous les êtres vivants endormis sont réveillés partout. Quel fut ce spectacle, dont les yeux de l'histoire ont été témoins dans l'éblouissement de ce soleil nocturne ! Les toits du malheureux Lyon, tous ses dômes, ses clochers, apparaissent un instant. Le Rhône et la Saône montrent soudain leurs flots enflammés, ainsi que les hauteurs et les vallées, les hameaux et les douces prairies, et toute la région d'alentour. — Les hauteurs, hélas ! sont couvertes d'escarpes et de contrescarpes, de retranchements, de courtines, de redoutes ; les artilleurs en uniforme bleu, comme les démons de la poudre, remplissent leur métier infernal, au milieu de cette nuit sinistre ! Que l'obscurité recouvre tout cela, car en vérité cela fait mal à voir. Chalier avait raison, sa mort colite cher à la ville. Les commissaires de la Convention, les congrès de Lyon, ainsi que l'incendie, ont paru et disparu, et il y a eu action et réaction, de pis en pis ; et enfin on en est arrivé à ceci : le commissaire Dubois Crancé, avec soixante-dix mille hommes et toute l'artillerie de plusieurs provinces, bombarde, Lyon jour et nuit. De plus grands malheurs sont encore à venir. La famine est dans Lyon, ainsi que l'incendie et la ruine. Désespérées sont les sorties des assiégés, Le brave Précy, leur colonel et leur commandant national, fait ce que peut faire un homme ; mais ses coups de désespoir sont sans résultat. Les vivres sont coupés ; il n'entre dans notre cité que des boulets et des bombes ! l'arsenal a poussé un rugissement épouvantable ; l'hôpital même sera détruit et les malades ensevelis vivants. Un drapeau noir flotte sur ce noble édifice, implorant la pitié des assiégeants, car quoique fous, en sont-ils moins nos frères ? Dans leur aveugle fureur, ils le prennent pour un drapeau de défi, et c'est de ce côté-là qu'ils tirent le plus. Le mal s'étend toujours de plus en plus, et où s'arrêtera-t-il, sinon quand il aura atteint le dernier degré ? Le commissaire Dubois n'écoute ni excuses, ni discours ; il ne veut que ces mots : Nous nous rendons à discrétion. Lyon renferme des Jacobins soumis, des Girondins dominants, des royalistes secrets. Et aujourd'hui qu'une folie sans oreilles, que les boulets de canon l'enveloppent, la municipalité au désespoir ne volera-t-elle pas à la fin dans les bras même du royalisme ? Sa Majesté sarde devait apporter du secours, mais elle a fait défaut. L'émigré d'Autichamp, au nom de deux Altesses royales prétendantes, traverse la Suisse avec du renfort ; il marche, mais il n'est pas encore arrivé. Précy hisse la fleur de lis ! A la vue de ce drapeau, tous les vrais Girondins tristement déposent leurs armes : — que nos frères tricolores nous foudroient donc, et nous massacrent dans leur colère ; nous ne voulons pas vaincre avec vous. Pour éviter la famine, les femmes et les enfants sont chassés de la ville ; Dubois inexorable les renvoie ; — il répand la flamme et la folie. Nos redoutes en balles de coton sont prises et reprises ; Précy, sous la fleur de lis porte la bravoure jusqu'au désespoir. Que deviendra Lyon ? c'est un siège de soixante-dix jours[18]. Voyez, dans ces mêmes semaines, loin dans les eaux de l'Ouest, dans la baie de Biscaye, est un sale et noir petit navire marchand, ayant pour maître un Écossais, sous les écoutilles duquel reposent, désolés, — dernier noyau du girondinisme au désespoir, les députés venus de Quimper ! Plusieurs se sont dispersés, cachés partout où ils pouvaient. Le pauvre Riouffe est tombé dans les serres du Comité révolutionnaire et les prisons de Paris. Le reste est ici sous les écoutilles ; le respectable Pétion, aux cheveux gris, le colérique Buzot, le soupçonneux Louvet, le jeune et brave Barbaroux et autres. Ils se sont échappés de Quimper et réfugiés dans cette misérable barque ; ils sont maintenant ballottés là et se débattent exposés aux dangers des vagues, à celui des Anglais et à un pire encore, à celui des Français ; bannis par le ciel et la terre dans le fond crasseux de ce navire marchand écossais, tandis que l'Atlantique stérile exerce autour d'eux ses fureur. Ils se dirigent vers Bordeaux, ils verront s'il y a encore là quelques étincelles d'espérance. Entrer dans Bordeaux, ô amis ! Les sanguinaires représentants conventionnels, Tallien et autres de même espèce, munis de leurs arrêts, de leurs guillotines, y sont arrivés ; la respectabilité est mise en terre, le jacobinisme y règne en souverain. De ce débarcadère de la Réole, du bec d'Ambès, la Mort pâle agite la lame tranchante de son épée révolutionnaire, vous guette et vous repousse ailleurs. D'un côté ou d'un autre de ce bec d'Ambès le patron écossais mouillera avec difficulté ; enfin cet homme habile et crasseux débarquera avec peine les Girondins à terre ; — et après avoir reconnu le terrain, ils disparaîtront promptement sous terre, et ainsi par des voies souterraines, dans des caveaux, dans des cabinets secrets d'amis, dans des greniers à foin, dans les caves de Saint-Emilion et de Libourne, ils fuiront la mort cruelle[19]. Jamais sénateurs furent-ils si malheureux ! VI. — CONTRE LES TYRANS.A tous ces obstacles incalculables, à toutes ces horreurs et ces désastres, que peut opposer une convention jacobine ? L'esprit du jacobinisme, qui ne calcule pas, et la frénésie sans formule du sans-culottisme ! Nos ennemis pèsent sur nous, dit Danton, mais ils ne nous vaincront pas, nous brûlerons plutôt la France. Les comités de sûreté, de salut, se sont élevés à la hauteur des circonstances. Que tous les mortels s'élèvent de même à la hauteur ! que les quarante-quatre mille sections et leurs comités révolutionnaires fassent vibrer toutes les fibres de la république, et que chaque Français sente qu'il faut agir ou mourir. Ce sont les artères du jacobinisme, ces sections et ces comités. Danton, par l'organe de Barrère et du salut public, décrète qu'il y aura à Paris, d'après la loi, deux réunions par semaine ; de plus, que le citoyen pauvre sera payé pour y assister, et recevra pour son salaire du jour quarante sous[20]. Voilà la fameuse loi des quarante sous, stimulant actif pour le sans-culottisme, pour l'artère vitale du jacobinisme. Le 23 août, le Comité de salut public, toujours par l'organe de Barrère, a proclamé, en termes qui méritent d'être rappelés, son rapport, qui devient bientôt loi, sur la levée en masse. La France entière, les hommes et les ressources de toute sorte qu'elle renferme, sont mis en réquisition, dit Barrère en langage de Tyrtée ; c'est de lui ce que nous avons de mieux. La république est une vaste cité en état de siège, deux cent cinquante forges seront établies ces jours-là dans le jardin du Luxembourg et autour des murs des Tuileries, à l'extérieur, pour fabriquer des canons, des fusils, sous les yeux du ciel et de la terre ! De tous leurs hameaux vers leurs chefs-lieux, de tous les chefs-lieux vers le camp et le théâtre de la guerre, les enfants de la liberté marcheront ; leur bannière doit porter ces mots : Le peuple français debout contre les tyrans. Les jeunes gens iront se battre, c'est leur devoir de vaincre ; les hommes mariés forgeront les armes, transporteront les bagages et l’artillerie, pourvoiront aux provisions. Les femmes travailleront aux vêtements des soldats, feront des tentes, serviront dans les hôpitaux. Les enfants effileront le vieux linge pour en faire de la charpie. Les vieillards devront se rendre sur les places publiques, et là, par leurs voix, exciter le courage des jeunes gens ; prêcher la haine des rois et l'unité de la république[21]. Paroles tyrtéennes qui résonnent dans tous les cœurs français. Avec ces dispositions d'esprit, puisqu'on l'y force, la France se précipitera de nouveau sur ses ennemis, s'élançant à corps perdu ; elle ne calcule ni dépenses, ni conséquences, n'observant d'autre loi, d'autre règle que cette loi suprême, le salut du peuple ! Elle a pour armes tout le fer qui est en France, pour force celle de tous les hommes, femmes et enfants que renferme la France, Là, sous leurs deux cent cinquante hangars de forgerons, dans les jardins du Luxembourg ou des Tuileries, laissons-les forger leurs armes, sous les yeux du ciel et de la terre. Or, avec cette audace héroïque contre l'ennemi étranger, la sombre vengeance contre l'ennemi domestique peut-elle faire défaut ? L'artère vitale des comités révolutionnaires est excitée par cette loi des quarante sous. Le député Merlin, pas celui de Thionville, que nous avons vu sortir de Mayence à. cheval, mais Merlin de Douai, nommé plus tard Merlin le suspect, — vient une semaine après, environ, présenter sa fameuse et universelle loi des suspects ; il ordonne à. toutes les sections, par
l'organe de leurs comités, d'arrêter immédiatement toute personne suspecte,
et expliquant en même temps quelles sont celles qui doivent être considérées
comme suspectes et susceptibles d'arrestation. Est suspect,
dit-il, quiconque, par ses actions, ses paroles et
ses écrits, est, — pour tout dire en un mot, devenu suspect[22]. De plus, Chaumette, enchérissant encore, dans ses placards
municipaux et ses proclamations, ira jusqu'à dire que vous pouvez presque
reconnaître un suspect et l'empoigner dans la rue, — l'envoyer au comité et
en prison. Faites attention à vos paroles, faites attention aussi à votre air
; si vous n'êtes pas suspect d'autre chose, vous pouvez être, comme on le
disait, suspect d'être suspect ! car ne
sommes-nous pas en état de révolution Jamais loi plus effrayante n'a été mise en pratique dans une nation. Toutes les prisons et les maisons d'arrêt sur le sol français sont remplies jusqu'aux toits ; quarante- quatre mille comités, semblables à autant de foules de moissonneurs et de glaneurs, moissonnent la France ; ils font leurs moissons et, les engrangent dans ces maisons. Moissons d'ivraie aristocratique. De peur même que les quarante-quatre mille, chacun dans son propre champ de blé, ne se trouvent insuffisants, nous aurons une armée révolutionnaire ambulante forte de six mille hommes, sous de bons capitaines ; cette armée parcourra le pays en tous sens et se lancera partout où il se trouvera une semblable moisson à abattre. Voilà ce que la municipalité et la société-mère ont demandé dans leurs pétitions ; ce que la Convention a décrété[23] que les aristocrates, les fédéraux, les messieurs disparaissent, et que les mortels tremblent : Le sol de la liberté sera nettoyé, — par la vengeance Jusqu'à présent le tribunal révolutionnaire n'a pas eu un jour de repos. Blanchelande, pour la perte de Saint-Dominique ; les conspirateurs d'Orléans, pour assassinat, pour attaque contre le député sacré Léonard Bourdon ; ceux-là, avec beaucoup d'autres, pour lesquels la vie était douce, sont morts. Chaque jour la grande guillotine reçoit sa pâture. Semblable à un spectre noir, chaque soir roule ce tombereau de la mort à travers la multitude des vivants. Les rues bruyantes en frissonnent sur le moment, l'oublient l'instant d'après. Les aristocrates 1 ils furent coupables envers la république, leur mort, ne serait-ce que par la confiscation de leurs biens, sera utile à la république. Vive la république ! Dans les derniers jours d'août, tombe une plus noble tête, celle du général Custine. Custine était accusé de dureté, d'incapacité, de perfidie, enfin accusé de bien des choses ; il ne fut reconnu coupable, nous devons le dire, que d'une seule chose, d'insuccès. En entendant sa sentence inattendue, Custine tombe aux pieds du Crucifix, et y demeure silencieux pendant deux heures. Il passe sur la place de la Révolution, les larmes aux yeux, la prière sur les lèvres, jetant des regards sur le couperet brillant ; il monta promptement au haut[24], et promptement fut rayé de la liste des humains. Il avait fait la guerre en Amérique, c'était un homme fier et brave, et son destin l'a amené là. Le deux du môme mois, à trois heures du matin, une voiture roulait, les persiennes baissées, du Temple à la Conciergerie. Dans l'intérieur étaient deux officiers municipaux et Marie-Antoinette, un jour reine de France ! Elle était dans cette Conciergerie, renfermée dans une affreuse cellule, privée de ses enfants, de ses amis, de tout espoir ; elle y est depuis bien des semaines, attendant l'heure de la fin[25]. La guillotine, on le voit, va toujours de plus en plus vite, comme tout le reste. La guillotine, par sa promptitude, donne une idée de l'activité générale de la république. Le cliquetis de cet énorme couperet s'élevant et retombant dans une horrible systole-diastole, est une partie de cet énorme mouvement vital et de la pulsation du système des sans-culottes ! — Les conspirateurs d'Orléans et ceux qui ont assailli un député doivent périr, malgré tous les pleurs et toutes les supplications, tant la personne d'un député est sacrée. Ce qui est aujourd'hui sacré, ne le sera pas demain ; même le député n'est pas plue grand que la guillotine. Le malheureux député Gorsas, nous l'avons vu se cachant dans Rennes, lorsque la guerre du Calvados éclata. Il s'esquiva plus tard en août, à Paris, où il vécut secrètement pendant plusieurs semaines dans les environs du Palais ci-devant royal ; ayant été rencontré un jour, il fut empoigné, son identité fut constatée, et sans façon, étant déjà hors la loi, on l'envoya it la place de la Révolution. Il mourut, recommandant sa femme et ses enfants à la commisération de la république. On était au 9 octobre 1793. Gorsas est le premier député qui périt sur l'échafaud, il ne sera pas le dernier. L'ex-maire Bailly est en prison ; l'ex-procureur Manuel également. Brissot et nos pauvres Girondins arrêtés, sont devenus des Girondins accusés et incarcérés ; le jacobinisme en masse demande à grands cris leur châtiment, Les scellés de Duperret sont brisés ces soixante-treize protestants secrets deviennent un jour, tout à coup, l'objet d'un rapport et sont décrétés d’accusation ; les portes de la Convention sont préalablement fermées afin qu'aucun des inculpés ne puisse échapper. Ils furent conduits on prison avec brutalité ce soir-là. Heureux ceux qui eurent la chance d'être absents ! Condorcet &est éclipsé, dans l'ombre ; peut-être, comme Rabaut, entre deux cloisons dans la maison d'un ami. VII. — MARIE-ANTOINETTE.Le lundi 14 octobre 1793, une cause est pendante au palais de justice, devant la nouvelle cour révolutionnaire ; cause telle que jamais ces vieux murs n'en virent une semblable : c'est le jugement de Marie-Antoinette. Celle qui fut la plus brillante des reines, aujourd'hui flétrie, défigurée, délaissée, comparait à la barre judiciaire de Fouquier-Tinville pour y défendre sa vie. L'acte d'accusation lui fut signifié la veille[26]. Pour répondre à de telles vicissitudes dans la fortune des hommes, quelles expressions peuvent être assez fortes ? le silence seul convient. On trouve peu de choses imprimées aussi tragiques, et même aussi épouvantables que ces pages sèches du Bulletin du tribunal révolutionnaire, qui ont pour titre Jugement de la veuve Capet. Ténèbres, ténèbres comme dans une fatale éclipse, comme dans les pâles empires de Pluton ! juges plutoniens, plutonique Tinville, entourés neuf fois par le Styx et le Léthé, et le Phlégéthon qui roule des flammes, et le Cocyte appelé le fleuve des lamentations. Les témoins assignés sont vraiment comme des esprits ; qu'ils soient à charge ou à décharge, eux-mêmes ils sont tous suspendus au-dessus de la mort et de la condamnation ; ils sont marqués dans notre imagination comme la proie de la guillotine. Le grand ci-devant comte d'Estaing, désireux de se montrer patriote, ne peut échapper, non plus que Bailly, qui, lorsqu'on lui demande s'il connaissait l'accusée, répond en s'inclinant respectueusement de son côté : Ah ! oui, je connais madame. Des ex-patriotes sont là, durement traités, tels que le procureur Manuel, des ex-ministres dépouillés de leur splendeur. Nous avons la froide impassibilité aristocratique, qui ne se dément pas même dans le Tartare ; la stupidité féroce des caporaux patriotes, des blanchisseuses patriotes, qui ont beaucoup à dire à propos de complots, de trahisons, du IO août, de l'ancienne insurrection des femmes, car aujourd'hui tout est crime pour celle qui a perdu, Marie-Antoinette, dans cet abandon complet, dans cette heure d'extrême besoin, ne se manque pas à elle-même, cette femme impériale. Sa contenance, dit-on, pendant la lecture de cette infâme accusation, resta calme ; on remarqua que de temps en temps elle remuait ses doigts, comme lorsqu'on touche du piano. Vous distinguez, non sans intérêt, même dans ce triste bulletin révolutionnaire, qu'elle se comporte en reine. Ses réponses sont promptes, précises, souvent d'une brièveté laconique. La fermeté qui, va jusqu'au dédain sans cesser d'être digne, se voile sous un langage calme. Vous persistez donc à nier ? — Mon intention n'est pas de nier, je n'ai dit que la vérité, j'y persiste. L'infâme Hébert apporte son témoignage sur beaucoup de points, et en particulier sur un fait concernant Marie-Antoinette et son jeune fils, — tel que jamais le langage humain n'aurait dû en être sali... Elle réplique à Hébert. Un des membres du jury fait observer qu'elle n'a pas répondu à ceci. Je n'ai pas répondu, s'écrie-t-elle avec émotion, parce que la nature se refuse à répondre à une charge semblable portée contre une mère. J'en appelle à toutes les mères qui sont ici ! Robespierre, quand il en entendit parler, éclata, au point presque de lancer une imprécation contre cette brute d'Hébert[27], dont l'ignoble mensonge est retombé sur sa tête ignoble. A quatre heures, le mercredi matin, après deux jours et deux nuits d'interrogatoire, le verdict est rendu arrêt de mort. Avez-vous quelque chose à dire ? L'accusée secoua la tête sans parler. Les flambeaux touchent à leur fin, le jour approche ; et pour elle aussi le temps est accompli, le jour de l'éternité va se lever. Cette salle de Tinville est obscure, mal éclairée, excepté où se tient la reine. Elle la quitte en silence, pour aller à la mort. Deux processions ou marches royales, séparées par l'espace de vingt-trois ans, nous ont souvent frappés d'un étrange sentiment de contrastes. La première est celle d'une belle archiduchesse ou dauphine, quittant. sa Vieille ville natale à l'âge de quinze ans, avec des espérances telles qu'aucune autre fille d'Eve n'en avait eu. Le lendemain, dit Weber[28], témoin oculaire, la dauphine quitta Vienne. Toute la ville était dehors ; d'abord avec un chagrin silencieux. Elle parut, on la vit s’enfoncer dans la voiture, le visage baigné de larmes ; cachant ses yeux, tantôt avec son mouchoir, tantôt avec ses mains ; quelquefois mettant la tête à la portière pour revoir encore ce palais de ses pères où elle ne devait plus revenir. Elle exprimait ses regrets, sa gratitude à ce bon peuple, qui était là, en masse pour lui faire ses adieux. Alors ce ne sont plus des larmes, mais des cris perçants de tous côtés. Hommes et femmes tous la fois s'abandonnent à leur chagrin. On entendait un bruit de deuil dans les rues et les avenues de Vienne. Le dernier des courriers qui la suivaient disparut, et la foule se dissipa. La jeune vierge impériale de quinze ans est devenue une veuve découronnée, épuisée, de trente-huit ans, blanchie avant le temps. Voici sa dernière procession : Quelques minutes après le jugement rendu, les tambours battaient aux champs, pour qu'on prit les armes dans toutes les sections ; au lever du soleil, la force armée était sur pied, les canons placés aux bouts des ponts, sur les places, dans les carrefours, tout le long du chemin du palais de justice à la place de là Révolution. Vers dix heures, de nombreuses patrouilles circulaient dans les rues ; trente mille fantassins et cavaliers étaient sous les armes. A onze heures Marie-Antoinette fut amenée. Elle portait un déshabillé de piqué blanc ; elle était conduite à la place de l'exécution de la même manière qu'un criminel ordinaire, liée, sur un chariot, accompagnée d'un prêtre constitutionnel en costume de laïque, et escortée de nombreux détachements d'infanterie et de cavalerie. Elle jette des regards d'indifférence sur ces militaires, et sur le double rang de troupes, tout le long de la route. Il n'y avait dans sa contenance ni abattement, ni hauteur. Quant aux cris de Vive la république ! et A bas la tyrannie ! qui l'accompagnaient pendant le trajet, elle semblait n'y faire aucune attention. Elle parlait peu à son confesseur. Lus banderoles tricolores flottant sur les toits attirèrent sou attention ; dans les rues du Roule et Saint-Honoré, elle remarqua aussi les inscriptions placées sur les façades des maisons. En arrivant sur la place de la Révolution, ses regards se portèrent suri le jardin national, autrefois les Tuileries ; ses traits dans ce moment-là exprimèrent une légère émotion.' Elle monta à l'échafaud avec assez de courage ; à midi et quart sa tête torr hait. Le bourreau la montra au peuple au milieu des cris universels et prolongés de : Vive la république ![29] VIII. — LES VINGT-DEUX.A qui maintenant, ô Tinville ! Les suivants sont de cou- leur bien différente ; ce sont nos pauvres députés Girondins arrêtés. Tous ceux d'entre eux qui dut pu être saisis : Vergniaud, Brissot, Fauchet, Valazé, Gensonné, autrefois la fleur du patriotisme français, au nombre de vingt-deux. Ils sont ici devant la barre de Tinville. Ils ont été sous la sauvegarde du peuple français, puis enfermés au Luxembourg, puis emprisonnés à la Conciergerie, et maintenant c'est ici que le cours des choses les a amenés. Fouquier-Tinville doit rendre compte d'eux comme il pourra. Incontestablement ce jugement des Girondins est le plus important de tous ceux que Fouquier a eus à conduire jusqu'ici. Ces vingt-deux, tous chefs républicains, sont là rangés sur une ligne ; ce sont les hommes les plus éloquents de France, jurisconsultes aussi, et ils ne manquent pas d'amis dans l'auditoire. Comment Tinville prouvera-t-il que ces hommes sont coupables de royalisme, de fédéralisme, de conspiration contre la république ? L'éloquence de Vergniaud se réveille de nouveau, et arrache des pleurs, dit-on. Et les journalistes rendent compte de tout ; le procès se prolonge de jour en jour ; il menace de devenir éternel, murmurent beaucoup de personnes. Le jacobinisme et la municipalité viennent en aide à Fouquier. Le 28 du mois, Hébert et autres arrivent en députation pour informer la Convention patriote que le tribunal révolutionnaire est tout à fait enchainé par les formalités légales ; qu'un jury patriote doit avoir le droit de couper court, de terminer les débats, lorsqu'il se sent convaincu. Cette proposition de couper court, si riche en conséquences, passe promptement à. l'état de décret. En conséquence, à dix heures, dans la soirée du 30 octobre, les vingt-deux, rappelés une fois de plus, reçoivent cette information, que le jury, se sentant convaincu, a coupé court, et rendu son verdict ; les accusés sont déclarés coupables, et la sentence est pour tous, sans en excepter un seul, la mort et la confiscation de leurs biens. Des cris s'élèvent parmi nos pauvres Girondins, et un tumulte que les gendarmes seuls peuvent réprimer. Valazé se poignarde, et tombe mort sur le coup. Le surplus, au milieu des clameurs et de la confusion, est reconduit à la Conciergerie. La Source s'écrie : Je meurs le jour où le peuple a perdu la raison ; vous mourrez à votre tour, quand il la recouvrera[30]. Point de secours ! Cédant à la violence, les condamnés entonnent l'hymne de la Marseillaise ; ils s'en retournent en chantant à leur prison. Riouffe, qui fut leur compagnon de captivité pendant ces
derniers jours, s'est plu à rapporter comment ils sont morts. Suivant nos
idées, ce n'est point une mort édifiante gai et satirique pot-pourri de
Ducos, scènes de tragédie dans lesquelles ils font dialoguer Barrère et
Robespierre avec Satan ; veille de la mort passée en
chants et en saillies de gaieté, avec des discours sur le bonheur des peuples, toutes ces
hases et celles qui leur ressemblent, nous devons les prendre pour ce
qu'elles valent. Ainsi se passe le dernier souper des Girondins. Valazé, la
poitrine couverte de sang, dort dans les bris de la mort, il n'entend pas les
chants. Vergniaud a sa dose de poison, mais il n'en a pas assez pour ses
amis, il n'en a juste que pour lui ; c'est pourquoi il le rejette bien loin ;
il préside à ce dernier souper des Girondins avec des éclats éblouissants
d'éloquence accompagnés de chants et d'allégresse. La pauvre volonté humaine
lutte pour s'affirmer d'une manière ou de l'autre[31]. Mais le lendemain matin, tout Paris est dans les rues ; jamais on ne vit une telle foule. Les chariots de la mort, le cadavre froid de Valazé étendu au milieu des vingt et un encore vivants, roulent le long des rues. Tète nue, les mains liées, en manches de chemise, l'habit jeté négligemment autour du cou, ainsi sont traités les éloquents de France ; on pousse des murmures contre eux et des huées. Aux cris de Vive la république ! quelques-uns d'entre eux répondent par le même cri de Vive la république ! D'autres, comme Brissot, sont plongés dans le mutisme. Au pied de l'échafaud, ils font encore entendre, avec des variations appropriées au moment, l'hymne de la Marseillaise. Représentez-vous bien cette scène de musique. Ceux qui vivent encore continuent à chanter ; le chœur s'affaiblit rapidement, ! couperet de Samson est rapide, une tête par minute, à peu près. Le chœur s'affaiblit, le chœur a cessé. — Adieu pour toujours, Girondins. Fauchet Te-Deum est, devenu silencieux ; la tête sans vie de Valazé est tranchée ; la faux de la guillotine a moissonné tous les Girondins. L'éloquence, la jeunesse, la beauté et la bravoure ! s'écrie Riouffe. Ô mort ! quelle fête dans tes salles ténébreuses ! Hélas ! dans la région éloignée de Bordeaux, les Girondins ne seront pas mieux traités. Dans les caves de Saint-Emilion, dans les greniers, dans les celliers, les mois coulent péniblement pour eux ; leurs vêtements sont en lambeaux, leur bourse vide, novembre et l'hiver arrivent ; avec Tallien et sa guillotine tout espoir est aujourd’hui perdu. Le danger approche de plus en plus, les difficultés grandissent, ils décident de se séparer. Les adieux furent touchants. Le grand Barbaroux, le plus enjoué des braves, s'arrête pour serrer dans ses bras son Louvet. En quelque lieu que tu rencontres ma mère, crie-t-il, tâche de remplacer son fils auprès d'elle. — Je n'aurai point de ressource que je ne partage avec ta femme, si jamais la chance me conduit auprès d'elle[32]. Louvet partit avec Guadet, Salles et Valadi ; Barbaroux avec Buzot et Pétion. Valadi se dirigea bientôt vers le Midi, en faisant route tout seul. Les deux amis et Louvet passèrent une misérable journée et une affreuse nuit, le novembre 1793. Trempés par l'humidité, épuisés de fatigue et de faim, ils frappèrent le lendemain, pour de- mander quelque assistance, il la maison de campagne d'un ami ; le faux ami refusa de les recevoir. Ils se réfugièrent en conséquence sous des arbres, avec une pluie battante. Désespéré, Louvet se dirigera sur Paris Il marche en avant, faisant jaillir la boue autour de lui, animé d'une vigueur nouvelle que lui donne la fureur ou la frénésie. Il traverse des villages, y trouve la sentinelle endormie dans sa guérite, pendant une pluie battante. Il est passé avant que l'homme ait pu le voir. Il déjoue les comités révolutionnaires, blotti dans des chariots de roulage, dans des voitures couvertes et découvertes ; dans l'une il se cache sous des havresacs et des manteaux de femmes, de soldats, dans les rues d'Orléans, pendant qu'on le cherche : ces évasions miraculeuses pourraient faire trois romans. Enfin il atteint Paris, et se trouve auprès de sa belle compagne ; il gagne la Suisse, où il attend de meilleurs jours. Les pauvres Guadet et Salles furent bientôt pris tous les deux. Ils périrent sous la guillotine à Bordeaux, les tambours battant pour étouffer leur voix. Valadi est également pris et guillotiné. Barbaroux et ses deux camarades échappèrent plus longtemps, jusque dans l'été de 1794, mais pas assez longtemps. Une matinée de juillet, changeant de cachette, ainsi qu'ils étaient souvent obligés de le faire, à une lieue à peu près de Saint-Emilion, ils remarquent une masse considérable de paysans ; sans nul doute ce sont des Jacobins qui viennent pour les saisir. Barbaroux prend un pistolet et se tue. Hélas ! ce n'étaient pas des Jacobins, c'étaient de braves villageois allant à une fête de campagne. Deux jours plus tard Buzot et Pétion furent découverts dans un champ de blé, leurs corps à moitié dévorés par les chiens[33]. Telle fut la fin des Girondins. Ils se levèrent pour régénérer la France, ces hommes, el voilà le résultat où ils sont arrivés. Hélas ! quelques reproches que nous ayons eu à leur adresser, leur cruelle destinée ne les absout-elle pas ? La pitié seule doit survivre. Tant d'âmes vaillantes de héros sont descendues dans le royaume d'Hadès ; ils se sont donnés en proie aux chiens et aux oiseaux de toute espèce, mais ici, comme dans l'Iliade, la volonté suprême s'est accomplie. Ainsi que Vergniaud l'a dit, comme Saturne, la révolution dévore ses propres enfants. |