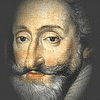LA LIGUE ET
CHAPITRE V. — VACANCE DU TRÔNE APRÈS LA MORT DE CHARLES X. - PRÉTENTIONS CONFUSES DES
PARTIS.
Parti espagnol pour l'infante. — Parti de la maison de Lorraine. — L'enfant de Guise. — Le duc de Mayenne. — Tiers-parti pour Henri de Navarre. — Pamphlets pour la loi salique. — États de Reims. — Négociation de Jeannin à Madrid. — Question des subsides. — Condition de l'élection. — Mouvement de la ligue en province. — Siège de Rouen. — Opération du duc de Parme. — Situation militaire. — Action diplomatique de Henri IV.1591. Le mouvement municipal, dont je viens de décrire les
graves circonstances, laissait entière la question d'avènement à la couronne,
quoique cette question se fût liée à toutes les secousses populaires. Qui
choisirait-on pour roi catholique, pour souverain de l'union ? Quel serait le
prince salué par les nuances diverses du parti des cités fédérées ? La mort
de Charles X avait ouvert une large voie pour toutes les prétentions à la
belle couronne de France. C'est en vertu de deux principes qu'agissaient les
candidats à la grande dignité royale : l'hérédité et l'élection. Le principe
de la vacance du trône n'était pas admis assez incontestablement pour que les
prétendants ne fissent valoir que des services catholiques et leur popularité
; tous invoquaient les droits de famille, la transmission héréditaire à des
titres divers. Les états convoqués et toujours suspendus, parce que le duc de
Mayenne voulait perpétuer la lieutenance-générale, ne devaient reconnaître
que la légitimité des droits : ce n'était pas une élection aux champs de guerre,
ou sous la tente, comme l'eussent fait les vieilles assemblées de France,
proclamant un roi au bruit de la framée ? Il régnait quelque chose de confus et
d'indécis encore dans les prétentions à la couronne ; les états-généraux
n'étaient point réunis ; tout se passait en intrigues, en sollicitations, en
démanches préparatoires. Alors se renouvelaient les hautes réclamations de
l'infante, fille de Philippe II et d'Elisabeth de France. On a vu déjà que,
dans ses instructions secrètes, le roi d'Espagne ordonnait à ses ambassadeurs
de pressentir les chefs de l'union sur les droits de sa fille. Charles X
régnait alors ; maïs lorsqu'il quitta la vie et la couronne, Philippe II
n'usant plus d'aucune précaution, réclame hautement le trône de France comme
un droit et une propriété. Don Diego d'Ibarra,
écrivait-il ; je pense qu'il est de la dernière
urgence pour La maison de Lorraine invoquait sa vieille popularité ; elle aussi se divisait en deux branches de prétendants. L'héritier de Guise venait de s'échapper de sa prison de Tours. Fils du grand Henri de Guise, l'enfant miraculeusement délivré était chéri de la multitude et des halles ; le duc de Mayenne tentait vainement de se mettre en concurrence avec lui ; l'oncle rappelait ses services ; mais le peuple n'avait d'affection véritable que pour le fils du martyr de Blois. Les gros bourgeois et les parlementaires l'eussent préféré à la succession espagnole, au cas où leur combinaison d'espérance et de prédilection, celle de Henri IV converti au catholicisme, viendrait à échouer. Quant aux instructions subséquentes de Philippe II, elles portaient, que si son ambassadeur ne pouvait obtenir l'élection de l'infante sans condition, il proposerait son mariage avec le duc de Guise. Quant à Henri de Béarn, il invoquait les droits de sa
royauté, en vertu d'autres principes, n ne reconnaissait pas la puissance des
états-généraux, pour déférer une couronne qui lui était acquise par
l'hérédité. Il appelait de son droit à son épée, des voix du peuple à
Tassentiment de sa chevalerie. Pour combattre la combinaison espagnole de
l'infante, qui répondait aux sympathies des halles et de l'union, les
royalistes du camp béarnais publièrent une suite de pamphlets qui roulaient
sur ces deux propositions : Que les François n'ont
jamais pu souffrir estrangers régner sur eux ; que la domination des femmes a
esté calamiteuse. Ces pamphlets servaient à démontrer que personne ne
pouvait entreprendre guerre contre qui que ce soit sans la permission du
prince. Les femmes ne peuvent ny doivent régner ; si
Brunehaut espagnolle n'eust pas régné en France, elle n'eust pas fait mourir
dix-huit princes du sang royal ; Frédégonde, femme impudique, fit tuer un roy
au milieu de son armée ; la mère du roy saint Louis conseilla à sondict fils
la guerre contre les Sarrazins, laquelle fut calamiteuse aux François ; la
femme du roi Charles VI troubla le royaume ; Clotilde, femme de Clovis, roy
de France, a entretenu ses enfants en querelle, tout le royaume de France en
troubles ; la régente, mère du roy François Ier, par tout le temps qu'elle a
régné, a fait tous ses efforts pour desfaire, raser et déraciner entièrement
toute la maison de Bourbon. Ces pamphlets n'avaient pas un grand
retentissement parmi des populations toutes préoccupées de la question
religieuse ; que leur importaient les lois fondamentales, les principes
parlementaires ! il s'agissait de sauver l'union municipale, et les secours
de Philippe n favorisaient ce résultat. Il faut répéter qu'à cette époque les
questions de nationalité n'avaient pas cette puissance d'opinion que depuis
elles ont obtenue ; la pensée religieuse agissait avec une énergie bien
autrement saisissante. En résultat, c'était aux états-généraux qu'allait être
déférée la solution de ces droits et de ces prétentions diverses. Le duc de
Mayenne avait promis au roi d'Espagne la convocation des états ; le lieu en
avait été fixé à Reims, ville de France catholique, et les pouvoirs du duc de
Feria étaient même spéciaux pour se présenter devant cette grande assemblée :
Grands, magnifiques et mes bien-aimés seigneurs,
leur disait le roi Philippe, je prends un si vif
intérest aux affaires de toute la chrestienté et particulièrement de Le duc de Mayenne était-il de bonne foi dans les offres qu'il faisait au roi d'Espagne ? N'appelait-il pas seulement des subsides pour servir ensuite sa propre cause ? Dans tontes ces circonstances, le duc de Mayenne, expression de la bourgeoisie, conservait ce caractère mitoyen qui lui était propre, ce désir de traiter avec tous les partis et de les servir tous, pour éviter une crise trop vive, trop décisive, et en tous les cas retirer le profit possible de sa situation. Le roi Philippe semblait juger cette avidité bourgeoise de Mayenne quand il écrivait à son ambassadeur, Don Diego de Ibarra : Ce que vous me dictes sur les prétentions du duc de Mayenne me paroist fort estrange ; je devois, dict-il, lui fournir cent mille escus pat mois pendant le temps mentionné ? — Cette demande est sans fondement ; il doit se référer à la response que je fis dans le temps au président Jeannin : j'y promettois de payer les troupes du duc de Mayenne Sur le mesme pied que celles sous le commandement du duc de Parme[3]. C'était dans l'espérance d'une convocation prochaine des
états que ces négociations étaient engagées. Le duc de Mayenne promettait
sans cesse de les réunir, car les sollicitations de Philippe II étaient
vives, pressantes, les états pouvant seuls décider la question de la
couronne. Le duc de Mayenne signait des lettres de convocation, puis les
contremandait ; d'un autre côté, les villes, toutes soumises à la liberté
municipale, ne tenaient pas à ces réunions générales qui leur enlevaient
toujours quelque partie de leur indépendance locale ; elles apportaient des
longueurs, des empêchements, ne permettant pas aux députés de traverser leurs
murailles, de franchir leurs portes et leurs ponts-levis. Deux instructions
furent envoyées par Philippe II au duc de Feria, pour sa conduite aux
états-généraux. L'une est patente, l'autre secrète. On voit dans la première
que l'élection d'un roi catholique ardent est le but principal de la mission
du duc de Feria : Point de régence, ou cessation des secours de l'Espagne ;
éloignement de tous les princes de la maison de Bourbon, et reconnaissance
des droits de l'infante. La minute de cette instruction porte exclusion pour le prince de Béarn et POUR CEUX DE Dans toutes les instructions secrètes ou publiques de Philippe II, on voit qu'il n'est aucunement question des prétentions du duc de Mayenne pour l'associer à la couronne. Le roi d'Espagne se défiait de lui et des parlementaires dont il était l'expression. Il n'en était pas de même du duc de Guise. Le roi savait toute sa popularité ; un bon mariage entrait même dans ses dernières intentions. Mon cousin, écrivait-il à l'héritier de la grande maison ; j'ai reçu avec les despesches de D. Mendo Rodrigues la lettre que vous m'avez escrite ; j'y vois que vous marchez d'un pas ferme vers'les obligations que vous impose le service de Nostre Seigneur. Tout moyen doit estre valable pour assurer un succès durable ; vous réclamez à cet égard mon appui ; or, croyez bien qu'en marchant sur les traces de vostre père, et de ceux qui sont morts pour la desfense de la religion catholique, vous trouverez en moy le plus zélé desfenseur et amy. Et à quelle condition proposait-on la belle et grande monarchie de France au roi catholique ? Ce roi absolu, éternel, Philippe, accepterait-il toutes les clauses que voulait imposer la sainte-union ? Ces clauses étaient de plusieurs natures : les unes se rattachaient à des ambitions personnelles, comme il arrive toujours dans les transactions humaines ; les autres, plus noblement inspirées, donnaient pleine satisfaction aux opinions, aux intérêts, aux grandes libertés des villes, des partis et des états. 1° Sa majesté procureroit de tout son pouvoir que l'hérésie fust exterminée de France, avec justice exemplaire des renieurs, blasphémateurs du nom de Dieu et des saincts. Establiroit en tout ce royaume le sainct office de l'inquisition, formidable aux mes-chants et désirable aux bons. Sa majesté ne pourvoiroit aux primaties, archeveschés, esveschés, abbayes et bénéfices de ce royaume, ny aussi aux places fondées pour l'entretenement des jeunes gens pauvres, tant ès collèges que hospitaux, aucun estranger dudict royaume. Sa majesté aussi ne pourvoiroit aux estais de connétable, de chancelier, des quatre mareschaux, d'admiral, de grand escuyer, de grand maistre, de grand chambellan, de grand prevost et autres, que des François naturels. Toutes tailles, subsides et impositions introduites depuis le temps du roi Louis XIIe, sauf la gabelle du sel au lieu où elle est reçue, et les décimes, seront cassés, révocqués et annulés. Sa majesté permettroit le trafic de tous ses pays d'Europe, Asie, Afrique, Amérique, isle de la mer Océane, ainsi que sa majesté le permet aux Espagnols ; le roy ne se nommeroit plus roy d'Espagne, non plus que roy de France, mais le grand roy ou autre tel titre qui ne portast spécialité. Les estats se tiendront de quatre en quatre ans, où on ad visera à réformer les choses appartenantes à l'estat. Ainsi catholicisme ardent, unité religieuse, liberté municipale et politique, élection royale, souveraineté des états, leur convocation périodique, déchéance delà couronne au cas de la violation du serment, régularisation des taxes, examen des comptes, franchise du commerce ; tel était le fondement dé la sainte-union des villes, telles étaient les conditions auxquelles elles voulaient faire un roi. Mais tout cela était encore bien confus, bien indécis : tant que les états n'étaient pas rassemblés, on ne pouvait jeter que des projets, on ne pouvait préparer que des intrigues. Les bons députée des villes et des provinces allaient arriver à Paris ; les prétendants exposeraient devant eux leurs droits respectifs, et ces droits seraient appréciés et jugés par les mandataires des trois ordres : clergé, noblesse et bourgeoisie allaient élire un roi. Dans les crises de la monarchie, toutes les fois qu'un
mouvement se développait avec quelque énergie, il y avait tendance à
reconstituer la vieille nationalité provinciale : que ce mouvement vînt des
tilles ou des barons, il avait le même esprit ; on se détachait du centre
pour se grouper en provinces indépendantes, circonscriptions mieux en rapport
d'habitudes, de langage avec chaque origine de peuples et d'invasions. Les
ligues de cités, quoique dominées par l'unité catholique, avaient produit un
résultat de morcellement ; de grandes familles qui possédaient les
gouvernements héréditaires, de vastes fiefs, des droits de protection et de
vieilles origines, s'étaient déclarées affranchies de toute obéissance, il y
avait des parlements particuliers pour la justice et l'administration ; des
cours des comptes, aides, finances. On n'avait besoin de l'autorité royale
que pour conserver une suzeraineté politique dont les liens étaient si
faibles encore. Cette démolition du principe d'unité avait commencé par Les troupes espagnoles, sous les ordres de don Juan de Laguila, entrèrent en Bretagne ; et le 1er décembre 1590, le duc de Mercœur écrivait à Philippe II : Sire, il seroit donc requis qu'il plust à vostre majesté m'ayder. Et nettoyant bientôt ceste province, comme j'espère faire, par la grâce de Dieu, et l'appuy qu'il plaira à vostre majesté me donner, l'on pourra tirer des commodités non seulement pour la conserver, mais aussi pour employer au service de l'Espagne dans l'entreprise d'Angleterre où autre, ainsi qu'elle voudra commander, tant pour lever des gens de pied et de cheval que pour armer des navires. Le duc de Mercœur avait raison de prévoir ce soulèvement des provinces d'Anjou et du Maine. L'envoyé auprès des braves Bretons, don Mendo de Ledesma, écrit à Philippe II : Les Bretons viennent à vostre royale majesté, comme à leur unique protecteur et seigneur, la supplient en toute humilité de leur faire grâce et faveur de secourir ces deux provinces, tyrannisées par l'ennemy, de deux mille soldats espagnols à pied et deux cents chevaux. Le mouvement de En réponse, le roi d'Espagne envoya des secours au duc de
Joyeuse en Languedoc ; quelques régiments passèrent les Pyrénées et prirent
garnison à Toulouse et à Montpellier. Dans le Lyonnais et Et en Provence quelle ferveur et quel zèle ! parlement,
cités municipales, Aix, Marseille, Arles, tout se réunissait pour la
conservation de l'antique foi catholique. Elle venait, cette grande province,
de recevoir un secoure effectif du duc de Savoie et des Espagnols,
auxiliaires de la sainte-ligue. Le duc de Savoie était entré dans Aix, appelé
par le parlement ; Marseille voyait ses braves galères unir aux couleurs du
duc ses longues flammes, ses banderoles à croix". Quelques
gentilshommes, sous la conduite du sire de Village, avaient voulu crier fueros los Savoyards ; mais le peuple, sous son
premier consul Casaulx, avait salué le prince, défenseur de sa croyance et de
ses libertés municipales. Gomme dans la commune de Paris, toutes les rigueurs
furent dirigées contre les huguenots et les bigarras,
tiers-parti qu'on signalait ainsi dans le patois de Provence[6]. Cependant
quelques différends s'élevèrent entre le consul Casaulx et le duc de Savoie
sur les privilèges de la ville : les Marseillais n'auraient jamais souffert
qu'une garnison oppressive entrât dans les murs de leur république
municipale, et lorsque, par surprise, le parti des gentilshommes se fut
emparé du monastère de Saint-Victor, Casaulx fit pointer des canons contre
ses hautes murailles, car la ville voulait elle-même défendre ses droits et
sa fol religieuse. En 1S91 une transaction réunit les esprits dans la cause
commune. La possession de Quand les échevins reçurent, en conseil de ville, ces propositions,
tous s'écrièrent : Est-ce que le Béarnais se mocque
de nous ; est-ce qu'on ne cognoist pas ses déportements ? Croit-il que nous
ayons oublié la prise d'Estampes et de Louviers, où furent faicts de si
cruels carnages, et de Vendosme, où il fit décoller monsieur de La défense des catholiques dans Rouen fut admirable comme l'avait été celle de Paris. On y vit les bourgeois de la ville sous l'estendard du Crucifix, pieds nuds, chascun un flambeau de deux livres en la main ; grand nombre de petits enfants qui chantoient les litanies, et puis les saincts reliquaires de mincX Romain, de sainct Godard, de sainct Ouen et de sainct Cande, Jean Dadræus faisoit de longues prédications, il montroit fort doctement les raisons qui empeschent de recevoir un hérétique pour roy de France : un jour fit lever la main au peuple de plustost mourir que de recognoistre Henry de Bourbon, hérétique, relaps, pour tel déclaré et condamné par les papes Sixte V et Grégoire XIV. Pendant ce temps le Béarnais attaquait vigoureusement la porte Sainct-Hilaire ; mais les habitants étoient tous sous les armes, résolus de s'ensevelir sous les ruines de la cité, et ce brave M. de Villars, à la teste des bons bourgeois, faisoit de fréquentes sorties, notamment une par la porte Cauchoise qui fut meurtrière aux hérétiques[7]. La sûreté et les subsistances de Paris dépendaient de
Rouen. Les membres de l'union le sentaient bien ; comment lutter avec de
simples troupes de bourgeoisie contre Henri de Navarre à la tête de la
chevalerie huguenote ? Le duc de Mayenne s'était rendu en toute hâte auprès
du duc de Parme, dans les Pays-Bas, pour appeler de nouveaux secours. Il lui
avait exposé les besoins de la ligue, la nécessité de transiger avec le
Béarnais, si Rouen n'était pas secouru comme l'avait été Paris. Le duc de
Parme fit de nombreuses difficultés ; il voulait faire acheter ses services ;
il n'avait pas été content de la reconnaissance des Parisiens après les avoir
délivrés du grand danger du blocus et de la famine : quel sort allait être
réservé aux intérêts de l'Espagne ; élirait-on l'infante dans les états ?
ferait-on quelques concessions au roi Philippe II ? Le duc de Mayenne promit
beaucoup, montra l'importance, avant toute chose, de ne pas subir la domination
du Béarnais, résultat inévitable, si l'on ne délivrait Rouen. Farnèse se
décida à une seconde campagne, et les braves soldats espagnols saisirent
leurs pique set arquebuses. L'armée wallonne traversa de nouveau, Alors la famille de Guise, et le jeune fils bien-aimé de
l'illustre Macchabée s'étaient rendus dans les Pays-Bas. De Landrecy, le 18
décembre 1591, le duc de Parme écrivait au roi d'Espagne : Je ne sçaurois dire combien j'ay de regret de voir les
choses de ce royaume et celles de l'union en particulier dans la confusion où
elles sont ; ne pouvant entretenir les uns ny les autres, ny subvenir à
Mayenne, ny aux François qu'on pourra avoir. J'en crains les désordres et
desbandements ; Dieu y pourvoira, car Mayenne et les François sont desgoustés
par faute de ne pouvoir et n'avoir moyen de leur subvenir ; je ne sçais ce
qu'il en seiu de nous et comment nous pourrons faire le royal service de vostre
majesté en aucun lieu, puisque le tout sera exposé au bénéfice de la fortune,
en une saison et affaire qui devroient estre bien différentes de ce qui est ;
de sorte que je ne sçais que dire, sinon que nous recommander à Nostre-Seigneur
et en ses miracles, car autrement il n'y a apparence, je ne dis pas d'obtenir
ce que Ton prétend, mais encore de nul bon succès. Le 15 janvier 1592, le premier mouvement des Espagnols commença sur les frontières ; le duc de Parme s'empresse de récrire à Philippe II : Sire, je partis de Landrecy samedy dernier, et vins loger sur les limites de France ; et pour ce qu'il me falloit passer bien près de Guise, où estoient pour lors la duchesse et le duc son fils, il me sembla qu'en passant je luy devois aller baiser les mains pour sçavoir quelle seroit son intention sur les affaires de ce royaume, ce que je fis ; et à ce que je pus comprendre, par les propos de Madame qui me furent confirmés par l'évesque de Plaisance qui estoit avec elle, je connus bien qu'elle ny son fils n'estoient aucunement contents du duc de Mayenne, se plaignant à moy du peu de compte qu'il avoit d'eux, disant qu'il ne faisoit son devoir à leur égard, et qu'il prendroit plutost le chemin d'amoindrir que d'advancer l'auctorité du duc de Guise. Sur le tard arriva le duc de Mayenne pour voir Madame, se trouver avec moy et traicter ce qu'il faudroit faire sur les choses plus pressées, et me semble que je l'ay trouvé plus retenu en ses paroles et avec plus d'ombrage et de soupçons qu'il n'avbit accoutumé ; il entra en mille plaintes, tant pour le regard de l'argent que pour le faict de don Diego. Enfin nous entrasmes sur la matière principale de la convocation des estats, et sur le surplus de l'eslection et déclaration d'un souverain catholique, luy rappelant l'instruction de vostre majesté touchant la sérénissime infante ; à quoy il dit qu'il la serviroit comme il estoit obligé ; mais qu'il estoit nécessaire de gagner plusieurs gentilshommes pour parvenir à ceste fin, me voulant faire entendre que sans cela, rassemblée des états seroit de nul profit. Cependant l'armée espagnole marchait au secoues de Rouen qui jetait de temps à autres ses braves défenseurs dans de périlleuses sorties. Le siège continuait avec persévérance, et les catholiques redoublaient de zèle, en face de cette troupe huguenote et royaliste qui menaçait ses murailles. La population des halles, des métiers, les bouchers, tisserands, les clercs de, écoles, tous couraient aux remparts, maniaient l'arquebuse ou la couleuvrine. S'il y avait des traîtres, des hommes malintentionnés qui songeassent à Henri de Navarre, ils étaient dénoncés par le peuple, frappés par le parlement. Vu par la cour, toutes les chambres assemblées, la requeste présentée par le procureur-général du roy, contenant qu'à l'occasion du siège mis devant ceste ville par Henry de Bourbon, prétendu roy de Navarre, aucuns malaffectionnés estant en icelle, ne séduisent le peuple, la cour faict très expresses inhibitions et defenses à toutes personnes, de quelque estât, dignité et condition qu'elles soient, sans nul excepter, de favoriser en e,ucune sorte et manière que ce sojt le parti dudict Henry de Bourbon, mais s'en désister incontinent, à peine d'estre pendus et estranglés. Et d'autant que les conjurations apportent le plus couvent la ruine totale des villes où telles trahisons se commettent, est ordonné que par les p,ces publiques de ceste ville et principaux carrefours d'icelle, seront plantées potences pour y punir ceux qui seront sy malheureux que d'attenter contre leur patrie ; et à ceux qui descouvriront lesdictes trahisons , encore qu'ils fussent complices, veut la dicte cour leur deslict leur estre pardonné, et leur estre payé deux mille escus à prendre sur l'hostel-de-ville[8]. Et qui aurait osé affronter les arrêts de la cour ! qui aurait osé parler du Béarnais au milieu de ce peuple qui défendait si vaillamment ses murailles contre les gentilshommes et les bandes d'étrangers pillards ! Henri de Navarre laissa un corps de troupes sous le maréchal de Biron, devant Rouen, et à la tête d'une nombreuse cavalerie, il courut harceler l'habile et prudent Farnèse, qui s'avançait en bataille, des frontières de Flandre. A Aumale, la mêlée fut chaude ; les arquebuses et couleuvrines retentirent ; Henri de Navarre s'aventura, comme il faisait toujours, avec sa témérité de gentilhomme, jusqu'au milieu des avant-postes ennemis ; il en revint blessé, échappant à peine aux regimientos espagnols, aux braves lances wallonnes. Le 9 février, le duc de Mayenne annonçait des succès au légat : J'ai eu advis, par un trompette des ennemis, que dans l'escarmouche, à Aumale, le roy de Navarre avoit reçu un coup de pistolet au-dessous, de sa cuirasse, qui lui avoit tout froissé le costé, et en gardoit la chambre ; de façon, monsieur, que cet effect a beaucoup accru le courage des nostres. Nous parlons tous demain pour nous advancer, et ne serons plus esloignés de Rouen que de six petites lieues et fort proches des ennemis. Je ne faudrai de vous donner advis de ce qui se passera entre nous et eux, et Dieu nous fiasse la grâce que le succès en soit à sa gloire et au bien de l'église. L'armée catholique continuait sa marche sur Rouen ; l'avant-garde
obéissait au duc de Guise, à MM. de Le duc de Parme ne négligeait pas ces bons rapports avec
les villes municipales ; il savait toute la force, toute la puissance des
états ; le peuple était pour lui ; ne i'allait-il pas songer à l'élection de
l'infante ? aménager les conseillers et échevins ? La position de l'armée
espagnole, après la délivrance de Rouen, aurait été critique, si le duc de
Parme ne s'était assuré un pont sur Les mouvements de la chevalerie calviniste étaient
particulièrement secondés par les troupes auxiliaires. Jamais Henri de
Navarre n'aurait pu, avec ses seules forces, conquérir une à une les
provinces du royaume de France, étroitement liguées. Que pouvait-il, noble et
pauvre enfant de race, contre cette population active des communes, défendant
ses croyances sur le champ de bataille, aux éclats des couleuvrines et
arquebuses ? Il se vidait sur la terre de France une vaste querelle : le
catholicisme et la réforme s'étaient personnifiés dans Philippe II et
Elisabeth. C'était une guerre d'influence entre l'Espagne et l'Angleterre.
Les Anglais ne pouvaient souffrir l'occupation simultanée de Rien de plus facile que de favoriser les Pays-Bas dans
leur projet d'indépendance. Henri de Béarn n'était pas seulement aidé des forces
militaires de l'Angleterre et de ses subsides ; sa diplomatie était habile à
se procurer partout des auxiliaires. Au siège de Rouen, il parut jusque dans L'ambassadeur réussit complètement. L'histoire de ces
négociations existe encore[10], et les
résultats en furent favorables au développement du pouvoir de Henri IV. Le
sultan soudoyait la révolte des Musulmans d'Espagne, de ces braves Maures qui
n'avaient rien abdiqué, ni leurs mœurs, ni leurs croyances, culte sacré
qu'ils conservaient dans leurs villages dispersés. Les flottes barbaresques
menacèrent les côtes d'Espagne ; elles inquiétaient la tête vieillie de
Philippe II. A chacune de ses victoires, à la nouvelle du plus petit de ses
progrès, Henri IV se hâtait d'en écrire à son allié de Constantinople, pour
appeler des secours et fortifier les liens des traités. Amurat suivait les
campagnes du Béarnais en multipliant les conseils. Dans un long firman,
expédié par ambassade, il lui disait : Vostre
ambassadeur qui est ici nous a baisé les pieds, et nous l'avons reçu et
escouté de bonne grâce. Il nous a dict que vous estiez roy de France, recognu
de tous, et quô vous n'aviez des empeschements que du costé de l'Espagnol,
avec lequel se sont joincts et mis quelques-uns de vos principaux vassaux,
qui vous font la guerre jour et nuict ; il nous a prié de vous aider et
assister ; ce que nous ferons bien volontiers si vous estes vraiment roy de
France, et si les Espagnols s'y opposent. Le sultan fit plus encore :
il mit ses flottes, sous pavillon musulman, à la disposition de Henri IV.
Dans la campagne de Normandie, Henri IV eut encore les secours des Suisses
réformés et des lansquenets d'Allemagne, troupes mercenaires, sans moralité,
et qui couraient là comme des condottieri d'Italie au moyen âge. Henri de
Navarre était resté maître de tout le plat pays de Normandie ; si le duc de
Parme avait atteint son but, la délivrance de Rouen, la chevalerie du
Béarnais, les Anglais auxiliaires sillonnaient en tous sens la plaine, et
cette prise de possession d'une province était proclamée par les
parlementaires comme une signalée victoire. Il fallait favoriser l'impulsion
des esprits et préparer la puissance morale du parti de transaction ; il
existe encore un bulletin tout entier écrit de la main du roi de Navarre sur
ses opérations militaires de Normandie : Du 28
avril. Sa majesté, continuant son dessein de combattre le duc de Parme, usa
de grande diligence pour approcher son armée, et se trouva proche d'icelle
lorsqu'on l'estimait encore bien loin. Sa majesté se logea proche d'Yvetot,
où estoient les ducs de Mayenne et de Guise, qui se retirèrent en grande
diligence, et en furent tués cinq ou six cents sur la place. On a pris
prisonniers le jeune baron de Les moindres succès étaient ainsi exaltés par des
publications qui relevaient les espérances royalistes. On se battait en
braves partisans, en bons chevaliers ; mais on n'avait aucune ville forte
pour appuyer ses mouvements, aucune cité populeuse et de ressource ; on
courait entre Paris et Rouen sans tenir ni l'une ni l'autre de ces grandes
municipalités. Supposez un éclatant succès aux armées catholiques, que
seraient devenus la chevalerie du midi et les étrangers à sa suite, dans des
provinces où les populations prenaient les armes au. son du double tocsin de
l'hôtel-de-ville et de la cathédrale ? De toutes parts on était aux prises.
En Lorraine, le brave duc de Bouillon remportait un avantage sur les catholiques
conduits par le sieur d'Arablize, grand maréchal de la province. Et à
Villemur, que devenaient les entreprises de Joyeuse ? Rien d'étonnant que les
catholiques fussent battus devant une ville zélée réformatrice. Le duc de
Joyeuse, voyant son armée dispersée, fit sonner la retraite ; mais ceste retraite lui fut si mal assurée, que les siens
se croyant poursuivis par l'armée victorieuse, s'enfuirent à l'estourdie et
se précipitèrent dans le Tarn. Le pont qu'il avoit basti estant coupé, causa
la mort de presque tous ses gens d'armes. Joyeuse, au désespoir, ne
put survivre à une si triste défaite ; on le vit, se débattant au milieu de
deux soldats qui voulaient le retenir, se précipiter dans le fleuve à la face
de l'ennemi vainqueur, qui le poursuivait à outrance. Vers la fin d'octobre, le corps de M. de Joyeuse a esté tiré de l'eau
et porté à Villemur pour y estre enterré ; et le Tarn se vit pendant un long
espace tout plein et jonché des testes et des corps de ceux qui avoient eu
recours à un élément si maupiteux. Joyeuse, brave compagnon d'armes,
qui mourait là de désespoir, se trouvait dans ce pays du Languedoc à peu près
en la même situation que Henri de Béarn dans le centre de |