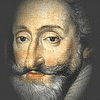LA LIGUE ET
CHAPITRE III. — DÉVELOPPEMENT DE L'UNION MUNICIPALE.
Nouvelle de la mort du duc de Guise à Paris. — Mesures municipales. — Circulaire aux villes. — Élections. — Conseil de l'union. — Magistrats. — Conseil des seize quarteniers. — Prédicateurs. — Déchéance de Henri III. — Gouvernement municipal. — Rapports extérieurs. — Mouvement provincial. — Alliance de Henri III et de Henri de Béarn. — Mort de Catherine de Médicis. — Situation de Paris. — Assassinat de Henri III. — Joie populaire. — Correspondance de la ligue avec l'Espagne. — Les deux rois de France, Henri de Navarre et Charles X. — Opérations militaires. — Arques. — Ivri.1588-1590. La nouvelle du coup d'état de Blois, de la cruelle exécution du duc et du cardinal de Guise, arriva au bureau municipal de Paris comme à vol d'oiseau par un nommé Verdureau, qui eschappa avant qu'on fermast les portes de la ville de Blois ; et depuis a tant couru qu'arriva ledict jour sur les sept à huit heures du soir[1]. Non seulement le noble chef de l'opinion catholique, le vainqueur des reîtres, et son frère le saint, le martyr, le cardinal avaient été lâchement dagués à coups de pertuisane, mais le bon prévôt de Paris, les échevins députés aux états étaient captifs, gardés ès prisons royales. Le messager porteur de cette triste nouvelle était vêtu de noir ; il allait parcourant les rues, criant d'une voix lugubre : Messers les bouurgeois et manants, nous n'avons plus nostre sainct et brave protecteur Henry de Guise et monseigneur le cardinal, son illustre frère. A minuit, les échevins assemblés au bureau de la ville se hâtèrent d'écrire à la famille de Guise, pour lui communiquer le funèbre message. Ils disaient au duc de Lorraine : Monseigneur, vous entendrez par la despesche de M. d'Aumale, le malheureux acte commis en la personne de monseigneur de Guise, ainsi que nous l'avons appris par deux courriers présentement arrivés. Cette nouvelle nous a resduits en telle perplexité et affliction que nous ne vous en pouvons rien représenter. Ce 24e décembre, à minuit, 1588. Paris se hâtait également d'annoncer la fatale exécution à
toutes les villes municipales : Messieurs, nous
venons préalablement de recevoir des plus misérables nouvelles. Deux
courriers, venant de Blois, nous ont assuré que traisteusement l'on tué monseigneur
de Guise, et pris plusieurs autres prisonniers ; pensez là-dessus à la
conséquence, et quel dessein l'on peut avoir sur nostre religion et sur tous
les catholiques. Jamais nouvelle n'avait eu un retentissement plus
soudain, plus universel ; le peuple des halles et des métiers, cette multitude
qui s'était levée tout entière le jour des barricades se réunit tumultueusement
en armes. C'était le 24 décembre, la veille de Noël, dans cette nuit de
prières à la crèche des pastoureaux, devant On n'entendait dans les rues que plaintes et douleurs sur l'horrible
assassinat de MM. les duc et cardinal de Guise. Mille estampes représentant
le martyre dès deux chefs de la maison de Lorraine étaient distribuées dans
la foule ; on y voyait : Les effigies de feu M. de
Guise et M. le cardinal son frère, massacrés pour soutenir l'église catholique
et la loi de nostre sauveur J.-C. ; lombeau sur le trépas et assassinat
commis aux personnes de messeigneurs de Guise qui sont morts pour J.-C. et le
public, et vivront à jamais. Ensuite d'autres gravures représentaient les corps des grands princes de Guise estendus dans une
salle du chasteau de Blois, percés et dagues de mille coups, ayant chacun un
crucifix en la main ; et la démonstration comme Henry de Valois, ce perfide
politique, masqué d'une vie saincte, ayant communié et disné avec lesdicts princes,
les faict tost après tuer et massacrer. Des images, enluminées de
rouge, démontraient comme Henry, le perfide, le
détestable Valois, fait mettre en pièces les corps sanglants des deux princes
martyrs ; puis les faict jetter au feu pour les consumer en cendres ; comme
les deux princes estant morts sont mis tout nuds sur une table, meurtris de
divers coups, et comme Henry de Valois repaissoit ses yeux de ce spectacle ;
et le martyre cruel du révérendissime cardinal, sous l'inhumain tyran qui
sautela d'allégresse et de plaisir en apprenant l'exécution, et crioit bien
fort : Je suis seul roi de France ; je vais remettre sus l'athée, le
libertin, le sorcier, le voleur, et tous les diables. Il n'était pas un sermon, pas une de ces harangues qui
parlaient aux masses, dans laquelle il ne fût question des princes de
Lorraine. Madame de Nemours, la mère du duc de Guise, assistait aux sermons
du petit feuillant ; le prédicateur, se tournant vers elle, s'écria dans son
invocation : Ô sainct et glorieux martyr de Dieu,
bénit est le ventre qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité ! Et
le docteur Lincestre, au milieu de l'église Saint-Barthélemy, exigea de tous les assistants le serment, en leur faisant
lever la main, d'employer jusqu,à la dernière goutte de leur sang et jusqu'au
dernier denier de leur bourse, pour venger la mort des deux princes lorrains,
massacrés par le tyran dans le chasteau de Blois à la lace des estats.
Il imposa un serment particulier au premier président de Harlay, qui, assis
devant lui dans l'œuvre, avait écouté sa prédication, l'interpellant par deux
fois en ces termes : Levez la main, monsieur le
président, levez-la haut, encore plus haut, afin que le peuple le voie.
Et ce peuple vivement ému continuait à briser tous les signes de la royauté,
toutes les marques de son antique sujétion aux Valois, tandis que les crieurs
des villes faisaient retentir les rues d'une multitude de lamentables
histoires : Portrait et description du massacre proditoirement commis au
cabinet et par l'autorité du roy, pendant les estats à Blois, en la personne
de Henry de Lorraine, magnanime duc de Guise, protecteur et défenseur de
l'église catholique et du royaume de France. — Les cruautés
sanguinaires exercées envers feu monseigneur le cardinal. — La vie et
innocence des deux frères, contenant un ample discours par lequel on pourra
aisément rembarre ceux qui taschent d'esteindre leur renom. — Regrets
et soupirs lamentables de Ces lamentations désordonnées n'amenaient aucune forme de
gouvernement, ne prépaient pas l'avenir du mouvement populaire que les chefs
cherchaient à régulariser. Pour bien comprendre la marche et la portée de la
révolution municipale de Paris, il est essentiel de préciser les divers
pouvoirs qui allaient s'y partager l'autorité. Dana l'ordre hiérarchique le
conseil municipal, le bureau de la ville, c'est-à-dire la réunion du prévôt
et des échevins de la cité, tenait l'administration publique, commandait aux
compagnies bourgeoises, réglait les halles, réunissait les métiers. Tous les
mandements pour la police et la bonne gestion émanaient du bureau de C'étaient là les autorités municipales. Sous un titre plus
général et se rapprochant davantage de la royauté, se trouvait le parlement
avec ses grand'chambres et ses présidences. Ce parlement devait jouer un rôle
actif, parce que son autorité était antique dans l'opinion des peuples, et
qu'elle s'étendit au dehors des murs de Paris. La ligue, en l'état du
parlement tel qu'il était composé et sans modifications, ne pouvait compter
sur son appui ; on y avait trop de dévouement pour le roi ; ne savait-on pas
qu'il y avait des présidents, des conseillers qui étaient en rapport avec
Henri III, le tyran déchu, et qui trahissaient la ville et la sainte-union
elle-même ? il fallait un coup de force : on verra que le peuple de Paris
l'essaya. Les autres cours souveraines avaient moins d'importance, et la
ligue mettait moins d'intérêt à les acquérir ; ces cours se montraient
d'ailleurs dévouées. Le premier acte administratif de ce gouvernement
provisoire fut de déléguer le commandement de Paris, l'action militaire, à un
des représentants de la maison de Guise ; M. d'Aumale reçut ce témoignage de
confiance. Comme gage au parti populaire, il confia lui-même En même temps des lettres circulaires exhortaient toutes les villes à demeurer dans de communs sentiments avec les bourgeois catholiques de la cité de Paris : Messieurs, nous sommes advertis que depuis les massacres et autres malheurs arrivés à Blois, plusieurs mal affectionnés à la religion et ne s'en servant que comme de masque pour tromper les catholiques, voQt de villes en autres, semant de faux bruits, déguisant la vérité de cette histoire tragique ; ils veulent persuada que le feu duc de Guise avoit quelque sinistre entreprise sur le roy. C'est un maigre prétexte pour colorer lesdicts assassinats, de dire que M. de Guise avoit une entreprise. Ses comportements ont assez descouvert son intention. Messieurs, c'est chose horrible à penser que la saincte communion ait servi de masque à l'entreprise de telles cruautés, et que les corps ainsi inhumainement meurtris aient esté escartelés et bruslés pour les priver de sépulture. Unissons-nous donc plus que jamais et nous gardons de surprise et de garnisons ; et, nous aidant l'un à l'autre, conservons nostre foy et nostre religion. Dieu nous y veuille tous bien résoudra, encourager et assister. Le bureau municipal de Paris ne resta point en arrière ; il s'associa hardiment à l'union. Et comment en eût-il été autrement, lorsque son ancien prévôt Versons, ayant entendu la nouvelle de la mort des deux princes de Guise, en fut si fort ému qu'il en mourut le lendemain de Noël ? Il étoit tellement ligueur et amateur du duc de Guise qu'il voulut embrasser son portraict avant que de mourir, rappelant bon prince ; et, ayant pris celui du roy, l'appela tyran, le rompit et mit en pièces. Les actes de la municipalité de Paris portaient tous à des mesures d'ordre et de bonne police urbaine : M. le président de Blanc-Mesnil, colonel ; nous vous prions faire et foire faire par les autres capitaines de vostre quartier bonne et exacte recherche présentement par toutes les maisons, hostelleries, chambres garnies et autres lieux de tous les soldats et autres personnes qui s'y trouveront sans adveu, et de ce nous faictes envoyer incontinent vostre procès-verbal. — Il est enjoinct à tous les bourgeois, manants et habitants de la ville, eux aller en personne aux guets, gardes des portes qui se font en icelle de jour et de nuict, et desfense à eux de désemparer la ville sur peine et confiscation de corps et de bien, auxquels bourgeois et habitants est aussi enjoinct de faire venir en ladicte ville, en toute diligence, le plus de grains, vivres et provisions qu'il leur sera possible, pour la fourniture et provision desdicts bourgeois, habitants et autres. — Monsieur le président d'Harneau, colonel ; faictes desfense à tous armuriers, quincailliers et autres qui font trafic d'armes en vostre quartier, d'en vendre aucune à quelle personne que ce soit sans exprès congé de monseigneur le duc d'Aumale ou de nous, sous peine de 200 escus d'amende et de confiscation desdictes armes. — En l'assemblée générale cejourd'hut faicte en la grande salle de l'hostel de ville, M. Rolland, nostre premier eschevin, a amplement fait entendre que pour éviter aux tumultes qui pourroient advenir par le menu peuple, lequel demeurant oiseux et en nécessité, pourroit s'esmouvoir et se mutiner ; il estoit fortement nécessaire de voter quelque médiocre somme de deniers pour subvenir aux plus nécessiteux tant que la misère durera ; partie sera distribuée au menu peuple et partie dans des ateliers et aux ouvriers pour fortification et réparation de la ville. Le fait mis en délibération a esté advisé ; attendu la nécessité présente, l'on doit faire une levée générale sur tous les bourgeois, manans et habitans de la ville, lesquels seront excités à contribuer gracieusement et sans contraincte pour une si juste et sainte cause, et les quêtes seront faictes par les curés et quatre bourgeois. Le bureau municipal de Paris, moins avancé dans la sédition que les seize, les orateurs populaires et les halles ne voulait pas rompre absolument avec le roi, auquel il avait écrit dans des termes de soumission, pour réclamer son prévôt et ses échevins retenus à Blois : Sire, les habitans de vostre ville de Paris s'estant assemblés en très grande et notable compagnie, tant du corps de ladicte ville, des principaux de vostre parlement, chambre des comptes et autres bons bourgeois d'icelle, ont desputé le sieur président Lemaistre[5] pour représenter à vostre majesté les très humbles requestes et supplications dont ils ont esté chçu,és de ladicte assemblée. Et pour l'assurance qu'ils ont qu'il plaira à vostre majesté les entendre bénignement et favorablement, ne ferons la présente plus longue, sinon pour supplier notre Créateur, Sire, vous donner longue et heureuse vie. 28 décembre 1588. Le parlement partageait en majorité ces opinions
d'arrangement et de modération ; il apercevait les périls d'une rébellion
ouverte ; il y avait mille chances de revers ; et alors que deviendrait Paris
dans la révolte ? Le conseil des seize quarteniers, colonels, prédicateurs de
paroisses, n'était pas aussi calme ; le peuple avait déclaré à haute voix la
déchéance de Henri de Valois ; cette voix puissante devait être entendue ;
plus d'arrangement avec Henri, le persécuteur des martyrs ; mais pour cela,
il fallait être maître du parlement , autorité civile et judiciaire, et de Le parlement ainsi organisé dans les intérêts du mouvement
municipal, put sanctionner la question de déchéance qui était alors agitée à Jamais rien de plus populaire que cette résolution de
déchéance. La multitude avait effacé partout, comme pour témoigner de son
affranchissement et de son émancipation politique, les armoiries royales ; Et comment les prédicateurs n'auraient-ils pas multiplié ces larmoyantes histoires, lorsqu'on savait que madame de Guise, la veuve du martyr, écrivait au duc de Nevers une bien pitoyable épître ? J'espère que Dieu aura pitié de moy et qu'il ne me deslaissera jamais en une si juste querelle ; mais qu'il suscitera tant de gens de bien pour se joindre à ceste cause, que bientost je verray une bonne justice de l'assassinat meschant et malheureux commis sur celuy qui n'eut jamais dans l'âme que le service de Dieu et celuy de ce malheureux, cruel, tyran, inhumain, qui, pour me priver de mon mary, a perdu son àme, son honneur et renommée. Pardonnez-moy si je continue à vous importuner de mes plainctes ; je ne puis m'empescher de cela, car estant privée de ce que j'avois de plus cher, il ne me reste que la vengeance que j'ay si empreinte dans le cœur que je ne parle ni ne resve autre chose ; à quoy je vous invite, conjure et supplie de m'assister, et en rescompense je vous offire et présente ma vie, mes pauvres enfants et tout ce qui est en nos puissances pour sacrifier à l'observance de vos commandements, que je tiendrai à jamais chers comme venant de vous, monsieur, que j'aime et honore autant que je recognois y estre redevable. Continuez-moy donc, s'il vous plaist, vostre bonne grâce, et croyez ce porteur qui vous parlera plus particulièrement de ma part. Je me remets donc sur luy pour finir ma lettre, en vous baisant très humblement les mains. Vostre très obéissante sœur, Catherine de Clèves[7]. Ainsi, pour bien résumer la situation de ce mouvement de
la ligue, il y a d'abord manifestation d'opinion publique, puissante,
énergique contre Henri de Valois, opinion prononçant la déchéance de fait
contre la royauté, et effaçant ses armoiries. Puis, elle trouve une
expression régulière dans le conseil municipal de Paris ; elle se fait
violente et désordonnée parmi les quarteniers et dans la chaire. La déchéance
est prononcée par Si à Paris la triste nouvelle du martyre de MM. de Guise, reproduit partout en belles images, avait fait une sensation si vive, si profonde, combien dut-elle être plus puissante encore dans ces cités sans cesse exposée aux attaques et aux insultes des huguenots ? On a vu que le conseil d'union avait écrit maintes circulaires aux échevins, prévôts, maires, majeurs, jurats, pour leur annoncer l'organisation entière de la sainte ligue, et les inviter à se joindre à lui contre le tyran Henri de Valois. La plupart des cités n'avait pas attendu cette invitation pour éclater ; en armes déjà, elles avaient déclaré leur liberté et leur entière adhésion à la foi catholique, au parti municipal qui en proclamait la grande suprématie. Partout le mouvement est marqué de ce double caractère : appel aux vieilles franchises de la cité, aux anciennes formes d'échevinage, élection, maison commune, beffroi, bannière des confréries et métiers ; et puis, esprit catholique, prédication libre et politique ; en un mot, gouvernement de la cité par la cité. Ce retour à la liberté municipale, à ces fédérations de ville à ville, sa fit avec un ordre, un ensemble qui peut même étonner les perfectionnements de la civilisation moderne. A Lyon, la nouvelle de Blois advint trois jours après, et
le conseil municipal se réunit sur-le-champ en une belle et grande assemblée
; il y fut exposé par le doyen des conseillers que
les bons et vrays catholiques de la ville avoient eu grande occasion de
prendre les armes pour se garantir des entreprises malheureuses qui faisoient
sur eux les hérétiques assistés des politiques et machiavélistes, lesquels
avoient si souvent faict desmonstrion de mauvaise volonté. Trouvant moyen
d'empescher nos desvotions accoutumées, qui est de mettre le sainct-sacrement
par les églises où le peuple va en desvotion et procession, sous prétexte
qu'ils disoient que le roy en auroit jalousie et diroit que nous faisons
prières pour les âmes de ces pauvres princes massacrés ; ils firent clorre la
bouche aux presdicateurs, empeschant qu'ils ne disant la vérité, et les
vouloient forcer de soutenir que les massacres, cet acte si meschant et
détestable, avoient esté bien et légitimement faiçt. Ce qui fut l'occasion
que la nuict le peuple se doutant de quelque surprise, se mit en armes de
soy-mesme et sans estre commandé. Et l'on descouvrit des arquebusiers de la
ville s'alloient jetter dans les maisons des politiques pour leur faire
assistance et main-forte. Il y avoit en la ville et dehors des personnes qui
disoient tout haut qu'avant qu'il fust peu de jours l'on pendroit tant de ces
eschevins mutins, qu'il n'y auroit pas du chanvre à demi pour faire des
cordes. Brief, le party catholique est demeuré le supérieur. Les desseins de ces
factionnaires conspirateurs se sont esvanouis comme la poussière au vent, et
nos politiques sont demeurés saisis et mis en un lieu où l'on est assuré qu'ils
ne nous peuvent plus nuire. Quand donc cet exposé eût été bien fait et parachevé, tout d'une voix on délibéra l'union jurée et promise par les consuls, échevins, manants et habitants catholiques de tous les ordres et états de Lyon ; tous s'écrièrent : Nous promettons à Dieu, sa glorieuse mère, anges, saincts et sainctes du Paradis , de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine ; jurons de donner tout notre pouvoir et puissance à la conservation de ceste ville de Lyon, establissement d'un bon et asseuré repos à la descharge du pauvre peuple. Nous voulons entretenir de poinct en poinct l'esdict d'union publié ès-cours de parlement de ce royaume, juré solennellement par le roy en l'assemblée générale des estats, et depuis par lesdicts estats, et n'assister de nos personnes ni moyens ceux qui ont violé et faussé la foy promise auxdicts estats. Ces résolutions, qui se passèrent en conseil de ville, il fallait les publier au dehors, et c'étoit là véritablement la sanction populaire ; le conseil n'hésita pas : A esté ordonné ! que les articles qui ont esté dressés de l'union, seront imprimés et publiés, ensemble la forme du serment que doivent faire tous les habitants de la ville de Lyon, et par ce, est enjoinct à Jehan Pillehotte, imprimeur de ladicte ville, de les imprimer. Faict au conseil tenu en l'hostel-de-ville, le lundi 2e mars 1589, par ordre dudict conseil : Janthonas. La grande ville de Lyon, qui commandait au passage du
Rhône, cette puissante cité, se prononçait donc pour la défense de ses
libertés municipales et du catholicisme ! Plus au midi, Toulouse se jetait
dans la ligue avec cette violence qui avait signalé ses excès lors de Et à Marseille, la ligue avait aussi retenti ; elle s'était facilement formée là : ancienne république, Marseille pouvait-elle repousser un système qui la faisait revenir à ses mille franchises de municipes, au gouvernement de ses consuls, à ses statuts et règlements, à sa maison de ville, à son vieil hôtel de la place Vivaux, à ses maire et échevins ? Déjà une première tentative avait été faite pour rendre
Marseille à sa liberté et à la ligue ; elle avait été déjouée par la force des
hommes d'armes. Depuis, la ville avait été plus heureuse ; et quand la
lettre des MM. les échevins de Paris
arriva pour annoncer la triste nouvelle de Blois et la déchéance de Henri de
Valois, l'hérétique, le tyran, la grande cité n'hésita pas. On se souvient
que la révolution municipale et catholique avait été tentée par le brave
consul Darius ; la partie victorieuse du conseil de ville s'était hâtée de
flétrir dans un tableau qui décorait l'hôtel-de-ville, la mort de l'intrépide
champion des libertés de la cité et de la sainte-union. Plus d'une fois ce
peuple de matelots, de bourgeois et de métiers avait gémi de cette
humiliation qui tournait au profit des huguenots. A peine avait-on publié l'édit
d'union à Blois, que le peuple marseillais prit les armes contre Que dirai-je de Rouen, à la population ardente, et qui la
première suivit le mouvement de Paris ? Le parlement s'unit à toutes les
résolutions du peuple, et avec Rouen, Amiens, Abbeville, Orléans et
cinquante-cinq autres grandes villes, environnées et couronnées de belles
tours à créneaux. Les provinces prirent ainsi parti pour la révolution
municipale de Paris. Le centre de ce mouvement était bien aux tours de
Notre-Dame, à l'hôtel de Alors s'organisait Toute l'histoire dont j'ai recueilli les débris est dominée par la grande figure de Catherine de Médicis, et ceux qui ont suivi avec quelque attention l'immense série des événements de cette époque, l'influence de transaction et de paix publique que la reine exerça, ont dû la placer haut. Tout se heurte, la société est comme un vaste duel de sang, et la voilà, cette femme patiente, active, intelligente, courant d'un camp à un autre, adoucissant les haines, apaisant les ressentiments. C'est la première négociatrice de ces temps de troubles : jeune, elle se sert de ses charmes pour la paix ; vieille à cheveux blancs sur son front large et ridé, elle parcourt en litière les tentes des hommes d*armes, calme les passions, fait tous ses efforts pour empêcher les déplorables batailles ; quand elle ne peut éviter ces batailles, elle les dirige au profit de la modération ; qu'importe qu'elle fit tout marcher vers la grandeur de son pouvoir, qu'elle aimât ce pouvoir, avec idolâtrie souvent ? qu'est-elle cette passion dans les âmes fortes ? la conscience de ce qu'elles valent, le sentiment éprouvé qu'on peut le bien et qu'on veut le faire ; qu'importent encore des faiblesses de femme, des superstitions, des talismans magiques ? la superstition se mêle toujours aux grandes émotions de la vie ; ceux qui voient un peu loin se laissent entraîner à cette terreur de l'immense nature, et petit qu'on est en face de l'univers, on s'agenouille devant ses phénomènes. La vieille chronique nous a conservé quelques-unes des faiblesses de Catherine de Médicis lorsqu'elle se rendait le soir chez Ruggieri, en son oratoire de la place aux Chats ; elle le consultait sur la destinée future de sa race. Un jour ledit Ruggieri l'entoura d'un cercle magique, et tandis que mille têtes fantastiques paraissaient autour d'elle et se reflétaient dans des miroirs noircis, trois petites figures royales parurent sur une table préparée, et l'alchimiste annonça que c'étaient les trois fils de Catherine, tous trois couronnés d'un pesant diadème. Le sieur Régnier, mathématicien, et qui passait pour magicien, était l'inventeur d'un certain talisman que Catherine portait toujours sur elle. On prétend que la vertu de ce talisman estoit pour gouverner souverainement et cognoistre l'avenir, et qu'il estoit composé de sang humain, de sang de bouc et de plusieurs sortes de métaux fondus ensemble, sous quelques constellations particulières qui avoient rapport à la nativité de cette princesse. Elle mourut, Catherine de Médicis ; et cette femme, qui avait réuni tant de grandeurs, fut délaissée à son agonie solitaire. Après sa mort, de laquelle fut parlé diversement, on ne parla non plus d'elle que d'une chèvre morte. Et si quelqu'un s'en souvînt, ce fui plutost pour en détester la mémoire que pour en publier les louanges. Et combien les partis s'attachèrent encore à cette mémoire ! combien de pamphlets sur ses débordements ! les huguenots en avaient déjà tant publié ! Les catholiques ne l'épargnèrent pas ; mais ils en parlaient avec modération, parce qu'ils savaient qu'elle avait gémi de Patientât de Henri Hî sur les Guise. Dans un de ces sermons si ardents qui se répétaient alors aux chaires de Paris. Lincestre fit entendre au peuple la mort de la royne-mère, laquelle, dit-il, a faict beaucoup de bien et de mal, et crois qu'il y a encore plus de mal que de bien. Aujourd'hui se présente une difficulté, savoir si l'église catholique doit prier pour elle, qui a vescu si mal et souvent soutenu l'hérésie, encore que sur la fin elle ait tenu, dict-on, pour nostre droicte union, et n'ait consenti à la mort de nos bons princes : sur quoy je vous dirai que si vous voulez lui donner à l'aventure, par charité, un Pater et un Ave, il lui servira de ce qu'il pourra. Henri III pleura sa mère ; il était alors tout occupé des états-généraux qui poursuivaient mollement leurs délibérations à Blois. La violence exercée contre les Guise avait effrayé cette bonne réunion de nobles, de clercs et de bourgeois ; on ne discuta plus que des questions sans importance ; on fit de la rhétorique, des protestations et peu d'actes. Henri III paraissait encore officiellement à la tête du parti catholique, signait les actes d'union, prenait en main le commandement des armées ; au fond il n'inspirait plus de confiance ; les députés ne songeant qu'à se séparer, ne prêtaient plus aucune force à la royauté des Valois ; et comment les catholiques se seraient-ils associés à un tyran déchu, lorsque les braves ligues de Paris et des bonnes villes bourgeoises tenaient la campagne et menaçaient le roi lui-même ? Dans cette situation, Henri III devait chercher des garanties et des ressources en d'autres forces. Les états-généraux se dissolvaient d'eux-mêmes ; le jour de la clôture il y eut pourtant des harangues. Leurs remontrances, Sire, ne seront pas fardées ni déguisées ; nous sommes à cela invités et contraincts par la franchise des états, par la liberté donnée, la sûreté promise. Nous recognoissons, et publions haut et clair, que le ciel et la nature vous ont libéralement enrichi de ce qui est bien nécessaire pour nous régir et gouverner. Mais le mal a esté que la lumière de vos vertus a esté empeschée et n'a pu jetter ses rayons, ni les faire pénétrer sur la misère et affliction de son pauvre peuple et désolé royaume, par l'artifice et pratique de quelques mauvais conseillers. Les états devenaient chose insignifiante. Les deux forces
actives, vivaces en présence, n'étaient, à vrai dire, que les armées catholique
et huguenote ; l'une sous la conduite des ducs de Mayenne et d'Aumale ;
l'autre sous la cornette blanche du roi de Navarre. En renvoyant les états de
Blois, Henri III s'était hâté de convoquer le ban et l'arrière-ban de la
chevalerie, parmi laquelle figuraient les brayes de Au milieu de deux partis seuls en force, et qui seuls par
conséquent pouvaient en prêter, que devait faire Henri III ? Depuis la
dissolution des états-généraux de Blois, le tiers-parti avait repris toute
faveur auprès de lui ; Henri avait rappelé plusieurs de ses favoris, de ses
jeunes hommes dévoués ; d'Épernon surtout était parmi cette téméraire
jeunesse que les partis extrêmes appelaient mignons. C'était un lien facile
de rapprochement avec le roi de Navarre. D'Epernon essaya dès ce moment de
cimenter l'alliance du roi avec le chef de la gentilhommerie béarnaise. Henri
de Navarre était trop habile pour ne pas comprendre toute la force que
donnerait à son parti l'union avec le roi de France. Non seulement cette
alliance lui assurait la nombreuse chevalerie qui s'armait pour le roi, mais
encore la puissance morale de cette royauté qui parlait si vivement encore à
l'imagination des peuples. Dans la vue de cette alliance, Henri de Navarre
publia un manifeste de tempéraments et de concessions. C'était la constante
politique du Béarnais rusé, comme l'appelaient les catholiques du conseil : Messieurs, quand il me ressouvient que depuis quatre ans
j'ai esté l'argument des tragédies de France, quand de ces yeux que Dieu m'a
principalement donnés pour les avoir tousjours ouverts au bien de ma patrie,
tousjours tendres à ses maux, je suis contrainct de la voir en feu, ses
principaux piliers desjà bruslés, ses meilleures villes en cendre, et qu'encore,
au lieu d'apporter de l'eau, d'estoufler les flammes, on me force à brusler
moy-mesme, ou je serois de tous les insensibles le plus insensible qui fust
jamais, ou bien il faut que mon ame reçoive mille fois le jour des peines et
afflictions que rien ne sçauroit égaler. Messieurs, jamais mon pays n'ira
après moy ; son utilité précédera tousjours la mienne, et tousjours on verra
mon mal, mes dommages, mes afflictions courir devant ceux de ma patrie. Aujourd'huy,
je suis prest de demander au roi mon seigneur la paix, le repos de son
royaume et le mien que j'ai faict jamais. Les guerres n'ont rien diminué de
cela. Que diroient ceux qui m'ont vu courageux, si, honteusement, je quittois
par la peur la façon de laquelle j'ai servi Dieu dès le jour de ma naissance
? Et puis quelle conscience ? Avoir été nourry, instruit et eslevé en une
profession de foy, et sans ouyr, sans parler, se jetter de l'autre costé ?
Non, Messieurs, ce ne sera jamais le roy de Navarre, y eust-il trente
couronnes à gagner. Instruisez-moy, je ne suis point opiniastre ; prenez le
chemin d'instruire, vous y profiterez infiniment ; car si vous me montrez une
autre vérité que celle que je crois, je m'y rendray ; et feray plus, je ne
laisseray nul de mon party qui ne s'y rende avec moy. Messieurs, nous sommes
dans une maison qui va fondre, un bateau qui se perd, et n'y a nul autre remède
que la paix : je la demande au nom de tous, au roy mon seigneur ; je la
demande pour moy, pour tous les François, pour Désormais Henri de Valois entrait en la pleine puissance
des huguenots ; roi nominal, il avait pour maître et successeur le Béarnais
et sa chevalerie aventureuse qu'il conduisait aux batailles. On garda toutes
les formes de respect dans la première entrevue des deux monarques alliés :
le Navarrais semblait abandonner toutes ses méfiances, le roi de France
cachait tous ses dépits. M. le mareschal d'Aumont
vint trouver le roy de Navarre de la part de sa majesté pour le prier de
vouloir passer et aller au Plessis-lès-Tours où sa majesté et toute la cour
l'attendoit, ce que il se résolut de faire tout incontinent ; il y avoit si
grande presse tant de ceux de la cour que ceux de la ville qui estoient
accourus, que leurs majestés demeurèrent l'espace de demi-quart d'heure à
quatre pas l'un de l'autre, se tenant les bras sans se pouvoir toucher, tant
la foule estoit grande. Leurs embrassements et salutations furent réitérés
plusieurs fois d'une part et d'autre, avec une mutuelle démonstration d'une
grande joie et contentement ; l'allégresse et applaudissement de toute
la cour et de tout le peuple fut incroyable, criant tous par l'espace de
demi-heure ; vive le roy ! Le lendemain, le roy de Navarre entra
dedans la ville pour aller donner le bonjour au roy, et depuis visita plusieurs
fois sadicte majesté, prenant ensemble, pour le bien commun du royaume,
plusieurs résolutions. Avec ces formes extérieures de soumission, le
Béarnais n'en était pas moins le maître ; il avait posé de dures conditions
dans le traité, la cession d'une place importante, Saumur, qui lui ouvrait L'alliance impie, aux yeux des catholiques, d'Henri III
avec le roi de Navarre éloignait de pins en plus le roi de France des saintes
et municipales unions de Pans. Une série d'actes de la royauté témoignait
asses qu'elle voulait désormais établir son gouvernement en dehors de cette
turbulence populaire, une première déclaration sur l'attentat,
félonie et rébellion du duc de Mayenne, duc et chevalier d'Aumale, les
frappa dans leur personne et leurs biens ; Paris, Orléans, Amiens et
Abbeville furent comprises dans la même proscription ; elles devaient être deschues de tous estats, offfices, honneurs, pouvoirs,
gouvernements, charges, dignités, privilèges, presrogatives, dons, octroys et
concessions quelconques à elles concédés, sauf si dans le quatorzième jour du
mois de mars prochain, elles recognoissent leur faute et se remettent en l'obéissance
que justement elles nous doivent par le commandement et l'expresse parole de
Dieu, sans laquelle elles ne se peuvent dire chrestiennes. Ces actes étaient dirigés contre l'union établie dans les
villes municipales ; et ne fallait-il pas que la royauté proclamât son propre
gouvernement à rencontre de la ligue ? Un édit de Henri ni intervint, par
lequel la cour de parlement qui siégeait à Paris était transférée à Tours
avec la chambre des comptes. Quelques fidèles magistrats obéirent à cette
injonction royale, et Pasquier fut parmi eux. Le pauvre avocat-général avait
laissé sa femme et ses enfants à Paris, au milieu des réactions de la ligue ;
cette majesté désolée de son ancienne et brillante compagnie, jetait de la
tristesse dans son esprit, du désordre dans ses idées. Quand la chambre des
comptes s'ouvrit solennellement, Pasquier pleura sur les malheurs de Toutefois, quelques magistrats, traîtres à la cité, cherchaient à ménager l'avenir et à préparer leur accommodement avec la royauté exilée ; et parmi eux le président Brisson, dans un acte signé de sa main, faisait la déclaration suivante : Ayant tenté tous les moyens à moy possibles pour sortir de cette ville afin de m'exempter de faire ou dire chose qui pust offenser mon roy souverain seigneur, lequel je veux servir, obéir et respecter toute ma vie et persévérer en la fidélité que Je dois, détectant toute rébellion contre lui, il m'a esté impossible de me pouvoir retirer et sauver, pour estre mes pas observés de toutes personnes, guettés et gardés, à raison de quoy estant contrainct de demeurer en ceste ville et adhérer ès délibérations auxquelles le peuple nous force d'entrer, je proteste devant Dieu que tout ce que j'ay faict, dict et deslibéré en la cour de parlement, et ce que je feray, diray et deslibéreray cy-après, a esté et sera contre ma volonté et par force et contraincte, y estant violenté par la terreur des armes et licence populaire. Ces magistrats pusillanimes étaient des exceptions dans le parlement ; la majorité était pour l'union catholique et municipale, et ne désavouait point en secret ce qu'elle faisait hautement et publiquement. Le premier acte de la ligue, après la déchéance de Henri III, avait été de créer un chef militaire, un homme de guerre et de vaillance, pour conduire les braver bourgeois sous les bannières de la cité ; le duc d'Aumale gouvernait Paris, tandis que le duc de Mayenne conduisait les armées. L'union voulait avoir un chef de modération tout à fait dévoué à sa pensée ; déjà en froideur avec le conseil des seize trop bruyant d, popularité, il était important qu'elle eût dans ses intérêts le lieutenant-général des forces catholiques. Pour bien saisir le caractère de la révolution municipale
de Paris, il est essentiel de rappeler que la population de la grande cité ne
se formait pas d'une seule classe, ayant ainsi une unique représentation. Les
parlementaires, la haute bourgeoisie, se trouvaient plus particulièrement en
rapport avec le conseil de l'union ; la petite bourgeoisie avec le bureau
municipal ; tandis que les balles, les métiers avaient leurs organes ardents
dans les seize quarteniers élus par le choix même de la multitude. Le duc de
Mayenne, l'expression modérée de la maison de Guise, offrait toutes les
conditions que la bourgeoisie et les parlementaires pouvaient désirer. Il
avait de grands talents militaires, de la prudence ; fervent catholique, il
ne repoussait pas les idées de transactions et de ménagements. C'était un
caractère à opposer à Bussy-Leclerc et aux chefs démocratiques de la cité.
Pouvait-il d'ailleurs n'être point agréable an peuple, le brave duc de
Mayenne, le frère da Guise et l'oncle du pauvre petit captif, alors sous la
main du tyran ? La triste veuve du balafré donna le jour à un héritier des
armes et du nom de Lorraine ; le corps de ville de Paris suspendit tout, pour
tenir le petit Tristan (car on appela ainsi
l'enfant orphelin) sur les fonts de baptême ; toutes les compagnies
bourgeoises furent sur pied et faisaient voir combien elles étaient joyeuses
de saluer le rejeton[12] de la grande et
noble famille. Quelque système de modération
que voulût suivre le conseil d'union, il était poussé par le bureau
municipal, surtout par les seize quarteniers ; et des mesures implacables
furent prises contre les habitants qui ne signaient pas la sainte ligue,
conservant l'espérance de transiger avec Henri de Valois. Les rigueurs
étaient bien plus sévères encore envers ceux qui avaient quitté la cité pour
se joindre aux huguenots, soit qu'ils siégeassent dans le parlement à Tours,
en la chambre des comptes, soit qu'ils combattissent avec Henri sous sa
tente. Ces mesures étaient nécessaires sous plusieurs rapports : ne
fallait-il pas jeter une grande terreur dans ce parti de transactions et de
ménagements, toujours prêt à pactiser avec Henri de Valois, le tyran déchu ?
Et puis, on avait besoin d'argent pour la guerre, pour organiser les
compagnies bourgeoises : à qui mieux s'adresser qu'aux politiques, qu'on
imposait au profit des halles et du bon peuple catholique ? De nombreuses
mesures de précautions et de police municipale se succédaient d’autant plus
rigoureuses que, par l'alliance de Henri de Valois et du Béarnais, Paris
allait être menacé d'une puissante chevalerie. Les conseils de l'union et de
la ligue restaient en permanence. De par les prevost
et eschevins. M. le président Du Blanc-Mesnil, colonel ; nous vous prions de
faire faire présentement, par MM. les autres capitaines de vostre quartier,
de bons et forts corps de garde de tous les bourgeois et habitants de vostre
dict quartier, chascun en sa dixaine. — Il
est enjoinct à tous boulangers, pastissiers et autres de cuire présentement
du pain pour subvenir à la nécessité. — Il
est ordonné que les habitants des villages d'Issy, Vaugirard, Montrouge,
Gentilly, Arcueil, Bagneux, Fontenay, Clamart, Chastillon et Meudon prendront
les armes, pour mettre en pièces les compagnies des ennemis qui se
présenteront. — Il est enjoinct à tons
capitaines et soldats, tant de cheval que de pied, de eux retirer dedans
cejourd'huy, heure de midy pour tout deslay, sous les resgiments et enseignes
en l'armée de monseigneur le duc de Mayenne, sur peine de la vie. — Ne faictes faute présentement et sans aucun. deslay
d'assembler tous les mauans et habitans de chascune dixaine de vostre
quartier, pour leur taire entendre qu'il est nécessaire d'ouvrir quelques
ateliers, pour faire travailler un bon et grand nombre des pauvres valides
qui sont en ceste ville, afin que par ce moyen trois choses grandement utiles
fussent faictes et accomplies, dont la première est la charité, par la
nourriture des pauvres ; la seconde, la fortification et réparation de ceste
ville ès lieux et endroicts nécessaires, et la troisième, l'empeschement de
l'oisiveté, mère nourrice de tous maux. — Il
est enjoinct au premier des sergents ou archers de la ville, avec tel nombre
d'autres archers qu'il appartiendra, se transporter en toute diligence ès maisons
de tous les hostelliers, cabaretiers et marchands de vins esquelles ils
sauront y avoir quantité de futailles, desquelles vous arresterez jusques à
la quantité de deux mille pièces pour servir aux barricades nécessaires à la
conservation des tranchées et advenues desdicts faubourgs, dont sera cy-après
faict paiement. — Desfenses sévères sont
faictes à tous espiciers, apothicaires et autres de vendre aucune poix,
résine sèche ou grasse, thérébentine, soufre et autres matières servant à
faire artifice et feu sans notre exprès congé, sur peine de cent escus
d'amende, et plus grande selon le cas. — Il
est ordonné m capitaine Périchon de se saisir des personnes des sieurs
présidents et maistre des comptes Amelot et de les mener à Il régnait au milieu du peuple un sentiment de tristesse religieuse, une atmosphère de pénitence et de miséricorde ; il n'était point permis de se livrer aux fêtes, à ces folies, vieux souvenirs de la cour de Henri III. Le 14 février, jour de mardy gras, se firent de dévostes processions, au lieu des dissolutions et mascarades ; entre autres s'en fit une de six mille escoliers pris dans tous les collèges, dont la pluspart avoient au plus douze ans, qui marchoient nuds en chemise, portant un cierge de cire blanche et chantant bien dévostement. Et chaque jour ces immenses processions pour la liberté municipale sillonnaient Paris, de toutes les paroisses, de tous âges, sexe et qualité, la pluspart en chemise et nuds pieds, quoyquue fist bien froid. Le peuple de la cité demandait la prédication dans les chaires publiques, comme à Athènes et à Rome il courait au Forum, pour entendre ses archontes ou ses tribuns. Le peuple estoit si enragé, s'il faut parler ainsi, qu'après ces dévotions processionnaires, il se levoit souvent de nuict et faisoit lever les curés et prestres de la paroisse pour les mener en procession, comme ils firent à René Benoist, curé de saint Eus-tache, lequel pensant leur faire quelque remonstrance, fut appelé politique et hérétique, et enfin contrainct de les mener processionner. Et ces armes puissantes de la parole, contre qui étaient-elles dirigées ? quel était le but de ces ardentes prédications ? le roi Henri III, le tyran, le Néron qui s'alliait avec les huguenots contre le chef et la tête des villes catholiques de France, la grande et belle cité de Paris. Il n'est sorte de calomnies populaires qu'on ne contât sur Henri III : il se criait mille pamphlets dans les rues comme il arrive toujours contre les pouvoirs renversés. Les Sorcelleries de Henry de Valois, et les oblations qu'il faisoit au diable, dans le bois de Vincennes, avec la figure des desmons d'argent doré, auxquels il adressoit des offrandes, et lesquels se voyent encore en ceste ville. — La vie et faicts notables de Henry de Valois, tout au long, sans rien requérir, où sont contenus toutes les trahisons, perfidies, sacrilèges, exactions, cruautés et hontes de cet hypocrite ennemi de la religion catholique ; esdition seconde, revue et augmentée de plusieurs autres desportemens et apostasies de ce dernier des Valois, lequel néanmoins, par ses abominables faicts, ne peut en rien obscurcir le lustre des prédécesseurs très chrestiens. Les prédicateurs en leurs sermons, exhalaient l'injure contre le roi : Ce teigneux, s'écriait Boucher, est coiffé tousjours à la turque, d'un turban, lequel on ne lui a jamais vu oster, mesme en communiant, pour faire honneur à Jésus-Christ, et quand ce malheureux hypocrite faisoit semblant d'aller contre les reistres, il avoit un habit d'Allemand fourré et des crochets d'argent, qui signifoient la bonne intelligence et accord qui estoient entre lui et ces diables noirs empistolés. Bref, c'est un Turc par la teste, un Allemand par le corps, une harpie par les mains, un Anglais par la jarretière, un Polonais par les pieds et un vray diable en l'âme. Lincestre, en son sermon du mercredi des cendres, avait dit au peuple : Je ne vous prescherai point l'évangile ? c'est chose commune, mais je prescherai la vie, gestes et faicts abominables de ce perfide tyran, Henry de Valois, qui invoque le diable. Et le prédicateur ayant tiré de sa manche un des chandeliers du dit roi, sur lequel il y avait des satyres gravés : Ce sont démons du roy, répétait-il ; ce misérable tyran les adore, il s'en sert en ses incantations ! Faut-il le dire encore ? les cordeliers ôtèrent la tête à la figure de Henri III qui était peint à genoux, priant Dieu auprès de sa femme, au-dessus du maître-autel, et les jacobin, barbouillèrent tout le visage d'une pareille figure du roi qui se trouvait dans leur cloître. Pendant ce temps les années réunies de Henri de Navarre et
du roi de France manœuvraient de concert. Le duc de Mayenne, à la tête de ses
fidèles catholiques, s'était présenté devant Tours subitement ; il était
parvenu à se rendre maître d'un des faubourgs de la ville ; mais Henri III,
retrouvant son ardeur des batailles, le força à la retraite. Depuis, les
royalistes avaient fait de grands progrès : M. de Montpensier remporta une
notable victoire sur les Gottiers, paysans de Normandie, qui avaient pris les
armes pour la ligue, D*un autre côté, le duc de Longueville, secondé par Paris n'ignorait pas ces intentions du roi ; on les
exagérait même pour animer le peuple et soulever ses haines. On. ne peut se
faire une idée de l'état d'irritation où étaient alors arrivés les esprits.
Qui donnait en effet la supériorité aux huguenots ? qui conduisait leurs
années jusque sous les murs de Paris ? n'était-ce pas Henri de Valois ? Ce
maudit tyran était le lien d'union entre une partie des catholiques et des
hérétiques ; en se débarrassant de lui, ne brisait-on pas ce parti impie ? ne
faisait-on pas rentrer dans le giron de la sainte ligue ceux que le concours
du vilain Hérode en avait détachés ? Et ce tyran continuait ses menaces,
rapportées au conseil municipal et au peuple. On racontait que Henri de
Valois se mettait parfois à la fenêtre de son hôtel de Gondi, à Saint-Cloud,
et que là, jetant les yeux sur Paris, il s'écriait : Ce
serait grand dommage de ruyner une si bonne et belle cité ; toutefois ne
faut-il pas que j'aye raison des rebelles qui sont dedans et m'en ont
ignominieusement chassé. Ces menaces s'adressaient aux noms les plus
populaires de la ville, et particulièrement à cette noble dame de
Montpensier, aussi vénérée par la multitude que Henri adressait de son lit de douleur une lettre au comte de Montbelliart : Mon cousin, mes ennemis s'aidant du zèle que je porte à ma religion et du libre accès et audience que je donne à tous religieux, pauvres gens qui veulent parlera moy, et violant sous ce manteau les lois divines et la foy qui doit estre sous l'habit ecclésiastique, ce malin, un jeune jacobin fut amené par mon procureur-général, pour me bailler, disoit-il, des lettres du sieur de Harlay, premier président en ma cour de parlement. Après m'avoir salué et feignant à me dire quelque chose de secret, j'ai faict retirer les personnes présentes, et lors ce malheureux m'a donné un coup de cousteau, pensant bien me tuer ; mais Dieu qui a soin des siens, n'a voulu que je perdisse la vie, et me l'a conservée par sa grâce et empesché ce damnable dessein, faisant glisser le cousteau, de façon que ce ne sera rien, s'il plaist à Dieu , espérant que dans peu de jours il me donnera ma première santé. Quelques heures après, toutes ces espérances de rétablissement s'évanouirent. Le roy, ayant esté porté en son lict bien soigné et médicamenté par plusieurs médecins et chirurgiens, donnait idée de guérison ; mais sur le soir, la blessure s'aggrava de telle sorte, que les chirurgiens n'espérèrent plus le sauver. Quelle tristesse dès lors parmi les braves compagnons de Henri III ! Le parti royaliste crut nécessaire de constater formellement qu'Henri de Valois, le roi très chrétien de France, allait mourir dans les sentiments catholiques ; il ne voulait point, tout en combattant sous les mêmes cornettes, être confondu avec les huguenots qui suivaient Henri de Navarre. Les royalistes catholiques craignaient l'excommunication du pape, et les fulminations contre la mémoire de leur roi ; ils se hâtèrent de dresser et sceller un procès-verbal particulier sur les circonstances de la mort de Henri III, leur maître et seigneur. Qu'on sçache donc que lorsque nostre roy se sentit blessé, il se recommanda tout aussitost à Dieu comme au souverain médecin ; il demanda à son premier chirurgien quel jugement il faisait de sa plaie, afin qu'il ne fust prévenu de la mort sans avoir recours aux remèdes de l'âme, qui sont les sacrements de l'église catholique, apostolique et romaine, à savoir : la saincte communion du corps et sang de Jésus-Christ et extresme-onction, etc. Sur les deux heures après minuict son mal rengrégea si fort, que luy-mesme commanda au chapelain d'aller prendre le précieux corps de Jésus-Christ, afin qu'estant confessé, dit-il, je le puisse adorer et recevoir pour viatique ; il adjouta : Je veux mourir en la religion catholique, apostolique et romaine ; mon Dieu, ayez pitié de moy et me pardonnez mes péchés, disant : In manus tuas, etc., et ce psaume : Miserere mei, Deus, lequel il ne put achever pour estre interrompu par l'un de nous qui lui dit : Sire, puisque vous désirez que Dieu vous pardonne, il faut premièrement pardonner à vos ennemis ; sur quoi il répondit : Oui, je leur pardonne de bon cœur. — Mais, sire, pardonnez-vous à ceux qui vous ont pourchassé vostre blessure ? — Je leur pardonne aussi, et prie Dieu leur vouloir pardonner leurs fautes comme, je désire qu'il pardonne les miennes. Et Henri III expira en disant ces paroles. Un roi de France mourait encore au milieu des secousses de
guerre civile. Henri de Valois n'avait pas encore trente-huit ans ; sa jeune
vie avait été grandement remplie, car à dix-huit ans il avait vaincu à
Montcontour et à Jarnac ; à vingt-deux il régnait en Pologne, à vingt-quatre
en France. Il avait été la véritable personnification de la gentilhommerie de
cour, de cette jeunesse folle, dissipée, passant sa vie au jeu, à la paume,
au bilboquet, à la chasse, aux mascarades et processions ; muguetant filles
et femmes ; puis, courant aux grandes batailles et s'exposant à la mort,
comme s'il se fût encore agi de plaisirs. Avec une plus haute capacité
militaire qu'Henri de Navarre et le prince de Condé, les ayant toujours
vaincus en batailles rangées, il n'avait pas, comme le Béarnais, cette
activité des gentilshommes montagnards, celte force de rudesse qui le faisait
coucher sur la dure en plein air. Les ministres huguenots, toujours pleins
des souvenirs de l'Écriture, aimaient à comparer ses armées à celles de
Darius ; et pourtant cette chevalerie efféminée que conduisait Henri, alors
duc d'Anjou, avait fracassé les dures cuirasses, les brassards épais des
Béarnais et des Allemands. Insouciant, prodigue, Henri pressurait le peuple
au profit de la jeunesse dévouée qui mourait pour lui ; comme sa mère, il
aimait l'éclat et les fêtes, les jeux, les ris, tout ce qui jette quelque
distraction dans une vie agitée. Il était rhéteur, maniait la parole souvent
avec noblesse et facilité. Sa figure n'était pas parfaite ; mais il avait
cette grâce des bonnes manières, ces formes séduisantes qui le distinguaient
même au milieu d'un cortège de brillants jeunes hommes. Indiscret pour les
femmes, conteur d'aventures scandaleuses, il passait sa vie à écouter ce
petit caquetage, ces causeries de mignon, qui babillaient de leurs bonnes
fortunes. Il y avait en lui des charmes, car, entouré de méfiances dans le
royaume de Pologne, il était parvenu à s'y faire adorer. En France, les
haines étaient trop vivaces, et peut-être cette indolence qu'on lui reproche
tenait-elle à la nécessité de ne pas prendre de parti tranché. Les affections
de Henri étaient catholiques ; il avait là commencé sa vie et l'on en garde
souvenir ; il s'était jeté dans les mesures violentes de Les deux grands faits qui avaient dominé tous les rapports
à l'extérieur, pendant les huit mois d'émotions populaires et de dramatiques
mouvements de la place publique, étaient l'assassinat des Guise et de Henri
III, les deux chefs d'opinions armés et alors en lutte. Les relations de
Philippe II avec la maison de Lorraine, ses ambassades officielles auprès du
roi de France, tout dut se ressentir de ces scènes tragiques, dernier coup
que les partis Se portaient dans leurs excès. Le duc de Guise n'avait cessé d'être
jusqu'à sa mort l'expression des intérêts catholiques en France comme auprès
du roi d'Espagne. Tandis que l'enfant du Lorrain, le pauvre captif, restait
en otage dans les mains du conseil de Henri III, le duc de Mayenne était
naturellement appelé à remplacer son frère, ce martyr de la cause religieuse.
Depuis longtemps il s'était mis en rapport avec l'Espagnol, et sous le nom de
Jacobus, il entretenait une correspondance active avec Philippe H et son
ambassadeur à Paris. Quand le duc et le cardinal de Guise tombaient à Blois,
le duc de Mayenne écrivait au roi d'Espagne : Sire,
si nous avions failli au devoir envers nostre roy, je supplie très humblement
votre majesté vouloir embrasser nostre conservation, nous ayder de son auctorité
et de ses moyens, en la poursuicte d'une juste vengeance, et considérer, s'il
luy plaist, qu'on cherche en nostre ruyne celle de la religion catholique et
l'establissement de l'hérésie, au préjudice de la resputation de tous les
princes et potentats catholiques, et principalement de vostre majesté. Sire,
Dieu à mortslré avoir tel soin des siens, que, au lieu de frayeur et
d'estonnement dont on peUsoit que les catholiques dussent estre saisis par le
sang et la mort de nos princes, ils ont pris courage et se sont, avec une
merveilleuse constance, résolus de s'opposer à tous Iq, desseins, violence et
tyrannie du roy, et de ne poser jamais les armes qu'ils n'ayent achevé sa
ruine, sans laquelle ils ne peuvent plus espérer de sûreté pour eux ny pour
la religion, ayant desjà donné un si grand commencement et progrès à leur
juste entreprise que plus des deux tiers du royaume y sont entrés, non
seulement du peuple et des grandes et meilleures villes, mais de la noblesse
et des principaux seigneurs, et de toutes sortes de personnes d'honneur et de
qualité de ceux qui sont les plus zélés à la religion. Défendez donc, s'il
vous plaist, sire, ceste cause, non plus comme la cause d'autruy, mais comme
la vostre, et le royaume vous en aura perpétuelle obligation. J'ay donné au seigneur
don Bernardino, vostre ambassadeur, un mémoire qui contient sommairement
l'estat auquel sont les affaires en ce royaume et la très humble supplication
que nous faisons à vostre majesté de nous secourir. Elle entendra aussi que
le conseil général de l'union des catholiques de ce royaume m'a eslu avec le
titre de lieutenant-général de l’estat et couronne de France, ce que, depuis,
les autres princes et parlement ont confirmé. J'ay accepté ce qui est du
péril, qui est de prendre la charge des armées et de pourvoir aux places où
le besoin le requerroit. Philippe, à San-Lorenzo, avait été profondément
affecté de la mort du duc de Guise, car il sentait toute la portée de ce coup
d'état, capable d'effrayer l'opinion catholique : la sainte union allait-elle
se dissoudre ? les états-généraux allaient-ils s'assouplir sous la main qui
s'était ensanglantée par une résolution si épouvantable ? Philippe II se hâta
de répondre à son ambassadeur à Paris : Don
Bernardino, par vostre dépesche du 25 décembre passé et les détails qui y
estoient joincts, j'ay appris ce qui est arrivé au duc de Guise et au
cardinal son frère, ce que j'ay ressenti profondé : ment, sous tous les
rapports, et plus particuhèrement pour la grande perte que faict la religion
catholique dans ces hommes qui combattoient pour elle avec tant de valeur,
bien quq leur faute ait esté très grande : après tant de raisons qu'ils
avoient de se mesfier, pourquoy se livrer et se mettre à la mercy ? Les uns
et les autres n'avoient qu'à s'excuser en se rejettant sur leurs occupations,
surtout après les advis que vous leur aviez donnés de ma part qui les
préservoient tousjours de ce danger. Pauvres princes ! prions pour eux. Pour
le moment il est impossible d'arrester une résolution et de fonder un
jugement sur les affaires de Tandis que Philippe n hésitait à se dessiner en présence de faits qui n'avaient pas pris couleur encore, le conseiller du roi Henri III, de Fresne-Forget arrivait à San-Lorenzo avec des instructions secrètes. Son but officiel était de présenter des compliments de condoléance sur la mort de Catherine de Médicis ; mais encore pour donner des explications sur la ligue, pure rébellion à laquelle tous les souverains étaient grandement intéressés pour l'exemple et la conséquence qui en résultent. Pour procéder d'une manière précise dans cette affaire avec sa majesté catholique, le roi très chrétien la prie de lui donner son assistance en trois choses : 1° de lui envoyer un secours de trois ou quatre cent mille écus en numéraire pour l'assister dans ses besoins présens ; 2° il demandera aussi que le roi d'Espagne fasse une démonstration publique par laquelle il témoigne qu'il n'est porté, en aucune manière, à favoriser ceux de la ligue ; 3° sa majesté catholique est priée de faire entendre au pape qu'elle est elle-même bien informée que la ligue n'est autre chose qu'une révolte et une cause de division entre les bons catholiques. Le sieur de Fresne demandera le rappel de don Bernardino de Mendoça, pour les diverses raisons qui ont été rapportées à sa majesté catholique, en déclarant de la part du roi son maître que ce prince est déterminé à ne plus traiter avec lui, et de plus l'admettre ni autour de sa personne, ni à sa suite[18]. Tels étaient les doubles rapports de Philippe II avec les chefs de la ligue et Henri III avant sa mort. Rien n'était dessiné précisément. Le roi d'Espagne voulait voir venir les événements, pour se donner le loisir d'étudier la crise politique et de prendre un parti définitif. Ses penchants étaient pour la ligue ; mais avant de la seconder activement, n'était-il pas essentiel qu'elle s'organisât elle-même, qu'elle formât un ensemble et qu'elle témoignât de ses forces ? Sur ces entrefaites, une dépêche pressée de don Bernardino de Mendoça arriva par courrier à San-Lorenzo : Sire, par mes lettres du 30 du passé, j'ay escrit à votre majesté à quel danger et extrémité se trouvoit réduicte la ville de Paris et la cause catholique. Il a plu à Nostre-Seigneur de nous en deslivrer par un événement si heureux qu'on ne peut l'attribuer qu'à sa main toute-puissante, et qui faict espérer qu'on en a fini avec les hérétiques. Un moine de l'ordre de Sainct-Dominique de Paris partit de ceste ville avec la résolution de tuer le roy pour la plus grande gloire de Nostre-Seigneur, ce qu'il a exécuté le 1er aoust, à huict heures du matin ; il a frappé le roy de deux coups de cousteau au bas-ventre, dont il est mort à deux heures de la nuict suivante. Vostre majesté jugera donc si ce peuple a des actions de grâces à rendre à Nostre-Seigneur pour le bienfaict signalé qu'il vient d'accorder à la religion catholique non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Ce qui rend cet événement plus heureux, c'est le descouragement où se trouvoient les bourgeois qui, n'ayant plus d'espérance de secours, refusoient de sortir pour monter la garde aux tranchées, et la disposition où estoient les soldats du duc de Mayenne de passer au roy dans le but de venir piller Paris ; les hommes qui faisoient le service estoient entretenus à force d'argent provenant des marchandises vendues et à force de promesses. Le peu de temps qui me reste ne me permet pas d'exprimer toutes mes pensées à votre majesté ; je le ferai lorsqu'on aura proclamé pour roy le cardinal de Bourbon par la voie des catholiques. Dieu leur fasse la grâce de sçavoir profiter du bienfaict qu'il leur a accordé à eux et à la cause de vostre majesté[19]. C'était pour l'Espagne une situation nouvelle. Le tiers-parti catholique allait s'effacer ; il n'y avait plus en face que deux opinions tranchées. L'organisation des villes municipales s'étendant sur tous les points, la ligue voyait s'agrandir ses forces et sa puissance. Y avait-il encore à hésiter pour Philippe II ? Fallait-il proclamer roi de France le Béarnais, le chef de la chevalerie huguenote, et le roi catholique pouvait-il saluer son implacable adversaire ? La mort de Henri m soulevait tout entière la question de succession à la couronne. La déchéance avait été prononcée à Paris et dans toutes les villes soumises à l'union ; mais le prestige attaché au nom du loi vivait encore, et la ligue n'avait point osé saluer un monarque de son -choix. Henri IH expirait ; le trône était naturellement en vacance ; quelle résolution allait être prise ? choisirait-on Henri de Navarre, hérétique, relaps, excommunié par le saint père ? ou bien ne valait-il pas mieux couronner quelque noble et digne catholique, le descendant de Charlemagne, le rejeton du Balafré si chéri du peuple, vaillant défenseur de la couronne et de la foi en France ? Sous la tente, ces diversités d'opinions s'étaient produites, même parmi les royalistes qui suivaient la cornette de Henri DI, unie alors avec celle de Henri de Navarre. Le Béarnais multipliant les témoignages de la plus vive
tendresse pour le roi défunt, n'avait pas quitté le chevet de son lit, et les
huguenots publiaient hautement et partout qu'avant d'expirer le roi de France
avait désigné Henri de Navarre pour son successeur. Le Béarnais se hâta de
donner avis de son avènement, de faire acte de royauté dans des lettres qu'il
adressa de sa main aux villes et aux officiers qui pouvaient servir sa
fortune ; il disait à M. de Montholon : M. le garde
des sceaux, la mêsme loy et la mesme prud'hommie qui vous ont contenu en la
fidélité que vous avez gardée au feu roy jusques à sa mort, me promettent de
vous la mesme loyauté, à moy, votre roy légitime et naturel par les lois de Quelques instants avant d'expirer, Henri III, en désignant son successeur, lui avait dit : Soyez certain, mon cher beau-frère, que jamais vous ne serez roy de France, si vous ne vous faictes catholique. Vérité profondément sentie ! la monarchie était catholique ; on n'aurait point souffert un roi huguenot ; mais Henri dq Navarre pouvait,il subitement abandonner sou parti, pour se faire encore une fois transfuge ? A la tête de la noblesse calviniste, devait-il trahir ses intérêts, pour apporter une parole incertaine dans un parti qui n'avait pas confiance en lui ? Ce fut dans l'objet de ménager toutes les opinions, et pour s'attirer les royalistes, que Henri de Navarre, tout en gardant sa croyance réformatrice, publia son grand édit de tolérance : Nous, Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, promettons et jurons en foy et parole de roy, à tous nos bons et fidèles subjects, de maintenir et conserver en nostre royaume la religion catholique, apostolique et romaine en son entier, sans y innover ni changer aucune chose, soit en la police et exercice d'icelle ; nous sommes tout prests et ne désirons rien tant davantage que d'estre instruits par un bon, légitime et libre concile général et national, pour suivre et observer ce qui y sera conclu et arresté ; et les estats-généraux d'iceluy royaume seront par nous convoqués et assemblés dedans le temps de six mois. Davantage, nous promettons conserver tous les princes, ducs, pairs, officiers de la couronne, seigneurs et tous nos bons et obéissants subjects indifféremment en leurs biens, charges, dignités, privilèges et prééminences ; finalement d'exposer, si besoin est, nostre vie et nos moyens avec l'assistance de tous nos bons subjects pour faire justice exemplaire de l'énorme meurtre , meschanceté, félonie et desloyauté, commises en la personne de feu le roy Henri III de bonne mémoire, nostre très honoré seigneur et frère. Cette concession s'appliquait aux trois points pour lesquels la ligue était formée : liberté municipale, indépendance des états-généraux, maintien du catholicisme ; et cependant elle n'était point suffisante ! Le parti catholique était trop fort pour n'exister que par concessions ; il voulait dominer, et n'eût accordé qu'avec peine à la réforme cette tolérance que Henri concédait comme une grâce au peuple. Si Henri IV fut salué roi de France par les calvinistes et
ses braves compagnons d'armes du Béarn, la plupart des vassaux attachés à
Henri III déclarèrent qu'ils refusaient de servir un roi huguenot ; plusieurs
quittèrent l'armée, entre autres le duc d'Épernon qui se retira avec toutes
ses troupes dans son gouvernement d'Angoulême. Un tel abandon inquiétait
Henri de Navarre ; seul avec sa chevalerie du Béarn, avec sa gentilhommerie
de montagne, il ne pouvait rien ; il fallait repasser Ainsi le résultat que s'était proposé le conseil de
l'union par l'assassinat de Henri III était accompli : cet attentat avait
dénoué l'alliance impie des royalistes avec les hérétiques ; la mort du roi
contraignait la noblesse montagnarde à se retirer dans les provinces ; Paris
était libre ! Et ce Paris était tout plein de pompes et de fêtes pour
célébrer sa délivrance ; une foule de pamphlets étaient destinés à reproduire
les joies du peuple ainsi débarrassé de l'oppression. Le tyran meschant avait méprisé les seigneurs, desdaigné les princes
haut titrés ; il avoit poussé aux honneur, dès coquinaux etbélistres ;
c'étoit un hypocrite dissimulant son infamie. Voulez-vous sçavoir le
testament de cet exécrable tyran ? à d'Épernon, il luy donne une fluste et
une bougie ; à Ghastillon un fouet pour estre le postillon d'enfer, où gist
l'amiral son père, et la mule de Pacolet, qui avoit été le varlet de madame
sa mère. Il existe encore une multitude de gravures reproduisant la
mort du roi hérétique sous mille formes diverses d'abord : L'hermitage préparé pour Henry de Valois ; un monstre
effroyable, la gueule béante, entouré de nuages épais, est la peinture de
l'enfer ; Henry de Valois est au milieu de deux diables desguisés en
capucins, qui le conduisent dans le susdict hermitage. Ensuite : Le portrait des charmes et signes de sorcellerie de Henry
de Valois, ni du nom, où se voyent une trentaine de cercles au milieu
desquels sont gravés certains caractères hébreux, grecs et latins ; les uns
estoient contre tous dangers, contre le tonnerre et la tempeste, pour
surmonter les malins esprits, pour commander aux diables, ou contre les
serpens ; les autres pour se faire aimer des hommes et des femmes, pour ne
point estre trahi et ne point craindre les phantosmes. Puis, venait l'adjournement faict à Henry de Valois pour assister aux
estats tenus aux enfers, où l'on voyoit un diable à longue queue, huissier
infernal, louchant la main à Henri III. Que d'éloges pour le saint,
pour le brave martyr qui armé d'un couteau avait tranché la vie à l'Hérode
couronné ! Les théologiens et prédicateurs
crioient au peuple dans leurs sermons que ce bon religieux ; qui avoit enduré
la mort si constamment pour libérer Et que de bénédictions n'adressait pas le peuple h la sainte mémoire de Clément ! quelle joie ne portait pas au cœur des halles cette mort de Henri de Valois ! On n'avait plus affaire qu'aux huguenots ; plus de souverain tiède et politique ; on pouvait élever un roi véritablement municipal et catholique, un roi de la sainte-union ! En envisageant cette question de succession royale, plusieurs noms devaient également y prétendre : si l'on eût suivi l'avis de messieurs les quarteniers et seize colonels, on aurait prolongé l'interrègne, parce qu'en l'absence de la royauté, le pouvoir municipal grandissait, et qu'en définitive l'autorité restait dans leurs mains ; mais le conseil régulier de l'union, les gros bourgeois, les parlementaires, ne voulaient pas de cet interrègne, et pour échapper à l'autorité arbitraire des quarteniers, ils désiraient un roi catholique, défenseur de leurs immunités. Oh ! si le bon duc de Guise, le brave et digne balafré, eût vécu encore, si le peuple des barricades avait pu saluer sa belle et grande figure, le roi eût été tout trouvé ; les halles, les métiers, les corporations eussent entouré le chef de guerre qui savait mourir pour elle ; mais ni lui ni le cardinal de Guise n'existaient plus ; son fils aîné, l'héritier de des titres, était captif des huguenots dans le château de Tours ; le duc de Mayenne ne pouvait être élu roi à sa place, et d'ailleurs, homme modéré, il n'inspirait pas assez de confiance aux halles ; Mayenne avait déjà la lieutenance générale du royaume ; il gardait une couronne et ne pouvait la poser sur son front ; jamais il n'eût pu se mettre en égales prétentions avec son neveu, l'illustre héritier du guerrier populaire, du martyr catholique. La concurrence de l'Espagne n'existait point encore.
Philippe II pouvait revendiquer la succession des Valois, par son troisième
mariage avec Elisabeth de France, fille de Henri II et de Catherine de
Médicis ; c'était, comme on le voit, l'abolition de la loi salique. Lorsque
le peuple de Paris, au temps des Bourguignons, salua l'Anglais Henri V pour
son roi, il n'avait tenu compte de cette loi surannée ; pourquoi n'en était-il
pas autant aujourd'hui pour l'Espagnol ? Mais ce parti n'était pas très avoué
; les forces de Philippe II n'étaient pas assez considérables à Paris,
quoique plein d'agents secrets de San-Lorenzo. Ce prince favorisait alors
l'élection du cardinal de Bourbon, parce qu'en définitive elle ne pouvait
être qu'une mesure provisoire qui laissait tous les droits en suspens. Commandeur Moreo, écrit-il à un de ses agents à
Paris, la nouvelle de la mort du roy Henry III m'est
parvenue ; mais si on doit s'en réjouir sous un point de vue, encore faut-il
faire juger aux catholiques que le moment est devenu propice pour résister
aux hérétiques que conduit la main du Béarnois. Ce qu'il y auroit de plus
advantageux pour nostre saincte cause, seroit de nommer de suite un roy
catholique et aussi intéressé à la conservation de la ligue que Test le
cardinal de Bourbon : vous le sçavcz assez du reste. Autrement, il va en
résulter une confusion dans les opinions, à la faveur de laquelle le Béarnois
s'introduira dans Paris. Ce seroit là le pire des maux, auquel vous devez
vous opposer par tous les moyens en vostre pouvoir[21]. Le choix du cardinal de Bourbon était donc une transaction et un moyen terme pour accorder toute chose ; ce fut une idée parlementaire qui laissait l'avenir libre de tout engagement. On pouvait, avec indépendance, se tourner à droite et à gauche ; le cardinal était sans lignée ; on reconnaissait les droits de la maison de Bourbon ; on en éloignait les membres hérétiques ; le duc de Mayenne restait lieutenant-général du royaume ; le duc de Guise, mineur, pouvait prétendre à la succession. Le cardinal de Bourbon n'était pas sans capacité ; tète à ménagements, il ne pouvait braver aucun parti ; il était doux de caractère et dévoué catholique. Cependant Henri de Béarn lui faisait éprouver de durs traitements. Tandis qu'on le faisait roi, le pauvre cardinal écrivait aux princes de Condé et de Conti : Mes neveux, on nous a adverti de nous tenir prest à partir d'icy demain au matin pour aller en tel chasteau qui sera desclaré par les guides et escorte. Je suis prisonnier ; et le danger où je me vois me faict entrer en désespoir. Si vous ne vous employez à ce dessein, chacun pensera que je suis abandonné de tous les miens, desquels j'ay dû espérer consolation et support. Adieu, messieurs mes neveux. Dieu vous veuille conserver. Le cardinal fut élevé à la dignité royale, ou, pour parler plus exactement, proclamé roi par la succession directe et naturelle : le parlement et le conseil d'union reconnurent ce principe, qu'à l'exclusion de Henri de Bourbon, rejeté par hérésie, son oncle arrivait à la couronne de plein droit ; tous les sujets devaient lui prêter serment de fidélité ; tous étaient tenus de lui donner aide d'argent et d'armes pour le délivrer de la captivité, comme autrefois tous les sujets du domaine de saint Louis avaient contribué à la rançon du roi aux mains des infidèles en Palestine. Le nouveau roi prit le nom de Charles X ; il fut reconnu par toutes les villes de l'union catholique et municipale ; il y eut fêtes et pompes pour son avènement. Personnification du catholicisme, le cardinal de Bourbon fut très populaire ; il fit tous les actes de la royauté, battit monnaies, rendit quelques ordonnances. Dans un scel royal, d'une dimension vaste, le cardinal de Bourbon est reproduit revêtu de ses habits royaux, sa couronne d'or sur la tète, tenant le sceptre et la main de justice ; sa figure est douce et grave ; il y a en lui tout à la fois du sacerdoce et de la dignité de roi : il semble que le graveur ait voulu reproduire cette dernière pensée de l'union catholique, à savoir, que le plus grand progrès de ses opinions était d'élever un prêtre, un cardinal, l'expression de l'église romaine, sur le trône. Pourtant, le conseil de l'union se maintint sous son règne, parce que le catholicisme et la cité voulaient conserver leurs garanties et que le roi était captif. Toutes les formes municipales furent soigneusement préservées ; les quarteniers et colonels gardaient leurs pouvoirs. Tandis que le duc de Mayenne, lieutenant-général du royaume, portait les armes en dehors de Paris, le conseil de l'union et le bureau de la ville prenaient des mesures de surveillance et de répression politique. En quittant Paris, le lieutenant-général publiait une déclaration pour exhorter les bons catholiques à se réunir : En attendant la liberté et présence du roy nostre souverain seigneur, admonestons, requérons, prions et exhortons tous princes, prélats, officiers de la couronne, seigneurs, gentilshommes de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, de se joindre, réunir et rallier avec nous, soit pour porter les armes contre les hérétiques, ou se retirer en leurs maisons, esquelles nous leur permettons revenir et demeurer ; à cette fin nous les avons pris et prenons en nostre protection et sauvegarde. Il ne leur sera rien reproché du passé, et tous descrets, sentences et jugemens qui pourroient avoir esté donnés contre eux, sont et seront comme non avenus ; et, pour ce faire, accordons aux susdits le délai d'un mois. Il y avait donc en France deux têtes couronnées ; l'une
saluée par la brave et rude chevalerie de province, l'autre élue par les
catholiques et les villes municipales ; l'une, royauté des gentilshommes ;
l'autre du peuple : elles allaient se trouver en présence dans la lutte. Et
cette royauté de Charles X, de ce prince captif des huguenots, était
immédiatement reconnue par Philippe II, qui écrivait encore à son ambassadeur
don Bernardino de Mendoça : Sa majesté se resjouit
sincèrement de l'eslévation au throsne du cardinal de Bourbon ! elle félicite
don Bernardino des secours qu'il luy a prestes en toute circonstance, et il
ne doit rien négliger pour que Charles X puisse librement exercer ses
fonctions royales. Il faut exhorter tous les gentilshommes et villes
catholiques de France, de la part du roy, à demeurer unis et d*accord pour le
bien commun. Le cardinal de Bourbon, en acceptant la couronne, doit maintenir
et accomplir ponctuellement toutes les conditions de la ligue. Que tousjours
on maintienne dans sa charge supresme de lieutenant-général du royaume, le
duc de Mayenne ; c'est un dédommagement bien mérité par les peines qu'il a
prises et les succès que luy doit la cause saincte. On doit honorer également
la personne du duc de Guise présent, comme le méritent la mémoire et le sang
de son père et de son oncle, martyrs tous deux de la religion. L'ambassadeur
ne manquera pas d'insinuer adroictement les droicts de l'infante, droicts que
luy ont acquis les alliances et mariages de familles royales ; il
revendiquera les autres droicts qui ont esté ravis à la couronne d'Espagne.
Mais tout cela doit estre dict sans importance, avec une bonne dissimulation[22], pour sonder le terrain et les esprits, et voir quel
effect cela produira, sans toutefois indisposer personne. Puis, est écrit en post-scriptum de sa main même de Philippe II : Le bruit court que le Béarnois auroit l'intention de se convertir..... ! ! mais que les catholiques se tiennent en garde contre ceste prétendue sincérité ; qu'ils n'admettent point la conversion, sans se consulter entre eux, sans demander au pape surtout s'il ne pense pas que c'est le loup qui veut se revestir de la peau de la brebis[23], pour faire ensuicte un carnage plus grand et plus sûr parmy les catholiques. Dès que Henri de Bourbon s'était déterminé à passer Venise avait conservé de nobles et bons rapports avec Henri III ; elle tenait à cette alliance, auxiliaire essentiel contre l'Espagne, Rome, Naples et l'Autriche, ses naturels ennemis ; et puis, le sénat avait souvenir de cette magnifique et joyeuse réception du roi de Pologne au milieu des lagunes de Venise, de ces fêtes de gondoles et d'amour, où Henri III s'estoit esbattu d'une manière si agréable. A la mort du dernier des Valois, Henri, son successeur, écrivit son avènement à la république, sa fidèle alliée. Ce ne fut qu'après deux jours de délibération dans le sénat que les Vénitiens reconnurent enfin Henri IV, malgré les efforts des ambassadeurs du roi d'Espagne, du duc de Savoie, du nonce du pape. Quelques sénateurs étaient d'avis de ne pas trop se hâter, pour ne point offenser le pape qui avait excommunié Henri ; mais le grand nombre l'emporta. La politique de Venise lui faisait regarder le rétablissement de la puissance française comme l'équilibre sur lequel le repos de l'Europe était fondé. La république ordonna à Jean Moncenigo, son ambassadeur, de se rendre à Tours auprès de Henri, pour le complimenter sur son avènement à la couronne, et elle déclara en même temps au sieur de Maisse, ambassadeur de Henri ni à Venise, qu'il pouvait demeurer auprès d'elle jusqu'à ce que le nouveau roi eût fait connaître ses intentions. La résolution du sénat fut apprise par le peuple avec une grande joie ; elle détermina au même parti les ducs de Mantoue et de Ferrare, qui firent l'accueil le plus favorable au duc de Luxembourg, passant alors pour se rendre à Rome où il était envoyé auprès du pape par les catholiques royalistes. A côte de l'alliance de Venise et de quelques petits
princes d'Italie, il en survint une autre plus curieuse, mais qui était d'un
grand poids alors dans le mouvement européen. L'empire musulman, cette haute
tête que le moyen âge catholique n'avait pu abattre dans les croisades,
s'était élevé à toutes ses splendeurs aux quinzième et seizième siècles !
Ennemi naturel du roi d'Espagne et de la maison d'Autriche, il avait cherché
ses plus antiques alliés en France et les avait trouvés depuis François Ier.
Le sultan ne pouvant reconnaître la ligue, qui aurait jeté la couronne de
France dans le mouvement espagnol, Amurat se tourna vers Henri IV, et un
firman en lettres d'or lui fut adressé : Amurat, par
la grâce du grand Dieu, très grand empereur de Constantinople, de Syrie,
Asie, Arabie, Jérusalem, Europe, seigneur de la maison des Ottomans, et de
tous les princes d'Asie et d'Afrique, souverain dominateur de la mer ; à toy
Henry de Navarre, issu de la race invincible des Bourbons ; je désire salut
et heureuse lin pour ce que tu ès très clément et débonnaire et que tu as
esté délaissé en bas âge ; la renommée a esté jusqu'à nous de la grandeur de
ton courage, magnanimité, et que don Philippe de la maison d'Autriche,
favorisant aucun de tes ennemis, tasche de te priver de la succession légitime
qui t'appartient au royaume de France qui est de nostre alliance et
confédération, en haine de ce que tu délestes les faux services dos idoles,
très desplaisantes au grand Dieu, pour tenir purement ce que tu tiens qui est
le meilleur du monde ; je te fais assavoir qu'ayant en horreur cette cause
qui ne tend qu'au profit particulier de ceux qui se sont eslevés contre toy,
je veux prendre la protection et tellement dompter la follie de tes ennemis
et de l'Espagnol qui t'occupe injustement le royaume de Navarre dont tu
portes le titre, qu'il en sera mémoire à jamais, et te rendant victorieux, je
veux te restablir avec ma puissance redoutable par tout le monde, au grand
espouvantement de tous les roys, ayant moyen de les réduire en telle
extresmité qu'ils ne te feront jamais ennuy. Il m'importe de savoir si tu l'as
pour agréable ; et pour assuré tesmoignage de ma bienveillance en ton
endroict, je t'enverray deux ; cents voiles surgir au port de Aiguemortes
aussi promptement que la nécessité le requerra[25]. La situation de
Henri IV ne lui permettait pas de refuser des auxiliaires aussi puissants ;
mais comment cette alliance avec les infidèles allait-elle être jugée par le
parti catholique, par les ferventes âmes qui brûlaient du même esprit que les
pieux pèlerins du douzième siècle marchant à Le duc de Mayenne était sorti de Paris avec son armée de
communes et de gentilshommes catholiques et marchait à son tour vers Par une pointe rapide et secrète, toute l'armée de Henri
de Navarre se porta sur Paris ; les faubourgs furent pris et pillés : A l'aurore du premier jour de novembre, ils furent
tellement attaqués, qu'en moins d'une heure ils furent tous emportes avec
meurtre de sept ou huit cents hommes de ceux qui estoient venus à la
desfense, perte de quatorze de leurs enseignes et prise de treize pièces de
canon, tant grosses que petites. Ces malheureux faubourgs furent
abandonnés à là fureur des soldats ; un affreux pillage suivit les scènes de
sang. Henri de Navarre entra dans le faubourg Saint-Jacques sur les huit
heures du matin, et s'avança jusqu'à la triste tour de Nesle baignée par les
eaux de Dans ce péril de leur cité, les bons habitants de Paris
prirent unanimement les armes. Pourtant, que de mesures de précaution avaient
été prises ! De par les prevost des marchands
et eschevins de la ville de Paris, M. d'Aubray, colonel au quartier de Sainct-Severin
; nous vous prions et ordonnons que pour la garde et sûreté de cette ville,
vous envoyiez par chascun jour, trois compagnies bien armées de bourgeois,
aux remparts et tranchées qui sont depuis la porte neuve jusques à la porte
de Montmartre, pour y faire bonne garde durant le temps que les ennemis
seront ès environs de ladicte ville[26]. Il est enjoinct aux habitans de Malgré ces précautions, les faubourgs furent pillés par
les troupes royales unies aux Anglais ; le respect pour les églises, si
impérieusement commandé par Henri de Navarre, tenait À la nécessité qu'avait
ce prince de ménager le parti catholique. Quelques braves et dignes
gentilshommes de cette opinion étaient restés sous sa tente ; il voulait se
lès attirer, grouper autour de lui tout ce qui n'était pas ligueur inflexible.
Henri de Navarre avait plus besoin alors que jamais de valeur et de politique
; le territoire sur lequel il combattait était tout dévoué à une foi
religieuse qui n'était pas la sienne ; au moindre engagement, les communes
prenaient les armes et tombaient sur les huguenots au son du tocsin. Ainsi, à
cette valeur innée dans son âme éprouvée par tant de fatigues, Bourbon joignait
cette conviction profonde de la nécessité de vaincre ; c'est ce qui explique
souvent ces beaux désespoirs au milieu des batailles qui ont rendu célèbre le
nom du Béarnais et lui assurèrent la victoire. D'ailleurs, Henri n'avait qu'à
montrer à quelques gentilshommes ses cornettes blanches pour commander la
guerre. M. de Mayenne, au contraire, devait concerter ses opérations
militaires avec le conseil de l'union, les parlementaires, les bourgeois, les
quarteniers ; et cela donnait à ses mesures militaires de l'hésitation et de
l'embarras ; on avait des idées de trahison, des volontés téméraires ; à sa
place, le général le plus consommé eût pu faire ainsi des fautes ; et puis,
les communes parleuses et bourgeoises pouvaient-elles résister à la rude
chevalerie des montagnes, si pleine de vigueur et d'énergie ? Ces
circonstances expliquent la plupart des victoires de Henri de Navarre ; ce
prince n'avait aucune tactique ; Biron et Si l'entreprise d'Arques n'avait point réussi, l'armée du
duc de Mayenne n'en était pas moins restée forte ; c'était seulement pour
elle un coup manqué, comme la pointe de Henri de Béarn sur Paris. La retraite
de l'armée catholique en Picardie n'était destinée qu'à favoriser sa jonction
avec quelques bandes espagnoles envoyées par Philippe II ; rien n'était
décidé. Un corps de onze cents lances, sous les ordres du comte d'Egmont,
marcha de L'argent manquait au duc de Mayenne, et comme son armée active comptait des mercenaires mécontents, cette circonstance jetait du désordre dails toutes ses opérations. Le 7 mars 1590, le duc de Mayenne écrivait au commandeur Moreo, l'agent du roi d'Espagne auprès de l'armée confédérée : Je vous conjure, au nom de Dieu, de vouloir venir en la plus grande diligence qu'il vous sera possible avec l'argent, et en attendant escrivez auxdicts estrangers pour les assurer du payement[27]. Et le 9 mars il ajoutait : Comme j'estois sur le poinct de marcher aux ennemis et lever le siège de Dreux, je viens de recevoir une nouvelle protestation de nos Suisses. Jugez, je vous supplie, la peine en quoy je suis, et combien ce m'est de désespoir de cognoistre le peu de secours que je reçois en ceste extresmité. Je vous en ay adverty et importuné mille fois, et ne vois pas que vous en preniez le soin que mérite l'importance de l'affaire. Ces peines, ces inquiétudes, le duc de Mayenne les exprimait quelques jours avant la bataille d'Ivry, qui décida la question militaire de la campagne et avança si puissamment la question politique de la succession à la couronne. L'armée du duc de Mayenne était supérieure en nombre, car il fut jugé qu'ils estoient plus de quatre mille chevaux et de dix à douze mille hommes de pied. Henri, aidé du maréchal de Biron, avait dressé son plan de bataille, et son armée, divisée en sept escadrons, présentait l'effectif suivant : Le premier escadron, sous les ordres du mareschal d'Aumont, pouvoit estre de trois cents bons chevaux flanqués de deux régiments d'infanterie ; le second, commandé par M. de Montpensier, avoit le mesme nombre de chevaux ; à sa gauche, quatre ou cinq cents lansquenets ; à sa droite, un régiment de Suisses ; la cavalerie légère, forte de quatre cents chevaux, estoit non loin de l'artillerie qui se composoit de quatre canons et deux couleuvrines ; le quatrième escadron, ayant pour chef le baron de Biron, comptoit deux cents cinquante chevaux ; le cinquième escadron estoit celuy du roy, fort de six cents chevaux rangés sur cinq rangs, et entouré de quatre bataillons de Suisses et des régiments de ses gardes ; le mareschal de Biron commandoit le sixième, fort de deux cent cinquante chevaux et de deux régiments d'infanterie ; le septième enfin estoit l'escadron des reistres, ayant aussi deux cent cinquante chevaux et entouré d'infanterie. Le prince de Conti arriva peu après avec sa troupe de cavalerie et quelque infanterie. Les deux armées se rencontrèrent à Ivry, près Dreux, quelques jours après les tristes lettres du duc de Mayenne ; et le 15 mars 1590, elles étaient en présence. Le combat s'engagea terrible : l'armée catholique s'était développée sur une hauteur ; les treize cents lances de Flandre formaient un escadron épais où brillaient les cornettes du duc de Nemours et du chevalier d'Aumale ; deux régiments suisses, couverts par de l'infanterie française, s'étendaient en corps de bataille. L'armée de la ligue, dit le récit officiel, estoit plus chargée de clinquants d'or et d'argent sur les casaques ; celle du roy l'estoit plus de fer, et ne se pou voit rien voir de plus formidable que deux mille gentilshommes armés à nud, depuis la teste jusques aux pieds. L'affaire commença par une canonnade de M. de L'armée du Béarnais, victorieuse, poursuivit le duc de
Mayenne et ses troupes en déroute jusqu'aux portes de la ville de Mantes qui
servit de refuge aux vaincus. Les catholiques éprouvèrent des pertes immenses
: la retraite, faite sans aucun ordre, leur fut surtout meurtrière ; rien ne
put résister à cette ardeur de la victoire qui animait la gentilhommerie
huguenote. Le résultat du combat était décisif ; il donnait une puissance
morale à l'armée calviniste ; il effrayait Paris, en fortifiant le parti
politique qui envisagea dès lors un terme au pouvoir municipal, par
l'acceptation de la royauté de Henri de Navarre. La bataille d'Ivry livrait
d'ailleurs |