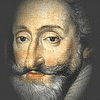LA LIGUE ET
LETTRE SUR L'ADMINISTRATION POLITIQUE DE HENRI IV.
|
A M. LE COMTE DE J'ai à raconter les derniers jours se la ligue, la ruine de cette vaste association provinciale et catholique, de ce gouvernement des municipalités, des confréries, des congrégations saintes et populaires. La lutte est à sa fin ; le principe de l'hérédité monarchique et de la prééminence des gentilshommes va triompher. Il n'y a plus dans la ligue cette effervescence des masses, ce dévouement des grands jours du siège de Paris et des processions municipales : le principe s'affaiblit ; Henri IV vient d'adhérer à la société catholique par sa conversion ; il sollicite à Rome, et il est prêt d'obtenir son absolution religieuse. Autour de lui se groupent les parlementaires dévoués, la haute bourgeoisie, timide et pressée de repos ; une fraction du peuple qui n'en peut plus de la vexation des hommes d'armes et des batailles civiles. Que trouve-t-il en face ? Non plus ce grand parti populaire, ce gouvernement énergique des Seize, alors proscrits par la faiblesse des classes intermédiaires, mais un pêle-mêle d'intérêts égoïstes et brouillons, personnifié dans ce duc de Mayenne, homme tout de chair et d'ambition, se posant comme l'héritier du principe de la ligue, voulant la couronne et n'osant rien pour l'obtenir. Je considère le duc de Mayenne comme le plus pitoyable caractère de cette époque. Le parti populaire l'inquiète et l'importune ; il s'en débarrasse, et prête main-forte au parlement et à la bourgeoisie, qui veulent reprendre l'autorité, passée dans les mains énergiques des confréries. Une fois ce parlement et ces bourgeois maîtres du pouvoir, Mayenne s'alarme encore de la tendance inévitable vers la restauration de Henri IV ; il brise avec ce mouvement d'opinion et veut retourner au parti populaire ; celui-ci a ses souvenirs et ses répugnances, et peut-il oublier que c'est Mayenne qui a fait pendre au haut des tours du Palais les braves quarteniers qui défendirent Paris lors du siège ? Les méfiances s'accroissent ; Mayenne, qui n'ose confier Paris à un chef militaire du peuple, le donne à M. de Cossé-Brissac, et M. de Cossé-Brissac ouvre les portes de Paris à Henri IV. Il y eut ici un peu de la faute de tout le monde. Quand une cause marche à sa décadence, les moindres accidents deviennent des dangers pour elle : la ligue en était là. Il aurait fallu une tête ferme et puissante, et déjà la vieillesse commençait à glacer cette grande figure de Philippe II, qui du fond de San-Lorenzo avait dirigé la pensée de l'association catholique. Le roi d'Espagne manqua de la prévoyance habile qui sait choisir les instruments de ses desseins et les met en rapport avec les besoins de la situation. Les trois ambassadeurs qu'il avait à Paris n'étaient point à la hauteur de leur tâche ; tous étaient hommes à petits moyens, à intrigues diplomatiques plutôt qu'à conceptions vastes et à résolutions décisives ; préoccupés de leurs querelles avec le duc de Mayenne, ils ne secondèrent pas assez efficacement le mouvement de la multitude ; ils ne firent de la cause catholique qu'un accident pour le triomphe des droits de l'infante, tandis que l'élection de l'infante ne pouvait être qu'une conséquence du principe, et non le principe même. Le duc de Feria est un caractère actif, un esprit subtil et vigilant, toujours entraîné par le sentiment de son importance personnelle et par cet orgueil castillan qui blessait les instruments de la ligue, spécialement la grande famille de Lorraine et les parlementaires. J. B. Taxis est plus conciliant ; il s'entend même assez bien avec le duc de Mayenne, et sa mission auprès de lui n'aboutit pas, comme celle du duc de Feria, à un duel chevaleresque ; mais Taxis n'est qu'un agent secondaire ; sans moyens pour agir, il dépend du duc de Feria, et n'ose rien faire sur sa propre détermination. Ibarra est le plus actif de tous. Commandant des forces militaires, il veille avec une admirable puissance d'esprit à tous les besoins d'une situation délicate. Ibarra n'a sous lui que quelques régiments napolitains ou wallons, et Paris lui est confié ! il est en face de toutes les intrigues, sous les ordres de M. de Brissac qui trahit, du parlement qui proscrit les étrangers, delà garde bourgeoise qui est fatiguée des Espagnols. Ibarra brave tous les dangers ; il sent qu'il n'est pas assez fort pour empêcher la catastrophe ; il la prévoit, et son admirable dépêche à Philippe II sur la surprise de Paris par Henri IV, témoigne de cette activité infructueuse en présence de la trahison. Dans ce perpétuel conflit d'intérêts, Henri IV devait triompher. Il était alors à la tête du parti huguenot, puissante chevalerie, de tous les gentilshommes royalistes et fidèles sous Biron ; il était appelé par les arrêts du parlement, appuyé sur son abjuration de Saint-Denis, et par les vœux de la classe bourgeoise. La trahison de M. de Brissac fut amenée par la force des choses dans les guerres civiles, il est des époques où tout le monde veut en finir ; si le gouverneur de Paris n'eût pas livré la ville, un autre accident l'aurait donnée à Henri IV. Le parti énergique étant désarmé et sans influence dans les affaires publiques, la garnison espagnole étant insuffisante, la bourgeoisie devait appeler nécessairement une restauration. Comme elle redoute le pouvoir des basses classes, et qu'elle ne peut pas tenir longtemps l'autorité sans mettre partout de la faiblesse et des tracasseries, elle se tourne naturellement vers un principe protecteur, et ce principe, c'est l'autorité forte et incontestable d'une hérédité de race. Du jour où les seize quarteniers furent proscrits, l'avènement de Henri IV devint inévitable. C'est de cet instant que commencent les soucis de la
royauté. Tant qu'on est aux champs de guerre, on se bat loyalement contre
l'ennemi qui est en face. On n'avait pas le temps de songer aux intrigues
quand les balles espagnoles sifflaient dans les panaches flottants. Mais
voici Henri IV et sa chevalerie à Paris. L'entrée du Béarnais n'excite aucun
enthousiasme ; elle se fait de nuit, au milieu des gardes et des
parlementaires cherchant vainement à provoquer quelques acclamations
publiques. Le lendemain il y a un peu plus d'entraînement : Henri manifeste
sa catholicité et s'agenouille à Notre-Dame ; que va-t-il faire de l'autorité
? Quelle sera la direction de son pouvoir ? Le voilà accablé sous mille
obstacles, aura-t-il la force de les surmonter ? Il faut pacifier les
provinces, car Paris n'a point tout donné à Henri IV : Quels sont les moyens qu'emploie Henri IV pour pacifier le royaume agité ? Avec une pénétration profonde, il voit d'abord que le parti catholique, c'est la société, société antique si Ton veut, mais forte encore de sa constitution formidable, de ses éléments d'action et d'énergie populaire. €e parti règne dans la majorité des provinces ; il est sous l'influence de chefs puissants, de grandes races qui naguère prétendaient à la couronne. Henri IV n'hésite pas. Dans les temps de tourmente et d'effervescence publique, la corruption est un moyen impuissant, parce que l'âme vivement agitée s'exalte avec désintéressement pour le soutien d'une grande cause. Les époques sanglantes ne sont jamais des époques avilies ; on est trop occupé de sa vie et de ses passions pour songer à' une position ambitieuse ; mais au temps d'affaissement et de décadence, alors les marchés arrivent ; chacun advise à sa fortune. Le roi comprit cette situation des esprits ; et voilà pourquoi il acheta une à une les provinces et les consciences, les hautes têtes ligueuses et les grandes cités. Une fois le marché fait, Henri IV put compter sur la toi des gentilshommes qui s'étaient compromis. La politique de l'avènement fut toute catholique ; il n'y eut que quelques proscriptions commandées par les circonstances et le mouvement naturel de la restauration. Après l'attentat de Châtel, les fidèles de Henri IV voulurent épurer le parti ligueur ; les Jésuites furent renvoyés, la prédication interdite ; cela n'eut qu'un terme. Un gouvernement a besoin de se fondre avec la société,
s'il veut se maintenir, et ceci explique toutes les concessions que fit Henri
IV au parti social, c'est-à-dire au catholicisme. Les deux éléments qui
avaient fondé la restauration de Henri, les royalistes de Biron et les
huguenots de Gondé, de Bouillon, de Mornay et de Sully, furent mécontents de
cette conduite. Quand on examinera de près le procès de Biron, à mesure qu'on
touchera les faits révélés par les pièces contemporaines, on se convaincra de
cette vérité : c'est que l'ingratitude de Henri IV envers l'ami de sa cause,
cette froide et cruelle persévérance qui demande au parlement une tète couverte
des lauriers d'Arqués, d'Ivri, est motivée par une pensée de sûreté
politique. Les gentilshommes royalistes, qui avaient servi Henri IV aux jours
de ses malheurs, s'indignaient de se voir oubliés et méconnus par le prince
qu'ils avalent élevé sur le pavois ; leurs nobles épées avaient protégé les
droits de la famille du Béarn, et maintenant ils se croyaient sacrifiés à
ceux-là mêmes qui avaient combattu Henri IV ! D'Épernon commandait en
Provence, et on lui arrache sa province pour la donner à Guise, le fils et
l'expression de la sainte ligue ; Biron avait conquis Quant aux parlementaires et à la bourgeoisie, ils furent
un peu désenchantés de leur enthousiasme pour Henri IV. L'administration du
roi fut travailleuse, pleine de sollicitude pour la prospérité publique ;
mais elle n'eut point de résultats populaires. Les partis étaient vivaces
encore ; l'oubli du passé ne fut pas tellement complet que les ligueurs ne
dussent être inquiets du nouveau règne. Il suffit de parcourir les registres
et les monuments du temps pour se convaincre de combien d'attentats la vie de
Henri IV fut menacée. Tout murmurait, les halles, les métiers, la judicature
même, qui avait cru voir dans l'avènement du Béarnais le retour de l'âge d'or
des lois et des franchises. Henri fut plutôt le roi des gentilshommes que le
roi du peuple : il avait un mépris militaire et chevaleresque pour les
bourgeois et les hommes de robe ; enfant des armes et de la conquête, il ne
pouvait souffrir les remontrances de la bourgeoisie et des parlements qui
venaient s'interposer entre lui, ses projets et ses plaisirs. C'était le
prince féodal, vainqueur de la commune, le brave et digne Gascon des temps du
Prince Noir et de la domination anglaise dans C'est dans les relations extérieures que Henri IV conserve une immense supériorité. Jamais prince ne posa mieux que lui la question européenne et ne la suivit avec une plus infatigable activité. Les registres de ses négociations, que j'ai compulsés page à page, confirment la haute opinion que la postérité a conservée de lui ; quelle sagacité dans le choix des hommes ! quelle réunion d'envoyés à têtes plus sérieuses, plus promptes à concevoir, plus persévérantes à exécuter ! Les noms du duc de Nevers, de Villeroy, Bellièvre, Sillery, d'Ossat, Duperron, Bongars, Sancy, Savary de Brèves se mêleront éternellement aux actes de la paix de Vervins à l'absolution de Henri IV, grande affaire du temps, à la pacification des provinces et à l'édit de Nantes. C'est à Henri IV qu'il faut reporter la lutte systématique contre la maison d'Autriche, ces essais de guerre contre la monarchie universelle de Charles-Quint et de Philippe II. La mort vint l'enlever à un mouvement militaire que sa royale pensée légua à Richelieu. On s'apercevra dans la dernière partie de ce travail que j'ai puisé à des sources nouvelles qui n'ont point été explorées dans mes premiers volumes. Le règne de Henri IV sort du mouvement général de la ligue, et doit être étudié par des documents spéciaux. Les manuscrits de Béthune et Colbert sont riches pour l'histoire des négociations avec l'étranger : c'est une belle collection de dépêches, de pièces autographes, dans lesquelles il faut également chercher la vie intime de Henri IV, la pensée de ses œuvres, la cause de ses soucis. Je ne sache rien en Europe de comparable aux manuscrits de Béthune, tous composés de pièces originales de la main du roi ou revêtues de sa signature : lettres, instructions aux ambassadeurs, tout s'y trouve réuni. C'est dans cette double collection Colbert et Béthune, et dans les vieux fonds Dupuy, les manuscrits de Saint-Germain, Saint-Victor, Notre-Dame, les cabinets de Gagnières et de la bibliothèque de Gange, que j'ai ramassé les documents nouveaux du règne de Henri IV. J'ai également recueilli à Florence quelques pièces essentielles sur Marie de Médicis, et j'ai dû, dans un récent voyage, comparer les archives du Vatican aux documents si remarquables des archives de Simancas. J'achève maintenant ma tâche, œuvre de patience et de
recherches laborieuses. J'ai pensé qu'en histoire les opinions passaient, et
qu'il ne restait pour les générations de l'avenir que les pièces
authentiques, sorte de bulletin officiel des idées et des passions d'un antre
âge. Voilà ce qui explique l'abondance des matériaux que l'on trouve dans cet
ouvrage. Établissant d'ailleurs un système nouveau qui heurte et brise toutes
les opinions antérieures, j'ai dû ne procéder qu'avec des pièces
contemporaines et des témoignages incontestables ; l'ai voulu tout voir par
moi-même, et les lieux que je décris, et le fond de la pensée de chacun des
gouvernements qui agitèrent Rome, 3 octobre 1836. |