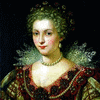GABRIELLE D'ESTRÉES
ET LA POLITIQUE DE
HENRI IV
VIII. — La Ligue.
- Henri III dans le camp des Huguenots (1583-1586).
|
2° Ce fut donc un essai de politique habile de la part de Henri III de se déclarer chef de la Ligue[3] ; par là il voulait annuler la popularité du duc de Guise, sa domination sur les Catholiques, tentative impuissante, car la multitude a plus de cœur que de raison ; elle aime passionnément et ne se confie qu'à ceux qu'elle aime. Henri III soulevait toute espèce de soupçons ; il n'était ni assez austère, ni assez dévoué pour inspirer confiance ; Catherine de Médicis avait toujours été considérée comme l'amie, la protectrice des Huguenots, ou au moins comme la tête de ce tiers parti qui leur avait tant concédé. Il arriva que par une circonstance fatale, partout où se portait l'armée royale de Henri III, contre le prince de Condé ou contre le roi de Navarre, elle subissait des échecs ou n'obtenait que des succès douteux, tandis que le duc de Guise, toujours victorieux, sauvait le pays ; or, les Catholiques en concluaient facilement que Henri III n'apportait pas toute la vigueur et la sincérité nécessaire à leur cause, et souvent même qu il la trahissait. Les liens de Le grand Henri de Guise dagué, Après la triste et sanglante exécution des Guises à Blois, il ne restait plus à Henri III qu'une résolution à prendre c'était de se réunir à Henri de Béarn, et de conduire sous sa tente les royalistes qui servaient encore sous sa bannière. Bonne fortune pour le Béarnais qui jusques-là, malgré sa bravoure, malgré quelques victoires obtenues à l'aide des reîtres, des lansquenets et des Anglais n'était pas beaucoup avancé dans ses affaires[6] ! Avoir le légitime roi de France, sous sa tente, c'était une immense force pour les Calvinistes, le but de la conspiration d'Amboise était en partie atteint ; indépendamment des forces personnelles et royalistes que Henri III menait avec lui, on avait des moyens de négocier, d'attirer à soi les esprits incertains, les ennemis nombreux de la famille de Guise ; l'arrivée de Henri III au camp des Gascons valait une victoire pour le Béarnais qui l'accueillit comme un sujet reçoit son prince. Henri de Navarre en profita pour se livrer à ses goûts, à ses distractions, à son amour immodéré des femmes. A cette époque les deux passions de sa vie était toujours la belle Corisandre (Madame de Guiche) et Madame de Liancourt (Gabrielle d'Estrées), qui toutes deux servaient sa politique de fusion ; souvent après un combat donné, au milieu d'un siège d'une ville, Henri quittait ses compagnons d'armes pour courir aux genoux de ses maîtresses, et cette vie dissipée faisait murmurer les Huguenots austères ; mais Henri avait tant de bravoure, il réparait si bien le temps perdu qu'on n'osait pas se plaindre haut ; Corisandre de Guiche, comme Gabrielle d'Estrées, fort dévouée à la cause commune, fournissait avec une générosité sans pareille de l'argent et des armes[7] ; l'une et l'autre vendaient les coupes de leurs bois, les produits de leurs fiefs pour fournir aux dépenses de la guerre, et les compagnons de Henri savaient l'utilité de ces dévouements. Les pamphlets ligueurs dénonçaient ces amours adultères et
s'en indignaient avec l'esprit tout populaire des multitudes ; la laideur
proverbiale de Henri de Béarn était reproduite sur des gravures, et on le
peignait sous les traits d'un bouc ou d'un satyre, symbole de sa vie désordonnée
et immonde[8].
Les ordres religieux, sauf les Augustins et les Génovéfains,
étaient très-prononcés pour La véritable héroïne de ces scènes émouvantes fut la
duchesse de Montpensier (Catherine de Lorraine
de la maison des Guise) ; Henri de Béarn l'avait courtisée et aimée
comme toutes les femmes de la cour de Catherine de Médicis ; mariée au duc de
Montpensier, elle avait au cœur deux haines profondes : les Coligny et Henri
III ; les Coligny avaient fait lâchement arquebuser le plus grand des Guises,
son père, devant Orléans, par Poltrot, et Henri III avait frappé de coups
d'épée et de poignard ses frères, aux États de Blois[10]. Entourée de ces
funérailles, n'expliquait-on pas son deuil, son ressentiment, son esprit de
vengeance ? C'est pourtant cette héroïne qu'a tant raillé la satyre
Ménippée[11],
obscur et plat recueil, moitié universitaire, moitié huguenot ! Quand Paris
se défendait avec héroïsme, quand les chefs du peuple se faisaient bravement
tuer pour la cause commune des corporations et métiers, trois où quatre
avocats ou universitaires cachés dans une obscure maison du quartier
Notre-Dame, tournaient en ridicule le populaire dénombrement de la cité qu'on
a depuis appelé la procession de La duchesse de Montpensier fut une héroïne ; comme la mère des Gracques, toujours vêtue de deuil, elle avait eu son père et ses frères assassinés, elle conduisait ses neveux, pauvres orphelins, au milieu des barricades, idolâtrés du peuple de Paris qui avait adopté les héritiers du grand nom de Guise : on pouvait bien lui pardonner d'avoir sur elle des ciseaux d'or pour faire la tonsure à Henri de Valois ; et comme les Guises descendaient de la race de Charlemagne, là duchesse de Montpensier pouvait se souvenir que le grand chef des Carlovingiens avait fait tonsurer et jeter dans un cloître les derniers des Mérovingiens. Ce qui paraît étrange à ceux qui n'étudient le passé qu'avec les idées du jour, était simple, naturel, à cette époque de croyance et de luttes. Quand une dynastie ou une cause s'efface, il n'est sorte d'absurdités et de calomnie qu'on ne jette contre elle ; les grands poètes de l'antiquité n'avaient-ils pas dit : Malheur aux vaincus ! |