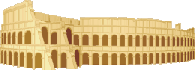LA FIN DU
LIVRE TROISIÈME — Conséquences de l’éducation païenne sur les auteurs chrétiens
CHAPITRE IV — COMMENT LES ÉLÉMENTS SACRÉS ET PROFANES SE SONT FONDUS ENSEMBLE DANS LE CHRISTIANISME.
— I —Lutte des souvenirs de l’école et des sentiments chrétiens chez saint Jérôme. - Sa polémique avec ceux qui lui reprochent de trop citer les auteurs profanes. - De quelle façon et à quelles conditions il pense qu’un chrétien peut se servir de l’antiquité païenne. - Les déclamations et les consolations chrétiennes. Il serait facile de pousser beaucoup plus loin cette étude. Comme je l’ai déjà dit, parmi les chrétiens qui appartenaient aux classes lettrées de l’empire, il n’en est presque aucun chez qui l’on ne retrouve l’influence des deux enseignements qu’ils avaient reçus, celui de l’école et celui de l’Église. Partout nous les verrions vivre ensemble sans parvenir à se supprimer, et, suivant les époques et les circonstances, dominer alternativement l’un sur l’autre. Quand on est jeune, c’est d’ordinaire l’école qui l’emporte. Saint Cyprien, en écrivant la lettre à Donatus, ne peut oublier qu’il vient d’être professeur ; il développe, il amplifie ; il fait des tableaux et des tirades ; il travaille son style avec complaisance[1], il imite tantôt les larges périodes de Cicéron, et tantôt les phrases hachées de Sénèque. Plus tard la foi prend le dessus, mais l’école résiste, et il s’ensuit souvent des luttes sourdes ou violentes entre les deux principes opposés. Il n’y a personne chez qui ces luttes soient plus visibles
et plus fortes que chez saint Jérôme. Dans sa jeunesse, il étudia y les
lettres avec passion : il était dans sa nature de ne rien faire à demi. Les
leçons de Donatus, son maître, l’avaient enflammé pour la grammaire ; il prit
ensuite tant de plaisir à déclamer, qu’on peut dire qu’il déclama toute sa
vie. Il lut tous les auteurs profanes, et s’en pénétra si profondément qu’il
lui fut désormais impossible de les oublier. La foi, qui vint par-dessus,
quelque ardente qu’elle ait été, n’effaça rien des souvenirs et des
admirations de sa jeunesse. Quand il s’enfuit au désert, il eut soin
d’emporter sa bibliothèque avec lui ; elle ne comprenait pas seulement La lettre où saint Jérôme racontait son aventure courut le grand monde de Rome et y obtint beaucoup de succès. Plusieurs de ceux qui la lisaient faisaient sans doute un retour sur eux-mêmes et n’avaient pas de peine à se reconnaître dans ce lettré incorrigible qui ne pouvait se soustraire au charme de ses premières études. C’était donc une leçon que saint Jérôme leur donnait, et dont les plus dévots cherchaient à faire leur profit. Pour ajouter à l’effet de son récit, il ne manque pas une occasion de reprendre ceux qui, comme il l’avait fait lui-même, accordent trop d’importance aux livres classiques. Il s’emporte contre les évêques ou les prêtres qui mêlent les grâces de la vieille rhétorique à leurs sermons, comme s’il s’agissait de parler dans l’Académie ou le Lycée[3], ou qui donnent à leurs enfants une éducation toute païenne, leur laissent lire des comédies et chanter les chansons des mimes[4]. L’étude des auteurs profanes ne lui semble pas compatible avec celle des livres saints : Qu’ont de commun, dit-il[5], Horace et les Psaumes, Virgile et l’Évangile, Cicéron et les apôtres ? Le malheur est qu’il ne pratique guère pour son compte les conseils qu’il donne aux autres. Lui qui trouve qu’Horace et le Psautier, Virgile et l’Évangile ne se conviennent pas, il les mêle ensemble à tout propos. Les souvenirs des écrivains païens se glissent partout chez lui même dans les ouvrages où ils paraissent le moins à leur place[6]. Il semble qu’il re puisse pas s’en défendre ; ils assiègent sa mémoire, ils arrivent, presque sans qu’il s’en doute, sous sa plume. Dans la lettre même où il s’accuse humblement d’avoir trop mis de rhétorique en conseillant la retraite à Héliodore et semble disposé à faire pénitence de tous ces souvenirs d’école, il ne peut s’empêcher de, citer successivement Thémistocle, Platon, Isocrate, Pythagore, Démocrite, Xénocrate, Zénon, Cléanthe, puis les poètes Homère, Hésiode, Simonide, Stésichore, Sophocle, sans compter Caton le censeur et les autres[7] : c’est un débordement d’érudition païenne. Toute cette antiquité classique lui est si familière que c’est elle qui se présente d’abord à son esprit, lorsqu’il est le plus ému, elle qui semble être l’expression naturelle et spontanée de ses sentiments. Quand il visite les catacombes, l’impression que lui causent le silence religieux de ces longues galeries et les alternatives effrayantes de lumière et de ténèbres se traduit aussitôt par un vers de Virgile : Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent. C’est encore un vers de Virgile qui lui vient à l’esprit lorsqu’il nous décrit les désastres de l’invasion et qu’il désespère de pouvoir tous les énumérer : Non
mihi si linguæ centum sint, oraque centum, Ferrea vox.... Il trouve tout dans Virgile, même le moyen de dépeindre les ruses et les subtilités du tentateur : Hostis,
cui nomina mille, Mille
nocendi artes, et la pendaison de Juda Et
nodum infelii lethi trabe nectit ab alta. Dans le désert, lorsque des moines jaloux le poursuivent, le tracassent, et veulent le chasser de sa misérable cellule, c’est encore dans un vers de Virgile que sa plainte s’exhale Quod
genus hoc hominum, quæve hunc tam barbara morem Permittit patria ?[8] On n’en finirait pas si l’on voulait indiquer tous les emprunts que fait saint Jérôme non seulement à Virgile, mais à Cicéron, à Salluste, à Horace, à Juvénal, à Plaute, à Térence, et même à Ennius et à Nævius. On comprend que cette manie de citer à tout moment les auteurs profanes ait à la longue exaspéré quelques dévots scrupuleux. Ses ennemis — il en avait beaucoup — en prirent occasion pour l’attaquer. Rufin, qu’il appelait un scorpion et un pourceau, lui rappela ce songe qu’il avait si complaisamment raconté à tout l’univers, et l’accusa de n’avoir pas tenu les promesses solennelles qu’il avait faites. En vain saint Jérôme prétendait-il, pour se défendre, que sa mémoire était seule coupable, que s’il avait promis de ne plus lire les auteurs païens, ce qu’il n’avait plus fait depuis quinze ans, il ne s’était pas engagé à les oublier, son tenace adversaire lui prouvait que ses affirmations n’étaient pas tout à fait exactes. Comme il avait longtemps vécu dans son intimité, il avait aperçu serrés, dans son portefeuille, des ouvrages de Platon et de Cicéron : n’était-ce pas pour les lire qu’il les gardait ? Pouvait-il nier d’ailleurs qu’il eût enseigné la grammaire aux enfants dans le monastère de Bethléem, et était-il possible de le faire sans leur expliquer les grands écrivains classiques ? Saint Jérôme, qui était bien forcé d’en convenir, se contenta de répondre qu’après tout il n’avait promis qu’en rêve, et que les promesses de ce genre n’étaient pas de celles qu’on fût forcé de tenir quand on était réveillé. C’est à d’autres, dit le pieux Tillemont, à juger si cette réponse est assez solide ; et il déplore que les plus grands saints ne soient pas exempts d’un peu de faiblesse humaine. Saint Jérôme me paraît mieux inspiré quand il ose avouer le cas qu’il fait des auteurs profanes et qu’il soutient résolument que ce n’est pas un crime de s’en servir pour la défense de la vérité. Cette opinion est exprimée dans divers endroits de ses ouvrages, surtout dans la lettre qu’il a écrite à Magnus, professeur d’éloquence à Rome[9]. Ce rhéteur s’était étonné, comme beaucoup d’autres, que saint Jérôme invoquât si souvent l’autorité des païens dans des livres de théologie chrétienne ; il lui répond qu’on voit bien qu’il est absorbé par l’étude de Cicéron et qu’il n’ouvre guère les livres saints, que Moïse et Salomon ont fait des emprunts à la sagesse grecque ; que saint Paul a cité des vers d’Épiménide, de Ménandre et d’Aratus ; puis il ajoute[10] : Il est dit, dans le Deutéronome, que, lorsqu’on veut épouser une femme captive, il faut d’abord lui raser la tête et les sourcils, lui couper les poils et les ongles, et qu’on peut ensuite s’unir avec elle. Est-il surprenant que moi aussi, charmé de la grâce et de la beauté de la sagesse profane, j’aie voulu en faire une israélite, de servante et d’esclave qu’elle était ? Après en avoir retranché tout ce qu’elle avait de mortel, tout ce qui sentait l’idolâtrie, l’erreur, les agréments coupables, ne puis-je pas, en m’alliant avec elle, la rendre féconde pour le Seigneur ? C’était donc une sorte de traité de paix que saint Jérôme
se proposait de conclure entre l’antiquité classique et le christianisme. Il
croyait qu’avec quelques modifications et quelques accommodements il était
possible de les employer tous les deux à une oeuvre commune. En réalité, il
n’a jamais fait autrement, et il n’est aucun, de ses ouvrages où ces deux
éléments contraires n’occupent leur place. Même quand il se croit obligé de
malmener ses anciens maîtres, et d’appeler Platon un sot[11], il ne cesse de
s’inspirer de leurs ouvrages, il en imite les expressions et les idées, il en
reproduit en partie le fond et la forme. Ces déclamations qu’il aimait tant
lorsqu’il était jeune, il y revient dans son âge mûr. Ses lettres contiennent
des controversiæ véritables, notamment
cette violente invective contre une mère et sa fille, l’une veuve, l’autre
vierge, qui se sont consacrées au Seigneur, et ne vivent pas d’une manière
qui soit conforme à leur état. Dans un sujet chrétien, il emploie sans
scrupule tous les procédés de la vieille rhétorique, et ne s’en cache pas,
puisqu’il dit lui-même que c’est vraiment un exercice d’école[12]. L’antiquité
païenne se retrouve encore plus dans ces longues pièces qu’il a composées au
sujet de la mort de Blæsilla, de Népotianus, de Paula, de Fabiola, de
Marcella ; elles tiennent à la fois de l’éloge funèbre et de — II —Ce que saint Augustin se proposait de faire après sa retraite de Cassisiacum. - Comment il changea de dessein. - Ce qu’il pensait, à la fin de sa vie, des auteurs profanes et des services qu’ils peuvent rendre. - Saint Ambroise. - Usage qu’il fait de l’antiquité païenne dans tous ses ouvrages. - Conclusion. Saint Augustin avait sans doute un dessein semblable, au moins à l’époque de cette retraite de Cassisiacum dont je parlais tout à l’heure. Il semble bien, quand on lit les Dialogues philosophiques, qu’il ait essayé alors une sorte de conciliation entre les deux esprits différents qu’il trouvait en lui. La manière dont il vivait dans la villa de Vérécundus nous paraît singulière : rappelons-nous comment une part y est faite à l’homme ancien et à l’homme nouveau, au professeur et au chrétien. Le matin, après avoir fait la prière, on se met à expliquer Virgile ; dans les entretiens, on cite saint Mathieu et Platon ; on chante les psaumes de David, et l’on célèbre Pyrame et Thisbé ; on cherche dans saint Paul des arguments pour se livrer avec plus d’ardeur à la philosophie. Gardons-nous de croire que ce mélange singulier révèle seulement la confusion d’une âme qui se connaît mal, et où se mêlent sans qu’elle s’en aperçoive des tendances contraires ; c’est un système arrêté. Sans doute ; après de longues luttes et de cruels déchirements, saint Augustin s’est décidé à croire sans preuve[14]. Cependant il ne lui suffit pas de croire, il veut comprendre ; la foi ne lui paraît solide que si elle s’appuie sur la raison, mais la raison a besoin d’être exercée pour atteindre la vérité, et c’est dans les écoles qu’elle s’exerce, par l’étude des sciences profanes, par l’usage de la dialectique, par la connaissance de la philosophie. Aussi ne se contente-t-il pas de tolérer l’enseignement des écoles, comme faisait Tertullien, il le recommande. La pratique des études libérales, dit-il dans un de ses Dialogues[15], pourvu qu’on la maintienne dans certaines bornes, anime l’esprit, lui donne plus de facilité et plus de force pour atteindre la vérité, fait qu’il la souhaite avec plus d’ardeur, qu’il la recherche avec plus de persévérance, qu’il s’y attache avec plus d’amour. Et ailleurs[16] : Si je puis donner un conseil à ceux que j’aime, je leur dirai de ne négliger aucune des connaissances humaines. L’apôtre a dit sans doute : Prenez garde qu’on ne vous surprenne par la philosophie ; mais il veut parler de celle qui ne songe qu’aux intérêts de la terre. II y en a une autre qui se préoccupe du ciel et qui ne mérite pas d’être condamnée. Prétendre qu’on doit fuir toute philosophie, ajoute saint Augustin[17], qu’est-ce autre chose que de dire qu’il ne faut pas aimer la sagesse ? Il déclare donc qu’il est résolu à continuer de l’étudier, et il se donne la tâche, pour le reste de sa vie, de lire avec soin Platon et d’en tirer tout ce qui n’est pas contraire aux enseignements de l’Évangile[18]. Il semble donc qu’à ce moment ses desseins et ses vœux n’allaient guère au delà d’une sorte d’épuration de la sagesse antique, qui devait en faire une science chrétienne. Ce dessein, il a cherché d’abord à le réaliser. Pendant l’année qu’il passa en Italie, après son baptême, et au début de son séjour en Afrique, nous le voyons occupé d’écrire des livres de grammaire, de rhétorique, de dialectique, son traité sur la musique, et celui qu’il a intitulé : Du Maître ; c’est une sorte d’encyclopédie issue de l’enseignement des écoles. Mais sa vie prenait déjà une autre direction. Dans les dernières lettres qu’il adresse à son ami Nébridius, on sent que son ardeur pour les recherches philosophiques n’est plus la même[19]. Les livres saints, auxquels il avait tant résisté, le charmaient tous les jours davantage. En faisant connaissance avec la véritable vie monastique, il comprit ce qu’avait d’artificiel et d’incomplet pour une âme comme la sienne ce repos studieux (liberale otium) dont il avait joui à Cassisiacum. Enfin il devint prêtre, et presque aussitôt évêque ; dès lors, comme il le dit lui-même, tout entier à des devoirs plus sérieux, il laissa échapper de ses mains tous ces divertissements d’homme de lettres, omnes illæ deliciæ fugere de manibus[20]. S’ils lui échappèrent des mains, ils ne sortirent pas tout
à fait de sa mémoire. On sent bien qu’il ne les a pas oubliés, aux efforts
qu’il fait pour nous convaincre, et peut-être pour se convaincre lui-même,
qu’il n’y songe plus. En réalité tous ces souvenirs de sa jeunesse sont
restés dans un coin secret de son cœur, un peu effacés et assoupis, mais ils
se réveillent plus souvent et plus vite qu’il ne le voudrait. La mauvaise
humeur qu’il manifeste, quand on l’y ramène malgré lui, semble trahir une
sorte de méfiance de lui-même et la crainte que ce feu caché ne se ranime.
Quand Mémorius réclame de lui la fin de son traité de Voilà sa véritable pensée ; et, puisqu’il espère que les
meilleurs de ces grands personnages du passé ont été délivrés par le Christ
et qu’ils siègent à côté des bienheureux, il n’y a plus aucune raison de leur
tenir rigueur ; on peut leur tendre la main sans scrupule, invoquer leur
autorité pour la défense des vérités qu’ils ont aperçues, et mêler leur
témoignage à celui des livres saints, quand ils se trouvent d’accord
ensemble. Nous avons vu plus haut que c’est la conclusion à laquelle il
arrive dans son traité de Ce mélange était dans les habitudes et dans les idées de
saint Ambroise, comme dans celles de saint Augustin et de saint Jérôme. Ce
que conseillaient les autres, il l’a toujours fait ; et même il paraît le
faire d’une façon plus résolue qu’eux, et n’a pas connu les indécisions et
les incertitudes qu’ils ont traversées : du moins il n’en reste pas de trace
dans ses ouvrages. C’était un esprit ferme et droit, un homme de gouvernement
qui s’était formé à la grande école de l’administration de l’empire. Il se
décidait vite, et une fois qu’il avait pris son parti, il s’y tenait.
Ajoutons qu’il était de ce grand monde de Rome tout imprégné de l’ancienne
culture littéraire, et qu’il avait toujours vécu dans cette atmosphère de
civilisation et d’humanité. A des gens comme lui les auteurs classiques
étaient devenus si familiers qu’ils faisaient pour ainsi dire partie de leur
être et qu’il ne pouvait pas leur venir à l’esprit de s’en séparer. Il tenait
de ses pères le respect de l’antiquité. Comme eux, il parle avec émotion des
souvenirs de la république[25] : C’était le beau temps ; personne alors ne connaissait
cette fatuité impertinente qu’inspire un pouvoir qui dure toujours, ni cet
abaissement qui naît d’une servitude qui ne finit pas. Dans cette âme,
où le passé tenait presque autant de place que le présent, l’accord se fit de
lui-même et du premier coup. E n’y a rien de plus intéressant que de voir
avec quelle aisance les souvenirs pro-fanes et les sentiments religieux se
mêlent ensemble dans les sermons prêchés au peuple de Milan sur l’œuvre des
six jours (Hexæmeron),
et qui sont comme un tableau de la nature : c’est Quand des hommes comme saint Ambroise, saint Jérôme et saint Augustin, de grands évêques, des docteurs illustres, se trouvaient amenés à professer ces maximes et qu’ils donnaient l’exemple d’employer l’antiquité profane à établir les vérités religieuses, qu’on juge ce que des chrétiens plus tièdes, de simples laïques devaient faire. Dans ces conditions, il était naturel qu’une sorte de fusion s’accomplit entre ces éléments d’origine différente qu’on faisait servir au même dessein, est c’est ce qui ne manqua pas d’arriver. Sans doute quelques scrupules ont dû se produire encore chez les gens timorés, comme il y en avait dans les cloîtres, et qui cherchaient toujours quelque raison de se tourmenter[32]. Mais leurs plaintes ne furent pas écoutées ; et, comme elles n’allaient pas jusqu’à proscrire l’ancien système d’éducation, et que tant qu’a duré l’empire la façon d’élever la jeunesse est restée la même, on peut dire que les influences de l’école vinrent sans cesse fortifier et accroître ces éléments étrangers qui, depuis cinq siècles, ne cessent des infiltrer dans le christianisme et qu’il essayait de s’assimiler. |